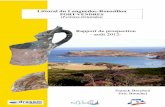Approche technologique des Moustériens Charentiens du Sud- Ouest de la France et du Languedoc...
Transcript of Approche technologique des Moustériens Charentiens du Sud- Ouest de la France et du Languedoc...
Jean-Michel GenesteJacques JaubertMichel LenoirLiliane MeignenAlain Turq
Approche technologique des Moustériens Charentiens du Sud-Ouest de la France et du Languedoc orientalIn: Paléo. N. 9,1997. pp. 101-142.
Citer ce document / Cite this document :
Geneste Jean-Michel, Jaubert Jacques, Lenoir Michel, Meignen Liliane, Turq Alain. Approche technologique des MoustériensCharentiens du Sud-Ouest de la France et du Languedoc oriental. In: Paléo. N. 9,1997. pp. 101-142.
doi : 10.3406/pal.1997.1230
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pal_1145-3370_1997_num_9_1_1230
AbstractThe boundaries of the different facies of the Charentian Mousterian defined on typological andtechnological bases are far from being obvious. For each observed criterion, the variations which havebeen primarily observed on a few selected series most often turn out to be deeply part of a continuityphenomenon that is well testified by the numerous series recovered from recent excavations. In theinstances of interest for us here, it has been possible to put forward a continuum more than adiscontinuity between the Ferrassie-type Charentian and the various typical Mousterians, on typologicalbases (scrapers ratio). On the other hand, it has often proved difficult to individualize the two CharentianMousterians, at least for some regions ; all the transition forms have been observed between the clearlyLevallois Ferrassie-type Charentian and the non-Levallois Quina-Type Charentian. F. Bordes admittedfor these reasons among others that it was more appropriate to speak of one only Quina-Ferrassiegroup and thus choosed to favour the typological likeness. Confronted to this somewhat jammedsituation, it has seemed important to consider the problem from a new viewpoint. The technologicalapproach that offers to take into account the retouch tools as well as the whole production system(methods for blank obtention) and the gestion one of these tools (selection of blanks, retouch, use,resharpening) constituted a different and more global way to consider the problem of the variability. Thepurpose of this paper is to evaluate the now available datas that have been established on these bases,in the wide region under study. The studies presented here are at different stages of completion, yet thispreliminary synthesis makes it possible to present the positive contribution of this new appoach. A greatcohesion comes out within the systems of lithic production of the Quina-type Charentian ensemblepresent in several sites as early as the Middle-Riss, around 300 000 years B.P. As for the Ferrassieensemble, it seems possible to integrate it into the variability of Mousterians that exhibit the recurrentLevallois methods of Debitage.
RésuméRésumé : Les limites des différents faciès du Moustérien charentien définis sur des bases typologiqueset technologiques sont loin d'être évidentes et le plus souvent, pour chaque critère observé, lesvariations initialement décrites sur un petit nombre de séries triées s'avèrent profondément intégrées àun phénomène de continuité largement confirmé par les nombreuses séries de fouilles récentes. Dansles cas qui nous intéressent ici, un continuum, plus qu'une discontinuité, entre le Moustérien de typeFerrassie et les Mousténens typiques a très vite été souligné, sur des bases typologiques (proportionsde racloirs). D'autre part, sur le plan du débi- tage, dans certaines régions du moins, l'individualisationdes deux Moustériens charentiens s'est souvent révélée difficile ; toutes les formes de transition ont étéobservées entre des Moustériens Ferrassie de débitage nettement Levallois et des Moustériens de typeQuina qui ne le sont pas. C'est, entre autres, sur ces bases que F. Bordes concédait qu'il étaitpréférable de parler d'un seul groupe Quina-Ferrassie, choisissant ainsi de privilégier la ressemblancetypologique. Devant cette situation quelque peu bloquée, il semblait important d'envisager le problèmesous un angle nouveau. L'approche technologique, qui se propose de prendre en compte non passeulement les outils retouchés mais plutôt l'ensemble du système de production (méthodes d'obtentiondes supports) et de gestion de ces outillages (sélection de supports, aménagement par retouche,utilisation, réaffûtage), constituait une façon différente et beaucoup plus globale d'envisager le problèmede la variabilité. Cet article se propose de faire un bilan, dans la large région considérée, des donnéesactuellement disponibles établies sur ces bases. Les études présentées n'en sont pas toutes au mêmepoint d'aboutissement mais cette première synthèse permet de montrer l'apport positif de cette nouvelleapproche. Il se dégage de l'étude une grande cohésion au sein des systèmes de production lithiques del'ensemble Charentien de type Quina qui sont présents dans plusieurs sites dès le milieu du Riss, auxalentours de 300.000 ans BP, alors que l'ensemble Ferrassie semble pouvoir être intégré dans lavariabilité des Moustériens à méthodes de débitage Levallois récurrent. La pertinence de l'entitécharentienne est donc directement remise en cause au profit de nouvelles distinctions fondées sur desinterprétations technologiques mais aussi plus largement fonctionnelles (au niveau des sites et desperspectives économiques) qui sont en cours d'élaboration. L'étude est illustrée par des donnéesprovenant des séries du sud de la France avec : 1 - le Charentien et ses origines en Périgord; 2 - laspécificité du Charentien de type Quina dans le Sud-Ouest ; 3 - les Moustériens charentiens de typeFerrassie (Charente, Lot); 4 - les Moustériens charentiens «atypiques» en Languedoc.
PALEO - N° 9 - DECEMBRE 1997 - Page 101 à 142
APPROCHE TECHNOLOGIQUE DES
MOUSTÉRIENS CHARENTIENS DU SUD-OUEST
DE LA FRANCE ET DU LANGUEDOC ORIENTAL
Jean-Michel GENESTE(1), Jacques JAUBERT'2', Michel LENOIR<3>, Liliane MEIGNEN<4>, Alain TURQ(5)
Résumé : Les limites des différents faciès du Moustérien charentien définis sur des bases typologiques et technologiques sont loin d'être évidentes et le plus souvent, pour chaque critère observé, les variations initialement décrites sur un petit nombre de séries triées s'avèrent profondément intégrées à un phénomène de continuité largement confirmé par les nombreuses séries de fouilles récentes. Dans les cas qui nous intéressent ici, un continuum, plus qu'une discontinuité, entre le Moustérien de type Ferrassie et les Mousténens typiques a très vite été souligné, sur des bases typologiques (proportions de racloirs). D'autre part, sur le plan du débi- tage, dans certaines régions du moins, l'individualisation des deux Moustériens charentiens s'est souvent révélée difficile ; toutes les formes de transition ont été observées entre des Moustériens Ferrassie de débitage nettement Levallois et des Moustériens de type Quina qui ne le sont pas. C'est, entre autres, sur ces bases que F. Bordes concédait qu'il était préférable de parler d'un seul groupe Quina-Ferrassie, choisissant ainsi de privilégier la ressemblance typologique. Devant cette situation quelque peu bloquée, il semblait important d'envisager le problème sous un angle nouveau. L'approche technologique, qui se propose de prendre en compte non pas seulement les outils retouchés mais plutôt l'ensemble du système de production (méthodes d'obtention des supports) et de gestion de ces outillages (sélection de supports, aménagement par retouche, utilisation, réaffûtage), constituait une façon différente et beaucoup plus globale d'envisager le problème de la variabilité. Cet article se propose de faire un bilan, dans la large région considérée, des données actuellement disponibles établies sur ces bases. Les études présentées n'en sont pas toutes au même point d'aboutissement mais cette première synthèse permet de montrer l'apport positif de cette nouvelle approche. Il se dégage de l'étude une grande cohésion au sein des systèmes de production lithiques de l'ensemble Charentien de type Quina qui sont présents dans plusieurs sites dès le milieu du Riss, aux alentours de 300.000 ans BP, alors que l'ensemble Ferrassie semble pouvoir être intégré dans la variabilité des Moustériens à méthodes de débitage Levallois récurrent. La pertinence de l'entité charentienne est donc directement remise en cause au profit de nouvelles distinctions fondées sur des interprétations technologiques mais aussi plus largement fonctionnelles (au niveau des sites et des perspectives économiques) qui sont en cours d'élaboration. L'étude est illustrée par des données provenant des séries du sud de la France avec : 1 - le Charentien et ses origines en Périgord; 2 - la spécificité du Charentien de type Quina dans le Sud-Ouest ; 3 - les Moustériens charentiens de type Ferrassie (Charente, Lot); 4 - les Moustériens charentiens «atypiques» en Languedoc. Mots clés : France, Moustérien, Charentien, lithique, technologie.
AVERTISSEMENT époque. Des travaux importants, plus récents, ne sont donc pas pris en compte, notamment les doctorats
Cet article a été préparé dans le cadre de la publication d'Alain Turq (1992) et de Laurence Bourguignon (1997) du colloque Les Moustériens charentiens, Brive, 26-29 qui traitent plus spécialement du Moustérien de type août 1990, et correspond à l'état des recherches à cette Quina selon l'approche ici décrite.
(1) Service régional de l'Archéologie d'Aquitaine - 54 rue Magendie - 33074 Bordeaux Cedex et UMR 9933 - CNRS- Talence
(2) Service régional de l'Archéologie de Midi-Pyrénées - 7 rue Chabanon - 31200 Toulouse et UMR 5608 - CNRS - Toulouse
(3) Institut de Préhistoire et de Géologie du Quaternaire - UMR 9933 - CNRS - Université Bordeaux I - 33405 Talence Cedex
(4) ERA 28 du C.R.A. - CNRS - Centre de Recherches Archéologiques, Sophia-Antipolis, 06560 Valbonne (5) Musée national de Préhistoire - B.P. 7- 24620 Les Eyzies de Tayac et UMR 9933 - CNRS - Talence
101
Abstract : The boundaries of the different facies of the Charentian Mousterian defined on typological and technological bases are far from being obvious. For each observed criterion, the variations which have been primarily observed on a few selected series most often turn out to be deeply part of a continuity phenomenon that is well testified by the numerous series recovered from recent excavations. In the instances of interest for us here, it has been possible to put forward a continuum more than a discontinuity between the Ferrassie-type Charentian and the various typical Mousterians, on typological bases (scrapers ratio). On the other hand, it has often proved difficult to individualize the two Charentian Mousterians, at least for some regions ; all the transition forms have been observed between the clearly Levallois Ferrassie-type Charentian and the non-Levallois Quina-Type Charentian. F. Bordes admitted for these reasons among others that it was more appropriate to speak of one only Quina-Ferrassie group and thus choosed to favour the typological likeness. Confronted to this somewhat jammed situation, it has seemed important to consider the problem from a new viewpoint. The technological approach that offers to take into account the retouch tools as well as the whole production system (methods for blank obtention) and the gestion one of these tools (selection of blanks, retouch, use, resharpening) constituted a different and more global way to consider the problem of the variability. The purpose of this paper is to evaluate the now available datas that have been established on these bases, in the wide region under study. The studies presented here are at different stages of completion, yet this preliminary synthesis makes it possible to present the positive contribution of this new appoach. A great cohesion comes out within the systems of lithic production of the Quina-type Charentian ensemble present in several sites as early as the Middle-Riss, around 300 000 years B.P. As for the Ferrassie ensemble, it seems possible to integrate it into the variability of Mousterians that exhibit the recurrent Levallois methods of Debitage.
Key-words : France, Mousterian, Charentian, lithic, technology.
Fig. 1 : Situation géographique des principaux sites mentionnés dans le texte : 1 Les Tares, 2 La Micoque, 3 Le Roc de Marsal, 4 Combe- Grenal, 5 Artenac, 6 Marillac, 7 Le Rescoundudou, 8 La Roquette, 9 Esquicho-Grapaou, 10 Brugas, 11 La Balauzière, 12 Les Chariots, 13 loton. (dessin J.-P. Lhomme). Fig. 1: Geographic location of the principal sites mentioned in the text. :
1 Les Tares, 2 La Micoque, 3 Le Roc de Marsal, 4 Combe-Grenal, 5 Artenac, 6 Marillac, 7 Le Rescoundudou, 8 La Roquette, 9 Esquicho-Grapaou, 10 Brugas, 11 La Balauzière, 12 Les Chariots, 13 loton. (drawing by J.-P. L'Homme).
INTRODUCTION
Le Moustérien charentien, malgré une apparente cohésion, est constitué d'un ensemble d'industries assez complexe du fait de l'intrication des différents paramètres contribuant à sa définition et de sa grande variabilité géographique qui a rapidement conduit à l'introduction de sous-groupes régionaux différenciés sur des bases typo-technologiques.
C'est à la suite de l'apport décisif de la classification de Bordes et Bourgon (1951, Bourgon 1957) que ce groupe a été isolé sur des bases techniques et typologiques. Le Moustérien de faciès charentais ou Charentien, dénommé ainsi en raison de son abondance en Charente, a été défini à partir de séries anciennes provenant de gisements périgourdins (La Ferrassie, l'abri des Merveilles). Par la suite, l'étude des industries de l'abri Chadourne, puis les données des fouilles effectuées à Combe- Grenal (Bordes 1972, 1984), au Roc de Marsal (Bordes et Lafille 1962, Turq 1979), à Caminade (Sonneville- Bordes 1969) et à La Ferrassie (Tuffreau in Delporte 1984) ont permis d'en préciser les caractéristiques.
Dans sa définition, le Charentien groupe deux industries moustériennes qui se distinguent des autres faciès par une forte proportion de racloirs.
- Le Moustérien de type Quina se caractérise par un débitage particulier, non Levallois, à talons lisses, dits «clactoniens». Les racloirs, outils les plus nombreux, sont fréquemment aménagés par des retouches écailleuses scalariformes dites de type «Quina». Les racloirs transversaux sont bien représentés.
102
- Le Moustérien de type Ferrassie se différencie par un débitage Levallois, par un moindre développement de la retouche Quina et une plus forte représentation des racloirs convergents (Bordes 1961, 1984). A l'issue d'un réexamen de séries classiques auxquelles sont confrontés les ensembles provenant de gisements fouillés plus récemment dans le Sud de la France (Fig. 1), la pertinence de l'entité Charentienne est remise en cause au profit de nouvelles distinctions fondées sur des interprétations technologiques voire aussi plus largement fonctionnelles qui émergent des travaux plus récents sinon encore actuellement en cours. 1 - CARACTÉRISATION TECHNOLOGIQUE DES ASSEMBLAGES LITHIQUES APPARENTÉS AU MOUSTÉRIEN DE TYPE QUINA ANTÉRIEURS AU DERNIER INTERGLACIAIRE (J.-M. G.). Dans la moyenne vallée de l'isle en Dordogne, à Sourzac, le gisement de plein air des Tares, fouillé et étudié par J.-P. Texier, a livré une abondante industrie qui est contenue dans une formation sédimentaire qui surmonte les alluvions de la nappe FW2 (Texier 1982). Elle a pu être attribuée à la fin du stade isotopique 6 sur la base d'arguments stratigraphiques et pédologiques (Bertran et Texier 1990). Cette industrie est donc contemporaine d'autres industries moustériennes antewùrmiennes sur éclats (Delpech et al. 1995) qui ne sont pas de type charentien. Ces dernières se caractérisent au contraire par un débitage Levallois (grotte Vaufrey, couche VIII par exemple, Artenac), ou par un débitage encore mal déterminé mais apparemment de type discoïde (Fontéchevade niveaux Tayaciens), mais ce sont aussi des ensembles lithiques où coexistent des pièces bifaciales et du débitage et qui sont regroupés sous le concept d'Acheuléen méridional défini par F. Bordes au Pech de l'Aze, à Combe-Grenal et à la Micoque (Bordes 1972, 1984). Il en est ainsi du Cap-de- Bielle, Hautes-Pyrénées (Clot et Marsan 1986). Mais il existe aussi des ensembles à bifaces essentiellement présents dans les formations fluviatiles comme ceux de Saint-Denis-de-Pile dans la vallée de l'isle (Moisan 1978) rapportés à la nappe FW4 par J.-P. Texier (1982). Aux Tares, le matériel des premières fouilles a été étudié par J.-Ph. Rigaud et J.-P. Texier. Cette industrie sur éclats, «malgré quelques différences que l'on peut attribuer à une spécialisation d'activités liées au mode de gisement, semble pouvoir être interprétée comme une possible origine nssienne de l'ensemble du groupe charentien» (Rigaud et Texier 1981 : 117). Le problème des origines rissiennes du Moustérien charentien était alors clairement posé de même qu'indirectement celui, plus large, de l'individualisation technologique du buissonne- ment moustérien depuis l'avant-dernière glaciation. Dans le cadre du présent colloque, un réexamen technologique approfondi de cet assemblage lithique rissien a paru justifié. Il est conduit dans la perspective de l'analyse de la chaîne opératoire de débitage et de sa comparaison avec celle des autres Moustériens charentiens
classiques qui sont essentiellement wùrmiens (Combe- Grenal, Le Roc de Marsal, Marillac).
Jusqu'à une période très récente, il était rarement précisé dans la littérature européenne quel type de débitage fournissait les supports dans les Moustériens charentiens rattachés au type Quina.
A la suite de F. Bordes et de M. Bourgon, il a été régulièrement fait référence à un débitage de type clactonien à propos de ces industries (Bourgon 1957, Bordes 1984). Cette technologie qui est assez peu définie était généralement investie d'une notion d'archaïsme puisqu'elle avait été reconnue au tout début du Paléolithique inférieur (Breuil 1932, Warren 1951, Wymer 1968).
Le plus souvent, et de plus en plus fréquemment, les auteurs décrivent un débitage «non Levallois» qui n'est donc évoqué que par défaut mais non défini. Des recherches technologiques récentes ont abordé la signification du mode de débitage dans les industries wùr- miennes charentiennes. Elles se sont attachées à déterminer les caractères technologiques spécifiques du Moustérien Quina, (Turq 1979, Lenoir 1986, Meignen 1988, par exemple). Une méthode de débitage a été mise en évidence au Roc de Marsal (Turq 1988) et généralisée à l'ensemble Quina (Turq 1989). Ce système de production «dans lequel plusieurs schémas opératoires coexistent» (Turq 1989 : 254), individualisé dans le gisement de Combe-Grenal (Lenoir et Turq dans cet article), servira de modèle de comparaison pour les modes de débitage des gisements des Tares et de La Micoque.
La comparaison avec d'autres gisements rissiens présentant des caractères technologiques voisins permettra de discuter l'existence d'un groupe d'industries aux caractéristiques morpho-techniques particulières qui aurait évolué dès le Riss dans le sens d'un aboutissement charentien. 1.1 - Caractères généraux de l'assemblage lithique du niveau 1 des Tares.
Les données rappelées ici, en préambule à l'approche technologique, concernent la structure typologique et les principaux caractères de l'assemblage lithique. Elles sont empruntées intégralement à la publication princeps de l'industrie du niveau 1 des Tares (Rigaud et Texier 1981). L'outillage est composé de racloirs, d'encoches, de den- ticulés qui représentent 85 % de l'outillage. Le reste de l'industrie est représenté par quelques grattoirs et couteaux à dos naturel. Citons quelques indices typologiques essentiels : indice de racloirs 54,11 ; indice de racloirs simples convexes 22,08 ; indice de racloirs transversaux 21,66 ; indice Quina 1,53 ; indice d'encoches et de denticulés 30,83.
La retouche habituelle des racloirs, y est décrite comme parfois plate, peu envahissante, mais pouvant être
103
Génération 1
Génération 2
"\ E2
E2
Génération 3
V V U"7
/ / / E : N : R : ER : Eclat Nucleus Retouché Eclat de retouche
Fig. 2 : Les Tares - Sourzac, Dordogne
Structure élémentaire en réseau de la chaîne opératoire de production de l'outillage en silex. La production est fondée sur un débitage d'éclats supports d'outils dont la définition et les méthodes sont indépendantes de la structure techno-économique, (dessin J.-P. Lhomme). Fig. 2 : Les Tares - Sourzac, Dordogne
Schematic representation of the reduction sequence (chaîne opératoire) of lithic tools. The production is based on the knapping of flake blanks for which the definition and methods are independent of the techno-econo- mic structure, (drawing by J.-P. L'Homme).
écailleuse, scalariforme. Elle peut être aussi bien marginale et discrète qu'irrégulière et denticulée sur certains outils.
Les caractères technologiques remarquables des produits de débitage ont d'emblée été déterminés par les auteurs : débitage au percuteur dur d'éclats courts et épais, bulbes très saillants et parfois multiples, cônes incipients, talons lisses et larges.
Les caractères qui précèdent ont donc justifié le classement de cet outillage au sein de la variabilité charentien- ne.
Par ailleurs, le niveau 1 des Tares a été distingué du Moustérien de type Quina par un indice de facettage (IF = 6,66 et IFs = 1,93) et un indice Quina très bas (1,53) ainsi qu'un équilibre entre les racloirs simples convexes et les racloirs transversaux qui est nettement différent de celui des autres Quina d'âge wùrmien.
Ces données proviennent d'une fouille restreinte ; il est certain qu'un échantillon plus représentatif pourrait mettre en évidence des caractères plus développés.
Au-delà de ces considérations, il apparaît maintenant nécessaire de définir de manière technologique ce type de débitage et de rechercher ses affinités avec d'autres débitages charentiens ou apparentés qu'ils soient wùr- miens ou antérieurs. Aux Tares, l'absence totale de méthode Levallois caractérise de prime abord le débitage. Les éclats sont le plus souvent courts et épais, l'angle d'éclatement entre la face inférieure et le talon est supérieur à 90° et généralement voisin de 100-110°. Le mode de production de ces enlèvements, qui servent de support à tout l'outillage, est particulier. Il a été rapproché du débitage clacto- nien et une comparaison possible avec l'assemblage lithique antewùrmien de High Lodge en Angleterre (Breuil 1932, Wymer 1968, Bordes 1984, Roe 1981) a été faite (Rigaud et Texier 1981 : 117). 1.2 - Chaîne opératoire de production des supports.
Comme tout système technique, le système de production d'outillage lithique et sa chaîne opératoire (Fig. 2) peuvent être définis par une structure, des objectifs, des techniques, des moyens et des méthodes de réalisation et enfin les finalités fonctionnelles de l'outillage.
104
1.2.1. Les objectifs peuvent être considérés par l'archéologue comme l'obtention d'un certain nombre de produits préférentiellement recherchés parce que ce sont les supports de la majorité des outils tels que racloirs (54,11 %), encoches et denticulés (30,83 %).
Les éclats souhaités, supports d'outils ou potentiellement outils eux-mêmes, s'ils sont bruts de débitage sont les suivants, par ordre d'importance décroissant :
- Des éclats à dos naturel cortical ou, très rarement, dépourvus de cortex. Ce sont eux qui présentent les caractéristiques morpho-techniques les plus remarquables. Ils sont plus larges que longs, dans la majorité des cas, et généralement assez épais. L'épaisseur maximale est située au niveau du talon et du dos. Leur face inférieure, au bulbe marqué, est régulièrement convexe mais parfois peu bombée. Ils possèdent par conséquent une section nettement triangulaire, peu allongée selon l'axe de débitage qui est généralement l'axe le plus court (Fig. 2, génération 1). - Des produits corticaux de type couteaux à dos naturel peuvent être produits occasionnellement ; ils sont les plus allongés de tous les produits (Fig. 2, génération 1). Une gamme de produits de ce type s'échelonne entre 80 mm et 25 mm de longueur maximale avec une moyenne
vers 50 mm. Ils supportent la majorité des racloirs simples convexes et transversaux. De tels produits correspondent à la fois aux éclats décrits comme caractéristiques du Clactonien et considérés comme représentatifs du Moustérien charentien (Bordes 1984, Meignen 1988, Turq 1988, 1989). Ils supportent de gros racloirs, des encoches, des denticulés et servent de base à des nucleus (sur éclat). La retouche de ces outils est le plus souvent écailleuse et scalariforme.
- Des éclats corticaux, d'entame ou très fortement corticaux, sont obtenus dès le début du débitage par initialisation d'un bloc de matière première dont la taille moyenne est contingentée par les ressources des formations fluviatiles étroitement locales. Leur face inférieure est rarement bombée avec bulbe proéminent (Fig. 2, génération 1), elle est souvent plate sinon légèrement convexe parfois avec deux points de percussion diamétralement opposés. Un débitage bipolaire posé sur enclume semble être attesté. Ils supportent les mêmes outils que les premiers ainsi.que des nucleus. - Des éclats sans résidu cortical sont apparentés à des produits du type des éclats Kombewa. Les véritables Kombewa (éclats Janus à bulbes strictement opposés) sont peu nombreux mais typiques. Ils sont de dimensions identiques à la moyenne de l'outillage, soit 45 mm
Fig. 3 : Les Tares - Sourzac, Dordogne
Outillage retouché sur éclat. 1-4 : racloirs sur produits variés. (Dessin J.-M. Geneste). Fig. 3 : Les Tares - Sourzac, Dordogne
Retouched tools on flake blanks. 1-4 : Scrapers on diverse supports, (drawing by J.- M. Geneste).
105
pour les plus grands et 25 mm pour les plus petits. Une grande partie de ce type de produits provient bien d'une face inférieure d'éclat mais ils ont un caractère Kombewa atténué en ce sens qu'ils portent des négatifs d'autres enlèvements. Ils se placent donc dans la chaîne opératoire après l'éclat Kombewa typique initial. Leur section est aussi triangulaire mais très symétrique et régulière. La face inférieure est peu convexe, plutôt plane. Le talon est punctiforme, linéaire, dans le cas d'enlèvements Kombewa typiques, mais il peut être nettement facetté bien que toujours peu développé. Leur morphologie est très standardisée, leur contour est ova- laire ou subtriangulaire avec une delineation du tranchant très régulièrement, ou fortement, convexe. La section du tranchant, qui est très rarement retouché et demeure donc brut de débitage avec quelques micro esquilles d'utilisation, est légèrement biconvexe donc fonctionnellement différente de celle du tranchant des racloirs qui est nettement piano-convexe (Fig. 2, génération 2 et fig. 4). - Des produits plus rares mais variés ne possèdent pas les caractères techniques des produits précédents parce qu'ils sont plus minces, à face inférieure plane ou même presque concave à bulbes parfois multiples. Leur section n'est pas triangulaire de manière aussi caricaturale que les précédents. Ces produits peuvent être plus allongés que les autres catégories. Ils sont produits au cours du débitage soit à partir des blocs soit de nucleus. Ils supportent des outils variés mais rares. - Des produits de ravivage des racloirs à retouche écailleuse scalanforme sont restés bruts ou supportent à leur tour d'autres racloirs simples convexes. 1.2.2. - Les techniques attestées sont le percuteur dur pour le débitage et le percuteur tendre pour la retouche. Le débitage se fait par une percussion violente, courte, selon une direction très pénétrante et non pas tangen- tielle comme dans d'autres débitages d'éclats. Elle est appliquée le plus souvent sur des plans de frappe tantôt larges et lisses bien dégagés, et dans ce cas elle emporte une large partie de ces derniers, tantôt plus étroits, peu aménagés. Dans certains cas, c'est une percussion lancée sur un appui solide qui détermine une fracture plane avec esquillement des deux faces ou au moins de la face inférieure de l'enlèvement. Le négatif est très spécifique , plan ou légèrement convexe, étoile voire fissuré, fracturé avec un contre-bulbe multiple. Ce débitage sur nucleus calé sur enclume, avec traces de choc et enlèvement d'esquilles sur le bord opposé au point de percussion, est assez net. Dans ce cas, les stigmates correspondent à la technique de débitage qualifiée de «bipolaire sur enclume». Cette technique est employée en cas d'obstacle majeur rencontré lors de la percussion directe lancée habituelle. Il est utilisé pour réaliser un enlèvement spécifique souhaité, entamer un bloc, surmonter une impossibilité pour la technique courante. Ce peut être le cas pour un plan de frappe impropre à une percussion efficace à l'angle de percussion trop ouvert (généralement voisin de 90° ou légèrement supérieur)
ou pour une insuffisance d'inclinaison distale de la surface de débitage.
1.2.3. - Chaîne opératoire de production des supports.
La chaîne opératoire de débitage d'éclats, bien qu'élémentaire dans son principe de récurrence, n'en est pas moins assez complexe du fait de la répétitivité de ses séquences. Sa structure est séquentielle en réseau non linéaire (Fig. 2). Sa finalité est la production d'une majorité des produits très standardisés mais peu diversifiés (2 ou 3 types), de section triangulaire, avec un dos assez épais au niveau du talon, qui sont utilisés transversalement la plupart du temps et supportent un racloir ou un denticulé sur le bord opposé au dos (outillage à son tour peu diversifié). Ces produits sont obtenus par une seule technique employée selon au moins deux procédés identifiés plus haut et selon le schéma opératoire suivant : - Phase 1 . Les blocs sont débités de manière conjecturale pour obtenir une première série (50 % environ) de grands enlèvements assez épais au bulbe proéminent et de produits à dos naturels larges et courts. Ces enlèvements assez vastes sont judicieusement orientés sur le bloc. Celui-ci peut être abandonné sans poursuite de son exploitation.
Une partie de ces éclats primaires ou enlèvements I supportera l'outillage le plus volumineux, des racloirs simples convexes pour l'essentiel à retouche Quina typique (Fig. 2, génération 1 et fig. 3 n°1). - Phase 2A. L'autre partie est l'objet d'un débitage sur sa face inférieure parfois même après réalisation et utilisation des gros racloirs Quina qui terminent leur vie fonctionnelle de cette façon. Des éclats Kombewa typiques sont d'abord obtenus puis des éclats aux caractères récurrents élémentaires. Jamais plus de cinq ou six enlèvements sont tirés d'un gros éclat primaire, le plus fréquemment deux ou trois. Ces enlèvements II supporteront 45 % de l'outillage. Une partie reste brute de retouche mais porte des traces d'utilisation, notamment les éclats Kombewa typiques. (Fig. 5) - Phase 2B. Enfin, une troisième génération de produits (enlèvements III), peu importante en nombre (5 % maximum), est obtenue de ces enlèvements secondaires qui ont toujours les mêmes caractères morpho-techniques. Ils sont difficiles à reconnaître car ce sont surtout les nucleus qui portent ces témoins négatifs mais ce procédé peut être théoriquement poursuivi encore au-delà jusqu'à épuisement de la matière (phase 2C éventuellement) (Fig. 2, génération 3). - Phase 3. Enfin, des éclats de réaménagement des pre-
106
Fig. 4 : Les Tares - Sourzac, Dordogne
1, 2 Surfaces de débitage de nucleus sur éclats. Seule la face inférieure des éclats est exploitée par une méthode de type Kombewa pouvant être suivie d'un débitage centripète. 2 Nucleus d'aspect discoïde élémentaire. (Dessin J.-M. Geneste). Fig. 4 : Les Tares - Sourzac, Dordogne
1, 2 Débitage surfaces of cores on flakes. Only the inferior surface of the flake is exploited by the Kombewa- type method, which can then be followed by centripetal flaking. 2 Elementary discoid core, (drawing by J.-M. Geneste).
miers gros outils sont produits et même retouchés en racloirs. Ce sont précisément des éclats présentant les mêmes caractères que ceux précédemment sélectionnés sur les enlèvements I, II et III qui sont à nouveau recherchés (Fig. 3 n°2 à 4).
La structure séquentielle ramifiée et en réseau de cette chaîne opératoire, dont chaque séquence est peu développée, est caractérisée par l'absence de produits prédéterminants des faces de débitage. Elle est répétitive au cours de la chaîne. La notion de récurrence, si elle existe, est rudimentaire et pas au sens d'une production récurrente sur une surface de débitage. Il n'existe aucun entretien du volume du nucleus, aucune réexploitation ni entretien des surfaces de débitage mais seulement poursuite d'un débitage sur des produits-nucléus toujours morphologiquement identiques mais de taille de plus en plus réduite jusqu'à épuisement. L'absence de récurrence au sens où elle est utilisée dans la définition du débitage Levallois (Boëda 1986), s'explique ici par la volonté de produire des enlèvements qui sont eux-mêmes des nucleus sur leur face inférieure. La convexité naturelle des faces inférieures étant alors prédéterminée par la technique de débitage (percuteur dur) et le mode d'application de la percussion qui est pénétrante et non tangentielle et qui, par conséquent, détermine des enlèvements rebroussés plus larges que longs. Ce procédé se répète aussi longtemps que possible.
Cette chaîne opératoire de débitage qui produit un type d'éclat déterminé à partir d'un bloc de forme choisie et à partir des surfaces convexes des nucleus sur éclat exploitées à partir de plans de frappe rudimentaires et localisés peut parfois reproduire les conditions d'un débitage récurrent dans le meilleur des cas. L'orientation des séries d'éclats est généralement unidirectionnelle unipolaire, à plan de frappe lisse unique. Toute la prédétermination réside ici dans les caractères morpho-techniques des enlèvements I du départ et ensuite dans la prédétermination des plans de frappe des enlèvements II sur les faces inférieures des enlèvements I. En ce sens, les enlèvements de type I et les suivants sont bien prédéterminés mais pas au sens habituel du débitage Levallois par des enlèvements les ayant précédés sur la même surface de débitage. Certains nucleus parmi les plus largement exploités, sur une seule face, présentent l'aspect de nucleus discoïdes faiblement récurrents (Fig. 4 n°1 et 2). 1.2.4. - L'outillage est associé à ces divers produits dans une proportion relative à leur abondance. Cependant, il est aussi présent sur des nucleus en fin d'exploitation, sur des produits fracturés et mal définis technologiquement et sur des éclats de reprise d'outils aux bords épais et abrupts parfois scalariformes. Cette dernière catégorie de supports est associée à de rares racloirs divers mais surtout à des encoches et des denti- culés. Une partie de l'outillage est constituée d'enlèvements aux tranchants bruts de débitage qui sont préfé-
107
rentiellement des produits de type Kombewa aux tranchants à section légèrement biconvexe (Fig. 5). 1.3 - Relations technologiques avec le débitage du Charentien de type Quina.
En se référant aux précédentes études relatives au débitage de type Quina (Meignen 1988, Turq 1989, Lenoir et Turq, cet article), il apparaît que la nature des produits- supports est bien ici identique à celle des séries Quina. Le caractère épais et de section triangulaire des supports a été retenu comme caractéristique pour les différents auteurs. Ce type de débitage que l'on peut qualifier de conjectural qui se fait en recherchant les meilleures opportunités d'enlèvements et qui n'est donc que très faiblement prédéterminé est, semble-t-il, celui qui paraît habituellement identifié dans le Quina. L'utilisation systématique de nucleus sur éclat et surtout de leurs faces inférieures avec production selon une méthode Kombewa est ici originale. L'abondance de ces produits aux Tares n'est pas comparable à celle décrite ailleurs. De même, le caractère extrêmement ramifié et répétitif d'une même séquence opératoire au cours de la chaîne opératoire, par réemploi successif d'enlèvements I et II comme nucleus, n'a pas été décrit de manière aussi
poussée dans le Charentien wûrmien (Turq 1989, Lenoir et Turq cet article).
Enfin, l'existence d'un débitage récurrent de type discoïde (Turq 1989), et surtout celle de produits Levallois (Lenoir et Turq, cet article) dans des ensembles Quina comme au Roc de Marsal et à Combe-Grenal nous parait poser de sérieux problèmes de coexistence technologique qu'il faudra expliciter. Ces derniers sont susceptibles d'être caractéristiques du seul Quina wùr- mien. 1.4 - Parenté technologique avec les autres assemblages du paléolithique moyen antérieurs au dernier interglaciaire 1.4.1. - Les Tares
Le débitage des Tares est remarquablement systématisé et structuré bien que la récurrence du débitage sur une même surface soit occasionnelle. A sa place, un autre principe est fondé sur la reproduction d'une surface nouvelle de débitage à partir des convexités naturelles de faces inférieures d'éclats initiaux. La productivité peut sembler moindre mais cette méthode permet d'obtenir
Fig. 5 : Les Tares, Sourzac, Dordogne, Fouilles J.-P. Texier. 1
-4 Produits de débitage utilisés sans retouche et obtenus aux différentes étapes d'une méthode Kombewa. (Dessin J.-M. Geneste).
Fig. 5 : Les Tares, Sourzac, Dordogne, Fouilles J.-P. Texier. 1-4 Débitage products used without retouch and obtained at different stages of a Kombewa method (Drawing by J.-M. Geneste).
108
Fig. 6 : La Micoque, Les Eyzies, Dordogne, Fouilles A. Debenath etJ.-Ph. Rigaud - Couche 3 ; niveau E base. 1-5 Outillage retouché sur éclat. (Dessin J.-M. Geneste).
Fig. 6 : La Micoque, Les Eyzies, Dordogne, Fouilles A. Debenath etJ.-Ph. Rigaud - Couche 3 ; niveau E base. 1-5. Retouched tools on flake blanks, (drawing by J.-M. Geneste).
rapidement, par un substitut efficace, des convexités régulières et nombreuses.
Les nucleus sont donc nombreux, ce qui compense leur faible productivité. Les convexités des faces inférieures d'éclats autorisent la production de tranchants à section biconvexe idéale. On peut se demander si le choix fait ici n'est pas fonctionnellement prédéterminé. Si un tranchant brut de débitage, destiné à couper des tissus carnés mous, par exemple, était souhaité, l'adaptation du procédé est remarquable. D'ailleurs, la remise en forme des surfaces de débitage n'est pas nécessaire ici puisque les enlèvements souhaités doivent être courts. La disposition unidirectionnelle, et plus rarement multidirectionnelle, des séries d'enlèvements sur une surface de débitage paraît donc, elle aussi, logique de ce point de vue.
Parmi les autres particularités que nous sommes à même de souligner, citons la rareté des accidents de débitage de type Siret, la faible importance de la retouche qui, dans le Quina, transforme intensément le support et surtout, un recours plus systématique, comme s'il était accentué ici, au «recyclage» de divers produits
en nucleus sur éclats, une maintenance particulièrement intense des vastes racloirs Quina par des réfections volumineuses du front de retouche Quina au percuteur dur qui sont utilisées à leur tour dans le système. Et, enfin, l'utilisation originale d'une percussion dure sur enclume ou calage ferme du nucleus. 1.4.2.- La Micoque
Au sein des industries Quina, l'équilibre typologique tend à individualiser comme un groupe à part les industries de la couche 3 de La Micoque et celle des Tares. Cette observation, faite dès 1979 par Rigaud et Texier, peut être étayée ici par l'apport des nouvelles fouilles de La Micoque, reprises en 1986, par une équipe pluridisciplinaire à l'initiative de A. Debenath et J.-Ph. Rigaud. Cette remarque fait suite aux observations de D. Peyrony et de M. Bourgon qui avait auparavant classé cet ensemble ainsi que la couche 4 du même gisement dans un Proto- Moustérien à affinités charentiennes, tout en le séparant de la couche 2 prise comme modèle du Charentien (Bourgon 1957, Bordes 1984). F. Bordes devait préciser que l'on pouvait y voir «un Moustérien primitif ayant quelques rapports avec le type Quina» (Bordes 1984). En se référant seulement à l'industrie du niveau terreux
109
gris-verdâtre de la couche 3 (couche E d'après Laville 1975), le débitage peut y être, comme aux Tares, subdivisé en deux stades. Le premier permet la production d'enlèvements I, les plus nombreux, corticaux, non récurrents, le second produisant des enlèvements II, éventuellement récurrents, parfois d'allure Kombewa. Ils sont toujours épais et portent des outils à retouche très écailleuse nettement scalariforme et parfois surélevée (Fig. 6). On peut reconnaître à cette période nssienne, sans doute voisine sinon antérieure à 300 000 B.P., un stade évolutif du débitage d'éclats où se met en place la notion de récurrence sur une même surface de débitage avec entretien de celle-ci par des procédés techniques variés et une gamme de produits prédéterminants susceptibles de conduire au débitage discoïde et au débitage Levallois. Le débitage y est en partie du même type que celui décrit au Tares. L'équilibre typologique de l'outillage est celui d'un Moustérien Quina avec seulement 43 % de racloirs. Dans cet ensemble lithique de la couche 3 de La Micoque, une partie des nucleus abandonnés à différents états de leur exploitation nous informent particulièrement bien sur les aptitudes technologiques de leurs réalisateurs. Ils montrent un stade d'initialisation des nucleus avec des enlèvements non récurrents, unidirectionnels, unipolaires et profonds (rebroussés), peu nombreux et parallèles (1, 2 ou 3) à partir d'un plan de frappe lisse, unique et naturel la plupart du temps (Geneste in Delpech étal. 1995). Ensuite, une série d'enlèvements prédéterminants peuvent très occasionnellement réaménager cette surface pour une série récurrente élémentaire et mal maîtrisée (produits fréquemment accidentés). Une partie de la production se fait à partir de gros enlèvements primaires par exploitation unidirectionnelle et unipolaire de leur face inférieure pouvant à son tour être conduite jusqu'à une récurrence pluridirectionnelle. Ce schéma opératoire complet inclut donc potentiellement celui des Tares. Ce dernier n'est donc, à notre avis, que le reflet partiel des potentialités technologiques du groupe qui l'a utilisé aux Tares dans un cadre fonctionnel très contraignant ou peu diversifié alors qu'à La Micoque celui-ci était beaucoup plus polymorphe. Un certain nombre d'indices évoqués plus haut semble en effet permettre de considérer que, aux Tares, les capacités conceptuelles mises en jeu relèvent d'un registre plus étendu que celui attesté par la seule production locale. Comme c'est bien souvent le cas en technologie, l'évaluation du niveau de compétence technique d'un groupe humain ne peut être déterminé que dans son cadre environnemental et fonctionnel et en prenant en considération des données relatives à tous les domaines des activités techniques.
D'autres industries, comme celle de High Lodge dans le sud de l'Angleterre (Breuil 1932, Wymer 1968, Bordes 1984, Roe 1981), de Baume-Bonne (couche D) en Provence (de Lumley 1969), de Fontéchevade (G. Henri- Martin 1957) de la Caune de l'Arago, Pyrénées- Orientales (de Lumley 1971), de Cova Negra, Valence
(Espagne) (Villaverde-Bonilla 1984), de Venosa Terranera, niveau inférieur, de Valle Guimentina (Italie) (Radmilli 1965) et de Kiik Koba, Crimée (U.R.S.S.) (Klein 1965) semblent posséder des affinités technologiques dans leur débitage, souvent décrit comme clactonien, bien que puissent leur être associés d'autres types de chaînes opératoires soit de débitage discoïdes soit bifa- ciales par exemple, et des outils particuliers. A ce titre, leur place dans la genèse antewûrmienne du débitage des industries sur éclats de la famille charentienne ne peut être exclue (de Lumley 1969 : 258, Rigaud et Texier 1981 : 117, Roe 1981 : 238), mais en l'attente de définition technologique appropriée, ne peut être considérée que comme une hypothèse de recherche. 1.5 - Perspectives diachroniques
L'industrie lithique des Tares bien que très spécifique et très élaborée présente un type de schéma opératoire qui porte déjà tous les éléments qui sont identifiables dans le Charentien Quina wùrmien. Il est peut-être fonction- nellement adapté à la spécificité du site lui-même. Malheureusement, le matériel archéologique autre que lithique est mal conservé et ne permettra pas d'étayer des hypothèses concernant l'exploitation du milieu animal. Cet ensemble lithique est à rapprocher de celui de la couche 3 de La Micoque qui présente lui aussi, bien que plus ancien, un système de débitage (Delpech et al. 1995) où se retrouvent les mêmes tendances mais plus riches de potentialités évolutives. A La Micoque, ce type d'industrie est interstratifié dans un ensemble d'acheu- léen «méridional» à débitage d'éclats et à production bifaciale, ce qui le place diachroniquement dans une variabilité buissonnante déjà évidente au milieu du Riss.
Bien que les relations des systèmes de débitage d'éclats du Paléolithique inférieur et moyen soient à analyser technologiquement dans le détail afin de préciser leurs relations synchroniques, le regroupement des systèmes techniques de production lithique des Tares et de La Micoque, couche 3, dans la même lignée évolutive que ceux du Charentien de type Quina s'impose ici. D'autres sites du Sud de la France évoqués plus haut présentent aussi les mêmes affinités techniques.
Cette lignée évolutive regroupe de manière abstraite des systèmes techniques analogues qui au cours d'une période de près de 300.000 ans ont pu émerger de manière aléatoire lorsque les conditions favorables à leur apparition se sont concrétisées en divers points géographiques de l'Europe Occidentale. Cette récurrence dans l'apparition n'implique nullement un facteur traditionnel et culturel dans la continuité de cette lignée même si chacun de ces systèmes était bien la conséquence d'une tradition technique puisque l'homme n'invente rien à partir de rien. Il est nécessaire de distinguer l'apparition récurrente tout au long d'épaisses tranches de temps de phénomènes plus strictement liés au rôle de
110
traditions techniques mais dans des contextes spatiotemporels plus cohérents et minces qui n'existent pas aux périodes considérées. Ainsi, la fréquence de systèmes techniques apparentés au Moustérien de type Quina, au cours de la période wùrmienne aux alentours de 70.000-50.000 BP, pourrait être interprétée comme la généralisation dans le sud de la France d'un courant de traditions techniques lié à des facteurs démographiques, sociaux et culturels. 2 - SPÉCIFICITÉ DU CHARENTIEN DE TYPE QUINA DANS LE SUD OUEST (M. L, A. T., L. M.) Distingué par F. Bordes et M. Bourgon (Bordes 1953, Bourgon 1957), le Moustérien de faciès charentais ou Charentien, dénommé ainsi en raison de son abondance en Charente, a été défini à partir de séries anciennes provenant de gisements péngourdins : La Ferrassie, l'abri des Merveilles. Par la suite, l'étude des industries de l'abri Chadoume, puis les données des fouilles effectuées par F. Bordes à Combe-Grenal (Bordes 1972, 1984), J. Lafille au Roc de Marsal (Bordes et Lafille 1962, Turq 1979), D. de Sonneville-Bordes à Caminade (Sonneville-Bordes 1969) et H. Delporte à La Ferrassie (Tuffreau 1 984) ont permis d'en préciser les caractéristiques. L'étude de 16 ensembles lithiques de Moustérien Quina (7 au Roc de Marsal et 9 à Combe-Grenal) et 5 de Moustérien de type Ferrassie (tous provenant de Combe-Grenal), a permis de préciser les caractéristiques, les variabilités, les relations et les limites de ces deux groupes moustériens. 2.1 - Le gisement de Combe-Grenal (couche 22), Domme, Dordogne Le gisement, situé à l'est de Domme, occupe un abri sous roche qui s'ouvre dans le petit vallon de Combe- Grenal, voie de passage entre la vallée de la Dordogne et le plateau de Bord. Lors de ses fouilles F. Bordes avait pour but initial d'établir une stratigraphie du remplissage et de récolter un mobilier lithique représentatif pour chacun des niveaux. L'opération a donc consisté d'abord à une rectification des coupes suivie par une fouille limitée. L'échantillon ainsi recueilli est très variable d'une couche à l'autre tant au point de vue de la surface fouillée que de celui du nombre de pièces recueillies : de 1 à 2 m2 à plus d'une dizaine, de moins de 100 pièces à plusieurs milliers. Le gisement a fait l'objet de nombreuses études pluridisciplinaires. Plusieurs travaux (Laville et al. 1983, 1986, Guadelli et Laville 1990) ont permis de replacer cette séquence dans la chronologie isotopique et d'établir des corrélations avec les grandes séquences polliniques. Les couches 64 à 56 renfermant de l'Acheuléen correspondent au stade isotopique 6. Le reste de la séquence renfermant du Moustérien est attribué pour les couches 55 à 53 au stade isotopique 5d, les couches 53 à 43 au stade 5c, la couche 42 au stade 5b, les couches 41 à 36
au stade 5a, les couches 35 à 22 au stade isotopique 4 et les couches 21 à 1 au stade isotopique 3. 2.1.1 - Les matières premières exploitées
Pour le Moustérien de type Quina, nous prendrons comme exemple la couche 22. Elle a livré 5518 objets parmi lesquels 948 outils retouchés. Les matières premières lithiques utilisées sont d'origine locale. Ce sont :
- Les silex du Sénonien blond et gris (47%) qui se trouvent en abondance dans un rayon inférieur à 1 ou 2 km dans plusieurs types de formations : falaises calcaires, éboulis de pente, alluvions de la Dordogne, altérites qui couronnent les reliefs. Ils se présentent sous la forme de rognons ou de galets ; - Les silex lacustres tertiaires (44%) se rencontrent en abondance à un kilomètre au sud-sud-est en périphérie mais aussi sur tout le plateau de Bord. Il s'agit de plaquettes et de congélifracts issus de la dalle de calcaire oligocène meuliérisé ; - Des galets de quartz (1%), de silex jurassiques (3%), tertiaires de la bordure du Massif central ou divers (2%) provenant des alluvions.
A cela il convient de rajouter quelques silex allochtones: - Les silex en plaquette du Portlandien final, 9 km vers le sud-ouest (0,7%) ; - Le silex du Fumélois (0,3%) ; - Le silex du Bergeracois (3%). 2.1.2 - Les pièces-supports
Les types de supports recherchés sont des éclats de morphologie particulière : ils sont courts, épais, l'épaisseur maximum étant généralement opposée au bord tranchant le plus long, ce qui leur donne une section de forme triangulaire (proche du triangle rectangle) (Turq 1989). Ils représentent 62 % des éclats. Ce ont par ordre de fréquence : les éclats à dos naturel 21 % (Fig. 7 n° 10), les éclats à talon épais 16 % (Fig. 7, n° 3 et 4), les éclats à dos brut de débitage 1 0 %, les éclats à dos naturel enveloppant 8 % (Fig. 7 n° 8 et 9), les éclats à talon dactonien (6 %) auxquels il convient de rajouter près de 1 % d'éclats en tranche de saucisson chiffre minimum en raison de la difficulté de reconnaître ces supports lorsqu'ils ont été transformés en outils. Outre ces types de supports spécifiques, il convient de remarquer le nombre important d'éclats corticaux (cortex supérieur à 50 %) qui représente 9 % (Fig. 7 n° 5). Les éclats Levallois comme les éclats plats à préparation centripètes sont rares, respectivement 1 ,5 % et 3 %. Les quelques éclats morphologiquement Levallois ne sont pas en nombre suffisant pour attester la présence d'une chaîne opératoire Levallois. Les bulbes de percussion sont très marqués, parfois multiples, le nombre de fracture Siret (un peu plus de
111
Fig. 7 : Combe-Grenal, Domme, Dordogne, Fouilles F. Bordes - Moustérien de type Quina (n° 2 à 10 couche 22, n° 1 couche 23) .
1, 2 Éclat de retouche de racloir Quina. 3, 4 Racloir transversal de type Quina sur éclat à talon épais. 5 Racloir transversal Quina sur éclat cortical. 6 Racloir déjeté sur éclat à talon épais. 7 Éclat Kombewa à talon lisse épais. 8, 9 Racloir transversal très réaffûté, sur éclat à dos cortical enveloppant. 10 Denticulé sur éclat à dos cortical. (Dessin M. Lenoir).
Fig. 7 : Combe-Grenal, Domme, Dordogne, Fouilles F. Bordes - Quina Mousterian (2 to 10 level 22, 1 level 23). 1,2 Retouch flake of a Quina scraper. 3, 4 Transverse Quina scraper on a flake with a thick butt. 5 Transverse Quina scraper on a cortical flake. 6 Déjeté scraper on a flake with a thick butt. 7 Kombewa flake with a thick, plain butt. 8, 9 Heavily resharpened transverse scraper on a cortically backed flake. 10 Denticulate on a cortically backed flake. (Drawing by M. Lenoir).
2%), la présence sur les talons de cônes incipients, attestent de l'utilisation du percuteur dur.
Les plans de frappe sont peu facettés par retouche (IF = 30,9 et IFs = 21). Les talons sont lisses mais souvent inclinés, c'est à dire avec un angle d'éclatement entre la face inférieure et le talon supérieur à 110°. 2.1.3- Les nucleus
Les nucleus sont au nombre de 169. Ils sont de petite taille, abandonnés lorsqu'ils n'étaient plus en mesure de fournir des éclats assez grands pour être transformés en outils (autour de 5 à 6 cm). Environ 42 % d'entre eux sont, au moment de leur abandon, informes ou fragmentés en raison de diaclases souvent présentes notamment dans le silex lacustre, les accidents de taille et leur fracturation volontaire. En effet sur de nombreuses pièces on observe plusieurs cônes incipients soit au centre des nucleus soit à proximité de la fracture. Notons que 2 % des outils ont été fabriqués sur ce type de support.
Les autres permettent une approche plus approfondie. L'une de leurs caractéristiques est la présence assez fréquente de larges plages corticales. Ils peuvent se répartir en 4 catégories : - les plus simples (10 %) sont des nucleus à un plan de frappe le plus souvent dégagé par un ou deux enlèvements ou qui utilise un plan de fracture (clivage naturel
de la roche) voire un pan cortical. A partir de celui-ci ont été détachés 3 à 4 éclats généralement courts et épais, le plus souvent parallèles parfois convergents ou totalement ou en partie superposés qui dans certains cas rebroussent ; - les plus fréquents sont les nucleus à enlèvements mul- tidirectionnels (60 %). Ils n'ont pas de morphologie précise et sont le plus souvent informes, globuleux, inclassables. Par contre le débitage est organisé. Il consiste en un changement fréquent de plan de frappe, avec de plans successifs la plupart du temps grossièrement perpendiculaires les uns par rapport aux autres. Ainsi, après la première séquence de production (ici souvent à partir d'un plan de frappe naturel) un nouveau plan de frappe est utilisé pour l'exploitation d'une nouvelle surface ; il peut également s'agir d'un pan naturel ou de l'empreinte des derniers éclats enlevés. Le débitage a été conduit selon ce modèle, de façon opportuniste jusqu'à l'abandon du nucleus. Lorsque les plans de frappe périphériques ne sont plus exploitables, le nucleus est fréquemment fracturé ce qui crée un nouveau plan de frappe et permet parfois la poursuite du débitage - les nucleus sur éclats sont nombreux (27 %). Le débitage s'organise autour de la surface de détachement de l'éclat selon qu'elle serve de plan de frappe comme la production d'éclats à talon de type clactonien, ou qu'elle soit utilisée comme surface de débitage préférentielle avec production de quelques éclats Kombewa puis débi-
112
Fig. 8 : Combe-Grenal, Domme, Dordogne, Fouilles F. Bordes - Moustérien de type Quina (couche 22). 1, 2 Nucleus à enlèvements multidirectionels. 2, 3 Nucleus sur éclat. 4 Nucleus à surface préférentielle de débitage (Les gros points correspondent à la surface inférieure de l'éclat transformé en nucleus.).
Fig. 8 : Combe-Grenal, Domme, Dordogne, Fouilles F. Bordes - Quina Mousterian (level 22). 1, 2 Core with multidirectional removals. 2, 3 Cores on flakes. 4 Core with a preferential flaking surface (the points correspond to the inferior surface of the flake transformed into a core).
tage tendant parfois au centripète (Fig. 8 n° 3). Si l'éclat initial est très épais on peut observer une tendance conduisant à des nucleus de type multidirectionnel (Fig. 8). De grands éclats corticaux et de grands éclats en tranche de saucisson ont pu être ainsi utilisés comme nucleus. - les nucleus à surface préférentielle de débitage (2 %), dont certains ont peut-être été faits sur éclats sont souvent à culot cortical. Ils ont permis la production de quelques enlèvements centripètes épais sans mise en place de plan de frappe sur toute leur périphérie.
S'y ajoutent quelques nucleus (2 %) qui sont d'anciens outils recyclés.
L'utilisation d'un percuteur dur et la volonté d'obtenir des talons épais, laisse des négatifs très concaves et il est donc parfois nécessaire d'enlever quelques éclats de rattrapage de la surface de débitage épais, laminaires ou pointus et de section proche du triangle isocèle.
2.1.4 -L'outillage.
Le pourcentage d'outils est très élevé (près de 35 %).
Les supports spécifiques montrent des taux de transformation nettement supérieurs, 61 % pour les éclats à talon clactonien, 57 % pour les éclats à dos naturel enveloppant, 52 % pour les éclats à dos naturel, 50 % pour les éclats en tranche de saucisson et 40 % pour les éclats corticaux et les éclats à dos brut de débitage. Les supports laissés bruts ont des dimensions nettement inférieures à celle des outils. Au sein de l'outillage, les racloirs largement dominants (IR = 56,9 % et IRess = 66,8 %) et souvent à retouche Quina (IQ = 20 %) sont essentiellement représentés par les formes convexes, avec surtout des racloirs latéraux puis des transversaux, alors que les limaces (0,2 %) (6) et les racloirs à retouche biface (0,5 %), pièces considérées comme caractéristiques de ce Moustérien sont rares. Les supports différent selon les types (Fig. 9). Ainsi les éclats à talon à dos ou talon clactonien ont été particulièrement utilisés pour la fabrication des racloirs transversaux (31 %) tandis que les éclats à dos cortical enveloppant (6 %) ou non (27,5 %) et à dos brut de débitage (1 3 %) ont été préférés pour les racloirs latéraux. Les éclats corticaux sont fréquents parmi les racloirs latéraux, doubles (14 %) et convergents (23,5 %). Pour ces deux dernières catégories il convient de préciser que l'intensité
(6) Pourcentage calculé sur la totalité des outils.
113
de la retouche rend souvent difficile l'identification du support. Les encoches et denticulés, le plus souvent obtenus par des encoches clactoniennes (Ici = 35 %), ont été fréquemment réalisés comme dans la plupart des Moustériens, sur les nucleus et les déchets de taille (éclats de retouche, fragments) (32 %). Les réaffûtages sont assez fréquents et attestés par la présence d'éclats caractéristiques (Fig. 7, n° 1, 2) (Lenoir 1986, Meignen 1988) et de racloirs à encoches (Turq 1988). Ils montrent la transformation possible d'un racloir en un denticulé. En revanche l'étude des types de supports en fonction des types de racloirs ne permet que rarement d'envisager le passage d'un type à un autre. L'utilisation fréquente de deux méthodes de transformation, la retouche scalariforme et l'encoche clactonienne qui modifie profondément le support, donne une idée d'une industrie où le recyclage des outils, des sous-produits du débitage et de certains accidents de taille sont fréquents. 1 pourcentage calculé sur la totalité des outils.
Ainsi en témoigne le taux de transformation des cassons (24 %) celui des supports non identifiables (6 %) des accidents Siret (20 %) et de quelques éclats de réaffûtage de racloir (3 %) (Fig. 7 n° 1 et 2) et des nucleus (10 %) souvent après leur fracturation accidentelle ou
taire. A cela il convient d'ajouter le pourcentage relativement élevé des outils composites. Ces caractéristiques jointes au bord bien arqué de certains racloirs passant progressivement au grattoir, donnent un style particulier à cette industrie.
2.1.5 - La chaîne opératoire (Fig. 9)
Les matières premières lithiques ont été récoltées dans l'environnement immédiat du site. Les blocs n'ont pas été décortiqués avant d'être introduits sur le site. Le débitage a d'abord mis en oeuvre le détachement d'une courte série d'éclats à plages corticales plus ou moins importantes, ou d'éclats à dos naturel de types variés à partir d'une zone corticale, d'un pan naturel ou d'un plan de frappe sommairement préparé par un ou deux enlèvements. La phase de production a commencé sans décorticage. Sur le bloc initial elle s'est poursuivie toujours selon le même rythme, par la succession de brèves séries de 3 à 5 éclats (séries élémentaires), courts épais à section triangulaire détachés à partir d'un plan de frappe unique avec entre chacune d'elles, changement de plan de frappe utilisant parfois les négatifs des derniers enlèvements. Le plus souvent les plans de frappe sont grossièrement perpendiculaires les uns par rapport aux autres. Dans ce cas il n'existe pas de surface préférentielle de débitage. Font exception à cette règle les rares nucleus à enlèvements centripètes et les nucleus sur éclat dont la surface inférieure du support initial a été utilisée comme surface de débitage. Par le biais des
Fig. 9 : Chaîne opératoire de débitage et de production des outils dans le Moustérien de type Quina. Fig. 9 : Reduction sequence (chaîne opératoire) of débitage and tool production in the Quina Mousterian.
debitage sur éclat clats initiaux grands cl épais eclats corticaux eclats en tranches de saucisson" eclats a dos naturel
114
nucleus sur éclats nous avons abordé l'une des caractéristiques du Moustérien de type Quina : le recyclage, ou buissonnement des modes de production et de transformation. A partir du débitage d'un bloc conduit de manière opportuniste selon une méthode simple, s'organise la succession de courtes séries élémentaires : - Production de nouveaux supports à partir d'éclats que nous appellerons initiaux. Selon l'utilisation faite de leur face inférieure, ont été obtenus soit des éclats Kombewa (utilisation comme surface préférentielle de débitage) soit des éclats à talon clactonien (utilisation comme plan de frappe). Si l'éclat initial est très grand et épais il peut permettre alors un débitage identique à celui effectué sur le bloc dont il est lui-même issu. - Transformation en outils d'une partie des nucleus, des accidents de taille, des déchets de taille et de réaffûtage des racloirs. Les outils retouchés sont recyclés et peuvent changer de type - racloir passant au denticulé - avant d'être abandonnés. Les observations concernant la couche 22 de Combe- Grenal s'appliquent aux autres couches de Moustérien de type Quina de ce site ainsi qu'à celles du gisement du Roc de Marsal. Dans ces deux séquences on observe de bas en haut une diminution du pourcentage de racloirs parallèlement à une augmentation du pourcentage des encoches et denticulés surtout de type clactonien (Turq 1979). Ce dernier point, qui n'est pas sans rappeler une technique de réaffûtage des racloirs, pose le problème de l'interprétation de cette observation et de la diagnose concernant le Moustérien à denticulés de la couche 20 de Combe-Grenal (comprise entre deux niveaux de Quina). Bien que cet ensemble présente toutes les spécificités du débitage Quina, on ne peut totalement exclure l'hypothèse d'un mélange.
En Aquitaine, il existe quelques séries de Moustérien de type Quina de plein air, toutes issues de ramassages de surface. Mis à part Chinchon (Sireix et Bordes 1972), les autres, provenant du Lot-et-Garonne (Baillard, Métayer, Loubès-Bemac, Estelet-Bulit), possèdent des bifaces et des éclats Levallois. Elles ne peuvent être retenues car elles sont probablement mélangées avec du Moustérien de tradition Acheuléenne. En Périgord, le Moustérien de type Quina montre une grande homogénéité, en grande partie due à la spécificité de son débitage. 2.2 - Le gisement de Mari Mac, Charente
Le site de Marillac constitue le meilleur exemple de Charentien de type Quina fouillé et étudié relativement récemment dans la région des Charentes où, par ailleurs, ou bien les collections de fouilles sont anciennes et malheureusement souvent très partiellement publiées, ou bien les séries sont pauvres. J.-M. Le Tensorer (1979, 1981) avait mis en évidence dans cette région, sur des
bases typologiques, une variabilité par rapport aux sites voisins du Périgord (Combe-Grenal, en particulier). Il nous a paru intéressant, dans une série où tout le matériel a été conservé, de comparer les données concernant les schémas opératoires avec celles obtenues justement à Combe-Grenal. Le gisement de Marillac (Charentes) est constitué d'un large aven peu profond dans lequel s'ouvre un abri prolongé par une galerie. Il comprend une série d'occupations dont deux niveaux plus riches, les couches 9 et 10, ont pu être étudiés (Meignen et Vandermeersch, 1987 ; Meignen, 1988). L'occupation, cependant, n'est jamais très importante et le matériel lithique reste peu abondant. Deux points principaux seront abordés successivement dans ce gisement : les caractéristiques générales de la chaîne opératoire qui en font un Charentien de type Quina, puis un trait particulier de l'économie (la gestion) des matières premières nous permettra de décrire l'une des séquences opératoires particulièrement développée dans les Charentiens de type Quina, la séquence de ravivage. 2.2.1 - Pièces supports
Dans les 2 couches (9 et 10), tout à fait comparables, la chaîne opératoire est clairement orientée vers la production de supports, secondairement retouchés ou non, qui sont des éclats courts, épais à talons lisses et larges, inclinés. L'angle d'éclatement entre la face inférieure et le talon est généralement supérieur à 110°. Ces supports comportent fréquemment un dos (cortical souvent, parfois brut de débitage) opposé au tranchant le plus long - ce qui leur donne la section triangulaire caractéristique décrite précédemment à Combe-Grenal. Les bulbes de percussion sont très prononcés, attestant, entre autre élément, l'utilisation du percuteur dur. La présence de cortex est remarquable, sous forme d'éclats à dos corticaux, à dos enveloppant, à talon-dos et aussi d'éclats corticaux d'entame ou largement corticaux qui sont obtenus principalement au début de l'exploitation des rognons. Dans tous les cas, les produits laminaires sont rares ; le débitage Levallois insignifiant. 2.2.2 - Nucleus
Les nucleus sont peu abondants, tous en silex local du Jurassique moyen (sauf un, très petit, exploité de façon exhaustive, en silex allochtone). Ils sont établis sur rognons souvent fracturés (nombreuses diaclases dans la matière première), plus rarement sur gros éclat cortical. Ils sont peu élaborés, ne comportent que la trace de quelques enlèvements et ne semblent pas montrer de mise en forme particulière. Ils conservent presque tous encore de larges zones corticales, ce qui indique bien que, dans ces cas là, la production de supports corticaux est possible tout au long de l'exploitation du bloc. Il ne semble pas y avoir de phase de mise en forme ou d'épannelage du bloc. L'une des morphologies fréquente est le «culot» de rognon, sur lequel une série d'enlèvements, unipolaires le plus souvent, parallèles ou
115
convergents, ont été aménagés ; ces enlèvements courts montrent des contre-bulbes profonds et sont parfois réfléchis. Les plans de frappe sont souvent naturels (corticaux ou plan de fracture de diaclase) ou sommairement aménagés par un large enlèvement. Dans le cas de quelques blocs d'exploitation multidirectionnelle, il est clair que les empreintes des éclats précédents ont été utilisées comme plan de frappe pour les enlèvements suivants. Une série de trois nucleus montre cependant une surface de débitage préférentielle de laquelle sont sortis quelques enlèvements de direction plus ou moins centripète, sans qu'il y ait un aménagement systématique des plans de frappe sur toute la périphérie (aménagements très localisés). Il semble donc que la chaîne de production de supports corresponde à un débitage plutôt conjectural, pour autant que l'on puisse en juger sur ces quelques nucleus, utilisant au maximum la présence de cortex pour produire les supports corticaux recherchés jusqu'à la fin de la séquence d'exploitation. Le trait le plus significatif semble être l'absence de mise en forme notable du bloc. La systématisation des éclats comme support de nucleus ne semble pas être de règle. 2.2.3 - Outillage retouché (Fig. 10) La proportion de supports transformés en outil est
vement forte (23 % en couche 9 ; 25,9 % en couche 10). Cet élément est beaucoup plus flagrant dans la série d'objets en silex importé (85,2 % en couche 10, par exemple, nous le verrons plus loin.). Les racloirs sont les outils les plus fréquents (IRess = 69,6 en couche 9 ; = 52,9 en couche 10), avec un développement remarquable de la retouche écailleuse scalariforme typique. (Indices Quina proches de 50). Les supports choisis pour aménager les racloirs comportent très souvent un dos, cortical ou brut de débitage. Ces outillages sont également marqués par un fort développement des racloirs transversaux, plus spécialement en couche 9 (35,2 % des racloirs) où ils atteignent le même taux que les racloirs simples convexes. Cet élément illustre parfaitement l'adéquation «production de supports courts/ larges- production d'outils transversaux», déjà signalée par F. Bordes (1972) et illustrée encore plus récemment par H. Dibble dans d'autres outillages que le Charentien. (Dibble, à paraître). Par contre, les pièces convergentes sont rares. Contrairement à ce qui a pu être mis en évidence dans d'autres sites de Charente, comme à La Quina par exemple, aucun outil de type «racloir à retouches bifaces-tranchoirs» n'a été découvert ici, pas plus que de limaces. Ces outils, considérés comme caractéristiques du Charentien Quina sont également
Fig. 10 : Gisement de Marillac, Charente, - couches 9 et 10, Charentien. 1 Racloir transversal à front abrupt. 2 Éclat de ravivage d'outil Quina recyclé en racloir. 3 Denticulé convergent. 4, Racloir double sur éclat épais. 5 et 6 Racloirs tranversaux surproduits corticaux.
Fig. 10 : Gisement de Marillac, Charente, - levels 9 and 10. 1 Transverse scraper with a steeply retouched edge. 2 Rejuvenation flake of a Quina tool recycled into a scraper. 3 Convergent denticulate. 4 Double scraper on flake. 5-6 Tranverse scrapers on cortical flakes and Quina retouch.
116
exceptionnels en Périgord, nous l'avons vu. Il paraît donc difficile de définir l'existence de «provinces culturelles» sur ce genre de critère, puisque sur quelques séries existants en Charente, les industries de Marillac constituent déjà une exception.
Les outillages aménagés par coches clactoniennes (becs, encoches et denticulés) sont présents en quantité non négligeable (IVess élargi = 24,5 en couche 9 ; = 27,9 en couche 10) et le point le plus intéressant est qu'ils sont fabriqués sur des débris ou des éclats épais diacla- sés, presque toujours sur le silex local, de mauvaise qualité. Un caractère opportuniste apparaît donc clairement dans la fabrication, sur place, de cette partie de l'outillage. 2.2.4 - Gestion des matières premières
De l'ensemble des données précédemment exposées, se dégagent déjà quelques particularités dans la gestion des matières premières. En effet deux grands groupes de matériaux ont été identifiés : l'un, strictement local, est un silex souvent d'assez mauvaise qualité, diaclasé, provenant des niveaux calcaires du Jurassique moyen, à proximité du gisement, ou éventuellement en position secondaire, à quelques kilomètres du site; le second aisément identifiable macroscopiquement, proviendrait des formations du Turonien-Coniacien-Santonien, signalées à une distance de 15-20 km, à vol d'oiseau, du gisement. D'autres silex sont présents mais en quantité infime. Les silex du groupe 1, local, sont les plus fréquents dans les deux couches, bien sûr, mais une bonne partie de l'outillage retouché est en silex allochtone. Nous avons signalé précédemment aussi que les racloirs sont souvent sur silex importé tandis que les encoches et denticulés sont presque toujours sur silex local. Si l'on examine plus en détail les phases technologiques et les types d'outils dans chacune des deux matières, une gestion différentielle apparaît clairement dans les deux couches : - en silex local, la totalité des phases technologiques est représentée : les produits de débitage, y compris les corticaux sont nombreux; les outillages retouchés bien représentés (20 % de l'ensemble en couche 9 ; 22,8 % en couche 10). Les nucleus, même s'ils ne sont pas très nombreux, sont pratiquement tous en silex local. Les outillages retouchés comprennent bien sûr des racloirs, ne montrant pas de réaffûtages importants, mais aussi de nombreux outils à encoches, comme signalé antérieurement ; - dans les séries en silex importé, la situation est différente : les produits de débitage sont rares et en général, de petites dimensions ; bon nombre d'entre eux, de morphologie très particulière (Lenoir 1986, Meignen 1988) ont pu être identifiés comme des éclats de ravivage d'outils à retouche Quina. D'autre part, les nucleus sont pratiquement inexistants; un seul, exploité de façon exhaustive, a été récolté en couche 9. Par contre, les outillages retouchés sont abondants, parfois même
ment (48,3 % en couche 9 ; 85,2 % en couche 10). L'ensemble de ces données tend à prouver donc l'importation de ce silex sous une forme technique déjà élaborée, probablement des supports retouchés. Ces outillages retouchés sont par ailleurs très largement dominés par les racloirs (couche 9 : 85,7 % des outils ; couche 10 : 87 %) parmi lesquels les transversaux sont encore exceptionnellement représentés (couche 9 : 58,3% des racloirs ; couche 10 : 35 %). Dans cette série, la retouche écailleuse scalariforme est de règle, encore plus fréquente que ce que nous avons énoncé pour l'outillage global. En effet, dans ce silex importé, la presque totalité des racloirs sont aménagés par retouches Quina ou 1/2 Quina. Un autre élément caractéristique de cette série en silex importé est la présence d'un phénomène de réaffûtage intense que nous avons pu identifier en particulier sur les racloirs transversaux dont la morphologie en est clairement le témoin (très larges, très courts, proportionnellement très épais; front du racloir abrupt, parfois même surplombant) mais aussi par la présence d'éclats de réaffûtage caractéristiques. Ces derniers sont eux-mêmes parfois transformés en racloirs, traduisant un recyclage des produits déjà souligné dans les industries du Périgord. La présence de racloirs fréquemment associés à une encoche clactonienne ainsi que la morphologie des déchets de réaffûtage (comparable à celle de la fabrication des coches clactoniennes décrite par Newcomer, 1970) nous avait conduit à envisager un cycle de retouches des grands racloirs d'abord par retouches écailleuses scalariformes établies sur la base de denticulés clactoniens, un affûtage de ce front de retouche au fur et à mesure de l'utilisation qui aboutit à lui donner finalement une inclinaison abrupte, d'où la nécessité alors de ces grands enlèvements sous forme de coches clactoniennes qui permettent d'obtenir à nouveau l'angle recherché (60-70°) (pour plus de détails, voir Meignen, 1988). Ces données soulignent donc l'existence d'un comportement différencié : - d'une part, l'introduction d'une matière première de qualité sous forme de supports retouchés, des racloirs probablement, provenant de sources relativement éloignées. Ce matériau fait l'objet d'un entretien particulier, les racloirs y sont largement réaffûtés, exploités jusqu'à la fin des possibilités ; même les déchets de cet affûtage sont recyclés.
- d'autre part, l'aménagement sur silex local, d'outils tels qu'encoches et denticulés souvent sur débris ou éclats diaclasés et de racloirs qui ne sont pas soumis ceux-là à une exploitation prolongée (pas de réaffûtage intense). Il est intéressant de noter cependant que les supports des deux séries présentent les mêmes caractères techniques : éclats courts et épais, souvent corticaux, à talons lisses, larges et inclinés ; les outils sont fréquemment associés à un dos. La différence essentielle est le plus large développement, dans la seconde série, de la retouche écailleuse scalariforme, qui semble donc être lié au fort degré de réaffûtage des racloirs. Cela ne signi-
117
fie pas que cette retouche est la conséquence directe de ce phénomène, mais plus simplement, que l'épaisseur croissante du support lors de ses affûtages successifs facilite le déploiement de ce type de retouches plus aisée à établir sur supports épais . Mais il ne faut pas oublier que d'autres types de retouches sont connus sur supports épais (cf. retouches épaisses des industries ris- siennes comme la Baume Bonne) et que la retouche Quina n'est pas si facile à obtenir systématiquement - elle suppose de réunir un ensemble de conditions (supports, gestes) qui ne peut être la conséquence du seul phénomène de ravivage
Ce comportement différencié entre deux matières premières différentes n'est pas un phénomène spécifique du Charentien de type Quina. Il a, en effet, été observé dans d'autres Moustériens, en particulier par J.-M. Geneste (1985) qui définit des outils «mobiles» souvent importés (racloirs mais aussi, selon les cas, bifaces, éclats Levallois) et des outils «non mobiles» tels les encoches et les denticulés. Par contre, le phénomène consistant en un entretien et un recyclage répétés des produits, le développement de cette dernière séquence de la chaîne opératoire, la maintenance des outillages retouchés, semble être un élément fréquent dans les Charentiens de type Quina (même s'ils n'en n'ont pas l'exclusivité). Il est intéressant de noter que les éléments qui nous aident à identifier le Charentien de type Quina, présents sur les supports fabriqués dans les deux matières premières, sont en quelque sorte exagérés dans la série importée (forte proportion de racloirs, développement des transversaux, prédominance de la retouche écailleuse scalariforme) - simple conséquence peut-être de la prolongation de vie des objets les plus fréquents par les moyens classiquement adoptés dans ce groupe. 2.2.5 - La chaîne opératoire
La chaîne opératoire se caractérise donc ici, en résumé, par production de supports dits clactoniens à partir de blocs, souvent des rognons, ne faisant pas l'objet d'une mise forme ou d'un entretien particuliers a priori, débita- ge suivant simplement quelques règles précises comme le maintien de certains angles entre les différents plans de frappe successifs (voir description précédente dans le cas de Combe-Grenal), une application de la force de détachement située loin du bord du plan de frappe - ce qui a pour conséquence une forte épaisseur des supports et de courtes dimensions. Ces supports sont tout indiqués pour l'obtention de racloirs transversaux, ici bien représentés. La simplicité apparente de cette phase de production est prolongée par une phase de maintenance de l'outillage (aménagements successifs du tranchant par la retouche) qui prend ici une part importante, d'autant plus que le matériau utilisé est plus précieux, de meilleure qualité, et cela seulement pour certains outils. Cette panoplie est largement complétée par des outillages fabriqués sur place dont certains (becs, encoches et denticulés) peuvent être qualifiés «d'expédients».
2.3 - Homogénéité des chaînes opératoires de type Quina La présentation de ces deux sites sélectionnés parce que significatifs de ce qui a pu être observé dans ces deux larges régions, permet de dégager une série de caractéristiques communes qui soulignent l'homogénéité des chaînes opératoires de type Quina : - la production de supports assez spécifiques, courts et épais, le tranchant le plus long opposé à un dos (section triangulaire), à talons lisses larges et inclinés, fréquemment corticaux ; - l'importance de la séquence de gestion des outillages retouchés : fort taux de transformation de supports (proportion importante de pièces retouchées) et intensité de la retouche sur chaque outil (phénomène d'affûtages successifs) ; - la présence marquée de la retouche écailleuse scalariforme, quelle que soit l'interprétation que l'on en donne.
Devant l'importance que revêt le type de retouche particulier qui caractérise les outils, essentiellement des racloirs, dans le groupe Charentiens, il s'avère judicieux d'en rappeler les caractères spécifiques et de souligner les différences d'autres retouches qui peuvent être abusivement regroupées sous cette même appellation. La définition princeps à laquelle il est plus fréquemment fait référence est celle proposée par F. Bordes qui fait de la retouche Quina une variante de la retouche «en écailles» et qu'il nomme «retouche en écailles scalari- formes». F. Bordes définit plusieurs caractères techniques à cette retouche (Bordes, 1961 : 8, 32, 35) des racloirs du Moustérien de type Quina. - 1 Technique de percussion : percuteur tendre ; méthodes : percussion directe avec un geste particulier utilisant une «partie assez éloignée du bout» d'objets possédant une morphologie assez particulière comme les phalanges de bovidés ; - 2 Étendue et morphologie sur le support : large, courte et en écailles ; - 3 Succession de plusieurs générations de retouches qui lui confère un caractère «en marche d'escaliers» ; - 4 Delineation du bord : le plus souvent très arqué, fo
rtement convexe ; - 5 Localisation sur le support : souvent envahissante et localisée latéralement (racloir simple convexe type Quina) ou transversalement (racloirs transversaux convexes type Quina) ; - 6 Volume du support : les éclats supports sont particulièrement épais.
Ces caractères seront généralement repris par les différents auteurs qui ont ultérieurement tenté d'en interpréter la répartition et la signification culturelle (Lenoir 1973,
118
Dibble 1988) ou bien cherché à en préciser les caractères technologiques et le mode de fabrication (Turq 1979, Lenoir 1986, Verjux et Rousseau 1986) et enfin (Boëda et Vincent 1990). C'est ce dernier travail qui a mis en évidence le caractère fonctionnel de la dernière génération d'enlèvements de cette retouche, qui tend à conférer au support un angle du bord nettement plus aigu que celui des premières générations. Ces auteurs ont montré que l'emploi d'un percuteur tendre d'une morphologie spéciale, telle une phalange de bovidé ou une large esquille de dia- physe, était particulièrement apte à produire ce type de retouche. Il est par ailleurs probable que des caractères «scalariformes» très accentués sur la convexité de certains racloirs épais puisse jouer un rôle fonctionnel de premier plan.
Dans ce type de retouche, la succession des générations d'enlèvement écailleux et profondément rebroussé donne, au bord tranchant et à la surface retouchée, un caractère agressif, râpeux et denticulé particulièrement efficace dans le travail des matières organiques, (viandes, articulations, cartilages et peaux) ; autant d'hypothèses de travail, qui pour l'heure, ne sont abordées que sur un plan technologique général.
Sur la base de cette définition, il convient de demeurer très réservé sur l'identification de retouche de type Quina ne possédant pas tous ces caractères. Un diagnostic différentiel particulièrement attentif doit être fait avec les retouches abruptes et particulièrement celles qui sont réalisées sur des supports épais. Elles peuvent résulter d'un long processus de ravivage qui leur confère un caractère abrupt qui peut être scalariforme mais ne l'est pas la plupart du temps. Cette situation peut aussi se produire par l'utilisation et le ravivage intensif de supports minces, Levallois par exemple, comme dans certains Moustériens du Zagros. Il ne peut s'agir de retouches Quina au sens strict du terme.
Le problème posé ici est celui de la retouche demi-Quina rencontré sur des supports minces. Rappelons simplement qu'une retouche de type Quina possédant des caractères discrets et de faible amplitude comme c'est nécessairement le cas sur le bord d'un support peu épais sera plus difficile à identifier de manière globale que sur un support épais où tous les caractères seront nettement exprimés. Le caractère épais d'un support peut être un paramètre important, associé au caractère fonctionnel de certaines retouches de type Quina. En outre, la maintenance d'une telle retouche dans sa forme typique implique une régénération du bord tranchant qui se réalise par de grands enlèvements emportant sensiblement la surface du support initial et réalisés au percuteur dur, afin d'obtenir un nouveau front de retouche plus régulier et correctement incliné. Les enlèvements sont alors caractéristiques et ne s'observent que sur les supports épais : ils participent dans certains cas à la chaîne opératoire de production de supports dans le Charentien de type Quina.
Une telle retouche rencontrée dans les industries Moustériennes en contexte Rissien (La Micoque couche 3, Les Tares) réapparaît dans les Charentiens Wùrmiens d'Europe Occidentale mais aussi dans le Micoquien d'Europe Centrale et Orientale où elle est aussi associée comme dans l'archétype de l'industrie Micoquienne, la couche 6 de La Micoque, à des pièces bifaciales de section piano-convexe mais aussi dans l'Acheuléo-yabrou- dien de Tabun et de l'aire proche orientale.
Cette apparition répétitive, due en partie à une récurrence de l'ensemble des conditions fonctionnelles de sa réalisation technique, est à prendre en compte en dehors d'une interprétation en terme de traditions culturelles identiques qui sont ici hautement improbable. 3 - DIVERSITÉ DES MOUSTÉRIENS CHARENTIENS DE TYPE FERRASSIE (M. L, A. T., L. M., J. J.) 3.1 - Le gisement de Combe-Grenal, couche 35.
Comme pour le Moustérien de type Quina nous prendrons comme exemple, la couche la plus représentative (couche 35 de Combe-Grenal) d'autant plus que pour ce type de Moustérien, dans aucune séquence stratigra- phique n'apparaissent des tendances de modification de sa composition typologique. Cette couche est datée du tout début du stade isotopique 4. 3.1.1 - Les pièces-supports
Cette industrie est caractérisée par la production de supports plats, souvent Levallois (IL = 17,2 %) de type récurrent, le plus souvent centripète (Fig. 11 n° 2), mais parfois aussi de type bipolaire (Fig. 11 n° 3) ou unipolaire (Fig. 11 n° 1). Les éclats Levallois, peu standardisés, présentent des contours assez irréguliers et sont peu élancés. Comme cela a été déjà signalé à plusieurs reprises dans les industries à débitage Levallois, les éclats Levallois présentent une préparation plus soignée des plans de frappe, soit un facettage important des talons. L'indice laminaire des outils (ILam) résulte parfois de la retouche qui a réduit la largeur initiale du support. Les autres types de supports sont moins facettés, mais l'angle formé par la surface supérieure et le talon est le plus souvent proche de 90°. Les types de support que nous considérons comme caractéristiques du Moustérien de type Quina sont peu nombreux puisqu'ils représentent 26 % dont 20 % d'éclats à dos corticaux qui correspondent ici en grande partie à des sous produits du débitage Levallois. Le Moustérien de type Ferrassie de la couche 35 possède donc quelques supports épais, comme tous les types de Moustérien. Dans ce gisement en grotte qui s'ouvre en sommet de falaise, l'indice Levallois typologique est très faible (ILtyp = 15,4) et la retouche a profondément modifié et réduit de façon significative le support initial ce qui, souvent, rend son identification technologique difficile (Fig. 11 n°4, 5 et 6). A La Ferrassie, gisement situé à proximité immédiate des gîtes de matières premières
119
-\ h
Fig. 11 : Combe-Grenal, Domme, Dordogne, Fouilles F. Bordes - Moustérien de type Ferrassie (couche 35). 1-3 Outil sur support Levallois. 4 Racloir convergent sur support Levallois intensément retouché. 5 Racloir sur support à face supérieure amincie. 6 Racloir à retouche totale de la face supérieure et partielle de la face inférieure. Fig. 11 : Combe-Grenal, Domme, Dordogne, Fouilles F. Bordes - Ferrassie Mousterian (level 35).
1-3 Tool on a Levallois blank. 4 Convergent scraper on a heavily reduced Levallois blank. 5 Scraper on a blank with a thinned superior surface. 6 Scraper with complete retouch of the superior surface and partial retouch of the inferior surface.
exploités il en est tout autrement. A Combe-Grenal, l'approvisionnement en matières premières lithiques est toujours majoritairement d'origine locale (97 %) avec les mêmes matières allochtones que dans le Moustérien de type Quina. Les deux grands groupes de silex locaux, les silex du Sénonien qui dominent (68 %) et les silex calcé- donieux (29 %) donnent lieu à des gestions légèrement différentes, liées à la morphologie des blocs. Le débita- ge Levallois concerne de préférence le silex lacustre qui se présente sous la forme de dalles alors que la production de couteaux à dos, support des racloirs latéraux, concerne plutôt le silex Sénonien généralement sous forme de rognons assez contournés. 3.1.2- Les nucleus
Les nucleus sont au nombre de 121. Trop épuisés, fragmentés ou tout juste blocs testés, nombre d'entre eux (36 %) ne sont pas ou ne sont plus porteurs d'informations concernant les techniques de débitage. Les autres correspondent surtout, au moment de leur abandon, à des nucleus récurrents centripètes (40,5 %) dont certains possèdent encore des caractères Levallois évidents.
Dans deux cas, le dernier éclat, très envahissant,
respond probablement à un enlèvement préférentiel. Pour les autres, les derniers enlèvements ont profondément altéré la surface de débitage probablement Levallois en laissant des négatifs d'enlèvement assez creux et parfois rebroussés. Parmi eux, la moitié conservent un culot cortical. Il existe des nucleus à enlèvements unipolaires (4 %), quelques nucleus à enlèvements multidirectionnels qui dans leur dernier stade présentent une surface préférentielle de débitage (8 %), des nucleus globuleux (6,6 %) et des nucleus sur éclat (4,1 %). Ces derniers ont été surtout exploités sur la face inférieure de l'éclat la plupart du temps selon une organisation centripète. 3.1.3 - L'outillage retouché
Le pourcentage d'outil est très fort. Les supports demeurant bruts ont généralement des dimensions inférieures à celles des outils sauf peut-être pour les éclats Levallois. L'outillage est dominé par les racloirs (IR réel = 57,8 % et IR ess = 78,1 %) et les encoches et denti- culés ne représentent que 2,8 %. Entre ces deux grandes catégories typologiques le choix des supports est globalement comparable à celui observé dans tous les Moustériens (Geneste 1 985) : les encoches et denti-
120
culés ont plus souvent que les racloirs (7,7 %), été réalisés sur des supports indifférenciés (17 %), d'autre part les éclats Levallois et plats jouent pour les denticulés et encoches, un rôle très important (54 %) légèrement plus fort que pour les racloirs (49 %).
Parmi les racloirs, dominent les latéraux convexes (près de 50 %) et l'indice Quina est assez élevé (IQ = 14,5 %). Les pièces à bords convergents souvent considérées comme caractéristiques de ce faciès moustérien représentent seulement 10,5 %. On observe un choix préférentiel des supports en fonction du type de racloirs. Les latéraux sont de préférence faits sur les éclats à dos cortical (29 %) souvent à talon lisse, les autres sur les éclats plutôt plats qui en raison de l'importance de la retouche, sont difficilement déterminables. Dans le cas précis de ce gisement et peut-être plus particulièrement de cette couche il existe de toute évidence un réaffûtage et une reprise des pièces (Fig. 11 n° 4, 5 et 6) qui, sans conduire au recyclage systématique (comme dans le Moustérien de type Quina de la couche 22), peuvent expliquer en partie le rôle important joué par la retouche scalariforme. Les limites de ce faciès moustérien sont floues. Bien des ensembles lithiques ne lui sont pas rattachés en raison d'indices distinctifs trop bas et sont attribués généralement au Moustérien typique riche en racloirs (exemple, les couches 28 à 30 de Combe-Grenal ou VI et VII du Roc de Marsal) ou certains Moustériens de tradition acheuléenne de plein air (La Plane).
En Périgord, il n'existe pas, dans les séries provenant de fouilles récentes, d'industries à caractères intermédiaires. Seule la couche de l'abri Chadoume, provenant de fouilles anciennes, évoque ce type d'industrie.
3.2 - Le gisement de La Ferrassie, couche M2e, Savignac de Miremont, Dordogne Les niveaux moustériens du grand abri de la Ferrassie, datant fort probablement de la fin du Wùrm II d'après les études paléoclimatiques (Delporte, 1984) ont fait l'objet de nouvelles fouilles, dirigées par H. Delporte entre 1968 et 1973, qui ont permis l'obtention d'une série lithique suffisamment abondante, la couche M2e, pour que la définition du Moustérien de type Ferrassie, établie sur les anciennes collections, puisse être précisée sur de meilleures bases (Tuffreau, in Delporte 1984). Même si cette étude n'a pas alors été réalisée en terme d'analyse technologique (dans une optique technologique), les résultats précis qui ont été publiés permettent de dégager les grandes lignes de l'organisation de la production lithique. 3.2.1 - Pièces supports
La chaîne opératoire est orientée vers la production de supports minces allongés (des éclats) voire laminaires, obtenus par les méthodes Levallois. De morphologie fréquemment sub-quadrangulaires, ces supports
blent aménagés par enlèvements centripètes le plus souvent, avec cependant la présence non négligeable d'une organisation uni/bipolaire conduisant à des supports présentant des arêtes parallèles sur leurs faces supérieures. Les premiers stades de l'exploitation des blocs consistent en une préparation centripète de la surface Levallois (les plus grands supports le montrent) ; de la même façon, il semble bien que le stade final soit également d'organisation centripète ( visible sur les faces supérieures des petits modules d'éclats et sur les nucleus). La production Levallois n'est pas très abondante (ILtechn = 17,4) mais aboutit à des supports réguliers. L'aménagement soigné des plans de frappe se traduit par un facettage important des talons, surtout sur les produits Levallois dont le détachement est ainsi correctement assuré. La préparation plus sommaire des plans de frappe pour les produits ordinaires aboutit à une proportion de talons lisses plus forte que pour les Levallois, ils ne semblent pas être l'objet du même investissement. Ces talons lisses, d'autre part, ne sont pas inclinés (comme nous l'avons vu dans le Charentien de type Quina) ; les angles d'éclatement entre face supérieure et talon sont rarement supérieurs à 90°. La tendance à une production de supports allongés se traduit également par un pourcentage non négligeable de lames (ILam = 20,1). 3.2.2 - Nucleus
Les nucleus Levallois dénombrés ne sont pas très abondants (16,3 %) mais parmi les très nombreux «discoïdes» (au sens de Bordes) (65 % des nucleus), il est fort probable qu'un certain nombre d'entre eux seraient identifiés maintenant comme Levallois récurrent. A. Tuffreau signale d'ailleurs que «certains d'entre eux sont probablement des nucleus Levallois dont le débitage a été poursuivi». 3.2.3 - Outillage retouché
Une large partie de cette production Levallois n'a pas été transformée en outils retouchés et a donc probablement été utilisée en l'état (ILtyp = 41) - ce qui contraste, bien sûr, avec ce que nous avons vu précédemment dans la couche 35 de Combe-Grenal. De façon générale d'ailleurs, cet outillage démontre un faible taux de transformation des supports : la proportion de pièces retouchées n'atteint que 12,7 % de la totalité. Il s'agit là d'un fait remarquable pour un Charentien de type Ferrassie, groupe pour lequel les travaux de N. Rolland ont établi un fort taux de transformation comme élément caractéristique. La sélection de supports Levallois pour la fabrication de l'outillage retouché est cependant évidente puisque le taux de transformation est nettement plus fort pour ces produits (Itgl = 39,9) que pour les produits ordinaires (Itgnl = 11,6). L'ensemble de ces résultats confirme que l'objectif de la chaîne opératoire était bien la production de ces supports.
121
L'outillage retouché comporte majoritairement des racloirs (IRess = 62,2) qui sont aménagés le plus souvent par de simples retouches écailleuses ; la proportion de retouches écailleuses scalariformes est très basse (IQ = 3,8). Ces racloirs sont principalement simples convexes, fréquemment associés à un dos cortical (26 % d'entre eux). La retouche qui les aménage affecte peu le bord de l'outil (elle est peu profonde) et elle est, de plus, souvent limitée à certains secteurs du tranchant ; ces données suggèrent donc une faible intensité de l'activité d'affûtage. Le développement des pièces à bords convergents est, par ailleurs, un élément caractéristique de cet outillage (un quart du groupe Mousténen), phénomène déjà souligné pour les Charentiens de type Ferrassie par F. Bordes. Les supports de ces produits convergents sont majoritairement Levallois et là encore, la retouche écailleuse scalariforme est peu fréquente. Les racloirs transversaux sont rares (5,1 %).
En résumé donc, la chaîne opératoire de la Ferrassie M2e est orientée vers la production d'éclats Levallois allongés, de différentes tailles, qui ont été partiellement sélectionnés pour être aménagés en racloirs simples ou convergents le plus souvent. D'autre part, une bonne partie de ces supports Levallois sont restés sans retouche. De façon générale, cet outillage se caractérise par un faible taux de transformation, tant sur la quantité de produits retouchés que sur l'intensité de la retouche sur chaque outil. Il semble donc que l'investissement technique ait été réalisé dans la phase de production de support plus que dans la séquence de mise en forme et/ou d'affûtage par la retouche.
3.3 - Le gisement d'Artenac, Charente.
Peu de séries provenant de fouilles modernes et publiées sont actuellement disponibles pour la région des Charentes. La couche 2 du gisement d'Artenac constitue cependant un bon exemple de Charentien de type Ferrassie dans ce secteur (Meignen, Chech et Vandermeersch 1977). 3.3.1 - Pièces supports et nucleus
A Artenac, l'objectif de la chaîne opératoire de production lithique semble être l'obtention d'éclats minces, souvent assez courts Les produits laminaires sont rares (ILam = 7).
La méthode Levallois est incontestablement utilisée pour obtenir ces supports (ILtechn = 18,1), sans obligatoirement être exclusive. L'examen des schémas diacritiques sur les produits Levallois et les nucleus indique la prédominance du système Levallois récurrent centripète, même si un certain nombre de produits traduisent l'existence d'une exploitation unipolaire. Le système récurrent est ici attesté par la présence d'enlèvements II et de nucleus portant l'empreinte d'enlèvements prédéterminés envahissants successifs. Cependant, quelques rares nucleus discoïdes vrais (Boëda 1986, 1995) et produits pseudo-Levallois suggèrent que les systèmes
Levallois récurrents ne détiennent pas l'exclusivité dans ce débitage. Les dimensions relativement importantes des nucleus sont un élément remarquable de cet assemblage : sauf quelques rares exemplaires de taille inférieure à 5 cm, les dimensions maximum de ces nucleus varient entre 6 et 10 cm ; il ne semble donc pas y avoir eu une exploitation maximale des blocs, conduisant à un fort degré d'exhaustion fréquemment rencontré dans d'autres industries Levallois. L'aménagement des plans de frappe conduit à une forte représentation des talons facettés, convexes le plus souvent ; quand les talons sont lisses, là encore, ils sont étroits et l'angle d'éclatement n'est pas ouvert, produisant donc des éclats relativement minces. Le débitage a été effectué au percuteur dur. 3.3.2 - Outillage retouché
Le taux de transformation de cet outillage est là encore faible (les outils retouchés constituent environ 10 % de l'ensemble). Une forte proportion de produits Levallois n'a subi aucune transformation par la retouche, quel qu'en soit le rôle (affûtage du tranchant, régularisation de la forme) (ILtyp = 50,1), ce qui signifie une utilisation probable des produits bruts de débitage. Cependant ces supports Levallois ont été préférentiellement retenus pour la fabrication des outillages retouchés. Les racloirs comme toujours dominent largement l'outillage (IRess = 61,1), comportant une importante série de racloirs simples convexes bien arqués, certains présentant une retouche écailleuse scalariforme typique. Les outils à bords convergents ne sont pas très fréquents (10,8 % des racloirs ; il n'y a pas de pointes moustériennes) et leur développement est ici comparable à celui des racloirs transversaux. Globalement, sur l'ensemble des racloirs, la retouche écailleuse scalariforme est assez peu utilisée (IQ = 10,7).
En résumé donc, la production recherchée ici est celle de produits minces mais courts, obtenus par les méthodes Levallois récurrentes centripètes. Ces supports restent souvent non transformés ; la production ne semble pas avoir été poussée sur les nucleus. Racloirs transversaux et outils à bords convergents sont en proportion comparable, il n'y a donc pas eu de préférence pour l'une de ces formes. 3.4 - Le gisement du Lycée, Pons, Charente Maritime
Dans la région des Charentes maritimes, le gisement du Lycée, à Pons, constitue un autre exemple d'industrie lithique proche de ce que nous avons décrit précédemment (Lassarade, Rouvreau et Texier 1969). Mais la production cette fois est beaucoup plus marquée par les méthodes Levallois (ILtechn = 36,4). Cependant, cet élément peut, bien sûr, être le résultat d'une introduction de supports Levallois dans le site. Nous disposons de peu de détails dans la publication, mais il semble que les produits recherchés soient des éclats de modules assez allongés, sans que la proportion de lames ne soit forte dans ce débitage (ILam = 5,3 %).Dans cette industrie
122
aussi, les supports Levallois sont restés assez souvent bruts de débitage (ILtyp = 31 ,6). L'ensemble est très largement dominé par les racloirs (IRess = 69,7), le plus souvent simples convexes, mais très peu aménagés par la retouche Quina, sauf quelques pièces typiques (IQ = 2,4). Par contre, les outils à bords convergents sont fréquents, régulièrement aménagés (16,9 % du groupe moustérien qui comprend plus spécialement une série de pointes mousténennes allongées et une limace typique). 3.5 - Le Rescoundudou (Sébazac-Concourès, Aveyron) et la question des séries limites entre Moustérien de type Ferrassie et Moustérien typique riche en racloirs
Ce gisement occupe une position géographique assez marginale (Grands Causses), excentrée par rapport aux ensembles aquitains, languedociens et du Velay (Fig. 1). Il est intéressant de situer la production lithique du Rescoundudou par rapport aux grandes familles de schémas opératoires du Paléolithique moyen car son profil typologique (indices sensu Bordes) rattache cet assemblage au groupe Charentien (Ferrassie + Quina) alors que les études descriptives et comparatives nuancent une attribution à l'un des deux faciès classiques, le rapprochant de séries «hybrides» comme le Charentien atypique du Languedoc oriental (de Lumley 1971) ou le Moustérien typique riche en racloirs (Bordes 1981). Cette question a déjà été abordée lors d'une contribution précédente selon une approche conventionnelle (Jaubert 1984). Nous nous limiterons ici à quelques observations d'ordre général issues d'un réexamen technologique préliminaire et partiel du matériel. Le contexte archéologique de la série lithique ainsi que le statut économique du site nous paraissent important à rappeler.
L'occupation principale (couche C1) est, selon toute vraisemblance, contemporaine de l'une des deux oscillations tempérées (5c ou 5a) qui prolonge le dernier interglaciaire sensu stricto avant la mise en place des conditions franchement froides du Pléniglaciaire ancien (stade 4) (Jaubert et al. 1992). A partir de cette époque, soit vers 70-60 ka, la région des Grands Causses semble d'ailleurs à nouveau désertée par les groupes de Néandertaliens(7).
Une des originalités de l'assemblage lithique est, comme pour le Charentien de type Quina de Puycelsi dans le Tarn (Tavoso 1987), son association au sein d'un ensemble géo-morpho-topographique de plein-air, très riche en vestiges fauniques qui peut être provisoirement interprété comme un site spécialisé dans l'acquisition, le
traitement et la consommation de deux espèces dominantes d'ongulés : le cheval et le daim (écotone). Ce constat ouvre des perspectives d'étude sur la question d'une quelconque influence «fonctionnelle» sur la composition de l'industrie lithique. L'extension de la nappe de vestiges (150 à 200 m2), sa puissance (> 1 m), sa richesse (plusieurs centaines de milliers de restes dont plus d'un millier d'outils) classent ce gisement parmi les sites à occupation longue et répétée.
Les observations qui suivent sont essentiellement déduites de l'examen de surfaces de débitage des éclats entiers ou cassés, bruts ou retouchés ainsi que des rares nucleus. 3.5.1 - Acquisition de la matière première
L'industrie lithique est débitée à partir de roches locales plutôt médiocres : silex locaux du Jurassique : 76,95 %(8> (contact Bajocien-Bathonien ; MP1a, plaquettes ou blocs diaclasés ; MP1b, rognons à inclusions diverses), quartz : 23,04 % (MP2a, galets des formations alluvionnaires ; MP2b, blocs ou fragments d'origine filonienne ; MP2c, quartz hyalin), silex locaux de provenance voisine (MPx, divers Jurassique, jaspes de l'Infrahas, silex tertiaires...). Le transport s'effectue sans préparation (Fig. 12) sauf pour quelques produits importés (Fig. 16 n° 9), opération autorisée par le faible module des matériaux locaux, les plus grands produits de débitage dépassant exceptionnellement 10 cm. 3.5.2 La chaîne opératoire de production des supports Préparation
Presque tous les produits de mise en forme attestent d'un débitage unipolaire. Les supports produits, entames, couteaux à dos corticaux, éclats à cortex résiduel, sont majoritairement minces, allongés, parfois laminaires. Une grande partie des outils retouchés est façonnée dès ce stade du débitage (entre 43,09 % et 29,84 % des pièces façonnées appartiennent à la phase 1 - produits corticaux de mise en forme - cf. liste-type Geneste 1985 et fig. 13). On remarque par ailleurs l'obtention de quelques supports épais, de section triangulaire comme ils sont décrits pour le Moustérien de type Quina (Turq 1989) mais ils ne semblent pas constituer un objectif prioritaire et ne relèvent pas d'une production autonome en terme de schéma opératoire. Cependant, l'absence de remontages confère à cette remarque un statut encore provisoire.
(7) Une attribution à l'»interpléniglaciaire» ne peut, methodologiquement, être définitivement écartée. Des essais de datations radiométriques sont en cours.
(8) Les pourcentages donnés ici correspondent à la moyenne de six décomptes : les décapages C1c à C1f portant sur 10 m2 (20143 vestiges), le sondage 10-VIII (2143 vestiges) et le secteur S6' , soit une dizaine de m2 (3584 vestiges).
123
Gîtes de M P
PHASES TECHNOLOGIQUES
Transport sans préparation
SUPPORTS DESTINÉS à la RETOUCHE
Débitage unipolaire ♦ PLEIN DÉBITAGE
Bipolaire
DERMERE PRODUCTION Centripète
Couteaux à dos corticaux Eclats à plage résiduelle en cortex Eclats fragments épais
Grands éclats ou lames LevalkMs Petits éclats ou lames Levallo» Petits éclats Levalkxs
Idats Levallois "diminutifs* NUCLEUS DISCOÏDES Fragments de nucleus
Nucleus abandonnés
Fig. 12 : Le Rescoundudou, Sébazac-Concourès, Aveyron - Moustérien de type Ferrassie ou Moustérien typique riche en racloirs. Chaîne opératoire du silex local du Bajocien. Fig. 12 : Le Rescoundudou, Sébazac-Concourès, Aveyron - Ferrassie Mousterian or Typical Mousterian with abundant scrapers.
Reduction sequence (chaîne opératoire) of the local Bajocien flint.
Phasage technologique (liste-type J.-M Geneste 1985)
Fig. 13 : Le Rescoundudou, Sébazac-Concourès, Aveyron - Moustérien de type Ferrassie ou Moustérien typique riche en racloirs - Histogramme des classes technologiques des outils (Cs). On notera les fortes proportions de pièces aménagées dès la phase de préparation (éclats corticaux) et sur fragments. Les produits Levallois sont figurés en noir.
Fig. 13 : Le Rescoundudou, Sébazac-Concourès, Aveyron - Ferrassie Mousterian or Typical Mousterian with abundant scrapers. Diacritic schémas of Levallois products : 1, 3, 5, 6, 8, Unipolar debitage. 4 Bipolar debi- tage. 7, 9 Centripetal debitage.
Production principale Cette phase, difficile à reconstituer compte tenu du caractère minoritaire des produits bruts entiers ou peu transformés ainsi que des nucleus (inexistants à ce
stade de la chaîne opératoire), relève d'une conception élaborée et efficace, parfaitement maîtrisée, adaptée à des matériaux de qualité médiocre et variable (cf. supra), acquis qui suppose une solide tradition technologique. La technique de débitage adoptée n'est pas encore précisée. Observé dès la phase précédente, le débitage unipolaire continue à dominer l'ensemble des autres schémas avec production de petits supports Levallois typiques ou non, allongés, longs (I/L < 0,5) laminaires (I/L < 0,33), parfois de vraies lames (I/L < 0,25). (ILam sensu Bordes = 26,53 pour les outils de C1c). Les produits recherchés font l'objet d'une préparation soigneuse avant détachement : talons facettés et plans de frappe abrasés. Les éclats ou lames à talons punctiforme ou linéaire sont nombreux, ce qui contribue à donner à l'ensemble du débitage une impression de minceur qui pourrait être une réponse économique à ce secteur pauvre en matière première de qualité. Il n'y a pas de vrais talons clactoniens, profonds et inclinés.
Une constante : la poursuite de l'exploitation, aboutissant à un recyclage systématique des produits à chaque stade du débitage, reculant progressivement la phase d'abandon (nucleus : 1 ,40 %(8> sur la totalité des vestiges lithiques > 2 cm). Les schémas diacritiques des produits (Fig. 14) permettent de distinguer la coexistence de plusieurs schémas Levallois récurrents : unipolaire (67 %)(9), bipolaire (13,8 %) et centripète (17 %). La modalité à éclat préférentiel est exceptionnelle (2,1 %), même en fin de cycle. Il est encore difficile d'estimer les rapports qu'ils entretiennent entre eux : stricte association à l'intérieur d'une même chaîne opératoire avec passage de l'un vers l'autre ou statut à part entière et distinct pour chaque modalité. Une certitude cependant : sauf accident (éclat Levallois outrepassé, fracture longitudinale),
(9) Calculs portant sur une série d'outils de Cs (N = 273), de C1c (N =190) et du sondage 10-VIII (N = 132).
124
1 "
F/g. 14 : Le Rescoundudou, Sébazac-Concourès, Aveyron - Moustérien de type Ferrassie ou Moustérien typique riche en racloirs.
Schémas diacritiques des produits Levallois : 1, 3, 5, 6, 8 Débitage unipolaire. 4 Débitage bipolaire. 7, 9 Débitage centripète. (Dessin J. Jaubert). Fig. 14 : Le Rescoundudou, Sébazac-Concourès, Aveyron - Ferrassie Mousterian or Typical Mousterian with abundant scrapers.
Histogram of the technological classes of tools (Cs). Note the high proportions of transformed blanks from preparation phases (cortical flakes) and on flake fragments. Levallois products are shown in black.
le débitage centripète de petits éclats Levallois ou «indéterminés» achève le cycle de chaque production.
Quelques éclats Kombewa appartiennent plus à des processus d'amincissements qu'à une production autonome et recherchée pour les propriétés de ses supports.
La production de pièces épaisses existe mais semble plutôt répondre à des besoins ponctuels. Ces supports sont issus des deux extrémités de la chaîne opératoire : la phase initiale du décorticage (entames, gros éclats corticaux à talon ou dos naturels) sert à façonner quelques racloirs simples latéraux, exceptionnellement transversaux, alors que la phase d'abandon (petits nucleus discoïdes épuisés ou même cassés) montre des supports retouchés en denticulés, en racloirs à retouche biface ou à dos aminci, en pièces à retouche couvrante et à amincissements divers. Le style de ces pièces rapproche les premiers du type Quina, les seconds du Ferrassie oriental, rhodanien ou bourguignon d'affinité centre-européenne, mais il paraît prématuré de faire ici la part entre les phénomènes de convergence environnementaux ou économiques et les traditions culturelles.
Façonnage
La proportion d'outils retouchés par rapport à la totalité
des éclats > 2 cm est assez importante : de 21,8 % à 31,1 %. La sélection permanente de supports destinés au façonnage tout au long de la chaîne opératoire est à noter, avec, en corollaire, un groupe des produits Levallois retouchés qui n'est pas majoritaire (entre 14,4% et 22,65 %(9>). Quand elle modifie sérieusement un bord, la retouche est écailleuse, parfois scalariforme, rarement de même étendue ou de même inclinaison le long du tranchant façonné. La technique de ravivage existe (outils à tranchants réduits : limaces, racloirs doubles étroits à retouche surélevée) mais demeure très minoritaire, ne procédant pas d'un cycle de retouche tel celui décrit pour le Moustérien de type Quina du Sud- Ouest (Lenoir 1986, Meignen 1988, Verjux et Rousseau 1986).
Un premier décompte des supports de racloirs en silex laisse apparaître une majorité de pièces de section mince (de 78,7 % à 79,2 %(9)). Quelques racloirs, essentiellement simples latéraux ou à retouche abrupte, ont été aménagés sur des supports épais (18 % à 20,6 %(9)): éclats à dos cortical, entames, gros éclats indifférenciés ou fragments. Il existe également des supports mixtes qui présentent un bord retouché mince passant à un tranchant façonné sur une section épaisse. Les racloirs en quartz sont façonnés presque à égalité sur des supports minces (55,1 %) et épais (44,9%).
125
Fig. 15 : Le Rescoundudou, Sébazac-Concourès, Aveyron - Moustérien de type Ferrassie ou Moustérien typique riche en racloirs. 1-3, 5-8 Outils retouchés en silex local. 4 Outil retouché en quartz. 1 Pointe moustérienne à base amincie. 2 Racloir double alterne. 3-8 Racloir simple latéral (3, 5, 6 sur produit Levallois, 7, 8 sur éclat épais à dos cortical, 4 sur éclat de décorticage). (Dessin J. Jaubert).
Fig. 15 : Le Rescoundudou, Sébazac-Concourès, Aveyron - Ferrassie Mousterian or Typical Mousterian with abundant scrapers. 1-3, 5-8 Retouched tools on local flint. 4 Retouched tool on a quartz blank. 1 Mousterian point with a thinned base. 2 Double alternate scraper. 3-8 Single lateral scraper. (3, 5, 6 on Levallois blanks, 7, 8 on thick flakes with cortical backs, 4 on a cortical removal flake), (drawing by J. Jaubert).
Fig. 16 : Le Rescoundudou, Sébazac-Concourès, Aveyron - Moustérien de type Ferrassie ou Moustérien typique riche en racloirs.
1-8 Outils retouchés en silex local. 9 Éclat Levallois en silex jurassique allochtone. 1-3 Racloir double bilatéral sur éclat, sur lame Levallois et sur éclat cortical. 4-6 Racloir convergent et déjeté sur éclat épais, éclat Levallois et éclat Kombewa. 7, 8 Racloir transversal sur éclat Levallois. (Dessin J. Jaubert).
Fig. 16 : Le Rescoundudou, Sébazac-Concourès, Aveyron - Ferrassie Mousterian or Typical Mousterian with abundant scrapers. 1-8 Retouched tools on local flint. 9 Levallois flake of allochtonous Jurassic flint. 1-3 Double bilateral scrapers, on a flake, on a Levallois blade and on a cortical flake. 4-6 Convergent déjeté scrapers on a thick flake, on a Levallois flake and on a Kombewa flake. 7-8 Transverse scraper on a Levallois flake, (drawing by J. Jaubert).
126
3.5.3 L'outillage retouché (Fig. 15 et 16) L'industrie est nettement dominée par le groupe des racloirs (IRess(8) = 76,07). Les fossiles directeurs du type Quina sont presque inexistants (3 limaces pour 1250 outils décomptés (8> ; racloirs transversaux = 5,07) et, par ailleurs, ceux qui caractérisent le mieux les faciès de référence du Moustérien de type Ferrassie (outils à bords retouchés convergents : Tuffreau in Delporte 1984), situent Le Rescoundudou bien en deçà de la moyenne habituelle avec un IRc de 8,03 (Texier et Jaubert à paraître). En dehors des racloirs simples latéraux (57,77 % sur l'ensemble des racloirs + pointes) qui ne présentent jamais une forte convexité, seuls les racloirs doubles ( Fig. 15 n° 2 et 3, fig. 16 n° 1, 2 et 3) sont bien représentés (10,69 %). Toutes les catégories existent y compris les racloirs à dos amincis ou base amincie ainsi que ceux à retouche biface (Fig. 15 n° 1).
Les pièces du groupe III (Paléolithique supérieur) sont négligeables et la proportion de denticulés ne dépasse jamais 7 % en décompte réel. Il n'y a pas de bifaces ni de couteaux à dos retouchés.
3.5.4 Interprétation La présence de concepts qu'il est possible de rattacher au moins pro parte au système Levallois (récurrent), la finesse des supports produits, leur allongement, ainsi qu'un façonnage plutôt discret, éloignent catégoriquement cette série du Charentien de type Quina, surtout si on en limite la définition aux schémas opératoires décrits pour le Sud-Ouest (Turq 1989, Turq et Lenoir cet article). Il reste à évaluer l'influence des matériaux du Causse Comtal dans le choix des modes opératoires, des techniques de façonnage et de ravivage afin d'écarter les interprétations «comportementalistes» («On n'est pas Quina en Côte d'Or parce que les matériaux ne s'y prêtent pas» : Verjux et Rousseau 1986) ou «économistes» (Dibble 1988, Rolland 1990). La différence entre Le Rescoundudou et les faciès Ferrassie très Levallois (Ferrassie M2e, Biache couche llbase, Orgnac niveau 1, Bérigoule niveau I, etc.) réside, entre autre, dans une présence minoritaire mais constante, d'outils épais, élément qui caractérisent également les outillages du Massif central. D'autre part, et ce malgré un débitage Levallois récurrent et majoritairement unipolaire, il y a sous-représentation des pièces à bords retouchés convergents. Suivant les auteurs, c'est habituellement en fonction de l'indice de racloirs qu'on aurait rattacher ce type d'assemblage plutôt au type Ferrassie qu'au Moustérien typique riche en racloirs. Si la question ne s'est pas posée pour des séries comme celle, rissienne, de la couche VIII de Vaufrey (Rigaud 1982, 1988) ou encore le Moustérien des Canalettes dans l'Aveyron (Meignen 1993), c'est essentiellement dû aux proportions plus raisonnables du groupe des racloirs sur l'ensemble de l'outillage (IRess < 60).
En privilégiant comme ici l'approche technologique, les
séries du Rescoundudou constituent donc une référence intéressante indiquant que la nécessité d'établir une limite entre les faciès de Moustérien de type Ferrassie et Typique riche en racloirs définis par Bordes ne semble pas devoir constituer une priorité actuelle. Par ailleurs, la question de sa limite avec les faciès languedociens du Charentien atypique devra être plus clairement précisée, car si la production Levallois semble bien dominer l'ensemble des schémas au niveau des supports, la forte proportion de nucleus épais, («informes», discoïdes vrais et même polyédriques) caractérisant le stade d'ex- haustion du débitage est loin d'écarter définitivement tout rapprochement avec le Charentien atypique décrit plus loin (Meignen infra). 4 - LES MOUSTÉRIENS CHARENTIENS «ATYPIQUES» EN LANGUEDOC (L. M.):
Partant des études effectuées dans la région du Périgord, F. Bordes a très vite souligné l'existence d'une variabilité géographique des Moustériens charentiens, notion reprise et développée par J.-M. Le Tensorer qui, en 1978, met en évidence, sur la base de comparaisons des types d'outils principalement, la présence d'une variabilité tant chronologique que géographique. Dans ce contexte, l'existence d'une province orientale ou rhodanienne est proposée, comprenant les sites de la région du Gard, la grotte du Figuier, en Ardèche (Combler 1967) et s'étendant jusqu'à la région du Lot (Mas Viel). Dans sa thèse portant sur le Midi méditerranéen (1971), H. de Lumley signale, en Languedoc oriental, à coté d'industries considérées comme Charentien de type Quina classique (grottes de l'Esquicho-Grapaou et de La Balauzière), quelques séries où les éléments considérés comme significatifs des charentiens de type Quina sont présents mais moins largement développés que dans les gisements précédents : c'est ce qu'il a appelé les Charentiens atypiques (sites de loton, des Chariots ; De Lumley 1971). Des recherches effectuées dans cette même région par l'un d'entre nous (L. M.) ont apporté des données nouvelles concernant un site Charentien typique (grotte de La Roquette, Meignen et Coularou 1981) et une occupation liée au second groupe (abri du Brugas, Meignen 1981). Il faut signaler que cette concentration de moustériens de type Quina (ou apparentés) reste l'exception dans cette zone méditerranéenne; quelques autres sites moustériens de type Quina se trouvent plus au Nord en Ardèche et dans la région rhodanienne ; dans la direction Ouest, le site de Puycelsi, dans le Tarn (Tavoso 1987) fait figure d'exception dans un contexte très marqué par le Moustérien de tradition Acheuléenne ; quant à la Provence, elle ne présente que quelques occurrences (grottes de la Baume Bonne, de Lumley 1971 ; de la Combette, Texier 1990). 4.1 - Le Moustérien charentien de type Quina classique
Le Moustérien Charentien de type Quina se trouve donc
127
aisément identifiable dans 3 gisements situés dans la vallée du Gard ou région avoisinante (vallée du Vidourle). Les séries provenant des grottes de l'Esquicho-Grapaou et de la Balauzière comportent, sur la base des données publiées par H. de Lumley (1971), acquises selon la méthode Bordes, un ensemble de caractéristiques définies précédemment dans les Charentiens de type Quina: une forte proportion de pièces aménagées par la retouche (en particulier dans la grotte de la Balauzière), une abondance de racloirs, bien sûr, établis sur supports épais souvent corticaux (dos, talons et dos, face supérieure corticale), l'aménagement de ces racloirs se faisant très fréquemment par une retouche écailleuse scalarifor- me largement développée. L'intensité de la retouche sur ces supports est très marquée, certains évoquant un avi- vage répété. Les outils considérés comme caractéristiques du Charentien de type Quina, (limaces, racloirs à retouches bifaces, racloirs transversaux aménagés par retouches Quina) sont toujours présents.
Ces assemblages présentent, par ailleurs, des points plus spécifiques à la région comme l'existence de racloirs à dos ou base amincis (phénomène mis en
dence également dans la grotte du Figuier, en Ardèche (Combier 1967)) et un plus fort développement des pièces convergentes (pointes moustériennes, racloirs convergents et déjetés). Les produits Levallois semblent y être plus fréquents que dans les Charentiens de type Quina du Sud-Ouest ; la description de nombreux nucleus «discoïdes» (au sens de Bordes) dans ces industries (plus spécialement dans la grotte de la Balauzière) nous pose un problème d'interprétation que nous évoquerons plus loin, lors de la présentation des Charentiens atypiques, et qu'il est impossible de résoudre sans faire un retour à ces collections, pour une étude technologique plus détaillée. Il importait ici, avant tout, d'insister sur leur présence.
4.1.1 - Le gisement de La Roquette, Conqueyrac, Gard
Dans la grotte de la Roquette, deux niveaux d'occupation peu intenses (couches 2 et 3) ont été fouillés. Le matériel lithique, peu abondant, est largement constitué d'outillages retouchés, le plus souvent en silex ; ce fort taux de modification des supports est un élément qui a été mis en évidence dans les moustériens charentiens
Fig. 17 : Grotte de La Roquette, Conqueyrac, Gard. 1, 6 Racloir convergent sur nucleus. 2 Racloir simple convexe. 3 Limace courte épaisse à retouche piano-convexe. 4 Racloir sur éclat de ravivage. 5 Racloir transversal. (Dessin J. Coularou).
Fig. 17 : Grotte de La Roquette, Conqueyrac, Gard. 1, 6 Convergent scraper on a core. 2 Single convex scraper. 3 Short, thick Limace with plano-convex retouch. 4 Scraper on a rejuvenation flake. 5 Transverse scraper, (drawing by J. Coularou).
128
de type Ferrassie et surtout de type Quina par N. Rolland (1990), que cet auteur interprète comme un phénomène lié à une exploitation maximale des supports dans des conditions de difficultés d'accès ou de carence en matières premières. Dans le cas de la Roquette, les matériaux utilisés sont diversifiés (différents silex, chailles et quartz) et peuvent être trouvés soit en position primaire dans la région de St Hippolyte du Fort (à 5 km du site environ) soit dans le lit du Vidourle, situé en contrebas ; ils sont donc disponibles à proximité, sous forme de galets ou de plaquettes irrégulières, mais en faible quantité, il est vrai. Les racloirs, très nombreux, sont sur supports épais, à talons lisses et larges, souvent inclinés (même si les talons clactoniens tels qu'ils ont été définis par A. Turq ne sont pas très fréquents) ; la production Levallois y est insignifiante. Les supports sont souvent intensément retouchés, aboutissant à des tranchants régulièrement convexes bien arqués (Fig. 17). Les traces d'un ravivage prononcé sont nettes sur un certain nombre d'outils, aboutissant à des fronts de retouche abrupts dont le contour est alors proche du bulbe de percussion. Là encore, les outils caractéristiques du Charentien de type Quina sont présents : limaces et racloirs bifaces, en particulier. Quelques exemples de nucleus recyclés en outils sont à signaler. Ces données brièvement résumées soulignent donc l'existence d'industries dans lesquelles semble se dégager une production de supports et une gestion des outillages retouchés semblables à ce qui a pu être décrit précédemment en Périgord, même si certains caractères, accusés dans cette région (supports à talons clactoniens, par exemple), ne se retrouvent pas aussi systématiquement ici. 4.2 - Les «Charentiens atypiques»
A coté de ces ensembles, quelques gisements localisés dans le même secteur à peu près, ont donc été isolés sous le terme de Charentiens atypiques.
Nous en présenterons deux exemples qu'il nous a été possible d'examiner de façon plus précise, même si l'étude technologique n'a pas encore abouti à une compréhension complète des schémas opératoires. 4.2.1 - Le gisement en pied de roche de loton, Beaucaire, Gard Le gisement en pied de roche de loton est un habitat de plein air, installé sur un replat rocheux de la molasse miocène, au pied d'une toute petite falaise. Il occupe une large surface, non réellement délimitée, dont une partie seulement a été fouillée. Mais les résultats obtenus montrent une occupation fort probablement liée à la chasse des Chevaux (élément dominant de la faune, par ailleurs constituée de très nombreuses esquilles en fort mauvais état), cet escarpement dominant une sorte de large couloir entre deux buttes témoins par où passaient fort probablement les troupeaux. Daté de 48 000 + 3 000 ans par la thermoluminescence (Valladas et al. 1987), il
semble correspondre à un épisode froid déterminant une végétation steppique dans ce secteur.
Cet habitat domine, à quelques centaines de mètres de là, une terrasse ancienne du Rhône constituant la principale source de matières premières.
Approvisionnement en matières premières
Un élément intéressant du comportement économique est la sélection effectuée dans ces matériaux : la terrasse rhodanienne comporte majoritairement de grands galets de quartzite et une très faible quantité (de l'ordre de 10 % dans nos tests) de petits galets de silex. Or ce matériau a été utilisé pour plus de 90 % de l'outillage, malgré une mauvaise qualité évidente (nombreuses vacuoles) et de très petites dimensions. Là encore donc, la proximité du matériau semble avoir été l'élément déterminant dans le choix d'installation, même si par ailleurs les contraintes de la matière première sont fortes (faible quantité, petites dimensions des galets). L'industrie va bien entendu être marquée par les caractéristiques de ces matières premières ; en particulier, les dimensions de l'industrie sont exceptionnellement faibles (longueur moyenne des produits : 2,8 cm), y compris pour les outillages retouchés et le débitage de galets de petites dimensions va également déterminer la présence de cortex important.
Pièces supports
Le débitage est orienté majoritairement vers la production d'éclats courts et épais, sur lesquels les talons lisses, souvent inclinés (l'angle d'éclatement entre la face inférieure et le talon est supérieur à 110°) et les talons corticaux sont de règle. Cependant le caractère «clactonien» des talons («lisses inclinés avec une largeur supérieure à la moitié de celle de l'éclat et un angle formé par la face supérieure et le talon voisin de 60°» Turq 1988) est peu fréquent, ce qui ne donne pas le même aspect de massivité des supports qu'à Combe- Grenal ou Marillac, par exemple. En particulier, les éclats ne présentent pas systématiquement la section triangulaire fortement asymétrique décrite plus haut, qui est, elle, due à l'importance de la portion de plan de frappe emportée lors du détachement de l'éclat. Ceci procède sans aucun doute d'un mode d'exploitation des blocs différent. Le débitage a été effectué au percuteur dur et il semble que la présence de bulbes multiples et de cônes incipients soit en relation, bien sûr, avec la technique utilisée mais qu'elle soit aussi accentuée par la mauvaise qualité à la taille de la zone sous-corticale des galets.
A côté de ces supports épais, une production Levallois avait été identifiée (Meignen 1976); même si elle s'avérait être de faible importance (ILtechn= 8,6), cette présence était plus marquée que ce qu'il est généralement décrit dans les Moustériens Quina du Sud ouest. Ces produits Levallois, sauf quelques belles pièces d'assez
129
grandes dimensions (5 à 6 cm) sont cependant généralement minces, assez irréguliers et surtout de petite taille (2,5 à 4 cm)- ce qui, nous l'avons vu, est un caractère constant de cet outillage. Ces produits montrent les traces d'une organisation des enlèvements de préparation le plus souvent centripète mais aussi souvent unipolaire. A côté de cette production Levallois, un certain nombre de supports peuvent être décrits comme «pseudo- Levallois» au sens défini par F. Bordes. Même s'ils ne sont pas très nombreux là encore (35 pièces), ils sont suffisamment nets et significatifs pour être décrits. Ce sont des éclats subtriangulaires («pointes pseudo- Levallois» de Bordes), parfois pentagonaux ou hexagonaux («pseudo-pointes pseudo-Levallois», Bordes 1961) dont l'axe de symétrie est toujours déjeté par rapport à l'axe de percussion, qui portent en face supérieure l'empreinte de 2 ou plusieurs enlèvements et présentent systématiquement un petit dos «bord de nucleus» prolongeant immédiatement le talon - ce qui leur donne parfois une base particulièrement épaisse, mais ce n'est pas le cas systématiquement ici. Considérées comme «un déchet de taille provenant de la régularisation du bord d'un nucleus discoïde» par F. Bordes (1961), elles furent ensuite interprétées comme un produit de préparation du Levallois par Kelley (1957) grâce au remontage sur un nucleus Levallois. J.-M. Geneste (1985) les identifie comme «enlèvement pseudo-Levallois débordant» produit lors de la remise en forme du nucleus Levallois et E. Boëda (1986) les considère comme des produits prédéterminants au même titre que les éclats débordants, dont elles présentent en effet les caractéristiques (dos débordant mais limité). Elles s'en distinguent cependant par un axe de symétrie déjeté par rapport à l'axe de débitage, alors que les deux sont pratiquement confondus dans le cas des éclats débordants. F. Bordes signalait que leur production était rarement systématique, bien qu'elles soient plus fréquentes dans certains Moustériens. Il faut signaler tout de même une exception à cette affirmation (constatation) : le cas du Moustérien d'Asprochaliko, en Grèce (Papaconstantinou 1989), où ces supports ont non seulement été produits en grande quantité mais où ils ont été sélectionnés régulièrement comme supports pour certains types de racloirs - ce qui traduit bien la possibilité de schémas opératoires orientés vers la production de ces supports, que ces schémas opératoires soient considérés comme de concept Levallois ou non. Dans le cas de notre industrie, à loton, ces supports ne sont proportionnellement pas très nombreux et sont de plus très rarement transformés par la retouche. Leur présence méritait cependant d'être signalée, comme significative de méthodes de débitage (Levallois, discoïde, ou autres).
Nucleus Les nucleus, relativement nombreux (plus d'une centaine), sont parfois d'interprétation difficile parce que souvent fragmentés, phénomène en relation avec la mauvaise qualité de la matière première déjà signalée.
Cependant, à coté de nucleus que l'on peut qualifier d'informes, au moins dans leur stade d'abandon (les plus nombreux), une série non négligeable de nucleus (une quarantaine) est accessible à l'interprétation des stigmates laissés en fin de débitage et peut aider à la compréhension des schémas opératoires mis en jeu. - en premier lieu, il importe de souligner la présence d'une petite série de nucleus de petites dimensions qui sont la résultante d'une exploitation par les méthodes Levallois: méthode Levallois récurrente unipolaire stricte (avec une mise en forme de la surface Levallois par enlèvements centripètes) ou unipolaire orthogonale dans laquelle l'exploitation unipolaire de la surface Levallois se fait successivement selon des directions à 90°. Cette méthode récurrente a été déchiffrée sur 7 nucleus. Par ailleurs, 9 nucleus portent trace du départ d'un grand enlèvement préférentiel qui a fréquemment outrepassé (en partie distale, mais aussi parfois latérale), défigurant ainsi le nucleus et entraînant son abandon. Ils présentent en général une préparation des plans de frappe périphérique et quand elles ne sont pas emportées par l'outrepassage, les traces d'une organisation centripète des enlèvements de préparation de la surface Levallois. Ces stigmates pourraient laisser envisager une méthode Levallois à éclat préférentiel ; mais il est plus probable qu'il ne s'agisse là que d'un ultime stade d'exploitation de nucleus récurrent par le départ d'un dernier grand éclat - phénomène déjà mis en évidence dans des ensembles Levallois. Tous ces nucleus ont cependant, comme point commun, un débitage réalisé dans un plan parallèle au plan d'intersection entre surface de préparation de plan de frappe et surface de débitage Levallois (définition du concept Levallois, Boëda 1986). - une seconde série de nucleus, moins abondante (n=10), présente un plan de frappe périphérique (ou semi-périphérique) à partir duquel ont été débités des enlèvements non préférentiels, non envahissants, de direction sensiblement centripète ou parfois ne passant pas par le centre (direction dite «tangentielle» Papaconstantinou 1989, ou «cordale» Boëda 1995), mais cette fois-ci, obliques, recoupant donc le plan d'intersection entre surface de préparation de plan de frappe et surface de débitage ; ils présentent une section épaisse, grossièrement conique, et correspondent au débitage discoïde vrai (Boëda 1986 : 304 et 1995).
- une dernière série de nucleus (n=19), enfin, plus abondante mais de morphologie moins bien définie, comporte des nucleus sur lesquels les enlèvements, assez rares (2 à 4), sont débités plus ou moins dans un même plan (nucleus plats) à partir de plans de frappe très localisés sommairement aménagés ; ils sont de direction unipolaire ou multipolaire, la méthode n'est pas récurrente. Ces nucleus présentent parfois des contre-bulbes profonds, les enlèvements sont courts, peu envahissants. L'élément frappant est la morphologie plane de la surface d'exploitation préférentielle, sans que ces nucleus ne montrent la moindre trace de prédétermination, Levallois
130
ou non. Il faut signaler, de plus, une petite quantité de nucleus aménagés à partir d'éclats, sur lesquels les Moustériens ont mis à profit les convexités des faces inférieures pour débiter des enlèvements, unipolaires convergents ou centripètes. Mais cette exploitation d'éclats comme nucleus reste un épiphénomène. L'ensemble des nucleus décrits ici ne représente qu'une faible partie du matériel disponible. Il importait cependant de les décrire, en particulier parce qu'ils semblent difficiles à relier à la production majoritaire décrite dans ce niveau. En effet, si la production Levallois , que l'on peut considérer comme faible pour le nombre de nucleus Levallois identifié, est probablement liée cependant à ces nucleus, peut-on supposer que les produits pseudo- Levallois sont partiellement le résultat de l'exploitation des nucleus discoïdes dont ils sont l'un des produits caractéristiques (cf. Asprochaliko) ? Les éclats courts épais sont-ils obtenus dans ces débitages assez conjecturaux dont la surface de débitage préférentielle porte l'empreinte d'enlèvements courts et profonds ? Peuvent- ils intervenir également dans les débitages discoïdes identifiés ? Ces différentes productions sont-elles indépendantes, ou successives, intriquées, du moins pour certaines d'entre elles, sur un même bloc ? Autant de questions actuellement non encore résolues. Comme nous l'avons dit antérieurement, le décryptage de ces schémas de débitage n'en est encore qu'à ses débuts...
A coté des produits Levallois (éclats et nucleus) déjà décrits, il faut signaler la présence d'éclats débordants Levallois nets qui prouvent que la méthode Levallois, si elle n'était pas la règle, était bien dominée. Il est certain que les petites dimensions des galets de silex ne facilitaient pas l'emploi de cette méthode de façon systématique. Mais l'existence de la série de petits nucleus (3 à 4 cm) montre cependant les capacités de ces Moustériens à dominer ce genre de problème s'ils le désirent. Outillage retouché (Fig. 18 et 19) Les outillages retouchés, peu abondants (11 % du matériel), comprennent majoritairement des racloirs (IRess = 70,2), fréquemment sur supports corticaux, courts et épais ; les dos corticaux ne sont pas abondants, les faces supérieures largement corticales le sont beaucoup plus. Les retouches écailleuses scalariformes, si elles sont présentes, sont souvent non continues sur tout le tranchant et assez irrégulières (retouches 1/2 Q). Par contre, certaines petites pièces épaisses, souvent allongées, montrent un phénomène intense d'aménagement par la retouche (souvent de morphologie écailleu- se scalariforme) traduisant les affûtages successifs. C'est ce qui a pu être observé, de toute évidence, pour les petites pointes moustériennes courtes et épaisses, pour certains racloirs simples et pour les denticulés. Par contre, les racloirs transversaux ne présentent pas de réaffûtage intense, comme nous avons pu le décrire dans des séries Quina telles que Marillac. Les observations que nous avons pu formuler pour les éclats peuvent
être répétées ici : même si les supports sont courts et épais, ils ne dégagent pas la même impression de massivité que ceux décrits dans les Charentiens Quina types. On peut s'interroger sur l'influence de la matière première dans ce cas : les petites dimensions des nucleus limitent les possibilités d'obtention de grands éclats supports dont la zone bulbaire est alors très épaisse. Les petits galets, à cause de leur relative faible épaisseur, ne permettent pas l'obtention de ces très épais supports sur lesquels les outils, en fin de vie, atteindront les fortes épaisseurs, qui, elles, bien sûr facilitent l'»étagement» de la retouche écailleuse scalariforme et la rendent typique. Le caractère scalariforme de cette retouche existe cependant clairement ici, même s'il n'est pas largement étendu.
Il est intéressant de noter par ailleurs, à propos de cette industrie, que la rareté et les petites dimensions des matières premières ne semblent pas avoir conduit à une exploitation maximale de chaque support par la retouche ; si certains produits, comme nous l'avons signalé, ont été affûtés plusieurs fois, le procédé n'est pas systématique et la proportion de produits retouchés n'est pas très forte. L'exploitation du matériau y semble moins intense, par exemple, qu'à Combe-Grenal où des éclats de plus grande taille étaient disponibles à proximité.
4.2.2 - Le gisement du Brugas, Vallabrix, Gard
Le gisement du Brugas a été découvert et fouillé lors de travaux de carrière. Pour autant que l'on ait pu en juger, vu les conditions de fouille, il s'agissait d'un fond d'abri sous roche comportant plusieurs niveaux d'occupation. L'occupation la plus intense, la couche 4, a livré une industrie lithique abondante, datée de 63 000 + 5 800 ans BP par la thermoluminescence (Valladas et al. 1987), associée à des niveaux charbonneux ; la faune n'était pas conservée. Les matières premières utilisées (presque uniquement du silex dans la couche 4) proviennent des niveaux du Cénomanien supérieur affleurant à moins de 5 km du site (en position primaire donc) ou des alluvions du petit ruisseau, le Coucouyon, lui aussi à faible distance. Pièces supports
Le débitage comprend cette fois encore des éclats courts, à bulbe de percussion très prononcé, mais relativement mince. Les talons lisses sont aussi dominants mais ils ne sont pas très larges et rarement clactoniens. Les angles d'éclatement entre face inférieure et talon sont rarement ouverts (supérieurs à 110°) et en conséquence, l'aspect massif des éclats rencontrés dans le faciès Quina classique n'est pas fréquent ici. Les supports corticaux sont pourtant assez abondants, sans que l'on retrouve de façon aussi systématique les dos corticaux enveloppants et les éclats à talon-dos, morphologies de supports bien mises en évidence dans les Charentiens Quina du Périgord. Nous le verrons plus loin, un certain nombre d'outils sont cependant établis
131
Fig. 19 : Gisement de pied de roche de loton, Beaucaire, Gard. 1 Racloir double sur support Levallois.
2-4 Éclat débordant. 5 Nucleus Levallois. 6 Petit nucleus (Levallois ?) recyclé en outil. (Dessin M. Reduron). Fig. 19 : Site at the foot of the roche de loton, Beaucaire, Gard. 1 Double scraper on a Levallois blank. 2-4 Core edge removal flakes (éclat débordant). 5 Levallois core. 6 Small core (Levallois?) recycled into a tool, (drawing by M. Reduron).
Fig. 18 : Gisement de pied de roche de loton, Beaucaire, Gard.
1, 2 Racloir simple convexe largement réaffûté. 3 Racloir double. 4 Grattoir associé à un racloir. 5 Pointe moustérienne. 6 Racloir à retouche biface. 7 Racloir transversal aminci sur la face inférieure. (Dessin M. Reduron). Fig. 18 : Site at the foot of the roche de loton, Beaucaire, Gard.
1, 2 Single convex scraper, heavily reduced. 3 Double scraper. 4 Endscraper associated with a sidescraper. 5 Mousterian point. 6 Bifacially retouched scraper. 7 Transverse scraper, thinned on its inferior surface, (drawing by M. Reduron).
132
sur des éclats courts et épais, corticaux, qui ne semblent pas être majoritaires dans la totalité du débitage. A coté de cette production, ont été également identifiés une faible proportion de produits Levallois (ILtechn = 8,1), généralement des éclats, de préparation centripète (Fig. 21 n° 1 à 3). Les produits Levallois symétriques, bien centrés et d'assez grandes dimensions sont rares; ils ont cependant été parfois choisis comme support d'outils retouchés. En général, la production Levallois est de petite taille, assez irrégulière, asymétrique, pouvant correspondre à une direction de percussion plus tangentielle que réellement dirigée vers le centre. Quelques vrais éclats débordants sont présents, mais il faut signaler encore l'existence d'une petite série de produits «pseudo-Levallois» (éclats à dos débordant limité, fig. 21 n° 5 et 6) comme déjà décrits dans l'industrie de loton. Ces produits ne présentent cependant pas de base épaisse, comme on pourrait l'attendre dans un débitage discoïde systématique.
Nucleus Les nucleus, assez abondants (n=140), sont le plus souvent d'interprétation difficile, sans organisation évidente des enlèvements par ailleurs peu nombreux. Cependant, une petite série de nucleus permet de retrouver les catégories décrites précédemment dans l'industrie de loton : - un premier groupe de nucleus plats (n=10) présente des enlèvements de direction centripète, envahissants, obtenus à partir de plans de frappe préparés sur toute la périphérie ; le débitage se fait sensiblement dans un plan parallèle au plan d'intersection entre les deux surfaces (préparation de plan de frappe et débitage) : ils peuvent donc être considérés comme le résultat d'un débitage Levallois récurrent, centripète le plus souvent (Fig. 21 n° 4).
- quelques rares nucleus (n=3), plus globuleux, présentent eux aussi des enlèvements de direction plus ou moins centripète mais cette fois, les plans de fracture sont obliques par rapport au plan sécant entre surface de préparation de plan de frappe et surface d'exploitation ; ils évoquent donc le débitage discoïde au sens strict précédemment décrit. - enfin, une série de nucleus sur éclat (n=5) montre des enlèvements, à contre bulbes marqués, de direction orthogonale ou opposée à partir de plans de frappe aménagés mais limités. Peut-être de façon moins nette, cependant les mêmes morphologies de nucleus que dans la série de loton ont été identifiées ici. Et se trouve soulevé le même problème des relations à établir entre la production majoritaire et ces nucleus en état d'abandon. Outillage retouché (Fig. 20 et 21)
Les outillages retouchés, proportionnellement peu nombreux (8 % de l'ensemble), comportent majoritairement
des racloirs et des pointes (IRess = 64,3 ; Mess = 66,3). Un certain nombre de produits retouchés sont effectivement sur supports épais, avec cortex ou non ; ils ne semblent pas appartenir à une phase particulière de la chaîne opératoire (phase de mise en forme par exemple). Ce sont ces outils, (souvent des racloirs simples, des pointes ou des racloirs convergents,) qui présentent les retouches écailleuses scalariformes les plus typiques, surtout développées sur les parties les plus épaisses du tranchant. Certains outils caractéristiques du Charentien Quina comme les tranchoirs (retouches bifaces et enlèvements piano-convexes) sont présents et bien typés. Les pièces à bords convergents, assez nombreuses (14,3 %), comportent surtout des pointes moustériennes, courtes sur supports épais, fortement retouchées et des racloirs convergents (ces derniers peu acuminés). De même, l'intensité de la retouche n'est pas un caractère général de cette industrie, mais une spécificité de certains supports sur lesquels elle est alors très marquée. Le réaffûtage est par ailleurs attesté par des éclats d'affûtage de pointes moustériennes, de racloirs convergents et par le caractère abrupt d'un certain nombre de fronts de racloir. Cependant ces traits ne sont pas dominants ; et on peut noter une légère sélection de supports Levallois pour les outils retouchés (malgré une faible production) et en particulier, les racloirs doubles semblent être établis sur supports minces, Levallois, et ils présentent des retouches marginales.
L'impression générale donnée par cet outillage est la présence de pièces retouchées (pointes moustériennes, racloirs simples et transversaux, racloir associé à un grattoir) portant tous les éléments significatifs des Charentiens de type Quina (support épais, cortical, retouches écailleuses scalariformes, intensité de la retouche) sans que ces outils soient majoritaires. Cela explique bien évidemment la première détermination qui en avait été faite. 4.2.3 - Autonomie du «Charentien atypique»
Si l'on veut maintenant tenter d'établir un bilan succinct de ce groupe Charentien atypique, nous nous retrouvons, en seconde analyse, dans le même embarras. Si tout ce qui concerne la phase de gestion des outillages semble, du moins en partie, comparable à ce qui a pu être décrit dans le cas des outillages du Charentien Quina du Périgord et de Charente, les phases de fabrication des supports, ou plus exactement au stade actuel de nos connaissances, ces supports eux-mêmes, semblent être largement différents. Décrits comme «éclats épais à talons lisses», dans une première approche techno-typologique classique, il est évident que ce premier réexamen nous conduit à souligner d'importantes différences dans la morphologie des supports (débitage clactonien au sens strict, peu marqué, en particulier). Cette morphologie résulte bien sûr d'une méthode d'exploitation différente des blocs, au niveau des plans de frappe et de la localisation des points d'impact ; sans aucun doute aussi, elle traduit des enchaînements de gestes différents. A l'autre bout de la chaîne, nous l'avons vu, apparaissent des mor-
133
Fig. 20 : Gisement du Brugas, Vallabrix, Gard. 1 Grattoir dégagé par deux encoches, associé à un racloir. 2 Pointe moustérienne courte et épaisse, sur nucleus. 3 Grattoir associé à un racloir. 4 Racloir transversal. 5 Racloir simple convexe. 6 Racloir à retouche biface et piano- convexe. (Dessin M. Reduron).
Fig. 20 : Gisement du Brugas, Vallabrix, Gard. 1 Endscraper defined by two notches, associated with a sidescraper. 2 Short and thick Mousterian point on a core blank. 3 Endscraper associated with a sidescraper. 4 Transverse scraper. 5 Single convex scraper. 6 Scraper with bifacial and plano-convex retouch, (drawing by M. Reduron).
Fig. 21 : Gisement du Brugas, Vallabrix, Gard.
1, 2 Éclat Levallois asymétrique. 3, 5 Pointe pseudo-Levallois. 4 Nucleus Levallois récurrent centripète. 6 Grattoir associé à un racloir. 7 Racloir simple convexe. 8 Racloir convergent à base amincie par retouche biface.
Fig. 21 : Gisement du Brugas, Vallabrix, Gard. 1, 2 Asymmetric Levallois flake. 3, 5 Pseudo- Levallois point. 4 Recurrent centripetal Levallois core. 6 Endscraper assoicated with a sidescraper. 7 Single convex scraper. 8 Convergent scraper with its base thinned by bifacial retouch, (drawing by M. Reduron).
134
phologies de nucleus non présentes dans les Charentiens Quina (nucleus Levallois récurrents, nucleus discoïdes vrais), que l'on serait tenté, en particulier le second, de prendre comme résultat final de la production de nos supports épais. Mais de plus amples recherches sur l'ensemble de ces éléments doivent être effectuées avant d'en avoir la certitude. Ainsi donc le problème soulevé au début de ce travail, de la variabilité géographique du Charentien de type Quina, apparaît plus important que soupçonné. Plus qu'une simple variabilité, peut-être s'agit il d'un schéma opératoire différent, du moins dans sa phase de production des supports, qui peut, ici, être mis en évidence, traduisant l'existence d'un système de production lithique lié, dans l'état actuel de nos connaissances, à des méthodes récurrentes, souvent centripètes. Mais il reste à déterminer si l'on peut parler dans cette production de coexistence de schémas opératoires différents (Levallois, discoïde ou autre) ou si l'on a affaire à un système mixte dont les morphologies de nucleus identifiées illustreraient différents stades. Cette variabilité souligne bien là encore les limites des recherches jusqu'alors effectuées dans ce domaine. Les résultats de ces analyses montrent combien l'approche technologique permet d'affiner notre compréhension de la complexité des connaissances techniques des Moustériens dans le domaine du lithique.
5 - CONCLUSIONS (JMG, JJ, ML, LM, AT) La prise en considération systématique de toutes les informations d'ordre technique contenues dans les ensembles lithiques attribués aux Moustériens charentiens, en ne privilégiant plus l'approche typologique des seuls outillages, autorise une nouvelle synthèse des données pour la période et l'aire géographique choisies pour cadre de ce travail collectif. 5.1. - Individualisation du Moustérien de type Quina au sein des Moustériens Au sein du Moustérien Charentien analysé ici, il apparaît clairement que dans tous les cas ce sont des industries caractérisées par un outillage essentiellement sur éclats obtenu par débitage et possédant des caractéristiques technologiques assez strictes. Ce sont tout d'abord ces dernières qui permettent avant tout d'effectuer au sein de l'ensemble Charentien (sous-ensemble essentiellement typologique) une première séparation de deux ensembles qui s'avère toujours pertinente pour le groupe moustérien dans sa totalité, ce qui lui confère une validité paradigmatique plus large et mieux établie. Cette séparation repose sur des bases techniques qui permettent de séparer deux grands groupes de conception du débitage et par conséquent deux types de production de l'outillage lithique. L'un correspond au Moustérien Charentien de type Quina strict ; il se caractérise par différents débitages prédéterminés réalisés sur des surfaces de débitage de nucleus dont l'exploitation peut être soit récurrente, et dans ce cas pourrait s'apparenter à
une conception discoïde du débitage (Boëda 1995), soit beaucoup plus sommaire telle qu'elle apparaît aux Tares niveau 1 et à La Micoque couche 3. Ces débitages produisent dans tous les cas des enlèvements épais et courts, parfois assez larges, jamais allongés si ce n'est au début du processus et ce sont alors des produits corticaux ou des couteaux à dos naturels.
L'outillage demeure largement caractérisé par des racloirs à retouche Quina. Celle-ci, étroitement dépendante de la morphologie et surtout de l'épaisseur des supports, est déterminée par un ensemble de caractères qui ne se retrouvent pas dans un autre type de retouche. Celle-ci a une finalité fonctionnelle évidente et s'obtient par une séquence de gestes particuliers. La maintenance fonctionnelle, qui peut dans certains cas prendre une grande ampleur sur la surface du support, participe pour une large part à la caractérisation de la chaîne opératoire de production de l'outillage du Moustérien de type Quina. Le contexte techno-économique de ces industries Quina ne peut à l'heure actuelle être précisé que par l'économie des matières premières et l'organisation spatiale régionale des territoires d'approvisionnement qui peut en être déduit et qui sont apparemment de même type. Une interprétation fonctionnelle de ces industries au sein des sites et des territoires économiques fondée sur d'autres onnées telles que les activités de subsistance et la prise en compte de l'exploitation des ressources organiques (faune, chasse...) devrait être enfin possible dans un avenir proche.
L'autre ensemble est constitué des systèmes de production fondés sur un débitage de type Levallois qui correspond alors au groupe des Moustériens de type Ferrassie, caractérisé par des produits plus allongés et assez minces et supportant des outils plus diversifiés comme dans les autres Moustériens. 5.2. - Cadre chronologique du Charentien de type Quina Sur la base des données présentées tout au long de cet article, les industries antérieures à l'avant-dernier inter- glaciaire telle que celle de La Micoque couche 3, antérieure à 300 000 ans B.P. (Delpech et al. 1995) et des Tares, de la fin de la période rissienne (Bertran et Texier 1990, Delpech et al. 1995) présentent bien toutes les caractéristiques des Moustériens Quina identifiés en contexte wùrmien dans le sud de la France.
Le système de production des éclats semble toutefois être fondé sur des conceptions plus élémentaires dont l'appartenance à la famille discoïde doit être encore discutée puisque le débitage s'effectue de manière peu ou pas récurrente et sur des surfaces peu ou pas convexes qui ne sont ni entretenues ni réexploitées par des enlèvements prédéterminants mais par un système hiérarchisé en réseaux non linéaires exploitant des surfaces naturelles ou brutes de débitage.
135
Par contre, la retouche Quina dans tout son processus, y compris sa maintenance, et l'exploitation des sous-produits de sa maintenance, y est remarquable tant à La Micoque qu'aux Tares. Les relations fonctionnelles de cette retouche et des catégories d'outils toujours peu diversifiées avec des activités techniques sur des matériaux carnés constituent une voie de recherche actuellement étudiée aux Tares. 5.3. - Variabilité du Mousterien charentien
Si une entité charentienne qui pourrait regrouper des Mousteriens charentiens de type Quina semble bien s'i
ndividualiser dès le Riss, parce qu'elle peut se caractériser par la possession de systèmes techniques de production d'outils sur éclats identiques ou en tout cas très proches en leur structure, leur conception et leurs chaînes opératoires, il en découle qu'un autre ensemble constitué des autres Charentiens s'en distingue. Mais, autant le groupe des Mousteriens Quina est homogène par rapport aux autres Mousteriens, autant le groupe résiduel qui renferme entre autres le Mousterien de type Ferrassie est plus difficile à organiser que ce soit sur le plan du débitage, souvent Levallois, mais pas selon des méthodes identiques, de la sélection des supports de la retouche ou de la typologie de l'outillage au sens habituel du terme, ces industries se distinguent du Quina. Cependant, elles ne présentent pas de caractère distinc- tif évident avec les autres Mousteriens mais plutôt des analogies qui conduisent à y voir plutôt un continuum reliant le Mousterien Ferrassie au Mousterien de Tradition Acheuléenne et au Mousterien typique. La littérature abonde en diagnostics différentiels cauteleux entre ces trois faciès. F. Bordes préférait d'ailleurs parler de groupes Quina-Ferrassie essentiellement à cause d'un manque d'homogénéité du Ferrassie et parce qu'il avait initialement fondé l'archétype charentien sur un caractère typologique quantitatif : l'abondance des racloirs. Si l'on prend en compte d'autres références telles que les systèmes techniques, il n'y a plus lieu de vouloir conserver une distinction fondée sur d'autres paramètres.
Parmi les différents facteurs susceptibles d'intervenir dans l'interprétation de la variabilité des faciès mousteriens, il est encore fréquemment fait allusion à la disponibilité en ressources lithiques. La forte amplitude de la retouche Quina de ce type d'industrie a en effet soit été mise en relation avec un argument de carence de matière première, donc de supports, ayant entraîné un usage prolongé et un recyclage de l'outillage et des produits. Or, aucune étude techno-économique n'a été conduite dans le but de tester ce type d'hypothèse. Or, dans certains cas, il est clair qu'une matière première abondante était disponible dans l'environnement immédiat si ce n'est sous les pieds des tailleurs et que des industries de type Quina mais aussi différentes ont été produites dans les mêmes conditions d'approvisionnement. En fait, tous les facteurs économiques mais aussi environnementaux, techniques et plus strictement liés aux traditions doivent
être pris en considération de manière globale et non pas isolée. 5.4. - Autres Mousteriens apparentés au Charentien
Le problème des convergences de faciès au sein du Mousterien dans son ensemble comme au sein du Mousterien charentien dans l'état actuel des données n'est qu'un artefact analytique résultant de la situation paradigmatique qui prévaut dans la définition bordienne des assemblages mousteriens. De nouvelles données étant en cours d'élaboration sur les bases techniques évoquées plus haut, il est encore prématuré de préjuger du résultat final. Mais on peut tout de même signaler l'évidence et l'homogénéité dès le Riss de plusieurs systèmes techniques de production qui se distinguent au sein du Mousterien et peuvent correspondre au groupe Quina bordien.
L'ensemble des autres Charentiens, que ce soit le Ferrassie ou les Charentiens atypiques identifiés en Languedoc oriental, demeure dans ce cas et pour l'instant en attente dans le polymorphisme mousterien de cette aire géographique.
La question de la coexistence et de la contemporanéité de différentes chaînes opératoires et conceptions au sein d'une même production lithique permet d'élargir à d'autres types de Mousteriens la question de la variabilité technologique charentienne.
Si dans l'aire géographique prise en considération, il est possible d'identifier clairement des industries conçues exclusivement et à partir du débitage d'éclats et composées d'un petit nombre d'outils sur éclats parmi lesquels les racloirs sont dominants, il existe d'autres ensembles lithiques mixtes où peuvent coexister (mais ce sont souvent des séries provenant de recherches anciennes dont les unités stratigraphiques ne peuvent plus être examinées en terme de niveaux d'occupation et de palimpsestes) plusieurs conceptions de production ou en tout cas plusieurs types de chaînes opératoires. Ainsi, une production typiquement Quina pourrait coexister avec une production discoïde qui reste à définir dans le sud de la France comme à Combe-Grenal (cf. plus haut).
Levallois et production de supports épais avec retouches Quina existeraient ensemble au Mas Viel, à la grotte du Figuier mais aussi au Proche-Orient (Tabun niveau 1 0). Levallois et laminaire pourrait être associés en Europe occidentale comme à Riancourt-les-Bapaume, fouilles de A. Tuffreau. Une production bifaciale est associée au sein de différentes industries à une production d'outils à retouche Quina aussi bien en Europe avec le Micoquien d'Europe centrale et orientale que dans des industries comme Champlost et au Proche-Orient dans l'Acheuléo-yabrou- dien. Dans cette dernière région, à Tabun, l'Amoudien est caractérisé par une retouche écailleuse scalariforme nettement Quina sur des produits de débitage laminaires.
136
5.5 - Perspectives diachroniques 5.6 - Synthèse
Dans les groupes qui précédent, il a été mis en évidence l'apparition dès le Riss de systèmes techniques qui paraissent très étroitement apparentés avec ceux qui ont été par ailleurs décrits dans le Moustérien Quina d'âge wûrmien. Ces systèmes sont identifiés dans un cadre spatio-temporel tellement dilaté qu'il est inconcevable, par rapport à l'échelle chronologique de développement des cultures humaines, d'envisager qu'il puisse s'agir d'une même filiation qu'elle soit technique ou plus largement culturelle. La notion de contemporanéité et d'épaisseur temporelles au cours du Paléolithique moyen n'autorise nullement de telles conceptions si ce n'est en formulant de nouvelles hypothèses relatives à la permanence, à la stabilité et à la notion de culture pour ces périodes. La seule observation de la répartition spatiale et chronologique de ces industries nous conduit seulement à observer une récurrence dans l'apparition de ces systèmes techniques largement étalés dans le temps entre 300 000 ans et 50 000 ans B.P. et dans toute l'Europe avec une concentration plus forte en Europe occidentale après le dernier interglaciaire. Celle-ci doit découler de la réapparition dans des conditions environnementales et technoéconomiques favorables de mêmes solutions techniques ou de formes analogues d'organisation de la production technique, ce qui est tout à fait possible pendant une période de l'ordre de 250 à 300 000 ans au cours de laquelle cette récurrence s'accélère progressivement pour être à son apogée entre 100 000 et 50 000 B.P.
Quant à la mise en évidence d'une tradition technique, on peut la concevoir à deux niveaux. D'une part, tout système de production technique d'un outillage est bien le fruit d'une tradition culturelle, il n'est pas le produit du hasard mais l'aboutissement de tout un contexte et d'une expérience cumulée par des générations. Mais de là à établir une continuité logique, en termes de tradition et donc la transmission culturelle d'un savoir et des savoir- faire pour des données dont nous n'avons jamais la preuve de la contemporanéité absolue à la génération près mais qui sont seulement datées par des méthodes (au mieux) numériques dites absolues, il y a un pas impossible à franchir pour le Paléolithique inférieur et moyen. Il est possible d'attester que les traditions ont existé lorsqu'elles ont coexisté avec d'autres différentes qui leur étaient strictement contemporaines à l'échelle de la signification des cultures. Lorsque nous sommes seulement en mesure de constater leur apparition isolée dans un réseau dont la densité spatio-temporelle n'implique aucune probabilité de contemporanéité, peut-on légitimement envisager une filiation culturelle ? D'autres interprétations doivent être ici proposées mais strictement adaptées à la nature des données et intégrant le maximum de paramètres les définissant notamment ceux qui sont relatifs à l'épaisseur des tranches temporelles et à la répartition spatiale.
L'approche technologique des industries charentiennes du Sud-Ouest et du Languedoc, basée sur la compréhension du système de production des outillages, permet d'envisager sous un jour nouveau ce qui était reconnu comme l'entité «Moustérien Charentien». Prenant en compte toutes les phases de la chaîne opératoire, et en particulier bien sûr les méthodes de production de supports, la gestion et la maintenance des outillages retouchés, ces recherches ne font que souligner l' hétérogénéité du Moustérien Charentien (groupe déjà difficile à délimiter sur les bases techno-typologiques classiques) et conduisent à le faire disparaître en tant qu'unité. Les deux Moustériens, de type Quina et de type Ferrassie, apparaissent comme trop différents dans leurs méthodes de production et de gestion des outillages pour que, sur la seule base d'une forte représentation des racloirs, on puisse les considérer comme un même ensemble.
Le bilan effectué dans cette région montre au contraire \' individualisation d'une chaîne opératoire «de type Quina», quelle que soit la signification que l'on en donne ensuite. Il a été possible de définir une série de comportements techniques qui se répète dans ses grandes lignes d'un Charentien de type Quina à l'autre. Son interprétation en termes de traditions techniques, et/ou de contraintes extérieures (morphologie, disponibilité en matières premières, mobilité du groupe) et/ou de fonctionnalité (du site, des outils), n'intervient que dans une seconde étape.
Semble donc s'individualiser un système de production lithique orienté vers l' obtention de supports courts et épais présentant un bord retouché plus long fréquemment opposé à un dos, qu'il s'agisse d'un véritable dos de débitage, cortical ou du talon, ce qui donne à ces pièces une section très nettement asymétrique et triangulaire. Si les caractéristiques du débitage sont assez bien connues (plans de frappe lisses, larges ; angles d'éclatement très ouverts, conservation de zones corticales importantes), l'enchaînement des gestes techniques qui permet de les obtenir n'est pas encore totalement élucidé ; quelques constantes apparaissent cependant déjà, comme le maintien de plans de frappe orthogonaux lors des différents changements d'orientation du débitage. Ces Charentiens de type Quina se caractérisent par ailleurs par l'importance de la séquence de maintenance des outils : forts taux de transformation des supports, intensité de la retouche sur chacun d'entre eux par l'emploi de la retouche écailleuse scalariforme et ravivages successifs de grande ampleur. La retouche présente des caractéristiques spécifiques obtenues par des gestes techniques précis ; elle semble destinée à établir un caractère déterminé du tranchant et pourrait alors avoir un but morpho-fonctionnel. Plus aisée à identifier sur les supports épais, elle est donc de fait plus nette dans les séries où le réaffûtage est un phénomène fréquent (ex : série en silex importé de Marillac). Mais elle ne doit pas être confondue avec les retouches abruptes devenant scalariformes que l'on obtient lors du
137
réaffûtage de supports même minces ainsi qu'à Bisitun (Dibble 1984). La vraie retouche Quina ne peut donc être considérée comme conséquence des seuls phénomènes de ravivage des bords d'outils. Ce geste technique doit être analysé dans un contexte économique et fonctionnel d'une part et dans le cadre de traditions techniques d'autre part.
C'est la combinaison des deux éléments : production de supports larges et épais, fréquence et amplitude des retouches qui peut permettre de caractériser ce système de production. Dès la période rissienne, apparaît dans cette région une méthode de production et de gestion des supports de ce type (La Micoque c.3 et Les Tares niveau 1).
Il est donc intéressant de souligner l'existence de ce courant technique très tôt individualisé par rapport à d'autres, différents, également présents dans la région. Cette ressemblance n'implique en rien des relations directes, voire des filiations entre ces assemblages, par ailleurs trop distants dans le temps pour que l'on puisse y apporter quelque crédit. Ces résultats signifient seulement l'apparition au cours de longues périodes et de manière récurrente de différentes conceptions de l'outillage moustérien dans le sud de la France.
La synthèse des données recueillie dans cette région pour les Moustériens de type Ferrassie aboutit au contraire à souligner une large variabilité, surtout si l'on considère les séquences de production de supports et de gestion des outils retouchés et les méthodes et conceptions qui les régissent. En effet, selon les méthodes de débitage Levallois utilisées, les morphologies des supports vont varier (courts, allongés, laminaires) entraînant des variations dans les outillages. Ainsi les fortes proportions de pièces convergentes, considérées comme un élément important de l'outillage du Charentien de type Ferrassie, semblent plus spécialement liées au débitage Levallois uni/bipolaire comme à Biache (Tuffreau 1986, Tuffreau et Somme 1988) ou dans les Moustériens du Zagros. Au contraire, des industries comme Artenac, au débitage Levallois majoritairement centripète, n'en présentent que de faibles quantités. Le phénomène semble donc plutôt lié aux méthodes Levallois mises en jeu ; il ne constituerait pas une caractéristique de tous les Moustériens de type Ferrassie. D'autre part, les exemples que nous avons pu traiter montrent également de larges variations dans le développement de la séquence de retouche des outillages. Si certaines industries comme Combe-Grenal c.35 montrent, en effet, une intense utilisation de chaque support et une forte proportion de pièces aménagées, ce comportement ne semble pas être la règle ; au contraire, nombre d'assemblages de type Ferrassie comportent des supports, en particulier Levallois, non transformés, ou aménagés seulement par des retouches peu profondes.
Il ne semble donc pas possible d'associer au Moustérien de type Ferrassie l'idée d'un fort degré de transformation
des supports. Les résultats obtenus sur ce point par les travaux de N. Rolland doivent donc être modérés ; ils pourraient être, pour partie, la conséquence d'un trop faible échantillon de sites.
Ces quelques réflexions soulignent donc l'impossibilité actuelle de regrouper les Charentiens de type Ferrassie dans un ensemble technologique commun et les rejettent, dans la famille des Moustériens de débitage Levallois (avec certains Moustériens typiques et Moustériens de Tradition Acheuléenne, en particulier). Les méthodes de débitage mises en jeu constitueront, du moins pour partie, les seuls critères d'approche de leur variabilité.
L'analyse technologique préliminaire des Charentiens atypiques du Languedoc soulève l'existence possible de systèmes techniques de production lithique non encore éclaircis se traduisant par la présence de supports épais mais non «clactoniens» de produits pseudo-Levallois, de nucleus discoïdes vrais et de nucleus Levallois récurrents centripètes ; par contre, la séquence de retouche, du moins sur certains support semble être comparable à ce qui a été décrit dans les Charentiens Quina. L'intérêt de cet ensemble est donc de souligner l'existence probable d'autres systèmes de production de supports non encore identifiés.
De façon plus générale, il est clair que les recherches récentes sur le Paléolithique moyen ont pour principal résultat la mise en évidence de la diversité des facteurs intervenant dans la variabilité des assemblages moustériens (Dibble et Rolland à paraître). Au-delà du débat réducteur qui prétendait l'interpréter en termes de culture ou de fonction ou d'évolution chronologique, la production d'un outillage est conçue aujourd'hui comme le résultat de la superposition de différents facteurs dont le caractère déterminant va varier d'un site à l'autre. Il est sans doute illusoire de compter déterminer un facteur explicatif fonctionnant dans toutes les situations. L'ensemble des éléments déterminants possibles doit donc toujours être gardé en mémoire.
Les conditions d'accès à la matière première lithique doivent toujours en premier lieu être discutées avant de proposer une interprétation de l'utilisation intensive des supports. Seule une pénurie de matière première dûment fondée sur des recherches paléo-environnementale géomorphologiques et climatiques peut justifier un comportement d'économie des supports, leur réutilisation intense et, par conséquent, une forte proportion de pièces retouchées. Aussi, dans certains cas comme à la Cotte de St Brelade (Callow et Cornford 1986) une réduction notoire de l'accès aux roches locales semble être un facteur déterminant la surconsommation des produits. Dans d'autres comme à Tabun, l'Acheuléo-yabroudien et le Moustérien à débitage Levallois, dans les mêmes conditions apparentes d'accès aux sources de silex des comportements techniques nettement différents sont attestés.
138
Quant au Charentien de type Quina, l'exploitation intensive des supports (forte proportion de pièces retouchées et de pièces réaffûtées, recyclées) semble bien être un des éléments qui le caractérise, nous l'avons vu. Mais cet élément ne suffit pas puisque le même comportement appliqué sur des supports minces conduit à des assemblages radicalement différents, dont les Moustériens du Zagros où certains Moustériens de type Ferrassie sont de bons exemples. Le caractère primordial reste donc la production de supports épais auquel vient s'ajouter le comportement d'exploitation intensive de supports, celui-ci étant lié ou non, selon les cas, aux conditions économiques et environnementales d'accès à la matière première.
Pour conclure, les modalités et les conceptions de la production de supports semblent devoir être considérées comme des caractéristiques essentielles de ces assemblages dont il importe de bien reconnaître les facteurs déterminants.
Méthodologiquement cela revient à dire qu'il est nécessaire d'appréhender dans leur totalité et de manière globale les éléments participant à la définition d'un système
de production lithique. D'ordre technique mais aussi environnemental et économique, ils sont tous des facteurs potentiellement discriminants dans l'interprétation de la variabilité des assemblages moustériens. Ils peuvent être directement corrélés à des comportements techniques qui, tels que dans le Charentien de type Quina, vont se reproduire de manière analogue pendant *de longues périodes du Paléolithique moyen.
Il importe donc de rationaliser dans cette variabilité et dans cette régularité de comportements la part qui revient à des facteurs économiques et fonctionnels au sens large.
C'est ensuite seulement que ces lignées techniques que l'on peut suivre diachroniquement peuvent être considérées comme l'expression de traditions techniques plus ou moins durables et éventuellement récurrentes dans le temps et l'espace.
Remerciements : Je tiens à exprimer ma reconnaissance amicale en premier lieu à Jean-Pierre Texier de l'Institut de Préhistoire et de géologie du Quaternaire, Talence, France qui m'a permis de travailler sur le matériel de ses propres recherches dans la vallée de l'isle et plus particulièrement sur ses fouilles personnelles du gisement des Tares ; aux signataires de cet article avec qui les échanges ont été animés et fructueux ; aux membres de la Direction des Antiquités Préhistoriques d'Aquitaine qui ont à des degrés divers collaboré à la mise en forme de cet article : Christine Monier, Christèle Jousserand, Monique Sigaud, Jean-Paul Lhomme. Les industries lithiques de La Micoque ont été étudiées dans le cadre du programme de recherches interdisciplinaires entrepris et coordonné entre 1986 et 1994 par J.-Ph. RigaudetA. Debénath. (J.-M. Geneste)
Madame D. de Sonneville-Bordes nous a donné toutes facilités d'examiner les industries de Combe-Grenal (fouilles F. Bordes), nous lui en sommes très reconnaissants. (M. Lenoir, A. Turq).
139
BIBLIOGRAPHIE
BERTRAN, P. et TEXIER, J.-P. 1990. L'enregistrement des phénomènes pédo-sédimentaires et climatiques dans les dépôts colluviaux d'Aquitaine : l'exemple de la coupe des Tares. In Méthodes et concepts en stratigraphie du Quaternaire européen. Actes du colloque international, Dijon 5-7 décembre 1988. Quaternaire, vol. 1, n°1 , p. 77-90, fig.
BOËDA, E. 1986. Approche technologique du concept Levallois et évaluation de son champ d'application : étude de trois gisements saaiiens et weichseliens de la France septentrionale. Paris : Université de Paris X. 3 1., 181 p. Thèse N.D. : Lettres : Université Paris X-Nanterre: 1986.
BOËDA, E., GENESTE, J.-M., MEIGNEN, L 1990. Identification de chaînes opératoires lithiques du Paléolithique ancien et moyen. Paléo, n°2, p. 43-80, fig.
BOËDA, E. 1995. Caractéristiques techniques des chaînes opératoires lithiques des niveaux micoquiens de Kùlna (Tchécoslovaquie). In Les industries à pointes foliacées en Europe centrale. Actes du colloque de Miskolc. Paléo ; suppl. 1. 1995.
BOËDA, E. et VINCENT, A. 1990. Rôle plausible de l'os dans la chaîne de production lithique à La Quina : données expérimentales. In : Les Moustériens charentiens, pré-actes du Colloque de Brive, 26-29 août 1990, p. 51- 52.
BORDES, F. 1953. Essai de classification des industries moustériennes. Bull. Soc. préhist. fr., t. L, n° 7-8, p. 457- 466, fig.
BORDES, F. 1961. Typologie du Paléolithique ancien et moyen. Bordeaux : Delmas. 2 vol., 86 p., ill. Publication de l'Institut de Préhistoire de l'Université de Bordeaux ; 1 .
BORDES, F. 1972. A tale of two caves. New York : Harper and Row. 169 p., fig.
BORDES, F. 1984. Leçons sur le Paléolithique. T.ll le Paléolithique en Europe. Paris : C.N.R.S., 459 p., ill. Cahiers du Quaternaire; 7
BORDES, F. et BOURGON, M. 1951. Le complexe moustérien : Moustérien, Levalloisien et Tayacien. L'Anthropologie, t.55, p. 1-2, ill. BORDES, F, LAFILLE, J. 1962. Découverte d'un squelette d'enfant moustérien dans le gisement du Roc de Marsal, commune de Campagne du Bugue (Dordogne). C.R. Acad. Se, 1962, t. 254, p. 714-715.
BOURGON, M. 1957. Les industries moustériennes et pré-moustériennes du Périgord. Paris : Masson. 141 p., ill. Archives de l'Institut de Paléontologie Humaine ; 27.
BREUIL, H. 1932. Les industries à éclats du Paléolithique ancien. I le Clactonien. Préhistoire, t.1, fasc.2,p. 125-190, NI.
CALLOW, P. et CORNFORD J. M. 1986. La cotte de St Brelade 1961-1978. Excavations by C.B.M. Me Burney. Geo Books Norwich, 433 p., fig., tabl., microfiches.
CLOT, A. et MARSAN, G. 1986. La grotte du Cap de la Bielle à Nestier (Hautes-Pyrénées). Fouilles M. Debeaux 1960. Gallia Préhistoire, t. 29, fasc. 1, p. 63-141.
COMBIER, J. 1967. Le Paléolithique de l'Ardèche dans son cadre paléoclimatique. Bordeaux : Delmas. 462 p., ill. Publications de l'Institut de Préhistoire de Bordeaux ; 4.
DELPECH, F, GENESTE, J.-M., RIGAUD, J.-Ph., TEXIER, J.-P. 1995. Les industries antérieures à la dernière glaciation en Aquitaine septentrionale : chronologie, paléoenvironnements, technologie, typologie et économie de subsistance. In Les industries à pointes foliacées en Europe centrale. Actes du colloque de Miskolc. Paléo ; suppl. 1. 1995.
DELPORTE, H. 1984. Le grand Abri de La Ferrassie. Paris : Laboratoire de Paléontologie Humaine et de Préhistoire, p. 111-144, ill. Études Quaternaires ; 7. DIBBLE, H. 1984. The Mousterian industry from Bisitun Cave (Iran). Paléorient, vol. 10, n°2, p. 23-33, ill. DIBBLE, H. 1988. Typological aspects of reduction and intensity of utilization of lithic resources in the French Mousterian. In DIBBLE, H., MONTET-WHITE, A. (Eds.) Upper Pleistocene Prehistory of Western Asia. Philadelphia : University Museum, University of Pennsylvania. University Museum Monograph ; 54. DIBBLE, H. Sous presse. Charentian-like industries from the Near East and their implications for the Quina and Ferrassie Mousterian of France. In Les Moustériens charentiens. Colloque international. Brive-La-Chapelle-aux- Saint 26-29 août 1990.
DIBBLE, H., ROLLAND, N. Sous presse. Beyond the Bordes-Binford debate : a new synthesis of factors underlying assemblage variability in the Middle Palaeolithic of Western Europe. In New perspectives on human adaptation and behaviour in the Middle Palaeolithic. GENESTE, J.-M. 1985. Analyse lithique d'industries moustériennes du Périgord : une approche technologique du comportement des groupes humains au Paléolithique moyen. Bordeaux : Université de Bordeaux I. 2 vol., X-572 p., 230 p de pi., Thèse N. D. : Se. : Bordeaux I : 1985 ; 2.
GUADELLI, J.-L. et LAVILLE, H. 1990. L'environnement climatique de la fin du Moustérien à Combe-Grenal et à Camiac : confrontations des données naturalistes et
140
implications. In FARIZY, C. (Dir.) Paléolithique moyen récent et Paléolithique supérieur ancien en Europe : ruptures et transitions : examen critique des documents archéologiques. Actes du Colloque international de Nemours, 9-11 mai 1988. Nemours : APRAIF, p. 43-48, ill. Mémoires du Musée de Préhistoire d'île de France ; 3.
HENRI-MARTIN, G. 1957. La grotte de Fontéchevade. 1° partie. Historique, fouilles, stratigraphie archéologie. Paris : Masson. 288 p., ill., 10 pi. h.t. Archives de l'Institut de Paléontologie Humaine ; 28.
JAUBERT, J. 1984. Le site mousterien du Rescoundudou : état actuel des recherches. Bull. Soc. préhist. fr., t. 81, n°4, p. 98-99. JAUBERT, J., KERVAZO, B., QUINIF, Y, BRUGAL, J.- Ph. et O'YL, W. 1992. Le site Paléolithique moyen du Rescoundudou (Aveyron, France). Datations U/Th et interprétation chronostratigraphique. L'Anthropologie. t.96, n°1,p.103-112. KEELEY, H. 1957. A propos des pseudo-pointes levalloi- siennes. Bull. Soc préhist. fr., t. 54, n°1-2, p. 9-12, ill.
KLEIN, R. G.. 1965. The Middle Paleolithic of the Crimea. Arctic Anthropology, vol. Ill, n°1, p. 34-68, fig.
LASSARADE, L, ROUVREAU, M., TEXIER, A. 1969. Le gisement Paléolithique du Lycée, à Pons (Charente- Maritime). Bull. Soc. préhist. fr., Et. Trav. n° 66, p. 341- 354., ill.
LAVILLE, H. 1975. Climatologie et chronologie du Paléolithique en Périgord. Étude sédimentologique de dépôts en grottes et sous abris. Marseille : Université de Provence, Laboratoire de Paléontologie Humaine et de Préhistoire. 422 p., 6 tabl., 181 pi. Études Quaternaires ; 4.
LAVILLE, H., RAYNAL, J-P. et TEXIER, J.-P 1986. Le dernier interglaciaire et le cycle wùrmien dans le Sud- Ouest et le Massif Central français. Bull. Assoc. fr. Et. Quaternaire, n°25-26, fasc. 1-2, p.35-46, ill.
LAVILLE, H., TURON, J.-L, TEXIER, J.-P. et al. 1983. Histoire paléoclimatique de l'Aquitaine et du Golfe de Gascogne au Pleistocene supérieur depuis le dernier interglaciaire. In ASSOCIATION DES GÉOLOGUES DU SUD-OUEST Paléoclimats. Journées de Bordeaux 30- 31 mai 1983. Paris: C.N.R.S. ; Bordeaux : A.G.S.O., I.G.B.A., p. 219-241, tabl. Cahiers du Quaternaire ; n° hors série : Bulletin I.G.B.A. ; 34.
LENOIR, M. 1973. Obtention expérimentale de la retouche de type Quina. Bull. Soc. préhist. fr., t. 70, n°1 , p.10-11.
LENOIR, M. 1986. Un mode de retouche «Quina» dans le Mousterien de Combe-Grenal (Domme, Dordogne). Bulletin de la Société Anthropologique du Sud-Ouest, t. XXI, n°3, p. 153-160, fig.
LE TENSORER, J.-M. 1979. Recherches sur le Quaternaire en Lot-et-Garonne : stratigraphie, paléoclimatologie et préhistoire paléolithique. Bordeaux : Université de Bordeaux I. IV-812 p., ill. Thèse : Se. : Bordeaux I : 1979 ; 1987
LE TENSORER, J-M. 1981. Le Paléolithique de -l'Agenais. Paris : C.N.R.S. 526 p., ill. Cahiers du Quaternaire ; 3.
LUMLEY-WOODYEAR, H. de 1969 Le Paléolithique inférieur et moyen du Midi Méditerranéen dans son cadre géologique : vol. 1 Ligurie-Provence. Paris : C.N.R.S., Centre de publication de Bordeaux. 445 p., fig. LUMLEY-WOODYEAR, H. de 1971. Le Paléolithique inférieur et moyen du Midi Méditerranéen dans son cadre géologique : vol. 2 Bas-Languedoc-Roussillon- Catalogne. Paris : C.N.R.S. 463 p., fig.
MEIGNEN, L. 1976. Le site mousterien charentien de loton (Beaucaire, Gard) : étude sédimentologique et archéologique. Bull. Assoc. fr. Et. Quaternaire, n°1 , p.3- 17.
MEIGNEN, L. 1981. L'abri mousterien du Brugas (Vallabrix, Gard) : premiers résultats. Gallia Préhistoire, t. 24, fasc. 1 , p. 239-253. MEIGNEN, L. 1988. Un exemple de comportement technologique différentiel selon les matières premières : Marillac couches 9 et 10. In OTTE, M. (Ed.) L'homme de Néandertal. Actes du Colloque international de Liège (4- 7 décembre 1986). Vol. 4 la technique coord, par L. Binford et J.-Ph. Rigaud. Liège : Service de Préhistoire, Université de Liège, p. 71-79, ill.
MEIGNEN, L. 1993. Les industries lithiques de l'abri des Canalettes, couche 2. In : L'abri des Canalettes. Un habitat mousterien sur les grands Causses (Nant, Aveyron). Fouilles 1980-1986. Monographie du CRA ; 10 : 239- 328. MEIGNEN, L, CHECH M., VANDERMEERSCH B. 1977. Le gisement mousterien d'Artenac à Saint Mary (Charente). Gallia-Préhistoire, t. 20, fasc. 1, p. 281-291, ill. MEIGNEN, L, COULAROU, J. 1981. Le gisement Paléolithique moyen de la Roquette (Conqueyrac, Gard): étude archéologique. Notes Internes [C.R.A.], n° 26, 19p.
MEIGNEN L., VANDERMEERSCH, B. 1987. Le gisement mousterien de Marillac (Charente) couches 9 et 10. Caractéristiques des outillages, économie des matières premières. In C.T.H.S. Commission de Pré-et Protohistoire. Préhistoire de Poitou-Charentes : problèmes actuels. Actes du 111e Congrès des Sociétés Savantes, Poitiers, 1986. Paris : C.T.H.S., p. 135-144, ill. MOISAN, L. 1978. Recherches sur les terrasses alluviales du Libournais et leurs industries préhistoriques.
141
Bordeaux : Université de Bordeaux I. 2 t., 421 p, ill. Thèse univ. Se. : Bordeaux 1 : 1978 ; 104. NEWCOMER, M. 1970. Conjoined flakes from the Lower Loam, Barnfield Pit, Swanscombe. Proceedings of the Royal Anthropological Institute, p. 51 -59. PAPACONSTANTINOU, E. S. 1989. Micromoustérien : les idées et les pierres : Asprochaliko (Grèce) et le problème des industries microlithiques du Moustérien. Paris: Université de Paris X-Nanterre. 2 vol., 246 p., fig. Thèse N.D. Lettres : Paris X-Nanterre : 1989. RADMILLI A. M. 1965. Abruzzo preistorice. Ed. Sansoni, Rome. RIGAUD, J.-Ph 1982. Le Paléolithique en Périgord : les données du Sud-Ouest sarladais et leurs implications. Bordeaux : Université de Bordeaux I. 2 t., 497 p., fig., tabl. Thèse : Se. : Bordeaux I : 1982 ; 737. RIGAUD, J.-Ph. (Dir) 1988. La grotte Vaufrey : paléoenvironnement, chronologie, activités humaines. Paris : Société Préhistorique Française. 614 p., ill. Mémoires S. P. F. ; XIX RIGAUD, J.-Ph. et TEXIER, J.-P. 1981. A propos des particularités techniques et typologiques du gisement des Tares, commune de Sourzac (Dordogne). Bull. Soc. préhist. fr., t. 78, n°4, p. 109-107. ROE, D. A. 1981 . The Lower and Middle Palaeolithic periods in Britain. London : Routledge & Kegan Paul. 324 p., ill., 38 pi. ROLLAND, N. 1990. Variabilité du Paléolithique moyen: nouveaux aspects. In FARIZY, C. (Dir.) Paléolithique moyen récent et Paléolithique supérieur ancien en Europe : ruptures et transitions : examen critique des documents archéologiques. Actes du Colloque international de Nemours. Nemours : APRAIF, p. 69-76, ill. Mémoires du Musée de Préhistoire d'île de France ; 3. SIREIX, M. et BORDES F. 1972. Le Moustérien de Chinchon (Gironde). Bull. Soc. préhist. fr., t. 69, p. 324- 336, ill. SONNEVILLE-BORDES, D. de. 1969. Les industries moustériennes de l'abri Caminade-est, commune de La Canéda (Dordogne) Bull. Soc. préhist. fr., t. 66, Et. Trav., p. 293-310, ill. TAVOSO, A. 1987. Les premiers chasseurs de la Vere. Marseille : Groupement d'Études et de Recherches Préhistoriques, Université de Provence, 24 p. TEXIER, J.-P. 1982. Les formations superficielles du bassin de l'Isle. Paris : C.N.R.S., Centre de publication de Bordeaux. 316 p., ill., cartes h.t. Cahiers du Quaternaire ; 4. TEXIER, P-J. 1990. Bonnieux-La Combette. Notes d'Information et de Liaison de la Direction des Antiquités PACA, n°7, p.171-175, ill.
TEXIER, P.-J. et JAUBERT, J. à paraître. Le Moustérien de type charentien dans le Sud-Est de la France. Contribution inédite des sites du Vaucluse. Communication présentée au colloque de Brive Les Mousté riens charentiens, 26-29 août 1990. TUFFREAU, A. 1984. Les industries moustériennes et castelperroniennes de La Ferrassie. In DELPORTE, H. (Dir.) Le grand Abri de La Ferrassie : fouilles 1968-1973. Paris : Laboratoire de Paléontologie Humaine et de Préhistoire, p. 111-144, fig. Études Quaternaires ; 7. TUFFREAU A. 1986. Biache-Saint-Vaast et les industries moustériennes du Pleistocene moyen récent dans la France septentrionale. In Chronostratigraphie et faciès culturels du Paléolithique inférieur et moyen dans l'Europe du Nord 22° Congrès Préhistorique de France. Suppl. Bull. Assoc. fr. Et. Quaternaire, n° 26, p. 197-207, fig. TUFFREAU, A. et SOMME, J. (Dir.) 1988. Le gisement paléolithique moyen de Biache-Saint-Vaast (Pas de Calais) . Vol.1 stratigraphie, environnement, études archéologiques, (première partie) Paris : Société Préhistorique Française, p. 185-214, ill. Mémoires SPF ; XXI. TURQ, A. 1 979. L'évolution du Moustérien de type Quina au Roc-de-Marsal et en Périgord: modification de l'équilibre technique et typologique. Toulouse : École des Hautes Études en Sciences Sociales. 181 p., 53 fig., 23 tabl. Mémoire. TURQ, A. 1988. Le Moustérien de type Quina du Roc de Marsal : contexte stratigraphique, analyse lithologique et technologique. Documents d'Archéologie Périgourdine, t. 3, p. 5-30, 24 fig. TURQ A. 1989. Approche technologique et économique du faciès Moustérien de type Quina : étude préliminaire. Bull. Soc. préhist. fr., t. 86, n°8, p. 244-256, 12 fig. VALLADAS, H., et al. 1987. Datations par la thermoluminescence de gisements moustériens du Sud de la France. L'Anthropologie, t. 91, n°1, p. 211-226. VERJUX, C. et ROUSSEAU, D.-D. 1986. La retouche Quina : une mise au point. Bull. Soc. préhist. fr., t. 83, n°11-12, Et. Trav., p. 404-415, fig. VILLAVERDE BONILLA, V. 1984. La Cova Negra de Xàtiva y el Musteriense de la region central del Mediterraneo espanol. Valencia : Servicio de Investigaciôn Prehistorica, 340 p. Série de Trabajos Varios;79. 1984. WARREN, H. 1951. The Clacton flint industry, a new interpretation. Proceedings of the Geologist's Association, p. 107-135. WYMER, J. 1968. Lower Palaeolithic Archaeology in Britain as represented by the Thames Valley. London : J. Baker. 429 p., ill.
142