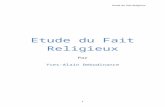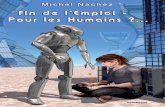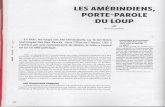Les feux de la Mort : les complexes funéraires du Languedoc occidental de la fin de l’âge du...
Transcript of Les feux de la Mort : les complexes funéraires du Languedoc occidental de la fin de l’âge du...
Le regroupement des morts. Genèse et diversité archéologique, p. 13 à 22
Les feux de la Mort : les complexes funéraires du Languedoc occidental de la fin de l’ âge du Bronze
à la fin du premier âge du Fer (ixe-ve s. av. J.-C.)
Jean-Pierre Giraud, Thierry Janin, Fabrice Pons
Introduction
Depuis plusieurs décennies, les travaux sur les nécropoles à incinération du Languedoc occidental constituent un des axes majeurs des recherches sur les sociétés protohistoriques de Gaule méridionale. Ces vastes ensembles, souvent forts de plusieurs centaines de tombes, apparaissent à la fin de l’ âge du Bronze, vers la fin du xe s. av. J.‑C. L’ origine de ce phénomène, soudain, n’ est toujours pas expliquée : on ne connaît pas de vestiges susceptibles d’ en annoncer les prémices pour les séquences immédiatement antérieures. C’ est notamment pour cette raison qu’ on a voulu y voir le résultat de migrations de populations importantes, depuis l’ Europe centrale. Cette théorie migrationniste, voire invasionniste, a autrefois conduit certains auteurs à désigner ces ensembles sous le terme de Champs d’ Urnes. Dans les années 1980, les chercheurs méridionaux se sont accordés à montrer que le terme de “champs d’ urnes” n’ était plus idoine pour désigner les nécropoles ouest‑languedociennes. Reprenant finalement un constat déjà établi par O. et J. Taffanel, on a mis là un point d’ arrêt à un nominalisme certes fédérateur, mais on a résolument assourdi les anciennes théories diffusionnistes nées au début du xxe s. qui voulaient voir dans ces sépultures la marque d’ une migration celtique dès le milieu de l’ âge du Bronze.
Ces nécropoles à incinération sont régulièrement distribuées en Languedoc occidental, et plus largement dans le Sud‑ouest. Leur aire de répartition s’ oppose nettement à celle d’ une autre pratique funéraire qui consiste à inhumer les défunts sous des tumulus de pierre. C’ est pour cette raison qu’ on distinguait jadis tumulus et tombes plates, ce dernier terme désignant les tombes à crémation. La table ronde organisée à Lattes en 1993 a réuni une quinzaine de chercheurs travaillant sur les dispositifs de signalisation des sépultures protohistoriques du Midi : lors de cette journée, tous se sont accordés à montrer que ces ensembles ne pouvaient en aucun cas demeurer sous l’ appellation de “tombes plates1”.
Les ensembles funéraires : de vastes nécropoles
Si, dans le Sud‑Ouest, des sépultures à incinération ont été reconnues dès les années 1930, il faut en réalité attendre les années 1940 pour qu’ on explore des ensembles importants. À une époque où l’ on ne pratique
1 Schwaller 1994.
Le regroupement des morts. Genèse et diversité archéologique
14
pas de grands décapages, mais où, lors des remaniements viticoles (arrachages, replantations, rassemblement de parcelles…), l’ on procède par sondages juxtaposés, il était évidemment délicat de se faire une idée exacte de l’ étendue de ces nécropoles, la persévérance d’ O. et J. Taffanel va permettre d’ en mieux préciser les développements topographiques. La nécropole de Las Fados à Pépieux (Aude) d’ abord2, puis les nécropoles mailhacoises ensuite3, vont permettre à ces deux chercheurs audois d’ envisager de vastes ensembles. Et s’ il est vrai que seules quelques dizaines de tombes seront au départ explorées, les découvertes postérieures vont largement en confirmer l’ importance numérique. À Mailhac (Aude) d’ abord, puis à Pézenas (Hérault) et Couffoulens (Aude) ensuite, les découvertes se multiplient et mettent au jour plusieurs dizaines voire centaines de tombes.
Mais c’ est à la faveur du développement de l’ archéologie de sauvetage qu’ un tournant va s’ opérer en Languedoc occidental. En 1976 et 1977, A. Nickels et son équipe explorent sur une grande surface une nécropole du viie s. av. J.‑C. au lieu‑dit Le Peyrou à Agde (Hérault). Lors de cette opération, une grande surface est décapée et on mesure alors non seulement l’ avantage qu’ il y a à disposer d’ un large espace de réflexion, mais surtout l’ opportunité de réfléchir sérieusement à l’ organisation générale de ces nécropoles4. Dans les années 1980, si l’ on continue à fouiller de petits groupes de tombes dans l’ emprise de travaux d’ aménagement modestes, on s’ attache aussi à étudier de grands ensembles : c’ est notamment le cas dans la région de Castres (Tarn), où, à Gourjade, on explore plus de 400 tombes. Dans la foulée, 175 sépultures sont fouillées au lieu‑dit Le Martinet, puis ce sont 640 sépultures qui sont exhumées en 1995 sur le site du Causse à Labruguière (Tarn) (fig. 1)5. Parallèlement, et suivant les travaux antérieurs et selon la disponibilité des terrains, les nécropoles de Mailhac font l’ objet de nouvelles attentions : dès 1993, une opération de fouille programmée, autorisée et financée par le Ministère de la Culture et de la Communication, permet l’ appréhension de près de 6 000 m2 de nécropole à incinération6. Faisant suite aux travaux pionniers d’ O. et J. Taffanel, cette opération va, d’ une part, affermir les premiers résultats, et d’ autre part, enrichir le ferment de la réflexion sur l’ organisation et le développement topographique des secteurs funéraires. Par la suite, d’ autres sites vont faire l’ objet d’ opérations d’ envergure variable : on retiendra en dernier lieu la fouille de la nécropole de la Rouquette à Puisserguier (Hérault) dont la conservation exceptionnelle a permis au fouilleur d’ alimenter le débat lancé par ses prédécesseurs7.
Cette accélération des découvertes, mais surtout la prise compte des restes humains incinérés dont la systématisation de l’ étude va s’ opérer, grâce à l’ opiniâtreté d’ H. Duday, font qu’ aujourd’ hui l’ étude des nécropoles à incinération est mature, même si plusieurs facteurs ne sauraient être sollicités : c’ est là une des limites des travaux sur ces ensembles d’ incinérations.
Des bûchers au sein des nécropoles : les complexes funéraires
En Languedoc occidental, c’ est l’ incinération des corps qui est exclusivement utilisée dès le Bronze final IIIB, à l’ exception notable des sujets décédés en phase périnatale8. Cette adoption de la crémation n’ est toujours pas expliquée, les sépultures de la séquence antérieure étant, on l’ a dit, rarissimes. Les hypothèses d’ une relation directe avec un culte solaire ne sont aujourd’ hui plus recevables.
L’ autre élément à retenir, au sein des ensembles du BFIIIB et du Fer I, est la présence de bûchers funéraires : à Mailhac notamment, mais aussi plus au nord, comme dans la région de Castres, les fouilles récentes ont révélé l’ existence de structures de crémation installées au milieu des nécropoles ; ces découvertes nous ont ainsi
2 Taffanel & Taffanel 1960.3 Louis et al. 1958.4 Nickels et al. 1989.5 Giraud et al. 2003.6 Janin 2000.7 Mazière 2006.8 Dedet 2008.
15
J.-P. Giraud, Th. Janin, F. Pons, Les feux de la Mort
■ Fig. 1 Plan partiel de la nécropole du Causse à Labruguière, Tarn (viie-vie s. av. J.-C.).
Le regroupement des morts. Genèse et diversité archéologique
16
poussé à désigner sous le terme de complexes funéraires ces associations de structures9. On sent ici l’ apport de l’ archéologie préventive (grands décapages) et les multiples observations qui ont pu être faîtes depuis le temps des pionniers. Ces structures de crémation – ces bûchers – peuvent prendre des formes diverses. Dans certains cas, comme à Mailhac, il s’ agit de petites plateformes constituées de blocs de grès (ressource locale), dont les dimensions atteignent parfois 0,8 x 1,60 m. Dans un cas, les fouilles ont pu révéler l’ existence de structures qui pourraient indiquer des crémations suspendues ; de tels cas sont connus par ailleurs, pour la Protohistoire du Languedoc (Ensérune, Olonzac10), mais également en Asie11.
Architecture funéraire et relations entre tombes : la sphère du visible
On l’ a dit, les sépultures à incinération du Languedoc occidental et, plus largement du Sud‑Ouest, ne peuvent plus être désignées sous le terme de “tombes plates”, pas plus que les nécropoles ne puissent être encore appelées “Champs d’ Urnes”. En effet, et dès les années 1950, les fouilles menées sur ces vastes ensembles ont largement montré que toutes les sépultures étaient initialement surmontées d’ un tertre de terre et/ou de pierre. Les fouilles les plus récentes n’ ont fait que confirmer les premiers constats12.
L’ organisation topographique de ces cimetières protohistoriques a ainsi été largement étudiée. Qu’ il s’ agisse de la nécropole du Moulin à Mailhac ou des ensembles du Castrais, on a constaté une gestion logique de l’ espace, mais on a jamais conclu à l’ existence de véritables concessions, plutôt à des regroupements de type
9 Janin 1994 ; Giraud et al. 2003.10 Schwaller et al. 1994 ; Janin et al. 2000.11 Pautreau & Mornais 2005.12 Janin 2000 ; Giraud et al. 2003 ; Mazière 2006, 160.
1 adulte
1 adulte
1 infans I ou II1 infans I
1 infans I
1 infans I
■ Fig. 2 Sépultures et âges au décès : un regroupement de type familial ? (nécropole du Camp-de-l’ Église Sud, Flaujac-Poujols, Tarn-et-Garonne ; viiie s. av. J.-C.).
17
J.-P. Giraud, Th. Janin, F. Pons, Les feux de la Mort
familial, comme à Mailhac ou au Camp de l’ Église sud à Flaujac‑Poujols (Lot) (fig. 2), hypothèse affermie grâce aux études anthropologiques menées, comme il se doit, “à l’ aveugle”13. Qui plus est, on a également pu montrer qu’ âge au décès et taille de la couverture étaient intimement liés : ainsi, les adultes bénéficient d’ une superstructure plus grande que celle réservée aux enfants.
Il n’ existe pas à proprement parler de nécropole régulée selon un plan orthonormé ; l’ exception réside dans la proposition faite par A. Nickels pour le Peyrou à Agde. Cependant, si on compare objectivement les vestiges architecturaux rencontrés à Agde comme dans les cimetières du Castrais, on ne peut que constater une similitude de forme et d’ agencement des monuments. Certes, l’ évolution du cercle vers le rectangle, ou dans le meilleur des cas le carré, est confirmée, dans le Castrais en tout cas. En revanche, dans la nécropole éponyme de Mailhac, on a constaté la coexistence des deux formes. Les enclos quadrangulaires agathois ou castrais semblent donc être le témoignage d’ une évolution logique liée, peut‑être, à la nécessité de mieux gérer les espaces sépulcraux. Par ailleurs, quelle que soit la nécropole considérée, on constate que toutes les sépultures sont accessibles, des espaces de circulation ayant été réservés au sein des complexes funéraires. Enfin, à Mailhac, le complexe funéraire s’ étend sur plusieurs hectares. Les tombes s’ échelonnent de la fin du xe s. av. J.‑C. au milieu du ve s. av. J.‑C., selon un développement topographique linéaire, sans qu’ une tombe récente ne recoupe une sépulture plus ancienne. Cela indique une incontestable rigueur dans la gestion de l’ espace funéraire et le respect des implantations sépulcrales. Une observation semblable a été faite pour la nécropole du Causse à Labruguière (Tarn) (fig. 1).
Dépôts funéraires : la sphère de l’ enfoui
Une évolution lisible dans les nécropoles du Languedoc occidental est avant tout celle des dépôts funéraires, tant quantitativement que qualitativement.
Il ne fait aujourd’ hui plus aucun doute qu’ entre les sépultures du BFIIIB et celles du Grand Bassin I, on assiste à une évolution significative du nombre de vases et d’ objets métalliques déposés dans les tombes. Ce changement, rapide, ne trouve pas d’ explication simple : on doit simplement, et raisonnablement, constater qu’ il est concomitant de l’ apparition des premiers objets en fer et de la modification de l’ implantation des habitats. Là encore, c’ est sans doute une modification des mentalités qu’ on doit lire : les défunts méritent alors d’ être accompagnés de plus de biens dans la Mort. Ce qui ressort des analyses récentes, c’ est probablement que cela reflète une hiérarchisation sociale accrue. Ainsi, entre la fin de l’ âge du Bronze (ixe‑viiie s. av. J.‑C.) et le Fer I Ancien (fin viiie‑viie s. av. J.‑C.), tout porte à croire que les communautés du Languedoc occidental vont connaître une modification sensible de leur structuration sociale : ils pourraient alors rechercher une forme d’ accumulation et, au‑delà le dégagement de surplus. Qui plus est, c’ est aussi la qualité de certains objets déposés dans les sépultures qui va marquer ce changement. À côté des traditionnels vases en céramique locale, on trouve désormais quelques pièces exogènes, pour ne pas dire exotiques ; de plus, les objets métalliques, si rares en contexte domestique, sont désormais de bons marqueurs sociaux : comment, en effet, expliquer la présence de pièces de harnachement, de simpulums, et même de broches à rôtir dans quelques rares tombes, sinon comme la marque d’ un statut social extraordinaire du défunt ; et que penser du char déposé dans une sépulture mailhacoise. Sur ce point, les travaux récents s’ accordent.
Le début du vie s. av. J.‑C. est le moment où l’ on assiste à une modification non pas du traitement funéraire, puisque l’ incinération reste de mise, mais bien du type d’ objets d’ accompagnement du défunt. Les services funéraires reflètent alors la consommation du quotidien : aux très rares vases importés du siècle précédent succède toute la panoplie des importations méditerranéennes recensées dans l’ habitat. Ainsi, on trouve régulièrement dans les sépultures de la vaisselle étrusque, principalement du bucchero nero, mais aussi des récipients de Grèce orientale. Puis, très vite, la céramique grise monochrome devient omniprésente. À partir
13 Pons et al. 2001, 70‑71.
Le regroupement des morts. Genèse et diversité archéologique
18
du début du deuxième quart du siècle, un contenant d’ un type nouveau est utilisé comme vase cinéraire : l’ amphore étrusque (Grand Bassin II à Mailhac, Pézenas, Castelnau‑de‑Guers) : cette pratique ne semble en revanche pas avoir été utilisée après 500 av. J.‑C. On soulignera aussi l’ apparition massive des armes dans les sépultures, alors qu’ elles étaient très rares dans les tombes de la séquence antérieure (fig. 3).
Vers 525 av. J.‑C., une autre modification de la pratique funéraire se fait jour : alors qu’ auparavant, les récipients déposés dans la sépulture étaient intacts, on brûle désormais les vases avec le défunt, et l’ ossuaire, comme réceptacle, disparaît totalement. C’ est là la caractéristique des sépultures datées entre 525 et 475 av. J.‑C.
Enfin, un autre critère semble caractériser les ensembles funéraires du Languedoc occidental, et cela depuis le BFIIIB. Il s’ agit de ce que l’ on nomme communément les offrandes alimentaires, et seulement les offrandes carnées, les éventuelles autres ayant bien sûr disparu. Dans la nécropole du Moulin à Mailhac, ces offrandes sont abondantes, et on a pu autrefois montrer qu’ elles étaient visiblement liées au sexe du défunt : bœuf, cheval et cerf, pour les sujets supposés masculins, ovi‑caprinés pour les sujets supposés féminins. La même constatation a été faite à Agde.
6
■ Fig. 3 Mobilier d’ une tombe de guerrier (T189 de la nécropole de Saint-Julien de Pézenas, Hérault ; v. 600 av. J.-C.).
19
J.-P. Giraud, Th. Janin, F. Pons, Les feux de la Mort
Des tombes singulières
Les tombes à simple ossuaire
Cette hiérarchisation sociale des communautés que permettent de lire les sépultures trouve encore un autre atout. Au Peyrou comme à Mailhac, au viie s. av. J.‑C., on a mis en évidence l’ existence de sépultures à “simple ossuaire”, pour reprendre la définition d’ A. Nickels14. Cette distinction demeure une réalité : à côté de sépultures à vases multiples (jusqu’ à 58 !), on a en effet fouillé des dépôts cinéraires constitués d’ un seul récipient (fig. 4), en l’ occurrence l’ ossuaire, accompagné quelquefois d’ un maigre mobilier métallique. Qui plus est, ces sépultures sont toujours installées dans l’ environnement immédiat – pour ne pas dire à une grande proximité – de tombes à vases multiples, à Agde comme à Mailhac, disposition jusqu’ alors inconnue. Cette dépendance topographique a été différemment interprétée. Pour A. Nickels, elle pourrait relever soit d’ une distinction sociale, voire même économique, soit d’ une différence ethnique. La question est importante et finalement logique dans l’ ambiance agathoise. Mais à Mailhac, où ces tombes existent aussi, on ne peut raisonnablement invoquer – encore ! – les Grecs. Les études anthropologiques, dans les deux cas, ont signifié qu’ il ne s’ agissait pas de distinctions d’ âge, et les études de mobilier ont proposé qu’ il ne s’ agissait pas de démarcation sexuelle. Si l’ hypothèse d’ une distinction ethnique devait être finalement retenue, on doit dès lors envisager que des apports de populations ont aussi concerné l’ arrière‑pays avant la fondation de la colonie de Marseille. Pourquoi pas ? Mais l’ hypothèse est bien fragile…
Au viie s. av. J.‑C. : de rares inhumations…
Les rares inhumations recensées au sein des nécropoles constituent une autre catégorie de tombes originales. Dans la nécropole du Peyrou à Agde, la tombe 108 renfermait les restes d’ un sujet âgé entre 6 et 8 ans accompagné d’ un mobilier assurément de type Grand Bassin I. Dans la nécropole du Causse à Labruguière, ce ne sont pas moins de 9 tombes à inhumation qui ont été découvertes ; enfants, adolescents et adultes y ont été déterminés. Ces traitements particuliers et très rares sont‑ils liés à une démarcation sociale ou sont‑ils le reflet d’ une différence ethnique ? Sont‑ce des tombes de sujets ayant connu une mort particulière, comme H. Gallet de Santerre l’ envisageait pour les squelettes retrouvés dans certains silos d’ Ensérune15 ? Rien ne permet aujourd’ hui de soutenir une hypothèse plutôt qu’ une autre.
14 Nickels et al. 1989.15 Gallet de Santerre 1980, 156‑158.
■ Fig. 4 Sépulture à vases d’ accompagnement (576) et sépultures adventices à simple ossuaire
(nécropole du Causse à Labruguière, Tarn).
Le regroupement des morts. Genèse et diversité archéologique
20
Au viie s. av. J.‑C. : de rares sépultures isolées…
Inconnues pour la séquence du Fer I ancien, les sépultures dites isolées, donc non incluses dans une nécropole, semblent apparaître au vie s. av. J.‑C., et sans doute dès le deuxième quart du siècle ; elles peuvent donc être globalement rattachées au faciès Grand Bassin II. Elles ne sont en effet connues qu’ en Languedoc occidental, et il faut bien avouer qu’ elles sont peu nombreuses : Saint‑Antoine à Castelnau‑de‑Guers (Hérault)16, les Faïsses à Mourèze (Hérault)17, Corno Lauzo à Pouzols‑Minervois (Aude)18. Enfin, dans la zone tampon que pourrait constituer la vallée du Lez, la tombe de la Céreirède à Lattes est à ce jour la sépulture isolée la plus orientale que l’ on ait recensée.
Dès 1960, dans leur publication de la tombe de Corno Lauzo, O. et J. Taffanel s’ interrogeaient sur la signification de cet isolement : “Comment expliquer qu’ une tombe de cette importance, tombe de guerrier sans aucun doute soit ainsi isolée, loin du cimetière et du village contemporains ? Nous pensons qu’ il s’ agit d’ un mort héroïsé, peut‑être enterré sur la frontière du terrain appartenant à la tribu du Cayla19.” Ce qui semble incontestable, c’ est qu’ il s’ agit effectivement de la tombe d’ un individu accompagné d’ un armement complet, associant armes offensives et armes défensives. C’ est également ce type de mobilier qui a été découvert dans la tombe de Castelnau‑de‑Guers. À Mourèze en revanche, si l’ on est bien en présence d’ une tombe isolée, les armes sont totalement absentes mais le mobilier est encore extraordinaire, avec notamment un bassin en bronze. Ce qui frappe encore, c’ est que ce type de sépultures renfermant un mobilier exceptionnel n’ est pas inconnu dans les nécropoles contemporaines, à Mailhac comme à Pézenas.
La signification de ces sépultures isolées est plus délicate à discuter. Les assimiler à des herôons est peut‑être un peu hâtif, même si l’ hypothèse est plus que séduisante. Pour d’ autres, ces tombes appartiendraient à des membres d’ une aristocratie rurale20 ; cela ne résiste guère à l’ analyse. Si tel était le cas, pourquoi serions‑nous en présence de tombes uniques, et pas de petites nécropoles rurales, telles qu’ on en connaît pour l’ époque romaine21 ? Il ne s’ agit pas ici de nier l’ existence d’ établissements ruraux de type ferme ou hameau dès le viie s. av. J.‑C., schéma accepté depuis longtemps par la communauté scientifique dès le début des années 1980, sans doute grâce au développement des grands travaux qui ont nécessité d’ importantes opérations d’ archéologie préventive. Plus simplement, on peut effectivement considérer ces sépultures comme des marqueurs territoriaux, sans qu’ il faille obligatoirement et systématiquement les assimiler à des tombes de sujets héroïsés.
Conclusion
Abordée dans les années quarante avec les travaux d’ Odette et Jean Taffanel, l’ étude du phénomène des complexes funéraires du Languedoc occidental a franchi une étape décisive avec les fouilles d’ André Nickels et de son équipe qui ont ouvert la réflexion sur l’ organisation internes de ces vastes ensembles funéraires. Les travaux des dernières années ont fait progresser ces analyses. En parallèle, la prise en compte des restes humains a complété la connaissance des sépultures. L’ évolution des dépôts funéraires est l’ écho de la hiérarchisation sociale croissante des communautés. La constitution de ces vastes complexes funéraires en Languedoc occidental ne doit pas apparaître comme un phénomène isolé : son extension reconnue semble s’ étendre de la vallée de l’ Hérault à l’ est jusqu’ à la moyenne vallée de la Garonne voire jusqu’ à l’ Atlantique. Malgré certaines différences dans les architectures funéraires, on trouve des parallèles certains de l’ autre côté des Pyrénées, en Catalogne, suivant une chronologie et une évolution globalement analogue. La même évolution vers une différenciation
16 Houlès & Janin 1992.17 Garcia & Orliac 1985.18 Taffanel & Taffanel 1960.19 Taffanel & Taffanel 1960, 13.20 Mauné 1998, 47‑48.21 Bel 2002, 17.
21
J.-P. Giraud, Th. Janin, F. Pons, Les feux de la Mort
entre des tombes plus pauvres et celles qui apparaissent plus riches peut y être reconnue, ce qui semble refléter là aussi une accentuation de la hiérarchie dans ces populations.
Il apparaît ainsi que de la fin de l’ âge du Bronze, à la fin du xe s. av. J.‑C. au milieu du ve s. av. J.‑C., dans le sud‑ouest de la France et le nord est de la péninsule ibérique, les nécropoles à incinérations représentent la pratique funéraire quasi exclusive. On peut observer que les cultures matérielles (mobilier céramique, équipement métallique) des populations auteurs de ces nécropoles ne sont pas totalement homogènes sur toute l’ étendue de ce territoire : celles du Languedoc occidental ou de la côte de la Catalogne seront plus rapidement – dès la fin du Fer I Ancien – au contact des populations exogènes et leur structuration sociale pourrait s’ en être ressentie comme le témoigne l’ évolution des mobiliers d’ accompagnements, ou l’ apparition de sépultures à simple ossuaire. Cependant, ces tendances évolutives sont suivies dans l’ ensemble, montrant un partage généralisé et durable des conceptions qui sous‑tendent ces pratiques funéraires. Il reste à préciser les “frontières” du territoire affecté par ce phénomène – qui ne sont pas celles des cultures matérielles et d’ en retracer l’ évolution à travers le temps pour tenter de cerner quels autres traits, statuts social, économique, politique, ethnique,... Ils pourraient lui être corrélés afin de mieux en saisir l’ origine et ce qui en a assuré la cohérence durant plus d’ un demi‑millénaire.
Bibliographie
Arcelin, P., M. Bats, D. Garcia, G. Marchand et M. Schwaller, éd. (1995) : Sur les pas des Grecs en Occident, Hommages à André Nickels, Collection Études Massaliètes 4, Errance – ADAM, Paris – Lattes, 492 p.
Bel, V. (2002) : Pratiques funéraires du Haut-Empire dans le Midi de la Gaule, La nécropole gallo-romaine du Valladas à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), ARALO, Monographies d’ Archéologie Méditerranéenne 11, Lattes, 539 p.
Dedet, B. (2008) : Les Enfants dans la société protohistorique, l’ exemple du sud de la France, Publication de l’ École Française de Rome 396, Rome, 400 p.
Gallet de Santerre, H. (1980) : Ensérune, les silos de la terrasse Est, Gallia Suppl. 39, CNRS, Paris, 164 p.
Garcia, D. et D. Orliac (1985) : “Mobilier d’ une tombe du premier âge du fer au lieu‑dit Les Faïsses à Mourèze (Hérault)”, Documents d’ archéologie méridionale, 8, 151‑154.
Giraud, J.‑P., F. Pons et Th. Janin, dir. (2003) : Nécropoles protohistoriques de la région de Castres (Tarn). Le Causse, Gourjade, Le Martinet. 1, Études et synthèses. 2, Catalogue des ensembles funéraires. 3, Planches du mobilier, Documents d’ Archéologie Française 94, Maison des sciences de l’ Homme, Paris, 276 p., 268 p. et 231 p.
Houlès, N. et Th. Janin (1992) : “La sépulture protohistorique de Saint‑Antoine à Castelnau‑de‑Guers, Hérault”, Revue Archéologique de Narbonnaise, 25, 433‑441.
Janin, Th., J. de Biazy, H. Boisson, N. Chardenon, A. Gardeisen, G. Marchand, A. Montecinos et P. Sejalon (2000) : “La nécropole du second Âge du fer de Mourrel‑Ferrat à Olonzac (Hérault)”, Documents d’ Archéologie Méridionale, 23, 219‑248.
Janin, Th. (2000) : “Nécropoles et sociétés élisyques”, in : Janin, éd. 2000, 117‑131.
Janin, Th., éd. (2000) : Mailhac et le premier âge du Fer en Europe occidentale, Hommages à Odette et Jean Taffanel, Actes du colloque international de Carcassonne, 17-20 septembre 1997, Monographies d’ Archéologie Méditerranéenne 7, Association pour la recherche archéologique en Languedoc oriental – Librairie archéologique, Lattes – Montagnac, 436 p.
Louis, M., O. Taffanel et J. Taffanel (1958) : Le Premier âge du Fer languedocien. II, Les nécropoles à incinération, Institut d’ Études Ligures, Montpellier, 262 p.
Mauné, St. (1998) : “Les établissements ruraux des vie et ve s. av. J.‑C. en Languedoc central. Études des cas et perspectives”, in : Mauné, dir. 1998, 45‑72.
Mauné, St., dir. (1998) : Recherches récentes sur les établissements ruraux protohistoriques en Gaule méridionale (ixe-iiie s. av. J.-C.), Actes de la table-ronde de Lattes (mai 1997), Collection Protohistoire Européenne 2, M. Mergoil, Montagnac, 175 p.
Mazière, F. (2006) : “Puisserguier, La Rouquette”, Bilan Scientifique Régional de Languedoc-Roussillon 2003, 159‑161.
Mordant, Cl. et G. Depierre, dir. (2005), Les Pratiques funéraires à l’ âge du Bronze en France, Actes de la table ronde de Sens-en-Bourgogne, Yonne, CTHS – Société Archéologique de Sens, Paris – Sens‑en‑Bourgogne, 525 p.
Nickels, A., G. Marchand et M. Schwaller (1989) : Agde, la nécropole du premier Âge du Fer, Revue Archéologique de Narbonnaise Suppl. 19, CNRS, Paris, 498 p.
Pautreau, J.‑P. et P. Mornais (2005) : “Quelques aspects des crémations actuelles en Thaïlande du Nord”, in : Mordant & Depierre, dir. 2005, 47‑60.
Le regroupement des morts. Genèse et diversité archéologique
22
Pons, F., Th. Janin, A. Lagarrigue et S. Poignant (2001) : “La nécropole protohistorique du Camp de l’ Église Sud (Flaujac‑Poujols, Lot)”, Documents d’ Archéologie Méridionale, 24, 7‑82.
Schwaller, M., éd. (1994) : “Structures de couverture et de signalisation des sépultures protohistoriques du Midi de la Gaule et des régions périphériques”, Documents d’ Archéologie Méridionale, 17, 9‑99.
Schwaller, M., H. Duday, Th. Janin et G. Marchand (1994) : “Cinq nouvelles tombes du Deuxième Âge du fer à Ensérune”, in : Arcelin et al., éd. 1994, 205‑230.
Taffanel, O. et J. Taffanel (1948) : “La nécropole hallstattienne de Las Fados, commune de Pépieux, Aude”, Gallia, 6 (1), 1‑29.
— (1960) : “Deux tombes de chefs à Mailhac (Aude)”, Gallia, 18 (1), 1‑37.