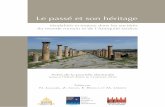L’efficacité des mots dans les miracles, les maléfices et les incantations
L'influence du cinema sur les enfants et les adolescents INTRODUCTION
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of L'influence du cinema sur les enfants et les adolescents INTRODUCTION
INTRODUCTION
APERCU DES PRINCIPALES TENDANCES Quiconque souhaite apprendre ce que nous savons de l'influence du cinéma sur les enfants et les adolescents trouvera, au long des pages qui suivent,la réponse fournie dans leurs écrits par quelque 400 auteurs appartenant à près de trente pays.
La présente bibliographie a pour objet d'inventorieret d'annoter les plus marquants des livreset articles consacrés à l'influence du cinema sur la jeunesse qui ont paru dans le monde entier au cours destrente dernières années. Cette tâche s'est révélée difficile du fait que ce vaste sujet a été abordé sous des angles très divers (physiologique, psychologique, psychiatrique, sociologique,criminologique, éducatif) et que les ouvrages ont été publiés en diverses langueset dans bon nombre de pays. En fait, la seule ou presque seule conclusion parfaitement inattaquable que l'étude des pages qui suivent permette de dé-gager est
la suivante : l'importance accordée au problème du cinéma et de l'enfance est considé-rable et ne cesse degrandir.
En effet, si les auteurs s'accordent généralement à reconnaître la nécessité de faire quelque chose, il n'en est plus de même lorsqu'il s'agit de savoir ce qu'il faut faire. Bien peu de jugements solides pourraient être tirés des seules données bibliographiques rassemblées dans la présente publication,du moins sana consulter le texte inté-gral des livres et articles résumés. Même alors,les avis réfléchis et les conclusions apparemment fondées des différents auteurs ne semblent que trop fréquemment s'opposer. Comme le dit l'un d'entre eux, tout ce que nous savons en toute certitude sur le cinéma et l'enfance, c'est que nous n'en savons pas grand chose de certain - à part l'attrait évident et persistant quele cinémaexerce sur les enfants.
Cette mise en garde faite, il reste que la pré-sentebibliographie permet de discerner certaines grandes tendances qu'il convient de ne pas négliger.A différents moments de ce débat mondial sur l'influence du cinéma, il est possible de "tâter le pouls de l'assemblée'' sans qu'un vote à main levée soit nécessaire.
Pour ne pas trop augmenter le volume de cette
bibliographie, nous en avons écarté les ouvrages relatifs au cinéma éducatif, c'est-à-dire au cinéma exclusivement utilisé comme auxiliaire del'enseignement,mais non ceux qui touchent à la question de l'éducation cinématographique ("film education"),parfois appelée initiation cinématographique("film appreciation"). En réalité, la plus remarquable des tendances qui se font jour ici reside dans l'intérêt croissant que suscite l'éducationcinématographique et ce qui s'y rapporte : développement de ciné-clubs pour la jeunesse, production et distribution de films récréatifs destinésaux enfants,projection de programmes spéciaux à leur intention. Bon nombre d'auteurs soutiennent que 1' éducation cinématographique devrait non seule -ment être encouragée, mais encore figurer officiellement dans les programmes scolaires ; une telle opinion a étéexprimée, avant même la période considérée ici, dans différents pays tels que l'URSS et le Royaume-Uni. Il aurait été peul'scientifique"de chercher à répartir en catégories positive et négative les données contenues dans un recueil tel que celui-ci ; si certains ouvragesportent des jugements nettement défavorables au cinema et aux effets qu'il produit sur la jeunesse, on ne saurait toutefois laisser d'être frappé par le nombre des opinions favorables exprimées à 1 'égard de son rôle éducatif et des mesures pratiques portées à son crédit. Tel est, en effet, le sens des plus importantessections de cette bibliographie où la censure elle-
même, pourtant considérée depuis toujours comme essentiellement négative, fait figure de facteur positif.
Les opinions personnelles exprimées par lesauteursdans la plupart des autres sections sont souvent fortement opposées, mais nulle part autant que dans la section consacrée à la "délinquance juvénile". Bien quece sujet soit tendancieux et prête à discussion, il était évidemment indispensable de grouper sous cette rubrique quelques ouvrages, tout au moins en raison du vif intérêt général que suscite actuellement le problème. L'examen des notices qui s'y rapportent permet d'avancer sans crainte deux ou trois conclusions.La première est qu'en se fondant sur les données actuellement disponibles, il est très difficile, voire pratiquement impossible, d'affirmer que le cinéma exerce une influence directe sur la délinquance juvénile. De nombreuses recherches ont sansdoute été faites en vue de determiner si le cinéma corrompt ou non la jeunesse,mais les méthodes employéessont différentes et les résultats obtenus contradictoires. Les diverses théories psychiatriques avancées à ce sujet ne reposent que sur des preuves insuffisantes. Les deux opinions extrêmes sont, l'une que le cinéma incite activement les jeunes gens à la délinquance et les renseigne directement sur la façon de commettre des actes délictueux, l'autre qu'il est une veritable soupape de sûreté capable de contribuer àprévenir l'inconduite et la criminalité juvéniles
enempêchant les enfants de courir les rues. A mi-cheminse situe l'opinion qui attribue le comportement criminal et amoral à des influences plus profondes et plus subtiles que celles du seul cinéma, tout enreconnaissant qu'une grande partie de ce qui est montré sur l'écran ne convient pas aux enfants. Il est certain qu'on retrouvera dans ces pages bon nombre de dadas mais, si leurs opinions different quant à l'influence directe du cinéma, la plupart des auteurs s'accordent à en signaler les influences indirectes et inconscientes. De leur avis commun, ces influences sontrarement dues à un seul film ou méme à plusieurs, mais résultent plus vraisemblablement de toute une série de films aux sujets et aux tendances analogues qui, par leur repetition, créent un nouvel état d'esprit chezle jeune spectateur ou modifient ses conceptions .
En d'autres termes, on soutient généralement que la présentation réitérée de certains thèmes et de certainstypes de comportement sur l'écran a beaucoup plus de chances de produire un effet indirect et différé que l'influence manifeste et immédiate d'un film isolé, même caractéristique.La conclusion très générale que l'on peut en tirer est que le cinéma a un effet essentiellement provocateur mais n'est que par exception une cause fondamentale.
On semble maintenant tenir pour presque certain que les jeunes gens des deux sexes tirent du cinéma leurs idées sur certaines questions secondaires et
d'ordinaire inoffensives telles que l'habillement,la coiffure, la façon de parler, lesdistractions et les jeux. Pour ce qui est des influences nuisibles, les facteurs le plus fréquemment tenus responsables sont laprésentation trop insistante et déformée des scènes de crime, de cruauté ou d'horreur et celle d'éléments que l'on pourrait grouper sous la désignation générale d'érotiques.Mais, comme le montrent les présentes notices bibliographiques, parents et éducateurs s'inquiètent aussi beaucoup des effets de certains elements moins visibles peut-étre du cinéma récréatif. On s'élève généralement contre la conception artificielle de la vie dans le monde du cinéma, où "tout ce qui est outré est présenté comme normal'', ce qui, dit-on, risque de fausser le sens des valeurs chezles spectateurs dont l'esprit n'est pas encore mûr. Parmi les thèmes de ce genre qui attirent les foudres de la critique figurent notamment : la description insistante du luxe et de la "bonne vie'' ; l'exaltationde la vengeance en tant que mobile ;les solutions chimériques proposées lorsque surviennentdes difficultés ; enfin la schematization artificielle des rencontres entre garçon et fille.Différents auteurs apDellent l'attention sur les images stéréotypées que crée l'écran en ce qui concerne aussi bienles personnages (le cow-boy,le gangster, etc. ) que les modes de comportement;la question ici posée est de savoir si de tels sté-réotypes ne risquent pas de donner aux jeunes spectateurs des autres pays une
conception erronée de la vie et des coutumes nationales. Quant aux attitudesou aux préjugés raciaux,certains faits prouvent que quelques films frappants suffisent à les influencer dans un sens ou dans un autre.
On aurait pu s'attendre à ce que les ouvrages figurant dans la partie consacrée à la "délinquance juvénile" soient tous de date relativement récente ;teln'est cependant pas le cas. Les auteurs du début de la période considérée n'ont pas négligé la question ; des études ont paru à ce sujet en 1933 et, selon l'un des auteurs cités, les recherches dans ce domaine auraient débuté peu après 1910, soit presque aussitôt que le cinéma eut commence à exercer son influence sur le grand public. Là encore , les auteurs et les théoriciens semblent avoir eu dès le début des opinionsdivergentes sur la question de savoir si le cinéma exerce sur la jeunesse une influence dirqcte et, dans l'affirmative,quelle en est la raison. La multiplication et l'usage croissant des techniques de recherché scientifiques n'ont guère contribué à éclairer la situation. A cet égard, il convient d'appeler I'attention sur le voeu exprimé par un auteurquisouhaite l'établissement d'une coopération plus étroite entre tous ceux qui s'intéressent à l'influencedu cinéma sur la jeunesse. Du moins la publication de la présente bibliographie devrait-elle, dans une certaine mesure, empêcher les chercheurs de pénétrer à
leur insu dans des parties déjàbien explorées de ce domaine.
Les problèmes évoqués dans d'autres sections de cette bibliographie sont plutôt plus simples que ceux qui se posent dans les sections consacrées à la délinquance juvénile et à d'autres repercussions du cinéma. Par exemple, différentes tendances se dégagent assez clairement des sections relatives à la fréquentation du cinéma (2 a) et aux préférences cinématographiques (2 b). Bien que certaines de ces tendances puissent paraître évidentes,il peut être utile de voir confirmer par de nombreux auteurs les opinions suivantes : les enfants en général vont au cinéma plus souvent que leurs parents et s'y rendent de plus en plus rarement en leurcompagnie 3 mesure qu'ils avancent en âge ; les garçonsont tendance à s'y rendre plus fréquemment que les filles ; enfin, les jeunes spectateurs les plus assidussont, d'une manière générale, les enfants malheureux ouesseulés, ceux qui cherchent à se distraire pour "fuir la vie quotidienne" et ceux qui s'intéressent le moins à d'autres activités. Plus particulièrement, certains faits montrent que la fréquentation varie en fonction des revenus, de l'intelligence et de l'éducation, les enfants les moins favorisés dans ces différents domaines allant plus souvent au cinéma que les enfants de famille aisée, d'une grande intelligence et éduqués avec soin.
Dans de très nombreux ouvrages consacrés à l'influence du cinéma sur la jeunesse on accorde une importance primordiale à l'âge des spectateurs, étant donné le rôle que joue ce facteur en ce qui concerne leurs habitudes et leur comportement, leur compréhension de ce moyen d'expression et les effets qu'il produit sur eux, les mesures de censure et la législation, enfin la production et la sélection de programmes considérés comme appropriés.L'examen des ouvrages mentionnés dans cette bibliographie permet de distinguer assez clairement quatre principaux stades oupériodes dans le développement des jeunes spectateurs ;on comprendra toutefois qu'il ne faut pas déterminer arbitrairement les groupes d'âge et que les différents stades se chevauchent. Le premier stade, qui va jusqu'àsept ans, correspond à l'âge dit du ''conte de fées", où les enfants vivent dans un monde imaginaire.Il y a lieu de noter ici que, pour unnombre appréciable d'auteurs, le cinéma ne convient nullement aux très jeunes enfants ; en général, les enfants ne devraient donc pas commencer à fréquenter les salles de cinéma avant l'âge de sept ans et surtout ne devraient pas s'yrendre sans être accompagnés d'un parent ou de quelqu'autre adulte responsable. Le deuxième groupe d'âge va de sept à douze ans. C'est ce qu'on appelle l'âge des "Robinsons", où l'expérience de la réalité prend de plus en plus la première place et où les enfants s'intéressent surtout aux aventures et à l'action. Mais on peut constater qu'ils sont déjà
capables d'adopter une attitude objective et de suivre les grandes lignes de l'actjon dans un récit. Cette période se fond avec le troisième stade, celui de la puberté (de douze à seize ans), où la personnalité de l'enfant s'affirme sensiblement et oh des tensions se manifestent. Dès lors, l'enfant moyen est fortement attiré par le cinéma bien que son caractère fictif ne lui échappe pas. Il est capable non seulement de comprendre un film dans son ensemble,mais encore d'interpréter dans une certaine mesure la structure interne et le sens du spectacle, Cette opinion est soutenue par les auteurs pour qui le "langage cinématographique" ne peut etre compris par les enfantsavant l'âge de la puberté. Selon une variante de cette théorie, on peut distinguer deux phases dans le développement de la compréhension du cinéma chez l'enfant : un âge mental de dix ans est nécessaire poursuivre les séquences et les différentes techniques d'expression cinématographique, tandis qu'il faut avoirun âge mental d'au moins douze ans pour bien saisir la signification réelle d'un film. La plupart des auteurs estiment que le quatrième stade de la comprehension cinématographique commence vers l'âge de seize ou dix-sept ans qui, dans ungrand nombre de pays, est celui oùles jeunes spectateurs sont légalement considérés commeadultes et ne sont donc plus soumis officiellement aux restrictions imposées par la censure. L'intérêt qu'ils portent au cinéma est fortement influencé par leur
désir de pénétrer les mystères du monde adulte dans lequel ils commencent alors à entrer eux-m&mes.
C'est cependant à l'âge de douze ou treize ans que l'on situe la ligne de partage décisive. Le problème du cinéma commence semble-t-il à douze ans. etles auteurs représentés ici s'accordent assez généralement à penser que les réactions des adolescentsdevant le cinéma sont sensiblement différentes de celles des enfants ; le débutde la puberté entrahie en effet non seulement une nouvelle façon de concevoir le cinéma et une meilleure comprehension de ce que veulentdire les films, mais encore des impressions plus vives et des effets plus puissants sur l'imagination et les sentiments, d'où l'apparition de nouveaux problèmes. Par exemple, c'est au cours de l'adolescence que le culte des vedettes se manifeste le plus visiblement.
Quant aux types de films préférés, c'est un lieucommun de dire que les goûts en la matière mû-rissent à mesure que le sujet mûrit lui-m&me.Toutefois,les témoignages recueillis ici permettent de dire avec certitude que les garçons préfèrentles films d'aventure, d'action et de violence, tandis que les filles aiment ceux qui concernent l'amour,la vie privéeet le charme. On peut encore distinguer dans ces catégories les subdivisions de detail suivantes : pour les garçons : films de guerre,films de cow-boys, comédies, films sur les animaux,films musicaux, films policiers et histoires criminelles à sensation,
histoires sportives ;pour les filles : films musicaux, films sur la nature et les animaux, comédies, histoiresd'amour, vie quotidienne et relations humaines. On peutrésumer ces tendances particulières en disant qu'outre les niveaux d'éducation, d'intelligence, d'âge et de fortune, le milieu social et la situationfamiliale exercent une influence sur la fréquentation du cinema par les enfants ainsi que sur leurs préférences, leurs goûts et leurs réactions devant les films. Il serait toutefois hasardeux de vouloir formuler des conclusionsplus précises que celles qui précèdent.
L'étude des notices pertinentes de la Section 6 semble montrer que l'on s'accorde généralement à reconnaître l'existence d'un "langage cinématographique"dont les éducateurs doivent tenir compte puisqu'il est impossible de bien comprendre les films sans une certaine connaissance de ce langage.En matière de production, il semble également à peu près certain que la simplicité est une condition essentielledans la réalisation d'un film 5 l'intention des enfants, notamment des jeunes enfants, car ils suivent difficilement le langage cinématographique(mouvement des caméras, symboles dutemps, etc. ), dont l'interprétation fait appel à un processus différent decelui qui intervient dans la lecture et la compréhension d'un livre. Les nombreux auteurs qui voudraient encourager 1' "education cinématographique",notamment au moyen de ciné-clubs et de débats cinématographiques (organizes soit dans les clubs soit
dans les salles de classe) ont généralement les mêmes idées quand à l'orientation qu'il faudrait donner aux activités de ce genre. De même,les auteurs reconnaissent d'une manière presque unanime l'intér&t que présente la production et la distribution de films spé-cialement destinés aux enfants et il y a peu de divergences d'opinions quant aux difficultés qui surgiront ou aux moyens permettant de les éviter.
1. OUVRAGES GENERAUX
(a) INTRODUCTIONS, REFLEXIONS ET EVALUATIONS 1. Lunders, Leo. Comment évaluer l'influence du cinéma sur les enfants ? In : Revueinternationale du cinéma, Bruxelles, 4 (lZ), 1952,p. 50-55.
Analyse critique de plusieurs méthodes d'évaluation qualitatives et quantitatives qui conduisent souvent à des conclusions erronées. Ne serait-il pas souhaitable et possible d'établir une cooperation plus étroite entre les différents enquêteurs qui étudient l'influence du cinéma sur la jeunesse ?Il faudrait élaborer un plan de travail, au sujet duquel diverses propositions sont présentées.
2. Muth, Heinrich. Land- Jugend und Kino. Lajeunesse rurale et le cinéma 1. in : Planck,Ülrich, Die Lebenslage der westdeutschen Landjugend, Munich, Juventa-Veclag, 1956.(Part 1 : 409p. ; Part II: 558 p. ) Les conditions de vie de la leunesse rurale en Allemagne occidentalel.
Critique des méthodes et des résultats des recherchesdéjà consacrées à l'influence du cinema sur lajeunesse.Ces recherches peuvent être ranges dans trois catégories : les études psychopé dagogiques ; les travaux pédagogiques qui ne font qu'aggraver l'inquiétude du public touchant l'influente du cinéma ;et les enquêtes sociologiques,négligées jusqu'ici. Pourque les études de psychologie individuelle soient fécondes, il faut disposer au préalable de données sociologiques suffisantes que fournira une enquête sur l'attitude de la jeunesse rurale à l'égard du cinéma. L'auteur examine la fréquentation cinématographique chez les jeunes ruraux, puis cite diverses corrélations, d'où il ressort que les amateurs de cinéma (qui assistent à des projections deux fois au moins par mois) se distinguent des spectateurs moins assidus, à d'autres points de vue également; préférencepour l'utilisation des loisirs en dehors du cercle familial, absence de certains préjugés concernant par exemple le maquillage.Le cinéma ne contribue nullement,comme le prétendent les esprits chagrins, à rendre la jeunesse mécontente de son sort.
3. Nozet, Hugues. L'influence du cinéma sur la jeunesse. Etudes expérimentales. In : Atti del Congres internazionale organizzato da1 CIDALC, Firenze, 6-11 Giugno 19LO "Il cinema nei problemi della cultura'' L Actes du Congrès international organisé par le CIDALC, Florence, 6-11 juin 1-0 "Le cinéma et les problèmes culturels"1. Rome, Bianco e Nero, 1951, p. 79-83.
Exposé sommaire des difficultés méthodologiques que présentent les recherches relatives à l'influence du cinéma sur la jeunesse. Quand il étudie comment les jeunes réagissent aux longs mét rages, le chercheur estgêné par l'impossibilité de modifier la composition même du film. Il faudrait réaliser des films spécialement conçus pour ce genre de recherches. Le fait qu'un film suscite chez les enfants et les adolescents une série de réactions complexes - motrices, psychologiques,émotives et intellectuelles - complique beaucoup ce genre d'études. Ce travail contient aussi un bref exposé de la méthode du professeur Wallon.
4. Reymaker, J. de. Methodes voor het onderzoek vande invloed van de film op de jeugd LMéthodes employées dans les recherches relatives à l'influence du cinéma sur 1ajeunesseJ.Université de Louvain, 1950 (Thèse inédite).
Cet examen critique de plusieurs enquêtes relatives à l'influence du cinéma sur la jeunesse vise surtout les méthodes employées à cette fin. Pour l'étude des
préférences cinématographiques, la méthode de Heuyer, Lebovici et Amado (Recherches au Centre de neuro-psychiatrie infantile) semble la meilleure, car elle explique la préférence pour certains films dans le cadre d'un examen clinique. Les recherches sur la façondont le cinéma modifie la vie mentale (Holaday et Stoddard ; Zazzo)semblent offrir d'encourageantes promesses. L'auteur considère cependant que les recherches touchant l'influence du cinéma sur les "attitudes''( Petersen et Thurstone) ont peu de chance de donner beaucoup de résultats. De nombreuses recherches(Rosen) montrent que 1 'influence du cinema prend souvent une forme suggestive (inconsciente).Wieseet Cole ont montré qu'un film est assimilé de façon différente selon le niveau ~ociai et culturel des spectateurs. Le meilleur point de départ pour les recherches ultérieures se trouve dans l'étude de la dynamique de la vie de l'enfant ou de l'adolescent. Lestechniques objectives (Blumer,Funk, Mayer) peuvent êtreutilisées pour des recherches portant sur les groupes aussi bien que sur les individus. Si l'on étudie les réactions collectives,ces techniques doivent être axéessur certains aspects et non pas sur l'ensemble du problème.L'étude approfondie du phénomène d'identification est fort importante, mais l'auteur considère que l'interprétation psychanalytique est troppartiale pour être de quelque profit. Une bibliographiedétaillée complète cet examen.
5. Dale, Edgar.pictures L L'assiduité des enfants au cinémal.New York, Macmillan, 1935, 81 p. (Payne FundStudies).Children's attendance at motion Etude sur l'assiduité des enfants au cinéma aux Etats-Unis d'Amérique. Les enfants de 5 à 8 ans vont au cinéma O, 42 fois par semaine. 22 70 des enfants de ce groupe d'âge n'y sont jamais allés.Les garçons de 5 à 8 am ontassisté enmoyenne à 24 séances par an, les filles du même %geà 19 seulement. De 8 à 19 ans, les enfants vontau cinema en moyenne une fois par semaine ou peu s'en faut ; dans ce groupe d'âge, 5 % seulement des enfants ne sont jamais aiiés au cinéma. Les garcons de ce groupe d'%ge ont assisté en moyenne à 57 séances par an, les filles à 46. 27 70 des garcons et 21 % des filles de ce groupe d'âge vont au cinéma deux fois au moins par semaine. Les enfants des villages voient moins de films que ceux des villes. Les pères n'accompagnent leur fils (entre 8 et 19 ans) que dans 2,83 % des cas, les mères dans 3,65 70. Dans 2370 des cas, les garçons de 8 ans étaient accompagnés par leurspère et mère. Gar-çons et filles préfèrent aller au cinéma avec des amis,unfrère ou une soeur, plutât qu'avec leurs parents.Aux Etats-Unis, 3,170 des spectateurs quivont au cinéma ont moins de 7 ans, 13, 770 ont de 7 à 13 ans,20,8 % ont de 14 à 20 ans et 62.4 70 ont plus de 20 ans.Toujours aux Etats-Unis, onze millions d'enfants de moins de 14 ans et 28 millions depersonnes âgées de moins de 21 ans vont au cinema une fois par semaine.
6. Department of Social Welfare and Community Development in Accra and Kumasi. Children and the cinema : a report of an Enquiry into cinema going amongjuveniles undertaken by the Department of Social Welfare and Co-munity Development in Accra and Kumasi LLes enfants et le cinéma. Rapport d'une enqu&te sur la fréquentation cinématographique chez les jeunes, effectuée par le Département d'action sociale et de développement communautaire d'Accra et de Kumasi_/. 1054, 14 p.,(multigraphié).
Rapport d'une enquête de portée limitée sur la fréquentation du cinéma par les jeunes de 8 à 16 ans, àAccra et à Kumasi (Ghana), ayant essentiellement pour objet de répondre aux doléances fréquentes concernant l'influence du cinéma surla délinquance juvénile. il semble que les jeunes assistent surtout aux séances de midi à 15 heures et négligent quelquefois l'école pour cela. Ils ont recours, pour se procurer l'argent nécessaire, à divers expédients : s'ils ne l'ont pas gagné ou économisé, ils mendient, volent ou se font payer leur place. Les enfants ne comprennent pas le dialogue parlé, de sorte qu'ils ne saisissent du film que ce que leur montrent les images. L'objet et éventuellement la morale du récit leur échappentcomplètement. Bref aperçu des différentes réactions des jeunes et de leur préférences pour certains films. Le principal danger du cinéma est dû aux circonstances dans lesquelles les enfants le fréquentent (en cachette, contre la volonté de leurs
parents, sans avoir l'argent nécessaire). 7. Feo, G. de. Quand et comment les jeunes fréquententle cinéma. In : Revue international du cinéma éducateur, Rome, IV (10 etil), octobre et novembre 1932, p. 865-874 et 944-955.
Ona procédé dans 742 écoles d'Italie à une enquête statistique sur l'assiduité de la jeunesse au cinéma.Ona obtenu 18.757 réponses (garçons : 70,3 7' ;filles : 29. 7 %). On constate qu'a mesure qu'ils avancent en âge, les enfants et les adolescents ont tendance à fréquenter des cinémas d'une catégorie supérieure et dece fait à voir des films de qualité croissante. A mesure qu'ils grandissent,ils vont aussi plus souvent au cinéma, les garcons du reste plus souvent que les filles. C'est le dimanche et les jours de vacances que les enfants vont le plus volontiers au cinéma ; ceux des milieu ouvriers préfèrent les séances du soir et des jours fériés. Les enfants y sont plus souvent accompagnés de leurs parents dans les grandes villes que dans les petites.
8.Gibson, Harold J. (Mrs) et Nahabedian,Vaskoy (Mrs). A Survey of the reading, radio and motion picture habits of Royal Oak public school students and their parents LEtude sur le comportement des élèves de l'école publique de Royal Oak et de leurs parents,ej matière de lecture, de radio et de cinéma_/. Royal Oak Michigan, Royal Oak
&ri moyenm,cinéma beaucoup plus souvent que ses parents. A8 ans, il va au cinéma une fois par semaine ;jwqu'à 12 ans, il assiste A la séance du samedi après-midi. Quand il atteint les classes secondaires du premier cycle, il va au cinéma le vendredi soir, généralement avec un camarade. Ses parents le conseillent sur le choix du spectacle ; en général, il apprécie les films que lui recommandent ses parents. Ses préférences vont aux comédies, aux westerns, aux dessins animés et aux films sur la vie des animaux ; plus tard, son intérêt pour les westerns décrofï au profit des comédies musicales. Il choisit désormais d'après 1 a distribution et la publicité. Quand il atteint le second cycle, il tient un plus grand compte des avis de la critique et il a tendance à adopter les mêmes critères que ses parenîs.