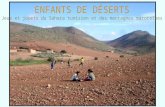Activités de catégorisation chez les enfants déficients intellectuels légers et les enfants...
-
Upload
u-picardie -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Activités de catégorisation chez les enfants déficients intellectuels légers et les enfants...
This article appeared in a journal published by Elsevier. The attachedcopy is furnished to the author for internal non-commercial researchand education use, including for instruction at the authors institution
and sharing with colleagues.
Other uses, including reproduction and distribution, or selling orlicensing copies, or posting to personal, institutional or third party
websites are prohibited.
In most cases authors are permitted to post their version of thearticle (e.g. in Word or Tex form) to their personal website orinstitutional repository. Authors requiring further information
regarding Elsevier’s archiving and manuscript policies areencouraged to visit:
http://www.elsevier.com/copyright
Author's personal copy
Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence 58 (2010) 317–326
Article original
Activités de catégorisation chez les enfants déficients intellectuels légerset les enfants tout-venant appariés par âge mental
Categorization activities by low intellectual disabilitychildren and typically developing children of the same mental age
O. Megalakaki ∗, H. Yazbek , N. FouquetÉquipe CLEA, faculté de philosophie, sciences humaines et sociales, université de Picardie-Jules-Verne, chemin du Thil, 80025 Amiens cedex 1, France
Résumé
L’objectif de cette recherche est d’étudier selon quels critères les enfants déficients intellectuels catégorisent des exemplaires appartenant aumonde du vivant et non-vivant, en comparaison avec des enfants tout-venant de même âge mental. Pour ce faire, nous avons utilisé une tâche detri libre qui permet de distinguer les aspects organisationnels et fonctionnels de l’activité de catégorisation. Dans une première étape, nous avonsdemandé aux enfants de trier spontanément des images, durant une deuxième étape, trois tas devaient être construit qui correspondent aux troiscatégories ontologiques manipulés par notre expérience (animaux, végétaux et artefacts) et dans la troisième étape, deux tas devaient être faitscorrespondant aux catégories du vivant et non-vivant. Nos résultats montrent que les catégories taxonomiques et thématiques coexistent et sontorganisées de la même facon chez les enfants déficients intellectuels et les enfants tout-venant appariés par âge mental et leur évocation dépend del’expérience du sujet et de la complexité de la tâche. De la même facon, l’utilisation de ces catégories, mise en évidence à travers les justificationsdes tas réalisés par les enfants, est similaire chez nos deux populations pour les animaux et les végétaux et différente pour les artefacts. En revanche,lorsque la tâche se complexifie (étape 2 et 3) et sa résolution demande un changement de stratégie, les enfants déficients ont des performancesinférieures à celles des tout-venant.© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Mots clés : Catégorisation ; Déficience intellectuelle ; Enfant tout-venant ; Vivant ; Non-vivant
Abstract
The aim of this research is to study according to which criteria intellectual deficient children categorize exemplars belonging to the world of livingand not living, compared with typically developing children of the same mental age. In order to do that, we used a free-sorting task which gives thepossibility to differentiate organizational and functional aspects of categorization activity. In the first step, we asked children to sort out picturesspontaneously. During the second step, three heaps must be constructed which correspond to the three ontological categories manipulated by ourexperience (animals, plants and artefacts) and in the third step, two heaps must be done corresponding to categories of living and not living. Ourresults show that taxonomic and thematic categories coexist and are similarly organized for the intellectual deficient children and the typical childrenmatched by mental age and their evocation depends of subject experience and the complexity of the task. Similarly, the use of these categories issimilar for our two populations for the animals and plants and different for artefacts. On the other hand, when the task gets harder (step 2 and 3)and its resolution needs a change of strategy, the intellectual deficient children have performances inferior to the typically developing children.© 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
Keywords: Categorization; Intellectual deficiency; Typically developing children; Living; Not-living
∗ Auteur correspondant.Adresse e-mail : [email protected] (O. Megalakaki).
1. Introduction
L’objectif de cette recherche est d’étudier les activités decatégorisation auprès des enfants déficients intellectuels légersappariés à des enfants tout-venant par âge mental dans une tâche
0222-9617/$ – see front matter © 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.doi:10.1016/j.neurenf.2009.12.006
Author's personal copy
318 O. Megalakaki et al. / Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence 58 (2010) 317–326
de tri libre où dans une première étape, on demande aux enfantsde mettre ensemble des items appartenant aux trois catégoriesontologiques du vivant et du non-vivant (animaux, végétauxet artefacts). Dans une deuxième étape, nous demandons auxenfants de faire trois tas qui correspondent aux trois catégo-ries ontologiques manipulés par notre expérience et dans unetroisième étape, ne faire que deux tas qui correspondent auxcatégories du vivant et non-vivant. L’avantage de la tâche du trilibre utilisée est qu’elle permet de distinguer les aspects orga-nisationnels et fonctionnels de l’activité de catégorisation. Bienque de nombreuses recherches se soient intéressées à l’étude dela catégorisation du vivant chez les enfants tout-venant, ellessont moins nombreuses à s’intéresser à ces activités chez lesenfants déficients intellectuels.
2. L’activité de catégorisation
La catégorisation est une activité cognitive fondamentale quiaide à l’organisation de notre environnement afin de repérer lesdifférences et les similitudes entre les objets, les actions, lesévènements et leurs propriétés. En diminuant de manière impor-tante la quantité et la diversité du monde, la catégorisation réduitl’effort cognitif en représentant les aspects du monde d’unemanière qui est à la fois plus informative et plus économique,ce qui permet à notre système cognitif de stocker et restituerl’information de manière efficace et nous donne la possibilitéde faire des inférences quand nous rencontrons de nouveauxmembres des catégories. C’est « une conduite adaptative fon-damentale qui permet à l’intelligence humaine de réduire lacomplexité et la diversité de l’environnement physique et socialen l’organisant » [1, p. 88].
Les résultats des études sur le développement concep-tuel montrent que les enfants tout-venant catégorisent lesinformations selon différents modes : « perceptif » (référenceà un ensemble d’objets regroupés selon leur apparence,forme/couleur), « thématique » (regroupement d’objets hétéro-gènes liés par leur appartenance à une scène ou un évènement),« taxonomique » (objets de même sorte regroupés en fonction deleurs propriétés communes de différents types, comme le nom,la fonction, etc). Les catégories taxonomiques sont organiséesselon une hiérarchie où les membres de la catégorie partagentdes propriétés communes et ont des caractéristiques de plusen plus abstraites, comme par exemple « animal, mammifère,caniche ».
Cependant, il n’y a pas de consensus entre les auteurs concer-nant l’ordre d’acquisition des différentes catégories. Certainsauteurs, tel que Nelson [2], ont une approche hiérarchiquedu développement de la catégorisation. Nelson considère quel’enfant tout-venant acquiert les catégories dans un ordre et unâge précis. Pour lui, le développement conceptuel débute par uneorganisation thématique entre deux et quatre ans qui se construità partir des représentations d’évènements et de l’expérience quien découle. L’organisation thématique contient des élémentshétérogènes et non substituables comme par exemple « un bol »et « du lait » qui sont proches dans la situation du petit déjeu-ner. Ces éléments hétérogènes sont organisés antérieurement enfonction des relations causales et temporelles. À partir de ces
représentations, l’enfant élabore vers l’âge de quatre à six ans descatégories dites « case à remplir » (slot-filler). Elles contiennentles représentations ayant des propriétés communes fonction-nelles et regroupent des éléments hétérogènes et substituablesdans la fonction donnée (par exemple, le lait et le jus d’orangese boivent au petit déjeuner). Puis, grâce au développement lan-gagier, les éléments de la catégorie « case à remplir » fusionnentprogressivement et nous avons l’apparition de catégories taxo-nomiques abstraites comme par exemple des « aliments » ou des« véhicules ».
Selon l’approche pluraliste, le développement des catégoriesn’est pas hiérarchisé et n’est pas lié à l’âge. L’enfant a accèstrès précocement à toutes les catégories et le fait de privilégiertelle ou telle catégorie dépend de la tâche, des caractéristiquesindividuelles et des connaissances que le sujet a des items del’expérience [3,4]. Bauer et Mandler [5] ont montré que mêmeles bébés âgés d’un an sont capables d’élaborer des catégoriestaxonomiques contrairement à ce que pensait Nelson qui consi-dère que ces catégories sont acquises à partir de l’âge de sixans. Smiley et Brown [6] ont montré qu’un enfant d’âge présco-laire est capable d’expliquer une relation taxonomique même s’ilchoisit un regroupement thématique des objets. Si nous avonsl’impression que l’enfant de quatre ou cinq ans ne comprendpas les relations taxonomiques existantes entre les concepts,c’est peut-être parce qu’il y a confusion entre les intérêts del’enfant et ses capacités. L’enfant préfère, par exemple, mettreensemble un chien avec une balle plutôt qu’un chien avec un ourscar il trouve cette association plus intéressante. Bauer et Mand-ler [5] ont montré aussi que les enfants d’âge préscolaire neregroupent pas les objets en fonction de la relation taxonomiquequi les lie mais en fonction de la manière dont ils interagissent.Par exemple, le chat et la souris vont être regroupés ensemblenon pas parce que se sont des animaux mais parce qu’ils inter-agissent ensemble (le chat attrape la souris). Markman et al. [7]ont proposé une épreuve de tri libre à des enfants âgés de troisà quatre ans selon deux conditions expérimentales : le tri devaitêtre réalisé en placant les objets sur quatre feuilles de papier,ou dans quatre sacs transparents. La consigne était de mettreensemble les choses qui vont ensemble. Pour chaque catégo-rie taxonomique pouvant être construite (fournitures, véhicules,humains, arbres), l’enfant disposait de quatre exemplaires parcatégorie. Les résultats ont montré que la condition sacs a per-mis aux enfants de faire plus de catégories taxonomiques. Selonles auteurs, c’était la réduction de l’espace de rangement quia permis aux enfants d’utiliser un système conceptuel existant,celui d’organisation taxonomique. Dans une expérience simi-laire, Lecacheur et al. [8] ont montré que le matériel proposéaux enfants de quatre à six ans peut induire un type de tri (cou-leur ou schématique), c’est-à-dire l’utilisation d’une catégorieau lieu d’une autre. En effet, quand le support matériel a unespace réduit, les objets sont empilés par les enfants et aucund’entre eux ne donne le nom d’une pièce car ils ont des difficul-tés à faire un tri schématique sur un espace réduit. En revanche,l’augmentation du volume de la pièce peut induire la réalisationde schémas nommés. De plus, Lecacheur et al. [8] ont constatéque les plus jeunes enfants préfèrent utiliser des relations théma-tiques. Deux types de tris sont donc possibles entre quatre et six
Author's personal copy
O. Megalakaki et al. / Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence 58 (2010) 317–326 319
ans et dépendent du support. Kalénine et al. [9] suggèrent égale-ment une double origine des concepts surordonnés. Ces conceptsdépendent non plus d’un changement dans l’organisation sous-jacente de l’enfant comme le prétendent les théories classiques(hiérarchiques), mais dépendent directement du processus detraitement de l’information perceptive et fonctionnelle issue ducontexte d’apparition commun des objets. Ces auteurs ont mon-tré que chez les enfants de quatre et cinq ans, les catégoriessurordonnées dans le domaine des objets naturels nécessite-raient la similarité visuelle, tandis que les catégories d’objetsfabriqués feraient appel à la similarité fonctionnelle issue deschémas d’action. Leurs résultats sont similaires à ceux obte-nus dans l’étude longitudinale de Scheuner et Bonthoux [10],dans une épreuve d’appariement élaboré sur le même principe.L’enfant est capable très tôt de former des catégories taxono-miques regroupant des objets sémantiquement reliés sur la basedu traitement d’indices perceptifs et des catégories thématiques,qui sont basées sur des indices contextuels et fonctionnels.
Waxman et Namy [11] ont également mis en évidence que« la consigne » peut avoir de l’influence sur le choix de la caté-gorie qui sera utilisée par l’enfant, lors d’une étude réaliséeauprès d’enfants de deux à quatre ans. Ils ont proposé une tâched’appariement avec des objets miniatures, opposant un associétaxonomique et un thématique, selon la consigne « trouve celuiqui va avec » pour un groupe d’enfants et « trouves-en un autre »pour un autre groupe. Leurs résultats ont montré que les apparie-ments taxonomiques en condition « trouves-en un autre » sontplus importants qu’en condition « trouve celui qui va avec ». Lesenfants sont donc capables d’ajuster le choix de la catégorie enfonction de la consigne proposée.
3. Catégorisation et déficience intellectuelle
Les études sur l’organisation catégorielle montrent que despersonnes déficientes intellectuelles ont des moindres perfor-mances comparativement aux personnes tout-venant de mêmeâge chronologique et/ou mental. Les résultats de plusieursauteurs vont dans ce sens et montrent par exemple, que des per-sonnes déficientes intellectuelles ont des difficultés à s’appuyersur les relations catégorielles existant entre les stimuli ce qui neleur permet pas de réussir dans les tâches de rappel et de recon-naissance [12] ou pour élaborer des stratégies métacognitives derappel [13] ou encore pour comprendre la stratégie sémantiqueproposée [14].
Cette difficulté des personnes déficientes intellectuellesaugmente selon le degré de la complexité du traitement cognitifdemandée pour la réalisation de la tâche. Lorsque la tâchedemande un traitement automatique de l’information, lesperformances des personnes déficientes intellectuelles sontéquivalentes à celles des non-déficients. En revanche, lorsquela tâche demande un traitement contrôlé et/ou explicite del’information, du type attentionnel verbal ou stratégique, lesperformances des personnes déficientes intellectuelles sontinférieures à celles des non-déficients. L’étude de Sperber et al.[15] auprès des adolescents déficients intellectuels montre desperformances différentes selon la complexité de la tâche. Ainsi,dans une tâche d’amorcage sémantique, où les relations catégo-
rielles sont activées automatiquement, les sujets déficients ontdes performances équivalentes avec les sujets tout-venant. Enrevanche, lorsque la tâche demande de faire un classement dutype « met ensemble les items qui vont bien ensemble » ou dejustifier les catégories produites, les enfants déficients ont desperformances inférieures. Selon ces auteurs, les relations catégo-rielles sont construites de la même facon chez les personnes nondéficientes et déficientes intellectuelles mais ce qui diffère c’estleur utilisation. Des résultats similaires ont été obtenus lorsquel’information présente dans la tâche demande un traitementautomatique [16]. Dans ce cas, les performances des personnesdéficientes intellectuelles sont comparables à celles des per-sonnes tout-venant du même âge chronologique et inférieuresquand la tâche requiert un traitement contrôlé. Hayes et Conway[17] ont constaté que lors de la mémorisation à court terme,l’encodage et le stockage des caractéristiques d’exemplaires(basés sur la recherche et l’activation en mémoire des exem-plaires qui sont globalement les plus similaires à l’élément àcatégoriser) sont moins efficients chez les enfants déficientsintellectuels quel que soit leur âge mental. En revanche, lescatégories prototypiques (basées sur la proximité des carac-téristiques de l’élément à catégoriser avec celles du prototypede la catégorisation) semblent indépendantes de l’efficienceintellectuelle. Les personnes déficientes intellectuelles ont doncdes connaissances catégorielles, cependant leur élaborationpeut être perturbée. De la même facon, les résultats de Vinteret Detable [18] montrent des différences de performances selonle type d’apprentissage (implicite ou explicite). Lors d’unapprentissage implicite, les performances sont similaires entredes enfants et des adolescents déficients intellectuels et desenfants tout-venant (du même âge chronologique et du mêmeâge mental) et différentes lorsque l’apprentissage est explicite.De plus, l’apprentissage implicite ne varie pas en fonction du QIou de l’âge. Vicari et al. [19] ont observé également, que dansdes tâches de mémoire implicite la performance de personnesdéficientes intellectuelles était comparable à celle des enfantstout-venant appariés par âge mental et inférieure dans des tâchesde mémoire explicite. Gavornikova-Baligand et Deleau [20,21]ont étudié l’organisation catégorielle des connaissances et leurmobilisation auprès de déficients intellectuels adultes. Les per-formances de ces sujets ont été comparées avec celles d’adultesnon déficients de même âge chronologique et d’enfants demême niveau mental. Les résultats de ces auteurs montrent unedissociation entre l’organisation catégorielle des connaissanceset leur mobilisation. Dans une tâche de catégorisation en choixforcé demandant un traitement non intentionnel (pointage desitems), les auteurs ont observé des performances similaires chezdes personnes déficientes et non déficientes. En revanche, dansune tâche impliquant un traitement intentionnel (justificationdes associations et tâche de tri), les performances de personnesdéficientes sont inférieures à celles des non-déficientes.
4. Problématique et hypothèses
Suite au cheminement théorique, présenté précédemment,nous constatons qu’il existe une divergence entre les diversesthéories concernant l’acquisition des différentes catégories.
Author's personal copy
320 O. Megalakaki et al. / Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence 58 (2010) 317–326
Les théories unitaires [2] expliquent que les catégories sontacquises chez les enfants par une succession d’étapes hiérarchi-sées (l’enfant commence par catégoriser thématiquement puistaxonomiquement). Les théories pluralistes [3,4] considèrentque les catégories thématiques et taxonomiques coexistent etleur évolution n’est pas liée à l’âge. L’utilisation de tel ou teltype de catégories dépend des caractéristiques individuelles,des situations proposées et de l’expérience de l’enfant avecles items [9,10]. Ces approches théoriques portent sur l’enfanttout-venant, cependant nous nous posons la question de savoircomment l’enfant déficient intellectuel léger catégorise. Nousnous demandons s’il possède en mémoire les différentes caté-gories, s’il les acquiert de la même manière ou si elles sontdéficitaires et dans ce cas, à quel niveau porte le déficit. De plus,nous voulons savoir si l’enfant déficient est capable d’utiliserces catégories de manière adéquate dans une tâche qui impliqueun recours à ces catégories. Les travaux sur des sujets déficientsont montré qu’ils possèdent en mémoire les catégories et que ledéficit porte sur l’utilisation quand il s’agit de justifier leur choix[21] ou selon le type de traitement automatique ou contrôlé [16]ou encore selon le type d’apprentissage implicite ou explicite[18].
En prenant en compte les résultats des précédents travaux,l’objectif de notre recherche est d’étudier les activités de caté-gorisation des exemplaires du vivant (animaux et végétaux) et dunon-vivant (artefacts). La distinction entre vivant et non-vivantest considérée comme une activité fondamentale dans le déve-loppement cognitif de l’enfant et parmi les premiers critèrespour cette distinction est le mouvement [22–25]. Le vivant a descaractéristiques qui lui sont propres, comme bouger, grandir, sereproduire, est capable d’états mentaux, etc. [26]. Alors que lesobjets artificiels sont appréhendés par l’action et la fonction del’objet, et leur utilisation courante joue un rôle important [9,10].
Pour mener notre étude, nous utilisons une tâche de trilibre, qui est simple, mais qui peut nous donner beaucoupd’informations sur l’organisation des informations dans lamémoire ainsi que leur utilisation si on l’exploite suffisam-ment. Notre tâche est composée de 13 images appartenant à troiscatégories ontologiques du vivant et du non-vivant (végétaux,animaux [dont un humain] et artefacts). Nous comparons lesperformances d’enfants déficients intellectuels légers à cellesd’enfants tout-venant appariés par âge mental sur la facon decatégoriser des items appartenant au vivant et au non-vivant.Nous demandons aux enfants, dans une première étape, de trierles items de facon spontanée en faisant autant de tas qu’ilsveulent, dans une deuxième étape, de faire trois tas (qui corres-pondent aux trois catégories ontologiques) et dans la troisièmeétape, deux tas (vivant, non-vivant). Après chaque tri nousdemandons à l’enfant de justifier les tas effectués afin d’observerselon quels critères il catégorise.
On s’attend à ce que les enfants déficients intellectuels fassentle même nombre et « type de tas » (thématiques, taxonomiques)que les enfants tout-venant mais les « justifications » pour expli-quer les tas réalisés seront différentes chez nos deux populations.On s’attend aussi à ce que les enfants déficients aient des per-formances inférieures à celles des tout-venant lorsque la tâchese complexifie (étapes 2 et 3).
5. Méthodologie
5.1. Population
Notre population est composée d’un groupe de 30 enfantsdéficients intellectuels légers, sans retard spécifique, recrutésdans un institut médicoéducatif (IME) et un groupe de 30 enfantstout-venant, recrutés dans une école maternelle d’Amiens, appa-riés par âge mental. Les enfants tout-venant ont été sélectionnésde facon à ce qu’ils ne présentent ni retard ni avance particulièreet nous considérons que leur âge réel équivaut à leur âge men-tal. Les données ont été recueillies durant l’année 2008–2009.Les mesures des QI et d’âges mentaux pour les enfants défi-cients sont tirées des différentes performances disponibles auxtests du WISC III et de Concepts de base du BOEHM-revisé(BOEHM-R). Le test de BOEHM permet d’évaluer la compré-hension et la maîtrise des concepts s’appliquant à des notionsde nombre, de lieu, de temps et/ou d’espace, qui sont indispen-sables pour que l’enfant comprenne les consignes données parl’enseignant et pour la réalisation des activités quotidiennes enclasse.
Concernant les caractéristiques des enfants déficients, ils ontun QI compris entre 50 et 67 (QI moyen 63) et sont considé-rés comme des déficients intellectuels légers selon les normesfrancaises et de l’OMS. L’âge réel de ces enfants va de 8,10 à14,5 ans (âge réel moyen 12 ans et deux mois) et leur âge men-tal (AM) va de cinq ans et deux mois à sept ans et quatremois (AM moyen 6,2 ans). L’âge réel des enfants tout-venantva de 4,9 à 6,3 ans (âge réel moyen cinq ans 11 mois). Lenombre de garcons et de filles était équivalent dans les deuxpopulations.
5.2. Matériel
Nous avons proposé aux enfants une tâche de tri libre. Lematériel se compose de 13 cartes d’images, en couleur, sur unfond blanc, représentant des objets familiers et connus, quiappartiennent aux catégories du vivant (végétaux et animaux)et du non-vivant (artefacts). Ces cartes ont été plastifiées et ontune dimension de 7 cm × 7 cm. Elles proviennent de banquesd’images autorisant leurs diffusions (BD2I et la petite souris).Neuf images représentent des items vivants (cinq animaux : dontun être humain, un chat, un poisson, une mouche et un oiseau ;quatre végétaux : un arbre, une marguerite, un fraisier et un oran-ger) et quatre images représentant des artefacts (une table, unetasse, un vélo et un avion).
5.3. Procédure
Les enfants sont pris séparément dans une pièce tran-quille de leur établissement. Après une brève prise de contact,l’expérimentateur explique à l’enfant qu’il va lui présenterdes images et qu’il doit répondre à certaines questions. Nousprécisons à l’enfant qu’il n’y a pas de mauvaise réponse.L’expérimentateur pose les images une à une sur la table etdemande à l’enfant de les dénommer au fur et à mesure. Ensuite,
Author's personal copy
O. Megalakaki et al. / Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence 58 (2010) 317–326 321
l’épreuve de tri libre se déroule en trois étapes :
• dans la première étape, l’expérimentateur demande à l’enfantd’essayer de faire autant de tas de cartes qu’il veut « en mettantensemble les cartes qui vont ensemble ». Nous laissons fairel’enfant ;
• dans la deuxième étape, sans mélanger les tas faits dans lapremière étape, nous demandons à l’enfant d’essayer de fairetrois tas de cartes, selon la consigne suivante : « Un autreenfant a fait trois tas et toi tu pourrais faire trois ? » ;
• dans la troisième étape, toujours sans mélanger les tas faitspar l’enfant dans l’étape précédente, nous disons : « Et main-tenant, tu pourrais faire deux tas ? ».
Pour chacune des trois étapes, une fois que les tas sont consti-tués, nous notons les items choisis et nous demandons à l’enfant« Pourquoi as-tu mis ces cartes ensemble ? ».
Pour la réalisation de notre expérience, nous avons d’aborddemandé le consentement des parents des enfants tout-venantainsi que le consentement des enfants déficients.
6. Critères de codage de données
Les données sont codées en deux temps selon les critèressuivants.
6.1. Analyse de la composition de tas
Dans un premier temps, nous notons pour chacune de troisétapes le nombre de tas effectués ainsi que leur « composition »(catégories retrouvées dans les tas). La composition d’un tasest codée comme « taxonomique » si les items appartiennent àla même catégorie ontologique (que des végétaux ou que desanimaux). Alors, qu’un tas est codé comme « thématique » si lesitems appartiennent à différentes catégories (des plantes et desartefacts).
Ensuite, nous regardons de combien de cartes est composéchaque tas afin d’observer la construction de catégories« taxonomiques » plus ou moins complètes. Ainsi, nous codons :
• taxonomique 5 : si la catégorie est construite avec tous lesexemplaires de la catégorie (c’est-à-dire tous les animaux dontl’humain) ;
• taxonomique 4 : si elle contient quatre exemplaires de la mêmecatégorie ;
• taxonomique 3 : si elle en contient trois ;• taxonomique 2 : si elle en contient deux.
6.2. Analyse de justifications
Dans un second temps, nous regardons la justification donnéepar l’enfant. Pour ce faire, nous avons construit des catégoriesd’analyse (Tableau 1). Ainsi, chaque tas est qualifié selon sacorrespondance à une des catégories construites. Par exemple,si un tas « taxonomique » est justifié par l’enfant en disant : « J’aimis ensemble le chat et le papillon parce qu’ils sont tous les deuxdes animaux », on le qualifie de « catégorie d’appartenance »(catégorie 6 du Tableau 1) ; si pour ces deux mêmes items, ildit je les ai mis ensemble parce que : « Le chat s’amuse avec lepapillon » on le qualifie de « interactionnelle » (catégorie 5 duTableau 1).
Nos données ont été codées par deux correcteurs indépen-dants et l’accord entre eux étaient de 95 %. Tous les désaccordsont été discutés et résolus.
7. Analyse de données
Nous avons effectué une Anova à mesures répétées pour com-parer le nombre et la composition des tas effectués par les deuxgroupes et une analyse Khi2 pour comparer les justifications destas.
8. Résultats
8.1. Nombre et type de tas effectués
Le « nombre de tas » effectué lors de « l’étape 1 » (Tableau 2),où les enfants sont invités à trier librement les objets, est le mêmechez nos deux populations. Lors de « l’étape 2 » quand nous
Tableau 1Catégories de codage de données.
Catégories d’analyse Critères d’attribution des catégories Exemples
Autre Le tas effectué n’est pas justifié ou la justification donnée necorrespond à aucune de nos catégories
Parce que
Perceptive La justification renvoie à des éléments de couleur, de forme et/oud’attributs physiques
Ils ont la même couleur
Spatio-temporelle Les exemplaires du tri sont liés thématiquement sur la base d’unlien spatial et/ou temporel
L’oiseau et l’arbre vont dans la forêt. La table et la tassevont dans la cuisine
Fonctionnelle Les exemplaires sont reliés par rapport à leur fonctionnalité (à quoica sert)
La petite fille fait du vélo. La voiture et le vélo vontensemble car ils peuvent rouler tous les deux
Interactionnelle Les exemplaires du tri sont reliés sur la base d’une interaction entreeux
Le chat grimpe à l’arbre et essaye d’attraper l’oiseau. Lafille s’amuse avec le vélo
Catégorie d’appartenance L’enfant nomme la catégorie d’appartenance des exemplaires d’unemême catégorie (animaux, végétaux, artefacts)
Ce sont tous des animaux. L’arbre et l’oranger sont desarbres Ce sont des objets
Biologique Les exemplaires du tri partagent la même propriété biologique L’oiseau et la mouche volent. L’arbre et la fleur poussent
Author's personal copy
322 O. Megalakaki et al. / Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence 58 (2010) 317–326
Tableau 2Effectif et pourcentage des enfants concernant le nombre et la composition destas effectués (mixtes et taxonomiques) par catégorie ontologique.
Enfantstout-venant(%)
Enfantsdéficients(%)
Étape 1 Total des tas 126 124
Total tas mixtes 63 (50) 64 (52)
Total tas taxonomiques 63 (50) 60 (48)
Taxonomiques animaux 25 (20) 20 (16)Taxonomiques animaux 5 1 (0,8) 0Taxonomiques animaux 4 13 (10,5) 9 (7)Taxonomiques animaux 3 0 2 (1,6)Taxonomiques animaux 2 7 (5,5) 6 (4,8)Taxonomiques animaux 1 4 (3,2) 3 (2,6)
Taxonomiques végétaux 24 (19) 28 (22,6)Taxonomiques végétaux 4 14 (11) 14 (11,3)Taxonomiques végétaux 3 6 (4,8) 0Taxonomiques végétaux 2 4 (3,2) 14 (11,3)
Taxonomiques artefacts 14 (11) 12 (9,4)Taxonomiques artefacts 4 5 (4) 2 (1,6)Taxonomiques artefacts 3 0 1 (0,8)Taxonomiques artefacts 2 9 (7) 9 (7)
Étape 2 Total des tas 69 31
Total tas mixtes 54 (78) 18 (59)
Total tas taxonomiques 15 (21,9) 13 (41%)
Taxonomiques animaux 5 (7,3) 5 (16)Taxonomiques animaux 5 1 (1,4) 1 (3)Taxonomiques animaux 4 2 (3,1%) 4 (13)Taxonomiques animaux 3 1 (1,4%) 0Taxonomiques animaux 2 1 (1,4) 0
Taxonomiques végétaux 5 (7,3) 6 (19)Taxonomiques végétaux 4 3 (4,5) 5 (16)Taxonomiques végétaux 3 1 (1,4) 1 (3)Taxonomiques végétaux 2 1 (1,4) 0
Taxonomiques artefacts 5 (7,3) 2 (6%)Taxonomiques artefacts 4 2 (3,1) 1 (3)Taxonomiques artefacts 2 3 (4,5) 1 (3)
Étape 3 Total des tas 28 0
Total tas mixtes 26 (92,8) 0
Total tas taxonomiques 2 (7,2) 0
Taxonomiques animaux 5 1 (3,6) 0
Taxonomiques végétaux 4 1 (3,6) 0
demandons d’effectuer trois tas, nous avons une différence signi-ficative entre nos deux groupes (F(1,53) = 13,194 ; p = 0,0006)sur le nombre de tas total effectué, mais pas d’effet d’interaction.Les enfants tout-venant (TV) font plus de tas que les enfants défi-cients intellectuels légers (D) (69 tas les TV et 31 les D). Pour« l’étape 3 » où nous demandons de faire deux tas, les enfantsdéficients ne sont pas arrivés à la réaliser.
Concernant « le type de tas » effectué (taxonomiques et thé-matiques), lors de « l’étape 1 », nous n’avons aucune différencesignificative entre nos deux populations, qui font toutes les deux
autant de tas thématiques que taxonomiques. Lors de « l’étape2 », 12/30 enfants déficients intellectuels y arrivent contre25/30 tout-venant. Nous avons une différence significative pourla composition de tas (taxonomiques et thématiques) et égale-ment un effet d’interaction entre les populations et le type de tas(F(1,53) = 13,194 ; p = 0,0006 ; F(1,53) = 14,773 ; p = 0,0003 ;F(1,53) = 9,876 ; p = 0,002, respectivement). Les enfants tout-venant font 69 tas et les déficients 31. Parmi ces tas, les enfantstout-venant font 54 tas thématiques et 18 les déficients. Nos deuxpopulations font toutes les deux le même nombre de tas taxono-miques. Pour « l’étape 3 », seuls 12/30 enfants tout-venant l’onteffectuée en réalisant en majorité des tas thématiques.
Afin d’étudier la « construction des catégories » pour lestrois catégories ontologiques (animaux, végétaux et artefacts),nous regardons le nombre de tas taxonomiques réalisés pourchaque catégorie. Nos résultats ne montrent aucune différencesignificative et cela pour les trois catégories et pour les deuxétapes. Les enfants des deux groupes font approximativementle même nombre de tas taxonomiques pour les trois catégories.Les catégories les mieux construites sont celles des animaux(25 tas construits par les TV et 20 par les D) et de végétaux(24 tas par les TV et 28 par les D), alors que la moins bienconstruite est celle des artefacts (14 tas par les TV et 12 parles D).
Quant à la construction, plus ou moins complète, de troiscatégories ontologiques (nombre d’exemplaires utilisés pourconstruire les tas taxonomiques), pendant « l’étape 1 » pourles « animaux », les enfants tout-venant sont plus nombreux àconstruire des tas complets avec les quatre exemplaires de lacatégorie (13/25 TV et neuf sur 20 D) (Tableau 2). Alors quele même nombre d’enfants des deux groupes construit des tasavec deux exemplaires (sept sur 25 TV et six sur 20 D). Pour lacatégorie des « végétaux », le même nombre d’enfants de deuxpopulations construit des tas avec les quatre exemplaires de lacatégorie (14 enfants de chaque groupe). Les autres enfants desdeux groupes font des tas avec trois ou deux exemplaires. Quantà la catégorie des « artefacts », peu d’enfants ont construit destas avec les quatre exemplaires (cinq TV et deux D). Pour laplupart, les tas sont construits avec seulement deux exemplairesde cette catégorie (neuf enfants de chaque groupe). Pendant la« deuxième étape », bien que le nombre de tas taxonomiquespour les animaux et les végétaux diminue globalement, lesenfants déficients sont plus nombreux à faire des tas avec lesquatre exemplaires de ces catégories (pour les animaux deuxTV et cinq D et pour les végétaux trois TV et cinq D).
8.2. Justification des tas taxonomiques
Au niveau du type de justifications (Tableau 3) utilisé par lesdeux groupes d’enfants pour expliquer les tas taxonomiques dela catégorie des animaux, il n’existe pas de différence signifi-cative aussi bien pour l’étape 1 que pour la 2. Les justificationsdonnées lors de l’étape 1 sont de nature taxonomique pour laplupart, en donnant le nom d’appartenance « ce sont des ani-maux » (76 % TV et 86,6 % D), ou biologique « la mouche etl’oiseau volent tous les deux » (16 % TV et 13 % D). À l’étape2, les tas taxonomiques sont justifiés par des réponses du type
Author's personal copy
O. Megalakaki et al. / Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence 58 (2010) 317–326 323
Tableau 3Pourcentages de justifications des tas taxonomiques.
Justifications Animaux Végétaux Artefacts
Étape 1 Étape 2 Étape 1 Étape 2 Étape 1 Étape 2
TV D TV D TV D TV D TV D TV D
Autre 8 0 67 69 9 11 0 0 7,2 0 37,5 0Spatio-temporelle 0 0 0 0 0 0 40 33,3 35,8 78,6 0 0Fonctionnelle 0 0 0 0 0 0 20 16,6 0 0 0 0Nom d’appartenance 76 86,6 33 31 83 67 40 50 57 21,4 62,5 100Biologique 16 13,3 0 0 8 22 0 0 0 0 0 0
TV : enfants tout-venant ; D : enfants déficients intellectuels légers.
autre par la plupart des enfants des deux groupes (67 % TV et69 % D) et par le nom d’appartenance (33 % TV et 31 % D).
La nature des justifications pour la catégorie des végétaux estla même pour nos deux populations pour l’étape 1 et 2. Lors del’étape 1, les justifications prédominantes sont de nature nomd’appartenance « ce sont des plantes » (83 % TV et 67 % D),biologique « elles poussent toutes les deux » (8 % TV et 22 %D) et autre (9 % TV et 11 % D). Quant à l’étape 2, les justifica-tions sont de nature thématique en faisant référence aux relationsspatio-temporelles entre les items (40 % TV et 33,3 % D) ou àleur fonctionnalité (20 % TV et 16,6 % D) ou encore à leur nomd’appartenance (40 % TV et 50 % D).
Concernant la catégorie des artefacts, pour l’étape 1, nousavons une différence significative entre nos deux populations surle type de justifications (X2(2) = 5,5227 ; p < 0,05). En effet, nousconstatons que les enfants tout-venant donnent plus de justifica-tions taxonomiques du type nom d’appartenance (57 %) que lesenfants déficients intellectuels (21,4 %). Les enfants déficientsjustifient plus les tas taxonomiques par des réponses de naturespatio-temporelle (78,6 % D et 35,7 % TV). Pour l’étape 2, il n’ya pas de différence significative entre nos deux populations pourles justifications. Les tas taxonomiques ne sont justifiés par lesenfants déficients que par leur nom d’appartenance. Alors queles enfants tout-venant les justifient par leur nom d’appartenanceou autre (62,5 % et 37,5 %, respectivement).
8.3. Justification des tas thématiques
Pour l’étape 1, (Tableau 4), nous avons une différence signifi-cative entre nos deux populations sur la nature des justifications(X2(4) = 11,095 ; p = 0,025). Des nombreux élèves des deuxgroupes donnent des justifications autres (28,6 % de TV et
Tableau 4Pourcentages de justifications des tas thématiques.
Étape 1 Étape 2
Justifications TV D TV D
Autre 28,6 37,65 53,7 74Spatio-temporelle 23,8 13 13 11Fonctionnelle 36,5 36,5 11,11 2Interactionnelle 1,6 10,6 20,4 11Biologique 9,5 2,4 2 2
TV : enfants tout-venant ; D : enfants déficients intellectuels légers.
37,6 % de D). Des arguments de nature spatio-temporelle sontdonnés par 24 % des tout-venant et 13 % des enfants déficientsD. Les deux populations donnent le même nombre de justi-fications de nature fonctionnelle (36,5 %). Nous avons aussides réponses de type interactionnel données par 1,6 % destout-venant et 10,6 % des enfants déficients. Des justificationsbiologiques sont données par 9,5 % des tout-venant et 2,4 %des enfants déficients. Quant à l’étape 2, nous n’avons pas dedifférence significative entre nos deux populations qui donnentdes justifications similaires pour justifier les tas thématiques.Les justifications qui prédominent sont de nature autre (54 %TV et 74 % D). Un certain nombre d’élèves des deux popu-lations donnent des justifications de nature spatio-temporelle,fonctionnelle et interactionnelle.
9. Discussion
L’objectif de notre recherche était de mettre en évidencecomment les relations catégorielles, dans le domaine du vivantet du non-vivant, sont élaborées et utilisées chez des enfantsayant une déficience intellectuelle légère en comparaison avecdes enfants tout-venant de même âge mental. Les aspects organi-sationnels de l’activité de catégorisation, pour notre expériencede tri libre, correspondent au nombre et au type de tas (taxono-miques ou thématiques) réalisés par les enfants. Alors que lesaspects fonctionnels correspondent aux justifications des tas etaux stratégies mises en œuvre pour réaliser les trois étapes del’expérience.
Nos résultats montrent que lorsqu’on demande de trier lesobjets de manière spontanée (étape 1) les enfants déficientsintellectuels légers font le même nombre et le même type detas que les enfants tout-venant. En effet, lors de cette premièreétape, il y a autant de tas taxonomiques et thématiques dans nosdeux populations. Dans la mesure où cette partie de l’activitéde catégorisation correspond plutôt aux aspects organisation-nels des catégories dans la mémoire, nos résultats indiquentque les catégories taxonomiques et thématiques sont construitesde la même facon chez les enfants déficients et les tout-venantde même âge mental. Les mêmes résultats ont été obtenus parGavornikova-Baligand [21] qui a montré que les personnes défi-cientes intellectuelles font les mêmes choix que les personnestout-venant.
Quand la tâche se complexifie, c’est le cas lorsque nousdemandons d’effectuer trois tas (étape 2), les enfants déficients
Author's personal copy
324 O. Megalakaki et al. / Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence 58 (2010) 317–326
ont des performances inférieures aux tout-venant. Cependant,bien que moins d’enfants déficients arrivent à réaliser cette étape,ils sont aussi nombreux que les tout-venant à réaliser des tas taxo-nomiques. En fait, la supériorité des enfants tout-venant résidedans la construction d’un plus grand nombre de tas thématiques.La difficulté des enfants déficients se confirme lors de l’étape3 (où le but est de faire deux tas vivant, non-vivant) car aucunenfant n’y est arrivé. Cependant, il faut noter que même parmiles enfants tout-venant, seuls 12/30 ont effectué cette étape enfaisant majoritairement des tas thématiques. Ce qui montre quela différence des deux populations n’est pas dans la construc-tion de catégories en mémoire, dans la mesure où pendant lapremière étape du tri spontané, les enfants des deux groupesconstruisent autant de catégories taxonomiques et thématiques.La difficulté des enfants déficients réside dans la mise en placedes outils cognitifs pour reconsidérer le classement réalisé (pen-dant la première étape), en utilisant de nouveaux critères et enélaborant de nouvelles stratégies afin de réaliser les nouveauxtris demandés aux étapes suivantes. Ces résultats rejoignent desrésultats précédents [16,21,15,19,18] qui montrent des perfor-mances similaires, entre les sujets déficients et tout-venant, dansdes tâches implicites ou automatiques et inférieures chez les défi-cients quand les tâches sont explicites ou contrôlées. En mêmetemps, il faut souligner aussi la difficulté des enfants tout-venantqui n’arrivent pas tous à réaliser moins de tas au fil des étapes.Comme d’autres auteurs [27,28,29], nous pouvons interprétercette difficulté en termes des capacités d’inhibition, de résistanceà l’interférence et d’attention sélective. En fait, la demande deréalisation de moins de tas à chaque étape nécessite une grandemobilisation des ressources attentionnelles, de résister aux choixfaits précédemment afin de réorganiser les tas déjà effectués etd’envisager de nouveaux.
Par rapport à la construction des trois catégories ontologiques(animaux, végétaux, artefacts) pendant la première étape, du trispontané, les enfants des deux groupes construisent approxima-tivement le même nombre de tas taxonomiques pour les troiscatégories. Les catégories les mieux construites sont celles desanimaux et de végétaux et la moins bien construite est celle desartefacts. De plus, pour la construction des catégories des ani-maux et des végétaux, la majorité de tas construits contiennentles quatre exemplaires de chaque catégorie et cela par les enfantsdes deux groupes. Alors que pour les artefacts le plus souvent,les items sont regroupés deux par deux selon leur fonctionna-lité ou leur lien spatio-temporel. Ces résultats sont conformes àceux obtenus par Grief et al. [30] qui montrent que dès quatreans, les artefacts sont appréhendés en termes de caractéris-tiques fonctionnelles et le vivant en termes de caractéristiquesbiologiques. Ces résultats montrent également l’influence dela tâche dans la construction de catégories. Lorsque la tâchen’est pas contraignante, les enfants sont capables de construirenon seulement la catégorie des animaux qui est plus facilementacquise, souvent par analogie avec les caractéristiques humains[31], mais aussi celle des végétaux qui est difficilement acquiseen raison de son statut particulier (les repères perceptifs pourl’attribution des mécanismes biologiques ne sont pas directe-ment accessibles, comme le mouvement, la respiration, etc.)[32].
Pendant la deuxième étape, un résultat étonnant est que bienque beaucoup moins d’enfants déficients arrivent à la réaliseren faisant trois tas (qui était le but de cette étape) cependant,ils sont aussi nombreux que les tout-venant à réaliser des tastaxonomiques et cela particulièrement pour les catégories desanimaux et des végétaux. Ce qui confirme que les catégoriestaxonomiques sont construites de la même facon chez les enfantsdéficients et les tout-venant. Quant au but de la troisième étape,qui était d’obtenir deux tas en opposant le vivant (animaux, végé-taux) au non-vivant (artefacts) il n’a été atteint par aucun enfantde nos deux populations. Nous constatons que les enfants tout-venant et déficients appariés par âge mental ont des difficultésà regrouper les animaux et les végétaux en une seule catégoriecelle du vivant [33,34]. Ils se centrent sur les aspects de surfaceet ne font pas les abstractions nécessaires pour la construction deces catégories. Bien évidemment nous devons souligner le rôlede notre consigne, qui est générale et peut expliquer en partiecette difficulté [11].
Concernant les justifications données par les enfants pourexpliquer les « tas taxonomiques » réalisés, durant la « premièreétape », nous remarquons que les catégories ontologiques des« animaux » et des « végétaux » sont justifiées de la même faconet ce par nos deux populations. Pour la plupart, les tas sontjustifiés par leur nom d’appartenance « ce sont des animaux »,« ce sont des plantes » ou par des arguments du type biologique« la mouche et l’oiseau volent tous les deux », « la marguerite etle fraisier poussent tous les deux ». Ce résultat montre que lesenfants déficients comme les enfants tout-venant peuvent justi-fier de facon taxonomique les tas taxonomiques construits. Cerésultat va à l’encontre de résultats précédents qui montrent queles enfants déficients construisent des catégories en mémoirede la même facon que les tout-venant mais ce qui diffère c’estl’utilisation de ces catégories [21]. Nos résultats peuvent être,en partie, expliqués par l’expérience personnelle des enfants. Eneffet, les enfants déficients intellectuels que nous avons interro-gés font beaucoup d’activités de jardinage et par conséquence,ils peuvent avoir des notions plus importantes concernant lacatégorie des végétaux. Quant aux justifications des tas taxo-nomiques de la catégorie des artefacts, les enfants déficients lesjustifient davantage par des relations spatio-temporelles que lesitems entretiennent entre eux « La table et la tasse vont dansla cuisine » et moins par leur nom d’appartenance, tandis quec’est l’inverse pour les enfants tout-venant. Ce résultat rejointles résultats de travaux précédents qui montrent que la catégo-rie des artefacts est apprise à partir du rôle des objets et leurutilisation dans des contextes bien spécifiques [9,10].
Les tas taxonomiques réalisés pendant la deuxième étape sontbeaucoup moins nombreux que pendant la première et cela pourles deux groupes. Pour expliquer ces tas, les justifications don-nées par les deux groupes d’enfants sont souvent différentes decelles données pendant la première étape. Pour les animaux etles végétaux, les justifications ne sont plus majoritairement denature taxonomique, mais aussi spatio-temporelle, fonctionnelleet autre. Pour les artefacts, le peu de tas réalisés sont justifiéspar leur nom d’appartenance ou autre.
Pour justifier les tas thématiques, lors de l’étape 1, les enfantstout-venant privilégient des réponses du type spatio-temporel
Author's personal copy
O. Megalakaki et al. / Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence 58 (2010) 317–326 325
« la table et le pot de fleur vont dans le salon » et biologique « lafille mange les fraises » tandis que les enfants déficients donnentdes réponses interactionnelles « le chat grimpe sur l’arbre ». Lesréponses de nature fonctionnelle « la fille fait du vélo » et autresont données par un nombre équivalent des deux populations.Ces résultats rejoignent des résultats précédents qui montrentque les justifications des regroupements thématiques dépendentdes expériences et des préférences des enfants [4]. Le fait quele pourcentage des justifications autres pour les tas thématiques(qui englobe des réponses du type « je ne sais pas », « parceque ») double de l’étape 1 à l’étape 2, peut nous laisser penserque certains tas thématiques ont pu être faits au hasard lors del’étape 2 par les enfants tout-venant qui ont réalisé cette étape.
Nos résultats sont en faveur de la thèse pluraliste du dévelop-pement cognitif [3,4] qui montre la coexistence des catégoriestaxonomiques et thématiques et s’opposent donc au point de vueclassique de Nelson [2]. Les enfants, particulièrement pendant letri spontané, sont capables de construire des classifications taxo-nomiques et thématiques en nombre équivalent, et de les justifierde facon cohérente. Ce résultat est d’autant plus intéressant queces deux types de catégories sont construits non seulement pourclasser les animaux et les artefacts mais aussi les végétaux, cequi généralement apparaît plus tard puisque cette classificationest considérée comme plus difficile.
10. Conclusion
Le présent travail montre que les catégories taxonomiqueset thématiques coexistent et sont organisées de la même faconchez les enfants déficients intellectuels et les enfants tout-venantappariés par âge mental et leur évocation dépend de l’expériencedu sujet et de la complexité de la tâche. De la même facon,l’utilisation de ces catégories, mise en évidence à travers lesjustifications des tas réalisés par les enfants, est similaire cheznos deux populations pour les animaux et les végétaux et diffé-rente pour les artefacts. De plus, lorsque la tâche devient pluscomplexe (étape 2 et 3) et demande un changement de stratégie,les enfants déficients intellectuels légers ont des performancesinférieures à celles des enfants tout-venant. Les difficultés obser-vées chez les enfants déficients se situent au niveau de laflexibilité cognitive et l’utilisation de stratégies efficaces afinde changer d’objectif pour la réalisation de la tâche. Ce sontdonc ces capacités nécessaires au bon ajustement du compor-tement du sujet en fonction des conditions de la tâche qui fontdéfaut au sujet déficient.
Conflit d’intérêt
Aucun.
Références
[1] Bideaud J, Houdé O. Le développement des catégorisations : « Capture »logique ou « capture » écologique des propriétés des objets ? Annee Psychol1989;89:87–123.
[2] Nelson K. Making sense: The acquisition of shared meaning. New York:Academie Press; 1985.
[3] Lautrey J. La catégorisation après Piaget. In: Meljac C, Voyazopoulos etR, Hatwell Y, editors. Piaget après Piaget. Évolution des modèles, richessedes pratiques. Paris: La pensée sauvage; 1998. p. 89–102.
[4] Blaye A, Bernard-Peyron V, et Bonthoux F. Au-delà des conduites de caté-gorisation : le développement des représentations catégorielles entre cinqet neuf ans. Arch Psychol 2000;68:59–82.
[5] Bauer PJ, Mandler JM. Taxonomies and triades: Conceptual organizationin one-to two-year-old. Cogn Psychol 1989;21:156–84.
[6] Smiley SS, Brown AL. Conceptual preference for thematic or taxonomicrelations: A nonmonotonic trend from preschool to old age. J Exp ChildPsychol 1979;28:437–58.
[7] Markman EM, Cox B, Machida S. The standard object-sorting task as amesure of conceptual organization. Dev Psychol 1981;17(1):115–7.
[8] Lecacheur M, Desprels-Fraysse A, Blaye A. Sensibilité de l’enfantà l’induction de tris logiques ou schématiques. Enfance 1999;2:157–70.
[9] Kalénine S, Garnier C, Bouisson, K, et Bonthoux F. Le développementde la catégorisation : l’impact différencié de deux types d’apprentissageen fonction des catégories d’objets, naturels ou fabriqués. Psychologie etÉducation, 2007-1, 33–45.
[10] Scheuner N, Bonthoux F. La construction des catégories surordonnéeschez l’enfant : utilisation différentielle des indices perceptifs et contextuelsselon le domaine du vivant et du non-vivant. Bull Psychol 2004;57(1):105–9.
[11] Waxman SR, Namy LL. Challenging the notion of a thematic preferencein young children. Dev Psychol 1997;33(3):555–67.
[12] Winters JJ, Semchuk MT. Retrieval from long-term store as a function ofmental age and intelligence. Am J Ment Defic 1986;90:440–8.
[13] Glidden LM, Bilsky LH, Mar HH, Judd TP, Warner DA. Semantic proces-sing can facilitate free recall in mildly retarded adolescents. J Exp ChildPsychol 1983;36:510–32.
[14] McFerland CE, Sandy JT. Automatic and conscious processing in retardedand non retarded adolescents. J Exp Child Psychol 1982;33:20–38.
[15] Sperber RD, Ragain RD, McCauley C. Reassessment of category know-ledge in retarded individuals. Am J Ment Defic 1976;81(3):227–34.
[16] Ellis NR, Woodley-Zanthos P, Dulaney CL. Memory for spatial locationin children, adults, and mentally retarded persons. Am J Ment Retard1989;93:521–7.
[17] Hayes BK, Conway RN. Concept acquisitions in children with mildintellectual disability: Factors affecting the abstraction of prototypicalinformation. J Intellect Dev Disabil 2000;25(3):217–34.
[18] Vinter A, Detable C. Implicit learning in children and adults with mentalretardation. Am J Ment Retard 2003;108:94–107.
[19] Vicari S, Bellucci S, Carlesimo GA. Implicit and explicit memory: A func-tional dissociation in persons with Down’s syndrome. Neuropsychologia2000;38:240–51.
[20] Gavornikova-Baligand Z, Deleau M. La catégorisation chez les adultesdéficients intellectuels : déficit de structuration ou de mobilisation ? RevFrancophone Deficience Intellectuelle 2004;15(1):5–21.
[21] Gavornikova-Baligand Z. Catégories implicites, catégories explicites etdéficience intellectuelle. Enfance 2005;57(3):253–60.
[22] Gelman SA, Gottfried GM. Children’s causal explanations for animate andinanimate motion. Child Dev 1996;67:1970–87.
[23] Gelman SA, Opfer JE. Development of the animate-inanimate distinc-tion. In: Goswami U, editor. Blackwell Handbook of Childhood CognitiveDevelopment. Oxford, UK: Blackwell; 2002. p. 151–66.
[24] Poulin-Dubois D, Tilden J. Le développement de la distinction animé– inanimé : effet de l’appartenance. Psychol Fr 2000;45(2):141–6.
[25] Rakison D, Poulin-Dubois D. Developmental Origin of the Animate-Inanimate Distinction. Psychol Bull 2001;127(2):209–28.
[26] Gelman R, Spelke ES. The development of thoughts about animate andinanimate objets: Implications for research on social cognition. In: FlavellJH, Ross L, editors. Social cognition. New York: Academic Press; 1981.p. 43–66.
[27] Dempster FN, Brainerd CJ. Interference and inhibition in cognition. SanDiege: Academic Press; 1995.
[28] Houdé O. Rationalité, développement et inhibition. Un nouveau cadred’analyse. Paris: PUF; 1995.
Author's personal copy
326 O. Megalakaki et al. / Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence 58 (2010) 317–326
[29] Zelazo PD, Müller U. Executive function in typical and atypical develop-ment. In: Goswami U, editor. Blackwell Handbook of Childhood CognitiveDevelopment. Oxford: Blackwell Publishing; 2002. p. 445–69.
[30] Grief ML, Kemler Nelson DG, Keil FC, Gutierrez F. What do children wantto know about animals and artefacts? Psychol Sci 2006;17(6):455–9.
[31] Poulin-Dubois D, Frenkiel-Fishman S, Nayer S. Infants’ inductive genera-lization of bodily, motion, and sensory properties to animals and people. JCogn Dev 2006;7(4):431–53.
[32] Inagaki K, Hatano G. Young children’s recognition of commonalities bet-ween animals and plants. Child Dev 1996;67:2823–40.
[33] Inagaki K, Hatano G. Young children’s spontaneous personification asanalogy. Child Dev 1987;58:1013–20.
[34] Meunier B, Cordier F. La catégorie des plantes. Étude développementalede son organisation. Enfance 2004;2:163–85.
Pour en savoir plus
Wechsler, D. WISC III. Manuel de l’échelle d’intelligence de Wechsler pourenfants, 3e édition. Paris, E.C.P.A, 1996.
BOEHM (A) Test des concepts de base – révisé – Manuel d’application,Paris, E.C.P.A., 1989.
BD2I : http://webu2.upmf-grenoble.fr/Banque images/.Site images la petite souris : http://lps13.free.fr/.