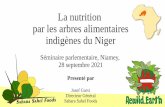Incoronata (Italie) : la production céramique entre indigènes et Grecs aux VIIIe et VIIe siècles...
-
Upload
univ-rennes2 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Incoronata (Italie) : la production céramique entre indigènes et Grecs aux VIIIe et VIIe siècles...
1
PROGRAMME DES RENCONTRES DOCTORALES ARCHEOLOGIQUES
DE L’ECOLE EUROPEENNE DE PROTOHISTOIRE DE BIBRACTE
Centre archéologique européen du Mont Beuvray
Les 28, 29 et 30 avril 2015
Comité scientifique :
Anne-Marie ADAM (Professeur émérite, Université de Strasbourg),
Philippe BARRAL (Professeur, Université de Franche-Comté)
Gérard BATAILLE (Ingénieur de recherche, INRAP)
Tomasz BOCHNAK (MCF, Université de Rzeszow)
Manuel FERNANDEZ-GÖTZ (Chargé d’enseignements, Université d’Edimbourg)
Stephan FICHTL (Professeur, Université de Strasbourg)
Vincent GUICHARD (Directeur général, Bibracte)
Jean-Paul GUILLAUMET (Directeur de recherche émérite, CNRS)
Martin SCHÖNFELDER (Chargé d’enseignements, Université de Mayence)
Stéphane VERGER (Directeur d’études, ENS)
Stefan WIRTH (Professeur, Université de Bourgogne)
Comité d’organisation :
Anna CANNOT (Doctorante, Université de Bourgogne, Eberhardt-Karls-Universität Tübingen)
Thibault LE COZANET (Doctorant, Université de Bourgogne)
Julie REMY (Doctorante, Université de Tours)
Josef WILCZEK (Doctorant, Université de Bourgogne, Masaryk University of Brno)
2
MARDI 28 AVRIL
10h - 12h Accueil des participants
12h Déjeuner
13h30 -14h Introduction aux rencontres / Introduction
- Anne-Marie ADAM, présidente du Conseil scientifique de Bibracte
- Vincent GUICHARD, directeur général de Bibracte
- Anna CANNOT / Thibault LE COZANET / Julie REMY / Josef WILCZEK
SESSION 1 :
URBANISME ET URBANISATION / URBANISM AND URBANIZATION
Président de séance : Stephan FICHTL
14h - 14h25 Meritxell MONROS : L’espace public et son occupation au Second âge du Fer (Ve s. -
Ier s. av. J.-C.) dans l’Est de la péninsule ibérique.
14h25 - 14h50 Lindsey BÜSTER : Inhabiting Broxmouth : Biographical and materiality approaches
to the study of Iron Age roundhouses in South East Scotland.
14h50 - 15h15 Thomas HUTIN : Perception et structuration de l’espace communautaire dans le
monde celtique.
15h15 - 15h40 Jonathan HORN : An approach to re-examining hillfort chronology.
15h40 - 16h05 Clara FILET : Dynamiques d’urbanisation et réseaux sociaux dans le monde celtique
transalpin du IVe au Ier siècle av. J.-C.
16h05 - 16h15 Discussion
16h15 - 16h45 Pause / Présentation des posters
SESSION 2 :
NORMES ET STANDARDS / NORMS AND STANDARDS
Président de séance : Philippe BARRAL
16h45 - 17h10 Rémy WASSONG : Architecture celtique et approche métrologique : si les Celtes
nous étaient « comptés ».
17h10 - 17h35 Andrea FOCHESATO : L’économie de la construction en bois à Bibracte. De la
gestion de la ressource forestière à la standardisation de l’architecture.
17h35 - 18h Pierre-Emmanuel PARIS : « Weight Method » : Nouvelle approche méthodologique
de l’estimation des poids de viande appliquée aux populations laténiennes.
18h - 18h25 Patrick MAGUER : L’apport de l’étude des trous de poteau à la compréhension et à
l’identification des édifices sur poteaux plantés de l’âge du Fer.
18h25 - 18h35 Discussion
18h35 - 18h55 Présentation des posters
19h Pot d’accueil et buffet dînatoire
3
MERCREDI 29 AVRIL
SESSION 3 :
ASPECTS D’ARCHÉOLOGIE FUNÉRAIRE / ASPECTS OF FUNERARY ARCHAEOLOGY
Président de séance : Stefan WIRTH
9h - 9h25 Chloé BELARD : Nouvelles approches et perspectives méthodologiques pour
l’archéologie funéraire du genre.
9h25 - 9h50 David BRÖNNIMANN et Hannele RISSANEN : Life and death at La Tène site
Basel-Gasfabrik (CH) - Interdisciplinarity investigations of selected settlement
features and two cemeteries provide insights into the Late Iron Age world.
9h50 - 10h15 Emilie VANNIER : Pratiques funéraires au Second âge du Fer dans la zone médio-
atlantique.
10h15 - 10h40 Christoph BAUR : Zur Sozialstruktur früheisenzeitlicher Bestattungen in Mittelitalien.
10h40 - 10h55 Discussion
10h55 - 11h25 Pause / Présentation des posters
SESSION 4 :
PRODUCTIONS METALLIQUES / METAL PRODUCTIONS
Président de séance : Martin SCHÖNFELDER
11h25 - 11h50 Scott STETKIEWITCZ : Exploring Iron Smelting « Systems » in Iron Age Europe.
11h50 - 12h15 Katalin NOVINSKI-GROMA : New fibula-types from the Northeast-Transdanubian
Hallstatt-group.
12h15 - 12h40 Rita SOLAZZO : Les ceintures de l’âge du Fer dans le Nord de l’Italie : la
technologie, la décoration et les centres de production possibles.
12h40 - 12h55 Discussion
13h - 14h30 Pause déjeuner
SESSION 5 :
CONTACTS, RELATIONS ET ECHANGES / CONTACTS, RELATIONS AND EXCHANGES
Présidents de séance : Tomasz BOCHNAK et Anne-Marie ADAM
14h30 - 14h55 Przemysław HARASIM : The La Tène Culture influences in Pomerania on the
background of the south-west and west parts of the Baltic Sea Region.
14h55 - 15h20 Steeve GENTNER et Katrin LUDWIG : Entre Sud et Nord du Rhin supérieur :
Production et consommation de céramiques de l’Alsace au Nordbaden au Ve - IVe s.
av. J.-C.
15h20 - 15h45 Asja TONC : Between the sea and the Alps : traces of mobility and trade of the Late
Iron Age societies in the northern Adriatic.
15h45 - 16h15 Pause / Présentations posters
4
16h15 - 16h40 Cécile MOULIN : Contacts et échanges entre Grecs et Gaulois en moyenne vallée du
Rhône au VIe - Ve s. av. J.-C. : Les apports de l’étude de la céramique peinte à pâte
claire.
16h40 - 17h05 Franziska FAUPEL : Reconstructing of Early Iron Age pathway models in Southwest
Germany and the Alsace.
17h05 - 17h30 Clément BELLAMY et Mathilde VILLETTE : Incoronata (Italie) : la production
céramique entre indigènes et Grecs au VIIIe - VIIe s. av. J.-C.
17h30 - 17h45 Discussion
18h - 19h30 Visite du musée de Bibracte
20h Buffet dînatoire et soirée festive
JEUDI 30 AVRIL
SESSION 6 :
MOBILIERS : APPORTS ET INTERPRETATIONS / THE ARCHEOLOGICAL MATERIAL :
CONTRIBUTIONS AND INTERPRETATIONS
Président de séance : Gérard BATAILLE
8h50 - 9h15 Guillaume REICH : Traces d’utilisation et mutilations sur les armes laténiennes :
l’exemple des armes du site de La Tène conservées au Laténium.
9h15 - 9h40 Gadea CABANILLAS DE LA TORRE : L’esthétique au quotidien dans l’âge du Fer
européen : pour une nouvelle approche de l’art laténien.
9h40 - 10h05 Imke WESTHAUSEN : One ring to bind them all ? New approaches on the meaning
of torques in the Late Hallstatt and Early La Tène Period.
10h05 - 10h30 Roxana MORTEANU : Bird-ships, hot springs, metal vessel and Apollo - same
symbol, different meaning ?
10h30 - 10h45 Discussion
10h45 - 11h15 Pause / Présentation posters
SESSION 7 :
TRANSITIONS ET PROBLEMATIQUES TRANSITOIRES / TRANSITIONS AND TRANSITIONAL ISSUES
Président de séance : Jean-Paul GUILLAUMET
11h15 - 11h40 Zoran ČUČKOVIC : Topophilia and the emergence of late prehistoric sanctuaries.
11h40 - 12h05 Clémentine BARBAU : Romanisation de la vie quotidienne : apport de l’étude de
l’instrumentum de type italique.
12h05 - 12h30 Quentin SUEUR : Vaisselle métallique en Gaule Belgique à la veille de la Conquête :
répartition spatiale et perspectives de recherche.
12h30 - 13h Conclusion des rencontres
13h Pause déjeuner
Après-midi Visite du site de Bibracte (optionnel)
5
POSTERS
MARDI 28 AVRIL
SESSION 1 :
URBANISME ET URBANISATION / URBANISM AND URBANIZATION
1. Isabel AUER : The Celtic square enclosure of Nordheim-Bruchhöhe, Baden-Württemberg,
Germany. Its developpement and structure – its function and status.
2. Célia BASSET : Apport des données récentes pour la compréhension des oppida de la basse vallée
de la Seine et de leur insertion locale et régionale.
3. Anna-Sophie BUCHHORN : The Treverian oppidum of Kastel-Staadt. Recent results and
perspectives.
4. Thimo Jacob BRESTEL : The creation of multifunctional boundaries in the Oppidum of
Manching.
5. Cyprien FORGET : L’occupation de la Loire moyenne à l’âge du Fer. Nouvelle approche des
relations entre réseau hydrographique et implantation anthropique.
6. Janja MAVROVIĆ MOKOS : Archaeological and geophysical exploration of the Kaptol - Gradci
Hillfort.
SESSION 2 :
NORMES ET STANDARDS / NORMS AND STANDARDS
7. Colin DUVAL et Pauline NUVIALA : Les changements morphologiques du bœuf en Gaule entre
le IVe s. av. et le Ve s. ap. J.-C. : les tenants d’une évolution technique et culturelle.
8. Marie PHILIPPE : La technique de production céramique comme marqueur d’échange : l’exemple
des poteries rhénanes à la veille du premier âge du Fer (Xe- IXe s. av. J.-C.).
MERCREDI 29 AVRIL
SESSION 3 :
ASPECTS D’ARCHÉOLOGIE FUNÉRAIRE / ASPECTS OF FUNERARY ARCHAEOLOGY
9. Petra KMEŤOVÁ : Early Iron Age burials from Chotin, SW Slovakia.
10. Doris LETTMAN : Second-hand traces of wear and organic substances on objects from the La
Tène B cemetery of Werneck-Zeuzleben.
11. Florine SARRY : Etude anthropologique de la sépulture multiple laténienne de Gondole (Les
Liots - Le Cendre, 63).
12. Caroline TREMEAUD : Le genre : une nouvelle variable pour l’étude des corpus funéraires.
SESSION 4 :
PRODUCTIONS METALLIQUES / METAL PRODUCTIONS
13. Émilie CAILLAUD : La métallurgie du fer en Aquitaine gauloise et romaine. Comprendre la
fabrication et la commercialisation du fer à travers les déchets de production : une étude
pluridisciplinaire. Approche méthodologique et premiers résultats.
SESSION 5 :
CONTACTS, RELATIONS ET ECHANGES / CONTACTS, RELATIONS AND EXCHANGES
14. Clémence BREUIL : Approche diachronique des « pierres à cerfs » de Tsatiin Ereg (Arkhangaï,
Mongolie) et de la diffusion de ce style artistique au travers des peuples scythes.
15. Marine LECHENAULT : L’île d’Elbe et la Corse à l’âge du Fer : comprendre la connexion
transtyrrhénienne.
6
JEUDI 30 AVRIL
SESSION 6 :
MOBILIERS : APPORTS ET INTERPRETATIONS / THE ARCHEOLOGICAL MATERIAL :
CONTRIBUTIONS AND INTERPRETATIONS
16. Aurélia FEUGNET : Le choix, très sélectif, des importations grecques et romaines dans le monde
celtique, entre 250 et 25 av. J.-C.
17. Jonathan HORN: Tankards of the British Late Iron Age.
18. Wolfram NEY : Découverte d’une sculpture en pierre de l’âge du Fer à Arzheim (Lkr. Landau in
der Pfalz, Rhénanie-Palatinat) - La chronologie et chorologie de la sculpture anthropomorphe en
pierre en Europe centrale.
19. Pierre-Antoine LAMY : Nouvelles données sur la statuaire protohistorique anthropomorphe en
Bourgogne.
SESSION 7 :
TRANSITIONS ET PROBLEMATIQUES TRANSITOIRES / TRANSITIONS AND TRANSITIONAL ISSUES
20. Nicolas DELFERRIERE : Caeruleum et Cinnabaris : décors pré-romains et romains précoces sur
le territoire des Éduens, des Lingons et des Sénons.
21. Simon TRIXL : The Celtic-Roman transition in the Rhaetian Alps and the alpine foreland - A
zooarcheological perspective.
8
SESSION 1 :
URBANISME ET URBANISATION / URBANISM AND URBANIZATION
L’espace public et son occupation au Second âge du Fer (Ve s. - Ier s. av. J.-C.) dans l’Est
de la péninsule ibérique.
Meritxell MONROS : Institut Català d’Arqueologia Clàssica/ 4 rue du Botrel, 35690 Acigne, Spain/
L’étude de l’espace public dans les oppida ibériques, c'est-à-dire au second âge du Fer (Ve s.
av. J.-C. – Ier s. av. J.-C.), montre les rues et les places en tant qu’espaces polyvalents, où toutes sortes
d’activités sont possibles. Mais ces espaces publics sont également des espaces de représentation ainsi
que le reflet d’une société très hiérarchisée, avec une organisation sociale complexe.
Cet étude nous a permis de documenter différentes sources d’activité, comme les activités
domestiques, les activités rituelles où les activités économiques, mais aussi d’étudier la gestion des
espaces (la gestion des déchets, de l’eau, etc.), dans lesquelles nous avons identifié une action
caractéristique. Après une analyse de différents sites, nous avons détecté une occupation de l’espace
publique, de manière quasi systématique, entre le IVe et le IIIe
s. av. J.-C. Dans la plupart des cas, cette
occupation est une réponse directe à l’ampliation des maisons, mais il s’agit dans leur majorité de
résidences aristocratiques. De la même manière, il existe aussi une occupation due à l’ampliation des
espaces domestiques ou pour des espaces collectifs, comme des magasins, entre autres.
Nous pouvons voir dans ces exemples la réponse à une nécessité humaine (agrandissement de
la famille notamment) mais aussi l’inégalité sociale (il y a plus d’ampliations des résidences
aristocratiques que des espaces domestiques). D’autre part, l’occupation de l’espace public est le reflet
d’une gestion de l’espace et de la vie urbaine dans les oppida ibériques de la part de quelqu’un, un
reflet donc de sa complexité sociale dans ses derniers siècles d’existence.
Inhabiting Broxmouth : Biographical and materiality approaches to the study of Iron
Age roundhouses in South East Scotland.
Lindsey BÜSTER : University of Bradford/ Room 2.02, Phoenix SW, Richmond Road, Bradford,
West Yorkshire, BD7 1DP, United Kingdom/ [email protected]
Broxmouth hillfort in East Lothian, Scotland was excavated in 1977-78 and has recently been
published in full as the result of a five year campaign of reanalysis at the University of Bradford. My
own doctoral research focused on the roundhouses at the site, which represented the latest known
phase of Iron Age occupation and as such, were protected from the (later prehistoric) truncation which
affected earlier phases of activity.
The roundhouses comprise timber, stone and composite timber/stone construction, as well as
demonstrating a variety of construction techniques (ring-grooves, double ring-grooves, stone footings
etc). As such, traditional interpretations had assumed a chronological succession from timber to stone
architecture at the site, with the stone structures not appearing until after the Roman conquest of the
region around AD79. AMS dating of the structures during reanalysis has however found them to be
broadly contemporary and spanning the conquest period.
Several of the better preserved roundhouses (particularly those of stone construction)
demonstrated periodic modification of the structural fabric on a single house-stance (the earliest of
which were shown to be pre-conquest in date). The variety of contemporary constructional techniques
9
and materials, together with the repeated modification of structures on single house-stances led me
towards biographical and materiality approaches (which also drew heavily on ethnographic evidence)
in the reanalysis of these structures. What were the driving forces behind the choice of materials and
construction technique, and the periodic (and often structurally unnecessary) modification of
structures, often in ways that constrained their use for later inhabitants?
Bayesian modelled AMS dates suggest that at least some of the roundhouses were remodelled
on a roughly generational basis. Furthermore, structured (and apparently curated) deposits within
walls, pits and postholes, and the replacement of certain internal features in similar places within
successive roundhouse interiors, suggest attempts to retain both physical and metaphorical links with
previous buildings and their inhabitants. As such, the physical structure of the roundhouses themselves
appear to have been used as mnemonic devices in the retention and renegotiation of household
identities (whatever form those households may have taken).
This paper will outline some of the unusually detailed evidence which can be gleaned from the
Broxmouth roundhouses, and suggest ways in which biographical and materiality approaches, together
with Bayesian modelling and ethnographic evidence, in the study of later prehistoric structures might
be used to tease out more nuanced understandings of the households which inhabited them.
Perception et structuration de l’espace communautaire dans le monde celtique.
Thomas HUTIN : Université de Strasbourg. UMR 7044 ARCHIMEDE, Archéologie et Histoire
ancienne : Méditerranée – Europe, MISHA/ Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme -
Alsace, 5 allée du Général Rouvillois CS 50008, 67083 Strasbourg, France/
Pendant longtemps les réflexions sur les aménagements collectifs et communautaires
n'occupaient qu'un champ transversal des recherches archéologiques sur l'âge du Fer. Toutefois, grâce
au développement progressif des fouilles extensives et l'apport de nouvelles données, notre perception
des agglomérations gauloises s'est très rapidement complexifiée.
Les récentes découvertes ont permis de proposer l'existence de lieux de réunion, attestés dès le
IIIème s. av. J.-C., assez vastes pour rassembler un nombre relativement important d'individus.
Cette nouveauté est en partie à mettre au crédit des fouilles réalisées sur certains grands
oppida de La Tène finale. À Corent, les fouilles ont révélé l'existence d'une vaste esplanade associée à
d'autres infrastructures formant un immense complexe monumental à caractère public. Au Titelberg,
un espace public, isolé du reste de l’habitat, est matérialisé au sol par un enclos fossoyé d’une dizaine
d’hectares. Ces places, destinées aux manifestations publiques, sembleraient donc s'organiser sous la
forme d'un espace vide bien délimité et aux fonctions complexes. Dans une majeure partie des cas,
toutes sont situées de manière à offrir une certaine accessibilité et visibilité aux individus qui
l’utilisent. Souvent implantées au début de la première période d’occupation laténienne, ou du site lui-
même, leurs formes, leurs superficies ainsi que leurs occupations internes semblent peu évoluer.
Tous ces éléments plaident bien évidemment pour l’existence d’une instance permettant de
préserver la pérennité de ces lieux. À l'image des centres civiques des chefs-lieux romains, ces points
de convergences de la population urbaine ont tout aussi bien pu accueillir des manifestations
religieuses, politiques, économiques et sociales.
Par le biais de cette communication, nous chercherons à mettre en évidence l'apport des
recherches récentes à la réflexion sur les espaces publics d'Europe celtique. Si une telle réflexion
pouvait difficilement aboutir il y a quelques années, l'état actuel de la documentation archéologique le
permet désormais.
10
An approach to re-examining hillfort chronology.
Jonathan HORN : Edinburgh University/ 3f2, 4 Brougham Place, EH3 9HW Edinburgh, United
Kingdom/ [email protected]
Hillforts are the dominant field monument of later prehistoric Britain with well over 4000
known sites, yet despite their relative abundance and over a century of recorded investigation, we still
lack a detailed understanding of their chronological development. Therefore it is timely and necessary
to re-examine their dating evidence, allowing the formation of new chronological models for this site
type. This paper will outline a methodology for assessing and correlating the dating information from
around 500 hillforts from Britain and Ireland which have dating evidence. Given the significant
variability in the quality and quantity of dating evidence available for each site it is necessary to grade
this evidence. This paper presents a grading scheme for the assessment of 14C date quality as well as
for assessing the strength of any given dated site as a whole.
Dynamiques d’urbanisation et réseaux sociaux dans le monde celtique transalpin du IVe
au Ier siècle av. J.-C.
Clara FILET : 1-Paris 1 Panthéon-Sorbonne, AOROC, UMR 8546 – Celtes et Étrusques/ Centre
Michelet, 3 rue Michelet, 75006 Paris, France/ [email protected]
La communication proposée a pour ambition de présenter un travail de doctorat entamé en
2013 sous la codirection de Patrice Brun (Université Paris 1, France) et Vladimír Salač (Université
Charles de Prague, République Tchèque), et le tutorat du SAMM, laboratoire de mathématiques
appliquées de Paris 1.
Ce travail s’appuie sur une approche originale des processus d’urbanisation des quatre derniers
siècles av. J.-C. en Europe celtique. Longtemps perçus comme un phénomène linéaire de
transformation du village en ville, de nouvelles perspectives permettent de considérer ces processus
non plus comme la simple mutation d’ « agglomérations artisanales » en « oppida », mais comme un
phénomène plus complexe de diversification progressive des sites d’habitats, issu d’une dynamique à
long terme de transformation du territoire.
La thèse étudie ces transformations à la lumière d’un nouvel élément : l’organisation et
l’évolution des réseaux de sites. On considère ainsi la ville comme l’articulation entre différents
réseaux correspondant à des contacts, à des interactions entre différents établissements, de l’échelle
locale à l’échelle interculturelle. L’objectif est de préciser l’organisation de ces réseaux de sites, c’est-
à-dire l’organisation des connexions entre les sites d’habitat à l’intérieur d’un territoire donné. L’étude
de ces interactions (renseignées notamment par la découverte de productions ou matériaux exogènes)
et de leur évolution permet de mieux comprendre comment les réseaux urbains se sont mis en place les
uns par rapport aux autres, ainsi que de percevoir l’importance de l’essor des agglomérations dans la
structuration du territoire et l’émergence de l’Etat. Il s’agit ainsi d’apporter de nouveaux éléments à la
compréhension des processus d’urbanisation.
De fait, ce travail s’appuie sur deux types d’outils issus des études de réseaux :
- les modèles d’interactions spatiales, permettant d’estimer l’attractivité d’un nœud en
fonction de son emplacement dans le réseau
- des outils issus de la Network Analysis, outil de représentation et d’analyse permettant de
mesurer un certain nombre des propriétés à l’intérieur d’un réseau
D’abord utilisés par les physiciens et géographes pour les premiers, dérivés de la théorie
mathématique des Graphes et largement utilisée par les historiens et sociologues pour les seconds, leur
11
application plus récente aux contextes archéologiques offre des perspectives novatrices sur l’étude des
processus complexes mettant en jeu des acteurs connectés.
L’objectif de la communication est ainsi de présenter le projet et les premières avancées d’un
travail binational (France-République Tchèque) et interdisciplinaire sur la compréhension d’un
phénomène clé de l’histoire Européenne : l’émergence de la ville.
POSTERS
The Celtic square enclosure of Nordheim-Bruchhöhe, Baden-Württemberg, Germany.
Its developpement and structure – its function and status.
Isabel AUER : Institut für Prähistorische Archäologie, Freie Universität Berlin, Altensteinstr/ 15,
14195 Berlin, Germany/ [email protected]
My dissertation project „Die spätkeltische Viereckschanze von Nordheim, Bruchhöhe, Lkr.
Heilbronn – Studien zur Baugeschichte, Architektur und Funktion“ is a contribution to the research of
the Celtic square enclosures as well as the Late Latène Settlement Systems and population structure in
the area of south-western Germany at the end of the Iron Age.
The basis of my research project is the post-excavation analysis of the finds, features as well
as the results received from dendrochronology and radiocarbon dating of the almost completely
excavated square enclosure of Nordheim, Bruchhöhe in Southwest Germany.
The intention is to clarify chronological questions, to reconstruct the spatial arrangement of
the features and their functions as well as to draw conclusions about the function of the whole
enclosure, its economic factors and its status. For all these aspects, it is also important to analyse the
location of the site in relation to other contemporaneous settlement places and to the natural landscape,
for example, through the regional and supraregional comparison of Late Iron Age sites and the use of
geographic information systems.
Apport des données récentes pour la compréhension des oppida de la basse vallée de la
Seine et de leur insertion locale et régionale.
Célia BASSET : Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, UMR 8215-Trajectoires/ 21 Allée de
l'Université, 92000 Nanterre, France/ [email protected]
La basse vallée de la Seine est, à la fin de l’âge du Fer, une aire d’interfaces économique et
politique où se modèlent des territoires en constantes interactions. Grâce aux nombreuses interventions
archéologiques concernant tous les contextes topographiques, le corpus de sites laténiens offre à
présent un cadre pertinent pour étudier les modalités d’occupation de l’espace du second âge du Fer
jusqu’au début de la période romaine. À ces données, s’ajoute depuis 2011 des levées LIDAR sur les
rebords de plateau actuellement en contexte forestier et longeant le cours du fleuve. Le plan de
nombreux sites fortifiés (dont des oppida) a ainsi pu être précisé illustrant la variabilité, la complexité
et la densité de ce type d’habitat. La question de leur fonction et de leur insertion locale, régionale et
de leur rayonnement à longue distance se doit d’être discutée. À la lumière des fouilles récentes sur
l’oppidum d’Orival, un focus sera mené sur la boucle du Vaudreuil, dernière grande confluence avant
l’estuaire.
12
The Treverian oppidum of Kastel-Staadt. Recent results and perspectives.
Anna-Sophie BUCHHORN : Ludwig-Maximilians Universität München, Institut für Vor- und
Frühgeschichtliche Archäologie und Provinzialrömische Archäologie, der Ludwig-Maximilians-
Universität/ Geschwister-Scholl-Platz 1, 80539 München, Germany/ [email protected]
My poster deals with recent results on the Celtic Oppidum of Kastel-Staadt. I focus on the
excavation of the property “König-Johann-Straße 55”, which has been the topic of my master´s thesis.
Afterwards, I´ll give an overview of the most important questions of my recently started doctoral
thesis which deals with the same site.
Kastel-Staadt is known as a Treverian Oppidum for a long time. It’s located about 20 km
south of Trier on a spur 200 m above the river Saar. While the Titelberg, the Martberg near Pommern,
the Kasselt near Wallendorf and the “Hunnenring” near Otzenhausen are published extensively,
Kastel-Staadt is known only sparsely from literature. The aim of my master’s thesis was to get
information about the occupation period and settlement development in the researched area.
The results are based on the analysis of the archaeological features and largely ceramic
findings.
One main conclusion is that the analyzed area has been settled at least since the late or even
the middle La Tène period. The transition to the Roman period took place seamlessly. During the
middle Augustian times, the number of Roman inspired vessel forms increased. A focus of settlement
seems to be in the 1st century AD. The area has been in use until the late antiquity, though the number
of finds decreases from the 2nd century on.
One aim of my doctoral thesis is the analysis of some more selected excavated areas as e.g.
that one in the region of the roman sanctuary. Important questions concern e.g. the continuity of cult
and the changing extent of the settlement from Celtic to Roman times. In addition, more theoretical
issues as the definition of the term “Oppidum” will have to be investigated. Interesting would also be
the question in what manner the process of Romanization took place in Kastel-Staadt.
The creation of multifunctional boundaries in the Oppidum of Manching.
Thimo Jacob BRESTEL : Vorgeschichtliches Seminar der Philipps-Universität Marburg/ Beigenstraße
11, 35037 Marburg, Germany/ [email protected]
The La Tène period settlement of Manching in Bavaria was founded in the phase of LT B2 in
the 4th century BCE and evolved during LT C2/D1 into a major supra-regional settlement of urban
character.
Part of this transformation process was the modification of the social and natural environment
through the delineation of multifunctional boundaries.
Different excavations carried out between the years 1990 and 2009 on the southern periphery
of the settlement revealed several ditched structures. These can be reconstructed as parts of a circular
ditchsystem, which consisted of two parallel ditches constructed during the second century BCE. This
system not only outlined the settlement area and created a social space, but also had functioned as
drainage to influence the groundwater level. It marked the beginning of an on-going cultivation
process and an intense interference into the natural environment.
This transformation process continued and gained a new quality with the erection of the ring-
shaped rampart around 140/120 BCE and the redirection of the Oppidums natural watercourses.
Applying an interaction model, drawn from architectural psychology and landscape-based
archaeological approaches I want to show in my communication how the three kinds of boundaries
13
(ditch-system, rampart and watercourses) affected human life and formed the urban space of the
Oppidum of Manching.
L’occupation de la Loire moyenne à l’âge du Fer. Nouvelle approche des relations entre
réseau hydrographique et implantation anthropique.
Cyprien FORGET : Université François Rabelais (Tours) - EA 6298 CeThis/ 3 rue des Tanneurs,
37041 Tours cedex, France/ [email protected]
Le territoire de la Loire moyenne est une zone de contact entre plusieurs entités politiques
gauloises qui sont les Carnutes, les Bituriges, les Sénons, les Turons et les Eduens. La Loire constitue
dès cette période un axe de circulation privilégié entre les cités gauloises, mais permet aussi de relier
cette partie de la Gaule au monde méditerranéen, comme nous le précise le géographe Strabon
(Géographie, VI, 1, 14), ainsi qu’à la façade atlantique. De fait, avoir la mainmise sur cette partie de
son tracé constituait sans aucun doute un atout tant politique qu’économique.
L’étude de la répartition et de la hiérarchisation des sites d’habitat, non plus dans le cadre du
territoire politique d’une cité, mais par rapport à la présence de la Loire et de son bassin, permettra de
mieux comprendre les dynamiques territoriales ainsi que les mutations qui ont été observées tout au
long de l’âge du Fer, et plus particulièrement à La Tène finale, au sein d’une zone fortement
influencée par le cours d’un fleuve qui revêtait déjà un caractère majeur. Dans un tel contexte, il paraît
important de savoir qui exactement contrôlait le passage de cette partie de la Loire, sans oublier
l’incidence que cette dernière a pu tenir au niveau du maillage territorial des entités politiques
implantées dans cette région.
Archaeological and geophysical exploration of the Kaptol - Gradci Hillfort.
Janja MAVROVIĆ MOKOS : University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences,
Department of Archaeology/ II. Odv. S. Jelačić 4, trstenik, 10 299 Marija Gorica, Croatia/
Since 2011 archaeological and geophysical exploration were conducted at the hillfort Kaptol –
Gradci. One house dated to the Early Iron Age was partially excavated, and a few houses dated to
transition from Early to Late Iron Age were completely excavated. By the geophysical survey the
whole raster of houses and streets were defined on the southern part of the hillfort. Archaeological
material from the transition period from Early to Late Iron Age closely linked Kaptol with Donja
Dolina.
14
SESSION 2 :
NORMES ET STANDARDS / NORMS AND STANDARDS
Architecture celtique et approche métrologique : si les Celtes nous étaient « comptés ».
Rémy WASSONG : Université de Strasbourg, UMR 7044 – ArcHiMedE/ MISHA, 5 allée du Général
Rouvillois, 67083 Strasbourg, France/ [email protected]
La métrologie historique est une discipline particulièrement en vogue à la fin du XIXème
siècle. Elle s'est principalement attachée à la mise en évidence des unités de mesure de masse, de
volume, de distance et de superficie utilisées par les civilisations de l'Antiquité, en particulier en
Grèce, à Rome ou au Moyen-Orient. Après une période de stagnation de la recherche, cette discipline
revient peu à peu sur le devant de la scène à partir des années 1970. C'est à ce moment qu'elle
s'émancipe également de l'archéologie classique pour s'appliquer aux périodes pré- et protohistoriques.
Dans un premier temps, ce sont surtout les sites provençaux, favorisés par la présence de murs en
pierres, comme Lattara par exemple, qui bénéficient de ce type d'étude. Ce n'est qu'à partir du début
des années 1990, avec les travaux de Franz Schubert sur l'oppidum de Manching, que les approches
métrologiques vont être plus largement appliquées à l'archéologie celtique. C'est aussi à partir de ce
moment que la recherche d'une unité de mesure standardisée n'est plus le but ultime de la recherche.
On tente désormais de percevoir et d'interpréter les modules architecturaux, les connaissances
mathématiques et plus généralement les techniques pouvant participer à la planification et à la
construction d'un bâtiment, d'une ville voire d'un territoire dans sa totalité. On évoque fréquemment
les relations entre le monde celtique et le monde méditerranéen à travers le mobilier découvert dans
certains sites de rang élevé (céramiques, mobiliers métalliques) qu'il s'agisse de monuments funéraires
ou d'habitats. Certains d'entre eux présentent, en plus des vestiges mobiliers, des formes ou des
éléments architecturaux dont l'origine semble à première vue extra-locale. La réalité est pourtant bien
plus complexe et pose également la question de l'origine et de la transmission des connaissances
techniques et du savoir.
L’économie de la construction en bois à Bibracte. De la gestion de la ressource forestière
à la standardisation de l’architecture.
Andrea FOCHESATO : Université de Bourgogne, UMR 6298 ArTeHiS/ 6 boulevard Gabriel, 21000
Dijon, France/ [email protected]
L'analyse de l'architecture urbaine des oppida ne vise pas uniquement à une restitution
technique de leur habitat ; elle mène aussi à des questionnements relatifs à la genèse de ces villes
fortifiées, à leur relation avec les agglomérations « ouvertes » préexistantes, ainsi qu'à l'originalité de
quelques-unes de leurs spécificités, par exemple leurs remparts monumentaux. De plus, cette analyse
mène à observer les oppida dans le cadre de leur territoire, en étudiant les liens qu'ils entretiennent
avec les ressources (notamment forestières) nécessaires à leur existence.
L'image que renvoie Bibracte (Mont Beuvray) est celle d'un site caractérisé par une activité de
construction très abondante et clairement réglementée, qui s'appuie véritablement sur un système de
mesures et de modules standardisés de construction, au sein d'une planification rationnelle de l'habitat.
De même que l’édification des remparts marque une véritable volonté d'isoler un espace bien défini (et
reconnaissable) à l'intérieur d'un territoire plus ample, l'organisation urbaine et la standardisation des
bâtiments et des techniques de construction témoignent aussi d'une très forte volonté d'organisation
15
des modalités de l'occupation de cet espace délimité. Une volonté qui d'ailleurs ne semble pas
étrangère aux agglomérations « ouvertes » dès le IIIe siècle av. J.-C.
En second lieu, l'étude de l'architecture en bois du Mont Beuvray relève des techniques de
charpenterie évoluées, qui permettent de réaliser des structures en pan de bois comparables à ceux
connus plus tard dans le monde gallo-romain.
Le bois constitue évidemment la ressource primaire et fondamentale dans la construction à
Bibracte. Comme le montrent les études xylologiques et anthracologiques, le chêne, propre d'un milieu
forestier collinéen, est sûrement l'essence privilégiée en charpenterie, tandis que le hêtre, arbre qui
domine les environs immédiats du site, semblerait principalement utilisé comme combustible. Le
chêne est employé pour les ossatures et les charpentes, les cloisons (souvent avec le noisetier) et les
toitures. La production des éléments de la construction (poteaux, poutres, planches, bardeaux) semble
elle aussi être l'objet d'une standardisation des mesures et des techniques de réalisation.
On observe se profiler l'image d'une « économie de la construction en bois » évoluée, capable
de supporter un rythme d'édification très rapide. L’énorme volume du bois exploité et la nécessité de
son approvisionnement dans un rayon relativement éloigné du site par le biais d'une sélection des
essences les mieux adaptées, mène en conséquence à approfondir la réflexion sur les relations
existantes entre l'oppidum (en tant que place centrale) et son territoire : en premier lieu, la production
et les échanges (artisanat, agriculture, commerce sur large échelle), mais aussi l'approvisionnement en
matériau et combustible, à travers une gestion de la forêt, source vitale pour l'existence de la ville.
« Weight Method » : Nouvelle approche méthodologique de l’estimation des poids de
viande appliquée aux populations laténiennes.
Pierre-Emmanuel PARIS : Université PARIS 1 Panthéon-Sorbonne ; UMR 8215 Trajectoires, Maison
Archéologie & Ethnologie René-Ginouvès, 21, allée de l’Université, F-92023, Nanterre Cedex,
France/ [email protected]
Appréhender les modalités de gestion des ressources carnées dans les sociétés anciennes est
accessible, de manière traditionnelle, à travers un large panel d’analyses statistiques réalisées
généralement à partir d’études ostéologiques. L’allométrie permet, quant à elle, d’approfondir un
certain nombre de thématiques proprement archéozoologiques et, notamment, d’estimer le poids de
viande. Or, si l’estimation de la part carnée dans l’alimentation des sociétés du passé est une démarche
scientifique connue des archéozoologues, sa mise en pratique n’est ni consensuelle ni uniforme.
Cette communication n’entend pas retracer l’historiographie des méthodes permettant
d’estimer les poids de viande, ni d’en faire la critique : il s’agit davantage de proposer une nouvelle
méthodologie de travail – reposant sur plusieurs études ethno-archéozoologiques – et de porter
l’accent sur son application à un contexte archéologique spécifique : la toute fin de l’âge du Fer dans
le nord de la France.
Ainsi, on s’attachera tout d’abord à présenter rapidement cette nouvelle méthode d’estimation
du poids de viande pour l’appliquer ensuite à deux cas d’étude, ceux des oppida gaulois voisins de
Condé-sur-Suippe sur le territoire rème (150 – 90 av. n. è.) et de Villeneuve-Saint-Germain, chez les
Suessions (90 – 30 av. n. è.). L’analyse croisée des données provenant de ces deux contextes
archéologiques permettra, par la suite, de mettre en exergue les apports de cette nouvelle méthode
archéozoologique aux problématiques, plus larges, du développement économique des populations
laténiennes dans lesquelles s’insèrent parfaitement les questions de production et de distribution des
ressources carnées. On tentera ainsi d’apporter de nouveaux éléments de réflexion à la question de
l’émergence des agglomérations gauloises et à leur impact sur les dynamiques économiques locales,
régionales voire extrarégionales.
16
Enfin, on présentera un outil informatique, destiné à la communauté scientifique, qui
automatise les traitements mathématiques et garantit une meilleure prise en main de cette nouvelle
méthode d’estimation du poids de viande.
L’apport de l’étude des trous de poteau à la compréhension et à l’identification des
édifices sur poteaux plantés de l’âge du Fer.
Patrick MAGUER : Université François Rabelais (Tours) - EA 6298 CeThis/ 3 rue des Tanneurs,
37041 Tours cedex, France/ [email protected]
Pour un protohistorien, le trou de poteau est la structure archéologique la plus souvent rencontrée
lors des fouilles. Pour autant, et peut-être en raison du nombre de ces structures à fouiller sur les sites
archéologiques, c'est aussi bien souvent celles que les archéologues de terrain négligent le plus, se
contentant bien souvent d'une fouille "mécanique" suivie d'une analyse planimétrique amenant à des
propositions de plan de bâtiment douteuses. A travers plusieurs exemples, nous verrons que l'étude
d'un trou de poteau, si elle n'est pas forcément complexe, permet l'acquisition d'un grand nombre
d'informations :
- sur les techniques de construction et leur évolution au cours de l'âge du Fer (morphologie du
trou de poteau et des supports (circulaire, carré), profondeur des fondations) et plus largement
sur l'architecture du bâtiment et le rôle des différents poteaux, porteurs et non porteurs, au sein
de l'édifice.
- sur l'évolution de la structure au cours du temps et sur sa chronologie, notamment par
l'observation de la position du mobilier archéologique dans le remblai du trou de poteau ou dans
le négatif.
Ce n'est qu'à partir de ces données et de leur analyse qu'il est possible de caractériser et de
comprendre l'architecture des édifices sur poteaux plantés.
POSTERS
Les changements morphologiques du bœuf en Gaule entre le IVe s. av. et le Ve s. ap. J.-
C. : les tenants d’une évolution technique et culturelle.
Colin DUVAL : CNRS, UMR 7209, Archéozoologie, Archéobotanique : Sociétés, Pratiques et
Environnements, Muséum national d’Histoire naturelle, Dép. EGB, 55, rue Buffon, CP 56, 75005,
Paris, France/ [email protected]
Pauline NUVIALA : CNRS, Université de Bourgogne, UMR ArTeHis 6298/ 6 boulevard Gabriel
21000 Dijon, France/ [email protected]
Entre le second âge du Fer et la période romaine, les bœufs gaulois deviennent plus grands et
plus robustes. Les liens entre ce changement de morphologie et la diffusion de la culture romaine ont
été démontrés depuis une trentaine d’années, notamment par les études de P. Méniel, F. Audoin-
Rouzeau, S. Lepetz, V. Forest et I. Rodet-Belarbi. Trois hypothèses sont avancées pour expliquer cette
évolution des morphologies, mise en évidence par l’ostéométrie : une amélioration locale des
conditions d’élevage, une importation - notamment depuis l’Italie - de bœufs à la morphologie
différente et, enfin, une hypothèse mixte impliquant à la fois un remplacement du cheptel gaulois et
l’application de nouvelles pratiques d’élevage.
17
Les objectifs de l’étude présentée ont été dans un premier temps de redéfinir l’origine
géographique et la temporalité des changements de forme des bœufs et de déterminer laquelle des
hypothèses, entre application de nouvelles méthodes d’élevage et importation d’animaux, était la plus
à même d’expliquer ces variations morphologiques. Dans un second temps, nous avons cherché à
comprendre les liens de causes à effets entre la production de bœufs plus grands et plus robustes et les
changements qui surviennent dans les sociétés gauloises à la fin de l’âge du Fer et suite à la Conquête
romaine.
Pour répondre à ces questions, notre analyse se fonde sur un important corpus de données
(près de 260 sites) qui permet la couverture d’une vaste zone géographique (entre France, Italie,
Suisse, Allemagne, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) et d’une période chronologique large (du IVe
s. av. J.-C. au Ve s. ap. J.-C.). Elle s’appuie en outre sur une approche interdisciplinaire intégrant des
méthodes de l’archéozoologie classique comme l’ostéométrie et d’autres, plus récemment
développées, comme la morphométrie géométrique. En complément, les sources littéraires et
iconographiques ont également été questionnées.
Les résultats obtenus nous ont permis de souligner notamment l’implication des sociétés
gauloises dans la mise en place des évolutions constatées et l’expression d’interactions culturelles et
économiques nombreuses, entre la Gaule et ses voisins, en particulier l’Italie.
La technique de production céramique comme marqueur d’échange : l’exemple des poteries
rhénanes à la veille du premier âge du Fer (Xe- IXe s. av. J.-C.).
Marie PHILIPPE : Université de Bourgogne, UMR 6298 ArTeHiS/ 6 boulevard Gabriel, 21000 Dijon,
France/ [email protected]
Au même titre que les objets métalliques, la céramique constitue un matériau privilégié pour
l’étude des relations (ou de leur absence) entre les populations hallstattiennes. Cependant, l’aspect
technique est bien souvent négligé alors qu’il constitue un indice fort d’appartenance sociale et
culturelle. Les études en psychologie du comportement démontrent en effet que le transfert d’un
savoir-faire technique implique l’acquisition d’habitudes motrices et cognitives auprès d’un modèle.
Ce poster vise à proposer un premier bilan des données techniques collectées sur les
céramiques de la vallée du Rhin supérieur à la veille du Premier âge du Fer. Conformément aux
attentes, le façonnage au colombin est omniprésent mais pas exclusif. La technique de fixation des
anses par tenon et mortaise, certainement héritée de la charpenterie, est aussi très présente bien que
très peu documentée dans les publications. Au total, 52 caractères de la chaîne opératoire sont pris en
compte pour chaque objet, et 400 récipients ont déjà été inventoriés. Un protocole de traitement
statistique a été élaboré pour trier les chaînes opératoires les plus similaires dans cette masse de
données.
Dès la fin de l’âge du Bronze, la diffusion à grande échelle des matériaux métalliques et du
style céramique Rhin-Suisse France Orientale laisse supposer que des réseaux de contacts étaient déjà
en place, et des frontières également. Aussi, la mise en évidence des interactions sociales existant à
cette époque devrait apporter matière aux discussions relatives à la mise en place des relations
politiques et commerciales des siècles suivants.
18
SESSION 3 :
ASPECTS D’ARCHEOLOGIE FUNERAIRE / ASPECTS OF FUNERARY ARCHAEOLOGY
Nouvelles approches et perspectives méthodologiques pour l’archéologie funéraire du
genre.
Chloé BELARD : ENS – UMR 8546 AOROC/ 45 rue d’Ulm, 75230 Paris cedex 05, France/
Cette communication vise à proposer une nouvelle approche méthodologique des données
funéraires, à partir du point de vue de la notion de genre. Cette notion permet effectivement de
reconnaitre le caractère profondément construit des identités sociales des hommes et des femmes
représentées dans les sépultures et notamment celles de l’âge du Fer. Mais elle ne se limite pas
seulement à cet aspect. En effet, l’archéologie du genre doit aller au-delà de la seule recherche des
effets matériels impliqués dans la distinction sociale entre hommes et femmes. Car les hommes et les
femmes ne représentent pas deux catégories sociales uniformes, dont la représentation est matérialisée
de façon homogène. Ils ont été inhumés différemment en fonction aussi de leur âge ou encore leur
appartenance à une classe sociale particulière.
En fait la notion de genre permet de s’intéresser fondamentalement à l’idéologie funéraire des
populations anciennes. La question est donc de savoir quels aspects de cette idéologie et de l’identité
sociale « multifacette » des défunts peuvent être appréhendés à partir des vestiges funéraires conservés
jusqu’à aujourd’hui. Il s’agira donc aussi de s’interroger sur la manière de caractériser
archéologiquement les différentes catégories hiérarchiques des hommes et des femmes de l’âge du Fer
à travers les assemblages mobiliers. De ce fait, cette communication sera également l’occasion de
présenter un nouvel outil graphique qui permet d’approcher la nature hiérarchique des ensembles
d’objets associés aux défunts. Car c’est en s’intéressant à la hiérarchisation interne des ensembles
funéraires que l’idéologie de genre de l’âge du Fer peut être véritablement étudiée.
Life and death at La Tène site Basel-Gasfabrik (CH) - Interdisciplinarity investigations
of selected settlement features and two cemeteries provide insights into the Late Iron
Age world.
David BRÖNNIMANN : Insitut for Prehisory and Archaeological Science (iPAS), University of
Basel/ Spalenring 145, 4055 Basel, Switzerland/ [email protected]
Hannele RISSANEN : Archäologische Bodenforschung des Kantans Basel-Stadt/ Petersgraben 11,
4051 Basel, Switzerland/ [email protected]
(With collaboration of Kurt W. ALT1, Corina KNIPPER3,Marlu KÜHN1, Sandra PICHLER1, Philippe
RENTZEL1, Brigitte RÖDER4, Jörg SCHIBLER1, Barbara STOPP1, Norbert SPICHTIG2, Werner
VACH5, Ole WARNBERG6 and Guido LASSAU2) 1) Insitut for Prehisory and Archaeological Science (iPAS), University of Basel
2) Archäologische Bodenforschung des Kantans Basel-Stadt
3) Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie, Mannheim, Germany
4) Ur- und Frühgeschichtliche und Provinzialrömische Archäologie, University of Basel, Switzerland
5) Center for Medical Biometry and Medical Informatics, University of Freiburg, Germany
6) Institute for Anthropology, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Germany
19
In the course of the research project “Approaching the living via the dead: human remains
from the Late La Tène site Basel-Gasfabrik and their cultural-historical interpretations”, a team of 14
researchers carried out archaeological, anthropological, archaeozoological, archaeobotanical,
biogeochemical, biomolecular, geoarchaeological and statistical analyses on the site’s finds and
features. The aim was to gain basic insights into living and social conditions, the origins of the
inhabitants, and funerary practices in Late La Tène Basel. This paper focuses on strategies and
solutions in interdisciplinary research teamwork and on developing integrative syntheses.
Furthermore, results of the archaeological sub-project (cemeteries) and geoarchaeological analyses of
pit infillings (pit 321), both undertaken as doctoral theses, are presented.
The Basel-Gasfabrik site (c. 150-80 BC) was discovered in 1911 and has been under
investigation ever since. The unfortified settlement was situated in the northern part of the modern city
of Basel (Switzerland) and covered an area of about 150’000 square meters. Several hundred thousand
fragments of locally produced or imported artefacts were recovered. The site was subdivided into
numerous domestic and economic units and also had two cemeteries with about 200 inhumations.
Additionally, several complete skeletons were found in pits, wells and ditches inside the settlement but
there are also a large number of isolated human bones from a variety of archaeological contexts.
Both cemeteries contained adults’ as well as children’s burials. Typochronological data
suggest that they were in use during the same time period. The variation and combination of grave
goods highlight slight differences between the deceased and children were buried with larger
quantities of grave offerings than adults. The geoarchaeological analysis shows that sunken features on
the cemeteries like a large ditch had stood open for a long time, being gradually and naturally
backfilled. Grave pits and small ditches stood open for shorter time spans after they had been dug.
Pit 321 was located within the settlement. It was at least 2.7 m deep with a diameter of 3 m
and contained the well preserved skeletons of two young men. On the basis of geoarchaeological
findings, it was possible to reconstruct the filling process of the pit. The interdisciplinary
investigations showed that the two men were deposited in occupation layer material which was infilled
quickly. Both men were identified as local individuals with remarkably similar diets and significant
traces of violence suffered during their lifetimes and around their time of death. Special objects like a
coin wallet and a coin stamp are interpreted as grave offerings, whereas no clear evidence of food
offerings was found. In summary, the placing of the two men in the pit seems to be a burial rather than
an undignified “disposal”.
The project generated new data regarding funerary practices in the settlement and cemeteries,
on local and foreign products in the archaeological material, the areas of origin and diet of the site’s
inhabitants as well as data about agriculture and animal husbandry in a consistently integrated
interdisciplinary approach.
Pratiques funéraires au Second âge du Fer dans la zone médio-atlantique.
Emilie VANNIER : ArcHiMèdE – UMR 7044, Université de Strasbourg/ 5 allée du Gal Rouvillois –
CS 50008, 67083 Strasbourg, France/ [email protected]
Cette communication présente un projet de thèse, sous la direction de Stephan Ficthl et Pierre-
Yves Milcent à l’Université de Strasbourg, sur les caractéristiques des ensembles funéraires celtiques
du complexe médio-atlantique (Ouest de la France, Belgique et Sud de l’Angleterre).
Ces recherches, à échelle macroscopique, ne procèdent pas à une étude anthropologique
précise des restes humains mis au jour dans ces ensembles funéraires mais à des analyses statistiques
et spatiales des types de traitements des corps, des dépôts de mobiliers, des monuments et des
aménagements des tombes.
Cette approche vise à identifier les groupes culturels présents en mettant en lumière leurs
caractéristiques propres mais aussi communes dans le domaine funéraire. Leur observation dans le
20
temps et l’espace aide également à comprendre les changements internes et les interactions entre les
différents groupes socio-culturels atlantiques ainsi qu’avec les sociétés contemporaines des complexes
culturels voisins. Ce projet ambitionne également d’éclairer les rapports entre les sociétés celtiques
continentales et des îles britanniques, à travers l’étude des pratiques funéraires reflétant divers facteurs
socio-culturels, économiques et idéologiques.
Ce travail vise aussi à étendre les recherches sur les pratiques funéraires du second âge du Fer
en Europe, souvent cantonnées à une échelle nationale, ainsi qu’à contribuer à élargir les
connaissances sur les populations du domaine atlantique, encore négligé en comparaison des zones
nord-alpines et méditerranéennes.
Zur Sozialstruktur früheisenzeitlicher Bestattungen in Mittelitalien.
Christoph BAUR : Institut für Archäologien, Universität Innsbruck/ Langer Weg 11, 3. Stock, 6020
Innsbruck, Austria/ [email protected]
Zur Sozialstruktur früheisenzeitlicher Bestattungen in Mittelitalien Am Übergang von der
Endbronzezeit zur Früheisenzeit zeichnet sich ein grundlegender Wandel im Siedlungsraster Etruriens
ab: die Mehrzahl der endbronzezeitlichen Siedlungen werden aufgegeben, es entstehen jene
protourbanen Zentren, die sich zu den etruskischen Stadtstaaten entwickeln. Träger und Motor dieser
„Protourbanen Wende“ sind die protovillanovazeitlichen Eliten Mittelitaliens, die im Grabritus anhand
von symbolischen Waffenbeigaben fassbar sind. Mit der Ausbildung der Villanova-Kultur zu Beginn
der Früheisenzeit ist der neue Siedlungsraster in seinen Grundzügen gefestigt, gleichzeitig lässt sich
ein Erstarken der Eliten in sozio-ökonomischer Hinsicht und ihr neues Selbstbewusstsein in den
Grabbefunden feststellen: nun gelangen auch echte Waffen in die Gräber.
Ab dem 9. Jh. v. Chr. entwickeln sich die waffentragenden Eliten zu einer stark
hierarchisierten Gruppe innerhalb der Gesellschaft. Sie sind keineswegs nur Krieger sondern verfügen
über wirtschaftliche, politische und kultische Macht, die im Grabritus dargestellt wird. Am Ende
dieses Entwicklungsprozesses stellen die „Principi Etruschi“ der Orientalisierenden Periode ihre
soziale Vorrangstellung in opulenten Grabausstattungen zur Schau.
Die Bezeichnung Villanova-Kultur muss jedoch kritisch hinterfragt werden; der Begriff
suggeriert eine kulturelle Einheitlichkeit, die so nicht existiert. Die Villanova-Kultur beschränkt sich
nicht auf das etruskische Kernland zwischen Arno und Tiber, isolierte Zentren bestehen in der Po-
Ebene, an der Adriaküste sowie in Kampanien. Gemein ist diesen Gruppen die Brandbestattung und
Beisetzung in bikonischen Urnen, sie bewahren jedoch eigenständige Traditionen und verfolgen
unterschiedliche Entwicklungsstränge.
Im Rahmen des Dissertationsprojektes werden die frühetruskischen Waffengräber ab der 2.
Hälfte des 10. Jh. bis zum 7. Jh. v. Chr. umfassend betrachtet. Auf breiter statistischer Basis werden
die Entwicklungen der einzelnen Zentren untersucht und in einen „panetruskischen“ Kontext gestellt.
Die Auswertung erfolgt EDV-gestützt, neben klassischen Analysemethoden kommen GIS-basierte,
räumliche Analysen zum Einsatz. Im Vordergrund stehen Fragen zur Genese der etruskischen
Gentilgesellschaft, die auch unter sozialanthropologischen Gesichtspunkten beleuchtet werden sollen.
21
POSTERS
Early Iron Age burials from Chotin, SW Slovakia.
Petra KMEŤOVÁ : Department of Archaeology, Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava/
Gondova 2, 814 99 Bratislava, Slovakia/ [email protected]
Early Iron Age was characterized by rapid increase of significance of the horse. This
relationship was reflected in burial rites: along with symbolic horse presence (horse harnesses), horse
burials as a symbol of high social status were present in human graves. In the late phase of the Early
Iron Age, new cultural elements occurred in the eastern Central Europe, partly associated with east-
European elements. Earlier views suggested that new type of horses from Eastern Europe were also
introduced here. Along with these changes a new type of horse burial occurred, namely horse placed in
a separate grave pit. These horse burials cannot be associated with any specific human burials,
therefore are supposed to be reflection of a specific rite.
In my poster, analyses of re-found skeletal horse remains from Iron Age cemetery in Chotín,
SW Slovakia (Vekerzug Culture, end of the 7th – end of the 5th century BC) will be presented. In
1950s and early 1960s, 13 graves with horse remains were excavated there, 10 of which were separate
horse graves with remains of the whole body. These horse remains have never been
archaeozoologically analysed and until recently were thought to be lost. However, skeletal remains of
10 horses from these graves were recently re-discovered, in order to realize interdisciplinary research.
The results of this research will be compared with few other analyses of contemporary horse skeletal
material, namely from another large Vekerzug Culture cemetery in Szentes-Vekerzug as well as with
horse remains from Eurasian steppes and from northern Italy. Based on these results, theories on Early
Iron Age horse breeding as well as horse exchange will be re-examined, and interpretation of the
specific rites associated with horses will be suggested.
This work is supported by the Slovak Research and Development Agency under the contract
No. APVV-0598-10.
Second-hand traces of wear and organic substances on objects from the La Tène B
cemetery of Werneck-Zeuzleben.
Doris LETTMAN : Otto-Friedrich-University (Bamberg)/ Johann-Strauß-Str. 10, 82008 Unterhaching,
Germany/ [email protected]
The early latène cemetery Werneck-Zeuzleben (Lower Franconia, northern Bavaria) was
excavated in 2009. Thanks to contemporary methods of restoration organic substances and traces of
wear can be found on plenty of the objects. Instead of the single graves or little grave groups which are
common in south Germany the 40 inhumations of Werneck offer a broader base for research. In
combination with the data from the anthropological examinations it´s possible to gather information
on the garment and gear and the burial rites.
In some cases the traces of wear might show a difference between the dress in daily life and in
the grave. Especially interesting are graves of children that contained objects that originally were used
by adult persons.
The comparison of costumes and burial rites is a further tessera to the registration and
evaluation of the different ways of contact to groups either in the core areas of the La Tène culture or
the regions north of it.
22
Étude anthropologique de la sépulture multiple laténienne de Gondole (Les Liots - Le
Cendre, 63).
Florine SARRY : PACEA UMR 5199 CBRS- A3P, Université de Bordeaux/ Allée Geofrroy St-
Hilaire CS 50023, 33615 Pessac Cedex-F, France/ [email protected]
La sépulture multiple du site de Gondole, mise au jour en 2002 par l’Inrap est localisée au
cœur du lieu de pouvoir arverne constitué par les oppida de Corent, Gergovie et Gondole. Elle est
datée de la Tène D2.
Cette structure d’exception s’intègre dans un espace situé à l’ouest de l’oppidum, hors rempart,
au nord de la voie principale est-ouest (en direction de Gergovie). La fosse réunit huit chevaux dans sa
partie ouest et huit hommes dans sa partie est : sept adultes (dont quatre de sexe masculin avéré) et un
immature. Les individus, globalement déposés sur leur côté droit, s’orientent selon un axe nord-sud, la
tête au sud.
La documentation réunie dans une perspective archéo-anthropologique a permis d’enrichir la
discussion autour de cette unité d’exception et d’envisager la réalisation d’études isotopiques.
L'analyse de l’isotope strontium permet d’établir un lien entre le sol géologique et l’émail
dentaire, élément le plus stable reflétant les premières années de vie d’un individu. Nous pourrions
ainsi discuter de l’homogénéité du corpus. Cette dernière est suggérée par les données métriques. De
plus, il est possible de préciser l’origine des inhumés afin de savoir si ces-derniers sont issus du
territoire arverne ou autre. Cette information enrichirait la discussion concernant le caractère unique de
cette sépulture.
À partir des isotopes stables de l’azote et du carbone et de leur transfert au sein des chaînes
alimentaires, il est possible d’appréhender « les tendances carnée, marine et végétale des régimes
alimentaires » des populations passées (Herrscher et al., 2002). Ces données permettraient
d’appréhender le statut social des inhumés et de voir si tous les individus présentaient le même régime
alimentaire.
Cette sépulture permet ainsi d’envisager d’autres approches dans l’optique d’affirmer ou
d’infirmer des observations qui ont pu être faites lors de l’étude biologique des squelettes.
Le genre : une nouvelle variable pour l’étude des corpus funéraires.
Caroline TREMEAUD : UMR 8215 Trajectoires, Maison Archéologie & Ethnologie, René-Ginouvès/
21 allée de l'Université 92023 Nanterre CEDEX, France/ [email protected]
Les données funéraires sont les seules qui permettent de questionner la place de l’individu au
sein d’un groupe à travers des variables « personnelles » (sexe, âge, statut…). Une partie de ces
variables résulte de la lecture anthropologique des restes osseux ; le reste provient de la lecture
archéologique, notamment basée sur le mobilier associé au défunt. Cette dernière permet de préciser le
genre de la sépulture. Inconsciemment utilisée depuis le XIXe s., cette variable « genre » fait
aujourd’hui l’objet d’une réflexion beaucoup plus approfondie. En effet, le genre doit être distingué du
sexe – qui se réfère à une donnée biologique – et considéré comme le résultat d’une construction
sociale qui vient compléter les données anthropologiques du sexe.
Ainsi, pour permettre la compréhension des pratiques funéraires, percevoir la dichotomie
sexuelle et son expression dans le monde funéraire et, plus globalement, pour pouvoir questionner les
rapports hommes-femmes, notamment dans leur accès à la richesse et au pouvoir, il devient nécessaire
d’effectuer une analyse du genre archéologique et de la confronter aux variables plus « usuelles »
(sexe, âge, richesse, statut).
23
Ces questions sont particulièrement intéressantes dans le cas des sociétés de l’âge du Fer dans
la zone nord-alpine. En effet, ces sociétés fortement hiérarchisées connaissent une phase de
structuration importante, notamment visible à travers le phénomène princier. L’apport de la variable
genre permet alors une réflexion fondamentale sur la structure même de ces sociétés, réflexion qui sera
menée à partir d’études de cas d’ensembles funéraires de l’âge du Fer dans le monde nord-alpin.
De plus cette réflexion peut être menée sur un cadre important permettant de questionner les possibles
influences entre différentes cultures européennes et surtout de présenter l’évolution, au prisme du
genre, tant chronologique que géographique des sociétés nord-alpines.
24
SESSION 4 :
PRODUCTIONS MÉTALLIQUES / METAL PRODUCTIONS
Exploring Iron Smelting « Systems » in Iron Age Europe.
Scott STETKIEWITCZ : University of Edinburgh/ 6 Cannng Street Lane, Edinburgh, Scotland, EH3
8ER, United Kingdom/ mailto:[email protected]
A smelting system, as defined by Dillmann and L'Heritier (2007 ; 1814), is a “smelting
operation with the same ore, charcoal, fluxes and furnace lining”. This system can also include overall
reduction parameters such as smelt duration, charge recipe, and draught flow. Each material
component possesses a particular chemical composition, and it is postulated that certain NRC (non-
reduced compound) ratios represent signatures within these systems; enabling unique system profiles
to be generated for different slag corpora. Identifying these discrete production situations is integral
for both intra- and inter- site comparability when chemically analysing iron smelting slag, and
represents a first step in synthesizing wider European Iron Age data. This technique, in conjunction
with PCA (principal component analysis) and ternary interpretation following from Rehren et al.
(2007) proposed model is applied to a series of ferrous residues from Iron Age sites in Scotland,
England, and France.
New fibula-types from the Northeast-Transdanubian Hallstatt-group.
Katalin NOVINSKI-GROMA : Eötvös Loránd University, Budapest, 1025, Budapest, Napsugár
lépcső 10/A, Hungary/ [email protected]
The archaeological site Süttő is situated in the western part of Hungary, called Transdanubia.
At this location we found two settlements and two cemeteries from the early Iron-age Hallstatt-culture
on the river bank of Danube. Excavations in the area were carried out in the 1970’s and 1980’s by Éva
Vadász and Gábor Vékony. One of the two cemeteries belongs to the so called flat type. A peculiarity
of this type is that we cannot find moulds up in the graves nowadays. The other graveyard consists of
tumulus-graves in different groups. In my recent work I focus on the flat cemetery, especially on grave
Nr. 11, which was prominently rich in grave-goods. Flat cemeteries from Transdanubia in general and
the surrounding areas (especially in southwestern Slovakia and eastern Austria) are not really rich in
grave-goods, they usually contain pottery and rarely include bronze or iron objects like wear-elements,
knives and rings.
In consideration of these characteristics, it is interesting, that besides the 14 pottery found in
the above mentioned grave from Süttő, 15 different metal objects were also revealed. Among them we
can find fibulas, a pin with spherical head, bracelets, a big amount of little bronze rings and little iron
tools. One of the fibulas was a boat-shaped brooch, which is a common finding in this region in the Ha
C period. In addition to that two double-looped bow fibulas also appeared together with a sand-glass
form catchplate and a semilunar fibula (Halbmondfibel).
Prior to their appearance in this grave, these types were unknown in the Hungarian Early Iron
Age. Through them we can trace a long-distance relationship both into the south (southwestern part of
the nowadays Romania and northern Serbia) and into the west and southwest (Slovenia, Italy and
Austria; probably till the border of the western Hallstatt-world). It also proposes new cultural
influences, which we could not detect before in the Northeast-Hungarian Hallstatt-Group. These new
25
forms in the Hungarian material could be important handholds of chronology because metal findings
on the ground are rare.
Besides these supports, we also have to take the place of the findings into account. Generally
we regard the graves of the flat cemeteries as the funeral places of the lower ranked people from the
local Iron-age communities. Usually we can only find parallels of these grave-goods at in the
surrounding areas and they seemed not having extended relations. But if we consider the rich
collection from grave Nr. 11 of Süttő, we raises the question of reviewing that old theory about the
system of the cemeteries at the Hallstatt-period in the western part of the Carpathian-basin.
Les ceintures de l’âge du Fer dans le Nord de l’Italie : la technologie, la décoration et les
centres de production possibles.
Rita SOLAZZO : Maison de la recherche – Nanterre (MAE), Maison Archéologie et Ethnologie, René
Ginouves/ 21 Allée de l’Université, 92 000 Nanterre, France/ [email protected]
Dans cette communication, nous examinons la production des éléments de bronze et de fer des
ceintures du nord de l'Italie (à l'exception de l’Étrurie Padana) au cours de l'âge du Fer, correspondant
au faciès archéologiques d’Este et Golant. Ces éléments correspondent à la plaque de métal avec
crochet de ceinture, souvent décorée, qui était la boucle de ceinture, généralement faite de matériaux
périssables; ils appartiennent aux vêtements des hommes et des femmes. L’objectif de la recherche est
celui de reconstruire la technique métallurgique de la réalisation de ces objets et toutes les étapes de la
transformation, de la matière première au produit fini. Une attention particulière sera accordée à la
décoration, à comprendre comment les différentes techniques de fabrication sont reliées au choix de
certains motifs ornementaux, soit en raison de leur plus grande faisabilité technique, ou à cause de
certains ateliers d'artisanat propres ou des cercles; dans ce dernier cas la décoration se réfère à
l'esthétique qui caractérise les différentes réalités régionales qui constituent les cultures archéologiques
de l'âge du fer dans le nord de l'Italie.
POSTERS
La métallurgie du fer en Aquitaine gauloise et romaine. Comprendre la fabrication et la
commercialisation du fer à travers les déchets de production : une étude
pluridisciplinaire. Approche méthodologique et premiers résultats.
Emilie CAILLAUD : HeRMA (EA 3811), Université de Poitiers/ 8 rue René Descartes TSA 81118,
86073 Poitiers Cedex 9, France/ [email protected]
Les recherches doctorales, débutées en octobre 2013 à l'université de Poitiers, (sous la
direction de Nadine Dieudonné-Glad et en codirection avec Didier Béziat, de l'université de Toulouse
III Sabatier), s'organisent autour des problématiques sur la métallurgie du fer et, plus particulièrement,
sur l'économie du fer et son impact dans le développement et l'organisation des sociétés en Gaule.
L'objectif de ces travaux de recherches est d'identifier les réseaux d'échanges et de circulation
des matières premières métalliques en Aquitaine gauloise et romaine, par des méthodes
physicochimiques.
Ces méthodes, mises au point par les équipes TRACES (Toulouse) et IRAMAT (CEA, équipe
de Philippe Dillmann) n'ont jamais encore été appliquées à l'Aquitaine antique.
26
En effet, afin d'évaluer les réseaux d'échanges et de circulation du fer en Aquitaine gauloise et
romaine, il est nécessaire d'identifier la provenance des matières premières métalliques en usage.
L'étude des résidus de forge, et plus spécifiquement des chutes métalliques, permet de recueillir des
informations essentielles sur l'origine du métal. Les inclusions de scories, présentes dans ces débris
métalliques, sont des marqueurs historiques des matières premières utilisées lors de l'élaboration des
objets. À l'aide de techniques d'analyses fines et destructrices, il est possible d'identifier les
compositions précises de ces inclusions. Ces compositions, comparées à celles de scories provenant de
sites de réduction, dont le corpus est maintenant abondant, nous permettront de cerner les différents
approvisionnements en fer des ateliers de forge étudiés.
27
SESSION 5 :
CONTACTS, RELATIONS ET ÉCHANGES / CONTACTS, RELATIONS AND EXCHANGES
The La Tène Culture influences in Pomerania on the background of the south-west and
west parts of the Baltic Sea Region.
Przemysław HARASIM : University of Rzeszów, ul. Margaretek 7/ PL 92-722 Łódź, Poland/
The La Tène culture influences in the Central and Northern Europe are the most crucial
question of the Pre-Roman Period. The last research on the La Tène influences in Pomerania was
conducted 20 years ago. This fact should be disquieting because the adaptation of elements of the La
Tène culture in Pomerania is an evidence for the attractiveness of the La Tène culture in societies
which lived in an area distant from Celtic settlements. The main target of this lecture goes through
characterize of the La Tène culture impact on the dress accessories and jewellery (like brooches,
necklaces, bracelets and pendants), on the armament (like double-edged swords, metal scabbards, belt-
hooks, spear-heads) used in Pomerania, as well as on the funeral rites, on the social structure of
societies, who lived in this region. Compare the complex La Tène influences in Pomerania with the La
Tène influences in neighbouring areas of the Baltic Sea Region would shed light on the dynamism,
directions and variety of the La Tène influences in the south, south-west and west parts of the Baltic
Sea Region and it will also show the specificity of Pomerania in the process of the La Tène influences
in Northern Europe.
Entre Sud et Nord du Rhin supérieur : Production et consommation de céramiques de
l’Alsace au Nordbaden au Ve - IVe s. av. J.-C.
Steeve GENTNER : Université de Strasbourg - UMR 7044 Archimède, Misha/ 5 Allée du Général
Rouvillois, 67083 Strasbourg, France/ [email protected]
Katrin LUDWIG : Établissement d’affiliation et laboratoire : Rheinische Friedrich-Wilhelms-
Universität, Bonn/ Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie, Regina-Pacis-Weg 7, 53113 Bonn,
Germany/ [email protected]
Cette communication propose de confronter deux ensembles géographiques clés lors de la
période de transition entre les âges du Fer. Une sélection d'habitats - et leur mobilier - de l'Est de la
France sera corrélée aux sites plus septentrionaux de la vallée rhénane, du Sud-Ouest de l'Allemagne.
Il s'agira de mettre en relation le matériel céramique de deux régions et, plus particulièrement,
la céramique tournée. Les études dédiées au Nord de la Forêt-Noire (Nordschwarzwald, Bade-
Wurtemberg) seront confrontées aux données mobilières des régions du Kraichgau et du bas et moyen-
Neckar (Bade-Wurtemberg) tout en les croisant aux corpus alsaciens. Les contacts liés notamment aux
phénomènes de production/distribution, de céramiques tournées, attestés parmi ces quatre espaces
régionaux seront mis en avant et exposeront une vision transfrontalière du paysage archéologique.
Ces régions limitrophes, et aujourd'hui frontalières, relèvent d'un complexe économico-
culturel interconnecté qu'il faut à présent analyser conjointement dans le but de caractériser les enjeux
liés à cette zone du Rhin supérieur au cours d'une période de basculement à la fin du Hallstatt et au
début de La Tène.
28
Between the sea and the Alps : traces of mobility and trade of the Late Iron Age societies
in the northern Adriatic.
Asja TONC : Institute of Archaeology/ Ljudevita Gaja 32, 10 000 Zagreb, Croatia/ [email protected]
The Late Iron Age phase of the autochthonous communities which inhabited the northern part
of the Eastern Adriatic and its hinterland, widely dated to 4th-1st cent. BC, has been generally viewed
as a period of increasing Hellenistic and Celtic influences. From the 2nd cent. BC another major route
becomes ever more relevant, i.e. that from North Italy and especially Aquileia, ultimately ending in
Roman military interventions that culminated under Augustus, bringing the area under Roman rule.
Contacts with Celtic, Hellenistic and other neighbouring autochthonous communities can be
recognised in directly imported items as well as their local imitations, but also occuring is the transfer
of ideas and know-how that affected the everyday life of local societies. By revising all gathered
archaeological finds and analysing available data on the burial customs and rituals within the area it is
possible to discern in more detail the phases of development of material culture, the territorial
distribution and mutual, as well as differences within a single community. Also, the trade networks or
traces of individual mobility point to preferred areas of contact and exchange, placing thus the local
communities within the regional context.
The data suggests a much more complex picture than the usually accepted idea of identifying
all the inhabitants of a specific area with the ethnic identities mentioned in ancient sources, the Iapodes
and Liburni in particular. On the basis of the results of the distribution analysis of typical dress
elements or their combinations and other specific traits of a single community, this obsolete view is
critically reviewed in the light of current approaches to the problems of identity. The differences in
social, historical or even geographical conditions that shaped this identities also influenced the
proceeding of the Romanisation process.
The final result presented is, thus, that of a revised chronology that enables a better
understanding of the development of the autochthonous communities and elucidates the various
influences that were finally incorporated in their identity.
Contacts et échanges entre Grecs et Gaulois en moyenne vallée du Rhône au VIe - Ve s.
av. J.-C.: Les apports de l’étude de la céramique peinte à pâte claire.
Cécile MOULIN : ENS Lyon, UMR 5189 HiSoMA/ 7 rue Raulin, 69007 Lyon, France/
La question des contacts, des relations et des échanges concernant les populations grecque et
gauloise en moyenne vallée du Rhône à la fin du premier âge du Fer (VIe et Ve s. av. J.-C.) est au cœur
d'un travail de thèse débuté à l’automne 2014.
La moyenne vallée du Rhône au premier âge du Fer incarne l'aire géographique privilégiée des
contacts et des échanges entre ces deux peuples. En effet, dès le VIIe s. av. J.-C., le mobilier retrouvé
en fouilles attestent la présence grecque en Gaule. Après la fondation de Massalia en 600 av. J.-C., ces
contacts vont devenir de véritables échanges à la fois économiques, culturels, politiques et sociaux,
mesurables à partir de l'étude de la céramique. Plus particulièrement, la céramique peinte à pâte claire
incarne le mobilier le plus à même de traduire ces différents échanges. De fabrication gauloise, il s'agit
d'une céramique dite "hybride", mêlant des techniques de fabrication (le montage au tour ou au
colombin), des formes de vases (les oenochoes, skyphos et urnes) et des décors issus des deux cultures.
L'étude de cette céramique peut nous renseigner sur les différents circuits commerciaux et
points d'échanges utilisés le long de la Vallée du Rhône. Pour cela, l'apport de sciences "dures" à notre
étude nous permet de dépasser une simple étude typologique. La comparaison d'échantillons de pâte
29
céramique pour cinq sites présentés dans le cadre de la thèse (Lyon (69), Soyons (07), Crest (26), Le
Pègue (26) et le Mourre de Sève (84)) est pour nous le moyen de comprendre les interactions des
différents sites entre eux. Dans un premier temps, ces comparaisons s’établissent d'un point de vue
pétrologique puis, des analyses physico-chimiques viennent caractériser les différentes fabriques
présentes sur ces sites. Ainsi, les aires de répartition peuvent également être mesurées et une nouvelle
géographie économique et culturelle de la moyenne vallée du Rhône pourra voir le jour.
Reconstructing of Early Iron Age pathway models in Southwest Germany and the
Alsace.
Franziska FAUPEL : Institut für Ur- und Frühgeschichte, Universität Kiel, Christian-Albrechts-
Universität/ Johanna-Mestorf-Straße 2-6, 24118 Kiel, Germany/ [email protected]
Based on the results of the research project “Siedlungshierarchien und kulturelle Räume” by
the German Research Foundation (SPP 1171), which showed the complex and heterogeneous cultural
area of the Early Iron Age in Southwest Germany (Baden-Württemberg), now the investigation of
infrastructure, interaction models and distribution systems during the Early Ion Age of the Alsace and
the Upper Rhine should take place. Cultural Mapping of the Early Ion Age in Southwest Germany
suppose the Upper Rhine as a main communication corridor. Precise questions of the location of
routes, infrastructure and distribution remain unanswered. This presentation is limited to modelling
and reconstructing the Pathway of the Early Iron Age as a starting point for further research on
infrastructure, cultural distances and cultural morphology of the study area.
In absence of modern communication techniques in prehistoric times, communication stuck to
travelling routes. Frequently used tracks are a result of intensive interaction-relationships, so the traffic
system or transportation system is closely correlated to the interaction-system. Basing on the location
of settlements and cemeteries an empiric pathway model will be reconstructed. This is based on the
assumption that grave mounds are located near routes. Now this empirical model has to be compared
to other theoretical models, in order to determine which conditions could fundamental for the specific
location of the routes. These theoretical models are mainly “Least-Cost-Path” Analyses. Additionally
other parameters than elevation models can be integrated like “Least-Cost-Path if walking is intended”
in contrast to a “Least-Cost-Path if driving is intended”, or good visibility in contrast to bad visibility,
preference of high levels or routes alongside river plains. Comparing these theoretical models with the
empirical model shows which theoretical models correlated best in order to distinguish the most likely
parameters.
The influence of interaction to the location of routes can be estimated in a second step of
research. It will include investigations of cultural distance and will help to reconstruct interaction
systems. A better understanding in traffic of goods and pathways of interactions will lead to a better
understanding in distribution, during the Early Ion Age.
Incoronata (Italie) : la production céramique entre indigènes et Grecs au VIIIe - VIIe s.
av. J.-C.
Clément BELLAMY : Université Rennes 2, Laboratoire Archéologie et Histoire Merlat (LAHM,
UMR 6566)/ Place du recteur Henri Le Moal CS 24307, 35043 Rennes cedex, France/
Mathilde VILLETTE : Université Rennes 2, Laboratoire Archéologie et Histoire Merlat (LAHM,
UMR 6566)/ Place du recteur Henri Le Moal CS 24307, 35043 Rennes cedex, France/
30
L’Incoronata (Italie) est un site majeur de l’âge du Fer sud-italien et méditerranéen.
Caractérisé d’abord par une occupation exclusivement indigène au VIIIe siècle av. J.-C., marquée par
des aménagements remarquables, de riches nécropoles et une production céramique notable in loco.
C’est ce contexte particulier qui voit l’arrivée de migrants égéens dès le début du VIIe siècle av. J.-C.
sur l’une des collines de l’Incoronata. Cette installation détermine une phase de coexistence entre
Grecs et indigènes, se manifestant dans la production céramique et ses structures associées, ainsi que
dans la sphère rituelle.
Ce contact continu et cette collaboration sur le plan artisanal, assez récemment reconnus sur
un site auparavant caractérisé dans les recherches précédentes par une forte dichotomie entre les
composantes grecques et indigènes, méritent d’être explorés sous différents prismes, capables de
rendre plus compréhensibles les modalités des interactions vécues.
Ainsi, une relecture historiographique critique des précédentes recherches s’est avérée
nécessaire afin de mieux appréhender les perspectives d’étude de ce phénomène. La céramique
constituant le principal témoin archéologique, il est important d’envisager son étude sous des aspects
divers, par le biais donc de la multidisciplinarité. Ont ainsi été mises à contribution et croisées des
études classiques basées sur la classification typo-chronologique et la technologie, des analyses
physico-chimiques sur le matériau céramique et des analyses archéomagnétiques sur les structures de
production, ainsi que la mise à profit des analogies tirées de l’anthropologie et de l’ethnologie.
La convergence de ces domaines d’études, complémentaires, permettent d’offrir une lecture
plus précise des relations entre Grecs et indigènes entre VIIIe et VIIe siècles av. J.-C., plus seulement
dans une optique helléno-centriste, mais dans le cadre plus large des relations internationales mises en
place autour du monde méditerranéen, entre deux « champs chronologiques » a priori distincts que
sont la Protohistoire et le début de la période archaïque, et qui s’interceptent ici, s’annulant presque
pour offrir la place à un nouveau champ épistémologique.
POSTERS
Approche diachronique des « pierres à cerfs » de Tsatiin Ereg (Arkhangaï, Mongolie) et
de la diffusion de ce style artistique au travers des peuples scythes.
Clémence BREUIL : Université Toulouse 2 Jean Jaurès – TRACES/ 5 allée Antonio Machado, 31058
Toulouse cedex 9, France/ [email protected]
Approche diachronique des "pierres à cerfs" de Tsatsiin Ereg (Arkhangaï, Mongolie) et de la
diffusion de ce style artistique au travers des peuples scythes
Les pierres à cerfs sont des stèles funéraires dont les plus anciennes sont datées de l'âge du
Bronze. Près de 800 stèles se répartissent de la moitié nord de la Mongolie à deux régions
méridionales de la Sibérie, la Touva et la Bouriatie, mais également jusque dans l'Altaï à la frontière
avec le Kazakhstan. Mes travaux de recherche sont réalisés sur le site de Tsatsiin-Ereg, en Arkhangaï,
où la mission anthropologique conjointe Monaco-Mongolie a recensé plus d'une centaine de stèles.
La production et le remploi des pierres à cerfs, toujours à destination funéraire, se poursuit
durant l'âge du Fer jusqu'aux invasions turcs de la Mongolie. Les deux exemples les plus connus de
remploi de stèle à l'âge du Fer sont les tombes gelées scythes de Pazyryk et d'Arzhan. Le matériel sorti
de ces tombes se trouve dans un état de conservation exceptionnel et donne un aperçu assez large de
l'art nomade en général.
Les thèmes iconographiques et le style de l'art nomade qui se développent à l'âge du Fer, prend
ses racines dans des manifestations graphiques plus anciennes que l'on retrouve notamment sur les
pierres à cerfs. La diffusion géographique et diachronique de l'art des steppes, jusqu'en Europe, tient
un rôle primordial dans la cosmologie des peuples scythes et dans leur influence sur le monde oriental.
31
L’île d’Elbe et la Corse à l’âge du Fer : comprendre la connexion transtyrrhénienne.
Marine LECHENAULT : UMR 5189 HiSoMA, 7 rue Raulin, 69007 Lyon, France/
Si les recherches récentes ont apporté un éclairage neuf sur l’âge du Fer en Corse méridionale
et le rapport à la Sardaigne nuragique, les sociétés du nord de l’île demeurent largement méconnues.
Les données disponibles illustrent une parenté économique et culturelle avec la Toscane, à définir en
finesse. C’est dans cette optique que des prospections et des fouilles sont conduites depuis 2013 dans
le Cap Corse. Or, un effort similaire est mené de l’autre côté de la mer Tyrrhénienne, sur l’île d’Elbe,
par le groupe de recherches italien "Aithale" (Pise, Florence, Sienne, Foggia). L’enjeu est désormais
de connecter les deux dynamiques, française et italienne. La synergie recherchée vise à comprendre la
connexion "Corse-archipel toscan" dans ses aspects économiques (mobilités humaines et matérielles)
et culturels (approche comparative des faciès). La communication présente les travaux en cours et les
perspectives, avec une insistance particulière sur le défi méthodologique que l’étude des populations
protohistoriques tyrrhéniennes peut représenter.
32
SESSION 6 :
MOBILIERS : APPORTS ET INTERPRETATIONS / THE ARCHEOLOGICAL MATERIAL :
CONTRIBUTIONS AND INTERPRETATIONS
Traces d’utilisation et mutilations sur les armes laténiennes : l’exemple des armes du
site de La Tène conservées au Laténium.
Guillaume REICH : 1-Université de Strasbourg, UMR 7044, 4 rue Blaise Pascal, 67400 Strasbourg,
France/ Université de Neuchâtel, Institut d'Archéologie Préhistorique, Avenue du 1er mars 26, 2000
Neuchâtel, Switzerland/ [email protected]
Ce travail se propose d'étudier la principale collection d'armes du site de La Tène (armes de
poing, armes d'hast, armes de jet) sous l'angle de la tracéologie. Les armes de la collection du
Laténium, si elles montrent un état de conservation variable d'un objet à l'autre, sont dans l'ensemble
remarquablement bien préservées par la taphonomie, du fait de l'anaérobie. Les objets sont parfois
recouverts d'une simple patine, proche de l'aspect original de l'artéfact. L'approche, relativement
originale, est basée sur un croisement disciplinaire entre l'analyse typochronologique, et des méthodes
moins exploitées dans le cadre de l'étude de la guerre chez les Celtes : l'archéologie expérimentale, la
comparaison avec d'autres cultures anciennes ou encore les sciences forensiques. Cette investigation
tente de savoir s'il est possible, à compter de traces visibles sur les objets du site éponyme, mais
également observables sur d'autres sites archéologiques laténiens, d'éclairer la question des traces de
destructions sur les armes. Ces dernières sont-elles plutôt imputables à des actes rituels volontaires,
comme dans le cas de Gournay-sur-Aronde, ou faut-il y voir les stigmates accidentels de combats ?
Nous formons le vœu, non pas de trancher définitivement la question de la fonction de l'énigmatique
site de La Tène, mais d'apporter quelques pistes de réflexion sur l'interprétation du site (sanctuaire,
trophée militaire...).
L’esthétique au quotidien dans l’âge du Fer européen : pour une nouvelle approche de
l’art laténien.
Gadea CABANILLAS DE LA TORRE : Departamento de Prehistoria y Arqueología, Universidad
Autónoma de Madrid/ Facultad de Filosofía y Letras, Campus de Cantoblanco, Ctra. De Colmenar km
15, 28049 Madrid, Spain/ UMR 8546 CNRS/ENS-Paris, Archéologie et Philologie d’Orient et
d’Occident (AOROC)/ École normale supérieure, 45 rue d’Ulm, 75230 Paris cedex 05, France/
La recherche traditionnelle sur l’art laténien s’est concentrée sur le mobilier métallique et les
décors figurés, ainsi que sur l’adoption d’éléments provenant de Méditerranée. Les objets et les
contextes analysés dans le détail forment ainsi un corpus très restreint constitué par un nombre
modeste de sites car on ne retient souvent que les tombes les plus riches. De manière plus ou moins
explicite, on adopte souvent une définition restrictive de l’art dit celtique, limitée à des biens de
prestige, et l’on attribue en général ces créations aux désirs et aux commandes des élites, aux ateliers
dépendants de l’aristocratie. Cette interprétation a façonné une image des sociétés européennes à l’âge
du Fer où les élites semblent seuls meneurs et acteurs de tout mouvement économique, politique,
religieux, culturel et donc artistique.
Exemples à l’appui, il s’agit ici de jeter un regard nouveau sur des matériaux et des ensembles
considérés comme marginaux, en particulier la céramique décorée par estampage. Cette catégorie de
33
mobilier peut être rattachée à l’art laténien de par le répertoire de motifs employés, les compositions
auxquelles ils participent et les ressources visuelles mises en œuvre. En examinant les contextes
d’apparition, on s’aperçoit alors que l’art laténien participe d’un phénomène plus vaste, l’émergence
d’une culture visuelle commune, pas nécessairement réservée exclusivement aux élites, dans de
nombreuses régions européennes à l’âge du Fer.
Dès lors que l’on considère les matériaux non nobles comme la céramique, le bois, le cuir et le
textile comme des supports de l’art laténien, de nombreux exemples ethnographiques montrent que les
objets de ce type, et en particulier la céramique décorée et les images qu’elle porte peuvent être
produits, communiqués et sélectionnés en dehors des circuits communément admis pour l’art celtique.
One ring to bind them all ? New approaches on the meaning of torques in the Late
Hallstatt and Early La Tène Period.
Imke WESTHAUSEN : Institut für Vor- und Frühgeschichtliche und Provinzialrömische Archäologie/
LMU München, Frankfurter Ring 34, 80807 München, Germany/ [email protected]
Many statements and assumptions about the torque as an indicator of social status and/or
prestige exist, but only few actual researches on this topic. Because of that, I chose to make it to an
aspect of my Magister dissertation from 2012 about torques of the Late Hallstatt and Early Latène
Period, their typology, extension and dating.
About 300 graves of probable closed association with torques and about 20 so called “Princely
Graves” with gold torques from the Late Hallstatt and Early Latène Period from Baden-Württemberg,
Alsace and the Swiss Plateau were used as a material basis. The graves were analysed and compared
in context of age, sex and gender, and composition of the grave goods. In general as well as assorted
after the different types, materials, dating of the torques and environment. My researches led to some
new conclusions and also confirmed and proved some old, as well as they disproved some others.
Some results are not as surprising such as the bronze torques being clearly a part of the female
period costume. On the other hand, the few eye-catching male burials with bronze or iron torques
from Ha D1 are possibly the equivalents to the later gold torques and “Princely Graves”, because they
are very well equipped with grave goods. In Ha D2 and Ha D3 the number of burials with torques in
general is noticeable higher near “Princely Graves” or near an associated “Princely Sites”, also in
particular children’s burials with torques. Massive and closed Torques with a diameter less than 20 cm
are found in adult burials as often as in children’s burials. Especially in the Hallstatt Period, they are
conspicuously often found in female burials with gold, amber and gagate and in the already mentioned
male burials. Their small diameter and closed form shows that they had to be pulled over the head in
children’s age. Maybe these torques were an insignia of a special social class, in which one was born
or introduced at a very young age. In the Asperg region in Baden-Württemberg an aborted
examination of the mitochondrial DNA of the skeletons of the local “Princes” and skeletons from
associated burials (position or furnishing) possibly suggests that bearer of these neck rings were
related to the “Princes”.
Despite the antique description of the torque as a characteristic attribute of the Celtic warriors,
there is only very little evidence for that in the Early Latène Period because only three graves
contained both torques and any kind of weapon, and in none of the other Latène burials the skeleton
was certainly anthropological identified as male. Only to mention a little excerpt of my results.
34
Bird-ships, hot springs, metal vessel and Apollo - same symbol, different meaning ?
Roxana MORTEANU : University of Bucharest, Faculty of History/ 7 Teilor street, Piteşti, Romania/
Representation of water birds may be found during Bronze Age and at the beginning of Iron
Age on various types of objects, being shown either similar to their real form or stylized, with various
associated motives. In my PhD paper “The Water bird symbol. Origin, evolution and interpretations” I
intend to approach different issues concerning water bird symbol and to search possible explanations
and answers to several questions related to all circumstances in which this symbol was used. My
purpose is to research through this PhD paper as many contexts as possible in the interest of recreating
possible past sequences, in which water birds have played a significant role. By associating
archaeological data with ancient literary sources and also by trying to take into consideration the
environment in which a Bronze Age individual lived and by trying to understand his preoccupations,
my attempt is focused on bringing new perspectives in interpreting the role that this symbol might
have had.
Initially, especially during Middle Bronze Age, their representation was in the form of
ceramics – they were shown as askoi or bird shaped bowls along the Danube and its tributaries. At the
end of Bronze Age and the beginning of Iron Age, water birds representations were associated to metal
objects. They appear next to solar and water symbols, with boats as a means of sun transportation,
known in the literature as Vogelsonnebarke. Actual representations are on the Hajdúböszörmény type
situlae, dated in HaB1, which can be found around the entire European area.
In order to offer an interpretation for water birds represented on metal vessels, I will first focus
on the discovery context (some problems concerning the landscape in which these vessels were made
and manipulated, the materials selected for creating them, the role of a water bird, objects associated,
etc.). There are two variants of main interpretations: The ones related to the sun’s route on the sky
(formulated especially by F. Kaul) and the ones related to Apollo the Hyperborean (information
offered by Greek and Latin sources: the swans may predict death or may bring prophecies; upon
Apollo’s birth they surround Delos 7 times; Apollo was tied by Hyperboreans in the country of which
he retreated part of the year and who came in a group of 7 in order to bring gifts to Delos; Apollo’s
chariot was drawn by swans). I will also try to show some connections between the water bird, hot
springs and god Borvo, because many Hajdúböszörmény type situlae are found in the vicinity of
thermal or mineral waters. Water bird representations could have had different significance from one
area to another. Moreover, beside the religious interpretations we should follow other qualities and
attributes these birds might have had (like the fact that the representations ships with two bird heads
placed towards opposite directions can suggest the idea of moving in both direction).
POSTERS
Le choix, très sélectif, des importations grecques et romaines dans le monde celtique,
entre 250 et 25 av. J.-C.
Aurélia FEUGNET : AOROC – Celtes et Étrusques, UMR 8546 (3e étage, escalier A)/ École normale
supérieure, 45 rue d’Ulm, 75230 PARIS Cedex 05, France/ ArScAn – Archéologies
environnementales, UMR 7041/ Maison de l'Archéologie et de l'Ethnologie, 21 allée de l’Université,
92023 Nanterre cedex, France/ [email protected]
Mon travail de thèse porte sur le choix, très sélectif, des importations grecques (monnaies,
alphabet) et romaines (amphores, vaisselles céramiques et métalliques) dans le monde celtique (limité
à l’espace resté politiquement indépendant de l’imperium romain à la fin du IIe s. av. n. è.), entre 250
35
et 25 av. n. è. Il est ici question de présenter les premiers résultats obtenus sur la répartition de ce
mobilier d’importation dans les contextes indigènes. Le travail de cartographie, de même que l’analyse
des contextes permettent de mieux appréhender l’utilisation de ces biens exogènes : dans les pratiques
économiques, politiques, et/ou cultuelles. Une attention toute particulière est portée à la fonction des
contextes de découverte et à la datation de ce mobilier, sans toutefois prétendre atteindre l’exhaustivité
d’un corpus exigeant car abondant, hétérogène et jamais constitué auparavant à une telle échelle.
Ainsi, ce sujet de recherche, permet de faire converger trois axes méthodologiques.
En effet, il s’inscrit dans le contexte très abondamment étudié des relations d’échanges entre
Celtes d’un côté et Grecs et Romains de l’autre, afin d’identifier les comportements indigènes vis-à-
vis des influences politiques et sociales méridionales à la veille de l’intégration dans l’empire romain.
Il permet aussi, à l’aide d’outils cartographiques, de préciser le rôle des contraintes géographiques
dans la dynamique des réseaux d’échange. Enfin, l’exploitation des textes antiques et des sources
linguistiques, dont les toponymes et les données épigraphiques, permettent de replacer les apports de
la culture matérielle dans une dimension sociologique et historique plus globale.
Avec l’ambition de présenter un travail relativement avancé au cours de ces journées, il sera
ainsi possible de dégager les tendances lourdes de cette approche de la sélection des biens
méditerranéens importés dans le monde celtique laténien.
Tankards of the British Late Iron Age.
Jonathan HORN : Edinburgh University/ 3f2, 4 Brougham Place, EH3 9HW Edinburgh, United
Kingdom/ [email protected]
Iron Age tankards are stave built wooden mugs completely covered or bound in copper-alloy
sheet. The distinctive copper-alloy handles of these vessels display intricate ‘Celtic’ or La Tène art
styles. These vessels feature prominently in the material record of Late Iron Age Britain. They are
characterised by their often highly original designs, complex manufacturing processes and variety of
find contexts. Since Corcoran’s original study was published in volume 18 of the Proceedings (1952a),
a systematic and detailed analysis of this object type has not been undertaken. New evidence from the
Portable Antiquities Scheme and recent excavations have more than quadrupled the number of known
examples (126 currently). It is therefore necessary and timely to re-examine tankards, reintegrating
them into current debates surrounding material culture in later prehistory. Tankards originate in the
later Iron Age and their use continued throughout much of the Roman period. As such, their design
was subject to varying influences over time, both social and aesthetic. Their often highly individual
form and decoration is testament to this fact and has caused issues in creating a workable typology for
this object group in the past (Corcoran 1952a; 1952b; 1957; Spratling 1972; Jackson 1990). A full
examination of the decoration, construction, wear and repair, dating and deposition contexts will allow
for a reassessment of the role of tankards within the social and cultural milieu of later prehistoric
Britain.
Découverte d’une sculpture en pierre de l’âge du Fer à Arzheim (Lkr. Landau in der
Pfalz, Rhénanie-Palatinat) - La chronologie et chorologie de la sculpture
anthropomorphe en pierre en Europe centrale.
Wolfram NEY : Johannes Gutenberg Universität Mainz, Institut für Vor- und Frühgeschichte/
Waldstraße 5, 55411 Bingen am Rhein, Germany/ [email protected]
36
Une tête en grès en grandeur nature utilisée pour la construction d'un mur d'une grange a été
découverte en 1988 à Arzheim. C'est l'un des rares exemplaires de la sculpture anthropomorphe en
pierre de l'âge du Fer en Allemagne, où on a trouvé - contrairement à la France - seulement une
vingtaine d'objets. Le sujet central de cet exposé est la découverte récente de la tête en pierre
d'Arzheim, qui n'était pas encore publiée, de même que la tête déjà connue de Freinsheim, qui est très
similaire. En raison de mauvaises circonstances des découvertes, il fallait entreprendre une datation
stylistique qui est principalement basée sur la coiffure caractéristique des deux têtes, dont une bande
de cheveux traverse le front d'une oreille à l'autre. En plus de la classification, la documentation des
deux sculptures est expliquée à l’aide d’un scan en 3D, réalisée avec la participation de l’école
supérieure spécialisée de Mayence. Un avantage de cette méthode est le traitement soigneux de l’objet
original, parce qu’il s’agit d’un procédé sans contact. Grâce à un logiciel approprié les modèles
peuvent être regardés en 3D, être représentés en coupe à chaque partie des têtes, éclairés par des
sources lumineuses différentes et mesurés dans le détail. La fabrication d'une réplique à l'échelle à
l'aide d'une imprimante 3D est aussi réalisable. En outre, la communication présente la chronologie et
chorologie de la sculpture de l'âge du Fer en Allemagne et en France, ainsi que quelques groupes
d'objets qui en résultent.
À l'aide des comparaisons stylistiques la datation proposée des têtes à la fin de la phase LT C à
LT D est une nouveauté absolue dans la région sud-ouest de l'Allemagne parce qu'on a supposé
jusque-là que la coutume de fabriquer des sculptures en pierre de grand format a fini au début de la
période La Tène moyenne.
Nouvelles données sur la statuaire protohistorique anthropomorphe en Bourgogne.
Pierre-Antoine LAMY : Université de Bourgogne, UMR 6298 ArTeHiS/ 6 boulevard Gabriel, 21000
Dijon, France/ [email protected]
Après un demi-siècle de découvertes majeures, le corpus de la statuaire protohistorique ne s'est
pas considérablement étoffé. Aujourd'hui, force est de constater la primauté d'autres artisanats sur
celui de la pierre, que ce soit au Premier ou au Second âge du fer.
Mais ce constat doit être nuancé par la méconnaissance qu'ont encore les chercheurs de la
chronologie de la statuaire protohistorique, surtout dominée par les productions du début et de la fin de
la période laténienne. De plus, le cloisonnement de la recherche entre Protohistoire et Antiquité a sur
ce sujet inhibé les échanges des spécialistes des deux époques. On reconnaîtra à J.-J. Hatt le grand
mérite d'avoir tenté une réunion au travers de son Esquisse d'une évolution de la sculpture en Gaule
depuis le VIe s. av. J.-C. jusqu'au IVe s. ap. J.-C. Cependant, le nombre limité d'objets étudiés ainsi
qu'une conception méliorative des arts celte et romain ont desservi l'ambitieux travail du savant.
Deux synthèses doivent être notées depuis : celle de P.-P. Bonenfant et J.-P. Guillaumet puis
celle d'A. Duceppe-Lamarre, aux limites géographiques et chronologiques plus larges. L'approche
chronologique du style et de l'iconographie s'en est trouvée enrichie. C'est à la lumière de ces travaux
récents qu'il convient d'opérer un réexamen des éléments de statuaire mis au jour en Bourgogne, plus
spécifiquement sur le territoire qui sera celui des Éduens. On en dénombre une dizaine, remarquables
par leur disparité les uns des autres : le cippe le plus modeste côtoie ainsi la statuaire colossale. Ces
différences sont bien évidemment imputables à un arc chronologique important : la plus ancienne stèle
est datée du début du Ve s. av. J.-C. tandis que la réalisation de la plus récente précède de peu la
conquête romaine.
Quelques parallèles stylistiques seront esquissés dans ce poster. Il sera enfin brièvement
question de méthodologie, puisqu'un examen critique a permis d'identifier un faux probable qui sera
présenté à cette occasion.
37
SESSION 7 :
TRANSITIONS ET PROBLEMATIQUES TRANSITOIRES / TRANSITIONS AND TRANSITIONAL ISSUES
Topophilia and the emergence of late prehistoric sanctuaries.
Zoran ČUČKOVIĆ : Université de Franche-Comté, UMR 6249 Chrono-environnement/ 18 rue
Chifflet, 25000 Besançon, France/ [email protected]
In a definition given by geographer Yi Fu Tuan « Topophilia is the affective bond between
people and place or setting ». Even though this concept pertains to an intimate « sense of place »
which may seem unattainable by archaeological means, it can be very useful in consideration of
historical dimension in the emergence of particular places, such as prehistoric ritual areas or
sanctuaries.
Several major categories of ritual places can be considered: natural places used for deposition
of artefacts (caves, rivers, wet areas) burial places, particular structures within settlements, and finally
sanctuaries stricto sensu with enclosed space and a shrine. Each of these categories can be regarded as
a different spatial strategy inasmuch as it results in spaces with high symbolic storage. However, such
places normally emerged through long term temporal sequences and, at least before the La Tène
period, without an obvious plan from the outset.
In the proposed communication several examples of Late Bronze to Early Iron Age ritual
places or sanctuaries from the eastern Adriatic area (Croatia, Bosnia and Herzegovina and Slovenia),
as well as from the wider central European area, will be considered. Particular attention will be paid to
the temporal dimension, not only in terms of chronology but also in relation to practices of formation
and maintenance of collective memory. This perspective enables to understand better the process of
emergence of ritual places (as opposed to a premeditated design). For instance the ritual place at
Turska Kosa in Croatia emerged through centuries of ritual activities on a small necropolis However,
such a development was made possible only in accordance with overall spatial strategies which are
reflected in the organization of settlements or wider inhabited territories, i.e. certain attachment to
fixed places.
Romanisation de la vie quotidienne : apport de l’étude de l’instrumentum de type
italique.
Clémentine BARBAU : Université de Strasbourg, UMR 7044 Archimède, MISHA/ 5 allée du Général
Rouvillois, CS 50008 67083 Strasbourg Cedex, France/ Université de Lausanne, ASA, Switzerland/
La période de transition entre la fin de l’âge du Fer et le début de l’époque romaine en Gaule
s’accompagne de diverses transformations culturelles du cadre de vie des populations gauloises. Ce
processus de mutation que l’on appelle traditionnellement « romanisation » se manifeste de diverses
manières : importations et imitations de céramiques italiques, transformations des techniques
architecturales… Hormis ces aspects, l’étude de l’instrumentum de type italique permet d’appréhender
le phénomène sous un angle inédit, mettant l’accent sur le quotidien des populations et sur les divers
comportements des populations réceptrices. En effet, durant les deux derniers siècles avant J.-C., on
voit apparaitre dans les corpus gaulois des objets appartenant à la culture matérielle italique tels que
des bagues à intailles, des ustensiles de toilette, des instruments de l’écriture, des lampes à huile, de la
vaisselle de bronze. Comment sont reçus ces objets dans les différents contextes de Gaule ? Que
38
signifie l’intégration de ces objets dans la culture matérielle gauloise, en termes d’acculturation ? Peut-
on percevoir plusieurs niveaux de romanisation ?
L’analyse typologique et contextuelle de ces objets permettra de proposer un éclairage
nouveau des modalités chronologiques et géographiques du phénomène de romanisation. L’accent sera
également mis sur les aspects sociologiques qui sous-tendent ce processus de transformations
culturelles qui touche la société gauloise.
Vaisselle métallique en Gaule Belgique à la veille de la Conquête : répartition spatiale et
perspectives de recherche.
Quentin SUEUR : Université Lumière Lyon 2/ 7 rue Raulin, 69365 Lyon cedex 7, France/ MOM-
Archéométrie, Tübingen, Germany/ [email protected]
Présentation d’un corpus comprenant la vaisselle italique importée et les productions locales
entre Seine et Rhin. Travail de recherche réalisé dans le cadre d’une cotutelle de thèse entre les
universités Lyon II et Tübingen sur le thème de la vaisselle métallique comme marqueur de
Romanisation en Gaule Belgique. L’inventaire systématique des pièces de vaisselle découvertes en
Gaule Belgique et leur distribution souligne les diversités culturelles à la veille de la Conquête. Ainsi
la répartition géographique de pièces d’importation, telles que les cruches de type « Kelheim » ou les
poêlons « d’Aylesford », met-elle en évidence les contacts étroits entre Rome et certains peuples de
Gaule comme les Rèmes ou les Trévires. De même, la présence certaines formes en contexte funéraire
plutôt qu’au sein de l’habitat, peut être révélatrice d’une fonction ou d’un statut. L’objectif de cette
communication, en présentant ces données de manière systématique, est donc, avant tout, de soulever
des interrogations, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de recherche.
POSTERS
Caeruleum et Cinnabaris : décors pré-romains et romains précoces sur le territoire des
Eduens, des Lingons et des Sénons.
Nicolas DELFERRIERE : Université de Bourgogne, UMR 6298 ArTeHiS/ 6 boulevard Gabriel,
21000 Dijon, France/ [email protected]
Plusieurs études récentes, notamment celles issues de la première table ronde sur les enduits
muraux pré-romains en Gaule, à Soissons en mars 2014, fournissent de nouvelles données sur les
décors pré-romains et les décors précoces en Gaule, permettant de mieux comprendre les techniques,
les pigments et les compositions ornementales utilisées à l’âge du Fer.
Le territoire géographique étudié, les citées des Eduens, des Lingons et des Sénons, présente
des vestiges de ces décors pré-romains et romains précoces entre le Ve s av. J.C. et le début du Ier
siècle (ex : Vix, Batilly-en-Gâtinais et Bibracte). Il s’agit donc d’appréhender ces vestiges, souvent
très fragmentaires, dans leur contexte, de comprendre les structures porteuses de ces décors, et
d’envisager les matériaux et les techniques mises en œuvre en fonction des contextes et des périodes.
La place des analyses physico-chimiques dans le cadre de l’étude de ces décors est également à
présenter.
39
The Celtic-Roman transition in the Rhaetian Alps and the alpine foreland - A
zooarcheological perspective.
Simon TRIXL : Institut für Paläoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin
der LMU/ München, Kaulbachstraße 37/III, 80539 München, Germany/
Despite longstanding research the transition from late Iron Age to Early Roman periods in the
Northern alpine region and the alpine foreland is a topic still controversially discussed in several
aspects. For a long time, only few sites dating to Latène D2 were known. For that reason, a hiatus of
land use at the end of the Iron Age was assumed. During the last decades, an increasing number of
settlements of the latest Celtic and earliest Roman period has been discovered. The subproject
“Population and livestock in the Rhaetian Alps and alpine foreland of the 1st century AD“(principal
investigators: Prof. Dr. Dr. J. Peters, Dr. B. Steidl) of the DFG-Research-Unit “Transalpine mobility
and cultural transfer“ aims at the question of continuity from an interdisciplinary point of view. In
close cooperation archaeology, prehistoric anthropology, zooarchaeology, palaeobotany, and
archaeometry acquire a general view of the development during the decades around the turn of the era
in the later province of Rhaetia. A special focus is on the Heimstetten Group (c. 30 – 60 AD):
Differing from the Roman-Mediterranean culture of the urban settlements in many respects, these
people could be an indigenous population.
Zooarchaeology investigates whether livestock developed continuously and in which way
autochthonus animal breeding strategies were influenced by the Romans. In addition to alterations in
the economic importance of single species, herd management and carcass processing, new trends in
stockbreeding can be evidenced by size-development of livestock species. These analyses are based on
animal bones recovered from Roman settlements and those of the Heimstetten Group. Furthermore the
study includes bone material from late Iron Age sites of the research area. This allows reconstructing
animal husbandry in the decades around the turn of the era.