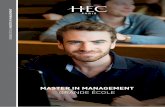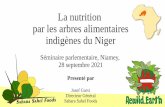Relations entre femmes dans l’Alger colonial : Henriette Benaben (1847-1915) et son école de...
-
Upload
univ-paris5 -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Relations entre femmes dans l’Alger colonial : Henriette Benaben (1847-1915) et son école de...
147Relations entre femmes dans l’Alger colonial | Rebecca Rogers
En français : « Madame Luce Benaben, née Henriette Belly. Elle consacra sa vie à l’art musulman et à la bienfaisance envers la femme indigène. 21 février 1847-9 mars 1915 ».
En arabe : « Ici repose Madame Luce Benaben, directrice de l’ancien bureau des arts arabes d’Alger, décédée à Alger en mars 1950. Que dieu l’accueille dans son vaste paradis ».
C ette épitaphe, en français et en arabe, sur un tom-beau abandonné depuis des années au cimetière Saint-Eugène d’Alger témoigne d’un moment
Relations entre femmes dans l’Alger colonialHenriette Benaben (1847-1915) et son école de broderies « indigènes ».
Cyber Shéhérazade 4 Ammar Bourras
Rebecca Rogers
148G&C |Articles Relations entre femmes dans l’Alger colonial | Rebecca Rogers
148
spécifique dans l’histoire coloniale algérienne. Il évoque les rapports entre une Française et ses consœurs « in-digènes ». Il parle d’art musulman apprécié et préservé par cette même femme. Mais il n’efface pas pour autant les traces de la domination coloniale, car il est bien ici question d’un rapport de patronage. Fort symboliquement d’ailleurs, le tombeau se trouve dans le cimetière réservé aux Européens. Les mots choisis, en français et en arabe, suggèrent toutefois des formes de compréhension mutuelle, voire des complicités partagées. Ce n’est pas un hasard si Henriette Luce Benaben a choisi de se faire enterrer dans un tombeau de style musulman. Il faut alors interpréter ce face-à-face entre l’écriture arabe et latine, s’interroger sur les différences entre les deux inscriptions et sur l’erreur de datation dans le texte arabe1. Il est en effet tentant d’y voir la preuve des complexités d’un « monde du contact » qui fait actuellement débat chez les historiens2. Comment en effet comprendre les interactions entre les populations qui se côtoyaient dans l’Algérie coloniale ? De quelle manière l’ap-proche biographique peut-elle saisir et rendre intelligible les moments de rencontres, largement ignorés par les historiens, entre femmes « colonisatrices » et « colonisées » ?3
En s’interrogeant sur les rapports qui existaient entre femmes de communautés différentes, cet article a vocation à pour-suivre une histoire sociale de l’Algérie coloniale sous l’angle de l’histoire des femmes et du genre. Depuis plusieurs années déjà, la recherche en ce domaine a montré combien la coloni-sation n’avait pas été seulement une affaire d’hommes. Ainsi, les femmes européennes étaient venues nombreuses, dès les débuts de la conquête française en 1830, comme vivandières, couturières, enseignantes, soignantes, prostituées… ou bien comme simples épouses, comme le montre, en particulier, Claudine Robert-Guiard4. Si les Européens ont beaucoup vécu entre eux, nous savons aussi que les contacts avec les popula-tions locales, notamment dans les villes, ont été nombreux5. Dans cet article, on utilisera la figure d’Henriette Luce Benaben
149Relations entre femmes dans l’Alger colonial | Rebecca Rogers
pour exemplifier la nature des rapports, qui ont lieu pendant la deuxième moitié du xixe siècle, entre femmes européennes et « indigènes ». D’autres figures féminines sont pourtant bien plus connues des historiens de cette période, notamment la féministe socialiste Hubertine Auclert et l’écrivaine-voyageuse arabophile et musulmane Isabelle Eberhardt6. Ces deux femmes ont rédigé des récits de leurs séjours en Algérie dans lesquels s’insèrent des portraits de femmes « arabes ».7 Leurs expériences, cependant, sont celles de voyageuses qui découvrent un temps l’altérité sans que leurs actions en terre algérienne ne modifient durable-ment les rapports locaux8. Henriette Benaben a, quant à elle, peu écrit sur ses rencontres avec les femmes « indigènes » mais elle a grandi et travaillé auprès d’elles, notamment entre 1875 et 1906, quand elle tenait un atelier de broderies indigènes à Alger. En se penchant sur son parcours et ses expériences, il s’agit d’abord de s’intéresser aux rapports sociaux produits par son éducation et son travail auprès de « la femme indigène » dans les dernières décennies du xixe siècle en Algérie. Son itinéraire sera ensuite situé par rapport à ceux d’autres femmes françaises qui ont ga-gné leur vie en travaillant auprès des populations « indigènes », notamment en développant des écoles professionnelles. Par cette double approche, l’objectif est de comprendre in fine dans quelle mesure les efforts de ces femmes pour former des jeunes filles musulmanes ainsi que pour préserver des arts anciens, comme la broderie, permettent justement d’approcher et peut-être même de saisir, même partiellement, ce « monde du contact » au féminin ?
I — Henriette Luce Benaben : une « Algérienne »9 exceptionnelle ?
Née à Alger, en 1847, Henriette Belly y grandit dans une famille très en vue. Sa grand-mère, Eugénie Allix Luce, a en effet ouvert la première école pour jeunes filles musulmanes dans la capitale en 184510. Dans
Relations entre femmes dans l’Alger colonial | Rebecca Rogers150
G&C |Articles
Le tombeau d’Henriette Benaben Cimetière Saint-Eugène d’Alger Photographie de Rebecca Rogers
151Relations entre femmes dans l’Alger colonial | Rebecca Rogers
Le tombeau d’Henriette Benaben Cimetière Saint-Eugène d’Alger Photographie de Rebecca Rogers
152G&C |Articles Relations entre femmes dans l’Alger colonial | Rebecca Rogers
les années 1850, Mme Luce est une personnalité publique et son établissement fait l’objet de nombreux articles de journaux, notamment dans L’Illustration qui y traite lon-guement des activités de « cette courageuse femme » qui a su triompher « de tant de préventions » en créant une « institution si féconde en résultats »11. L’école de Mme Luce accueille en effet plus d’une centaine de filles et leur offre, en français et en arabe, des leçons de lecture, d’écriture, d’arithmétique auxquelles s’ajoutent les tra-vaux d’aiguille. À l’instar des écoles primaires en métro-pole, son établissement dispense donc les rudiments du savoir académique (lire, écrire, compter), mais propose aussi des travaux manuels et des leçons de religion, sauf qu’il s’agit ici d’islam12. Quant au deuxième époux d’Eugé-nie Allix Luce, Louis Luce, il est musicien et professeur de musique auprès de garçons musulmans, connu pour les airs arabes qu’il met en musique. La jeunesse d’Henriette est ainsi marquée par ce couple qui vit et travaille en contact constant avec les populations locales. Son propre itinéraire sera encore plus caractérisé par une volonté de proximité inscrite dans la pierre tombale de sa sépulture au moment de son décès.
1. Grandir dans la Casbah d’Alger
Située au n°7 de la rue de Toulon dans la basse Casbah, l’école de Mme Luce est aussi le lieu où grandit la jeune Henriette Belly, entourée des écolières de sa grand-mère. Son père, Félix Belly, est un ingénieur fantasque qui abandonne rapidement son épouse Marie ; celle-ci revient alors vivre chez sa mère dans la Casbah13. C’est donc par sa grand-mère institutrice que la pe-tite fille s’initie au savoir, fréquentant l’école « arabe-française » de cette dernière. Élevée avec des jeunes filles musulmanes, Henriette Belly apprend tôt la langue des colonisé-e-s. Lors des distributions de prix que Mme Luce organise, en fin d’année scolaire, pour récompenser ses élèves, elle est encouragée à se positionner comme médiatrice entre les deux cultures.
153Relations entre femmes dans l’Alger colonial | Rebecca Rogers
Ainsi, en 1854, c’est elle qui traduit en arabe, à l’attention des familles musulmanes présentes, les fables récitées en français par ses camarades d’écoles14. À l’école, Henriette apprend aussi à broder et à coudre ; les travaux de cou-ture sont censés donner des habitudes de travail aux jeunes filles et, en même temps, un moyen potentiel de vivre. Au milieu des années 1860, son père emmène Henriette, alors adolescente, à Paris et la place pendant deux années dans un pensionnat pour jeunes filles anglaises tenu par Mrs Grenfell. Elle y découvre la langue et la culture anglaises qui lui serviront tant, comme nous le verrons par la suite, une fois qu’elle sera devenue adulte. De retour dans la capitale de l’Algérie française en 1868, son chemin croise celui de Paul Benaben, un jeune ba-ryton toulousain, qui se trouve à l’affiche du théâtre d’Alger. C’est la grand-mère qui autorise le mariage. Ce dernier a lieu à Alger en mai 1869. Henriette a alors vingt-deux ans. Alexandre Dumas fils, ami de la famille Luce et futur protecteur de la fille d’Hen-riette, disait d’elle lorsqu’il l’a rencontrée à Alger dans les années 1860 : « Elle avait un rayon de soleil dans le cerveau »15.
Henriette Benaben devient rapidement mère, accouchant d’une fille, Jeanne, en 1870. Comme sa propre mère, elle ne connaîtra que peu d’années de vie conjugale et maternelle. L’époux, artiste et méridional, court les jupons ; Henriette le quitte vers 1874, avec Jeanne, pour retrouver Mme Luce et la vie de la Casbah. Cette dernière dirige, dans ces premières années du gouverne-ment civil en Algérie, un ouvroir pour jeunes filles « indigènes » – l’école ayant cessé d’exister en 1861. Quand Mme Luce décide de se retirer dans son village natal en France, en 1875, c’est à sa petite fille qu’elle confie la responsabilité de l’ouvroir. Ainsi com-mence l’engagement durable de la jeune Henriette Benaben en faveur de la promotion des femmes arabes.
2. Diriger un ouvroir
Spécialisé dans la broderie de luxe, l’ouvroir que reprend Henriette Benaben est toujours situé, comme du temps de Mme
154G&C |Articles Relations entre femmes dans l’Alger colonial | Rebecca Rogers
Luce, rue de Toulon dans la basse Casbah, près d’une autre ins-titution du même type tenue par Rosa Barroil16, mais réservée, quant à elle, à l’apprentissage de techniques plus rudimentaires de lingerie17. Au début du gouvernement civil en 1870, l’éduca-tion et la formation des femmes « indigènes » ne sont pas vrai-ment une priorité alors même qu’en France le conflit anticlérical encourage le développement d’initiatives laïques en faveur des filles18. En Algérie, cependant, la politique scolaire devient net-tement défavorable à l’éducation des filles musulmanes. En effet, est abandonnée, à cette époque, la volonté d’assimiler les « in-digènes » : politique qui était à l’origine des écoles arabes-fran-çaises ; la circulaire du 14 octobre 1867 prône à leur place des écoles primaires mixtes (élèves admis « sans distinction de race ni de religion ») qui a pour effet concret de faire chuter le nombre d’élèves musulmans et surtout de musulmanes. En 1873, on ne trouve que 356 garçons musulmans et 79 filles musulmanes sco-larisés dans tout le département d’Alger19. Ainsi l’existence de ces deux ouvroirs, qui donne une formation à une petite centaine de jeunes femmes, est-elle exceptionnelle dans le paysage algérois de la fin du Second Empire et des débuts de la iiie République20.
La plupart des œuvres où se rencontrent Européennes et femmes « indigènes » relèvent d’ailleurs plutôt de la charité. En 1873, le conseil général d’Alger21 note ainsi l’existence de sept établissements dépendant du bureau de bienfaisance musulmane, dont six sont dirigés par des femmes : une maison de refuge pour vieillards et infirmes des deux sexes ; un orphelinat pour enfants abandonnés des deux sexes ; une salle d’asile pour enfants de quatre à sept ans ; trois ouvroirs ou ateliers de charité (dont celui de Mme Luce et de Mme Barroil). Cette même année le conseil général – clairement anticlérical – retire la direction du refuge, de l’orphelinat, de la salle d’asile et de l’un des ouvroirs aux Sœurs de la Miséricorde22 pour les confier à des dames laïques, dont on ne sait pas grand-chose en l’état de la recherche23. À cette époque, il n’y a plus aucune école pour jeunes filles « indigènes » à Alger.
155Relations entre femmes dans l’Alger colonial | Rebecca Rogers
Lorsqu’Henriette Benaben reprend l’ouvroir de sa grand-mère, en 1875, celui-ci est relativement fragilisé par une ré-organisation du Bureau de bienfaisance musulmane dont il dépend. En effet, Eugénie Luce y attirait des jeunes femmes désireuses d’apprendre un métier grâce à des bourses d’ap-prentissage, financées et mises en place par le Conseil géné-ral en 1861. Un arrêté du Gouvernement général du 3 mars 1874 réorganise le Bureau et, de ce fait, les ouvroirs sont alors rangés dans la catégorie des « établissements privés », ne béné-ficiant plus de l’argent public. Ce changement sert de prétexte au Conseil général pour ne plus financer les bourses24. Ainsi la nouvelle directrice de l’ouvroir n’offre-t-elle plus, à cette date, à ses élèves-ouvrières que la perspective d’acquérir un talent sus-ceptible de leur fournir, par la suite, du travail ; et ce tout en apprenant un peu de français, ce qui est toujours utile pour le commerce.
Les mémoires de Jeanne Crouzet-Benaben, fille d’Henriette, permettent de mieux comprendre les motivations de sa mère lorsqu’elle démarre sa carrière professionnelle à Alger25. En par-ticulier, ils dessinent le portrait d’une femme ayant fait des choix de vie relativement singuliers qui l’ont rapprochée des popula-tions musulmanes qui l’entourent et qui l’ont positionnée comme une femme « libre », obligée de travailler pour subvenir à ses besoins. Ayant obtenu la garde de sa fille lors de sa séparation, Henriette Benaben abdique rapidement ses responsabilités ma-ternelles, envoyant Jeanne en France, en 1876, chez sa grand-mère, Eugénie Luce qui assurera seule sa première éducation. À Alger, elle dirige l’ouvroir et fréquente le photographe algérois, Charles Louis Klary, qui lui donne une certaine notoriété dans le milieu des photographes26. L’espoir de refaire sa vie avec lui l’éloigne un temps d’Alger et de son ouvroir lorsqu’il quitte la ville, en 1879, pour s’établir à Paris. Mais leur aventure ne dure pas. Au moment du décès de Mme Luce, en 1882, Henriette Benaben est de nouveau active à la tête de l’ouvroir qui connaît une cer-taine prospérité grâce aux commandes des étrangers américains et anglais surtout27.
156G&C |Articles Relations entre femmes dans l’Alger colonial | Rebecca Rogers
Sa fille la décrit comme une âme artiste, férue de théâtre, de musique, de littérature et de poésie et peu attentive aux conventions sociales. Lorsque son chemin se sépare de celui de Klary, elle assume avec résignation sa solitude et s’investie, de plus en plus, dans la connaissance de la broderie arabe :
« Dans le patio d’une maison arabe arrangée avec ce goût qui n’appartient qu’à elle, les petites brodeuses accroupies devant leurs métiers bas et groupées harmonieusement par ses soins formaient un tableau si gracieux qu’on venait de loin pour le voir… Petit à petit, sa situation s’améliorait, et commençait alors la période de sa vie où elle devait se révéler à elle-même comme la grande artiste, la piètre com-merçante peut-être, mais la femme de valeur et l’infatigable travailleuse qu’elle était, et finalement forcer le respect de tous »28.
Contrairement à Eugénie Luce qui a longtemps œuvré pour transmettre la « civilisation française » à ses élèves, Henriette Benaben cherche plutôt à faire découvrir l’artisanat féminin tra-ditionnel et à transmettre des techniques de broderie aux femmes qui l’entourent. Son divorce d’avec Paul Benaben, prononcé le 2 juin 1887 (trois années après le vote de la loi Naquet l’autorisant à nouveau), concrétise sa décision de vivre seule, en femme in-dépendante. À cette date, elle est bien identifiée dans le paysage algérois comme la directrice d’un ouvroir de broderie. Elle a éga-lement fait le choix d’inscrire cet établissement dans la continui-té de l’œuvre de sa grand-mère et se fait appeler Luce Benaben. Si son parcours de vie se démarque de l’ordinaire dans l’Algérie coloniale – par les conditions de son éducation et la renommée de sa grand-mère – le fait d’exercer un métier et de vivre hors du mariage « bourgeois » est nettement moins exceptionnel dans ces années-là de la colonisation29. En cherchant à la situer parmi les autres Européennes qui s’occupent de femmes « indigènes », il sera question dans ce qui suit de la manière dont ces « travail-leuses » ont, par leurs activités, modifié les rapports sociaux entre femmes colonisatrices et colonisées tout en léguant une série de
157Relations entre femmes dans l’Alger colonial | Rebecca Rogers
représentations qui ont tendance, paradoxalement, à gommer la richesse et la diversité des interactions vécues.
II — Travail et formation féminins dans l’Algérie coloniale
Henriette Benaben n’est en effet pas la seule Française à travailler avec et auprès des femmes musulmanes à Alger. Outre les Petites sœurs des pauvres qui s’occupent d’un asile de vieillards à la Bouzaréa (ville proche de la ca-pitale), l’Annuaire général de l’Algérie signale, en 1880, trois sages-femmes qui assurent le service médical du Bureau de bienfaisance d’Alger et deux autres femmes qui dirigent des ouvroirs dans le quartier de la Casbah : Mesdames Prague et Bain30. L’ouvroir de la rue de Toulon est rangé alors dans une rubrique « Maisons de travail pour les filles musulmanes ». Il n’empêche qu’à cette date, ce choix de vie est rare et la tendance générale est plutôt au renforcement des frontières raciales entre les popula-tions31, comme le démontre, en 1881, la promulgation du Code de l’indigénat32. Le gouvernement civil au pouvoir manifeste peu de sollicitude pour les filles musulmanes33 qui sont laissées aux soins exclusifs de leur famille, et ce d’autant plus qu’à Alger, la croissance de la population européenne est importante et que cette dernière est ma-joritaire. En 1886, on trouve en effet dans la ville 65 227 Européens pour 5 372 Juifs naturalisés, 1 005 étrangers et seulement 14 670 « indigènes » (soit 20% de la popu-lation totale seulement)34. Mais contrairement à d’autres villes coloniales, les quartiers sont moins séparés, à l’ex-ception notable de la haute Casbah, presqu’exclusive-ment réservée à la population arabe35. L’emplacement des trois ouvroirs précités au cœur même de la basse Casbah, lieu de plus grande mixité sociale et raciale, crée une proximité peu commune entre femmes « in-
158G&C |Articles Relations entre femmes dans l’Alger colonial | Rebecca Rogers
digènes » et européennes. C’est de cette proximité entre Françaises et élèves ouvrières36 que renaîtront à la fin du xixe siècle des institutions plus centrées sur l’éducation des filles musulmanes.
1. Des ouvroirs aux écoles professionnelles
L’ouvroir tenu d’abord par Eugénie Luce puis par Henriette Benaben marque plus durablement les esprits que les autres éta-blissements, sans doute en partie du fait de sa longévité. Rose Barroil, qui bénéficiait, comme Eugénie Luce, de bourses d’ap-prentissage pour ses élèves, dans les années 1860, laisse son ou-vroir aux mains de Mme Prague la décennie suivante37. Cependant en 1886, Henriette Benaben est la seule à avoir encore pignon sur rue. Son établissement est alors signalé dans l’annuaire du commerce d’Alger sous la rubrique « broderies arabes ». En effet, l’ouvroir est un lieu de travail et de formation mais également de commerce puisque les objets confectionnés sont ensuite mis en vente. En fonction des périodes et des sources, l’une ou l’autre orientation est plus ou moins affirmée mais les deux sont étroite-ment intriquées, comme le montre le journaliste anglais Joseph C. Hyam lorsqu’il décrit l’ouvroir d’Henriette Benaben dans un guide de l’Algérie pour les Anglais en 189938. Dans une rubrique « broderies algériennes » il présente son école (school) où « ac-tuellement on trouve une trentaine de filles mauresques de cinq à quinze ans qui produisent des broderies algériennes ». Son texte insiste sur le caractère philanthropique de l’entreprise dans la mesure où la directrice apprend non seulement des techniques de travail aux filles, mais qu’elle soutient aussi financièrement un certain nombre de pauvres femmes maures qui n’arrivent pas à vivre de leur labeur. Joseph C. Hyam incite les touristes à découvrir l’école mais aussi à rendre visite à un deuxième établissement à Mustapha Supérieur où, face à l’église écos-saise, Henriette Benaben a loué une belle maison de style oriental pour mettre en valeur : « Les innombrables objets délicats de cette broderie exquise ». Entre bienfaisance et travail lucratif, l’école-ouvroir constitue encore une curiosité
159Relations entre femmes dans l’Alger colonial | Rebecca Rogers
à la fin du xixe siècle alors qu’il commence à faire modèle. L’institution d’Henriette Benaben fonctionne, sous sa di-rection, comme une école de broderie où les jeunes filles apprennent des techniques et s’exercent à la production d’objets de toutes sortes : linge et vêtements, décorations et poupées qui se vendent dans le magasin attenant à l’ou-vroir. L’établissement accueille aussi de jeunes ouvrières qui y trouvent un cadre de travail collectif ainsi que le matériel nécessaire pour façonner des produits destinés à la vente. En 1907, le fonctionnement de l’ouvroir est décrit ainsi par l’Ins-pecteur général Félix Hémon :
« Choisies vers six ou sept ans, peu payées, mais préser-vées de la misère et de pis encore, les apprenties travaillent à des broderies à la fois riches et délicates, sur fond clair, à des écharpes, à des mouchoirs, où, à défaut des représen-tations d’animaux interdites par le Coran, s’enroulent ou se déroulent ici des feuillages étranges, observés et rêvés, là des strophes coraniques aux dessins merveilleusement compliqués. Partout la ‘couleur locale’ est respectée : voici des croissants, des mains symboliques, préservatrices du mauvais œil, et voici des costumes éclatants, près de por-tières d’étamine aux tons éteints »39.
Selon ce dernier, une moyenne annuelle de soixante à soixante-dix fillettes ou jeunes femmes est accueillie par Henriette Benaben dans les dernières décennies du xixe siècle. L’ouvroir d’Henriette Benaben est donc, on le voit, à la fois une école et un lieu de tra-vail entre femmes dans une ville où les possibilités « honorables » de rémunération sont relativement limitées, d’autant plus que les années 1880 sont des années de crise économique.
Au-delà de cet aspect, comme le signale d’ailleurs Hémon lui-même, se pose aussi la question du caractère « civilisateur » de l’œuvre d’Henriette Benaben. Malgré l’absence d’un enseigne-ment direct en français, « l’action indirecte est très puissante », écrit-il : « toutes les apprenties apprennent le français par la
160G&C |Articles Relations entre femmes dans l’Alger colonial | Rebecca Rogers
pratique, et le parlent plus ou moins bien. Je ne dis rien de l’in-fluence morale exercée sur elles, et par elles, en quelque me-sure, plus lentement qu’on ne voudrait, sur leurs familles »40. Selon lui, cet établissement devrait servir de base à l’éducation professionnelle dans les écoles de filles « indigènes ».
Le développement d’écoles professionnelles féminines est d’ailleurs une question débattue dans les deux décennies avant la Première Guerre mondiale au moment où le gouvernement civil prône une politique dite d’association. Dans le domaine culturel, cela se traduit par l’encouragement d’une architecture de type néo-mauresque, par le développement d’ateliers d’apprentissage au sein des écoles primaires indigènes et par la mise en place d’une série d’enquêtes sur les industries d’art indigène41. À cette période, les initiatives d’Henriette Benaben rencontrent donc la politique scolaire coloniale qui, après une longue période d’ou-bli, encourage de nouveau l’instruction des filles « indigènes ». En effet, depuis la fermeture de l’école d’Eugénie Luce, en 1861, les Français cessent de prôner l’instruction des filles , craignant l’opposition que celle-ci génère du côté des notables musulmans. L’arrivée des colons au pouvoir à partir de 1870 exacerbe cette politique de l’oubli. De plus, le discours officiel associe de plus en plus les femmes musulmanes aux domaines de la famille et de l’islam, supposés inaccessibles à la culture française42. Ainsi, en 1898, on ne trouve dans toute l’Algérie que cinq écoles de filles ou écoles enfantines qui accueillent 1 300 élèves43.
Cette même année cependant, par les articles 17-19 du décret du 18 octobre 189244, un programme d’enseignement professionnel est arrêté pour les écoles d’apprentissage annexées aux écoles de filles. Les objectifs d’un tel enseignement sont « la restauration des antiques industries de la fabrication des tapis et des bro-deries arabes et la confection des couvertures, tentures, etc.. qui furent autrefois si prospères » sans oublier l’enseignement ménager et l’économie domestique (lavage, repassage, rac-commodage, couture et cuisine). L’affirmation officielle d’un besoin d’écoles professionnelles féminines ne doit pas cacher
161Relations entre femmes dans l’Alger colonial | Rebecca Rogers
l’existence de lieux de formation avec des désignations qui varient fortement : école primaire, école d’apprentissage, école-ouvroir, école professionnelle. À Alger et dans ses en-virons, à la fin du xixe siècle, l’enseignement professionnel des filles devient plus visible et il est assuré dans au moins six endroits : dans l’école de tapis de Mme Delfaux, créée en 1896 ; dans l’ouvroir de Mme la comtesse d’Attanoux où l’ont fabrique des broderies et des dentelles ; dans l’école des de-moiselles Pignodel, au Fort Empereur (Alger) ; dans l’ouvroir de Mustapha Supérieur et dans celui de Cherchell, tous deux dirigés par des dames protestantes anglaises ; et, enfin, chez Henriette Benaben, rue du Rempart Médée45.
En 1902, le Bulletin de l’enseignement des indigènes de l’Aca-démie d’Alger publie un long article sur l’éducation profession-nelle dans les écoles « indigènes » de filles qui témoigne de leur développement46. Il s’agit toujours de directrices françaises qui proposent un enseignement primaire et un programme pro-fessionnel sur le modèle initié par Mme Luce au milieu du xixe
siècle. À cette époque, cependant, les produits de ces ateliers rencontrent à la fois une demande d’objets artisanaux – telles les broderies arabes – de la part des touristes, et une politique culturelle arabophile soutenue par le Gouverneur général Charles Jonnart. Ce contexte favorable au développement du travail des femmes françaises et « indigènes »47 est aussi celui où des images prolifèrent proposant un autre regard sur ces dernières. En nous penchant sur certaines sources iconographiques qui montrent l’école de broderie l’on discerne ainsi des stratégies de représen-tation de la part d’Henriette Benaben, mais aussi les traces de rapports sociaux qui ne demandent qu’à être mieux connus.
2. Représentations du travail auprès des femmes arabes
Comme sa grand-mère, Henriette Benaben a rapidement com-pris qu’il fallait « vendre » la bienfaisance auprès des fillettes mu-sulmanes dans quatre directions différentes : les autorités pour qu’ils la soutiennent ; les familles pour qu’elles lui envoient leurs
162G&C |Articles Relations entre femmes dans l’Alger colonial | Rebecca Rogers
filles ; les jeunes femmes musulmanes elles-mêmes pour qu’elles acceptent de venir travailler dans l’ouvroir ; et enfin les touristes et les habitants européens pour qu’ils lui achètent ses brode-ries48. Dans cette entreprise, elle a utilisé les moyens mis à sa disposition par son époque. En particulier, elle a profité de ses relations privilégiées avec les photographes européens d’Alger et les a autorisés à diffuser des images de son ouvroir qui pré-sentent des jeunes femmes « indigènes » occupées à des activités utiles. Après sa liaison avec le photographe Klary, qui précède le décès de Mme Luce en 1882, elle déménage son ouvroir au n°7 de la rue Bruce à la fin des années 1880 dans les quartiers tou-ristiques de la basse Casbah. Là, elle partage l’immeuble avec un autre photographe, Poter, qui avait remplacé Klary à cette même adresse en 1879. Poter, à son tour, va céder son emplacement aux frères Vollenweider qui s’installent au début des années 1890 aux côtés de la directrice de l’ouvroir49. Ainsi il n’est pas surpre-nant que son atelier de broderies « indigènes » soit souvent pho-tographié entre les années 1880 et 1900.
Alexandre Leroux semble être le premier à prendre en photo l’intérieur mauresque de la rue Bruce où est installée Henriette Benaben entre 1882 et 1895. Les images montrent des petites filles qui œuvrent sur des métiers à tisser, entourées de tapis et de broderies. Une femme voilée de blanc figure dans les deux images conservées au Musée du Quai Branly. Garante de la « mo-ralité » des filles, elle n’est clairement pas une institutrice, mais plutôt une surveillante50. Dans les années suivantes, le célèbre photographe algérois, Jean Geiser, et son ancien apprenti, Arnold Vollenweider, prennent d’autres clichés qui circulent en cartes postales à partir de 1894 lorsque celles-ci sont autorisées51.
Ces images d’intérieurs féminins industrieux contrastent avec celles, plus tardives, qui répondent à une demande net-tement plus voyeuriste et sexualisée52. Ici, les photographes témoignent plutôt d’un regard ethnographique qui, en péné-trant dans les ruelles de la Casbah et en poussant la porte des maisons mauresques, révèle un univers qui semble à l’écart
163Relations entre femmes dans l’Alger colonial | Rebecca Rogers
du monde moderne. Comme le montre Zeynep Çelik, ce-pendant, ces images font parties d’un discours plus géné-ral sur les effets de la présence française et donc sur les aspects bénéfiques de la colonisation53. Tout en effaçant la présence d’Henriette Benaben, la carte postale ci-après (p. 164) montre des jeunes filles « indigènes » occupées à broder dans une cour mauresque dont l’architecture est à la mode en cette fin de xixe siècle54. La carte signale cependant la rencontre coloniale et la collaboration entre femmes par son titre même : « École de broderies indigènes de Madame Ben-Aben ». En précisant qu’il s’agit d’une école, la photographie se distingue de l’image généralement véhiculée dans les « scènes et types » et met en avant le travail d’apprentissage. La cour est transformée en lieu de travail, même si certaines des jeunes filles ne sont pas à l’ouvrage. Mais il s’agit bien d’une mise en scène dans la mesure où la directrice française n’est pas représentée et que le nom de son ex-mari est ici « arabisé ». Cherchant à vendre des cartes postales d’intérieurs mauresques, le photographe Vollenweider, comme son compère Geiser55, joue sur le goût de l’exotisme et, ce faisant, arabise le patronyme de la directrice.
Cette représentation qui efface la figure de la maîtresse fran-çaise est certainement voulue en partie par l’intéressée. Lors de l’exposition universelle à Chicago en 1893, elle choisit de repré-senter les broderies de son ouvroir et une fillette au travail (voir p. 167)56.
L’enseigne brodée précise cependant qu’il s’agit de l’établis-sement de « Madame Luce Ben-Aben » laissant planer le doute sur ses origines. Est-ce dans un désir de paraître plus « authen-tique » ? Souhaite-t-elle gommer la relation de domination colo-niale qui lui permet d’envoyer une ouvrière musulmane faire de la figuration devant des spectateurs américains ? Ou alors cette orthographe exprime-t-il plus sincèrement le sentiment de proxi-mité qu’elle ressent avec la culture arabe ? Il est impossible, en l’état, de répondre à ces questions, mais on peut noter que si elle fait le choix de faire figurer son établissement sous une forme
Relations entre femmes dans l’Alger colonial | Rebecca Rogers164
G&C |Articles
Carte postale de l’école de broderies indigènes de Madame Luce Ben Aben(photographe-éditeur, Arnold Vollenweider, collection privée Michel Mégnin), fin du XIXe siècle
165Relations entre femmes dans l’Alger colonial | Rebecca Rogers
arabisée dans l’annuaire du commerce d’Alger57 – Luce Ben Aben – la stèle de sa tombe fait retour à l’orthographe de son ex-mari en y ajoutant, comme toujours, le nom de sa grand-mère : Luce Benaben.
Conclusion : de l’ombre à l’exposition
« Mme Ben-Aben n’est ni une intrigante, ni une quéman-deuse ; c’est une timide, quelque peu fataliste, qui accom-plit sa mission tranquillement, sans bruit, et qui travaille sans relâche pour garder auprès d’elle ses jeunes appren-ties qu’elle adore et qui le lui rendent bien. L’École profes-sionnelle de broderies indigènes, depuis cinquante ans, fait vivre des milliers de Mauresques, lesquelles, à leur tour, ont inculqué à des générations d’ouvrières indigènes, les secrets de leur art merveilleux. Il est de toute équité que les assemblées élues interviennent : l’art, la justice et le bon renom de la France l’exigent »58.
Cet éloge, par l’écrivain et militant communiste Émile Violard de la quinquagénaire Henriette Benaben défendant sa « mission » auprès des « Mauresques »59 au nom de « l’art, la justice et le bon renom de la France », parle de relations d’adoration entre la Française et ses ouvrières « indigènes ». Décrite comme une femme timide, travaillant sans bruit, ce portrait rejoint celui des-siné par Augustin Berque, quelques décennies plus tard, lorsqu’il est question d’évaluer l’impact de la présence française cent ans après la conquête de l’Algérie. Homme de terrain, Berque a acquis ses connaissances sur l’Algérie coloniale comme administrateur de communes mixtes puis comme chargé de mission aux Affaires Indigènes. Comme les officiers des bureaux arabes au milieu du xixe siècle, il est convaincu de la possibilité de construire des rap-ports durables et productifs entre les populations en présence et il voit les activités de Mme Luce, et de sa petite-fille, dans cette perspective : « La France a toujours eu de ces collaborateurs demeurés dans l’ombre et qui, de leurs doigts agiles, tissaient l’avenir. »60 En réalité, les sources d’époque, et notamment l’ico-
166G&C |Articles Relations entre femmes dans l’Alger colonial | Rebecca Rogers
nographie, donne une autre image d’Henriette Benaben, celle d’une femme qui a su faire sortir de l’ombre ses consœurs musul-manes en faisant reconnaître la valeur des objets tissés par leurs « doigts agiles ».
Au moment du décès d’Henriette Benaben, en 1915, le jour-naliste arabophile Victor Barrucand publie un éloge qui insiste sur la proximité de cette dernière avec la culture du lieu où elle est née et de son « culte sincère pour les choses de l’Islam »61. La nécrologie pose ainsi la question des effets d’une vie passée, entourée de femmes musulmanes, d’une Française œuvrant pour leur donner une forme d’éducation. Dans son long article, Victor Barrucand évoque surtout la manière dont elle a su, avec sa grand-mère, développer « l’enseignement de tout un petit peuple de fillettes aux doigts menus, accroupies devant des métiers et tirant des fils de couleur suivant le tracé de dessins qui furent ceux d’un passé cruel et splendide. »62 Henriette Benaben ne s’est pourtant jamais convertie à l’islam malgré sa volonté d’arabiser son nom de famille. Et l’erreur de datation sur la stèle arabe de sa tombe suggère les limites des rapprochements entre les cultures. Sans savoir qui en est responsable, elle paraît révélatrice de la difficulté à déchiffrer ces rapports alors même que la majorité de nos sources nous viennent des colonisateurs.
À la fin de sa vie, Henriette Benaben est représentée dans quelques photos où on la voit encourageant ses jeunes apprenties (voir ci-après p. 168). Contrairement à l’image figurée plus haut dans le texte, il est clairement question ici de la rencontre et du travail en commun d’une femme française et de jeunes filles musulmanes.
Cette photographie – que l’on pourrait qualifier de « familiale » – raconte une autre réalité que celle mise en scène dans les cartes postales ethnographiques ou dans l’image de l’exposition universelle : celle d’un quotidien laborieux où l’exotisme cède le pas au familier, voir à l’intime. La directrice paraît maternelle et pleine de sollicitude pour ses élèves-ouvrières qui, de leur côté,
Photographie de l'exposition universelle de Chicago en 1893. Une élève pose devant l'enseigne brodée de l'école de Madame Luce Ben-Aben.
167Relations entre femmes dans l’Alger colonial | Rebecca Rogers
Henriette Benaben avec ses apprenties Collection familiale, fin du XIXe siècle
Relations entre femmes dans l’Alger colonial | Rebecca Rogers168
G&C |Articles
169Relations entre femmes dans l’Alger colonial | Rebecca Rogers
se concentrent sur leur travail sans regarder le photographe qui les immortalise.
L’approche biographique d’Henriette Benaben fait donc décou-vrir une autre histoire de la colonisation, plus « mixte », où les femmes « indigènes » sortent de l’ombre dans laquelle les discours orientalistes et les politiques coloniales les ont longtemps canton-nées. Malgré tout cependant, cet article, comme les sources sur lesquelles il s’appuie, nous ramène inévitablement vers les iné-galités des rapports en situation coloniale. Même arabisé le nom d’Henriette Benaben n’évoque qu’une des parties en présence ; celles qui brodent attendent encore qu’on puisse les nommer.
•