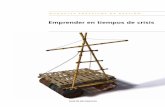Crise et triomphe du roman au XVIIIe siècle: un bilan
Transcript of Crise et triomphe du roman au XVIIIe siècle: un bilan
1
in : Michel Delon et Philip Stewart (éds), Le second triomphe du roman, Oxford, SVEC 2009/1, p.22-66.
Jan Herman, Mladen Kozul, Nathalie Kremer (KU Leuven)
Crise et triomphe du roman au XVIIIe siècle. Un bilan1
Un système littéraire en état de crise
Le triomphe du roman au XVIIIe siècle est inséparable d’une crise, du roman même,
mais aussi du système littéraire au sein duquel sa position évolue d’une marginalité plus ou
moins assumée à une posture plus confortable assurée par une production qui ne cesse de
croître et que le succès auprès du public confirme. Cette légitimation progressive au sein d’un
système littéraire en émoi est surtout d’ordre factuelle en ce que la montée du « genre » se
mesure d’abord et de manière empirique par son incontestable « succès ». Le triomphe du
roman en tant que « genre » littéraire ne serait cependant que passager si le succès grandissant
et l’élargissement du lectorat qui en sont certes les symptômes les plus immédiatement
visibles ne se doublaient d’une tentative de la part de romanciers de confirmer cette
légitimation de fait par une légitimation plus intrinsèque, d’ordre poétique. Rien que les pages
de titre témoignent de la tendance à la redéfinition et à la reconfiguration poétiques de la
prose narrative dans la première moitié du siècle. Les symptômes en sont bien clairs : le nom
de l’auteur est souvent laissé en blanc, la qualification générique de « roman » est
systématiquement évacuée au profit de dénominations comme « Mémoires » ou « Lettres »
qui rattachent le texte à des formules discursives connotées d’authenticité. A cette double
vacance de la page de titre répond le trop-plein du péritexte où l’on remarque une assez
extraordinaire prolifération d’avant-textes: épîtres dédicatoires, Avis au lecteur,
Avertissements du libraire, de l’éditeur, du traducteur, etc. Les vacances de la page de titre et
la prolifération des avant-textes s’observent dans un contingent de récits qui, loin de faire la
majorité, est suffisamment important pour y repérer les traces d’un changement stratégique
dans la façon dont la fiction en prose commence à se redéfinir sur le plan poétique.
« Ceci n’est pas un roman » est sans doute la formule la plus emblématique de cette
conversion. Oblique et biaisée, elle peut appeler une double lecture, sémantique d’une part,
pragmatique d’autre part. A un niveau purement sémantique, elle implique un rejet de tout ce
qui peut rappeler la fiction. En effet, le document authentique dont le texte se dit être la
transcription passe pour véridique. Authenticité vaut véridicité. D’un point de vue
pragmatique cependant, la formule paraît soumise à l’usure du temps. Par l’effet de
reconnaissance provoquée par la fréquence de son emploi, elle ne peut pas manquer de
signifier à la longue l’appartenance du texte à un paradigme fictionnel. ‘Ceci n’est pas un
roman’ signifie ‘Ceci est un roman’. L’expression peut dès lors apparaître comme une
formule rituelle au travers de laquelle se conclut un pacte de lecture où la vérité du texte est
proclamée dans la fiction même. Il semble que dans la nouvelle configuration poétique du
roman, le rapprochement des faits narrés du vécu s’accompagne d’une reconnaissance de la
fiction. L’adhésion du lecteur à l’univers diégétique et la créance attachée par lui aux faits
narrés ne semblent pas exclure la conscience que le récit relève de la fiction. Au contraire, on
serait tenté de croire que la vérité des faits narrés n’a de légitimité que si elle se présente en
même temps comme fictionnelle. Vrai mais fictionnel, vrai dans la fiction, vérité fictionnelle.
1 Cet article est le résultat d’un travail collectif réalisé au sein du Centre de Recherche sur le roman du XVIIIe
siècle de la KU Leuven. Deux autres personnes y ont également contribué: Géraldine Henin et Agnieszka
Teodorcick. Qu’elles soient ici remerciées de leurs enquêtes préparatoires.
2
C’est en effet à cette hypothèse que notre étude veut s’attarder : la légitimation du roman
comme genre ne saurait s’effectuer par une accréditation qui ferait oublier le statut fictionnel
du texte. Ce serait faire du roman un discours mensonger, mal plus grave que les
condamnations esthétiques et éthiques auxquelles il veut se soustraire. La légitimation ne
saurait, au contraire, qu’être l’effet d’une reconnaissance de la fiction comme telle. Fiction où
peut apparaître une image du réel fidèle et vraie, mais sans que le lecteur perde la conscience
que ce réel et cette vérité n’existent que dans la fiction. ‘Ceci n’est pas un roman’ devient
ainsi l’emblème d’une fiction véritable où sémantique et pragmatique, accréditation et
légitimation du récit en prose apparaissent comme le recto et le verso de la même médaille.
Cette médaille, on l’appelle « conversion générique », c’est-à-dire le rejet de la qualification
générique de « roman » au pofit d’une affiliation aux genres connotés de d’authenticité et de
véridiction.
Cet article propose un tour d’horizon des études consacrées à cette complexe
problématique depuis l’ouvrage de Georges May, Le Dilemme du roman (1963), fondateur
d’une filière au sein de l’Histoire du roman qui privilégie la dimension sémantique de la
question, en mettant l’accent sur les techniques d’accréditation des faits narrés. Une autre
filière, qui n’a pas reçu la même lumière, aborde la problématique sous un angle pragmatique
en interprétant les mêmes symptômes de renouveau romanesque comme des stratégies de
légitimation propres au « nouveau » roman. On fera ici, de l’une et de l’autre filière, le relevé
critique et organisé en mettant d’abord en lumière des études qui n’ont pas reçu tout l’intérêt
qu’elles méritent sans doute. La complexité de la problématique du triomphe du roman
demande que dans une première phase on distingue ces deux filières, pour montrer ensuite
que les poncifs et topoï au travers desquels la conversion générique s’effectue concourent à
l’une ét à l’autre stratégie.
Deux options orienteront notre raisonnement. Elles impliquent l’une et l’autre un
élargissement de l’objet d’étude. Premièrement, la publication récente de trois anthologies de
préfaces de romans2, qui ont permis d’étendre considérablement la base documentaire
nécessaires à de telles enquêtes, invite à reconsidérer sous l’angle du discours préfaciel
certaines hypothèses concernant les modalités d’apparition de nouveaux paradigmes
romanesques dans le champ littéraire. Accréditation et légitimation choisissent en effet le
péritexte comme un lieu privilégié pouvant accueillir leurs stratégies respectives. Notre choix
des études présentées sera limité par le traitement que leurs auteurs y réservent au discours
préfaciel. Deuxièmement, l’étude des stratégies complémentaires d’accréditation et de
légitimation du roman et les déplacements au sein du système littéraire qu’elles entraînent, ne
peut se faire sans une esquisse préalable de l’organisation du champ discursif de l’époque.
Champ discursif et système littéraire
Dans la première moitié du XVIIIe siècle, le champ discursif de la République des
Lettres, qui englobe non seulement le système littéraire mais aussi le champ du savoir, est en
butte à des mutations culturelles profondes dont l’ouvrage important de Philippe Caron3 fait
état. La première difficulté qui surgit au regard de la situation littéraire de l’époque est la
notion même de « littéraire ». Au début du XVIIIe siècle, la position des Belles-Lettres est en
partie astreinte par la révolution des disciplines physico-mathématiques et donc sujette à
2 Jan Herman, Incognito et roman, Préfaces de romanciers anonymes et marginaux, 1998, Christian Angelet et
Jan Herman, Recueil de préfaces de romans du XVIIIe siècle¸ tome 1: 1700-1750, tome 2: 1750-1800, 1999 et
2003. 3 Philippe Caron, Des « Belles-Lettres » à la « Littérature ». Une archéologie des signes du savoir profane en
langue française (1680-1760). Louvain-Paris, Peeters, 1992
3
celles-ci. Elle se définit en comparaison avec la nouvelle matrice de sciences, ce qui sera
cause d’une sémantisation antinomique. Il faut en effet relever la progressive scission des
Lettres et des Sciences.
Avant 16604, Lettres et Sciences sont unies. Les deux couvrent un seul et même
champ et désignent autant la totalité du savoir que quelconque exercice auquel se livrent les
intellectuels, sans aucune distinction de spécialité. Les Lettres, ou les Sciences, englobent
toutes les connaissances confondues, transmises durant les études par le véhicule du livre.
Descartes, dans le Discours de la Méthode (1636)5, cite sous le nom de « Sciences », toutes
les disciplines qui peuvent faire l’objet d’enseignement : l’éloquence, la poésie, les
mathématiques, la théologie, la jurisprudence, la médecine et les autres sciences. A partir de
la deuxième moitié du XVIIe siècle cependant, les nouvelles sciences – autant les sciences de
la nature que les sciences sociales et politiques – entament leur marche vers le sommet de la
hiérarchie qui commence à caractériser le champ discursif. L’unicité fait place à une
dichotomie : les Lettres et les Sciences deviennent progressivement deux lieux d’activités
différents. Le lexique tarde cependant à enregistrer les mutations en cours. Ainsi, aussi tard
qu’en 1690, Furetière écrit à l’article « Lettres » de son Dictionnaire universel : « lettres se dit
aussi des sciences ». Le syntagme de « Belles-Lettres », en revanche, se lexicalise entre 1650
et 1660. De même, « homme de lettre » devient « bel esprit ». Un sème esthétique vient se
greffer sur le sens de « Belles-Lettres ». En effet, il désigne des ouvrages écrits de manière
agréable, revêtus d’ornements. C’est le premier symptôme d’une scission entre les beaux
textes et les discours à fonction purement informative. Les nouvelles frontières du champ
littéraire se dessinent graduellement, coupant peu à peu les œuvres à visée esthétique des
autres formes d’écriture. L’expression « République des Sciences » employée par Condorcet
(1739-1794) dans un sens spécialisé6 et qui vient se juxtaposer à celle de « République des
Lettres » qu’on enregistre dès le XVe siècle, entérine le nouveau découpage du champ
littéraire. Or, l’époque qui nous intéresse ici – la première moitié du XVIIIe siècle – amorce
cette scission et reflète le caractère problématique des relations qu’entretiennent les Sciences
et les matières communément appelées Belles-Lettres, à savoir l’Histoire (y compris
l’Histoire sainte), la Philosophie, la Poésie, la Rhétorique7.
De la confrontation des deux pôles désormais concurrents de l’activité intellectuelle se
dégage une conception antagoniste de leurs rôles respectifs, traduite par une sémantisation
antinomique8. Les deux grands domaines du paysage discursif se meuvent dans un réseau de
prédicats opposables9. Ainsi, « l’instruction », « l’abstraction » et « le sérieux » ressortiraient
aux textes scientifiques. Les traits constitutifs des textes « littéraires », en revanche, seraient
« le plaisir », « l’invention » et « l’aménité ». Le scientifique a l’apanage de la raison et
confère à ses œuvres une approche rigoureuse, analytique et méthodique, tandis que l’homme
de lettres accommode l’imagination avec le sentiment et écrit avec feu et enthousiasme. Cette
émotivité du discours littéraire engage, sur le plan rhétorique, tant l’« ethos » que le
4 Philippe Caron, Des « Belles-Lettres » à la « Littérature ». Une archéologie des signes du savoir profane en
langue française (1680-1760). Louvain-Paris, Peeters, 1992, p.55. Caron observe une spécialisation grandissante
des termes Lettres et Sciences à partir de cette date-là. 5 Idem, p.212. 6 Hans Bots, Françoise Waquet, La République des Lettres, Paris, Belin-De Boeck, coll. Europe & Histoire 1997,
p.58. 7 Caron, op. cit., p.114. Les frontières des Belles-Lettres sont très fluctuantes jusque dans les années 1750. On
peut toutefois discerner un noyau de genres fréquemment cités et d’autres plutôt périphériques. Dans la
représentation graphique en cercles concentriques présentée par Caron se trouvent au centre poésie et rhétorique. 8 Id., p.341. Caron donne un tableau antithétique des Belles-Lettres et des Sciences exactes. 9 Id., p.355-356. Caron présente une configuration de lexèmes contrastifs, prédicats courants de Sciences et
Belles-Lettres.
4
« pathos » en ce que le lettré brûle lui-même de la flamme avec laquelle il veut embraser le
lecteur. Les avant-textes de romans, comme une légion d’autres textes, filent ces descriptions
contrastives. Prenons en guise d’exemple un extrait de la préface des Enchaînements de
l’amour et de la fortune (1736) par le Marquis d’Argens. Outrant à l’extrême le clivage qui
s’opère dans le paysage discursif, ce préambule expose l’opposition entre un « livre de
galanterie » et « des matières abstraites et sérieuses ».
Un auteur, en faisant un livre de galanterie, s'amuse autant que ses lecteurs : il donne
cours à son imagination et les idées qu’elle lui fournit l'occupent agréablement. Il jouit
le premier du plaisir que doit causer son ouvrage. Mais dans des matières abstraites et
sérieuses, surtout lorsqu’on veut les rendre à la portée de tout le monde, l’esprit sans
cesse occupé se lasse bientôt et sent le poids du travail.10
Les « matières abstraites et sérieuses » relèvent donc de l’épineux et de l’inaccessible au
commun des mortels. Elles doivent surmonter plus d’obstacles et triomphent plus
difficilement, à force de travail. Les « livres de galanterie » par contre sont légers, amusants,
délassants, agréables.
Cette lexicalisation contrastive s’emplit souvent de résonances polémiques, et ceci
surtout dans le premier tiers du XVIIIe siècle. A côté du mot « Sciences » au sens générique
du terme surgissent une pléiade de tournures telles que sciences « utiles », sciences
« sérieuses », sciences « réelles ». Ces syntagmes établissent en creux une comparaison avec
d’autres secteurs du paysage discursif qui ne seraient pas utiles, sérieux ou réels. Les adjectifs
qualificatifs témoignent des voies de spécialisation qu’ont prises les sciences et donnent une
connotation de vérité, d’exactitude, de démonstration et donc de crédibilité. Partant, ces
disciplines sont marquées au coin de la précellence et rejettent ainsi tacitement les autres
disciplines au rang du mensonge, de l’approximation, du frivole, de l’inutile. En août 1753,
dans le Mercure de France, l’abbé Forest écrit :
L’esprit d’analyse et de calcul règne avec tant d’empire dans notre siècle, que toute
étude qui n’a pas quelque rapport aux Sciences exactes, passe en général pour
inutile.11
Le scientifique s’arroge un statut de supériorité12. Son activité prédomine sur celle du bel-
esprit qui arbore ses talents de galanterie et de civilité dans les cercles mondains. Le
scientifique possède une compétence qui se soustrait à la versatilité de l’opinion publique : il
s’assigne la recherche de la vérité qui s’affranchit du fortuit de l’instantané et qui prévaut sur
les vogues littéraires par essence passagères. Il s’érige en juge compétent, capable de se
prononcer en vertu de ses connaissances approfondies. Ses jugements sont soumis à la vérité
et à la morale, sans quoi ils perdraient toute légitimité. Dans ce cadre, le langage est véhicule
du vrai et du bien et obéit dès lors à des préceptes austères qui ne se conforment pas aisément
aux agréments de l’élocution.
Dans cette perspective qui prône la supériorité des Sciences, les Belles-Lettres sont de
plus en plus contestées : « qu’importe un texte agréable s’il n’est pas utile », clament ses
10 Jean-Baptiste de Boyer, marquis d’Argens, Les Enchaînements de l’amour et de la fortune, ou les Mémoires
du marquis de Vaudreville, par Monsieur le marquis d’Argens, La Haye, 1736, dans Jan Herman et Christian
Angelet, Recueil de préfaces de romans du XVIIIe siècle. Volume I : 1700-1750. Par Jan Herman, Louvain,
Presses universitaires de Louvain, 1999, p.197. Dorénavant: Recueil. 11 Discours sur cette question Combien les sciences sont redevables aux Belles-Lettres – Mercure de France,
août 1753, p.47 dans Caron, op. cit., p.212. 12 Didier Masseau établit une typologie des intellectuels au XVIIIe siècle dans L’Invention de l’intellectuel dans
l’Europe du XVIIIe siècle, Paris, PUF, p.34-44.
5
accusateurs. Les moralistes stricts et tenants des sciences « sérieuses » stigmatisent le
« delectare » poussé à l’extrême – le trop-plaire – et dénoncent la culture de bagatelles et de
sentiments artificiels :
Gardez-vous de prévenir le public en votre faveur. Cette coutume, toute usitée qu’elle
soit parmi les écrivains de nos jours, est opposée au sens commun et sent plus le
charlatan que le philosophe ou l’homme qui pense.
Tel est le conseil donné dans la préface du Diable ermite (1740)13 par Lambert de Saumery.
L’on incrimine les praticiens des Belles-Lettres axés sur les blandices de l’élocution et
destinés à satisfaire une curiosité gratuite. Ils ne sont que des manipulateurs, à l’affût des
seules techniques de persuasion, à la recherche de paroles efficaces qui prennent au piège le
lecteur. L’esprit n’est alors que l’art de broder, d’habiller des riens. Sans génie, les Belles-
Lettres ne sont plus que l’art – au sens péjoratif du terme – de palabrer et de briller en société
avec ce vernis verbal. Les critiques dénigrent le fait que l’on s’érige en auteur à peu de frais.
Toute une piétaille littéraire s’approprie indûment le titre d’auteur. Ces écrivaillons – souvent
appelés « beaux-esprits » avec résonance négative - n’hésitent pas à s’abaisser à la flagornerie
pour se faire une place dans la République des Lettres. « Tant de nains, montés sur des
échasses, y sont devenus tout à coup des espèces de colosses »14. Evidemment, il ne faut pas
réduire tous les gens de lettres au même dénominateur. Comme le signale Caron,
entre le bel esprit et les Belles-Lettres, la différence n’est pas de nature mais de degré :
c’est celle qui existe entre l’usage et l’excès. Mais le type de faculté mis en jeu, l’effet
souhaité, la fonction du texte ou de l’acte de parole, principalement orientée autour du
plaisir, sont identiques.15
Un autre chef d’accusation concerne les pratiques de lecture qu’induit ce type d’ouvrages :
soit une lecture commode, morcelée, que le lecteur peut mener au gré de ses humeurs, soit une
lecture d’une traite, faite sous l’empire de la passion. Une passion qui endort la raison et lâche
la bride à l’imagination. Dans les deux cas, les œuvres font les heures de loisirs du tout-
venant, le lecteur n’assimile pas l’ouvrage, il manque de concentration et son sens critique
s’estompe. Citons Didier Masseau à ce sujet :
Apparaît ici l’envers inquiétant de la pédagogie triomphante sur laquelle les
philosophes entendaient bâtir leur règne. Ceux-ci pensaient faire accéder les lecteurs à
la lumière de la vérité, en les transformant habilement en partenaires complices.
Les nouveaux romanciers – tels Baculard d’Arnaud, le spécialiste des émois et des
larmes – ne s’adressent plus qu’à des récepteurs médusés par un effet de discours. Il
faut noter que cette dernière critique émane surtout des philosophes, car ceux-ci
prétendent réinstaurer les modalités d’une lecture légitime, reposant sur la
concentration et l’imprégnation préalable d’une culture ; moyen aussi, pour eux, de
dénoncer les charlatans qui ont failli à une mission essentielle de l’intellectuel, en
pervertissant les règles du jeu.16
13 Pierre Lambert de Saumery, Le Diable ermite, ou Aventures d’Astaroth banni des enfers. Ouvrage de
fantaisie. Par Mr. de M***, Amsterdam, 1740, dans Recueil, p.264. 14 Claude Godard d’Aucour, L’Académie militaire, ou les Héros subalternes, par Parisien, qui suit l’armée,
Amsterdam, 1740, dans Recueil, p.251. 15 Caron, op. cit., p.235. 16 Masseau, op. cit., p.131.
6
En mesurant les disciplines à leur degré d’utilité pour les hiérarchiser, les détracteurs des
Belles-Lettres les enferment dans la sphère du plaisir (et du charlatanisme) en réduisant leur
portée aux seuls ouvrages de divertissement et les relèguent ainsi à l’ordre du facile et de
l’inutile. Du délassement à la futilité, il n’y a qu’un pas.
Le roman, genre relégué à la périphérie du champ des Belles-Lettres, est à plus forte
raison minoré par rapport aux sciences. En témoigne, par exemple, le « Tableau raisonné des
Connaissances humaines » de l’Encyclopédie, de manière très visuelle : le roman est
littéralement rejeté à la queue des genres englobés par les Belles-Lettres. Ce tableau,
représentation de la hiérarchie du champ des connaissances au milieu du XVIIIe siècle,
ramène l’ensemble des connaissances humaines à l’entendement. Les auteurs, Diderot et
d’Alembert, en reconnaissent trois modalités : la mémoire, la raison et l’imagination. A
l’entendement par la mémoire ressortit l’Histoire, sacrée, civile et naturelle. Le champ qui
ramène l’entendement à la raison est appelé « Philosophie », qui se ramifie en Métaphysique,
Science de Dieu, Science de l’homme (Logique, Morale) et Science de la Nature
(Mathématiques, Physique). Quant aux connaissances humaines dont l’entendement peut être
ramené à l’imagination, elles comprennent la poésie (sacrée et profane) et les arts (musique,
peinture, sculpture, architecture, gravure). La poésie peut être narrative, dramatique ou
parabolique. Placé à la fin du paradigme de la poésie narrative, après le poème épique, le
madrigal et l’épigramme, le roman est suivi d’un « etcetera », qui en dit long sur la position
tout à fait marginale qu’occupe la prose narrative profane et imaginaire au sein de la
hiérarchie discursive telle que la concevaient les directeurs de l’Encyclopédie au milieu du
XVIIIe siècle.
De nombreuses préfaces de romans attestent ce contexte hostile. Le romancier ne peut
ignorer les critiques. Cette conscience de la position marginale amène le roman à tenir compte
de la disposition des lecteurs et de prendre en considération leurs passions, leurs émotions et
leurs croyances. La préface est le lieu où il peut faire fléchir son public et modifier l’état
d’esprit défavorable. Sur le plan rhétorique, la préface est une réponse adressée à autrui, à la
représentation que l’opinion se fait du roman et celle que le roman donne de lui-même.
Certains préfaciers le font de manière explicite en intégrant une dimension intersubjective et
dialogique à leur discours. Cela leur permet de déployer leurs thèses et les thèses du camp
adverse, qu’ils présentent pour mieux pouvoir les réfuter et asseoir le crédit public. La teneur
des arguments qu’ils avancent varie de préface en préface. Une majorité des préfaces font
preuve de vigilance en cherchant un terrain d’entente avec le parti adverse, d’autres foulent
aux pieds les critiques.
Dans la plupart des préfaces, la prudence est de mise. Celles-ci préconisent que la
primauté du plaisir n’est pas un axiome dans le roman qu’elles présentent, que l’auteur a eu
moins en vue l’amusement du public qu’une « catharsis » des passions, orientée vers
l’édification et la correction des mœurs. Leur façon de suppléer aux critiques et de délivrer
leur ouvrage de sa réputation frivole est en effet l’introduction d’un aspect moralisateur. Une
multitude de préfaces le rappellent : il faut préserver le lecteur de ses faiblesses, lui polir
l’esprit et former ses mœurs en parant l’ouvrage d’exemples de vertu et de réflexions
instructives pénétrantes. Sans vertu, pas de persuasion. Des traits de morale doivent être
semés ci et là pour saisir l’esprit du lecteur et pour éviter qu’il succombe aux passions
déréglées. Ainsi, l’œuvre fera l’objet d’une lecture plus attentive et méditée, pour qu’elle
puisse laisser une impression solide. Une lecture-perfusion, lente et pénétrante, qui convaincra
à long terme et non pas dans l’impétuosité du moment. Dans l’avertissement qui précède Les
Aventures d’Euphormion (1711) par Drouet de Maupertuy, le préfacier annonce au lecteur :
Qu’il lui suffise de trouver dans la lecture de cette Histoire de quoi s’instruire et se
délasser l’esprit innocemment. Celui qui la donne au public n’a point eu d’autre motif.
7
C’est pour cela qu’il a pris soin de n’y rien mettre qui ne porte à concevoir de l’amour
pour la vertu et de l’horreur pour le vice et de semer en divers endroits des réflexions
et des maximes qui conduisent naturellement et peuvent beaucoup aider à produire ce
double effet, en quoi consiste le tout de la Morale.17
Dans la même lignée, certains préfaciers joignent l’utile à l’agréable en insérant dans leur
récit des traits d’autres domaines du savoir, tels que l’histoire, la politique ou la philosophie.
Citons ici en guise d’exemple la préface qui introduit Les Entretiens des cafés de Paris (1702)
du Chevalier de Mailly :
Ce livre a tout ce qu’il faut pour piquer la curiosité du public. Il est nouveau dans son
espèce et donne beaucoup plus qu’il ne promet. La satire, la galanterie et le comique y
règnent presque partout. La Morale et la Politique y trouvent leur place. La
Philosophie même y brille dans deux entretiens, l’un touchant l’origine du monde et
l’autre concernant la lumière et la diversité des couleurs. On y remarque encore des
traits d’Histoire, des aventures surprenantes et des descriptions vives.18
D’autres préfaces obvient aux critiques en alléguant que la détente est indispensable à l’ère
des sciences. Les œuvres de divertissement, loin d’être superflues, sont nécessaires pour
ménager les esprits après de grands efforts intellectuels. Ainsi, dans la préface du roman de
Bibiena intitulé Le petit Toutou (1746), le préfacier fait état des éventuels reproches que l’on
pourrait lui adresser et conclut que
la lecture d'un récit clair, enjoué, court, varié, peu chargé de faits et semé d'agréables
saillies est le seul plaisir qu'on puisse prendre en tout temps, en tout lieu ; celui qui
s'accommode le mieux d'une légère attention. L'Histoire d'un perroquet, d'une
écumoire, d'un silphe, d'un moineau ou d'un petit toutou ne laisseront certainement
aucune trace dans l'âme. N'est-ce pas là le vrai moyen de ménager les forces de
l'esprit? N'est-ce pas être soigneux de les conserver à la philosophie ?19
Une minorité de romanciers ne se soucient guère des griefs qui leur sont destinés et ne se
cachent pas de la production légère qu’ils offrent au public. Ils présentent ouvertement leur
« bagatelle » aux lecteurs, tout en faisant un joli pied de nez aux critiques. Un exemple
éloquent est celui de Jeannette qui, dans sa préface, déclare ne pas avoir pu résister au désir de
« s’historier » et de s’ériger audacieusement en auteur sans connaître les normes imposées par
les savants. Elle dit :
Ignorant les règles que les savants ont prescrites pour l’Histoire, mon début ne sera
peut-être pas conforme aux lois qu’ils ont imposées, mais je m’en console si, quoique
je ne les suive pas, je plais au plus grand nombre de mes lecteurs. 20
Jeannette est d’avis qu’il suffit de plaire pour être agréée par le lecteur et esquive ainsi les
préceptes de la tradition. Elle met également en scène un « ami sage » qui s’oppose à sa
17 Jean-Baptiste Drouet de Maupertuy, Les Aventures d’Euphormion, Histoire satirique, Anvers, 1711,
dans Recueil, p.84. 18 Chevalier de Mailly, Les Entretiens des cafés de Paris, et les différends qui y surviennent. Par M. le C. de
M***, Trévoux, 1702, dans Recueil, p.33. 19 Jean Galli de Bibbiéna, Le petit Toutou, Amsterdam, 1746, dans Recueil, p.277. 20 Pierre Alexandre Gaillard de la Bataille, Jeannette seconde ou la nouvelle paysanne parvenue. Par M.G*** de
la Bataille, Amsterdam, 1744, dans Recueil, p.248.
8
création libre. Aux yeux de ce dernier, il faut plus que de l’esprit pour pouvoir se prétendre
écrivain. Mais Jeannette rétorque qu’elle a écrit son ouvrage conformément aux désirs du
public qui préfère des ‘bagatelles ingénieuses’ et des ‘riens narrés avec esprit et légèreté’ aux
ouvrages de jadis, guidés par ‘un génie vaste, un jugement solide, une érudition profonde’.
Un ami sage, auquel j'ai confié ce dessein extravagant me représente en vain qu'il faut
pour cela plus que de l'esprit. Ses remontrances sont inutiles; je lui répondis qu'il est
dans l'erreur, que le goût du temps n'est pas celui de l'antiquité, qu'il est vrai que pour
mériter autrefois à bon titre la qualité d'auteur, il fallait un génie vaste, un jugement
solide, une érudition profonde, mais qu'aujourd'hui sans tout cela, on se fait naturaliser
dans la République des Lettres.
Je le lui prouve par nos ouvrages modernes, dénués de tout ce que l'on admirait dans
les anciens, qui cependant entraînent les suffrages du public et font la réputation des
auteurs. Je lui fais sentir que des bagatelles ingénieuses, des riens narrés avec esprit et
légèreté trouvent plus de lecteurs que des écrits chargés de morale et de science. Il
veut répliquer, je lui ferme la bouche ; il se retire en haussant les épaules, je le laisse
partir pour travailler à mon histoire en liberté.21
Jeannette fixe donc la voix des critiques ; elle incorpore une présence, un ami sage, pour
déployer les thèses du camp adverse et y riposter du tac au tac.
Aux yeux de ses détracteurs, le roman n’a aucun crédit à cause de son manque de
sérieux. Le roman est cantonné du côté des genres qui exploitent et simulent les émotions et
dont le jugement est soumis au cœur mobile. La préface est une réponse, ou dans les termes
de Gisèle Matthieu-Castellani, une « passion-réponse »22 à ses détracteurs.
Au vu de ces fragments de préfaces, le roman apparaît comme un discours doublement
minoré. Mis au rebut à l’intérieur du champ des « Belles-Lettres » ou du champ de
l’entendement réglé par « l’imagination », il est à plus forte raison dévalorisé par rapport aux
sciences, qui s’affranchissent du champ des Belles-Lettres auxquelles elles appartenaient
quelques décennies auparavant. Autant les sciences gagnent du crédit, autant les Belles-
Lettres en perdent, et le roman en particulier. La préface de roman mettra dès lors en place
une stratégie de légitimation plurielle, s’inscrivant dans plusieurs axiologies à la fois. Le
roman s’engage activement dans le débat de plus en plus cuisant entre les Sciences et les
Belles-Lettres qui tentent pourtant de l’exclure : par les réponses qu’il apporte aux différents
chefs d’accusation aux ouvrages non scientifiques, le roman défend la cause du champ des
Belles-Lettres au sein duquel il soutient pourtant une position précaire.
La conversion générique comme stratégie de légitimation
Les Belles-Lettres constituent un « système littéraire ». Le « système littéraire » est
l’ensemble d’actants, institutions et de forces qui structurent l’activité littéraire d’une époque.
Dans ce système, l’apparition de nouveaux clivages et la redéfinition de notions poétiques,
comme la vraisemblance23, ont des incidences importantes sur l’organisation et la distribution
21 Ibidem. 22 Gisèle Matthieu-Castellani, La Rhétorique des Passions, Paris, Presses universitaires de France, p.59-60. 23 Cf. Nathalie Kremer, « Vraisemblance et reconnaissance de la fiction. Pour une redéfinition de la vraisemblance
dans le cadre d’une poétique romanesque », Fictions classiques (publié sur Acta Fabula le 29 avril 2006), URL : http://www.fabula.org/colloques/document128.php et « La vraisemblance conduit-elle au vrai ? », in : Studies rond de Franse literatuur van de XVIIIe eeuw : ‘Belgian work in progress’ : Études de littérature française du XVIIIe siècle (Contactforum van 20 januari 2005 aan de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten) , éd. par Jan Herman, Paul Pelckmans et Nathalie Kremer, Bruxelles, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 2005, p. 85-94.
9
des rôles et sur les rapports de force qu’entretiennent les différents discours le composant. Ces
discours se hiérarchisent selon un ensemble complexe de critères axiologiques, poétiques et
institutionnels. le roman y est un mal venu, en ce qu’il vient troubler, comme on le verra, les
clivages entre les différents types de discours. La préface est le lieu, stratégique, où le roman
écrit sa défense.
Dans deux articles éclairants - “Le système littéraire en état de crise. Contacts
intersystémiques et comportement traductionnel”24 et « Du non-littéraire au littéraire. Sur
l’élaboration d’un modèle romanesque au XVIIIe siècle »25 - Shelly Yahalom étudie les
déplacements et polarisations évoquées ci-dessus à partir du modèle du « polysystème ».
Développé à l’Université de Tel Aviv, ce modèle d’inspiration lotmanienne permet de
ressaisir un maximum de paramètres dans une grille de réflexion cohérente. Le raisonnement
de Sh.Yahalom est axé sur l’idée de crise du système littéraire classique. Ce dernier est
fortement hiérarchisé. Cette hiérarchie est traduite par Sh.Yahalom en termes topologiques: au
centre s’inscrivent les modèles textuels dits « canoniques », comme la tragédie et l’épopée,
qui se caractérisent par une forte réglementation formelle et thématique qui, elle, se dégage
sans difficulté de l’examen attentif des “Arts poétiques” de l’époque. Autour de ce centre
circulent des formules textuelles formellement et thématiquement moins strictement définies
qui, pour cette raison, ne sont pas admises par le centre mais reléguées par ce dernier à la
périphérie parce que non conformes aux normes et valeurs (le respect de la vraisemblance, des
bienséances, la nécessité de plaire en instruisant, etc.) en vigueur dans ce centre. Se produit,
dans les deux premières décennies du XVIIIe siècle, une révolution dans cet état de choses:
rétrécissement du centre du système d’un côté, élargissement sans précédent de la périphérie
de l’autre. Ce qui est en cause dans cette crise du système littéraire classique est la définition
de la notion même de « littérature ». Qu’est-ce qui est perçu comme littéraire, qu’est-ce qui ne
l’est pas? En effet, ledit rétrécissement du centre se traduit par une formulation plus restrictive
des conditions d’appartenance à ce qui est considéré, par la critique doctrinaire, comme “de la
littérature”. Cette formulation autoritaire du “bon usage” littéraire, qui émane d’un souci de
préserver les acquis et le prestige du Grand Siècle, a des conséquences importantes. Elle
produit d’abord un élargissement de la périphérie, que vont rejoindre des formules
discursives condamnées. Elle produit en second lieu une explosion de textes épigonaux qui,
tout en se conformant aux règles prescrites par le centre du système, ne sont pourtant pas faits
pour en augmenter le prestige. Troisièmement: à court terme, cet état de choses produit un
clivage entre la production et la réception du produit littéraire: la zone canonique, qui
consolide ses critères d’appartenance, cesse d’être représentative de “la littérature” de
l’époque. En d’autres termes, les modèles textuels donnant le ton ne se situent pas, ou plus, au
centre du système, devenu un champ épigonal, mais se retrouveront à la périphérie du
système, où elles développeront des stratégies discursives susceptibles d’en assurer la
reconnaissance et la valeur littéraires. Parmi ces modèles novateurs, le roman26.
24 in Poetics Today II, 4 (1981), p.143-160. 25 In Poétique 44 (1980), p.406-421. 26 Il n’est pas clair à quel moment précis Sh.Yahalom situe cette crise. La comparaison élaborée par l’auteur
entre le système littéraire et le système socio-politique permet toutefois d’arguer que, pour elle, la crise se
produit dans les dernières décennies du règne de Louis XIV. En effet, l’hyperstructuration du centre du système
littéraire est l’homologue d’une pareille hyperstructuration dans le domaine socio-politique: “au début du XVIIIe
siècle, ce système se trouve au sein d’un processus de mutation dans sa marge, sans que celle-ci ait la possibilité
de pénétrer dans le centre, c’est-à-dire sans que change le principe du pouvoir (comme c’était le cas en
Angleterre) de façon à permettre à ses éléments constitutifs (la bourgeoisie) d’échanger leur force “réelle” en
position hiérarchique “équivalente” (transformer sa richesse en moyen de pouvoir). Parallèlement, les éléments
se trouvant au centre se transforment graduellement en “fonctions vides”, détachées de l’activité véritable du
système socio-politique.” (p.148-49)
10
Quelles sont ces stratégies discursives périphérique visant à conférer aux formules textuelles
marginales comme le roman une plus grande légitimité ? Pour éviter le statut de texte
inférieur, marginal, périphérique, le roman s’associe à un champ de textes non perçu comme
littéraire: les mémoires, les lettres. Pour ce donner un statut moins inférieur - toujours selon
Sh.Yahalom - le roman se soustrait à la critériologie en vigueur dans le centre du système en
se donnant pour un texte “authentique”, c’est-à-dire non littéraire et non fictionnel. En
d’autres termes, le roman recourt à une “tactique de dissimulation”, qui visait un double but.
Primo, se présentant comme des Mémoires authentiques, le roman se libère des normes que la
poétique classique imposait à la fiction, et surtout de celles qui impliquaient le respect des
“bienséances” et de la “vraisemblance”; secundo, camouflé en « Mémoires » le roman n’est
plus perçu par le centre du système comme un modèle textuel pouvant mettre en danger le
statut élitaire de ce dernier. En d’autres termes, par la conversion générique, le roman, non
seulement se soustrait à la critériologie littéraire qui ne s’appliquait qu’aux textes fictionnels,
mais évitait en même temps d’être considéré comme un genre littéraire nouveau menaçant le
centre du système. Et en même temps, ce nouveau modèle textuel, qui tentait d’échapper à la
condamnation en se camouflant, pouvait mettre en place, dans sa préface, de nouvelles
normes et valeurs, opposées aux normes classiques en vigueur dans le centre du système: le
naturel, le quotidien, le particulier, …, par exemple.
Envisageant le même déplacement en termes discursifs, Sh.Yahalom affirme que le
champ canonique, occupant le centre du système, refuse au roman la qualité de « texte »,
c’est-à-dire de discours soumis à certaines règles et principes tant rhétoriques que stylistiques
qui en assurent la « littérarité ». Le roman, en tant que discours qui est le contraire de ce qu’un
« texte » devrait être, est rejeté à la périphérie du champ littéraire, dans la zone non
canonique, comme un « anti-texte ». Selon l’hypothèse de Sh.Yahalom, le roman,
anathématisé comme « anti-texte », cherche de nouvelles voies en refusant les critères de la
« littérarité » qui lui avaient valu d’être exclu du champ canonique du système littéraire. Loin
de tenter de répondre à ces critères de la littérarité dictés par le centre du système, le roman,
comme anti-texte, cherche des alliances avec des textes non littéraires, s’excluant par là du
système littéraire en tant que tel. En d’autres termes, en allant rejoindre des modèles textuels
comme les mémoires ou les recueils de lettres authentiques qui, précisément, n’ont pas la
prétention d’être « littéraire », le roman se transforme en « non-texte ». Il se rend
méconnaissable au regard du centre canonique du système. En même temps, cette conversion
d’anti-texte en non-texte remet en question le statut générique du roman qui, refusant la
qualification générique de « roman », s’appelle désormais « Mémoires de… » ou « Lettres
de…. ».
C’est ici que le concept de « polysystème » acquiert toute sa pertinence. Pour saisir la
complexité de la conversion générique dans ce système en état de crise, il faut supposer
l’existence de trois secteurs topologiques. L’apparition de ces trois zones est le résultat d’une
double opposition : entre le système littéraire et le système non littéraire, d’une part, et au sein
de ce système littéraire, entre champ canonique (le centre) et champ non canonique (la
périphérie), d’autre part. Les déplacements au sein du système littéraire sont appelés
intrasystémiques. Entre le système littéraire et le système de textes non-littéraires, ils sont
appelés « intersystémiques ».
Ce raisonnement en termes d’interférences entre différents champs et systèmes est
extrapolé par Sh. Yahalom au fascinant et très complexe problème des textes traduits de
l’anglais. Cherchant des alliances avec le champ de textes non littéraires comme les
mémoires, l’ « anti-texte » peut aussi, sans sortir du champ littéraire, s’allier à des modèles
textuels qui échappent aux critères de la littérarité dicté par le centre canonique du système
français, par le fait précisément qu’ils ne sont pas français. L’interférence intersystémique
entre les systèmes littéraires français et anglais donne naissance à des modèles textuels
11
hybrides comme les pseudo-traductions. Certes, la pseudo-traduction peut de prime abord
nous apparaître comme une manière de camouflage comparable à celui qui donne naissance
au pseudo-mémoires, La ressemblance formelle avec la tactique de dissimulation
intrasystémique paraît évidente. C’est en effet ce que déclare Sh.Yahalom:
L’état de texte d’origine anglaise était considéré comme pouvant libérer [le roman] des
normes littéraires, qui sont toujours pour les “sujets parlants” du système littéraire
français, “françaises par excellence”. La conception du rôle du “traducteur” occupe
dans ce cas la même fonction que celle du rôle de l’ “éditeur” de Mémoires ou de
Lettres. Cette identité fonctionnelle ressort surtout de la comparaison des préfaces:
dans presque toutes, il existe une “excuse” pour la présentation d’un texte qui ne
correspond pas aux exigences de la bienséance et de la vraisemblance, et une
justification de ce défaut par l’ “originalité” ou par l’immédiateté du texte. Une autre
caractéristique commune est le double système de normes: justification de la nature
transgressive du texte par son statut authentique et corrections éditoriales
(traductionnelles) en cas de violation exagérée. L’équivocité issue du double système
de normes est caractéristique du texte ambivalent27.
Un statut ambivalent, voilà ce que le texte pseudo-authentique et le texte pseudo-traduit
semblent avoir en commun. Mais ces deux stratégies sont-elles en tous points identiques sur le
plan quantitatif d’abord et sur le plan qualitatif de leur fonctionnalité ensuite? Tous les
bibliographes s’accordent pour constater dans la première moitié du siècle une véritable
explosion de pseudo-mémoires. A list of French prose fiction de P.S.Jones recense plus de
200 textes sur 970 qui adoptent l’écriture à la première personne. Et, plus fiable dans la
perspective critique qui nous retient ici, l’ouvrage de Ph.Stewart, Imitation and illusion in the
French memoirs novel 1700-1750, se fonde sur une lecture approfondie de 85 romans
identifiables comme des pseudo-mémoires, parmi lesquels les grandes réussites du genre. Or,
le petit nombre de pseudo-traductions de textes anglais, en revanche, est sans commune
mesure avec l’explosion du récit mémorial. Quand on met de côté les traductions véritables,
un relevé effectué dans les bibliographies de P.S.Jones et de H.W. Streeter28 aboutit, pour la
première moitié du siècle, à une petite vingtaine de pseudo-traductions contenant dans leur
titre un renvoi à l’Angleterre29.
La crise du roman est étudiée sous l’angle de la légitimation par Sh.Yahalom.
L’accréditation n’est qu’un phénomène secondaire dans le raisonnement. Les stratégies de
« camouflage » et de conversion générique visent moins à assurer la véridicité du récit
(accréditation) qu’à soustraire le récit à la critériologie littéraire et à fortifier sa position dans
le polysystème discursif de l’époque (légitimation). Cependant, il semble que, tout en
échappant à la critériologie littéraire, le roman se heurte à un inconvénient plus fondamental
qui est d’ordre à la fois épistémologique et moral: il devient un discours mensonger qui ne
s’avoue pas pour ce qu’il est, une fiction. Mensonge romanesque. En fin de compte, les
interférences intra- et intersystémiques ne pourront mener qu’à l’exclusion définitive du
roman non seulement, pour reprendre le Tableau de l’Encyclopédie, du domaine de la
connaissance par l’imagination, mais du champ discursif tout court. Un texte peut
difficilement se légitimer par le mensonge. La théorie de Sh.Yahalom contient sa propre
aporie.
27 Sh.Yahalom, 1981, p.154. 28 Harold Wade Streeter, The Eighteenth Century English Novel in French Translation: a bibliographical Study,
New York, Benjamin Blom, 1936 29 Pour un commentaire plus circonstancié sur l’hypothèse de Sh.Yahalom,, nous renvoyons à Jan Herman, “La
pseudo-traduction de romans anglais dans la première moitié du XVIIIe siècle. Analyse titrologique, in Annie
Cointre et Annie Rivara (éds), La Traduction romanesque au XVIIIe siècle (Actes du colloque de Metz 26-28,
septembre 2001), Amiens, Presses universitaires d’Artois, 2003, p.11-25.
12
La conversion générique comme stratégie d’accréditation
La thèse bien connue de Georges May se présente elle aussi comme une
conceptualisation de la position instable, ambiguë et précaire du roman dans le champ
littéraire du XVIIIe siècle. Les griefs encourus par le roman sont bien connus depuis l’«étude
sur les rapports du roman et e la critique » menée par G.May. Le premier a deux aspects: l'un
généalogique, l'autre poétique. La critique généalogique se résume dans la conviction
inlassablement répétée selon laquelle la lecture du roman « gâte le goût » faute de répondants
chez les Grecs ou les Romains. Les attaques proprement poétiques insistent sur l’impossibilité
physique et morale du romanesque, de son invention, de sa psychologie, de son style. Le
préjugé de naissance s’affaiblit ou périclite ; ce qui n’empêche que le roman soit perçu
comme genre corrompu et corrupteur. Il ne se conforme « à aucune des règles classiques
fondées sur le respect du bon sens et du bon goût. »30. Deuxième chef d’accusation : le roman
attribue un rôle privilégié à l’amour, il est donc immoral. Le roman produit un effet tentateur
et corrupteur sur son lecteur, ou combien pire, sur sa lectrice. Il attire la sympathie du lecteur
sur l’amoureux ; il ne peut qu'inspirer de mauvaises mœurs. G. May détecte qu’au début du
XVIIIe siècle l’accusation d’immoralité, reprise des attaques contre le théâtre du dernier quart
du siècle précédent, perd de sa virulence. En revanche, celle d’invraisemblance perdure,
s’approfondit et se complète, pour amener le changement du goût du public et de mode
d’écriture romanesque.
Ces exigences critiques sont contradictoires et enferment le romancier dans un cercle
vicieux – conceptualisation qui permet à G. May de formuler son influente thèse: si le
romancier entreprend de satisfaire les partisans d’une littérature d’édification morale, il ne
peut qu’idéaliser et embellir la nature humaine ; mais ce faisant, il tombe dans l’irréel et
l’invraisemblable. D’autre part, s’il choisit de représenter la nature humaine telle qu’elle est,
et dans la mesure où « le réalisme est à l’art ce que le cynisme est à la morale », il ne peut que
tomber dans l’immoralité31.
A la différence de la lecture de Sh. Yahalom, la conversion générique, présentée
comme une issue au dilemme, est abordée sous l’angle de l’accréditation par G.May.
Balançant « entre Scylla et Charybde », le roman développe dans son péritexte des stratégies
qui sont censées le rapprocher du discours véridique, voire à faire croire que le récit est
véridique. Ecoutons G. May à ce propos : ‘Tous les bons romanciers de l’époque […]
recourent à des procédés techniques de cet ordre pour libérer le roman de l’hypothèque
poétique et lui conférer l’estampille historique.32’ G. May fait en cela écho à Frédéric Deloffre
qui, dans un article sur « le problème de l’illusion » qui a fait date, parlait « d’un arsenal de
moyens propres à imposer au lecteur l’impression qu’on ne lui offre rien que de vrai ».33 La
même lecture des revendications de véridicité est au centre des influentes études de Vivienne
Mylne et de Philip Stewart qui l’une et l’autre étudient le problème préfaciel sous l’angle de
« l’illusion »34 ou de ce que Ph.Stewart appelle « the Art of make-belief » et ce que nous
appelons l’accréditation. Ces études réservent au dossier préfaciel une lecture essentiellement
30 Ibid., p. 23 31 Ibid., p. 102. 32 G. May, Le dilemme du roman, 1963, p.145. 33 Frédéric Deloffre, ‘Le problème de l’illusion et le renouvellement des techniques narratives de 1700 à 1715’,
dans La littérature narrative d’imagination; des genres littéraires aux techniques d’expression (Paris, PUF,
1961), 115-33. 34 Philip Stewart, Imitation and Illusion in the French Memoir-Novel, 1700-175. The art of make-belief0 (New
Haven and London, Yale, UP, 1969) et Vivienne Mylne, The 18th Century French Novel, techniques of illusion
(Manchester University Press, Barnes&Noble, NY, 1965/ Cambridge, UP, 1980).
13
sémantique. L’approche sémantique a longtemps été la seule manière acceptable de lire le
dossier préfaciel du XVIIIe siècle. Toutefois, est-ce que réellement, comme l’affirme
Vivienne Mylne, le roman ne pouvait plaire et instruire que s’il savait gagner la confiance et
la croyance du lecteur en la vérité du roman ?35 Pour répondre à cette question, il n’est pas
nécessaire de remettre fondamentalement en question les thèses de G. May ou de Ph. Stewart.
De l’aveu même de G. May, les prétentions à l’authenticité se soustrayaient, au moins en
partie, à une lecture purement sémantique :
Il va sans dire que la plupart des lecteurs n’avaient pas la naïveté de prendre au pied de
la lettre de pareilles prétentions à l’authenticité absolue. Mais il est indubitable que le
public de 1730 et même encore celui de 1761 était d’une crédulité monumentale,
comparée au scepticisme universel de ‘l’ère du soupçon’ qui est la nôtre
aujourd’hui.36
Le paradigme du roman véritable
Au vu du vaste dossier de préfaces qui constitue la base du présent travail, il paraît
légitime de grever les lectures de la conversion générique de deux tares importantes. La
première concerne l’accréditation. On peut se demander si la ‘crédulité’ de l’époque était
réellement monumentale et si l’ ‘ère du soupçon’ n’apparaît pas plus tôt qu’après la deuxième
guerre mondiale. La question est déjà posée par G. May, qui laisse grande ouverte la porte à
une lecture qui ne se contente pas de cette approche sémantique. La récurrence des procédés
narratifs d’accréditation comme le topos du manuscrit d’une part et la topicité des
protestations de véridicité d’autre part relancent le discours préfaciel dans une « ère du
soupçon » où ils ne peuvent être lu que comme des discours obliques. « Ceci n’est pas un
roman » commence, par sa récurrence, à signifier « Ceci est un roman », selon un mécanisme
pragmatique voisin de ce que S.Freud appelle ‘die Verneinung’, où un propos qui reçoit trop
d’insistance s’inverse en son contraire.37 La deuxième tare a déjà été mentionnée. Elle
concerne aussi bien la thèse de G.May que celle de Sh.Yahalom: la conversion générique
conduit tout droit au mensonge romanesque qui, au regard de la doxa de l’époque, était
difficilement acceptable. L’accréditation fallacieuse est une forme de délégitimation, d’un
point de vu à la fois épistémologique et moral
Envisagées sous un angle pragmatique, la conversion générique se fait lire à la lumière
d’un autre questionnement : s’il est vrai, comme nous le posons, que le public n’était pas
toujours dupe et qu’il l’était sans doute de moins en moins à mesure que les assertions et
récits devenaient topiques, quelle était la fonctionnalité de ces topoï préfaciels? La « crédulité
monumentale » du public contemporain, si elle est parfois remise en question par les études
s’inspirant du Dilemme du roman comme on le verra, continue à embarrasser les chercheurs.
Ph. Stewart a consacré à cette question des pages qui la nuancent tout en apportant toutefois
des arguments suggérant que la perspicacité des lecteurs contemporains ne doit pas être
surestimée.38 Le texte cité par Ph.Stewart à l’appui de cette thèse démontre cependant, à y
35 Vivienne Mylne, The 18th Century French Novel, techniques of illusion (Manchester University Press,
Barnes&Noble, NY, 1965/ Cambridge, UP, 1980). 36 G.May, Le Dilemme du roman au XVIIIe siècle, p.144. 37 Sigmund Freud, ‘Die Verneinung’. Werke aus den Jahren 1935-1930, p.11-15 et 46-53 38 Ph.Stewart, Imitation and Illusion in the French memoir-novel, 1969, p.29-30: “That the historical pretensions
became conventionnel by no means necassarily signifies that no one ever beleived them. In fact there are plenty
of indications that the acumen of readers was on occasions rather low. […] But even if those who were duped
had been only those who wihed to be, they would still, no doubt, have been a sizable company””, p.31: “It would
be a mistake to conclude that genuiely mystifying cases were rare”.
14
regarder de près, un autre phénomène, auquel il faut s’arrêter, à savoir l’ambiguïté du statut
épistémologique du texte. Il s’agit d’un extrait du Pour et Contre où Prévost déclare :
Sans remonter jusqu’aux légendaires, on a vu paraître de nos jours quantité d’ouvrages
qu’on ne sait dans quel rang l’on doit mettre, et qui sont devenus comme autant de
problèmes dès le premier moment de leur naissance. Est-il bien décidé, par exemple,
que L‘Espion turc, les Mémoires de Rochefort, ceux de Pontis etc. doivent être rangés
dans la classe des romans, ou dans celle des livres de quelque autorité ? […] Ce serait
d’y opposer un mélange de fictions et de vérités, que leurs auteurs prennent ainsi plaisir
à confondre, parce qu’écrivant pour plaire ils savent que la vérité seule ne plaît pas
toujours, et qu’un récit de pure imagination ne saurait satisfaire non plus les personnes
de bon sens. Il est vrai qu’on ne serait guère plus avancé après cette supposition,
puisque la difficulté de démêler le vrai du faux empêcherait toujours qu’on ne pût fixer
à quelle classe un livre de cette nature appartient. Mais on ne courra jamais grand risque
à le placer au rang des romans.39
Hésiter sur le rayon auquel un livre doit être placé dans la bibliothèque des Lettres, autrement
dit sur son statut épistémologique, n’équivaut pas à être dupe. Constater qu’un livre pourrait
être vrai mais qu’il pourrait tout aussi bien être une fiction, témoigne au contraire de lucidité.
Il faut donc s’en tenir au constat, très fréquent au XVIIIe siècle40, que le lecteur était dans le
doute et en venir à l’hypothèse que la création d’un statut épistémologique (et générique)
ambigu relève sans doute de la haute stratégie romanesque.
« Un récit qui ne contient que de vrai est une histoire : un tissu de fictions est une
fable ; le mélange de la fable et de l’histoire fait le roman ». Cette célèbre définition du
roman, qu’on doit à Seigneux de Correvon, 41 mérite d’être remise en mémoire. Elle est
emblématique. La suite est plus essentielle encore : « Ce qu’il y a de vrai intéresse, ce qu’il y
a de fiction embellit et amuse ; plus la vérité y domine, mieux la fiction est ménagée, et plus
le roman approche de sa perfection ». Il est remarquable que dans ce mélange de vérité et de
fiction que présente le roman, la fiction peut être « ménagée », ce qui semble impliquer que si
la vérité est immuable, la fiction est un vecteur susceptible d’être dosé du plus au moins. La
définition de Seigneux de Correvon est celle du « roman véritable ». Elle repose sur un dosage
variable de vérité et de fiction.
Aux dires de Seigneux de Corevon, le roman parvient à sa perfection, poétique bien
entendu, quand la fiction parvient à se faire oublier. L’habile dosage du vrai et d’un fictif
presque effacé accrédite le récit, en ce sens qu’il arrive à entraîner le lecteur dans l’univers
qu’il crée et auquel le lecteur finit par croire. Mais d’autre part, la vérité n’a pas toujours
intérêt à ce que la fiction se fasse oublier complètement. Pour une double raison. D’abord,
l’adhésion du lecteur serait détruite par la découverte du mensonge. Ou comme le disait
Vauvenargues : « Le faux dégoûte au moment où il se laisse sentir. On ne relit point un
roman ».42 Mais ensuite, Le récit n’a pas toujours intérêt à mentir. Dans le contexte discursif
de l’époque, certaines « vérités » véhiculée par le discours narratif, comme l’intimité du moi
et le passionnel, pour être acceptables par la doxa, avaient besoin de se présenter non pas
comme « effectives », mais comme « fictives ». Le nouveau paradigme romanesque a besoin
de se donner un statut épistémologique ambigu, parce qu’à travers le besoin d’accréditer le
39 Prévost, Le Pour et Contre (Paris, Didot, 1733-40), tome 6, p. 340 et 352-53. 40 Voir Jan Herman, ”La recherche d’un statut ambivalent dans le roman français de la première moitié du
XVIIIe siècle”, in Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte (1988) no 3, p. 349-362. 41 Seigneux de Correvon, ‘Lettre à Mme D** sur les romans’ Bibliothèque française, ou Histoire littéraire de la
France (Amsterdam, Jean Frédéric Bernard, 1728), p.47 42 Vauvenargues, ‘Des Romans’ Oeuvres de Vauvenargues (Paris, Cité des Livres, 1929), I, p.89-90.
15
récit par la réduction de son aspect fictif, transparaît une seconde nécessité qui consistait à
légitimer le récit en présentant les vérités qu’il véhicule comme fictives. Ce nouveau
paradigme romanesque, on pourrait l’appeler « roman véritable ». La vérité n’y apparaît pas
nue, mais comme l’effet d’une habile construction où la fiction s’efface sans se faire oublier.
La reconnaissance de la fiction à travers la véridiction est une condition nécessaire à
l’acceptation du discours par la doxa. Dans ses Confessions Rousseau présentait son
autobiographie comme une entreprise inédite. Rien n’est plus significatif. Jusqu’à ce que
Rousseau forme « une entreprise qui n’eut jamais d’exemple »43, l’intimité du « moi » ne
pouvait paraître sur la scène publique qu’endossant l’habit de la fiction, dans les pseudo-
mémoires, précisément.44
Ce rapport entre la fiction préfacielle et l’autobiographique est au centre de l’étude de
Jenny Mander, Circles of learning: narratology and the eighteenth-century French novel45.
Dans cette importante étude, J. Mander met à contribution certains acquis de la narratologie,
comme la différence entre les rapports homodiégétique et hétérodiégétique qu’entretient le
narrateur avec l’histoire qu’il raconte. Le point de départ du raisonnement est l’identité
fondamentale entre le ‘je’ de l’énonciation et le ‘je’ de l’énoncé que J. Mander appelle ‘the
autobiographical link’. Dans la conception narratologique de G. Genette, toute narration est
essentiellement à la première personne car elle émane nécessairement d’un sujet, qui peut
parler de lui-même en tant que personnage (rapport homodiégétique) mais ne le fait pas
toujours (rapport hétérodiégétique). Cette conception de la narration se construit autour d’une
unité fondamentale et fermée entre le sujet et son texte. Or, ce n’est qu’en apparence que les
romans-mémoires des années 1730 répondent à ce schéma. S’il est vrai que le XVIIIe siècle a
abondamment exploré la veine du roman-mémoires, la présence d’un péritexte souvent très
développé éloigne sensiblement la narration à la première personne du lien autobiographique.
Par rapport à la relation homodiégétique que celui-ci investit, le péritexte produit ce que J.
Mander appelle un processus d’‘hétérodiégétisation’, ce qui revient à dire que le ‘je’ de la
narration est mis dans une position où il devient progressivement un ‘il’.46 Les modalités de
ce processus d’hétérodiégétisation sont nombreuses. Il apparaît en effet, dans les récits
préfaciels qui précèdent ces romans, que le texte peut à tout moment être réapproprié par un
tiers. Le siècle a fourni quantité d’exemples de récits présentés comme des manuscrits
trouvés. Ceux-ci peuvent aller d’une figuration minimale du genre – ‘Le manuscrit m’est
tombé par hasard entre les mains’ qui précède Le Mentor Cavalier (1736) du marquis
d’Argens - à des géométries très complexes telles qu’en offrent les romans du chevalier de
Mouhy, par exemple. Implosif ou explosif, le maniement du topos du manuscrit trouvé
implique une désappropriation du texte. L’auteur du manuscrit est absenté et déresponsabilisé.
N’étant pour rien dans la publication du texte, il n’est plus passible de condamnation pour
quelque raison que ce soit, éthique et même esthétique. En effet, le je-narrateur étant ainsi
hétérodiégétisé, le texte se transforme entre les mains de ses nouveaux détenteurs : il sera
43 Rousseau, Les Confessions, Livre 1: “Je forme une enterprise qui n’eût jamais d’exemple et dont l’exécution
n’aura jamais d’imitateur. Je veux montrer à mes semblables un home dans toute la vérité de la nature, et c’est
home ce sera moi.” 44 Pour Ph.Stewart au contraire, il n’y a pas rupture entre le roman-mémoires et la naissance de l’autobiographie.
L’une découle logiquement de l’autre: “Rousseau wrote at the outset of his Confessions that his intention to
depict himself “dans toute la vérité de la nature” was without example: in terms of nonfiction he may have been
right, but his concept is perfectly in keeping with the tradition of the memoir-novel, and may have been derived
from it” Ph. Stewart, Imitation and Illusion, 1969, p.173. 45 Jenny Mander, Circles of learning: narratology and the eighteenth-century French novel (Oxford, Voltaire
Foundation, Studies on Voltaire and the Eighteenth Century no 366, 1999), chapitre 3 : ‘Prefatory discourse :
dissolving the autobiographical link’. 46 J.Mander, Circles of learning, p.70 : ‘In reworking the original manuscript, the editor breaks the direct link
between the text and the first person’.
16
corrigé, complété, raccourci, amélioré, etc. L’origine même du récit est obnubilée,
l’association entre le ‘je’ et son texte rompue. En même temps qu’il est désapproprié, le texte
est transformé par ce processus d’hétérodiégétisation, en se rapprochant du discours oral et de
ce J.Mander appelle le ‘téléphone arabe’47: la forme du message est à la merci des utilisateurs
qui se le transmettent et on n’est jamais sûr si le message reçu par le narrataire soit encore le
même que celui envoyé par le narrateur.48 Le lien autobiographique entre ‘auteur et œuvre’ se
trouve affaibli et même neutralisé.
Jenny Mander soulève un questionnement présent en filigrane dans la thèse de G.May
en le formalisant et en le déplaçant. L’angle d’approche ne rejoint plus les prémisses
focalisées sur des techniques de réalisme narratif ou d’accréditation, mais ouvre une
perspective d’ordre pragmatique en saisissant certaines conditions d’apparition du roman,
dans le contexte socio-historique des années 1730. Par la conversion générique, le texte
s’efforce à brouiller les traces qui mèneraient à son origine. La chaîne de médiation qui relie
les différentes versions du texte est soumise à un processus de transformation. Le lien
autobiographique rompu, la première personne est déresponsabilisée par l’absence d’une
rigoureuse paternité textuelle. L’originalité d’un texte est située dans un espace intertextuel :
un nouveau texte est toujours une transformation d’un texte préexistant, etc. Au roman qu’il
précède, la préface pose des questions qui concernent son autonomie et ses conditions
d’apparition dont l’enjeu réside moins dans l’accréditation trompeuse que dans la pragmatique
de déresponsabilisation d’un récit qui vient « de nulle part ».
La Crise et dilemme du roman
Dans les histoires littéraires et autres ouvrages spécialisés de la deuxième moitié du
XXe siècle, la notion de crise du roman prévaut sur celle de dilemme. Constatons en même
temps que les commentateurs qui essaient d’aller au-delà du dilemme et d’identifier la crise
du roman en d’autres termes que ne l’a fait G. May s’avèrent relativement peu nombreux.
Pratiquement tous les historiens du genre ont noté l’existence d’une crise du roman au XVIIIe
siècle. Celle-ci se serait surtout manifestée dans les années 1725-1761, même si elle était
détectable dès le dernier quart du siècle précédent. La plupart des histoires littéraires
consultées restent dans la lignée de G. May et s’accordent sur l’interprétation mayenne de la
situation du roman en y apportant des nuances parfois capitales qu’il s’agit ici mettre en relief.
Cinq historiens du roman notamment – D. Masseau, J.-M. Racault, J. Sgard, J. Terrasse, L.
Versini – emploient explicitement le mot "crise" ; d’autres parlent de polémique autour du
roman (M. Delon), de discussions (H. Coulet), de malaise (B. Didier), d’impasse (D.
Masseau), de problème (S. Spencer), de mise en cause (J.-J. Tatin-Gourier), de controverses
(Jean Sgard), de querelle ou de situation inconfortable (J.M. Goulemot, J.-J.Tatin-Gourier) ou
du dilemme dans lequel a été enfermé le genre romanesque (D.Masseau, R.Pomeau, B.Didier,
J. Sgard, J.-J. Tatin-Gourier, J.-M. Goulemot). Lorsqu'ils envisagent le roman dans son
rapport avec la critique, ils s’accordent sur les raisons qui ont provoqué cette situation
"inconfortable" du roman, celles identifiées par G. May : esthétiques et morales 49.
Cependant, en démontrant aussi bien la mauvaise foi que le caractère tendancieux des
attaques contre le roman, les historiens relèvent dans les commentaires d’époque plusieurs
47 Jenny Mander, ‘Téléphone arabe: la nature discursive du roman des années 1730’, dans Le Roman des années
trente. La génération de Prévost et de Marivaux, éd.Annie Rivara et Antony McKenna (Saint-Etienne, PU,
1998), p.119-30. 48 Jenny Mander, ‘ Moi et l’ouïe: la concurrence entre l’écrit et l’oral’, dans Le Topos du manuscrit trouvé.
Hommages à Christian Angelet, éd. Jan Herman et Fernand Hallyn (Leuven-Paris, Peeters, 1999), p.149-57. 49 Pour le détail de ces références, le lecteur voudra bien se rapporter à la bibliographie à la fin de cet ouvrage.
17
paradoxes. Ainsi, comment concilier le refus de reconnaître le roman pour un genre littéraire à
part entière avec les exigences d’obéissance aux bienséances et à la vraisemblance? En
accusant le roman de manquer aux bienséances, la critique lui faisait l’honneur de le
soumettre aux règles du classicisme. Que la règle des bienséances eût perdu un peu de son
crédit au cours du XVIIIe siècle, comme le suggérait G. May, ou qu'elle se fût modifiée et
diversifiée, celle de la vraisemblance conservait un prestige intact voire accru. En tout cas, les
appliquer à un genre considéré roturier n'allait pas de soi. Cette discussion, n'était-elle pas mal
fondée? Tout porte à croire qu'elle s’appuyait sur des arguments problématiques et déjà
inactuels à l’époque. En conséquence, certains historiens du roman tendent à relativiser
l'importance du discours critique sur le roman dans l'évolution du genre.
Tout en ménageant une large place aux hypothèses de G. May, H. Coulet note ainsi
que les rapports entre la critique et le roman de 1715 à 1760 "reposent sur un quiproquo"50. Si
la critique discutait bien la vraisemblance du roman, sa qualité artistique et sa valeur morale,
c’était parce qu’elle "ne reconnaissait pas la légitimité du genre romanesque"51. L’essence du
roman lui échappe. D'une part, le roman ne se prête pas aux règles appliquées aux genres
"poétiques". D'autre part, il est indigne de rivaliser avec les disciplines dispensant une
connaissance, comme la philosophie morale ou l’histoire. H. Coulet estime que "cette
question de droit, inutile et fausse", a contraint tant les critiques que les romanciers à "ne voir
que de biais les questions esthétiques"52. Il fait sien le constat de G. May, qui note la
faiblesse, l’ineptie, l’injustice et l’aveuglement de la critique, mais refuse la perspective de ce
dernier selon laquelle le face à face avec la critique a forcé les romanciers à s’éloigner de
l’extravagance et à se rapprocher du vrai. Il préfère expliquer l’essor du genre par des raisons
d’ordre sociologique, jugeant la critique, "dans son ensemble, réactionnaire et rétrograde"53.
Non seulement les querelles sur le roman sont de mauvaise foi, mais les polémistes
des deux côtés donnent l’impression de ne pas parler de la même chose. Selon H. Coulet, "si
la réflexion théorique sur l’essence du genre a progressé, ce n’est certainement pas au
dialogue entre les critiques et les romanciers qu’elle le doit"54. Écartant de ses analyses la
notion de dilemme, H. Coulet résume les attaques esthétiques et morales des principaux textes
de l’époque commentés par G. May. Il ramène les premières au dogmatisme esthétique
contradictoire et confus dans ses principes, mais recouvrant « une réalité sociologique très
forte ». Celle-ci relève du "goût aristocratique qui régnait dans la poésie et au théâtre, et avait
régné dans le roman"55.
Quant aux réquisitoires moraux, H. Coulet estime que les romanciers ne pouvaient
"prétendre être les défenseurs de la morale et de la vertu qu’en jouant sur les mots", étant
donné que le roman de l’époque peint "des passions condamnables aux yeux de la morale
étroite" et apporte en même temps "aux problèmes de conduite une réponse libératrice".
Constatant que le roman "prêtait sa voix aux tendances de l’époque moderne, hédonisme,
individualisme, réalisme, sensibilité", H. Coulet explique le mépris pour le roman par "les
partis pris littéraires et les préjugés antiphilosophiques"56. A ses yeux, la plus virulente
attaque contre le roman antérieure à la publication de La Nouvelle Héloïse (1761), contenue
dans l’Entretien sur les romans de l’abbé Jacquin (1755), constitue "un éclatant hommage à la
modernité du genre romanesque et une reconnaissance sans réserve du succès qu’il rencontrait
auprès du public"57. En effet, en dépit des accusations dont il est accablé, le roman se porte
50 Henri Coulet, Le roman jusqu’à la Révolution, Paris, Armand Collin, (1967), 2000, p. 297. 51 Ibid., p. 298. 52 Ibid., p. 298. 53 Ibid., p. 298. 54 Ibid., p. 298. 55 Ibid., p. 298. 56 Ibid., p. 299. 57 Ibid., p. 303.
18
bien, parfaitement reconnu par un vaste public de lecteurs. A la nécessité de se légitimer sur le
plan théorique s’opposait une légitimité factuelle.
Dans Le Roman à la première personne, René Démoris fait référence à l’ouvrage de
G.May en notant à son tour que les romanciers et les critiques s’engagent dans un dialogue de
sourds. Comme H. Coulet, il voit dans les attaques contre le roman l’indice de l’autonomie
grandissante du genre: malgré la divergence de leurs jugements de valeur, des auteurs tels
Lenglet, Bougeant, Porée, Argens ou La Chesnaye des Bois érigent le roman en sujet digne
d’intérêt. Pour R. Démoris, si crise du roman il y a, elle concerne plutôt les questions des
rapports entre l’histoire et le récit de fiction, entre la vraisemblance du narré et l’authenticité
de l’énonciation, qu’un dilemme dans lequel le roman serait enfermé par son conflit avec la
critique. Il note d’ailleurs que celle-ci se fait plus nuancée qu’on ne le dit habituellement :
c’est moins "le principe" du roman qui est attaqué que « la faiblesse ou l’immoralité des
œuvres existantes"58. Si elle s’en prend aux ouvrages les plus neufs et les plus intéressants, la
raison en est que "les mêmes œuvres qui ont suscité le besoin de réévaluation du roman sont
aussi celles qui, en raison de leur nouveauté, se laissent le plus malaisément apprécier au nom
des critères traditionnels"59. Cette inadéquation des jugements critiques s’explique enfin par
"la dénivellation entre l’intérêt suscité par une œuvre et la dignité de son statut dans la
hiérarchie des genres"60. Comme désorientée à son insu par l’illégitimité du roman, la critique
qui le vise est pourtant moins vide de sens qu’on ne pourrait penser : elle traduit "l’importance
nouvelle du genre romanesque"61. Des historiens du roman tels que H. Coulet et R. Démoris
vont donc au-delà de l'interprétation du "dilemme" proposée par G. May sans s’en démarquer
clairement. Mais ils voient aussi d’autres griefs qui expliqueraient la mise en cause du genre
au XVIIIe siècle.
Béatrice Didier adhère aux termes du dilemme mayien, mais avance que celui-ci n’est
pas le seul qui se pose : selon elle, c’est la technique même de la narration qui est remise en
cause. Ce qui semble central, c’est un problème d’énonciation: le ‘je’ qui commence à
apparaître authentifierait la vérité de la narration tout en affirmant la stricte subjectivité du
point de vue. Le dilemme multiple qui serait à identifier concerne les rapports entre réalité et
fiction, mais aussi entre le "romanesque" traditionnel et la trivialité du monde social qui
accède à la représentation 62.
Robin Howells63 inscrit le dilemme de G. May dans la continuité de l'âge classique en
analysant la réflexion sur le romanesque antérieure au développement du roman des
Lumières. Il commente les Conférences de Théophraste Renaudot (1634-1641) où le roman
apparaît déjà opposé à l'histoire comme la folie s'oppose à la raison. Ce texte du XVIIe siècle
expose une perspective selon laquelle c’est une folie de "préférer à la réalité les images d’une
fantastique beauté et les discours fabuleux en général"64. Selon R. Howells, dans le processus
qui déplace vers le roman la fonction de représenter le monde social et individuel
contemporain, le roman du XVIIIe siècle se voit graduellement investi de deux fonctions
différentes, qu’il dénomme "intramondaine" et "extramondaine". La première tendance, dont
il identifie la cristallisation dans les textes de Prévost, Crébillon, Baculard d'Arnaud ou
Diderot, correspond au roman qui "nous fait voir notre monde"65. La deuxième assigne au
58 René Démoris, Le Roman à la première personne. Du Classicisme aux Lumières, Paris, Armand Colin, 1975,
et Genève, Droz, 2002, p.447 59 Ibid., p. 447 60 Ibid., p. 447 61 Ibid., p. 447. 62 Béatrice Didier, Histoire de la Littérature française du XVIIIe siècle, Paris, Nathan, 1992, p. 35, 98. 63 Robin Howells, “Statut du romanesque : l’opposition roman / histoire dans la pratique signifiante de 1635 à
1785”, in Folies romanesques au siècle des Lumières, Paris, Desjonquères, 1998 64 Ibid., p. 21. 65 Ibid., p. 35.
19
roman la fonction de représenter une vérité idéale ou idéalisante: "le roman est et doit être tout
ce qui n’est pas, le portrait d’un monde qui soit différent et supérieur au nôtre"66. Le dilemme
du roman tiendrait dès lors à une différentiation des points de vue au sein même de la critique,
où plusieurs conceptions poétiques se concurrencent.
Hormis les accusations fondatrices de la théorie de G. May qu'il reprend, Didier
Masseau insiste sur un autre reproche adressé au roman: celui-ci se verrait accusé à cause de
sa faculté imaginaire, c’est-à-dire son pouvoir de provoquer l’adhésion du lecteur à une réalité
fictive, jugée fausse. L’adhésion provoquée par le roman est pernicieuse en ce qu’elle
présente au lecteur des modèles de conduite empruntés à une réalité qui n’est pas véritable. 67
J. Sgard, quant à lui, approfondit l’interprétation mayenne de la crise en proposant son
inscription dans le tissu romanesque même:
Le romanesque des grands romans n’a jamais disparu, et il s’est toujours mesuré à un
besoin de réalisme social. Dans les années trente les romanciers intériorisent le
dilemme: le romanesque est devenu le romanesque du cœur, un ensemble
d’aspirations à l’amour et à la grandeur, qui se voient contrariées par les exigences de
la famille ou de la société.68
Si une conclusion provisoire peut être tirée de ces quelques lectures de l’hypothèse de G.
May, c’est que si dilemme il y a, il se traduit d'autant de manières qu’il y a de spécialistes. Le
regard posé sur le roman au XVIIIe siècle multiplie les dilemmes et paradoxes, tant au niveau
des reproches adressés au roman par la critique, qu’au sein de cette critique même, qui est loin
d’être unanime. Le fait même qu’un immense lectorat favorable contredisait ces avis
défavorables ne pouvait que déstabiliser davantage la position du roman au sein du champ
littéraire. Quand ensuite le dilemme s’intériorise, il devient en quelque sorte constitutif du
roman: et paradoxalement encore, en s’intériorisant, il semble se résoudre.
La crise et le statut de la fiction
Les dernières années du XXe siècle et le début du XXIe ont été marquées par la
publication d'ouvrages de spécialistes se démarquant des théories qui ont fait école dans
l’histoire littéraire antérieure. Parmi eux, on pourrait compter notamment Daniel-Henri
Pageaux, Jean-Paul Sermain, Marian Hobson, Alain Montandon, Jean-Jacques Tatin-Gourier,
Jean-Michel Racault et Thomas Pavel. Bien qu’ils évoquent les termes d’accusations contre le
roman relevés par G. May, ils tendent à s'éloigner de son interprétation de la crise du roman, à
atténuer l'opposition entre les aspects esthétique et moral des controverses du temps, et à
mettre l'accent sur la problématique du statut de la fiction romanesque dans le champ littéraire
et au sein du roman lui-même.
D.-H. Pageaux déplace le débat en insistant sur la nature fictionnelle de l’histoire
romanesque. En renvoyant implicitement à la théorie des mondes possibles, il soutient que
tout roman se propose de présenter un autre monde, à l’existence duquel il prétend. Ceci
rendrait donc vain les problèmes du réalisme et de la vérité appliqués au roman. A ses yeux, la
vraie crise du roman relève de "la tension entre l’illusion inhérente à toute fiction et le réel
auquel elle renvoie par convention"69. Car écrire, c’est feindre, et le propre de l’histoire
66 Ibid., p. 35. 67 Didier Masseau, XVIIIe siècle : incertitude et triomphe du roman, in Le roman, Littérature, coll. Grand
Amphi Littérature, éd. Bréal, 1996, p. 128. 68 Jean Sgard, Le Roman français à l’âge classique, 1600-1800, Paris, Livre de poche, 2000, p. 109-110. 69 Daniel-Henri Pageaux, Naissance du roman, p. 66.
20
romanesque est d’être une fiction. D.-H. Pageaux se demande si le roman est un genre en
crise. Etymologiquement, crisis signifie en grec "examen". "Le roman est en crise parce qu’il
s’examine […] Il porte en lui la critique du genre auquel il prétend appartenir"70. D.-H.
Pageaux évoque les analyses de Gérard Genette qui démontrent qu'une lecture fautive de la
fameuse triade aristotélicienne, faite par Goethe, puis par Hegel, a abouti à la distinction des
genres épique, lyrique et dramatique. Aristote pose la double distinction des modes (narratif
et dramatique) et des objets (inférieurs et supérieurs). Quatre possibilités s’offrent alors : la
tragédie (mode dramatique, objet supérieur), l’épopée (narratif, supérieur), la comédie
(dramatique, inférieur). Reste le quatrième (narratif, inférieur, parodie) dont Aristote ne traite
pas. Cette "fausse fenêtre", la case "structurellement vide", sera remplie par le roman71.
Pageaux rappelle ainsi les analyses de Mikhaïl Bakhtine selon lequel le roman, seul genre
constitué en contact avec la réalité, présente une histoire qui se veut "vraie, réelle, en dépit (ou
à cause) de son caractère de fiction"72.
La théorie bakhtinienne du genre romanesque, que D.-H. Pageaux évoque brièvement,
a laissé de nombreuses traces dans la réflexion récente sur la crise du roman au XVIIIe siècle.
Depuis plusieurs décennies, la pensée de Bakhtine s'est largement disséminée dans les études
sur le roman du XVIIIe siècle, au point d'en devenir une sorte d'héritage commun. Ses
spécificités ne sont pas toujours clairement identifiées même par ceux qui s'en nourrissent,
peut-être à leur insu. Il paraît utile d'en rappeler quelques aspects particulièrement pertinents
pour la discussion sur le dilemme du roman tel qu'il est envisagé par G. May.
La réflexion de Bakhtine est axée sur l'analyse du discours, "la langue dans sa réalité
concrète"73. Le théoricien russe voit le champ discursif romanesque depuis l’antiquité comme
organisé par une dynamique oppositionnelle enter deux "lignes stylistiques du roman". Le
roman de la première ligne stylistique s’est élaboré dans le courant des "forces centripètes du
langage", autrement dit, des tentatives d’unification du langage liées au devenir verbal (et
donc idéologiques, dans le sens bakhtinien, large, du terme) des groupes sociaux
idéologiquement dominants. Il est caractérisé par un style monologique et abstrait, en ce qu’il
fait abstraction du plurilinguisme de la vie courante74. Il subjugue son matériau à un langage
unique et conventionnel qui s’oppose comme langage « noble » ou canonique unifié à des
formes variées considérées comme basses et vulgaires. Ce langage conventionnel,
spécifiquement littéraire a déterminé, à en croire Bakhtine, les théories du genre romanesque
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle75. Contrairement à ce type de roman, où le langage n’est pas
lui-même objet de représentation, le roman de la seconde ligne stylistique donne une place de
choix à la représentation du plurilinguisme et du discours d’autrui, en recourant aux
stylisations, à la parodie, à la polémique plus ou moins cachée. Il va vers le plurilinguisme,
associant des procédés de représentation des variantes sociales du langage à une méfiance
générale envers la parole sérieuse et autoritaire76.
Ainsi, la seconde ligne stylistique s’applique à dévoiler, parodiquement et
polémiquement, la "virtuelle dialogisation interne contenue dans le langage noble"77. Si celui-
ci s’établit par opposition au plurilinguisme, la seconde ligne détruit ce plan littéraire élevé et
abstrait pour réduire ce langage conventionnel à un simple participant du dialogue plurilingue.
Le plurilinguisme, qui se dévoile dans l’utilisation des différents langages et codifications
70 Ibid., p. 63. 71 Ibid., p. 10-11. 72 Ibid., p. 13. 73 Mikhaïl Bakhtine, La Poétique de Dostoïevski [1929], Paris, Seuil, 1970, p. 252. 74 Mikhaïl Bakhtine, "Du discours romanesque" [1934-35], in Esthétique et théorie du roman, Paris, Gallimard,
1978, p. 193. 75 Ibid., p. 188. 76 Ibid., p. 213-214. 77 Ibid., p. 198.
21
narratives comme objets de représentation, est inséparable des "forces centrifuges du
langage", des tentatives d’opposition à l’unification et à la centralisation du langage.
Pour Bakhtine, le plurilinguisme est par définition "parodiquement et polémiquement
braqué contre les langages officiels de son temps"78. Appartenant à la seconde ligne, les
formes parodiques se développent par opposition à ce qui est perçu comme conventionnel,
monologique et abstrait. Le roman de cette facture privilégie le temps-espace concret de la vie
courante, une logique de la crise et de l’initiative et une image de l’homme installé de plain
pied dans la société de son temps. Aussi la perspective bakhtinienne permettrait-elle
d'identifier, au sein du discours romanesque du XVIIIe siècle, un roman de la première ligne
stylistique qui s’accommode de la critique du roman, interagit avec elle, y répond et tente de
s’y conformer. Mais elle permet aussi de discerner un roman appartenant à la seconde ligne
stylistique, opposé à un tel accommodement.
Précisons que, dans une telle perspective, l’appartenance exclusive d’un roman à une
des deux lignes stylistiques ne peut être établie. Tout roman incorpore les éléments des deux
lignes stylistiques. Leur opposition devrait être envisagée comme une polémique
intraromanesque variable dans le temps : tout roman, une fois publié, sera à son tour de
l’ordre du matériau réutilisable par d’autres romans et appartiendra davantage à l’une ou
l’autre des deux lignes. Dans le champ des discours romanesques, les rapports entre les
éléments des deux lignes stylistiques organisent une polémique flottante qui suit l’évolution
des conventions romanesques.
Le dilemme du roman, tel qu’il est envisagé par G. May, pourrait donc, dans la
perspective bakhtinienne, être envisagé en fonction d’une interaction dialogique interne au
discours romanesque. Dès lors, la condamnation critique du roman n’apparaît pas tant comme
une donnée qui lui est extérieure que comme une donnée discursive et axiologique que tout
roman intègre d’une façon ou d’une autre. La perspective bakhtinienne permet d'apporter trois
correctifs à l'hypothèse du "dilemme" avancée par G. May.
D'abord, la réaction du roman n’est pas nécessairement de l’ordre de la défense ni du
conformisme. Elle peut être simplement envisagée comme une position de non-défense.
Ensuite, G. May évacue de son étude les œuvres qui "ne contribuent guère à son propos"
parce qu'ils n'étaient "guère faits pour résoudre le dilemme, ni pour se concilier le bon vouloir
de la critique"79. Ce faisant, il met de côté la seconde ligne stylistique du roman, précisément
parce qu'elle ne se conforme pas à son point de départ et ne correspond pas à l'image d'un
genre romanesque sur la défensive. Or, l'existence d'un roman polémique et parodique vis-à-
vis des forces centripètes du langage contient la promesse d'une issue au dilemme et suggère
que le roman avait précisément tout intérêt à se développer en dehors de la sphère centripète
des discours valorisés. Finalement, c'est justement le roman parodique qui peut être envisagé
comme "réaliste" dans la mesure où il donne une ample place à la représentation du langage,
notamment celui typiquement littéraire confronté à un ensemble de langages sociaux.
L'évolution du roman vers un plus grand réalisme n'est pas un objectif historique du roman,
mais l'effet d'un remplacement au sein du système littéraire de conventions narratives
devenues inappropriées ou démodées. La parodie des conventions, typique de la seconde ligne
stylistique, a pu jouer un rôle important dans l'évolution du roman du temps. Elle est
intrinsèquement liée aux forces centrifuges du langage, à la représentation des multiples
langages sociaux et de la vie concrète des individus et des groupes qui les parlent.
Bref, le dilemme du roman apparaît dans la perspective bakhtinienne comme dilemme
d'un certain roman, celui de la première ligne stylistique qui cherche en vain un
rapprochement avec les discours centripètes. Interagissant avec lui, un autre roman plus
dialogique, ouvert aux possibilités d'exploitation du langage, semble suggérer que le genre
78 Ibid., p. 96-97. 79 Georges May, Le Dilemme du roman au XVIIIe siècle, p. 201.
22
avait tout intérêt à ne pas se défendre contre la double condamnation mise en avant par G.
May qui, en un sens, fait son succès. Maintenant le roman hors du conventionnel, à l'écart des
discours centripètes et valorisés, la condamnation lui aurait permis de se développer plus
librement que les genres canoniques, de répondre mieux et plus rapidement aux soucis d'un
public de plus en plus diversifié.
Métafictions de Jean-Paul Sermain est sans doute l’ouvrage récent qui doit le plus à
l’idée bakhtinienne du roman en tant que discours composite à l’intérieur duquel s’opèrent les
renversements des codes et des croyances de la culture officielle. Le fonctionnement critique
de la fiction romanesque que Bakhtine attribue au roman où domine la "deuxième lignée
stylistique", dépourvue de légitimité culturelle, reléguée dans les marges de
l’institutionnalisation littéraire et privilégiant différents mécanismes de retournement des
discours et des vérités agréées affiliés à la culture carnavalesque, tels parodie ou ironie, est
pensé par J.-P. Sermain comme le fonctionnement essentiel du paradigme romanesque qui
domine la production des récits de fiction entre 1670 et 1730. Même les ouvrages conçus
comme représentatifs d'un paradigme romanesque qui s'affirme comme une valeur littéraire
nouvelle, tels les romans de Marivaux, Prévost, Crébillon, Diderot, ou Laclos, montrent aux
yeux de J.-P. Sermain "des univers rongés par l’illusion, la tromperie, la manipulation"80, et
mettent en œuvre un travail de sape qui atteint les vérités et les discours tenus pour vrais et
véridiques.
J.-P. Sermain place sa réflexion dans le prolongement de celles de R. Démoris, dans la
mesure où celui-ci voit le roman du temps comme le dispositif textuel visant à susciter le
soupçon. En reprenant et déformant les narrations et discours tenus pour fiables ou véridiques,
le roman en dénonce la fausseté ou la pure conventionalité, il les présente comme fictionnels.
Mais pour J.-P. Sermain, cette dénonciation de la fiction est elle-même et simultanément le
mécanisme de la production du récit de fiction, qui conjugue ainsi la construction d’un monde
fictionnel vraisemblable avec un travail herméneutique et critique sur le matériau fictionnel
dont il se nourrit. J.-P. Sermain expose un modèle subtil et nuancé d’interpénétration des deux
lignées stylistiques bakhtiniennes appliquées au roman de la fin du XVIIe et du début du
XVIIIe siècles, dans lequel le paradoxe d’une dénonciation fictionnelle de la fiction, l’ironie
et la parodie apparaissent comme des mécanismes centraux du roman, tout entier placé sous le
signe paradigmatique de Don Quichotte.
Dans un sens, J.-P. Sermain revalorise les observations des critiques du roman de l'âge
classique commentés par G. May, qui voient le récit romanesque comme le discours qui vise à
brouiller les distinctions entre le vrai et le faux81. En insistant sur la fonction épistémologique
de la fiction romanesque, il analyse le roman comme le mécanisme discursif qui exhibe la
fiction et ses pouvoirs d’égarement tout en utilisant la fiction elle-même pour dénoncer ses
méfaits et l’offrir à l’appréciation du lecteur en tant que fiction vraisemblable.
Dans cette perspective, tout roman est à la fois roman et antiroman. La parodie et la
reprise discursive en sont les configurations langagières essentielles. Le récit romanesque
propose une fiction reprise du monde discursif et narratif existant, et la dénonce comme
fiction tout en la vraisemblabilisant. Le dilemme du roman, si dilemme il y a, ne se lit plus
dans le rapport entre le roman et la critique. Intériorisé, le dilemme concernerait la distinction
incertaine entre la fiction et le mensonge, que le roman ne vise pas à résoudre, mais dont il
fait son matériau.
L'ouvrage de Marian Hobson, The Object of Art. The Theory of Illusion in Eighteenth-
century France a sans doute joué un rôle de tout premier plan dans le déplacement du
dilemme mayien. Celui-ci ne dépend plus du rapport entre le roman et la critique, mais de
80 Jean-Paul Sermain, Métafictions (1670-1730). La réflexivité dans la littérature d'imagination, Paris,
Champion, 2002, p. 88. 81 Voir en particulier Armand-Pierre Jacquin, Entretiens sur les romans, Paris, Duchesne, 1755, pp. 213, 237.
23
celui que le roman établit entre sa propre facture et l'image qu'il tente de projeter de lui-même.
Deuxième déplacement: le dilemme du roman concerne le flottement de son statut entre les
pôles factuels et fictionnels du récit. M. Hobson analyse d'abord le statut de la fiction dans les
arts picturaux du XVIIIe siècle, puis dans le roman. Elle conceptualise le rapport entre le réel
et le fictif à l'aide de deux notions: aletheia et adequatio. La première concerne un rapport
"bimodal" à l'illusion. Dans ce cas, le récepteur de l'œuvre d'art est soumis à l'illusion tout en
étant conscient qu'il s'agit d'une illusion. Cette conception trouve sa réalisation historique dans
l'art baroque et rococo. Vers le milieu du siècle, au moins dans le domaine artistique, la
conception bimodale de l'illusion cède à une conception que Hobson nomme « bipolaire ».
Celle-ci correspond à une méprise du récepteur qui est trompé et prend, même
momentanément, la représentation pour la réalité. Le XVIIIe siècle connaît une évolution
d’une illusion "douce", bimodale, à une illusion "forte", totale, bipolaire. L’illusion comme
méprise remplace graduellement le jeu illusionnel initial. L’illusion apparaît comme un outil
dans le remplacement de l’œuvre d’art comme représentation par l’œuvre d’art comme
reproduction.
Dans l'illusion bimodale, l’art ne réfère pas à quelque chose d’extérieur à lui, mais
plutôt à sa propre réalité de signe, en insistant sur son propre manque de signification
intrinsèque. Cette structure d'appel de l'œuvre est associée à un mouvement dit de
"papillotage", un mouvement d’"aller-retour" entre la perception de l’objet et la conscience de
l’objet. L'art engage les sens, mais ne trompe pas la raison. A partir du milieu du siècle une
approche différente de l’illusion s’impose, qui tente d’exclure, d’évacuer, plutôt que d’inclure
la conscience du spectateur. L'art est perçu comme une tentative de fournir une représentation
de la chose assez vraisemblable pour que l’esprit se prenne au piège de l’illusion et se croie
face à la réalité même.
Résumant brièvement la thèse mayenne, M. Hobson pose la question de savoir si
l'indéniable subversion romanesque, sur le plan moral et esthétique, peut constituer un
argument valable pour montrer l'évolution du roman vers une forme "réaliste". Elle critique
l'usage de la notion de "réalisme" dans la construction d'une histoire téléologique du roman, et
remarque que la réception du roman au XVIIIe siècle n'était pas tant concernée par sa
véridicité que par les circonstances fictionnelles de son énonciation: si celle-ci n'était pas
crédible, le récit raconté ne pouvait pas l'être non plus. 82
Comme le fera plus tard J.-P. Sermain, M. Hobson situe les enjeux de l'évolution du
roman dans le maniement de la fictionnalité du récit. L'emploi intensif des techniques
d’authentification à partir de 1670 environ place le roman dans l’espace entre le domaine de
l’histoire et du romanesque. Le roman va jouer sur le mélange des deux pour semer le doute
sur son propre statut. Remarquons que la trace de la réflexion de G. May dans ce
raisonnement reste perceptible. D'après G. May, le rapprochement entre le roman et l'histoire
est une des composantes centrales de la recherche d'une nouvelle vraisemblance entreprise par
le roman de la première moitié du XVIIIe siècle. Selon M. Hobson – et là aussi, les
observations de G. May demeurent sensibles - le problème du parasitage des techniques de
l’histoire par le roman se pose aussi bien aux critiques qu'aux romanciers. Pour parer aux
critiques, les défenseurs du roman insistent sur l’importance de la fiction dans le roman, ne
serait-ce que de manière biaisée ou paradoxale, justement pour le distinguer du vrai, conçu
comme appartenant au domaine de l'histoire. Le roman doit rester distinct de l’histoire tout en
la parasitant. Les stratégies qui servent à le rapprocher de l'histoire visent à exhiber plutôt qu'à
cacher son statut fictionnel. La trace de la théorie bakhtinienne du roman se lit chez M.
Hobson dans son affirmation selon laquelle le roman s'évertue à introduire le doute en
82 Marian Hobson, The Object of Art. The Theory of Illusion in Eighteenth-century France, Cambridge,
Cambridge University press, 1982, p. 85-87.
24
sollicitant la conscience de la possibilité de la fiction même, ou surtout, dans ce qui est
présenté comme véridique.
D'après M. Hobson, la majeure partie des romans du XVIIIe siècle exploite la
conversion générique non pas tant pour induire en erreur – ce qui correspondrait à l'illusion
comme adequatio – que pour éveiller le doute sur le statut fictionnel ou non du récit. Le
roman est du côté d'aletheia. Pour M. Hobson, comme plus tard pour J.-P. Sermain, il s'inscrit
dans le paradigme ouvert par Cervantès et renforcé par Scarron. Chez M. Hobson comme
chez J.-P. Sermain, la parodie, la reprise satyrique ou critique des narrations et formes
discursives par le roman jouent un rôle de premier plan, dans la mesure où elles impulsent et
guident le travail critique et herméneutique du récepteur. Pour les deux auteurs, le roman reste
un genre subversif. Même lorsqu'il paraît exclure le faux, affirmant qu'il ne présente que la
vérité, il montre que même l'adequatio repose sur une simple apparence du vrai plutôt que sur
les tentatives de sa parfaite reproduction.
J.-J. Tatin-Gourier ne conteste pas de manière explicite le dilemme mayien, mais ne se
prive pas de l'infléchir, l’enrichir et le reformuler. Affaiblissant l'opposition entre la
vraisemblance et la moralité avancée par G. May, il note que dans le premier versant du
siècle, le sens du réel "est presque unanimement identifié à la moralité du roman"83. Si
l'apologie du roman éminemment moral parce qu'essentiellement véridique ne fait pas
l'unanimité vers le milieu du XVIIIe siècle, et que le traditionnel procès de l'immoralité
s'amplifie, cette évolution tient surtout aux appréhensions nées du rôle joué par la fiction
narrative dans le combat philosophique et dans la représentation des mœurs libertines84. J.-J.
Tatin-Gourier insiste sur la conscience du lecteur d’époque qui se ressent des nouvelles
modalités de lecture du récit fictif qui surgissent au XVIIIe siècle. Le dilemme du roman se
déplace vers le domaine du difficile maniement de la conscience de la fictionnalité du récit.
La lecture n’est plus naïve, mais savante, habile à interpréter comme tels des procédés
narratifs. L’évolution du roman s’accompagne d’une réflexion sur la fiction, sur le rapport du
lecteur à l’auteur et sur l’acte même de la lecture. De fait, la fiction est essentiellement un
artifice. "Tout en produisant l’illusion du réel, le récit romanesque doit aussi se présenter pour
ce qu’il est : un simulacre"85. Les différents procédés d'authentification du récit, parmi
lesquels la simulation du récit oral, permettent d'en exhiber le caractère fictif. Ainsi, le roman
qui prétend retranscrire le récit oral peut à la fois multiplier les détails aptes à produire un
effet de réalité et restituer les interventions du destinataire fictif du récit. Tout en répondant
aux exigences de la vraisemblance, le roman se signale comme fiction, ce qui n'empêche pas
qu'il produise en même temps l'illusion du réel86.
Pour J.-M. Racault, le débat autour du genre romanesque est indissociable d'une crise
plus profonde et générale des valeurs du monde classique87. Pour lui, la situation du roman
peut être expliquée par trois ordres de causes : il reprend les arguments moraux et esthétiques,
mais en ajoute un troisième qui serait d’ordre philosophique, et qu'il qualifie de "grief
majeur": le roman est pernicieux par cela même qu’il est fiction, c’est-à-dire fausseté. La
lecture du roman accoutumerait le lecteur "à aimer la fausseté"88. La fiction court le risque
d'être confondu avec le mensonge, et condamnée justement pour vouloir s'affubler de
83 Jean-Jacques Tatin-Gourier, Lire les Lumières, Paris, Dunod, 1996, p.118. 84 Ibid., p.118-119. 85 Ibid., p.110. 86 Ibid., p. 111. 87 Jean-Michel Racault, “Les jeux de la vérité et du mensonge dans les préfaces des récits de voyages
imaginaires à la fin de l’Age classique (1676-1726)”, in Métamorphoses du récit de voyage, actes du colloque de
la Sorbonne et du Sénat (2 mars 1985), recueillis par François Moureau, Paris-Genève, Champion-Slatkine,
1986, p. 86. 88 Jean-Michel Racault, "Les jeux de la vérité et du mensonge dans les préfaces des récits de voyage imaginaires
à la fin de l'Age classique (1676-1726)", p. 86.
25
véridicité afin de gagner le lecteur dubitatif. J.- M. Racault reprend deux principes esthétiques
qui servent d'appui à la récusation du roman au nom du statut ontologique de la fiction,
identifiés par Vivienne Mylne. Dans The 18th Century French Novel, techniques of illusion,
V.Mylne analyse la justification de la fiction comme une tactique défensive du roman89. Selon
J.-M. Racault, lecteur de V. Mylne, l'époque entretient une confusion entre la fiction et le
faux. Cette confusion prospère sur les lieux de croisement des deux postulats divergents. Le
premier tient au penchant fort prononcé de la conscience littéraire de l'époque selon lequel
l'implication intellectuelle ou affective du lecteur dans l'histoire relatée est subordonnée à la
conviction que celle-ci est vraie. Le deuxième relève du consensus établi parmi les
romanciers et les théoriciens sur une conception étroitement littérale de l'illusion romanesque
qui empêche de distinguer deux modalités de l'adhésion du lecteur, la créance littérale et le
consentement à l'illusion, "the willing suspension of disbelief", selon la formule de
Coleridge90.
Il y aurait donc différentes manières de croire au roman. Le roman pourrait en d’autres
termes susciter différents types d’adhésion. L’adhésion d’un joueur, par exemple. Dans un
article récent, Jean-Marie Schaeffer distingue quatre attracteurs sémantiques structurant
l’histoire quelque peu chaotique de la notion de fiction: l’illusion, la feintise, le façonnage et
le jeu. Le rapprochement de la fiction de l’« illusion » l’attire dans l’orbite de l’erreur.
Articulée sur la notion de « feintise », la fiction est rapprochée du mensonge. Le
« façonnage » comme troisième attracteur sémantique fait apparaître l’idée d’invention et
d’artifice. Le « jeu » enfin entraine la fiction du côté de l’enclave pragmatique, où elle peut
apparaître comme une « province non sérieuse enclavée dans la vie sérieuse »91. Où se situe
dans ce paysage la fiction artistique et par quels traits se définit-elle ?
Les pages que Jean-Marie Schaeffer a consacrées à cette question peuvent fournir de
nouvelles bases au questionnement complexe auquel nous confronte la situation du roman
dans la première moitié du XVIIIe siècle. Une illusion n’est pas forcément produite dans le
but de tromper ; on peut se tromper soi-même dans le traitement cognitif accordé à certaines
représentations qu’on se fait. Ce sont des « illusions cognitives ». Prise dans le sens de
feintise, fiction peut désigner des « manipulations » consciemment effectuées pour induire en
erreur. Comme dans le cas de l’illusion cognitive, ces représentations sont fausses, mais
répondent en outre à une double intentionnalité : elles sont produites comme erreurs dans le
but de tromper. Le terme de « fiction » peut aussi se rapporter aux « entités hypothétiques ».
Un électron est une fiction dans la mesure où c’est le « postulat d’une entité opératoire dont le
statut ontologique reste indécis ». « Fiction » désigne aussi l’« intrigue de supposition »,
comme situation virtuelle : « supposez que… », ou l’« expérience de pensée », qui sont des
dispositifs déductifs où la situation de départ constitue un ensemble de propositions
hypothétiques qu’il s’agit de vérifier par la suite, etc.
Tous ces types de fiction ont en commun qu’ils continuent à entretenir un lien avec le
véridictionnel. L’erreur, le mensonge, l’indétermination ontologique, la proposition
suppositionnelle, l’expérience de pensée… restent indexées sur le monde réel. La fiction
artistique par contre ne s’oppose pas à la vérité mais n’est pourtant pas indexée sur le monde
réel. Elle relève de l’immersion. Sa validation n’est pas de l’ordre de la discrimination
logique. Jean-Marie Schaeffer formule cette différence essentielle ainsi :
89 Vivienne Mylne, The 18th Century French Novel, techniques of illusion, Manchester University Press, Barness
and Noble, NY, 1965. 90 Jean-Michel Racault, "Les jeux de la vérité et du mensonge dans les préfaces des récits de voyage imaginaires
à la fin de l'Age classique (1676-1726), p. 87. 91 Jean-Marie Schaeffer, “Quelles vérités pour quelles fictions”, in Vérités de la Fiction, numéro spécial de
L’Homme. Revue française d’anthropologie 175-176 (2006), p.20.
26
Une expérience de pensée est un dispositif expérimental de nature logique, un univers
suppositionnel ou contrefactuel construit pour résoudre par des voies formelles (c’est-
à-dire en suivant les règles d’inférences) des problèmes ne pouvant être résolus par des
voies empiriques (que ce soit pour des raisons pratiques ou parce que toute enquête
empirique présuppose leur solution). Une fiction artistique, en revanche, nous invite à
nous immerger mentalement ou perceptivement dans un univers narré ou dans un
semblant perceptif, et à en tirer une satisfaction immanente à l’activité même de cette
immersion. Assimiler ce type d’expérience cognitive au fonctionnement des
expériences de pensée nous interdit d’en comprendre à la fois le fonctionnement et les
fonctions92.
Alors que l’illusion cognitive, la manipulation par la feintise, les hypothèses
d’indétermination ontologiques, les intrigues suppositionnelles et les expériences de pensée
tombent toutes sous un régime où la question de la vérité est pertinente, celle-ci est sans
pertinence pour la fiction artistique, qui est à comprendre, selon J.-M.Schaeffer, sous le signe
du « jeu » : « l’irréductible particularité de la fiction artistique réside en effet dans le fait
qu’elle est la cristallisation culturelle la plus ambitieuse d’une activité dont les premières
traductions sont les jeux fictionnels des enfants »93. La feintise ludique est une compétence
psychologique acquise par l’enfant durant le processus de la maturation et dont dépend
l’acquisition d’une identité affective et cognitive stable. Elle repose, pour l’adulte, sur un
contrat qui « nous invite en effet à isoler les représentations qu’il encadre du réseau de
croyances d’arrière-plan qui délimitent notre vision du réel et de construire l’univers
fictionnel comme un monde clos sur lui-même94.
Le triomphe du roman en Europe
La question qui se pose à l’issu de ce survol est de savoir s'il est indispensable de
formuler la « situation inconfortable » du roman en termes de dilemme ou même de crise.
Chez I. Watt, nous ne voyons ni crise ni dilemme. L’auteur de The Rise of the Novel. Studies
on Defoe, Richardson and Fielding ne rend pas non plus compte d’accusations contre le
roman.95. Publié en 1957, cet ouvrage demeure un point de référence de l’histoire littéraire.
Les points de vue d’I.Watt ne convergent pas avec ceux de G.May, même si leurs thèses sont
apparues à peu d’années d’intervalle. La théorie du premier est pratiquement absente des
histoires littéraires françaises96. Le plus souvent on s’en tient à parler de la différence que
seule la langue anglaise peut rendre en opposant the romance et the novel.
L’une des thèses avancées par Ian Watt est que la naissance du réalisme a donné jour
au roman anglais du XVIIIe siècle. Le roman est pour Watt une forme littéraire nouvelle qui
commence avec Defoe, Richardson et Fielding et diffère de la fiction en prose antérieure.
Cette différence réside dans l’emploi du “réalisme”, caractère déterminant qui distingue les
ouvrages des romanciers du début du XVIIIe siècle des œuvres de fiction précédentes. Le
réalisme du roman anglais du XVIIIe siècle, bien différent de ce que l’on appellera “réalisme”
au XIXe siècle, ne réside pas dans le genre de vie qu’il représente, mais dans la manière dont
il le fait. I. Watt explique la nature du réalisme romanesque par des analogies avec le réalisme
92 J.-M.Schaeffer, 2006, p.24-25. 93 J.-M.Schaeffer, 2006, p.32. 94 J.-M.Schaeffer, 2006, p.33. 95 Ian Watt, The Rise of the Novel, Studies on Defoe, Richardson and Fielding, London, Chatto and Windus,
1957. 96 Dans les histoires littéraires que nous avons consultées, il n’y a que Daniel Pageaux qui cite son nom et fait un
résumé de ses théories. Voir sa Naissance du roman, Paris, Klincksieck, p. 69-72.
27
philosophique. Toutefois, il ne va pas jusqu’à dire que le réalisme romanesque en tire son
origine.
Le roman serait une forme littéraire reflétant la réorientation individualiste et novatrice
(novel, et non plus romance) qu’a prise la pensée au XVIIIe siècle. Son critère principal serait
la vérité par rapport à l’expérience individuelle : toujours unique et par conséquent nouvelle.
Le roman anglais est l’expression d’une nouveauté, d’une originalité. Il rejette des sujets
traditionnels du romance et son style conventionnel, en rendant compte de la vie réelle,
actuelle, à partir d’un point de vue particulier, individualiste. L’historien anglais insiste sur
l’usage référentiel du langage et en fait un élément de nouveauté.
La technique narrative du roman qui reflète pleinement ce changement pourrait être
appelée ‘réalisme formel’. ‘Formel’, selon I. Watt, parce qu’il se réfère à un ensemble de
procédés narratifs que l’on trouve réunis par excellence dans le roman et que l’on peut donc
considérer comme typiques de la forme elle-même. Le ‘réalisme formel’ est, en fait,
l’incarnation narrative d’une prémisse implicite dans la forme du roman en général. Selon
cette prémisse, ou cette convention première,
Le roman est un compte rendu complet et authentique de l’expérience humaine, et est
donc dans l’obligation de fournir à ses lecteurs des détails du récit tels que
l’individualité des personnages en cause, les particularités spatio-temporelles de leurs
actions, détails qui sont présentés au moyen d’un emploi du langage plus largement
référentiel qu’il n’est d’usage dans les autres formes littéraires97.
Le roman permet une imitation de l’expérience individuelle immédiate dans son
environnement spatio-temporel, ce qui fait du genre romanesque la forme la plus apte à
exprimer l’étroite correspondance entre la vie et l’art. I. Watt fait de ce "réalisme formel" le
trait caractéristique du roman moderne ainsi qu’une condition nécessaire de son "ascension".
Sa perspective est entièrement ramenée aux questions de réalisme qui auraient
déterminé l’apparition du roman moderne, the novel. Reste que la terminologie d'histoire
littéraire anglaise installe de fait une coupure nette entre deux types de récits fictionnels en
prose, the romance et the novel, et que cette césure correspond à la mutation du romanesque
qui s'engage vers le commencement du XVIIIe siècle.
Alain Montandon est un des rares historiens de la littérature, sinon le seul, à élargir le
champ de la recherche en prenant en compte la critique allemande de l’époque. En 1774,
c’est-à-dire assez tardivement par rapport à la période qui nous intéresse, paraît l’Essai sur le
roman de Friedrich von Blanckenburg qui marque une vraie révolution dans les théories
romanesques de l’époque. Aux termes de cette théorie dont A. Montandon présente les
grandes lignes, le genre romanesque est, par essence, une déformation du réel. Blanckenburg
l’appelle "une histoire vraie fictive"98. Le paradigme du « roman véritable » est ainsi
explicitement attesté. Grâce à cette acception, que Blanckenburg n'était pas le seul à relever,
le roman est réhabilité et reconnu par les théories esthétiques en tant que genre d’une
indiscutable modernité99. On rejoint le point de vue d’A. Montandon, qui est aussi celui de
M.Hobson et de J.-P. Sermain, selon lequel l’enjeu du débat autour du genre romanesque au
XVIIIe siècle résiderait dans le consentement à l’illusion, dans l’acceptation de l’illusion
97 "The novel is a full and authentic report of human experience, and is therefore under an obligation to satisfy its
reader with such details of the story as the individuality of the actors concerned, the particulars of the times and
places of their actions, details which are presented through a more largely referential use of language than is
common in others literary forms", Ian Watt, op. cit., p. 32. 98 Ibid., p. 42. 99 Ibid., p. 41-44.
28
romanesque ou dans sa contestation. Le XVIIIe siècle ne se défera que progressivement de
l’empreinte de la théorie néo-aristotélicienne de la mimesis aux termes de laquelle la fiction
est légitimée par son respect de la vraisemblance: "le problème du statut de la fiction
tourmente les romanciers qui hésitent devant les différentes sortes de croyances et the willing
suspension of disbelief que le roman implique"100.
"A chaque époque, les réussites du roman sont infiniment plus ambitieuses que celles
du besoin de bien écrire et de bien raconter. La littérature s’interroge sur des sujets autrement
profonds et, pour divergentes qu’elles puissent paraître, les formes que le roman a prises au
cours de son histoire n’en sont pas moins liées par la permanence de cette interrogation".
Avec cette phrase, T. Pavel achève sa récente histoire du roman occidental, qui marque une
actualisation toute récente sinon de l'argumentation de G. May dans son ensemble, au moins
des termes du débat qu'il a impulsé101. La problématique que T. Pavel estime être constitutive
du roman dès sa naissance se définit, aux différents moments de son évolution, par les
rapports particuliers et mouvants qu’il noue entre l’individu, l’idéal moral et la communauté
humaine. Ecartant de ses analyses les rapports entre le roman et les exigences critiques
formulées à son encontre, T. Pavel situe "la pensée du roman" dans la réflexion que celui-ci
propose ou impulse à propos de l'appartenance de "l'idéal moral" à "l'ordre du monde"102. Les
deux exigences contradictoires relevées par G. May se déplacent, tout en perdant de leur
caractère antinomique, ou plutôt, tout en étant conçues comme tension permanente inscrite
non dans le rapport du roman avec ses critiques, mais dans l'anthropologie romanesque.
Dans le vaste panorama déployé par T. Pavel, le XVIIIe siècle opère un premier grand
tournant. A l’époque précédente, qui couvre le roman hellénistique, le roman de chevalerie
médiéval et le roman pastoral baroque, les œuvres qui représentent ces trois formules
narratives se caractérisaient par la domination d’une idée, la multiplication apparemment
immotivée des épisodes et l’invraisemblance des aventures et des caractères. Cette
multiplication et cette invraisemblance tiennent moins à une méconnaissance de l’effet de réel
par leurs auteurs qu’au fait que "le projet artistique et moral auquel ils souscrivaient -[…] la
représentation de l’idéal moral dans toute sa majesté - les encourageait à inventer des modèles
exaltants plutôt qu’à raconter des faits plausibles"103. Le XVIIIe siècle interrompt cette
idéographie dans la mesure où l’idéal moral sera progressivement intériorisé. L'exigence
morale posée au roman relevée par G. May dans les textes critiques du XVIIIe siècle s'intègre
chez Pavel à la problématique de la vraisemblance, - il évoque à ce sujet la "vraisemblance
descriptive et les effets d'immersion évoquant le vécu immédiat du personnage"104 - sous le
signe de laquelle le roman du XVIIIe siècle se demande précisément si "l'individu est, oui ou
non, la source de la loi morale"105.
Si l’époque prémoderne avait placé les normes de l’idéalité morale en-dehors de
l’homme et les avait conçues à la fois comme extérieures et supérieures, le roman du XVIIIe
siècle donne à la même question une nouvelle réponse, subjective, en accord avec le
"dualisme" des Lumières:
Tout comme le sujet connaissant était censé tirer de son propre sein les principes qui
gouvernent l’univers et tout comme la principale mission de la société était de
100 Alain Montandon, Le roman au XVIIIe siècle en Europe, Paris, PUF, 1999, p.35-36 101 Thomas Pavel, La Pensée du roman, Paris, Gallimard, 2003. 102 Ibid., 46-47. 103 Ibid., p. 90. 104 Ibid., p. 142. 105 Ibid., p. 48.
29
sauvegarder les droits inaliénables de l’individu, l’idéal moral se trouva désormais
inscrit dans le cœur de l’homme106.
S’affirment dès lors dans le roman la dignité de l’individu, indépendante de sa position
sociale. La Marianne de Marivaux rappelle l’intrigue des Ethiopiques d’Héliodore, l’enjeu de
l’histoire étant la reconnaissance par la société du véritable rang moral de la narratrice qui, de
haute naissance mais coupée de sa famille, manifeste une dignité morale en dépit de son
origine inconnue. La forme de ces nouveaux romans est empruntée au roman picaresque,
civilisé par Marivaux selon T. Pavel107. La question de la représentation de l'amour dans le
roman, autre versant du reproche d'immoralité adressé au roman du XVIIIe siècle et analysé
par G. May, devient chez T. Pavel une des problématiques au sein desquelles le roman
"réfléchit à l'établissement du lien entre l'homme et ses proches", et pose "la question
axiologique qui consiste à savoir si l'idéal moral fait partie de l'ordre du monde"108. Les
analyses de T. Pavel, qui admet par ailleurs que "l'origine du roman moderne se trouve dans le
dialogue polémique avec les 'vieux romans'"109 suggèrent l'ouverture d'une aire problématique
qu'il n'aborde pas explicitement: en vertu de quel rapport avec la réalité ou avec le vrai la
fiction "pense"-t-elle?
Le Roman véritable : quelle fiction, quelle illusion, quelle vérité ?
Au terme de ce survol raisonné, on est en droit de se demander s’il serait opportun de
définir le nouveau paradigme qui s’isole dans la première moitié du XVIIIe siècle de « roman
véritable », proposé par F.Blankenburg. Un nombre important des études récentes présentées
ici semblent légitimer cette étiquette. Notre propre conception de la gradualité de la fiction qui
ne traduit pas un dilemme mais la double nécessité d’accréditer – par l’effacement de la
fiction – et de légitimer- par la mise en évidence de la fiction - simultanément le récit en
découle.
Les approches du roman qui n’abordent la conversion générique qu’en termes
d’accréditation tiennent à nos yeux insuffisamment compte de trois distinctions, essentielles
pour la définition du nouveau paradigme romanesque dont la conversion générique est le
principal symptôme. La première concerne l’intention du romancier producteur de fiction, la
deuxième l’appréhension de l’illusion par le lecteur et la troisième le type de vérité à laquelle
cette dernière donne accès.
Si la vérité est immuable, il faut reconnaître à la fiction une certaine gradualité. Cette
idée, théorisée récemment par G.Genette dans Fiction et Diction110, apparaît clairement dans
la définition citée de Seigneux de Correvon. La gradualité de la fiction s’étale entre un état
non déclaré, qu’on peut appeler feintise, et un état déclaré. L’état déclaré de la fiction peut
aller de paire avec des signaux comme les invraisemblances ou les « faussetés » qui révoltent
une fois que l’illusion se dissipe, comme le remarque Gayot de Pitaval :
Les faits étranges et surprenants qui frappent dans les histoires agréables qui sont
l’ouvrage de l’imagination causent un plaisir empoisonné, disons-le, par la fausseté des
événements. Cette beauté feinte n’est pas une vraie beauté ; elle éblouit d’abord,
l’illusion se dissipe, et la répugnance naturelle que nous sentons pour le faux nous
révolte dans le fond du cœur contre la plus belle fiction.
106 Ibid., p.141. 107 Ibid., p.143. 108 Ibid., p. 47. 109 Ibid., p. 43. 110 Gérard Genette, Fiction et Diction (Paris, Seuil, XXX)
30
Mais lorsque le vrai se rencontre avec le merveilleux et que la nature nous les offre dans
un tissu de faits où il semble qu’elle ait emprunté d’un génie heureux des
embellissements, alors notre esprit et notre cœur goûtent un plaisir pur, exquis.111
Le « faux » se situe des deux côtés de l’échelle. L’état non déclaré de la fiction répond à une
intention de l’auteur de tromper et est donc par définition « faux », comme les mémoires
aprocryphes de Courtilz de Sandras ou les nouvelles galantes de Mme de Villedieu, qui
attirent les foudres de Pierre Bayle112. De l’autre côté de l’échelle, des excès de merveilleux
produisent eux aussi un effet de « fausseté ». Le plaisir, qui s’évanouit à la perception de
cette fausseté, est dès lors une question de dosage, de mélange, de rencontre heureuse entre le
vrai et le merveilleux. Il est par ailleurs essentiel de relever que la fausseté de la fiction
déclarée n’est pas la même que celle de la fiction non déclarée. La première traduit des
critères d’ordre poétique - de vraisemblance et d’invraisemblance - l’autre est soumise à une
critériologie morale : elle est mensonge. On retrouve les deux pôles du dilemme du roman.
Le même passage de Gayot de Pitaval est aussi emblématique d’une seconde
opposition qui touche à la perception qu’a le lecteur de la fausseté du récit. C’est ici que les
distinctions opérées par Marian Hobson s’avèrent capitales. Il est du mérite de Marian
Hobson de distinguer deux modes de perception de la fictionnalité d’une œuvre d’art en
général et d’un récit en particulier. Le premier mode dit bipolaire implique une oscillation
entre conscience de fictionnalité et oublie de fictionnalité. Tout autre est la perception
bimodale de la fiction, où conscience et oublie de fictionnalité coexistent. La fiction se fait
oublier par la vraisemblance de la construction narrative sans que pour autant le lecteur perde
la conscience qu’il est entré dans un univers de fiction. L’ « oubli » de la fiction est un effet
du « génie » du romancier, comme le déclarait Gayot de Pitaval, et amène un plaisir « pur et
exquis » en « séduisant » le lecteur qui, sans être trompé, consent à suspendre son
incrédulité113.
On ne saurait acquiescer à la lecture de Marian Hobson lorsqu’elle observe, entre la
première et la deuxième moitié du XVIIIe siècle, une évolution de la conception bimodale à
celle bipolaire de l’illusion, dont on pourrait montrer qu’elles coexistent tout au long du
siècle114. L’intérêt du travail de M.Hobson réside dans la distinction explicite entre fiction et
illusion : deux modalités d’illusion ont coexisté au XVIIIe siècle selon que, dans le mélange
de fiction et de vérité qu’est le roman, la conscience de fictionnalité était perçue comme
conciliable avec la perception de la vérité.
S’il est important de savoir de quelle manière la fictionnalité de l’œuvre pouvait être
appréhendée, il est également indispensable de s’interroger sur la nature de l’autre pôle du
mélange entre fiction et vérité. Une troisième distinction, en effet, devrait permettre de
distinguer une vérité comme adequatio et une vérité comme aletheia. La fiction peut être un
révélateur de vérité, qu’elle « dé-couvre ». Cette vérité apparaît alors comme aletheia. Elle est
111 Gayot de Pitaval, Causes célèbres et intéressantes (1734), cite dans Ph.Stewart, Imitation and Illusion, 1969,
p.24. 112 A côté des commentaires de Pierre Bayle dans l’article “jardin” du Dictionnaire historique et critique,
Ph.Stewart cite ce passage, très pertinent, du “Catalogue des écrivains français” dans Le Siècle de Louis XIV de
Voltaire: “On ne place ici son nom [de Courtilz] que pour avertir les Français, et surtout les étrangers, combien
ils doivent se défier de tous ces faux mémoires imprimés en Hollande. Courtilz fut un des plus coupables
écrivains de ce genre. Il inonda l’Europe de fictions sous le nom d’histoires. Il était bien honteux qu’un capitaine
du regiment de Champagne allât en Hollande vendre des mensonges aux libraries”. 113 Le fameux propos de Coleridge “The willing suspension of disbelief” trouve toute sa pertinence dans la
conception bimodale de l’illusion. 114 Cette démonstration occupe une large partie de Jan Herman, Mladen Kozul et Nathalie Kremer, Le Roman
véritable. Stratégies d’accréditation et de légitimation au XVIIIe siècle, Oxford, Voltaire Foundation, SVEC
2008/8, 250p.
31
moins l’effet d’une « imitation » de la réalité – adequatio – que d’une opération qui dévoile ce
qui était caché, qui met à la surface ce qui restait enfouï, qui remet en mémoire ce qui était
oubliée (Lethe).115 La vérité comme adéquatio préexiste à l’œuvre, elle y est représentée,
imitée. La vérité comme aletheia par contre est inséparable du travail artistique même et de la
fiction, qui la dé-voile, qui l’arrache à l’empire de l’oubli (Léthé) où elle était enfouïe.
Par rapport à la triple dichotomie esquissée ci-dessus, les études qui expliquent la
conversion générique comme des stratégies d’accréditation, restreignent l’objet d’étude à
(1)l’état non déclaré de la fiction (la feintise), (2)qui produit une illusion (bipolaire) dont le
lecteur est dupe et (3)qui considère la vérité du texte comme une adequatio, c’est-à-dire une
imitation fidèle de la réalité y compris la réalité textuelle. Les lectures moins réductrices, et
qui prennent notamment en considération la fonction légitimante de la fiction, définissent leur
objet d’étude comme (1)un mélange de vérité et de fiction, (2)où la fictionnalité apparaît
comme un vecteur graduel, (3)où l’intention de l’auteur n’était pas toujours de tromper, (4)où
le lecteur n’était pas toujours dupe (même s’il pouvait l’être) et (5)où l’effet de vérité dégagé
par l’œuvre pouvait être de l’ordre de l’adequatio et de l’aletheia.
115 La definition de la vérité comme aletheia est aussi ancienne que la philosophie occidentale. Sa theorisation
par M.Heidegger, dans Sein und Zeit (1927) constitue, avec l’ouvrage de Marian Hobson (cf. infra) la base de
notre lecture.