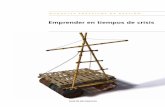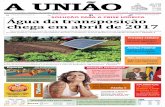L’européanisation de l’islam de crise
-
Upload
hypotheses -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of L’européanisation de l’islam de crise
Numéro 57 ● Printemps 20069
DossierDossier Actuel Culture
CONFLUENCESMéditerranée
Amel BOUBEKEURChercheur à l’EHESS/ENS
L’européanisation de l’islam decrise
A partir des années 90, les problèmes sociaux que peuvent
connaître les musulmans européens sont analysés par les pou-
voirs publics à travers la prisme de l’islam. Ces problèmes, qui
ne sont que très rarement spécifiques à la communauté musul-
mane (notamment ceux se structurant autour des femmes), vont
être inextricablement liés dans leur traitement politique à la
construction d’une nature problématique de l’islam, un islam de
crise n’intervenant dans l’espace public que de façon quasi
exclusivement polémique.
La politisation de la présence des musulmans en Europe del’Ouest par les institutions nationales et européennes s’é-chelonne sur 30 ans1. Jusque dans les années 70, cette pré-
sence peu visible et considérée comme temporaire à travers la figu-re de l’immigré, ne suscite que peu d’intérêt de la part des politiquespubliques. Au début des années 80, la fin de la dynamique migra-toire et l’émergence de jeunes de confession musulmane nés enEurope incite de plus en plus les Etats membres de l'Union euro-péenne à inscrire sur leur agenda la présence nouvelle et souventpensée comme problématique de ces populations. Parce que plustouchés par le chômage et l'exclusion sociale que le reste de la
Musulmans de France
population, les musulmans d’Europe se sont souvent vus paradoxa-lement exclus au titre de leur manque d’intégration aux sociétéseuropéennes. C'est donc à travers le prisme de la crise sociale (grè-ves, émeutes… ) que va se structurer l’attention que les acteurspublics (Etats et médias) porteront aux musulmans. Les réponsespolitiques apportées vont dans un premier temps être élaborées sousl’angle ethnique notamment en France avec la politique «beur». Apartir des années 90, ces réponses politiques changent de registre.Ce n’est plus à travers la question de l’ethnicité mais celle de l’islam,que sont reconceptualisés les problèmes sociaux que peuventconnaître les musulmans européens. Ces problèmes ne sont que trèsrarement spécifiques à la communauté musulmane (notammentceux se structurant autour des femmes) mais vont être inextricable-ment liés dans leur traitement politique à la construction d’unenature problématique de l’islam, un islam de crise n’intervenantdans l’espace public que de façon quasi exclusivement polémique.En effet, les années 90 correspondent aussi à un certain nombre d'é-vénements liés (de façon très différente) à la présence des musul-mans européens tels que les attentats terroristes (Paris, Madrid,Londres), l’affaire Rushdie au Royaume-Uni, les processus de réisla-misation des jeunes nés en Europe et leurs lots de confrontationsidentitaires2, et depuis les années 2000, les tensions autour du rôledu religieux dans l’espace séculier, la lutte contre l’antisémitisme,voire même la délinquance dans les quartiers populaires à majoritémusulmane. Ces évènements de crise vont amener les acteurs insti-tutionnels ainsi que les médias à prendre en compte la variable reli-gieuse comme mode déterminant dans la compréhension et la réso-lution de ces problèmes. Cette perspective sous-tend donc l'idéeselon laquelle l'islam serait le facteur explicatif de ces crises enmême temps qu'il en serait la solution. Ainsi, les politiques de luttecontre le terrorisme dit islamique se résument à un ensemble dedispositifs sécuritaires, doublés de la volonté de mettre en place unislam officiel, national et paisible. Avec ce diagnostic présentantl'islam comme variable explicative des difficultés que connaissentles musulmans d'Europe, on élude les déficiences en matière d’éga-lité d’accès au ressources culturelles et économiques, qui participentégalement à l'émergence de ces crises, et dont la responsabilité derésolution politique relève prioritairement des Etats et de l’Union. Vadonc progressivement s’effacer la frontière entre l’islam comme
Numéro 57 ● Printemps 200610 CONFLUENCES
Méditerranée
religion européenne de facto et l’islam en tant que facteur politiqueexogène et autonome, déclencheur de crises menaçant les fonde-ments des sociétés concernées.
Les débats sur le rôle de l’islam dans ces crises sont le plus sou-vent présentés en terme d’inadaptabilité culturelle pouvant menerau «clash des civilisations», tels que l’ont été les questions du portdu voile, des émeutes en banlieue et plus récemment l’affaire descaricatures islamophobes3. La réponse amenée par l’Union en termesde développement de politiques interculturelles afin de prévenir lescrises autour de l’islam, participent également, et de façon presqueironique, à cette question d’inadaptabilité culturelle. Une cultureintrinsèque à l’islam et mal adaptée à l’Europe, plus que la relativeégalité d’accès à l’identité majoritaire entre musulmans et nonmusulmans, serait donc le problème. Dans le contexte post 11 sep-tembre, cette question d’une nature islamique incompatible s'estaccompagnée d'une logique sécuritaire de lutte contre le terrorismeislamique de la part des Etats de l'Union. Là aussi, si l’islam en tantque religion doit être concerné, les politiques anti-terroristes occul-tent alors en partie les problèmes plus quotidiens qui se posent auxmusulmans d’Europe tels que l’islamophobie, la gestion du culte, laconstruction de mosquées, la formation d’imams et autres. Le rôleau sein de l’Europe de ces citoyens pensés comme «nouveaux» et«particuliers» est ainsi configuré par des politiques hésitantes et nonhomogènes, oscillant entre assimilation, interculturalisme et inté-gration4, mettant en avant la difficulté, à un niveau national commeà un niveau européen, de choisir entre les catégories de minorités,d’immigrants, de nouveaux nationaux ou encore de «nouveauxeuropéens» pour désigner les musulmans. L’apparent échec de 30 ansde politiques sociales européennes visant à intégrer les musulmansest aussi sans doute à relier au fait que ces politiques se sont large-ment faites sans eux, hormis bien sûr lorsque ceux perçus commedes autorités musulmanes sont sollicités sur des sujets reliés à lasécurité et au terrorisme. Comblant le manque de représentation etde participation politique sereines de l’ensemble des musulmans enEurope, cette conception d’un islam de crise consomme de plus enplus la rupture existante entre les élites politiques européennes et laréalité excentrée et polémique des musulmans européens.
Pour mieux comprendre le rôle réel ou supposé de l’islam dansles multiples crises que rencontrent l’Europe aujourd’hui et qui se
Numéro 57 ● Printemps 200611
Introduction
DossierDossier Actuel Culture
CONFLUENCESMéditerranée
Musulmans de France
construisent autour de la présence des musulmans, il faut d’abordcomprendre quelle est la part des influences des pays musulmans dit«d’origine» et celle purement européenne dans ces phénomènes. Ilest ensuite nécessaire de juger du caractère réellement islamiquevoire communautaire des revendications des musulmans en Europelorsque ces crises adviennent, et de poser la question du rôle desautorités religieuses dans leur résolution. Enfin, de nombreuses cri-ses se sont cristallisées autour de ce que l'on pourrait appeler lesmusulmans militants. Aussi, il sera important de montrer commentla variable religieuse détermine ou non la radicalisation politique,voire l’usage de la violence, chez ces individus dans leurs rapportsà l'Europe.
Influences extérieures ?
Avec l’installation définitive des populations musulmanes enEurope et l’émergence de jeunes européens de confession musulma-ne issus de cette immigration, ainsi que le nombre important deconvertis, l’islam doit être aujourd’hui considéré comme une com-posante européenne. Cependant, les crises se structurant autour deces musulmans sont souvent singulièrement expliquées commeétant le fruit d’une logique importée, tributaire de l’influence d’unislam étranger5. L’influence que peut avoir l’islam étranger lors decrises européennes se lit à deux niveaux. De façon externe, ce sontd’abord les relations politiques que les Etats-membres entretiennentavec certains pays musulmans qui permettront de souligner certai-nes influences étrangères sur l’islam européen. Il y a ensuite eninterne, l’attention que les musulmans eux-mêmes prêtent à l’islamétranger, notamment dans leur consommation religieuse.
Depuis leur émigration, les musulmans représentent pour les paysd’origine une ressource politique de négociation avec l’Europe.Intervenant dans la gestion des problèmes liés aux populationsmusulmanes, ils ont pendant longtemps influé sur l’orientation despolitiques (ou plutôt de l’absence de politiques) des Etats membressur la question de islam. Depuis les années 70, ces pays (principale-ment l’Algérie, le Maroc et la Turquie, mais aussi l’Arabie Saoudite)pourvoient de façon majoritaire au besoin d’imams, au financementde mosquées, à l’enseignement religieux en France, Allemagne,
Numéro 57 ● Printemps 200612 CONFLUENCES
Méditerranée
Belgique, Pays-Bas, Suisse, Espagne, Italie. Cet islam étranger a cer-tes comblé dans un premier temps le manque de réponse de l’Europeà la demande cultuelle des immigrés, mais il a surtout permis de ten-ter de garder les populations musulmanes sous le contrôle de leurpays d’origine évitant ainsi le développement d'une opposition à cesrégimes d’une part, et d’autre part, l’islam n’étant alors pas considé-ré comme relevant de l’identité européenne, que les primo-migrantsmusulmans ne formulent pas en direction des Etats-membres desdemandes politiques trop fermes, notamment concernant l’organisa-tion du culte.
Dans un deuxième temps, à partir des années 80, apparaissent desmouvements transnationaux originaires du monde musulman quivont tenter, à l’image de l’islam consulaire des pays musulmans, destructurer le champ religieux européen et de s’en assurer le leaders-hip. Parmi les plus influents, le Tabligh6 installé en Europe par desmissionnaires originaires du Pakistan, le salafisme7 en provenanced’Arabie Saoudite, et la tendance des Frères musulmans disséminéepar des élites islamistes en provenance du Maghreb et du Moyen-Orient.
Les musulmans européens se sont vus ainsi otages des tensions etcompétitions entre ces différentes tendances qui tentent souvent dereproduire en Europe les conflits existant dans le monde musulman.En France, ces tensions ont trouvé leur illustration lors de la créa-tion en 2003 du Conseil Français du Culte Musulman (CFCM), lesconsulats marocains et algériens ayant fait pression sur leurs ressor-tissants afin d’orienter leur vote en direction de listes reflétant leurmajorité nationale. L’animosité que se vouaient dans les années 90jeunes salafi et Frères musulmans en Europe, entretenue en grandepartie par les théologiens d’Arabie Saoudite, a également pu condui-re à des affrontements sporadiques entre ces deux groupes. De façonmoins polémique, la diaspora turque a également joué un rôleimportant dans le plaidoyer de l’accession de la Turquie à l’Europe.Les influences étrangères sur l’islam européen sont donc réelles maiselles ne sont souvent que peu reliées au rôle politique interne desmusulmans nés en Europe. Elles reflètent au contraire la volonté derôle politique des Etats étrangers dans la question de l’islam euro-péen vis-à-vis de l’Union européenne.
Concernant l’influence que peut avoir l’islam étranger sur la vieplus quotidienne des musulmans européens, c’est en grande partie
Numéro 57 ● Printemps 200613
Introduction
DossierDossier Actuel Culture
CONFLUENCESMéditerranée
Musulmans de France
par l'absence de structures européennes islamiques de productionthéologique8, intellectuelle et culturelle que l’on peut la comprend-re. Cette absence pousse par conséquent souvent les musulmansd’Europe à rechercher des références en dehors des frontières euro-péennes. Les autorités religieuses saoudiennes jouent par exempleun grand rôle dans cette dynamique. Les positionnements idéolo-giques des relais musulmans européens (associations, lieux de culte,sites internet…) lors de crises politiques internationales, peuventégalement parfois être infléchis par ces autorités étrangères.L’opposition d’un grand nombre de militants musulmans aux poli-tiques européennes sur le conflit israélo-palestinien et la guerre enIrak avait, entre autre, pour base les différentes fatwas du théologienégypto-qatari Youssouf Qaradawi, proche des Frères musulmans.Ces fatwas ont poussé certains musulmans à boycotter des produitsisraéliens et américains (Coca cola, Nike…)9. La consommation reli-gieuse des musulmans européens représente un marché étendu, etdes acteurs de toutes types essaient de s’y agréger. Bien que leurimpact soit minime, les cassettes de propagande tournées dans lemonde arabe, les sites internet dit «jihadistes» ainsi que les récits decombattants ayant œuvré dans les pays concernés jouent égalementun rôle important dans la radicalisation puis le passage à la violen-ce de jeunes musulmans européens comme l’on démontré les cas desfilières dites tchétchènes et irakiennes.
Les racines européennes des crises
Cependant même si les supports de cette radicalisation sont étran-gers à la réalité européenne des musulmans, la motivation est-elle àcomprendre en termes purement européens ? En effet, pour la dizai-ne de jeunes musulmans nés en Europe qui décide de réaliser unattentat suicide, le jihad représente une sortie des crises européen-nes qui se structurent autour de la présence des musulmans enEurope, un échappatoire nihiliste qui résorbe leur incapacité à agirsur ces crises et à transformer les raisons de leur mal-vie de musul-mans en Europe10. Cette sortie de crise par l’exil peut également sedérouler de façon pacifique et pragmatique. De plus en plus de jeu-nes salafi, voire de jeunes musulmans peu pratiquants, décident defaire leur hijra (mot arabe qui signifie émigration et qui reprend
Numéro 57 ● Printemps 200614 CONFLUENCES
Méditerranée
l’idée de l’émigration du Prophète de la Mecque, où il était persécu-té, jusqu’à Médine). Quittant l’Europe, où ils sont nés, pour s’instal-ler dans un pays musulman (principalement l’Arabie Saoudite et lespays du Golfe, mais également Egypte, Algérie, Maroc, Syrie) ilspensent alors échapper à une vie islamique européenne de crise(stigmatisation, discrimination, confrontation avec les institutionstelles que l’Ecole, la Police, les hôpitaux etc). Fascinés par le senti-ment d’appartenance qui leur fait défaut en Europe, ils pensent queces pays au vu de leur forte croissance économique (ici il s’agit duGolfe) et de la place accordée à l’islam, leur permettront de vivre unevie religieuse moins en tension, mais surtout d’accéder à un certainbien-être social «bourgeois» que selon eux l’Europe a échoué à leuroffrir.
Le rôle des gouvernants des Etats-membres est aussi à prendre encompte concernant les racines européennes des crises. L’existenced’un islam étranger intervenant dans la vie des musulmans a eneffet conduit la classe politique européenne elle-même à chercher àl’extérieur de ses frontières les réponses aux crises se structurant enEurope autour de l’islam. Dans le cadre de la lutte contre le radica-lisme islamique, certains pays européens (Allemagne, France) ontexpulsé des imams dans leur pays d’origine (Turquie, Algérie) pourleurs déclarations attentatoires à l’ordre public. Lors de l’affaire duvoile, le ministre de l’Intérieur, Nicolas Sarkozy, s’est rendu àl’Université d’Al Azhar afin d’obtenir une fatwa du mufti d’EgypteAl Tantawi demandant aux jeunes filles de retirer leur voile à l’éco-le. Contrecoup de ce déplacement d’un problème français dans lemonde arabe, des manifestations ont eu lieu contre le projet de loisur le voile dans différents pays musulmans (Egypte, Liban, Algérie).Ces manifestations furent certes l’expression d’une opinion contre ceprojet de loi, mais elles furent aussi l’occasion pour des mouvementsislamistes d’affirmer une visibilité politique importante sur le planinternational.
Les médias européens (russes et américains également) font aussiappel à l’idée d’attitudes islamiques importées afin d’expliquer lescrises européennes. Lors des émeutes française de novembre 2005,la comparaison de jeunes musulmans «menant une «intifada desbanlieues» et transformant «Paris en Bagdad» était très présente.L’idée que l’islam aurait été le facteur déclencheur de cette explosiona permis une instrumentalisation de la part des médias étrangers et
Numéro 57 ● Printemps 200615
Introduction
DossierDossier Actuel Culture
CONFLUENCESMéditerranée
Musulmans de France
de la classe politique internationale. Ainsi, les médias américainsont pensé la crise des banlieues comme une «manipulation d’AlQaïda», la France payant le prix de sa «politique pro-arabe», et lesmédias russes ont lu les raisons des émeutes comme le prolonge-ment idéologique de la résistance tchétchène, justifiant ainsi leurspolitiques de répression des indépendantistes sous l’angle du com-bat du radicalisme islamique.
En réalité, les interactions existant entre l’établissement d’unislam européen et les évènements internationaux autour de la ques-tion de l’islam sont plus complexes, se situant à mi-chemin entreinfluences étrangères et construction endogène. Certes, il fautreconnaître le poids de l’influence étrangère mais le rôle de cesacteurs internationaux ne doit pas être surévalué dans les crisesdans lesquelles sont impliqués les musulmans d’Europe. L’argumentdu malentendu culturel entre l’islam et l’Europe mis en avant parl’Union Européenne lors de l’affaire des caricatures a ainsi permisaux Etats musulmans de se présenter comme les seuls acteurs capa-bles de restaurer la fierté des musulmans en Europe. Cependant ona vu combien cette crise a été comprise et utilisée de façon différen-te par les musulmans européens et les Etats musulmans. Là où cer-tains Etats, comme la Syrie, étaient dans une logique externe d’op-position aux décisions de l’Europe au Moyen-Orient11, les musul-mans européens (de même lors des affaires du voile ou encore d’at-taques islamophobes) ont fait appel à la question du droit en solli-citant leur juridiction nationale et la Cour européenne des droits del’Homme. Ils ont fait valoir, non pas le cliché de la «haine de l’is-lam» ancrée en Occident, mais les valeurs européennes de liberté decroyance, de liberté d’expression pour manifester son désaccord, demulticulturalisme voire même de laïcité comme outil de protectiondes religions. Les réactions des musulmans européens durant cegenre de crises, et dans leur grande majorité, sont le signe de leurintériorisation des valeurs issues de la culture politique européenne.Ces réactions doivent être liées à leur volonté d’être des citoyensactifs. C’est donc la responsabilité des leaders politiques européensde prendre en compte ces crises de façon profondément européen-nes, mobilisant un leadership fort et une capacité de dialogue avecleurs citoyens (à l’image de Tony Blair après les attaques terroristesde Londres, présentant les musulmans du Royaume-Uni non pascomme la cause du problème mais comme une composante nationale
Numéro 57 ● Printemps 200616 CONFLUENCES
Méditerranée
touchée par la tragédie au même titre que les autres). Ces crises ontdonc dans une grande mesure des racines occidentales qu’il s’agissede leurs modes d’expression, des valeurs qu’elles mobilisent ou deleur origine. Ainsi, lors des tensions se structurant autour de l’islam,les positionnements des musulmans se font selon des logiques poli-tiques européennes.
Lors des émeutes de 2005, il faut souligner que c’est aussi l’isla-mophobie ambiante en Europe, et non pas «les attaques faites à l’is-lam à Bagdad» qui a eu des effets de radicalisation du sentimentd’exclusion (et plus particulièrement lors de l’explosion d’une gre-nade lacrymogène de CRS dans la mosquée de Clichy-sous-bois).Certes les émeutiers n’étaient pas des musulmans pratiquants, maisnul n’est besoin d’être un religieux observant ou militant pour sesentir concerné voire visé par l’islamophobie. C’est cependant, ici leseul lien que l’on peut faire entre cette crise et la question de l’is-lam. Sur le plan de leur énonciation politique, les émeutes de 2005s’inscrivent dans une tradition de contestation typiquement françai-se (Mai 68, grèves lycéennes). Les émeutiers n’avaient pas de propo-sitions politiques définies selon les modes d’expression politiquesmajoritaires, il serait faux pour autant de conclure à la dépolitisa-tion de ces populations, que l’on relierai au vide laissé par l’échec del’islam comme projet politique dans les banlieues. Ce serait encoreune fois faire de l’islam l’élément d’explication exogène de l’explo-sion de ce genre de crises (y compris par défaut dans le cas de l’ar-gument de la dépolitisation). De façon périphérique certes, mais pro-fondément française et politique, s'est exprimée à travers ces émeu-tes la volonté de voir s’appliquer le modèle d’intégration à la fran-çaise, et non pas sa contestation. La dépolitisation des structurespolitiques traditionnellement en charge de l’encadrement des popu-lations à majorité musulmane en France (travailleurs sociaux, syn-dicats, partis d’extrême gauche) ne saurait signifier la dépolitisationdes acteurs musulmans eux-mêmes. Se sentant démunis des outilsde contestation politique majoritaires (rappelons concernant lesmécanismes de transmission d’une mémoire citoyenne que la majo-rité de leurs parents immigrés n’ont toujours pas le droit de vote),certains émeutiers ont justifié leurs violences par l'envie de fairerespecter par le gouvernement français ses promesses en terme delutte contre les discriminations raciales et économiques. Il était
Numéro 57 ● Printemps 200617
Introduction
DossierDossier Actuel Culture
CONFLUENCESMéditerranée
Musulmans de France
d’ailleurs intéressant de constater la prudence des Etats musulmanssur une quelconque possible solidarité avec les émeutiers. L’islam(ou son échec) en tant que doctrine politique n’était donc pas le fac-teur explicatif des émeutes de 2005.
La variable religieuse dans les processus de radicalisation politique
L’absence de poids des acteursreligieux dans les crises
A l’influence de l’islam étranger pour expliquer les attitudes desmusulmans lors des crises, vient s’ajouter le facteur religieux. Lesdimensions protestataires et communautaristes que l’on attribue àl’islam joueraient un rôle important dans le déclenchement de cescrises. Le modèle de l’enclave musulmane est une constructionimposée et non choisie, notamment à travers les zones urbaines àforte concentration musulmane. La vision d’une population musul-mane mise sous tutelle par des acteurs islamistes nourrissant un pro-jet de rupture collective de ces quartiers avec la société relève plu-tôt d’un mythe. Comprendre l’islam comme une religion probléma-tique car différente lors de ces crises, s’avère aussi peu fécond. Plusencore, l’expérience a souvent montré que les leaders ou acteursd’autorité musulmans n’était pas capable de résorber seuls les crisesautour de la question de l’islam. La participation de ces acteursdevraient plutôt se situer sur du long terme, et non pas au seulmoment de l’élaboration de politiques anti-délinquance. Qu’en est-il alors de la variable du communautarisme islamique mise en avantpour expliquer les émeutes en France qui se sont déroulées fin2005 ? Ce sont plus les conditions communes d’exclusion socialedes émeutiers que leur appartenance à une même religion qui expli-quent les violences dans les banlieues françaises pendant l'automne2005. Le faible contrôle qu’ont eu les leaders musulmans et islamis-tes dans ces quartiers en est la preuve. En effet, l’appel au calme deYoussouf Qaradawi et sa demande faite à la France de dialogueravec les responsables musulmans pour apaiser la situation n’ont pas
Numéro 57 ● Printemps 200618 CONFLUENCES
Méditerranée
été écoutés. La fatwa de l’Union des Organisations Islamiques deFrance, l’une des principales fédérations d’associations islamiques,appelant à l'apaisement, est restée sans effet. Enfin, les quelques jeu-nes militants musulmans ayant choisit d’effectuer des rondes de nuitn’ont ramené que partiellement le calme dans les cités. Cette situa-tion a remis en cause la vision selon laquelle les acteurs religieuxpouvaient encadrer les populations musulmanes et garantir l'ordrepublic et la paix sociale.
L’engagement religieux conduit-ilnécessairement au radicalismepolitique ?
Alors que les émeutes ne faisaient que très marginalement réfé-rence à la religion, les attitudes politiques de certains musulmansvis-à-vis des sociétés européennes trouvent clairement leurs justifi-cations à travers l'islam. Ce phénomène touche en grande partie lesmusulmans dits militants appartenant à des associations et courantsislamiques. Dans le rapport que les musulmans militants entretien-nent entre religion et politique, trois groupes pourraient être distin-gués : les musulmans qui développent une «citoyenneté croyante»12,ceux qui décident de vivre en retrait de tout système politique auxréférents européens et non musulmans, et enfin un groupe ultra-minoritaire qui place l’islam dit «jihadiste» au cœur de son engage-ment politique.
Pour le premier groupe, l’islam devient le point de départ d’unengagement citoyen dans la société. Cet engagement politique àpartir du référent islam ne doit ainsi pas être compris comme lesynonyme d’une radicalisation politique. En effet, leur participationaux manifestations contre la loi sur les signes religieux à l’école n'é-tait pas la preuve d’une volonté d’imposer un référent religieux àune République laïque mais la volonté de réclamer par une négocia-tion politique la mise en œuvre de directives reposant sur les basescommunes de citoyenneté, de liberté d’expression et de choix reli-gieux. Dans ce cas, l’islam permet de prendre part à l’édification dela société à laquelle on appartient et d’y apporter sa contribution entant que minorité positive. Sans la représenter exclusivement, l’in-tellectuel suisse Tariq Ramadan est l'un des principaux promoteur decette «citoyenneté croyante» ou «religiosité citoyenne» qui influencegrandement l’engagement politique de nombre de musulmans
Numéro 57 ● Printemps 200619
Introduction
DossierDossier Actuel Culture
CONFLUENCESMéditerranée
Musulmans de France
d'Europe, surtout les classes moyennes réislamisées en Europe(France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Grande-Bretagne etEspagne). Signe de l’intérêt politique de ce groupe pour l’européani-sation du débat sur l’islam, la mise en place récente du EuropeanMuslim Network sorte de Think Tank dont Tariq Ramadan est le pré-sident. Les musulmans appartenant à cette catégorie votent, s’enga-gent dans les partis politiques et se prononcent sur des questionssupranationales, telles que le référendum sur la Constitution euro-péenne, organisent des débats sur les questions d’altermondialisme,notamment au sein du Forum Social Européen…
Alors que le premier groupe fait de l'islam le facteur déclencheurd'une intégration politique et sociale à la vie citoyenne des payseuropéens, le deuxième affirme que l'islam interdit toute forme departicipation politique ou sociale des musulmans dans les payseuropéens. Cette lecture de l'islam ne conduit donc pas à un inves-tissement politique dans la société, mais au contraire à un repli totalsur l’identité religieuse. On retrouve cette attitude surtout chez lesadeptes des courants du Tabligh et du salafisme13. Leur «radicalisa-tion», ou du moins leur renfermement, religieux n’est pas synonymede radicalisation politique puisqu’il n’y a pas de volonté de partici-pation politique. On voit ici également la faiblesse de l’explicationde la radicalisation politique par le communautarisme. Loin deconduire à une violence politique qu'ils condamnent, leur credoamène leurs adeptes à se retirer de la société. Pour eux, contraire-ment au premier groupe, aucun processus de négociation avec l’Etatne peut être engagé, quand bien même celui-ci concernerait lesmusulmans d'Europe. Par conséquent leur islamité, qui s’exprimedans un cadre universaliste et intemporel où seul le fait d’imiter leProphète prime, ne saurait être contenue dans un processus profanede négociation avec l’Etat. La religiosité est vécue sur un mode sec-taire où l'on ne reconnaît pas les valeurs dominantes de la société.Ils tentent de vivre leur foi en milieu clos tout en se protégeant des«souillures» de la société ambiante. Ils ne peuvent alors se pensercomme partie prenante d’un système politique non musulman. Poureux, une attitude de retrait est jugée préférable à toute forme de par-ticipation, ce n’est donc pas eux que l’on retrouvera en majoritédans les manifestations contre la loi sur le voile ou la publicationdes caricatures du Prophète.
Le troisième groupe de musulmans militants est représenté par
Numéro 57 ● Printemps 200620 CONFLUENCES
Méditerranée
des jeunes nés en Europe et commettant des attentats terroristes. Làoù le deuxième groupe vit son opposition dans la distance à l'envi-ronnement européen, eux affirment que l'islam donne la possibilitéaux musulmans de se défendre par le jihad des offenses subies, éma-nant de l'Occident. Bien qu’ils ne partagent pas un statut social par-ticulier, ils ont en commun l’expérience du déclin social et de la relé-gation à un moment donné de leur parcours. Le corpus normatifislamique est moins la raison pour laquelle ils choisissent la violen-ce que leur expérience personnelle et subjective d’avoir été victimed’injustices. Ils placent alors le jihad (qui laisse beaucoup plus delatitude à l’action individuelle et à la vengeance personnelle quel’appartenance à un groupe communautariste) au cœur de lacroyance religieuse en estimant que seule la violence terroriste per-met de donner aux musulmans d'Europe et à ceux du monde musul-man, les moyens d'actions pour peser sur les politiques des paysmembres. Ainsi, quand les attentats de Madrid en mars 2004 et deLondres en juillet 2005 ont eu lieu, il s'agissait entre autres de fairepression sur les Etats occidentaux, en l'occurrence l'Espagne et leRoyaume-Uni afin qu'ils rappellent leurs troupes militaires,envoyées en Irak.
Conclusion
Il est donc très complexe de mesurer le rôle réel de l'islam dansles crises qui touchent les musulmans en Europe ou se construisentautour de leur présence. Il est nécessaire de pointer l’intérêt de poli-tiques communes aux Etats-membres et aux institutions européen-nes, autres que sur les néanmoins nécessaires questions de luttecontre le terrorisme. Ces intérêts ne convergent que très rarement etlaissent aux musulmans européens le sentiment d’être otages depolitiques hésitantes représentant la difficulté qu’a l’Europe à discer-ner les contours de sa nouvelle identité.
Surdéterminer la variable religieuse, fait considérer les groupesmusulmans comme homogènes, ce qu`ils ne sont pas. Tout au pluspeuvent-ils éventuellement être distingués par les modes politiquesde protestation qu`ils mobilisent durant les crises européennesautour de l`islam. Néanmoins, ils présentent la caractéristique com-mune d`avoir été déçus par ce que l`Europe propose en termes de
Numéro 57 ● Printemps 200621
Introduction
DossierDossier Actuel Culture
CONFLUENCESMéditerranée
Musulmans de France
politiques publiques concernant leur présence en Europe. Cettedéception est néanmoins de façon étonnante génératrice d’uneattente de changements. Ainsi, les demandes de reconnaissanceadressées par la majorité d’entre eux lors des crises, soulignent lapersistance de leur confiance dans les institutions nationales eteuropéennes. Le traitement de la question de l’islam de façon euro-européenne permettra aussi l’émergence d’une participation poli-tique « neutre» et sereine chez les musulmans militants, sortis ducadre exclusif de la réaction à la marginalisation.
L`Europe doit repenser ce qui peut être proposé aux musulmansen termes de participation et de représentation politique. Il estnécessaire de créer un espace public commun, alternative viable àce qui est actuellement proposé par l`usage de la violence ou leretrait. Après les politiques d’intégration pensées jusqu’ici afin derésorber les crises autour de l’islam, ce sont aussi des politiques denon-exclusion de ces populations qui doivent maintenant être envi-sagées.
L’intérêt de ces crises autour de l’islam est d’avoir pu mettre enlumière l’attachement des musulmans aux valeurs européennes, etleur résistance aux tentatives d’instrumentalisation par les Etats dumonde musulman. La solidité des positions politiques à venir del’Europe sur ces questions, dépendra alors très certainement dudegré de participation de ses musulmans à la construction d’unenouvelle identité européenne. ■
Notes :
1. Nous ne ferons pas ici référence à l’histoire coloniale de gestion de l’is-lam. Nous ne prendrons pas également en compte la question de l’identitéislamique européenne «native» de l’Europe de l’Est..
2. Pour un aperçu des dynamiques de réislamisation en Europe, c’est-à-direle processus de retour à un islam engagé chez les jeunes, voir AmelBoubekeur, «L’islamisme comme tradition. Fatigue militante et désengage-ment des élites islamiques en Occident», in Samir Amghar (dir.), LesIslamismes d’Occident, Lignes de Repères, 2006.
3. Pour comprendre l’origine et les effets de ce concept voir Nilüfer Göle,Interpénétrations : L’islam et l’Europe, Galaade, Paris, 2006.
4. Alors que le modèle français d'intégration repose sur l'idée d'assimilation
Numéro 57 ● Printemps 200622 CONFLUENCES
Méditerranée
des populations étrangères, les modèles britannique et hollandais se fon-dent sur la reconnaissance des particularismes culturels et ethniques deleurs immigrés. Pour une description par Etats-membres de la place de l’is-lam voir Stéphane Papi «Les statuts juridiques de l'islam dans l'Union euro-péenne» in L’Europe en Formation, n° 2, 2006.
5. Pour un panorama des acteurs internationaux qui structurent le champreligieux européen, voir Samir Amghar, «Islam de France et acteurs interna-tionaux», Politique étrangère, 1-2005.
6. Mouvement de réislamisation originaire du sous-continent indien crééau début du siècle dernier. Il est présent dans plus d'une centaine de pays.Il dispose de «filiales» dans de nombreux pays européens (France, Belgique,Grande-Bretagne) et fait de la prédication religieuse son activité centrale.Son centre européen se situe à Dewsbury près de Londres.
7. Le salafisme se réclame d'une application littéraliste et orthodoxe del'islam, souvent liée aux théologiens d'Arabie saoudite. Voir Samir Amghar,«Le salafisme en Europe: une mouvance polymorphe de la radicalisation»,Politique étrangère, 1-2006.
8. Il existe cependant une structure européenne le Conseil européen de lafatwa et de la recherche. Proche des Frères musulmans, cet organe qui setrouve sous le patronage du théologien Youssouf Qardawi est en charged'édifier une norme islamique tenant compte de la réalité sociale euro-péenne. Celle-ci n`est malgré tout pas reconnu par le monde musulmancomme une organisation faisant autorité. Elle est également majoritaire-ment composée d’acteurs militants issus du monde musulman. Pour unaperçu de leur production voir Recueil de fatwas. Avis juridiques concernantles musulmans d'Europe, série n°1,Tawhid, 2002.
9. Il est à noter que ces pratiques de boycott n’ont pas été propres auxmusulmans militants, d’autres citoyens européens, juifs pacifistes ou alter-mondialistes ont également boycotté sans référence à l’islam.
10. Nous nous basons sur des entretiens que nous avons réalisés avec desjeunes ayant commis des attentats suicides en Irak.
11. Olivier Roy, «Caricatures : géopolitique de l’indignation» in Le Monde,8/02/2006.
12. Sur ces notions, voir Franck Frégosi, «Les contours discursifs d'une reli-giosité citoyenne : laïcité et identité islamique chez Tariq Ramadan», inFelice Dassetto (dir.), Paroles d'islam. Individus, sociétés et discours dans l'is-lam européen contemporain/Islamic words. Individuals, Societies etDiscourse in Contemporary European Islam, Maisonneuve etLarose/European Science Foundation, 2000. Voir également KhadijaMohsen-Finan, «La mise en avant d'une citoyenneté croyante: le cas deTariq Ramadan», Travaux de recherche de l'IFRI, 2003.
13. Ici ce sont les courants «massifiés» du Tabligh et du Salafisme dont ils’agit, et non pas des classes dirigeantes, souvent plus radicales.
Numéro 57 ● Printemps 200623
Introduction
DossierDossier Actuel Culture
CONFLUENCESMéditerranée
Numéro 57 ● Printemps 200625
DossierDossier Actuel Culture
CONFLUENCESMéditerranée
Abderrahim LAMCHICHI
Musulmans de France, politiquede reconnaissance et éthique deresponsabilité
Les questions relatives au statut de l’islam, à son institutionnalisa-tion, à l’organisation de son culte ou à sa place dans l’espace publicse trouvent depuis de nombreuses années au cœur des débats sur l’in-tégration et sur la laïcité française. Seulement, cette visibilité ne ren-voie qu’en partie à la redécouverte par les individus concernés de ladimension purement religieuse de leurs racines culturelles, encoremoins à une quelconque transposition sur le sol français et européendes conflits qui déchirent les sociétés musulmanes, et parfois des res-sentiments à l’égard de l’Occident qui s’y expriment. Elle manifestebien plus profondément un besoin légitime d’affirmation identitaire etun attachement aux principes de reconnaissance et d’estime de soi1.
La plupart des études portant sur les opinions exprimées etles réalités vécues par les populations de «culture musul-mane» en France (et dans le reste des pays de l’Union euro-
péenne) ont mis en évidence leur extraordinaire diversité ainsi queleur ardent désir de s’insérer socialement et culturellement dans lessociétés européennes démocratiques et sécularisées. Au demeurant,cette sécularisation est pareillement très largement avancée en cequi concerne l’islam «diasporique» (j’y reviendrai). La réussite du«vivre ensemble» demeure toutefois conditionnée par l’accueil et lerespect de la diversité, mais aussi par la conformité de tous à unvéritable esprit de responsabilité, en particulier l’accord sur un
Musulmans de France
langage éthique et politique commun.En une génération à peine, ces populations ont fait montre d’une
formidable capacité d’adaptation. Globalement, malgré les difficul-tés sociales persistantes pour certains d’entre eux, les Musulmanssemblent bien assumer leurs multiples appartenances et identités etparviennent à concilier leurs croyances religieuses (quand ils sontcroyants) et leur vécu en Europe — contribuant de la sorte à la diver-sification de son espace culturel et au renforcement de la tolérancereligieuse.
Pourtant, la situation socioéconomique d’une partie importanted’entre eux n’est guère satisfaisante, aggravée de surcroît par toutessortes de discriminations et d’exclusions2. En dépit de cette situationet de l’exacerbation de conflits inextricables susceptibles d’affecternégativement la perception de l’islam, voire d’amplifier la défianceà son égard (guerre et attentats sanglants en Irak, situation intena-ble en Palestine, montée en puissance du terrorisme islamiste plané-taire, et, plus généralement, situation mondiale délétère), la présen-ce des Musulmans en France (et dans les autres pays européens) n’adonné lieu à aucune tension extrême.
Malgré les difficultés inhérentes à tout processus d’apprentissagede la vie en commun, en dépit de l’impéritie de certains courantsradicaux peu représentatifs ou des tentatives de diabolisation réci-proque développées par ceux qui ne souhaitent ni une améliorationde la façon dont les communautés se perçoivent, ni une coexisten-ce de civilisation, l’islam de France offre l’image d’une religionsomme toute apaisée et relativement bien ancrée dans la société3. Etc’est précisément dans cette perspective et à ce titre que les citoyensissus de cette culture (bien au-delà du cercle des seuls fidèles) expri-ment une puissante demande de reconnaissance. Preuve s’il en étaitbesoin que la reconnaissance par autrui est indispensable à l’estimede soi et à la construction d’une identité apaisée.
Embrasement des banlieues
La violence autodestructrice qui a embrasé les banlieues françai-ses l’automne dernier, a révélé des réalités déplorables, perceptiblesdepuis fort longtemps : mal-être, discriminations à l’embauche et aulogement, relégation dans des quartiers pauvres, chômage massif
Numéro 57 ● Printemps 200626 CONFLUENCES
Méditerranée