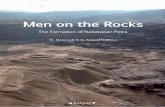RAPPORT 2016 Résultats de l'étude qualitative concernant ...
Contribution à l'étude des secteurs liquidiens du mouton
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Contribution à l'étude des secteurs liquidiens du mouton
UNIVERSITE DE DAKAR T083 ..t2ECOLE INTER-ETATS DES SCIENCES ET MEDECINE VETERINAIRES
ANNEE 1983
THESE
présentée
pour obtenir le grade de
DOCTEUR VETERINAIRE(Diplôme d'Etat)
par
Madame CISSE née Ndèye Maïmouna NDIAYE
née le 7 février 1958 à KAOLACK (Sénégal)
'-Ç" ••
CONTRIBUTION à L'ETUDE des SECTEURS LIQUIDIENS
du MOUTON - DOSAGE de la VOLEMIE
au RADIOCHROME (51 Cr)
Soutenue publiquement le 22 juin 1983
devant la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Dakar
Jury: Président
Directeur de Thèse
Membres
François DIENG
Alassane SERE
A. Lamine NDIAYE
René NDOYE
1. Pierre NDIAYE
ECOLE INTER-ETATSDES SCIENCES ET MEDECINE
VETERINAIRES DE DAKAR- - .------
,_ ISTE DU PERSONNEL ENSFIGNANT POUR
L'ANNFE UNIVERSITAIRE 1982 - 1983
.=.=-=.=.=-=-
1 - PERSONNEL A PLEIN TEMPS
l - PHARMACIE-TOXICOLOGIE
N •••••••••••••••••••• ~ • • • • • • • • • • • • • • • •• ProfesseurFrançois Ad é b a y 0 AB 10LA. • • • • • • • • • • • • • •• f"18 î t r e- As s i El tan t
2 - PHYSIQUE MEDICALE - CHIMIE
BIOLOGIQUE
N ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Germain JérÔme SAWADOGO
3 - ANATOMIE - HISTOLOGIE EMBRYOLOGIE
................ ProfesseurMaître-Assistant
N •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ProfesseurCharles Kondi AGHA ••••••••••••••••••••• naître-AssistantFrançois LAMARqUE •••••••••••••••••••••• V.S.N.Amadou ADAMOU •••••••••••••••••••••••••• MoniteurAd rie n Mar i e Gas ton REL EM •••••••••••••• t'10 nit e ur
4 - PHYSIOLOGIE - PHARMOCODYNAMIE THERAPEUTIQUE
Moussa ASSANE ••••••••••••••••••••••••••Olorounto Delphin KOUDANDE •••••••••••••
Alassane SERE .......................... rO'lattre de Conférences Agrégé
AssistantMoniteur
5 - PARASITOLOGIE - MALADIES PARASITAIRES
ZOOLOGIE
N ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Joseph VERCRUYSSE ••••••••••••••••••••••louis Joseph PANGUIJ ••••••••••••••••••••Désiré AHOt'1lANTO ••••••••••••••••••••••
ProfesseurMa1tre-AssietantAssistant.Moniteur
6 - HYGIO;E ET INDUSTRIE [1[5 DENrEES D'OPIGIN[ t\"!l'1ALE
~,
1 ~ " •••
~!alang SEYD 1 "••••••.•.....•••••••••••••••Evariste MUSENGARUREMA •••••••••••••••••••
7 - MEDECINE - ANATOMIE PATHOLOGIQUE - CLINIQUE-------------------------------------------Ar'·lBUL AN TE
• • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Théodore ALOGNINDUWA •• 0 ••••••••••••••• _ •••
Roger PARENT ••• f ••••••••••••••• 4 ••••••••••
B - REPRODUCTION ET CHIRURGIE
r~\rofesseur
rh! t tre-Ass i t3 t 8.:1l
:~o'liteur
P :.' Dr e s s () urM3ître-Assistp~t
Assistant
N ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ProfesseurPapa El Hassan DIOP ••••••••••••••••••••••• i'1;;ître-Assistw'd.Christophe LEPE1IT •.•••••••••••••••••••••• V.S.N.Fidèle Molélé MRAIDINGATOLOUM ••••••••••••• Moniteur
9 - t1ICROBIOLOGIE - PATHOLOGIE GENERALE -MALADIES CONTAGIELSES CT LEGISLATION
SANITAIRE
.........................................Justin ~yayi AKAKPO •••••••••••••••••••••••Francis FUMOUX ••••••••••••••••••••••••••••PiE:r re SORNAREL •••••••••••••••••••••••••••
10 - ZOOTECH~IE - ALI~ENTATION - DHDIT
ECONOHIE
F!"ofesseur11 B ~ t r C' - i\ s sis t ,: ,_M~!tre-AssjRt~nt
L'~-,~,istAnt C\C'
r·,:;çht;;I'ches
~\hrnadoll Lamine NOIAYE ••••••••••••••••••••• F'ro f es88urOum8roll Oi~\"I;\ ••••••••••••••••••••••••••••••• /,:ssistant8 a i< {} r y B /1 DO. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ;'Î 0 ", i te u r
II - PERSONNEL VACATAIRE
BIOPHYSIQUE
René ~'mOYE ................................ ! ; ::.> t +_ r e d e C0 f'
férnncesFRculté de~"Ifdecine & C~2
Ph>.lrmaciüil ~ l I.! ERS 1 T[ ,1 rDrl!,' tIR
Alain LECOMTE ••••••••••••••••••••••• Ma!trp AssistantFa cul ; (' cl f' r~ t: dcci n\-'6 dc, Di"srm:-Icie
!:! t~ 1 V1.3 S l Tf DUE-:~
PHARMACIE-TOXICOLOGIE
:"amadou B{IDIANE •••••••••••••••••••••• Oocl:<::ur on Pharmacit_~
BIOCHIMIE PHARMACEUTIQUE
t'lednmc Elisabeth DUTfWGE ••••••••••••• t-lattr')-,'ssistantr nC III 1: <.' d (') ri1é d t;' C i rH:
& de Fr-1nrriE'cieUNIVERSITE DE DAKAR
ACRONGr'1I[
Simon BARf~ETO ....................... MAître d0 RechGrchesO.R.S.T.O.M. DAKAR
fi 1 0 CL H1A T0lOG l [
Cheikh BA ••••••••••••••••••••••••••• Mo!tr0_~s8istant
Facult~ Ces Lpttr~s
& Scjonc~s Humain0sUNIVE?SlT[ DE U~KtR
BOTANHWE
Guy t'l J\ YNf~ RT • • • • • • • • • • • • • • • • • r • • • • • • • f; A t t r ~; - ; S D i. s t nn tF ::; cu] t .~ ri ': t'1 (; dE: C i nê'(; dl: Ph[J!'[-I:"cieUNIV[?SITC DE DM<i--Y
DROIT FT ECONOMIf RURALE
MomAdou NIANC ••••••••••••••••••••••• Doct~ur 0n Sociolo~i
Jurtd;_c1'-!v~ Chcrch2t':;'à 1. 1 1 • r . [' . ~I •
UrdVU,SITf DE Dl\V/\,i.
ECONOMIE GENERALE
Oum a r BEhTE. • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • •• ::, f} 8 i s t nr \ tF~cult{ \!r-:s Scier;c(:'sJuri~iquHs & Ecorn-f!J i qu ~.; sUNIVERsrrr DF DAVPR
GENETIQUE
Jean Pierre DENIS ••••••••••••••••••••••• Dccleljf Vétérin0jr~,
Inspecteur Vétér~
naite L.~~.E.n.V. Cj'
DM<AR-HANN
RATIO~!N[!"l[NT
Ndiaga MRA.YE
J'.GROSTOLCGIE
............................
............................
Docteur VétérirRir~
L..N.E.R .. V deDAKAR-HMH-J
DoctCl r Vétérin3jr~,
Inspecteur en ChefL.~;.E.R.V. deD:'l!< 1-\ f? - :"if.~ m·j
GUERIN •••••••••••••••••••••••••••••••••• DCr:tfêUf \fétérinniT':';L.~\i.E.R.V. dl';·D;'Y H;-H/\N"J
II 1 - PERSONNEL EN f-1ISSIm· (pr(:vu pour 1987-83)
ANATOMIE PATHOLOGIQUE GENERALE-------------------------------rH che l r-iOR 1N ........................... Profc-';'~eur
Facult~ de '·1édLri:.,:,Vé t (. r't '1 ;-) ire d f3
Sfl.I'·:T-rlYI-\CINTHf:-OUEBrC
fI Nr, T0 t1 1E P t: THO LOG 1 Qt 'r sPEe 1 i\ L [
[rnest TfUSCHER ••••••••••••••••••••••••• Proft:ssC:lJrrecl.H:' de ~r,~d(cir,r
Vété' ri r, D ire ci eSI-d ", T- fi yP; C1NTHE -
fJ;~![nfC
BIOCHIMIE VETERINAIRE
J. P. RRAU~ •••••• ~ •••••••••.•.•••••••• •• Pr of esseurE. ~'l. \1. - TOULOUSE
CHIRURGIE
P... C;\ZrfUX .............................. Pr:.l f L;SSf:ur
E.~.V. - TCUlGUSl
PATHOLOGIE DE LA RfF)fWDlJCTION - OeSTETHIQU[
Jean rEr~!rY ••••••••••••••••••••••••••••••••• Prof'esseurr ~I V' TOI 1 1 (' : C ~~ • - li l. U J \.i_
DE1\.' r: E0L [1 r; l E
Jacques ROZIER •••••••.••••••••••••••••••••••• PrGfesseur[ \' I{ TO'Jl Gttr: r:_,...1 -, • V • - 1 t _ ,; .....: t ...
PATHOLOGIE DES EQUIDES
Jean-Louis POGCHELON •••••••••.•••••••••••••
P;HHOLOGIE 80VINE
J i~~ an l ECO ;:1. r~: ET. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • •
P~THOLOGIE CENERALE - MICROBIOLOGIE -
l rI; r'1 UNOL 0 Gl E
Jp8n OUDt'~: •••••••••••••••••••••••••••••••••
PH~RMACI[ - TOXICOLOGIE
Professeur~.• ;\, • V. - AL F[) i.(
PrcfesseurL <\; • V. - Nli ~1T FS
F'rofesseurF • \ • v. - LY[) ~;
G. L DFGl: [ ••••••• t ••• " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • F': r (j i" fJ 8 se uri • ~" • \/. - LVC~.
A mon vénérable oncle Serigne Madior CISSE
Admirable guide spirituel
Vos hautes qualités morales et votre abnégation
constituent pour nous un modèle de vie
Profonde gratitude pour vos prièr.es.
Hommages respectueux.
- A ma grand-mère
Pour ta bonté et ta générosité.
Profonde reconnaissance pour la tendresse et
la sollicitude que tu nous a toujours manifestées.
- A mon père
En témoignage de ma reconnaissance pour tous les
sacrifices consentis et pour l'amour que tu nous
a toujours porté.
Je te dois infiniment.
- A ma mère
Bien faible témoignage de ma reconnaissance
pour tous les sacrifices que tu as consentis
pour mon avenir et celui de mes frères ~t soeurs.
Puisse ce travail t'honorer.
- A mon mari
Un fruit de ta confiance et de ta co.préhension
Avec l'espoir que les vicissitudes de la vie
seront surmontées ensemble
Pour que s'éternise notre amour.
- A mes beaux-parents
- A mes beaux-frères et belles-soeurs
Exemple de bonté et de confiance
Avec la ferme volonté de ne jamais décevoir
Très vive affection.
- A mes oncles
Boubacar, Mambaye, Diakha et Khalyl
- A mes tantes
N'Dèye Khar, N'Dèye Awa, Fatou Niang Siga
Pour tout ce que vous avez fait pour moi
Vive affection et reconnaissance.
- A mes frères
- A rf/es soeurs
L'union fait la force
Ne jamais démériter
Mieux faire.
- A mes enfants : Faballa et Cheikh Tidiane
Avec l'espoir que vous ferez mieux.
- A mes cousins
- A mes cousines
- A toutes mes amies de la cité Claudel
- A Diogou et Fama
- A Marguerite
Qu'ils trouvent dans ce travail le témoignage
de toute mon affection.
- A ma famille
Que tous ses membres et chacun en particulier
veuillent bien trouver ici amour, aff~ction,
amitié et reconnaissance
Que l'unité existante s'éternise.
- A tous nos camarades de l'E.I.S.M.V.
En souvenir des moments difficiles passés ensemble.
- Au personnel de l'E.I.S.M.V.
- Au personnel de l'E.N.S.U.T.
- Au personnel de la Faculté de Médecine et de Pharmacie
- A tout le personnel de l'Univ~rsité
Pour leur aimable contribution à la réalisation
de ce travail.
- Nous remercions sincèrement
• Mme Jacqueline Piquet
• Mme Sylvie Gassama
• Mme Assanatou Sow
du département de Biophysique de la Faculté de
Médecine et de Pharmacie de Dakar
pour leur contribution effective et efficace à
l'élaboration de ce travail.
- A Messieurs • Papa Fall
• Bougaleb Omar documentaliste au L.N.E.R.V.
- A Mesdames • Diop secrétaire en Biophysique
• Fatoumata NDoye secrétaire à l'E.N.S.U.T.
• Diouf documentaliste à l'E.I.S.M.V.
- A Mademoiselle Marie No~lle MBengue secrétaire à l'E.N.S.V.T.
Pour leur gentillesse et compréhension
Pour leur amicale collaboration à l'exécution
de ce travail.
- A nos maîtres
• de l'Ecole Corniche Filles
• des Lycées Ameth Fall et Charles de Gaulle
• de la Faculté des Sciences
• de la Faculté de Médecine et de Pharmacie
• de l'Ecole Vétérinaire (E.I.S.M.V.)
Pour leur enseignement
Profonde gratitude.
- Le Professeur François DIENG
agrcig~ de M~decine L~gale â la Facult~
de Médecine et de Pharmacie de Dakar
Vous nous faites un grand honneur en acceptart
la pr~sidence de notre jury de thèse.
Soyez assuré de notre sincère reconnaissance.
Hommages respectueux.
- Le Professeur Alassane SERE
agrégci de Physiologie à l'E.I.S.M.V.
Vous avez bien voulu nous confier ce travail
et en suivre l'~laboration avec un soin particulier.
Soyez assur~ que votre rigueur scientifique
et votre esprit critique nous ont profond~ment marqu~s.
Il nous est agr~able de vous exprimer notre
reconnaissance pour votre enseignement, pour l'accueil
bienveillant et quasi paternel que nOus avons toujours
trouv~ auprès de vous et pour l'honneur que vous nous
faites en acceptant de si~ger dans notre jury de thèse.
- Le Professeur Ahmadou Lamine NDIAYE
agrégé de Zootechnie à l'E.I.5.M.V.
Nous avons admiré vos hautes qualités intellec
tuelles et votre sens du travail bien fait.
Votre présence dans ce jury est un honneur
auquel nous sommes très sensible.
Nous vous prions d'accepter l'hommage de notre
profond respect et notre vive reconnaissance pour votre
enseignement.
- Le Professeur Ibrahima Pierre NDIAYE
agrégé de Neurologie à la Faculté de
Médecine et de Pharmacie de Dakar
Nous ne dirons jamais assez la reconnaissance
que nOus vous devons pour le soutien et les marques de
sympathie que vous nous avez toujours accordés.
Vous nous faites un grand honneur en acceptant
de juger ce travail.
Nous voudrions mieux exprimer ce qu~ nous
ressentons pour vous témoigner notre reconnaissance et
notre profonde gratitude.
- Le Professeur René NDOYE
agrégé de Biophysique â la Facult~ de
Médecine et de Pharmacie de Dakar
Nous avons trouvé aupr~s de vous aide et
compréhension.
Vous nous avez séduit par votre abord facile
et votre grande disponibilité.
Vous avez accepté de juger ce travail.
Sinc~res remerciements.
-Par délibération, la Faculté et l'Ecole ont
arrêté que les opinions émises dans les dissertations
qui lui seront prés€ntées doivent être considérées
comme propres à leurs auteurs et qu'elles n'entendent
leur donner aucune approbation ni improbation·.
,
- l -
Dans les zones sahéliennes et sahélc-soudan;ennes
à climat chaud et sec où se situent la plupart ce nos
régions, le problème de l'eau revêt deux aspects:
- le premier est relatif au ravitailler1ent en eau
des animaux, il est du ressort des services d'hydraulique
pastorale et de l'éleveur,
- le deuxième concerne l'économie de l'eau chez
l'animal, il est du ressort du physiologiste ~t du zootechni
cien. Er. effet dans ces régions, "l a mise en jeu des réactions
thermolytiques déclenche une v~ritable concurrence pour l'eau
disponible entre les différentes fonctions" (105) et compro
met de ce fait toutes les productions.
C'est dans cet environnement considéré comme
hostile à l '~levage que nous avons choisi comme animal
d'étude le mouton, esp~ce si bien adaptée qur les pouvoirs
publics ont tendance ~ l'oublier dans les projets de
développement dp. l'éleva0e.
En r~alité, le mouton dispose de qualités à fairE
valoir
- sur le plan socio-économique, le Sén~gal est
un pays à ra pour cent musulman et le nombre d'ovins
sacrifiés lors de l'ATd el Kebir (Tabaski*) est considérable,
* Tabaski fête religieuse musulmane.
- 2 -
sans compter lors des cérémo~ies familiales (mariage,
baptême, ••• ). De plus en ~battage contrôl~ les quantités
pondérales d'ovins sacrifi~s par an sont très importantes.
- sur le plan zootechnique, le mouton est un
animal sohre et sa product~on est supérieure à celle du
bovin (42).
- sur le plan physiologique, la tolérance du
mouton aux températures élev~es est excellente:
• il est capable de sacrifier l'homéother~ie
en élevant rapidement sa température corporelle,
• la thermolyse par polypnée thermique et
sudation sacrifie l'eau du "milieu intérieur " (14). Cependan!
le mouton est capable d1économiser l'eau et on a constaté
que son pouvoir de concentration urinaire est supérieur
à celui du bovin (96).
Cette présente th~se sera intitulée "Contribution
à l'étude des secteurs liquidiens du mouton - Dosage de la
volémie au radiochrome 51Cr", sujet dont l'importance se
mesure au nombre et à la qualité des travaux qui lui ont
été consacrés.
En effet le problème du métabolisme de l'eau
n'est pas l'apanage de ce vingtième siècle en dépit des
- 3 -
multiples recherches en ce sens. Déjà en 185r., l'illustre
physiologiste CLAUDE BERNARD (14) affirmait:
"Personne ne contestera l'importance de
l'étude des différents liquides de l'orQanisme à l'état
normal et pathologique. C'est en effet dans le sang et
dans les liquides qui en dérivent que la physiologie
trouve la plupart des conditions pour l'accomplisse~ent
des actes physicochimiques de la vie, et c'est dans les
altérations de ces mêmes liquides que la médecire cherche
les causes d'un très grand nombre de maladies".
Cette phrase saisissante de vérité est encore
aujourd'hui irréfutable. En effet l'eau constitue "la base
structurale et fonctionnelle des êtres vivants" (11).
En outre ses fonctions sont sous la dép~ndance
de ses~propriétés physiques ~t chimiques.
Son rôle est fondamental dans l'hom~ostasie de
la température corporelle gr3ce à sa chaleur spr.cifique et
chaleur latente de vaporisation très élevées.
Nous nous sommes proposé de déterminer l'eau du
secteur plasmatique en raison de son rô1~ fondamerta1 dans
les mécanismes de lutte contre la chaleur.
- 4 -
En particulier son étude présente un intér~t
réel chez l'agneau en raison de sa toison peu d6veloppée et
de l'immaturité de son mécanisme thermor~gulateur.
Ce secteur assure en effet la liaison cr.tre
milieu ext~rieur et int~rieur et subit le prrmier toutes
les modifications de l'équilibre hydrique. E~ outre, toute
modification de ce secteur entratne des réactions correc-
trices par le mécanisme réflexe neuro-endocrinien et c'est,
à partir de sa composition ct de son vo1um0 que sc fait la
régulation des autres s~cteurs hydriques de l'organisme.
Notre étude compr~ndra deux parties:
- dans la première nous présenterons les
secteurs hydriques, les principes des méthodes de dosage
et le choix des substances utilisées.
la seconde partie sera consacrée ~ "cxpéri-
mentation et au commcnt~ire des résultats obtenus.
PRE t1 1 E RE? ART 1 E
LES SECTEURS lf/DRI~~:UES, EXAfilEN DES ['RIlKIPES
GENERAUX DES METHODES DE DOSAGE ET
CHOIX DES SUBSTANCES
- 6 -
Dans l'étude de l'hydratation de l 'organisme,
il est plus intéressant de voir la répartition de l'eau
corporelle en grands secteurs hydriques.
Cet artifice d'étude a permis de mieux cerner
les désordres hydriques en mettant en évidence une répar
tition anormale du capital hydrique en vue d'en proposer
une thérapeutique adéquate.
Nous étudierons ainsi dans cette partie:
- Les secteurs hydriques de l'organisme,
ensuite seront successivement abordés:
- Les principes généraux des méthodes de dosage
- Le choix des substances utilisées.
/:.. HAPITRE l
- 7 -
LES SECTEURS HYDRIQUES
Un certain nombre de considérations permet de
diviser l'eau corporelle en deux grands secteurs:
- un secteur extracellulaire
- un secteur intracellulaire
Il s'agit de considérations:
1) biochimiques: composition électrolytique
différente.
2) anatomiques: les liquides de l'organisme
sont contenus dans des formations anatomiques rlus ou
moins étanches.
3) fonctiornellcs : la répartition d'un corps
soluble, rarement uniforme dans tout l'organism( se fait
dan S Il n co mpar t i men t qui r econ na 1' t des l i mit cs. ~' 0 us
devons noter que ces compartiments encore appelés
lIespaces de diffusion ne coïncident pas exacteml.':nt aux
compartiments anatomiques ll (72).
• 8 -
Imf!ortance relative de~---5lj.'L!érent~.secteurs
~1dr ,i <I U ~.5•..ct!;.... .1_' !!.r:.9.! fi i s ry~
(Cours Magistral de Physiologie. 1979. E.l.S.M.J.:
Tube digestif____..J,--.......,là- .__.;' ", "': ~.~, J\NJ-
f-- .~
,
1
1!,!
!1
J•
Estomac
'-./Secteur plasmatique
(5 % du poids corporel)....11...... 1.
Secteur interstitiel
(15 % du poids corporel)
Secteur intracellulaire
(42 % du poids corporel)
~iminat;on ré".!
......--fCOMPAP11M[NT
EXTR/'.,CfCLUL/\IR
( ion domi nantr~ d '"
IN Rl1.:.'LLLULAIr.
( ~ i.: r; d ,; li: i nan t
- 9 -
1 - LE SECTEUR EXTRACELLULAIRE
Ce secteur comporte",,·af
,~: 1·
- l'eau plasmatique compartiment plasmatique
- les liquides interstitiels et la lymphe:
compartiment interstitiel.
Il met en communication les cellules avec le
milieu extérieur.
1.1 - Le compartiment plasmatique
Le liquide plasmatique est un liquide intravascu
laire circulant, en rapport avec le monde extérieur par l'in
termédiaire des poumons, du rein, du tube digestif et de la
peau.
C'est la circulation sanguine qui assure les
échanges respiratoires et nutritifs indispensables à la
vie; c'est elle qui règle la constance du "milieu inté
rieur" (14).
Le plasma sanguin est riche en chlore, sodium,
pauvre en potassium et une place à part doit être faite
aux protéines dont la concentration très forte distingue
ce secteur des autres compartiments du liquide extracellu
laire.
- 10 ~
les tissus
(Oe VIS SCHr R. 296 1) l 2B)
LIQUIDEINTRACELLULfl,IR.E:
LIQUJDE.:;
EXTRACE l LULJ i f{ C:.:
Liquide int':'1'stit~el
- 11 -
1.2 - Le compartiment interstitiel
C'est un liquide d'imbibition réalisant le bain
où les cellules vivent, puisent leurs aliments et rejettent
leurs déchets.
Il est séparé du pl~sma sanguin et lymphatique
par la paroi des capillaires.
L'eau interstitielle est riche en chlore et sodium
mais elle est beaucoup moins riche en protéines que lleau
du plasma. C'est une sorte d'ultrafiltrat du plas~a.
A ce secteur extracellulaire, il faut ajouter
"l'eau trar.scellulaire", dénomination suggérée par
EDELMAN (49), pour celle qui est contenue dans des compar
timents spéciaux de l'organisme, comme l'eau du tractus
gastro-intestinal, les liquides céphalorachidien et
synovial, l'urine contenue dans l~s tubes r6naux et la
vessie, l'eau des cavités p~ritonéale, pleurale et péricar
dique ainsi que les sécrétions comprises dans ln lumière
des glandes ct les humeurs oculaires.
II - LE SECTEUR INTRACELLULAIRE
C'est l'eau protoplasmique, support du contenu
cellulaire; c'est dans ce secteur que se déroulent les
différents processus métaboliques.
Les analyses de fragments tissulaires et tout
- 12 -
Mi 11 i-équivèllentsPar li""re.. ,-:- - ---.-- --,":"",,,..,
, Sub$ta'l'tc~S Mm i04llsN!$" d~V'eri.rt
,tu-. .... ~ ................'toiOU>, .......... -..,........,'*""'"
8ttrée
t,,.,.. .... --- '............ ...- ....... ~ ..... ... __ NJll'!'t
~
i1
1 1 . 11
En.1
1
~"i~~.~if
1-'!~.
~ ~
1 ~~
i11 j!i
1,tIl
!
1 1
NI
132
1 glucostl;..,. ............... f:!tIl6' .....
1
___ iIW)I """ ... -. Ul* ..... if.._ o1Uft "!Jl!:: ... "'2'~,
1Substancei Mn i Cm i,;;~~;. ft i,"""se~{'- - -- - - - - ..,," '"'''' - -.,r urée- ~, ,.... -' ~ ~~
LIqUIDES INTERS1!TIElS1
P l 1\ S MA
• glUC()$1'!!C,... .,. ........... fllW .... __ 'Obk ...,.. .......... ~ ~ ~t
••Mg 3
Ca 5ProtéiMS
J( 5 15-- ............. Ili".....A,ides organ\ ...
~;1i"5
$ r' 'I!lI"'6L01.- .11 ---Po.ii 2M:11Ii , -".11' "'...
COa H.or.
27
:4~ Cl
140 103
1;
1•
1
50
- 13 -
sp~cialement des muscles stri~s ont apport~ beaucoup de
renseignements sur la composition du liquide contenu dans
les cellules.
Sa composition électrolytique est diff~rente de
celle du secteur extrace"u'aire ~ le cation K+ y prédomine.
On y trouve ~galement du magn~sium, des sulfates, phosphates
et protéinates.
Avec JUSTIN-BESANCON et LAMOTTE (90) on peut
insister sur le fait que les substances dissoutes sont
inégalement réparties dans les cellules. Ainsi le phosphore
nra pas une répartition homogène dans les muscles, le
chlorQ égolement est particulièrçment abondant dans les
tendons, cartilages et muqueuse gastrique.
III - LES ECHANGES HYDRIQUES
Or considère classiquement que les secteurs extra
cellulaire et intracellulaire sont s~parés par la membrane
de la cellule mais il convient de noter que le fèit essenti(l
qui les distinoue llun de l'autre est une composition élec
trolytique différente d~terminart la plupart des mouvements
dreau.
Nous verrons successivement les types c1échanges
d'eau et le contrôle de ces échanges qui se font entre les
différents secteurs hydriques.
- 15 -
IILl - Les tYl2es d'échanQe entre ces secteurs
Des ~changes d'eau s'effectu~nt ~ 1'i~térieur des
divers secteurs dc" répartition hydrique puis ~rtre crs
secteurs ~t le milieu ambiant.
111.1.1 - Echanqes entre cellules et li~uidG
-----------------------------~----interstitiel
Ils se fort à travers la mpmbrane c~llclaire ct
répondent en particulier ~ des phénom~nes d'osmGs~. Le
cOfT1partim(~nt le plus hyp':rtoniqu.' "pvmpe" (72),1(:: cornpi'lrti-
ment le plus hyootoriquc. Ainsi toute hYPlrtor~; osmotiqu~
extr<1CL:llul",irt:' tend à f3ir;: paSSEr de l'E~u des rc:llules
vers l~ sect~ur lxtr~cel1ulairc ; inversement ~GLte hypotor~~
osmotique ~xtr~cellulaire ~ugmcnt~ l'hydr~t~tior c211u11ir:
aux déoc:ns du S.:ct'è:ur (;xtracFlllllaire.
[0ns ce type d'~changc, cn dehors u~~ fJcteurs
cxtracellulair~s qui se résument dans 105 müd;fi(~ti(ns
de l~ pression osmctique de ce sectccr, des facteurs dits
Il C p l l u l :;. ire sile r. c ') r (' f () r t !Tl '''1 l C (~~ n r. us, fj li l i P "i rl ;;: S t pro t é i n t' <;
e t n p t a b Ci lis fT1 C cel l ulai r p j (i !J (; r: t U li r ê 1.: i [11 r :' r t ,~, \~ t, i rte r -
viE:nrent.
- 16 -
111.1.2 - Echanges entre liquide interstitiel et----------_._---~---------------------
C'est la présence J'un taux de protéines beaucoup
plus élevÉ dans le plasma que dans les liquides intersti-
tiels qui conditionne les échanges entre ces d~ux compar-
timents hydriques.
Oans le capillaire artériel, l'eau plasmatique
tend à fuir vers les liquides interstitiels SO!JS l'influenc.:-
de la pression hydrostatique (P.H) sanguine qlli est supé-
rieure à la IIpression oncotique" (P.O) exercée par les
protéines plasmatiques; dans le capillaire vcin~ux l'eau
est attirée à nouveau des liquides interstitiels vers le
torrent circulatoire en raison de la pressiür~ oncotique
qui est supérieure ~ la pr~ssion hydrostatique.
monde extérieur
Le liquide plasmatique reçoit du monde extérieur,
par l'intermédiaire du tube digestif l'eau ingérfe et
absorb~e au niveau des capillaires intestinaux, de m~me
que les aliments rendus assimilables par le foie.
Grâce aux poumons, il reçoit égalemert l'oxygène
nécessaire aux combustions.
En outre, du fait de la disposition Je l'appareil
circulatoire, il est directement branch6 avec plusieurs
- 11 ..
!!of!r~ ! E!:' t •.t i,!~ .~5~~!!Jl!U!t..!Î...Y_'un ! 6'1 ' • .t~~~~ ilses d-:1!.':L~~,~~t!:f;.
J.!_PJ.!.2~!jtJ!_~_.' ~.!...~ttj.~..!.!'l.!lt!sJ 14. ~fl • t,~.!S.ti~~!Lf:~l:.w,U.
R!.!..~ J.~~J:1..dr~l.t- t i ~ue d~ !l!...)!LJ~j1tU1.!..i!..~(tŒm4ANf4, CH.::f{, P.'rltis à4J. Phj's101~iel' M~S$on tk!" 1§16. 1151)
Pressiononcot i qt.Hl! ..
rr;PA.CfS
\FRST!TIElS
ES~ACE$
ESPACES
Pression hydrostatique15 l'lUllHg
(intéri@ur~ • l~ pr~~~inn
, oncQtiqu~)
;::".=
Pression hydroetatiQut.
Pres!ion oncotique
lJ'ff~rente entre les deu)t. (flux net)
TractusG GestH
\
.. 18 '.
f.!!!..tr~ i ....~~~ . U!I!! 1~!~.s,_,!J..LÇ2r.I~IL.: f,f." ~r;:l!ts ....!~~::,.IL
milieu extérieur~_-.,.... t '/,II_"'_"'~""_
OANOWSKI end ElKINTON. Body Flu)ds. 1955. 5
Peau
.-----.
LIQU,uJEINTPf.,CfLLULA IPf
Rein
• 19 -
organes éliminateurs de déchets à savoir
le rein
- le tube digestif
- les poumons
- la peau
Dans l'~tude du comportement, de l'adaptation
des animaux au climat chaud et sec, cc type d'~change
mérite une attention particulière.
En effet le liquide plasmatique est le plus
mobile et subit les perturbations initiales lors d'expo
sition à la chaleur.
Lors de perte abondante d'eau par sudation ou
polypnée consécutive à l'exposition au chaud, 12 plasma
devient hypertonique. Il y aura appel d'eau du liquide
interstitiel vers le plasma hypertonique. Il s'ensuit un
passage d'eau du liquide intracellulaire vers le secteur
interstitiel.
Ainsi tous les secteurs encaissent ce déficit
hydrique. ~ais cette correction d'urgence do la perturba
tion ne suffit pas. Il faut que la perte par les divers
émonctoires de l 'organis~e soit comblée par 1 'opparition
d'une sensation spéciale, la soif et par la r~duction du
volume urinaire.
- 20 -
Soif (pour les entrées d'cau) et sécrétiun
urinaire (en ce qui concerne les sorties d'eau) 50nt donc
les deux postes les plus importants et ajustables du
bilan hydrique qui est un 1ndicateur pour l'équilibre
hydrique.
Dans la pratique, l'économie de l'e8u chez les
animaux adaptés à 1~ sécheresse se jouera essentiellement
sur ces deux postes ajustables du bilan hydrique ~ savoir
- résistance à la déshydratation
- réduction de la diurèse.
les ~nim~ux résistants à la d~shydratation
perdent un peu de leur poids en un temps relativement plus
long que pour les autres. Ainsi MC FARLANE (107) rapporte
qu'une perte de poids de 20 % sJobserve en
- 7 à 10 jours chez le chameau
- 5 à 4 jours chez le mouton
2 à 3 jours chez le bovin
lorsque la température maximale diurne dépasse 40 oC.
D'autre part le rein du mouton a un potentiel
de concentration qui représente 2 à 3 fois ce qu l ;l utilise
dans les conditions normales. La concentration urinaire
d'un mouton hydraté est de 1200 mosm/l ccmpar6e à 3800 moSm/l
lorsqu'il est privé d'eau pendant 6 à 8 jours (96).
mosm/l = milliosmole par litre
.. 21 -
(Cours magistr.l de Physiologie, 1979, f.I.S.M,V.)
11\....QI
...-+.>..... --, +.>11\
L~ liquides....s::.... intracellulairesVIQI"0.....
ce :Jx: t7
1li') ....<: -'..J0-
...;..........::...... : .................... ,.:....•-,.•.••••.•.•"..••..•.•_.*,'._.': .."fI" ..........:.:-.:.....::• '. ••• • .... ~..• " ....... " • 4 .:·.·..::·:·:::,..: ....... ~:.··.·.·.·.·.·.·.·c·.· ...·::"':: .~.: ...;'\!...... ..... -;1'••-• .. ".••• • • ......••~:•••:. ta ••••••••• ••••.,.·.·.c •• ~ ••:.-;. •• ' ••••1.......; _'".",-:••• ~ •• \IlI:.J:. ......(,j. ,* ............ ····i······.,..··tt.!t,· .... :........~:..........::,'::: .-: ......I!l.,~ .. _:': ".I·.~:::., 1-....-: ... .......... ......
- So ~ uté~
~ passage d'eau
Une diminution de la teneur en eau du plas.ma ::~~, augmen-t at ion de lac 0 ncent rat ion des 0 luté s ~~-:} é l évat ; Cl n (li:~l apression osmotique ~~ passage d'eau des liquides interstitielsvers le plasma ~~> le secteur interstitiel devient hypertoniquepar rapport au secteur intracellulaire : ~... appel d~eau dusecteur intracellulaire vers le liquide interstitiel. d~où
déshydratation cellulaire et apparition du phénomène rle soif.
- 22 -
En pathologie également. le bilan hydrique est
positif (c'est-à-dire que les entrées d'eau sent supérieures
aux sorties) lors de r6tention hydrique lorsque des épanche
ments se forment d~ns les séreuses ou dans le tissu con
jonctif (oedèmes) ; il est par contre négatif (c'est-à-dire
que les sorties d'eau sont plus importantes que lps entrées)
dans les d6shydratations : c'est ce qui se produit lors
d'i~portantes déperditions hydriques par exemple dans les
diarrhées ou lorsque les pertes d'eau par vaporisation ne
sont pas compensées par un apport d'eau suffisant.
111.2 - Régulation des échanges hydrigues
Le contrôle des échanges hydriques est humoro
neuro-endocrinien.
- Premièrement des centres diencéphaliques sont
sensibles
• par des volorécepteurs à la quartitf
• par des osmorécepteurs à la composition des
liquides extracellulaire et intr~cellulaire.
Les impressions reçues sont transmises aux
centres coordinateurs hypothalamiques et déclenchent la
sensation de soif.
Ce phénomène de soif joue un rôle essentiel
dans la régulation de l'équilibre hydrique en permettant
d'ajuster l'apport liquidien à la quantité excr('tée.
• 23 •
Sur le plùn physiologique donc la soif apparaît
comme un signal indiquant la nécessité de remplacer l'eau
perdue par l'organisme.
On lui reconnaît en général une cause locale:
(CA~NON et GREGERSEN) (29) la sécheresse buccopharyngienne
sous la dépendance d'une insuffisance de la sécrétion
salivaire, une cause générale (CLAUDE BERNARD) (15) qui
est l'appauvrissement général de l'organisme en eau.
Cependant BELLOWS (10) estime qu'on peut combiner
ces deux théories car un appauvrissement de l'organisme en
eau a pour première conséquence un tarissement de la
sécrétion salivaire.
- Deuxièmement le système endocrinien règle les
excreta
• La post-hypophyse agit sur le rein par son
hormone antidiurétique (ADH). La sécrétion dr. cette hormone
a pour conséquence l'exagération de la réabsorption active
de l'eau au niveau du segment distal du tube urinifère.
Il en résulte une réduction rapide de la diurès~ et. par
suite, une diminution des déperditions aqueuses susceptibles
de se produire au niveau du rein. Ce phénomène aboutit
donc ~ favoriser la dilution du plasma.
- 24 -
• L'anté-hypophyse met en jeu les surrpnales
qui, par leurs minéralocorticoTdes en particulier l'aldos
térone,réglent la rpabsorption de l'eau et des ions.
L'aldostérone, hormone dé l'épargne sodée agit au niveau
du tube contourné distal du rein et emp~che ure éliminatior
hydrique importante •
• A un degré moindre, la thyroïde, les oestrogènes
agissent sur la déperdition ou la rétention hydrominérale.
Ce contrôle a pour but de maintenir dans l'orga
nisme un ~quilibre hydrique normal mais il suffit qu'un
des multiples facteurs de l'équilibre: tube digestif,
appareil respiratoire, circulatoire, nerveux, endocrinien,
rein, n'assume plus ses fonctions qu'il apparaisse un
trouble du métabolisme de l'eau qu'il conviendrè de corrigtr.
(:. HAPITRE II
1 - DEFINITION
- 25 -
PRINCIPES GENERAUX DES ~fTHODES
DE ~1ESURE
,Le principe de toutes les méthodes de mesure
des secteurs hydriques de l'organisme est basé sur le
fait que l'espace de diffusion de certains corps. qui
est Ille volume hydrique apparent dans lequel cett8 subs
tance s'est répandue de façon homogène lorsque sa diffusion
est complète ll (HAt-lBURGER) (72), semble avoir des frontièrE:s
grossièrement superposables à celles des différents
5ecteurs.
Ce principe est simple et HAXHE (79) le définit
ainsi
IISi une qun"tit~ Q d'une substance indicatrice
quelconque est introduite dans un syst~me clos et que
cette substance se distribue uniformément pour atteindre
un équilibre, le volume total V du système peut sc calcu
ler à partir de la corcentration finale C. En effet Q = CV".
LJ~quilibre suppose que l'indicateur nr puisse
être détruit ou form~ dans l'organisme et qu'on ruisse
conna'tre la quantit~ excrétée ou perdue pendant la
période d'équilibre.
- 26 -
Cependant les substances utilis~es comme indi
cateur dans ces dosages doivent présenter un certain
nombre de conditions qu'exigent l'expérimentation et leur
usage chez des êtres vivants.
II - CONDITIONS EXIGIBLES POUR LE CHOIX DE LA SUBSTANCE
Elle doit:
- diffuser uniformément et rapidement dans son
espace de distribution (114)
- ne pas pénétrer dans les autres compartiments
- s'éliminer très lentement
- ne pas subir d'altération dans l'orgarisme
- ne pas être toxique
- se prêter à un dosage facile, rapide et précis.
Toutes ces conditions sont très diffic~les à
réunir, voire même impossibles. Aussi si l'une d'entre
elles fait défaut la méthod~ doit être considérrf comme
un procédé clinique approximatif.
Dans tous les cas, il est donc n~crssaire que la
technique utilisée soit précisée dans l'exposé des
résultats.
- 27 -
III - MODE DE CALCUL D'UN ESPACE DE DIFFUSIO"
Après l'injection d'une substa~ce diffusant
dans un secteur hier d~terminé, on fait des rrél~vcments
à des intervalles de temps donnés en vue de d6t~rminer la
concentration de la substance.
La concentration plasmatique, en fonction du
temps passe par deux phases
- une période de diffusion à pente rapide
- une période d'élimination représe~tée par une
droite sur du papier logarithmique.
Pour faire un calcul correct il faut pouvoir
déterminer avec certitude le moment o~ la diffusion de la
substance est complète et homogène, ce qui nl(st guère
facile.
Trois méthodes sont proposées pour contourner
cette difficulté
- la méthode du prélèvement unique
- la méthode d'extrapolation de CACHERA et
BARBIER
- la méthode de perfusion contirue
III.l - Méthode du prélèvement unique
L'expérimentation permet de déterminer pour
chaque substance un délai suffisant pour que la diffusion
soit complète. Et, c'est passé ce délai qu'on 2ffectue et
- 28 -
dose le prélèvement.
Deux cas sont alors à envisager
1) Si le corps ne s'élimine pas par l'urine J
o~ admet que le dosage effectué reflète exacte~ert la
concentration C réelle de cette substance.
Et la formule V = Q permet de calculpr le volumeC
de diffusion VJ Q étant la quantité de substance injectée.
2) Si le corps s'élimine rapidement dans les
urines J il faudra doser la quant1tée E excr~tée dans
l'urine entre le moment de l'injection et le mo~ent du
pr~lèvement sanguin.
La formule sera V = Q - EC
Cette méthode simple et rapide marqu2 de
précision car elle néglige les pertes extrarénales et ne
fait appel qu'à un seul dosage sanguin.
111.2 - Méthode d'extrapolation établie par C~CHERA et
BARBIER (25-27)
Ces auteurs ont proposé la construction de la
courbe théorique d'élimination de la substance étudiée de
façon à pouvoir établir le taux virtuel qu'elle aurait
atteint si l'élimination avait été nulle.
- 29 -
la courbe est 6tab1ie sur oapier scmi-
logarithmique et les pr~l~vements sanguins successifs de
la p~riode d'élimiration fournissent des taux pl~smatiques
se situant sur une droite.
On prolonge le segment rectiligne de la courbe
vers l'axe des ordonnées à gauche et on obtient un point
désigné par Co qui Ilfournit la valeur idéale de la concen
tration telle qu'elle apparattrait si la diffusion du
produit ~tait instantanée au moment de l'injection"
(CACHERA) (24).
Le volume de la diffusion V sera fourni par la
formule
v = QC-o
où
Q est la quantité injectée et
Co la concentration virtuelle lue sur la cour Le au
temps O.
La courbe d'élimination étant légèrement en pente,
Co sera supérieure à la valeur fournie par la pre~ière
méthode. Aussi on obtiendra. par c~tte méthode des espaces
de diffusion plus r~duits que ceux déterminés par la
m€thode du prélèvement unique.
Cette méthode est d'autant mei11éurE que la
pente d'élimination est constante. Elle est plus sûre que
la préc~de~te mais nlest pas à l'abri de toute critique
.. JO .•
100
Co
40
20
------.....
T'E'mp ~'- ..... -.,..,... .- ...... ~, l (h '.' .~ 1 e d~c 1...
n1 ~~ '{ ~: .~
- 31 -
notammer.t en ce qui concerne les corps ayant, com~e
l'urée (72), une clearance élevée et variable 2vec la
diurèse aqueuse et dont la pente d'élimination ne rcut être
considérée comme constante. De ce fait "il devient arbitrair~
d'extrapoler vers la gauche le segment d'élimination".
En effet pour l'urée la Quantité éliminée par
unité de temps dépend dû sa concentration dans le s~ng et
du volume de la diurèse aqueuse.
111.3 - Méthode de perfusion continue
On r~alise une perfusion prolongée et continue
de la substance afin de compenser l'excrétion du produit.
Puis on arrête la perfusion lorsque, par dosaqes successifs,
on obtient un taux plasmatique constant, tout en ~dmettant
alors que la dispersion de la substance est totalé dans
l'espace à mesurer.
Tout~s les urines sont ~nsuite recueillies de
façon à déterminer la quantité totale Q élimin~e rar l'or
ganisme jusqu'à disparition totale de la subst~nce dans
les humeurs.
N,B. : La clearance exprime l'élimination plasmatique de la substance
par unité de temps; c'est une -mesure de l'épuration
plasmatique·.
- 32 -
L'espace de diffusion V est alors donné par la
formuleQ
V = ë
dans laquelle C est la concentration plasmatiQ~e dll corps
étudiée aussitôt avant l'arrêt de la perfusion.
Cette méthode a l'inconvénient d'être longue et
délicate.
D'autre part or. ne ma~trise pas avec certitude
le moment où la diffusion est complète et homogène car
l'espace de diffusion peut ne pas être complèttwent occupé
même si les pertes par voie urinaire sont comçensées par
la perfusion continue.
~ussi DEANE (40) propose de déterminer linon plus
le moment où la concentration plasmatique C devient cons-
tante mais celui où elle devient proportionnellr à la
somme des quantités injectées par voie veineuse di~inuée
de la somme des quantités excrétées par voie rénale'l.
Cette proportionnalité suppose que tout l'espace
de diffusion soit occupé.
Selon HAMBURGER et MATHE (72) "un tel procédé
est relativement rapide mais exig~ une rigueur extrême
dans la constance de la quantité de produit perfusée par
minute".
- 33 -
/: HA PIT REl II CHOIX eES SUBST Mices
De tr~s nombreuses susbtances ont ~t~ utilisées
pour la détermination des secteurs liquidiens. Ces subs
tances encore appelées "traceurs Il sont de deux ordres
principaux :
1) - traceurs chimiques où l'indicateur est une
molécule ou un ion, dosé par une de ses réactions caractp
ristiques.
2) - tra,ceurs radioactifs dont la concentration
est évaluée par la mesure de leur activité.
Cependant nous devons souligner qu'actuellement
les traceurs radioactifs trouvent dans l'étude de l'eau
et des électrolytes un vaste cha~p d'application en raison
de leur utilisation facile nécessitant cependant un matéripl
onéreux et fragile.
Leur emploi est basé sur le principe général des
techniques de dilution.
1 ~ SECTEUR EAU TOTALE
A la fin du Ige siècle, des auteurs co~me
VOLKMAN~ (16S) et ENGELS (54) fournissent les rremi~res
données sur l 'hydratation totale de l'organisme en
desséchant des cadavres.
- 34 -
Ils ont alors montr~ que l'eau tctale rlu corps
représentait entre 58 et 72 pour cent du Doi~s du corps.
Mais devant ltimpossibilité de réalis~r cette
méthode de dessication sur le vivant de l'anim~l et son
imorécision, des techniques applicables in vivo furent
mises au point.
Il s'agit de la méthode de dilution qui consiste
à administrer une substance chimique, en quantité connue,
par la voie sanguine et à déterminer son espace de diffusion
(ou dilution) lorsque sa répartition dans le secteur est
complète et homogène.
Oe nombreuses substances ont un espace de dilution
qui se superoosp au volume de l'eau totale du corps et par
suite ont été proposées comme traceur pour la mesure de
l'eau totale, chacune dans une technique particulière.
Il s'agit de :
- l'urée (2 - 30 - 89 - 114 - 115 - 125)
- la thiourée (31 - 3q - 170)
- la sulfanilamide (53 - 80 - 125)
- l'antipyrine (12 - 19 - 47 - 93 - 135 - 153 -
154 - 159 - 168)
- la 4-amino antipyrine (A7)
- la N-acétyl-4-amino antipyrine (12 - 135 - 136 -
160 - 168)
- la 4 iodo-antipyrine (75)
- 35 -
- l'oxyde de deutérium ou (eau lourdt) (21 - 49 -82 - 106 - 127 - 145 - 146 - 158 )
- l'oxyde de tl'itium ou (eau tritiéc) ( 3 - 8 -17 - 57 - 72 - 74 - 100 - 115 - 117 - 122 -126 - 131 - 135 - 139 - 147 - 161 - 163 - 172)
1.1 - L'urée
Différents travaux ont montré qu'ello tend à sc
r~partir dans les divers tissus de l'organisme proportion
nellement à leur teneur en eau {JAVAL et BaYET (89),
MARSHALL et DAVIS (114), AMBARD (2)}
Elle présente certains avantages tels la facilité
de dosage, le prix de revient peu élevé et la Dossibilité
de nombreux contrôles pour la répétition de l'épreuve.
Cependant elle reste inapplicable
- quelle que soit l'espèce, aux sujets atteints
d'insuffisance rénale élevée,
- sous sa forme la plus simple (urée ordinaire)
chez les ruminarts qui métabolisert l'urée
dans leur tractus digestif.
1.2 - La thiourée
Il apparaît des travaux de DANOWSKI (39) chez
le chien que les variations dans les volumes de diffusion
de la thiourée correspondent en gros aux variations du
- 36 -
volume d'ealJ corporelle mais CHESLEY (31), ~ILLIAMS et
col. (17D) mettent en doute chez le rat et chez 'Ihomme
l'homogénéité de la distribution de cette substance dans
la totalité de l'eau du corps.
1.3 - La sulfanilamide
A la suite des travaux de PAI~TfR (125) chez
le chien, on considère qu'actuellement ce traceur est un
indicateur de diffusion assez grossier. C'une façon
générale l'espace sulfonamide est supérieur au volume
d'eau totale. De plus son usage nlest possible que chez
le chien car chez l'homwe et les autres animaux, elle est
conjuguée dans le foie sous forme d'acétyl-sulfanilamide
et elle donne avec les protéines des composés à distri
bution irrégulière (RO).
1.4 - L'antipyrine
Proposée par SOBERMA~ et col. (153-154) dans la
mesure de l'eau totale tant chez l'homme que chez l'animal,
l'antipyrine satisfait bien aux conditions i~posres à un
indicateur d'espace de diffusion.
Elle est dosée de façon précise au spectrophoto
m~tre u-v (47-154), mais on doute de l'homog~n6ité de sa
distribution dans la totôlité des espaces d'eau et sa
vitesse d'élimination est rapidé.
•
- 37 -
1.5 - La 4-amino-antipyrine {4-A.A}
Proposée comme indicateur d'eau totale par
HUCKABEE (87), d'apr~s cet auteur, cette substance présen
terait des avantages certains par rapport à l'antipyrine
et devrait progressivement se substituer à cette dernière.
La comparaison des résultats fournis par la
mesure simultanée de l'eau corporelle au moyen de l'anti
pyrine et de la 4-A.A montre que les espaces de dilution
de la 4-A.A. sont égaux ou légèrement inférieurs à ceux de
l'antipyrine.
1.6 - La N-acétyl-4-amino-antipyrine
BERGER, BRODIE et col. (12) la proposent comme
indicateur d'eau totale.
TALSO (160), l'utilise chez 1 l homme, REID et
col. (136) chez le boeuf, puis GLASCOK et col. (135) chez
le lapin.
Son dosage est plus facile que celui de l'anti
pyrine (ne nécessitant pas un dispositif U.V) mais en
raison du nombre limité de travaux ré~lisés avec cette
substance, il est difficile de porter un jugement de
valeur sur son intérêt et sa précision.
- 38 -
1.7 - La 4-iodo-antipyrine
Elle a été utilisée chez l'homme (160) et chez
le mouton par HANSARD et LYKE (75), où elle a fourni des
résultats comparables à ceux de l'antipyrine.
Des données plus détaillées manquent à son sujet
mais il semble qu'elle ait un dosage plus simple que celui
de l'antipyrine (75).
1.8 - L'eau lourde
HEVESY et HOFER (82) proposent son usage chez
l'homme. Elle a l'avantage de ne pas être toxique pour
l'organisme aux doses utilisées et se mélange parfaite
ment à toute l'eau extrace11u1aire y compris l'eau intra
cellulaire car sa pénétration cellulaire semble identique
-à celle de l'eau ordinaire (21 - 127).
On lui reproche cependant de nécessiter des
méthodes de dosage délicates et onéreuses et de surestimer
la quantité d'eau corporelle (145).
1.9 - L'eau tritiée
La détermination de l'eau totale nécessite l'em
ploi d'un traceur se répartissant uniformément dans tous
les espaces d'eau.
- 39 -
l'accord de tous les auteurs est fait actuelle
ment sur le choix de l'indicateur le plus adéquat pour la
mesure de l'eau totale. la présence d'un radio-isotope
dans la molécule même de l'eau, constitue en effet un indi
cateur idéal, réalisé par l'eau lourde et l'eau tritiée.
En outre l'eau tritiée présente de nombreux
avantages :
- emploi à des doses traceuses,
- prix de revient faible,
- pur émetteur de rayonnement a (bêta) très mou.
le faible pouvoir de pénétration des 6 facilite les mesures
de protection contre les dangers dtirradiation,
- injectée par voie intraveineuse, elle diffuse
rapidement et de façon homogène dans la totalité de lfeau
corporelle. Sa concentration finale permet de calculer
l'eau totale par la méthode classique de dilution isoto
pique.
- son dosage est facile pour tout laboratoire
équip~ en compteur à scintillation liquide.
Néanmoins cette substance présente les inconvé
nients de tout corps radioactif. Certes les radiations
émises sont faibles, très peu énergétiques, ce qui d'ail
leurs rend le dosage assez délicat, mais il existe un
danger potentiel dans l'introduction dans ltorganisme de
ce produit radioactif à période de vie relativement
- 40 -
longue (12, 3 années) (72).
Concernant le mouton, la littérature fournit
quelques données :
- ANAND et PARKER (3) trouvent une valeur d'eau
totale égale ~ 54,6 : 1,8 % du poids du corps et une demi-vie
binlogique d'eau tritiée de 5,4 : 0,4 jours.
- HANSARD (74) montre respectivement chez des
moutons jeunes et adultes que le secteur "eau tritiée" est
- TILL et DOWNES (161) obtiennent une valeur de
~B,O à 78,0 % avec une moyenne de 62,0 %.
- PANARETTO (126) trouve 34,6 à 72,2 %.
- Plus récemment AGASSE (1) obtient trois séries
de résultats :
• Chez des agneaux non sevrés il trouve un secteur
d'eau totale égal ~
* 70,07 : 2,79 % par la méthode de CACHERA
et BARBIER (26)
* 71,03 : 2,97 % par la méthode du prélèvement
unique •
• Chez des agneaux sevrés et des moutons adultes,
en considérant l'eau du tractus digestif comme faisant
partie de l'eau totale, il trouve respectivement 74,25 %
et 67,54 % du poids du corps.
- 41 -
et 67.54 % du poids du corps.
II - SECTEUR RUMEN-RESEAU
L'eau des réservoirs gastriques ne représente
qu'une réserve très minime chez les monogastriques ; elle
est plus importante chez les herbivores mais "la quantit~
d'eau physiologiquement disponible est faible car la
résorption de cette eau entraîne rapidement une dessica
tion du contenu gastrique des réservoirs incompatibles
avec leur fonctionnement normal" (149).
Ce secteur propre aux ruminants nia été ét dié
que récemment; et un certain nombre de substances ont ét~
proposées pour effectuer le dosage in vivo.
Clest ainsi qulen 1874 WILOT (169) utilise la
silice. En 1953, SPERBER. HYDEN et EKMAN (156) trouvent
que le P.E.G. (poly~thylène glycol) est la substance
appropriée pour mesurer le volume ruminal mais SMITH.(151)
en 1958.montre que des substances interférentes présentes
dans le duodénum pr~cipitent avec le P.E.G. Et surévaluent
le volume du rumen.
En 1963 l'usage des sels de lithium s'impose
gr~ce aux travaux de HARISSON, HILL et MA~GA~ (78). En
effet le sulfate de lithium (Li2S0~) a l'avantage de
pouvoir être utilisé à de faibles concentrations pOl'r
la mesure du volume ruminal.
- 42 -
De plus le lithium est facilement dosé par le
spectrophotomètre de flamme avec une bonne précision.
Un peu plus récemment DOWNES et Mc DO~ALD (45)
(1964) utilisent le chrome radioactif 51Cr associé à
l'acide tétraacétique éthylène diamine ( 51 Cr_E.D.T.A) et
un ar plus tard TILL et DOW~ES (160) montrent que l'usag
du P.t.G. marqu~ au tritium facilite le dosage.
~ous avons peu de données sur le secteur rumen
réseau des ovins.
- Mc FARLANE (108) rapporte, chez d~s moutons
Mérinos, que l'eau ruminalc représente 4 à 14 1, du poids
du corps.
- MAN GAN et WRIGHT (112), en utilisant le
sulfate de lithium comme traceur, trouvent respectivemen
sur deux moutons différents un volume ruminal de 4,79 ct
5,94 litres.
- AGASSE (1) trouve r~spectivcment chez des
agneaux sevrés et des moutons adultes un secteur rumen
réseau égal à 10,7 + 1,32 et 9,44 + l,al 1. du poids
corporel.
- 43 -
III - SECTEUR EXTRACELLULAIRE
Jusqu'à nos jours t la mise au point d'une
méthode pouvant déterminer ce secteur s'est avérée diffi-
cile. En effet on n'a pas encore trouvé la substance qui
doserait uniquement ce secteur sans jamais pénétrer dans
la cellule.
Différentes substances ont été proposées, cepen-
dant nous nous intéresserons à cell~s d'un emploi plus
courant.
111.1 - Thiocyanate de sodium
Il a connu le plus de faveur parmi les substances
proposées pour la mesure des liquides extracellulaires.
~
Son avantage réside dans sa répartition rapide
(45 minutes) et son dosage facile (38-65-66).
En outre il a pour inconvénient de pénétrer dans
certaines cellules (érythrocytes et cellules de la muqueuse
gastrique) (38), et d'être éliminé par la voie digestive
et urinaire; raison qui a conduit CACHERA et BARBIER à
proposer la méthod~ d'extrapolation définie auparavant.
111.2 - Mannitol
C'est un alcool dérivé par hydrogénation d'un
sucre la mannite.
- 44 -
En 1947, ELKINTO~ (51) démontre que cette subs
tance permet de déterminer simultanément le volume extra
cellulaire et la cleara~ce glom~rulaire mais elle a le
grave inconvénient d'être partiellement métabolisée dans
l'organisme.
111.3 - Inuline
KRUHOFFER (99) le propose le premier. Il semble
qu'en raison de son poids moléculaire élevé, elle ne
pén~tre pas dans les cellules et constitue alors la
substance idéale mais elle présente deux inconvppients
majeurs: une lente diffusion et unE rapide élimination
rénale (5~, 144, 151).
111.4 - Sodium radioactif
Le sodium radioactif 24 Na a été proposé pour la
mesure du liquide extracel1ulaire par de nombreux auteurs
(55,91). Ces derniers montrent que le meilleur moment pour
doser le volume de ce secteur se situerait entre 1 heure
30 minutes et 3 heures après l'injection. Passé ce délai,
les chiffres seraient majorés sans doute par un certain
degré de pénétration intracellulaire (91, 110).
- 45 -
111.5 - Radiochlore
Et udi é par MA~I ERYe t HAEGE (Ill), i l a Po t é
utilisé dans la détermination des secteurs extrocellulairés
par de nombreux auteurs (68 - 166 - 171). Mais sa technique
s'est avérée difficile à cause de la période relètivement
courte de cet isotope 36Cl (37,3 minutes).
111.6 - Radiobrome et Radiosoufre
De nomhreux auteurs (20 - 66 - 166) montrent que
l'ion brome se répartit dans les tissus exactement comme
l'ion chlore. On l'a utilisé avec l'ion soufre 35S pour
faire une comparaison dans le dosage de ce secteur (102).
111.7 - Radiosulfate
SAVOIE et JUNGERS (142) montrent que l'ion
sulfate radioactif permet de déterminer le secteur extra
cellulaire, chez l'homme. Son dosage est facile en scintil
lation liquide. Mais le sulfate. indique-t-on, passe dans
l'estomac, les intestins, la moelle et donc, son espace
de diffusion n'est pas strictement extracellulaire.
- ~6 -
IV - SECTEUR SANGUIN, SECTEUR PLASMATIQUE
La saignée fut d'abord utilisée puis rapidement
la méthode de dilution s'impose.
La composition singuli~rement riche du sang peut
se schématiser en une phase liquide, dispersante, le plasma,
et une phase solide, dispersée dans tout l'organisme,
constituée par les globules rouges, leucocytes et plaquettes
encore appelés "éléments figurés " du sang.
Aussi la mesure du volume de l'eau plasmatique, ' ..
peut se faire selon deux procédés différents
1) - soit en déterminant l'espace de diffusion
de substances à grosses molécules qui vont se diluer plus
ou moins parfaitement avec le plasma. Il s'agit
- du bleu de Chicago (94)
- de la polyvinylpyrrolidone (subtosan) (46 - 132)
- de la tétraiodophénolphtaléine (133)
- du rouge vital (77)
- du rouge brillant vital (85).
- du rouge Congo (115)
~- du bleu trypan (148)
- du bleu Evans (62 - 63 - 64 - 95 - 143).
2) - soit en mesurant de façon indirecte le
volume plasmatique à partir du volume globulaire total
sichant que la concentration des globules est fixe et
donnée par l'hématocrite.
- 47 -
Les méthodes principales uti1iser.t l'oxyde de
carbonf? (37 - 86 ), puis les radioéléments tels
- le 59FC' (60 - 70 - 71 )
- 1' 131 1 (92)
- 1e 32p ( 5 - 22 - 120 - 121 - 142)
- le 51Cr (l ... 61 - 95 - 157) •
Parmi toutes ces substances dont l 'espace de
diffusion a ~t~ préconis~ pour esti~er le volume plasma
tique, les plus intéressantes sont:
IV.l - Bleu de Chicago
Proposé par CACHERA et BARBIER (23), son usage
est facile. Une simple lecture photom~trique permet de
déterminer la teneur en colorant du plasma.
Cette technique comporte cependant des diffi
cu1t~s lorsque le plasma est trouble, ce qui se produit
notamment lors d'hyperlipidémie.
IV.2 - Po1yviny1pyrro1idone
POU L1\ ni e t PlE TTE (1 32 ), 0UL0 ~" G deR 0SNJI, Y e t
LA BAD IE (46) 0 nt sig nal é que l' e spa ce de d.i f fus ion de
cette substance était superposable au volume plasmatique.
Sa lecture est ais~e au photomètre mais son
dosage manque de précision. D'autre part le subtosan
n'est pas un corps défini. Il est constitué d'un mélange
- 48 -
de molécules de taille différente parce que diversement
polymérisées.
IV.3 - Tétraiodophénolphtaléine
POZNANSKI (133) l'utilise chez le chie~ en
raison de sa faihle élimination rénale, de sa rf:pétabilité
et de sa faible toxicité pour l'organisme.
Les r0sultats obtenus concordent av~c ceux des
autres méthodes.
IV.~ - Bleu Evans ou T-182~
Ce colorant injecté in vivo se fixe parfaitemert
sur la molécule d'albumine (63). Il y a cependant des
difficult6s dans la mesure de la densité optiqlJC du colo
rant lors d'hémolyse et de turbidité post prandiale.
L'6quilibre apparent est atteint en 10 à 15
minutes.
Un autre inconvénient ce la méthodG résulte de
la coloration bleuâtre gardée par les téguments après
l'épreuve.
IV.5 - Fer radioactif
Il a 6t~ propos~ par HA~N et col. (70-71) mais
surtout étudié par GIBSO~ et col. (60). Le marqu~ge a
lieu in vivo. On injecte du radiofer 55Fe (p~riüde : 4 ans)
- 49 -
ou 59Fe (période: 37 jours) chez un sujet. Ce derr.ier
fabrique alors des hé~aties marquées dont le maximum
est atteint vers le 21 e jour. Les hématies marquées
serviront de traceur chez un autre sujet apr~s dosage au
prpalable de leur radioactivité.
IV.6 - Phosphore radioactif
Le marquage des h~maties a lieu in vitro ~ 37°(
(5) mais cette méthode nlest pas couramment employée car
le phosphore radioactif ( 32 p) quitte les hématies à une
vitesse trop importante (€ pour cent en une heure).
IV.7 - Chrome radioactif
Le chrome radioactif 51Cr est actuellement le
traceu~ de choix car la technique de marquage est très
simple (157). Emetteur de rayonnc~ent y (gamma), sa
période est de 27.7 jours.
D'autre part le 51Cr a la nropri~t~ de franchir
les membranes globulaires en changeant de va12ncc c'est-à
dire en passant de l'état pentavalcnt à llétat trivalent.
Le marquage a lieu in vitro.
Son avantage comme traceur du globule résulte
du fait qu'une fois libéré dans la circulation. après la
mort de la cellule. il ne peut plus marquer df nouveaux
9lobules ; il circule alors sous forme trivalente. laquelle
ne franchit pas la membrane globulaire.
- 50 -
Le site de liaison de llérythrocytr ?-vpc
l'isotope 51Cr sous for~e de chro~ate se trouve au
niveau de l~ "ortior ~lobire d~ l'h~moqlobi~f (JS7).
Cette liaison dort le processus est complexe restr
suffisamment stable durant vingt quatre he~rcs.
Chez le mouton la littérature fournit ure
valeur moyenne de f,5 pour cent du poids corporrl pour
le secteur sanguin et 4,5 pour cent du poids du corps
pour lr secteur plasmatique.
r'ous préciserons ces valeurs chez ras animaux
d'expérience.
o§o
- 52 -
1: HAPITRE 1
1 - MOUTONS D'EXPERIENCE
1.1 - Provenance
MATERIEL D'ETUDE
Nous disposions d'un lot initial de 12 moutons
de race maure dont 7 d'entre eux appartenaient au service
de Physiologie. Les 5 autres nous ont été cédés par le
département de Microbiologie de l'Ecole Vétérinaire.
Livrés à eux-mêmes lors des ruptures de stock
d'aliment, à base de fane d'arachide et de concentré, les
animaux s'attardaient devant les immondices si bien qu'en
Novembre certains eurent une diarrhée sévère qui emporta
un agneau.
Au moment de l'expérimentation, de nouvelles
naissances étaient enregistrées. Le lot expérimental compor
tait alors 14 moutons dont :
- 3 agneaux à la mamelle
- 2 agneaux sevrés
- 6 brebis dont 2 gestantes
- 3 béliers
1.2 - Préparation des animaux
Les animaux sont gardés dans la salle de manipula
tions et pesés au début de chaque expérience.
- 53 -
La région jugulaire est ensuite soigneusement
rasée pour la désinfection et la mise en place du catheter
qui sera relié au robinet à trois voies. Il s'agit d'un
catheter intraartériel stérile avec guide spiralé (Seldicath
N.D.).
II - TRACEUR UTILISE
Le radiochrome nous a été fourni par le Commissa
riat A l'Energie Atomique pour compte International C.I.S.
sous forme d'une solution isotonique stérile de chromate
de sodium d'activité égale à 1 millicurie.
III - MATERIEL D'INJECTION ET DE PRELEVEMENT
Un dispositif comportant deux seringues de 10 ml
permet d'injecter et de prélever le sang:
- une seringue renferme l'eau physiologique
- l'autre contient le produit marqué.
Ces seringues sont reliées à un robinet à trois
voies lui-même relié au catheter.
Ce dispositif permet d'une part d1injecter le
sang marqué et de rincer la seringue d'injection par aspira
tion et refoulement successifs, puis d'effectuer un rinçage
final par de lleau physiologique dont le volume est le
double de celui du sang injecté.
- 54 -
A 1• 1
A Seri"9ue ca11br~e de 10 ml renfer~ant
le produit marqué
B Seringue de 10 ml renfermant le $oluttisotonique de chlorure de sodium
C Robinet à trois voies
o Catheter
- 55 -
Tous les prélèvements se font sur des tubes
contenant des grains d'héparinate de sodium.
Pour chaque injection et prise de sang, du matériel
différent, parfaitement stérile a été employé.
Au total, pour l'ensemble des animaux, ce matériel
a été utilisé:
- 14 catheters (Seldicath N.D.)
14 seringues de 10 ml pour le prélèvement avant
marquage
- 14 tubes héparinés de 10 ml pour le marquage
- 14 seringués de 10 ml pour les injections de
sang marqué
14 seringues de la ml pour l'eau physiologique
2P seringues de la ml pour le prélèvement après
marquage
56 tubes à hémolyse pour la lecture au compteur.
IV - LE COMPTEUR DE LA RADIOACTIVITE
Le comptage de la radioactivité se fait au moyen
d'un compteur gamma à cristal-puits du type ABBOT-Laboratories
Auto-LOGIC.
Le cristal détecteur présente une excavation cylin
drique, ou puits, dans laquelle l'échantillon est introduit
le rendement de détection est ainsi très grand, permettant
- 56 -
le comptage de prélèvements de faible activité. Le comptage
est totalement automatisé: un dispositif mécanique intro
duit l'tchantillon dans l '~nceinte de comptage et l'y
maintient durant un temps prédéterminé. Les résultats du
cow.ptage sont imprimés.
- 61 -
Le vernier réglé sur le sommet de la masse
910bulaire permet de lire directement l'hématocrite.
III - SECTEUR PLASMATIQUE
Le calcul direct permet de connattre le volume
sanguin. Pour obtenir le volume plasmatique, il suffit de
faire intervenir l'hématocrite.
Sachant que l'hématocrite mesure la proportion
entre la masse globulaire et le volume sanguin total, nous
pouvons en déduire la relation
SS = 100 SP100-h
, d'où
SP SS x (100 - h )=100
où
SS = secteur sanguin
SP = secteur plasmatique
h = hématocrite.
- 62 -
r:- HAPITRE III
1 - RESULTATS
1.1 Agneaux non sevrés
(Tableau nO 3)
RESULTATS - DISCUSSION
Sur un lot de trois agneaux non sevrés, nous
obtenons
pour le secteur sanauin
du poids du corps.
6,35 : 0,37 pour cent
- pour le secteur plasmatique
cent du poids corporel.
4,36 + 0,24 pour
1.2 - Agneaux sevrés
( Tableau n° 2)
Le lot de deux agneaux sevrés donne :
- un secteur sanguin égal à 4,93 pour cent du
poids du corps.
- un secteur plasmatique de 3,41 pour cent du
poids du corps.
1.3 - Moutons
(Tableau nO 1)
Avec le lot de 9 moutons, on obtient
- pour le secteur sanguin: 5,39 + 0,48 pour cent
du poids corporel
- pour le secteur plasmatique 3,98 + 0,28 pour
cent du poids corporel.
- 63 -
Tableau nO 1 - Moutons adultes volumes sanguin et p1asmatigue
1~I 0 Sexe Poids Volume sanguin héma- Vo'lume plasma-
tocrite tiquekg ml %poids % ml %poids
1 F 34,6 1745 5,04 25 1039 3,00------ ------ ------- ------- ------- ------- ------- -------
3 M 44,5 2473 5,55 23 1904-~::~--I------ ------ ------- ------- ------- ------- -------
4 F 39,6 2417 6,10 25 1812 4,571-----. ------ -.----- ------- ------- ------- ------- -------
e F 23,2 1151 4,96 28 R28 3,56------ -----. ------- ------- ------- -------4-------
-~~~~--I9 F 40,4 2388 5,91 22,5 1951------ ------ ------- ------- ------- .----.- ------- -------jla F 30,6 1632 5,33 24 1240 4,05 1
1------ ------ ------- ------- ------- --.---- ------- -------1Il M 55,8 2512 4,57 25 1884 3,37 1
------ ------ ------- ------- ------- ------- ------- -------11
12 F 24,8 1467 5,91 26 1112 4,48 1
j------ ------ ------- --.---- ------- ------- ---.--- -------14 M 31,0 1592 5,13 23 1226 3,95
Moyenne 5,39 24,6 3,98
Ecart-type 0,48 1,63 0,28
• Ces résultats sont exprimés en millilitres (ml) et en
pourcer.tage du poids corporel (% poids)
• F signifie femelle
• M signifie mâle
- 64 -
Ta b l eau n° 2 - .;..;A...9.;.;.n..;;,e,;:;,a.;;.u.;.;.x-...;;.s..;;,e.;.v,;,.r..;;,é.:::.s-..:...-..:...V..;.,o.;.1.;.,u;,;,;,ffi.::.e-=-s-...;;.s..;;,a,;.;.n....o.;;.u.;.i.;...n_.::.e.;.t--L.p.;.l..;;;,a-=-s;,;,;,m..;;;,a.;.t.;.i,.:J.q.;;.u..;;,e
N° Sexe Poids Volume sanguin héma- Volume plasma-1
tocrite tiquekg ml % poids % ml % poids
2 M 10,4 502 4,82 31,5 344 3,30
------ ------ ------- ------- ------- ------- ------- -------113 F 13,2 667 5,05 30 467 3,53
Moyenne 4,93 30,7 3,41
• Ces résultats sont exprimés en millilitres (ml)
et en pourcentage du poids corpor.el (% poids)
• F signifie femelle
• M signifie mâle
- 65 -
Tableau nO 3 - Agneaux non sevrés Volumes sanguin et plasmatiqu~
1
~,I 0 Sexe Poids Volume sanguin héma- Volume 'plasma-tocr He tique
kg ml %poids % ml %poids
5 M 8,3 542 6,53 35 359 4,32
------ ------ ------- ------- ------- ------- ------- -------6 M 7,1 476 6,70 30 333 4,69
------ ------ ------- ------- ------- ------- ------- -------7 M 5,4 315 5,~3 30 221 4,09,
Moyenne 6,35 31,6 4,36
Ecart-type 0,37 2,35 0,24
• Ces résultats sont exprimés en millilitres (ml)
et en pourcentage du poids corporel (% poids)
• F signifie femelle
• M signifie mSle
- 66 -
II - DISCUSSION
Nous n'avons pas appliqué la formule
R x nEdc =
r
En effet, dans la pratique, des corrections sont
nécessaires sur la valeur de l'activité injectée. Pour ce
faire, il faut tenir compte de l'activité restant dans la
seringue.
La formule devient alors
Edc= Ri x n - r s
r m
où
Ri = activité injectée
n = volume injecté
r s = activité restant dans 1a seringue
r = activité du sang prélevé.m
II.1 - Secteur sanguin
Pour ce secteur, les valeurs obtenues sont de
• 6,35 ! 0,37 pour cent du poids' corporel chez
les agneaux non sevrés
• 4,93 pour cent du poids du corps chez les agneaux
sevrés
- 67 -
• 5.39 ! 0,48 pour cent du poids corporel chez lES
moutons.
Les agneaux non sevrés ont donc un volume sanguin
beaucoup plus important. Ce volume connaît une baisse consi
dérable chez les agneaux sevrés pour ensuite augmenter
légèrement avec l'âqe adulte.
Les valeurs obtenues chez les moutons sont légère
ment supérieures à celles de la littérature (1) qui donne
• 4,92 + 0,61 et 3,33 ! 0,44 pour cent du poids du
corps respectivement pour les secteurs sanguin et plasmatique
contre 5.39 ! 0,48 et 3,98 ! 0.28 pour cent chez nos animaux
d'expérience.
Par contre chez les agneaux et en particulier chez
ceux qui sont sevrés. cette même littérature fournit des
chiffres plus élevés. En France. sur des lots expérimentaux
de 13 agneaux non sevrés et la agneaux sevrés. les chiffres
suivants ont été obtenus avec les mêmes conditions de dosage
Secteur Secteursanguin plasmatique
Agneaux non sevrés 7.16 + 1.19 % 4,50 + 0,97 %- ------------------------ --------------- -------------~~
Agneaux sevrés 7.36 + 0,78 % 4,58 + 0,5 %- -
d'où une augmentation de la volémie avec l~ sevraJe.
- 68 -
Pourcentagdu poidscorporel
6
5
Volume sanguin
4 Volume plasmatique
3
Volume de globule~ rouges
lot d'animauxAsAns
1.s.- .... ...- ...... _
Ans • lot d'agneaux non sevrésAs s lot dJagneaux sevrés
M c ïot de moutons
- 69 -
Pourtant notre expérimentation a été menée sur
des agneaux en parfait état de santé, ayant présenté un
hématocrite normal.
Cette baisse du volume sanguin pourrait donc
traduire soit un phénomène d'adaptation au climat, soit
des conditions d'élevage particulier non adapté se manifes
tant pendant le sevrage qui représente une période assez
critique dans la vie de ces animaux dont les besoins nutri
tionnels alors importants ne sont pas correctement couverts~
Certes, il serait prématuré de porter un jugement
de valeur, une appréciation juste sur cette chute brutale de
la valeur de ce secteur au moment du sevrage dans la mesure
oD ces résultats nIent ~té obtenus que sur deux agneaux
sevrés et sont donc statistiquement insuffisants.
Il serait souhaitable d'élucider cette question
qui pourrait aboutir si nos hypothèses de départ se vérifient s
à rechercher ces causes pour y apporter les solutions qui
s'imposent.
Nous avons dlautre part remarqué que le sang des
jeunes animaux se liait plus avidement avec le chrome que
celui des adultes car avec une demi-dose de chrome, le
nombre de coups émis par leur sang marqué était peu différent
de celui des adultes. Ce phénomène pourrait avoir une liaison
avec 1 1 hématocrite plus important des agneaux.
- 70 -
II.2 - Hématocrite
L'hématocrite connaît des variations appréciables
avec l'âge des animaux. Sa valeur moyenne est de :
31,6 ~ 2,35 chez les agneaux non sevrés
• 30,7 chez les agneaux sevrés
• 24,6 + 1,63 chez les moutons.
RAWNSLEY et MITRUKA (134) fournissent des moyennes
respectives d'hématocrite de
• 31,7 ~ 0,92 chez le mâle
• 34 + 1,30 chez la femelle.
L'hématocrite trouvé chez les moutons adultes est
denc relativement bas.
II.3 - Secteur plasmatique
Il est de : (en pourcentage du poids corporel)
• 4,36 ~ 0,24 chez les agneaux non sevrés
• 3,41 chez les agneaux sevrés
• 3,9R + 0,28 chez les moutons.
Ce secteur connaît donc les mêmes variations que
le secteur sanguin, en ce qui concerne l'âge des animaux.
pour cent
30
28
26
24
22
...._---....----......----...-------,-,Ans As M lot d atlimaux
Ans = lot d'a9n~aux non $evrésAs = lot d'agneaux sevr'sM z lot de moutons
- 72 -
II.4 - Volume des hématies
Chez le mouton la littérature fournit un pourcen
tage de globules rouges égal à 2 pour cent du poids corporel.
Nous l'avons calculé en faisant la différence
Volume des hématies = Volume sanguin - Volume plasmatique
et ces chiffres ont été obtenus (en pourcentage du poids du
corps)
• 1,99 ~ 0,19 chez les agneaux non sevrés
• 1,52 chez les agneaux sevrés
• 1,41 + 0,24 chez les moutons.
On remarque donc une décroissance progressive
dans le pourcentage globulaire avec l'âge des ènimaux
et un certain degré d'anémie.
- 73 -
Tableau récapitulatif
Agneaux non Agneaux Moutonssevrés sevrés
Volume sanguin 6,35 + 0,37 4,93 5,3Q + 0.48- -Volume plasmatique 4,36 + 0,24 3,41 3,98 + 0.28- -Hématocrite 31,6 + 2,35 30,7 24,6 + 1,63- -Pourcentaged'hématies 1,98 + 0,19 l,52 1,41 + 0,24- -
- 75 -
L'eau est le constituant le plus abondant de
l'organisme vivant.
Elle est indispensable à la vie.
Elle représente environ 65 % du POidS corporel
chez les êtres vivants.
Cette eau se répartit en deux grands compartiments
- un comparti~ent intracellulaire: 45 % du poids
du corps. C'est l'eau contenue dans la cellule.
- un compartiment extracellulaire : 20 % du poids
du corps. C'est l'eau qui est er dehors de la cellule. CE
compartiment est divisé en :
• secteur interstitiel : 15 % du poids du corps
• secteur plasmatique: 5 % du poids carrorel.
Nous avons dos~ l'eau par la méthode classique
de dilution isotopique utilisant comme traceur des globules
rouges marqués au SlCr dans un secteur qui est quantitati
vement le moins important mais dont le rôle physiologique
est tout aussi considérable que celui des autr~s comparti
ments de répartition hydrique.
Il s'agit du secteur plasmatique qui, grâce à
sa position d'intermédiaire entre le milieu txtérieur et
le milieu intérieur intervient de façon primordiale dans
- 7() -
les phénomènes de la thermoréqulation. En effet dans ces
régions chaudes, le maintier d'un haut niveau de productior
est difficile à cause de l'importante quantité d'excédent
de chaleur m~tabolique produite, en plus de la chaleur
imposée par l'environnement comme si la charge totale de
chaleur à dissiper est considrrable.
Cette thermolyse sacrifie l'eau de l'organisme,
et le plasma est le récepteur initial de toute perturbation
de l'équilibre hydrique. Il s'ensuit des rép€rcussions sur
les autres secteurs liquidiens. On perçoit donc toute la
mobilité de cett2 eau plasmatique entre les différents
secteurs de répartition hydrique.
Donc, il conviendra d'~m(liorer les
conditions cJ'abreuvement des moutons de më\rièrf:: ~ couvrir
les besoins d'entretien ct de production. En rffct la
croissance, le travail musculaire, la gestation, la sécré
tion lactée entraînent d'importantes pertes d'eau.
Nous avons obtenu des résultats diff6rcnts selon
le stade de développement de l'animal:
- premièrement, en pourcentage de poids corporel,
le secteur sanguin est éqal à :
• 6,35 ! 0,37 chez les agneaux non sevr~s
• 4,93 chez les agneaux sevrés
• 5,39 + O,4f chez les moutons.
- 77 -
- deuxièmement, le secteur plasmatique est égal
e~ pourcentaqe du poids du corps à :
4,36 + O,2~ chez les ag~eaux non sevrés
• 3,41 chez les agneaux sevrés
• 3,93 + 0,28 chez les moutons.
D'une façon générale, ces résultats sont insuffi
sants car ~tablis sur un petit nombre d'animaux. ~éanmoins
ils permettent d'avoir une certaine idée sur l'ordre de
grandeur.
Aussi, nous souhaitons que des recherches ulté"
rieures viennent enrichir cc travail, améliorer l'échantil
lonnage pour ~tablir des statistiques plus pr6cists, en ce
qui concerne les valeurs de tous les spcteurs hydriques ct
les variations selon l'âge, le sexe, l'état d'cnqraissemert,
les diverses productions, voire m~me étudier ces v~riations
dans les situations pathologiques.
De plus, rleplJ;s plus d'un siècle, d~ nombreuses
méthodes de détermination ont été mises au point ~ussi
bien pour le volume du sang, important indicaLeur des
modifications physiologiques et pathologiques dans l'orga
nisme, que pour les autres secteurs de répartition hydrique.
Actuellement, l'étude de leur pr~cision respectiv G doit
être abord~e de façon urgente. Ceci permettrait d'avoir
- 78 -
une idée correcte sur le II physiologique ll pour mieux
comprendre le "pathologique".
En effet l'évaluation judicieuse des changements
ne pourrait 6tre appréciée qu'en fonction de valeurs
normales précises.
- 79 ..
. 1 - AGASSE J.C.Contribution à l'6.tude des secteurs hydriques dumouton à ll a ide des radio-él~ments
Thèse, Toulouse, nO 2, 1971.
2 - A.MB,L\.RD L.Physiologie normale et patholoqique des reins1 Vol., Paris, 1920, Masson éd.
3 - ANAND R.S. and PARKER H.R.Total body water and water turnover in sheepAm. J. Veto Res., 1966, !l, 119, 899 - 902.
4 - ANDERSON R.S.Observation on the water and electrolyte metabolism inthe goat.Z.C.T.A. Physiol. Scand. 1955,11 (1), 50-6.
5 - ANDERSON R.S.The use of radioactive phosphorus for determiningcirculation erythrocyte volumesAm. J. Physiol., 1942, 137, 539.
6 - ANDERSON R.S. and ROGERS E.Hematocrit and Erythrocyte Volume Determination in thegoat as related to spleen behaviorAm. J. Physiol., 1957, 188, 178.
7 - Application des isotopes dans la Recherche et laproductionPrincipes techniques, 1967, Edition Leipzig
- ASCH~ACHER P.W., KA~AL T.H., and CRAGLE R.G.Total body water estimations in dairy cattle usingTritiated water.J. Anim. Sci., 19E5, ~, 430.
9 - BANCROFT J., KENNEDY J.A. and MASON M.F.The blood volume and Kindred properties in pregnant sheepJ. Physiol., 1939, 95, 159.
10 - BELLOWS R.T. et VAM WAGENEN W.P.The effect of resection of the olfactory, qustatory,and trigeminal nervers on water drinking in dogswithout and with diabetes i~sipidus
Am. J. Physiol., 1939, 126, 13
11 - BENEZECH C.L'eau: base structurale et fonctionnelle des êtresvivants ie1 vol, Paris, 1962, Masson et C éd.
- 80 -
12 BERGER [.Y., BROOlE B.B~, AXELROD J., DUNNING M.F.,POROSOUSKA Y. et STEELE J.tv'\.
Fed. Proc., 1950, 2, Il.
13 - BERGER E.Y. et STEELE J.M.Electrolyte and water metabolism. Physiologic considérations.Med. clin. North. Amer., 1952, ~, 829.
14 - BERNARD CL.Leçons sur les propriétés physiologiques et lesaltérations pathologiques des liquides de llorganismeBaillère éd., Paris, 1859, p. 371.
15 - BERNARD CL.Leçons de Physiologie expérimentale1 vol., Paris, 1855, Baillère éd.
16 - BINET L.Esquisses et notes de travail inédites de CLAUDE BERNARDMasson éd., Paris, 1952.
17 - BIRO P.R., FLlNN P.C., CAYLEY J.W.O. et WATSON M.J.Body composition of live ~attle and its predictionfrom Fasted Liveweight, Tritiated water space and AqeAust. J. Agric. Res., 1982,11, 375-87.
18 - BONVALLET M. et DELL O.Métabolisme de l'eau et thermorégulation physiqueAnn. Nutr. Alim. 1949, l, 185-243.
19 - BRODIE B.B., AXELROD l., SOBERMAN R. et LEVY B.B.The estimatio~ of artipyrine in biological materialsJ. Biol. Chem. 1949, 179, 25.
20 - BRODIE B.B •• BRAND E. et LESHIN S.The use of bromide as a measure of extracellular fluid,J. Biol. Chem., 1939, 130, 555.
21 - BROOKS S.C.The permeability of erythrocytes to deuterium oxide(heavy water)J. Celle Camp. Physiol., 1935, Z' 163.
22 - BRO~N F.A., HEMPELMAN L.H. et ELMAN R.The determination of blood volume with red cellscontaining radioactive phosphorus (32p)Science, J942, 96, 323.
- 81 • •
23 - CACHERA R. et BARBIER P.Concentration sanauine et volume du sangParis, méd., 19 4 5: ~, 93.
24 - CACHERA R.La répartition et les migrations de l'eau dans l'organismePresse méd., 1942, 20, 241.
25 - CACHERA R. et BARBIER P.Etude de la diffusion dans l'organisme humain dessolutions de rhodanate de sodium introduites par voiesveineusesC.R. Soc. Biol., 1941, 135, 1180.
26 - CACHERA R. et BARBIER P.La notion de volume globulaire totalParis, méd., 1945, ~, 101.
27 - CACHERA R. et BARBIER P.L'épreuve du Rhodanate de ~a. Méthode de mesure desliquides interstitielsC.R. Soc. Biol., 1~41, 135, 1175.
28 - CANNON W.B.Les bases physiologiques de la soifRev. oén. Sc., 191 Q , 3, 69.- -
29 - CAN~O~ W.B. et hREGERSEN M.I.Studies on regulation of water intake, effect of extirpation of salivary 91ands on water intake of dogs whilejauting.Am. J. Physiol., 1932, 102, 336.
30 - CHAUFFARD A., BRODIN P. et GRIGAUT A.Diffusibilité clinique comparée de l'acide urique et
.de l'uréeC.R. Soc. Biol., 1922, 86, 335.
31 - CHESLEY L.C.Observations on the absorption, apparent volume of distribution and excretion of thio-ureaJ. Clin. Investig., 1944, !l, 856.
32 - CLARK R. and QUIN J.J.Studies on the water requirements of farm anima1s inSouth Africa. II The relation between water consumptionand a atmospheric temperature as studied on merino sheep.Onderstepoort J.L. Veto Sc., 1949, !f' 3~5-356.
- 82 -
33 - CLARK R. and QUIN J.J.Studies on the water requirements of farm animals inSouth Africa. 1. The effect of intermittent wateringon merino sheepOnderstepoort J.L. Veto Sc., 1949, ll. 335-343.
34 - Compartiments liquidiens. Le sargChaire de Physiologie. Faculté de Médecine de Paris.
35 - Constantes biologiques et explorations fonctionnellesLe concours médical Sup. n° 4-52, 1965
36 - COURTICE F.C.The blood volume of normals animalsJ. Phy s i 0 1., 1Cl 43, 10 2, 290 •
37 - COURTICE F.C. et GUNTON R.W.The determination of the blood volume in man by thecarbon monoxide and dye methodsJ. Physiol., 1949, 10P, 142.
38 - CRANDALL L.A. et A~DERSON M.X.Estimation of t~e state hydration of the body by theamount of water available for the solution of sodiumthiocyanate.Am. J. Digest. Dis. Nut., 1934, l, 126.
39 - DANOWSKI T.S.Use of thiourea as a measure of change in body waterJ. Biol. Chem., 194~, 152, 207.
40 - DEANE N., SCHREINER G.E. et ROBERTSON J.S.The velocity of distrihution of sucrase between plasmaand interstitial fluid, with reference to the use ofsucrose for the measurement of extracellular fluid inmanJ. Clin. Investiq., 1~51, 30, 1463.
41 - OESGREZ A., ~ORETTI J.L., ROBERT J. et VINOT J.~.
Abrégé de Médecine nucléaire.
~ 42 - DIA P. IBRAHIMAL'élevage ovin au Sénégalperspectives d'avenir.Thèse, Dakar, nO ~, 1979.
Situation actuelle et
43 - DILL O.B., ADOLPH E.F. et WILBERG C.G.Adaptation to the Environment, 1964.
44 - DONNElLY J.R. et FRER M.Prediction of body composition in live sheepAust. J. Agric. Res., 1974, 25, 825-35.
- 83 -
45 - DOWNES A.M. et Mc DONALD I.W.Br. J. Nutr., 1964, ~, 153.
46 - DULOt,IG DE ROS~!AY C. et LABADIE p.
La mesure du volume plasmatique par le Subtosan 25(L'eau en bioloqie et en thérapeutique, lIIe Congr~s
m~dical international d'Evian, 1951, vol. l, Paris.
,(1,7 - DUMONT 8.L.L'utilisation de l'antipyrine pour la mesure in vivode l'eau totale du corps chez les ovins.Ann. Zootechnie, 1955, 1, 315-319.
48 - EBAUGH F.G., EMERSON C.P. et ROSS J.F.J. Clin. Invest., 1953, 1f, 1260.
49 - EDELMAN 1• S. , OLNEY J. M., JAMES A.H., BROOKS L. etMOORE F.O.Science, 1952, 115, 447.
50 - ELKINTON J.R.~ater metabolismAnn. Rev. Biochem., 1950, .li, 145.
51 - ELKINTON J.R.The volume of distribution of mannitol as measure ofthe volume of extra-cellular fluid, with a study of themannitol methodJ. Clin. Investiq., 1947, ~, 1088.
S2 - ELKINTON J.R. et DA~OWSKI T.S.The Body Fluids : Basic physiology and practicaltherapeuticsThe williams and Wilkins company, Baltimore, 1955.
53 - ELKINTON J.R. et TAFFEL M.The apparent volume of distribution of sulfocyanateand of sulfanilamide in the dog.Am. J. Physiol., 1942, 138, 126.
54 - ENGELS ~J.
Die Bedeutung des Gewebe al s Wasser DepotsArch. f. exper. Pathol. u. Pharmacol., 1904, ll, 346.
55 - FAUVERT R. et LOVEROO A.Etude des mouvements du sodium dans l'organisme aumoyen du sodium radioactifSem. Paris, 1950, ~, 132.
- 84 -
56 - FLEISCHERlleau et les électrolytes dans l'organism2Physiologie - Pathologie - Thérapeutique.
57 - FOOT J~Z~a SKEOD f., and Mc FARLANE D.N.Body com~osition in lactating sheep and the indirectmeasurement in the live animal usinq tritiated waterJ. Agric. Sci., 1979, 92, 69-tH. -
58 - GAUOINO M., SCHWARTZ I.l. et lEVITT M.F.Inulin volume of distribution as a measure of extracellular fluid in dog and manProc. Soc. Exp. Biol. Med., 1948, 68, 507.
59 - GENEVIEVE J. ~~rie BrizayContribution à l'étude des compartiments hydriqueschez le cobaye à 1 laide des radio-élémentsThèse, Toulouse n° 12, 1973.
60 - GIBSON J.G., PEACOCK W.C., SElIGMA~ A.M. et SACK T.Circulating red cell volume measured simultaneouslyby the radioactive iron and dye methodsJ. Clin. Investig., 1946, ~, 839.
61 - GRAY S.J. et STERLING K.The tagging of red cells and plasma proteins withradioactive chromiumJ. Clin. Investig., 1950, !Q, 1604.
62 - GREGERSEN M.I.A practical method for the determination of bloodvolume with the dye T-1824J. Lab. Clin. Med., 1944, 29, 1266.
63 - GREGERSEN M.I. et RAWSON R.A.The disappearance of T-1824 and structurally relateddyes from the blood streamAm. J. Physiol •• 1943, 138, 608.
64 - GREGERSEN M.I. et SCHIRO H.The behavior of the dye T-1824 with respect to itsabsorption by red blood cells and its fate in bloodundergoing coagulationAm. J. Physiol., 1938, 121, 284.
65 - GREGERSEN M.I. et STEWART J.O.Simultaneous determination of the plasma volume withT-1R2t1, and the t1available fluid tl volume with sodiur.!thiocyanate.Am. J. Physiol., lQ39, 125, 142.
- 85 -
66 - GOUDS~IT A., LOUIS L. et SCOTT J.C.Bromide space t thiocyanate space and the measurementof extra-cellular fluid volumeAm. J. Physiol., 1941, 133, 297.
~ 67 - GUY LORGUEContribution à l'étude de l'eau totale en MédecineVétérinaire~éthodes de mesure. RésultatsThèse, Toulouse, 1964. ~.
6A - HAEGE L.F. et MANERY J.F.The extent to which radioactive chloride penetratestissues and its significanceAm. J. Physiol. 1941 t 134, 83.
69 - HAFEZ E.S.E.Adaptation of Domestic Animals.
70 - HAHN P.F., BALE W.F. et BALFOUR W.M.Radioactive iron use to study red blood cells overlong periodsAm. J. Physiol., 1942, 135, 600.
71 - HAHN P.F., BALFOUR W.H., ROSS J.F., BALE W.F. et WHIPPLEG.H.Red cell volume circulating and total as determined byradio-ironeScience, 1941, 93, B7.
72 - HAMBURGER J. et MATHE G.Physiolog~e normale et pathologique du M€tabolisme de l 'ClU.Paris (VI) éd. Flammarion, 1952.
73 - HAMWI G.F. et URBACH S.T.Body compartments. Their measurement and application taclinical medicine.Metabolism ; 1953, I, 391.
74 - HANSARD S.L.Total body water in farm animalsAm. J. Physiol., 1964, 106, 1369.
75 - HANSARD S.L. et LYKE W.A.Proc. Soc. Biol. Med., 1956,21, 263.
76 - HARDY J.O. et DRABKIN D.L.Measurement of body water : technicsJ. Am. Med. Ass., 1952, 149, 1113.
and complications.
- 86 -
77 - HARRIS O.T.The value of the vital red method as a clinicalmeans for the estimation of the volume of bloodBrit. Y. Exper. Pathol., 1920, l, 142.
78 - HARRISON f.A., HILL K.J. et MANGAN J.L.Absorption and Excretion of lithium and MagnEsiumin the sheepJ. Biol., 1~63, 89, 99.
··;19 - HAXHE I. I.Mesures des compartiments corporels. Méthodes etRésultatsJ. Physiol., Paris, 1Q64, ~, 7 - 109.
80 - HEINfMAN M.J.Distribution of sulfonamide compounds between cellsand serum of human blondJ. Cl in. Invest., 1943, ll, 29.
81 - HERMANN H. et CIER J.F.1 - Bioénergétique et rations alimentaires. Sang lymphe. Compartiments liquidiens de l'organisme Circulation du sang - Respiration.
82 - HEVESY G.V. et HOFER E.Die' verweilzeit des wassers in menschlischen K8rper,untersucht mit Hilfe von "scr.werern" wasser al,; indicator.Klin. Wschnschr. , 1943, 1. 1524.
83 - HIX E.L. t UDERBJERG G.R.L. et HUGUES J.J.The body fluids of ruminants and their simultaneousdeterminationAmer. J. Veto Res., 1959, ~, 184-191.
R4 - HODGETTS V.E.The Dynamic Red Cell storage Function of tho spleen insheep. III Relationship to determination of bloodvolume, Total red cell volume, and plasma volume.Aust. J. Exp. Biol. and ~ed. Sci., 1961, }2, 187.
85 - HOOPER (.W. , SMITH H.P., BETT A.E. and WHIPPLE G.H.Blood volume studiesl. Experimental control of a dye blood volume methodAm. J. Physiol., 1920, 21, 205.
86 - HOPPER J., WlNKlER A.W. et ELKl~TON J.R.Simultaneous measurements of the blood volume in manand dog by means of carbon monoxyde.II. Under abnormal conditions, includ1ng secondary shock.J. Clin. Investig., 1944, !2, 636.
- P7 -
87 - HUCKABEE W.E.
11. APpl. Ph ys; 0 l ., 195 f" 2., 1 57 •
88 - 1NGR M1 D. L. ct ri; 0tH! TL. E•
~an and Animals in Hot Environm0nts.
8q - JAVAL ~. et BOYE T.
La r6tention de l'urée et sa diffusion dans les liquidesde l'organisme.C.R. Soc. Biol., 3910, 68, 5?7.
90 - JUSTIN BESANCON L., LAMOTTE M., LAMOTTE-RAPTLLON S.et nrj~BIËR P.Les hormones cortico surrénales ct lE métabolisme àel'eau et des électrolytes.Congr~s Français médi~al, 28e session, Bruxelles, 1951,1 vol, ch. Loric éd.
91 - KALTREIDER N.L., ~ENEELY G.R., ALLEN J.R. 2t PALE W.F.Determination of the volume of the extrac2111!1~r fluidof the body with radioactive sodiumJ. Exper. Med., 10~1, 74, 569.
92 - KANEKü J.J. et CORNELIUS C.E.Clinical biochemistry of DO~Estic Animals
Second Fdition vol. II, 1971.
~ 3 - V. FIT H ri. Î"1 •
Water mctabolismAnr.. Rev. Physiol., 1953,12, 63.
94 - KEl TH ~:. fI; ., Ra~l r~ TRE EL. G. et GER P, GHTYA method for the determination of plasma and blood volumeArch. ~ed. Int., 1Q15, 16, 547.
95 - KLEME~T A.W., AYER D.E. et ROGERS E.B.Simultaneous Use Of 51 Cr and T-IP2~ Dye in blood volumestudies in the Goat.Am. J. Physiol., 10SS, 181, 15.
96 - KO~LA~ DJABAKOUAspects de la lutte contre la chaleur chez certainshoméothermes en AfriqueThèse, Dakar, n° i, 1979.
97 - KOR~ITZER M.,DELCPOIX C. et CLEE~POEL H.Rev. franç. Etudes clin. ct biol., 1965, 11, 632.
- 88 -
() 8 - KP. AYBl LL H. F., fol M' KIN GS O. G., BIT TEH H. L •
Body composition of cattle estimation of bo~y fat froGmeasurement in vivo of body water by use 0f antipyrineJ. Appl. physiol., 1051, l, F Pl-6P9.
99 - KRUHOFFER P.
Inulin as an indicator for the extra-cellular spaceActa Physiol. Scandinav., 1946,11, 16.
100 - HUMAR l. et BERGER E.Y.Preparation of samples for liquid scintillationanalyses of tritiated waterInt. J. Appl. Radiat. Isot., 10.68, 19, 80S-7.
101 - LABOUCHE CL. et MAINGUY P.Aspects physiologiques et nutritionnels d~ l'alimentation du bétail en Afrique tropicaleRev. Elev. Med. Veto Pays trop., 195~, ?21.
102 - LACROIX M., BUSSET R. et MACH R.S.Utilisation comparative du soufre-35 et du brome -Ptpour la d~termination du volume de l'eau Extracellulair~clv. Med. Acta., 1965, vol. 32, P7.
103 - LEE D.H.K. et R08INSO~ K.
Reactions of the sheep ta hot atmospheresProc. Roy. Soc. Queensland., 1~41, 21, 180-200.
104 - LEITCH et THOMPSONEconomy of water of farm ùrimalsNutr. Abst. and Rev., 19~4, ~5.
105 - LG MAG~EM J.
Consommations spontanées d'eau et dE sels minérauxdans la régulation de l'équilibre hydromineral. Lesmécanismes périphériques.Colloque du CNRSCNRS, Paris C 265 - C 281, 195~.
106 - LUCKE 8. et HArVEY E.~.
The permeability of livina cells to heavy w3ter(deuterium oxide)J. Ccll. Comp. Physiol. t 1934, 2' 475.
107 - MAC FARLANE et col.Water and electrolyte changes in tropical merinosheep expos~d to dehydratation during suwmerAust. J. Açric. Res., lQ61, If, 889 - SI?
- H9 -
108 - t~ ACFA RLMi E VI'. V., r·~ 0RIS etH0lN Il, RDB.Water economy of tropical Merino Sheep~ature - London, 1956, 178, 304 - 305.
109 - ~1ACH R.S.Les troubles du métabolisme du sel et de llfau.Masson et Cie éd. Paris, 1946F. Roth et Cie éd. Lausanne.
110 - MANERY JeF. et BAI E ~!.F.
The penetration of radioactive sodium a~d phosphorusinto the extra- and intra-cellular phasls of tissuesAm. J. Physiol., 1941, 132, 215.
111 - MA~ERY J.F. et HAEGE L.F.The pxtent to which radioactive chloride penetratestissues and its sionificanccAm. J. Physiol., 1941, 134, n3.
112 - MANGA~ J.L. et WRIGHT p.C.The measurement of rumpn volumes of sheep and cattlewith lithiuœ salts.Res. Veto Sei., 1968,2, 366.
113 - ~~ARCHALL G. et DUHAMEL G.
Le sangCollection "Que sais-jeu.
114 - MARSHALL [.K. et DAVIS D.M.Urea ; its distribution in and its Elimination framthe bodyJ. Biol. Chem., 1914, lf, 53.
115 - MEISNER H.H., VA~ STADEN J.H. et PRETORIUS E.In vivo estimation of body composition in cattlewith tritium and UrE:è rlilution. 1. AccurGcy of predictiorEquations for the whole bodyS. Afric. J. Anim. Sei., 1980, lQ, 165-173.
116 - MELIK T.Recherches sur l'évaluation de la masse du sang parl'injection intraveineuse de Rouge-CongoThèse, Paris, 193~.
117 - MOE~S R.S., BUSSET R., COLLET R.A.! ~AGA~T OF DEUXCHAINES et MACH R.S.D~termin8tion de l'eau totalR par la méthod~ ~ l'cautritiéeSc hwei zeris che ~.~. ed i z i ni s che ~J 0 chc: ns c hr i ft, l 963, ~ ,932.
- 90 -
118 - MONTASTRUC P.Régulation des mouvements d'G~U. La mictionEd. Flammarion, 1971, P~ris le.
119 - i·I;OORE F.O.
Determination of total body watcr and solids withisotopesScience, 1946, 10~, 157.
120 - ~t ACHM;~! H. M. J f1. t-1 ES G. ~,! '! 1'100 RE ~l. hl. 2 t F. VJI f.l SE. 1•
Comparative study of red cells volumes in humansubjects with radioactive phosphorus taa8ed red cellsand T-182.1 dyeJ. Clir. Investig., 1950, 29, 25?.
121 - ~I YLHi G.
Blond volume det0rmination with radin active phosphorusBrit. H2art J., 19~1, I, 81.
122 - PACE N. t KL. 1NEL., SCHi~ CH~1 t~ r'I H. K. e t f.! 1\ RFE~1 1Sï ~.~.
Studies on body composition. IV Use 0f radir1ctivehydrager for measurerncnt in viuG of total hody waterJ. Biol. Chem.,1947, 162, ~5J.
123 - P~CE N. et RATHBUN E.N.Studies en bcdy composition. III. The body water andchemically comhined nitrogen C0ntent in rel?ticn tafat content.J. Biol. Chem., 19tj5, 15P, 685.
12 i1 - PApl TER E. E•
Total body water in the dogIlm. J. Physic·l., 191]0, 129, 67~4.
125 - PAINTER E.E.
Simultaneous determiraticns of the body water availabl'for dilution of exoqenous urea and sulfanilamide in unanesthetized doq.Am. J. Physiol., 193P, 123, 159.
126 - p~rAQETTO B.A.
Andy composition in vivo. IX. The rElation of bodycomposition ta the tritiated w~ter spaC0S Jf cwesand wethcrs fasted for short periodsAust. J. Agric. Res., 1968, 19, 267-272.
127 - PARPART A.K.The permeability of the mammali3n erythrvcyte tadeuterium oxyde (heavy water)J. Celle Comp. Physiol., 1935, l, 153.
T
- 91 -
128 - PETERS J.P.~J ater excha nqePhysiol. Rev., 1944, 24, 491-531.
129 - PICART p. et CALVEl H.Mesure des compartiments liquidiens corporels chpzdes bovins de l'Ouest-Africain.~éthodes et r~sultats.
R~? 1/. E1ev. fvi ed. VEt. Pa'y s t r 0pic a LJ x, 19 f 7, 2Ci, 2, 31l •
130 - PINSON E.A.Watcr exchanaes and barri ers as studied by t~e use ofhydrogen isotopf.SPhysiol. Rev., 1952,11, 123 - 134.
131 - PINSON E.A. et LANGHA~ W.H.Physiology and Toxicoloqy of tritium in man.J. appl. Physiol., lQ, 108-126, 1952.
132 - POULAIN P. et PIETTE M.Déterminatior de la masse sanguine par la polyvinylpyrrolidone (Subtosan)Bull. Soc. Chem. Biol., 19 AP, 7 ct ~, 49F.
133 - POZNANSKI W.J.Dosage volumétrique du nlasma sanguinAnn. Biol. Cl in., 1950, l, 250.
134 - RAWNSLEY M.H. et MITRUKAClinical and Hematoloqical reference values in NormalExperimental Animals -~asson Publishinq ~SA, Inc, 1977.
135 - REID J.T., BALCH C.C. et GLASCOK R.f.Thé li seo f tri t i um,of ant i PYr i ne and 0 f r,' - ace t y1- 4amino-antipyrine in the m~asurement of body w~ter inliving rabitsBrit. J. Nutr., 195P, 12, ~3.
136 - REl D J. T., BJi LCH C. C., HEA0 ~~. J. e t ST R!\ UD ,J. ~J •
Use of antipyrine and N-acotyl-4-amino-Jntipyrine inthe measurement of body water ~nd the intr3ruminalwater of the gùstrointestinal tract of living cattle.~! a t li r e • t 19 57, 170, 103 t, •
137 - REYNOLDS M.Measurement of bovine plasma and blood volume duringpregnancy and lnctationAm. J. Physiol., 1953, 175, 118.
- 92 -
138 - RICHET G., ARDAIllOU R., AMIEl C. et PAILLARDEouilibr~ hydro~lectrolytiqu~ norm~l pt pat~Jlogiquc
Précis du prètici~n, 4 0 éd., Baillière, Paris.
139 - RICO A.G., lORGUE G. pt KPITTLE J.p.
Et~d~.d€ l'eau totale chez le l~pin ~ l'}ide de l'eautrltlE'E.
Pev. Med. Vet., 1067, 11P, 12, Qt9.
140 - ROBI~SO~ J.R et Mc CANCE R.AWater metabolism.
141 - SAMSON WRICHTPhysiologie appliqu~e à la Médecine 13 r.
142 - SAVOIE J.C et JU~GERS P.Mesure de l 'espace extracellul~ire chez l 'homme àl'aide du radiosulfate 35S
Rf.:v. franc. Et. Clin. et biol., 1965, vol 10,99.
143 - SCHA~BYE p.
The circulating blood volume of sheep as d0terminedby means of 32p -talJged erythrocytcs and T-1[2/,;,Nordisk. Veto Med., 1952, i, 929.
14 t1 - SHAN t! 0N J. A.The excretion of inulin by the dogAm. J. Physiol., 1935, 112, t:OS.
1~5 - SCHOE~HEIMER R.Dynamic state of body constituentsCanhridgr:, 19 116.
146 - SCHLOERB P.R., FRIIS-HANSEN B.J., EDflMA~ I.S.,SOlOMON A.K. et ~OORE F.O.The me as I.J rem (, nt a f Tot a l B0 dy y,I ater i n the il urn ansubject by Deuterium oxyde dilutionJ. Clin. Invest., 1950, IQ, 1296.
147 - SEARLE T.W.Body composition in lambs and young sheep and itsprediction in vivo from tritiated water soaC2 andbody weightJ. Aoric. Sei., 1970, 74, 357-62.- -
148 - SEYDERHELM R. et LAMPE N.lur Fr~ge der Blutmengenbestimmung. II. ColorimetrischeBlutmengenbestimmung mit TrypanblauZtschr. f.d. Ges. Exp. Med., 1923, ~, 177.
- 93 -
149 - SHW Nri ETH.
L'eau, besoins de l 'organisme. ~~tabolisme
Influence de l'abrcuvement sur la producticn animale.
150 - S H~ 0 ri ~,! ETH., J ACQ U0 T R. et L r: 8ARS H.
Dorn~es qén~rales sur la nutrition et llalimcntationTOme 1 : ~létabolismes et transits, vol. l.!., 1960.
151 - S~ITH W.W., FI~KELSTEIN ~. Et SMITH H.W.Renal excretion of hexitols (sorbitol, mannitol anddulcitol) and their derivates and of cr(ioCH~nous
creatinine-like chromooen in ~OQ and marJ. Biol. Chem., 1940, 135, 231.'·
152 - SMITH B.S.W. and SIKES A.R.The e f f ec t 0 f rOll t e 0 f dos i n9 and met Il 0 ct ü f 'c' S t i mat i 0 l~
of tritiated water space on the dctermination of totalb0 dY water and the r r edie t ion 0 f bc cl y fat i n s he ep •J. Agric. Sei., 1974, QI, 105-112.
~ 153 - SOBERMAN R.J.Use of antipyrine in measurement of total body waterin arimalsProc. Soc. Exp. 8iol. r·1(;d., 1950,~, 7P9.
154 - SOBERMAN R.J., BRODIE B.B •• LEVY P.B., AXELPOD Je,HOLLANDER V. et STEELE J.M.The use of antipyrine in the measurcment of totalbody water in manJ. BIol. Chem., 1q~?, 179, 31.
155 - STEElE J.M., BERGER E.Y.! DUNNING M.F. et BRODIE B.8.Total body water in manArr. J. Physiol., 1950, 162,313.
156 - SPERBER l., HYDEN S. et EKMAN J.L.Lantbr. Hogsk. Ann., 1953, IQ, 337.
157 - STERLING K. and GRAY S.J.Determination of thE circulatino Red cell volume inman by radioactive chromium .J. Clin. Investia., 1950, 20, 161~.
~ -158 - STOLL G.,EDELMAN l. et MOORE F.
L'utilisation de l'oxyde de deutérium d~ns lps déterminations de l'eau totale du corps et dans l'étude dela perménbilité.Con 9r rs d' EV1A~l ; 19~ 1, vol. 11
- 94 -
159 - SWA~SON E.W. et NEATHERY H.W.Body water estimations with identical dairy cattle~sing antipyrineJ. Anim. Sei., 195f., 15, 1300 - 1301.
160 - TALSO P.J., LAHP T.N., SPAFFORO ~., FERf~ZI G. etJACKSON H.R.J. La h. Cl in. t1e d ., 1955, 41), 619.
161 - TILL A.R. et DOWNES A.M.Brit. J. Nutr. 1965, 19, 435.
162 - TOllR~!A.DRE O. JEM~-P1ERRE
Détermination à l'aide des radioéléments des volumesdes secteurs hydriques chez le lapinThèse, Toulouse, nO l, 1973.
163 - UOERK WU F.A.O., KOZOLL 0.0. et MEYER K.A.Determination of total body water with tritiumOxyde (H203)J. Nucl. Med. USA, 1963, !' fiO-q.
164 - VISSr,HER (DE) M. et P.ECKERS C.Les isotopes radio~ctifs en MédecineCollectior IIApplications des sciences nucléaires ll
, IfJfil.
165 - VOLK~ANN p.
Untersuchunaen Uber das ~enqenverh!ltniss dES Wassersund der Grundstoffe des menschlichen Koro0.rsGesellsch. d. WissEnsch., Math. Phys. Kl~sse, 1874,~, 202.
166 - WALLACE G.B. et ERODIE B.8.The distribution of arlministred bromide in comparisonwith chloride and its relation to body fluidsJ. Pharm. Exper. Therap., 1939, 65, 214.
167 - WALKER J.J.R. et DZIEMIAN A.J.Biochemical and Physiological Date on the normal goatCml. C Medical Division Research Report, 1950, 31.
168 - WHITING F., BALCH C.C. et CAMPLONG R.C.Sorne problems in the use of antipyrine and ~ acetyl-4amino-antipyrine in the determination of body waterin cattle~r;t. J. ~!utr., 1960, 14, 5lC~-533.
- 95 -
169 - \~ 1LOT E.
J. Landw., H:7O" 'll.., 177.
170 - ~ILLIAMS R.H. ct KAY G.A.Absorption, distribution and excretion of thioureaArn. ,J. Phys;ol., 1945, 143, 715.
171 - WINKLER A.W., ELKI~TON J.R. et EISEMAN A.J.Comparison of sulfocyanate with radioact.ive chlorideand sodium in the measurement of extracellular fluidAm. J. Physiol., 1943, 139, 239.
172 - YOlL 8. GUYContribution à l'étude de l'eau totale chez le pouletpar l~ méthodl de dilution à ll eau tritiéeThèse, Toulouse, n° l, 1971.
TP.P.LE DES ~' p, T 1 [ RES-------------------------------------
1NTRODU CT ION •••••..•••••••..•••••...•••••••.••••• 1
PRE~qERE PARTIE LES SECTEURS HYDRIQUES
EXAr'! f ~, 0ES PRn: C1PES GEN ERAli X 0ES
METHODES DE DOSAGE ET CHOIX DES
SUS STAN CE S •••...........................• 5
Chapitre 1 : Les secteurs hydriques ••••••••••••• 7
1 - Le sect\:"'lIr extri'lcellulnire 9
II - Le secteur intr~cel1ulaire ••..•••••••••••• Il
III - Ech anges hyd r i que s ••.••••••.••••.•••••••.• 13
Chapitre II Principes qénérnux des méthodes
de mesure .......................... 25
1 - Définition ................................ 25
II - Conditions exigibles pour le choixdes substancf.:s 26
III - Mode de calcul drun espace de diffusion 27
Cha pit rel 11 : .;;.C.;..h..;.,o..;.i.;..x--.;;,d..;.,c_s_....;.s_u..;.b..;.,s_t....a..;.n....c...;..e s
1 - Secteur Eau totale ............ . . ........ .. 33
11 - Secteur Rumen-Réseau ....................... 41
IIr - Sectl?ur extracclllJl aire ................... 43
IV - Secteur sanguin, secteur plasmatique ...... 1;6
DEUX IE~E PARTI E
Chapitre 1
EXP ER1MrNTA T1a~I
t,1ESURE DE LI FAU PLASMATIQUE
Matériol d1étude .
51
1 - t1outons d1cxpériencc ••••.•••••••.•.••••••• 52
II - Traceur uti lisé 53
III - Matériel d1injection et de prél~vement •••• 53
IV - Compteur de la radioactivité .•.•.•.••••••• 55
Chapitre II : Protocole expérimental ••.........••
1 - Secteur sanguin....................... .... 57
II - Détermination de llhématocrite •••.•••••••• 60
III - Sf:ct€ur plasmi'ltiquc ••••.•••••...•.••••••• fi
Chapitre III : Résultats. Discussion
1 - R~ sul t at s •••..••.••....•..•........•.••••• 62
II - Discussion................................ 66
.......................................
BIBLIOGRAPHIE........................................ 79
DES 1 L LUS T RAT l n ~ S---------------------------------------------
Pages
l - Import~nce relative des différents secteurs
hydriques de l'organismf' .
2 - Distribution de llcau et des électrolytesdê\ns les tissus .
3 - Structure ~lectrolytique du secteur
8
1(\"
extr ace 1 lu lai re •••.........•.........••....•..•• 12
4 - Composition hypothftique moyenne du
intracellulaire en milliéquiva10nts
liquide
.............5 - Représentation schématique du S0ns des (changes
d'eau entre le plas~~ et les liquides interstitic 1s, e n f 0 nc t ion cl t' 1(l pre s s ion hydr 0 s t ?c t i Cl li e
dn.ns le capillaire 17
6 - Compartiments liquidiens du corps : 6chang~s avecle milieu extérieur Ir.............................
7 -~" 0 uv cm en t s d' e (J u 10 r s cl e l (\ d i min ut ion ;: E:
l'hydrÂmie
- D~tcr~ir~tion de Co Dar la méthode d'extrapolation
de CACHE PA et BP RB1ER •.•............•••••.•.••••
21
.......................................o - Dispositif utilis~ pour les injpctions intr2
veineusr.:s sr:
10 - V(\ri~tion ries volumes sanguin, plasm2tique et
globulaire en fonction de 1 '~9C des moutons ••••• 6P
11 - Vari~tion de l'hématocrite en fonction d€ l 'Sge. 71
SERMENT DES VETERINAIRES DIPLOMES DE DAKAR
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=
"Fidèlernent attaché aux directives de Claude
BOURGELAT, Fondateur de l'Enseignement Vétérinaire dans
le monde, je promets et je jure devant mes Mattres et
mes Ainés
- d'avoir en tous moments et en tous lieux le
souci de la dignité et de l'honneur de la
profession vétérinaire.
- d'observer en toutes circonstances les principes
de correction et de droiture fixés par le code
déontologique de mon pays.
- de prouver par ma conduite, ma conviction, que
la fortune consiste moins dans le r.ien que l'on
a, que dans celui que l'on peut faire.
de ne point mettre à trop grand prix le savoir
que je dois à la générosité de ma patrie et à
la sollicitude de tous ceux qui m'ont permis
de réaliser ma vocation.
QUE TOUTE CONFIANCE ME SOIT RETIREE S'IL ADVIENNE QUE JE ME
PARJURE".
o§o
Vu
LE DIRECTEUR
de l'Ecole Inter-Etats des
Sciences et Médecine Vétérinaires
Vu
LE DOYE/I'
de la Faculté de Médecine
et de Pharmacie
Le Candidat
LE PROFESSEUR RESPCNSABLE
de l'Ecole Inter-Etats des ScienCL~
et Médecine vétérinaires
LE PRESIDENT DU JURY
Vu et permis d'imprimer _
Dakar, le ------------------------
LE RECTEUR PRESIDENT DU CONSEIL PROVISOIRE DE L'UNIVERSITE