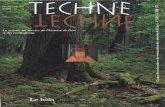Oeuvres de Farny Elégies Et Poesies Diverses - Forgotten Books
Claude Debussy, médiéviste dilettante ? L'écho de ses oeuvres et de sa correspondance
Transcript of Claude Debussy, médiéviste dilettante ? L'écho de ses oeuvres et de sa correspondance
Aventures et voyages au pays de la Romane
Tania VAN HEMELRYCK Claude Debussy, médiéviste dilettante?
L'écho de ses œuvres et de sa correspondance
Pour Pierre MAS SART
Publié sous la direction de Jacques CARION, Georges JACQUES et Jean-Louis TILLEUIL
E.M.E.
Claude Debussy, médiéviste dilettante ? L'écho de ses œuvres et de sa correspondance
Au tournant du xxe siècle, le Moyen Âge et ses images ressurgirent dans les arts. La musique apporta sa pierre à l'édifice des représentations médiévales, alliant parfois ses manifestations aux élans patriotiques de certains compositeurs.
Dans cet esprit, le personnage de Claude Debussy 1 est singulier dans les rapports qu'il nourrit avec la littérature médiévale, tant dans ses compositions musicales que dans ses écrits personnels. Loin de dépasser le cadre de nos compétences, nous souhaiterions approcher la dimension pragmatique de cet intérêt médiéval chez Claude Debussy, au-delà, d'une part, de l'expression musicale, et d'autre part, des considérations esthétiques liées au climat culturel de l'époque. Ainsi, outre une présentation des œuvres où résonnent des accents et des inspirations médiévaux, nous considérerons la vaste correspondance que le compositeur entretint avec les artistes de son temps et qui fournit un ensemble d'éléments, peu considérés par la critique musicale, soulignant le goût du Moyen Âge chez Debussy.
* * *
Dans ses «jeunes années », Claude Debussy manifesta déjà un engouement médiéval, d'abord conforme à l'air du temps, puis de plus en plus personnel. Ainsi, après son retour de Rome, où il séjourna comme lauréat du Prix 2 de 1884
1 Th. KABISCH, art. « Debussy», dans L. FINSCHER, Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopiidie der Musik, Kassel. Barenreiter, 2001 (2e éd.), t. 5, col. 566-640.
2 Il obtint Je Premier Grand Prix de Rome en 1884 pour sa cantate L'Enfant prodigue.
332 T. VAN HEMELRYCK
à mars 1887, il écrivit au directeur de la Villa Médicis, Ernest Hébert, le 17 mars 1887, l'exaltation et l'admiration que provoqua son premier contact avec la légende de Tristan, dans la mise en scène de Wagner, dont il venait d'admirer le premier acte:
Premier acte de Tristan et Iseut: c'est décidément la plus belle chose que je connaisse, au point de vue de la profondeur de l'émotion, cela vous étreint comme une caresse, vous fait souffrir, pour tout dire: on passe par les mêmes sensations que Tristan, et cela sans violenter son esprit ni son cœur 3.
On sait combien l'œuvre de Richard Wagner influença les symbolistes français et belges dans leurs explorations médiévales. Ainsi, Claude Debussy se rendit en « pèlerinage» à Bayreuth en juillet 1889, où il entendit pour la première fois Tristan und Isolde en entier, un an après sa rencontre avec Parsifal et Die Meistersinger dans le même lieu.
Dès cette époque, le compositeur mit en musique des œuvres littéraires, comme celles de Paul Verlaine, Charles Baudelaire ou encore Stéphane Mallarmé. Le Moyen Âge est encore loin en apparence. De fait, c'est vraisemblablement au contact de Verlaine que le musicien s'intéressa à la poésie médiévale. Debussy s'inspira particulièrement du courant symboliste 4, qui sut exploiter certaines représentations de l'époque médiévale.
D'ailleurs, le Moyen Âge occupait peut-être déjà ses lectures personnelles, bien qu'il ne le citât qu'en anecdote dans cette lettre du 9 septembre 1892, adressée à André Poniatowski, où il parlait de la musique nouvelle:
Vous savez ce qu'est la mienne, étant un des rares qui en ait saisi l'essence, et le côté spéculatif que l'on a l'habitude de traiter comme certains sauvages vis-à-vis d'un manuscrit du Moyen Âge 5.
C'est sans doute grâce à son ami Ernest Chausson, auteur de l'opéra Le Roi Arthus, qu'il s'ouvrit à la matière médiévale. De fait, poussant Chausson à terminer son œuvre au plus vite 6, badin, il déclara le 24 octobre 1893 :
Il est vraiment dommage que je n'aie pas le pouvoir magique de Merlin: me voyez-vous apparaître un jour parmi les fleurs de pommier, et vous adressant un joli petit discours, pendant que des brises très musiciennes, et un peu chromatiques s'accorderaient sur les
3 Claude DEBUSSY, Correspondance. 1884-1918, éditée par Fr. LESURE, Paris, Hermann (Savoir: sur l'art), 1993, p. 56.
4 Ses affinités littéraires avec Maeterlinck, H. de Régnier, J. Laforgue et Mallarmé soulignent cet aspect. L' exposition qui eut lieu à Rome en 1984 tenta de mettre en exergue« l'appartenance de Debussy au mouvement symboliste» ; cf. Fr. LESURE, «Introduction », dans Debussy e il simbolismo. Catalogue de l'exposition omaggio a Claude Debussy, prix de Rome 1884, Febbraio-Giugno 1984, sous la direction de Fr. LESURE et G. LOGEVAL, Rome, Palombi, 1984, p. 27. De plus, « la corrélation entre la peinture, la poésie ct la musique, sous l'égide de la musique et de sa fluidité suggestive, est le thème central de l'esthétique moderne, jusqu'à cette musicalisation de tous les arts qui gouverne l'aventure symboliste et trouve en Pelléas et Mélisande son accomplissement souverain» ; cf. J. LEYMARIE, « Préface », dans Ibid., p. 21.
5 Claude DEBUSSY, Correspondance. 1884-1918, p. 69.
6 L' œuvre, qui l'occupait depuis 1885, fut terminée en 1895 et créée en première mondiale le 30 novembre 1903 au Théâtre royal de la Monnaie (Bruxelles).
CLAUDE DEBUSSY, MÉDIÉVISTE DILETTANTE? 333
harmonies dont vous entourez Merlin, je vous dirais probablement: « Ernest Chausson, les temps sont venus, vous manquez gravement à mon amitié, quittez ce Roi Arthus, cause de tant de tourment, et qui cache tant de choses, en vous retenant férocement dans le soin de raconter son histoire, allez vous reposer dans l'amitié de Claude 7.
L'année 1898 marqua l'entrée du Moyen Âge dans l'œuvre debussyste. De fait, en avril, Claude Debussy dédiait à Lucien Fontaine les deux Chansons de Charles d'Orléans qu'il avait écrites pour la chorale familiale des Fontaine, fondée en 1894 et dirigée par le compositeur 8. Il s'agit de deux chansons a cappella sur deux poèmes de Charles: Dieu! qu'il la fait bon regarder! et Yver, vous n'estes qu'un villain. L'œuvre ne sera publiée qu'en 1908 9, Debussy changeant considérablement la version définitive de Yver [ ... J, et adjoignant une troisième pièce, Quand j'ai ouy le tabourin ; les trois pièces furent chantées pour la première fois aux Concerts Colonne le 9 avril 1909 10, sous la direction de Claude Debussy.
Selon François Lesure, Debussy aurait travaillé sur la base de l'édition des Poésies complètes de Charles d'Orléans due à Charles d'Héricault 11 ; d'abord seul, puis avec Louis Laloy en vue de l'édition. En 1904, il avait fait la connaissance de ce normalien, agrégé de lettres (1896), qui terminait une thèse de doctorat sur Aristoxène de Tarente 12. Pourtant, les textes du prince-poète édités avec les œuvres de Debussy s'écartent parfois sensiblement de l'édition d'Héricault. De fait, l'analyse tend à prouver que le musicien aurait utilisé l'ouvrage d'Aimé Champollion-Figeac J3 ; à de nombreux endroits il reproduit les mêmes ponctuation et accentuation, même si le texte donné par Debussy témoigne parfois de changements et modernisations personnels.
Dès lors, bien qu'en témoignage d'amitié Gabriele d'Annunzio lui offrît la seconde édition des Poésies de Charles d'Orléans, éditées par Ch. d'Héricault, Debussy dut travailler sur l'ouvrage si contesté de son prédécesseur. Le cadeau ne manqua pas d'attirer l'attention des critiques, troublant peut-être l'analyse avec cette belle dédicace :
au divin Claude Debussy ces vieilles chansons qu'il renouvelle
7 Ibid., p. 90.
8 Fr. LES URE, Claude Debussy: biographie critique, Paris, Klincksieck, 1994, pp. 171-172.
9 Trois chansons de Charles d'Orléans à 4 voix mixtes sans accompagnement, Paris, Éd. Durand & Cie, 1908-1910. Fr. LESURE, Claude Debussy: biographie critique, p. 302.
10 Fr. LESURE, Catalogue de l'œuvre de Claude Debussy, Genève, Minkoff (Publication du centre de documentation Claude Debussy, III), 1977, p. 97.
11 Il existe deux éditions de l'ouvrage: Paris, A. Lemerre, 1874,2 vol. ; Paris, Flammarion. 1896,2 vol.
12 Fr. LESURE, Claude Debussy: biographie critique, pp. 251 et 323.
13 Les poésies du duc Charles d'Orléans publiées sur le manuscrit de la Bibliothèque de Grenoble, éd. A. CHAMPOLLION-FIGEAC, Paris, J. Belin-Leprieur et Colomb de Batines, 1842.
334 T. VAN HEMELRYCK
Mai, MCMXIII Gabriele d'Annunzio 14.
L'intérêt médiéval de Claude Debussy déborda également du cadre strict de sa production musicale, s'immisçant dans sa vie privée par petites touches éparses, dont sa correspondance livre quelques nuances. Ainsi, dans une lettre du 29 mai 1899, rédigée à l'attention de sa première femme, le mannequin Lilly Texier, il s'appesantissait sur leurs lectures et leurs propositions littéraires respectives:
Je n'ai pas pu lire la Tour de Nesles, ne possédant pas cet immortel ouvrage ... Je le regrette encore et j'espère que tu voudras bien me le raconter. .. Tu aurais tort de t'efforcer de ressembler à Marguerite de Bourgogne; c'était une très vilaine femme qui comprenait la vie d'une façon un peu trop brusque ... D'ailleurs les romans-feuilletons sont décidément une mauvaise lecture 15 !
Nous n'avons malheureusement pas retrouvé la trace d'un inventaire ou d'un catalogue des livres personnels de Claude Debussy, hormis celui de la vente qui fut organisée en 1933. Outre les Poésies de Charles d'Orléans reçues de d'Annunzio, aucun des romans ou livres qui ont fait partie de sa bibliothèque n'y est répertorié.
Quoi qu'il en soit, il aurait également possédé une édition des œuvres de Villon, auteur qui inspira ses œuvres ultérieures; peut-être travailla-t-il sur cette possible édition que lui avait offerte son ami Pierre Louys 16, et dont il semblait le remercier par avance dans une lettre de juillet 1903 :
On dira ce qu'on voudra ... Un Villon vaut mieux qu'une canne! Et ma joie de le recevoir s'augmente de ce qu'il soit de ta bibliothèque; non pas que son rude vocabulaire s'en trouve adouci, mais à un point de vue Claude Debussy il en devient d'autant plus précieux 17.
Villon patienta encore sept ans avant de s'inscrire au catalogue de Debussy. Cependant, le Moyen Âge servait déjà la veine nationaliste 18 qu'il tentait d'imprimer à ses œuvres. Le compositeur se tourna à nouveau vers Charles d'Orléans, mais cette fois il s'agissait de rondeaux sur lesquels il écrivit des mélodies avec accompagnement de piano ; les deux rondeaux furent publiés, avec un poème de Tristan Lhermite, sous le titre de Trois chansons de France 19, toujours chez
14 Cf. n° 178, dans G. ANDRIEUX, Catalogue de vente de livres précieux anciens, romantiques, modernes, manuscrits, documents et lettres autographes. Collection Jules Huret [1 à 154 J et Collection Claude Debussy [174 à 224J, Paris, 1933. Il s'agit de l'édition de 1896 en deux volumes, «reliure de maroquin mauve, premiers plats décorés de l'ex-libris doré, avec la devise per non dormire dans une couronne laurée; motifs géométriques dorés sur les seconds plats, dos à nerfs ornés du même motif, fil. dor. int., têtes dor., non rognés. Plusieurs vers ont été cochés par Claude Debussy. etc. » (pp. 33-34).
15 Claude DEBUSSY, Correspondance. 1884-1918, p. 146.
16 Jeune écrivain, ami de Gide et de Valéry, il rencontra Debussy chez Mallarmé; Victor Hugo était son poète préféré ... Cependant, les relations amicales des deux hommes cesseront en août 1904 avec la tentative de suicide de Lilly Texier (épousée en 1899), et son divorce l'année d'après.
17 Claude DEBUSSY, Correspondance. 1884-1918, p. 181.
18 sur ce type d'exploitation voir Ch. ALMAVI, Le Goût du Moyen Âge, Paris, Plon, 1996.
19 Fr. LESURE, Catalogue de l'œuvre de Claude Debussy, p. 107. Bibliographie, Vallas, p. 289.
CLAUDE DEBUSSY, MÉDIÉVISTE DILETTANTE? 335
Durand en mai 1904, Dans ce cas précis, il est indubitable que Claude Debussy a utilisé l'édition de Champollion-Figeac pour établir son texte. L'édition parut en 1842 en même temps que celle de J. M. Guichard, non sans engendrer une vive querelle entre les deux érudits 20. À l'inverse de Guichard et d'Héricault, Champollion-Figeac a élaboré son édition sur la base du manuscrit de Grenoble qui, pour le rondeau Le temps a laissié son manteau, donne un texte différent des autres manuscrits, mais semblable à celui imprimé sur les partitions de Claude Debussy 21.
Dans une lettre à son éditeur du jeudi 12 mai 1904, écrite en Belgique et concernant la probable représentation des Danses 22 à Léopold II, Claude Debussy lui restituait des épreuves et suggérait des amendements typographiques aux Trois Chansons de France:
Dans les « 3 Chansons de France », ne seriez vous pas d'avis de remplacer les petits ornements qui séparent le titre du nom de l'auteur, par un rappel de celui employé sur la couverture, pour le même usage, et qui est si fort élégant? 23
Il dédicaça ces trois pièces à Emma Bardac 24, qui deviendra sa seconde épouse en 1905,
Charmé depuis longtemps par le Tristan de Wagner, Debussy projeta une composition dramatique sur le sujet, après la lecture du roman-adaptation de Joseph Bédier qui venait de paraître en 1900. Ainsi, dans une lettre adressée à Victor Segalen le 26 juillet 1907, Debussy parlait de son projet 25 d'écrire une œuvre théâtrale et surtout de sa lecture de l'œuvre de Bédier:
20 Dans son édition, Ch. D'HÉRICAULT relate sobrement les faits dans sa« Notice bibliographique» ; cf. va\. 2, pp. 281-293.
21 En effet, outre le v. 3 donnant broderye (vs. brouderie chez d'Héricault et Guichard), le v. 4 note soleil raiant sensiblement différent des leçons de d'Héricault (soleil luyant) et de Guichard (souleilluisant) ; sans oublier la divergence du v. 5 qui en son jargon (Champollion-Figeac) vs qu'en son jargon (d'Héricault et Guichard).
22 Il s'agit des Danses pour la harpe chromatique (qui venait d'être conçue par le directeur de la maison Pleyel, Gustave Lyon, en opposition à la harpe à pédales) et quintette à cordes qu'il composa pour les concours du Conservatoire de Bruxelles. Dans une lettre d'avril 1904, Claude Debussy se plaint au père de Jacques Durand des exigences « belges» de la maison Pleyel et de l'obligation de présenter sa composition à Auguste Gevaert, directeur du Conservatoire; cf. Claude DEBUSSY, Lettres à son éditeur, éd. par J. DURAND, Paris, A. Durand et Fils, 1927, pp. 17-18.
23 Claude DEBUSSY, Lettres à son éditeur, p. 18; FR. LESURE, Claude Debussy: biographie critique, pp. 256-257. Apparemment 1. Durand n'exécuta pas la demande de Claude Debussy puisque les petits ornements des pièces et ceux de la couverture sont différents. Notons que les considérations concernant la facture et la présentation matérielle des éditions des œuvres du compositeur sont nombreuses dans ses échanges avec son éditeur (cf. par exemple Lettres de Claude Debussy à son éditeur, pp. 7,11,13, etc.).
24 Fr. LESURE, Claude Debussy: biographie critique, p. 257.
25 L'œuvre, prévue sur un drame lyrique de G. Mourey, ne se réalisa jamais, bien que beaucoup de bruit fût fait autour d'elle. Dans une lettre à J. Durand du 5 août 1907, il s'exclame; «D'où peuvent bien venir les informations sur" l'Histoire de Tristan" dont certains journaux, y compris" Le Temps ", si grave et si scrupuleusement informé, se sont emparés? », Lettres de Claude Debussy à son éditeur, pp. 51-52 (nouvelle édition dans Claude DEBUSSY, Correspondance. 1884-1918, p. 229). François Lesure précise que, dans sa lettre du 23 août 1907, Claude Debussy envoya un thème à son éditeur; cf. Fr. LESURE, Catalogue de l'œuvre de Claude Debussy, p.153.
336 T. VAN HEMELRYCK
Pour Tristan l'histoire en est simple: quand, à son apparition, je lus le Roman de Tristan, par Bédier 26, j'eus tout de suite le désir d'en faire un drame lyrique, tant cela me parut beau, et tant il me semblait nécessaire de restituer à Tristan son caractère légendaire, si déformé par Wagner et par cette métaphysique douteuse qui vraiment là, reste encore plus inexplicable que partout ailleurs ... Puis, j'oubliais ce projet quand dernièrement Mourey 27, que je n'avais plus vu depuis des années, vint me voir et me parla de ses projets sur Tristan; mon enthousiasme, mal endormi je l'avoue, se réveilla, et j'acceptai 28 !
Dès la parution de son Roman, Joseph Bédier fut sollicité par son cousin Louis Artus afin d'en extraire une pièce de théâtre. À cet égard, Claude Debussy eut quelques échanges, dont une entrevue en mars 1909 à la Société des Auteurs, avec Louis Artus qui affirmait avoir la préséance sur l'œuvre, s'opposant à l'entreprise du compositeur et de G. Mourey 29. Joseph Bédier lui-même écrivit 30 au compositeur afin qu'il créât la musique de scène de l'adaptation théâtrale de son cousin, mais Debussy refusa d'abandonner sa collaboration avec G. Mourey et l'entreprise échoua 31.
Mourey ne désespérait pas d'adapter quelque texte médiéval avec son ami, lui proposant même Huon de Bordeaux, œuvre d'un trouvère artésien du XIIIe siècle 32 ! Debussy freinait ses ardeurs et, dans une lettre du 29 mars 1909, s'exclamait:
Huon de Bordeaux, c'est très bien mais nous retombons chez des personnages à casques et à légende toute faite ... j'aimerais mieux votre idée du Marchand de rêves ... cela, ne fixant rien, permet tout; et c'est justement ce qu'i! nous faut, car il y a plus de féerie dans notre époque que Monsieur Clemenceau ne le suppose 1 Il s'agit simplement de la trouver 33.
François Lesure précise que « Debussy possédait dans sa bibliothèque un remaniement en prose du xve siècle, Les Aventures merveilleuses de Huon de Bordeaux et de la belle Esclarmonde »34. Selon toute hypothèse, le compositeur
26 Claude Debussy parle certainement du Roman de Tristan et Iseut traduit et restauré [par J. Bédier] (Paris, Sevin et Rey, 1900), ou du Roman de Tristan et Iseut reconstitué d'après les poèmes français du XII' siècle [par J. Bédier] (Paris, Piazza, 1900, avec des illustrations de Robert Engels), à moins qu'il n'ait lu la version « philologique}) dans THOMAS, Roman de Tristan, éd. par J. BÉDIER (Paris, Firmin-Didot [Société des anciens textes français], 1902 et 1905, 2 vol.).
27 Poète et critique d'art, traducteur de Swinburne et d'Edgar Poe.
28 Segalen et Debussy, éd. par A. JOLY -SEGALEN et A. SCHAEFFNER, Monaco, Éd. du Rocher (Domaine Musical), 1961, pp. 62-63. Debussy aura également de nombreux entretiens au sujet du Tristan avec Segalen (Ibid., pp. 74-78,100, etc.). Nouvelle édition dans Claude DEBUSSY, Correspondance. 1884-1918, p. 227.
29 Claude DEBUSSY, Correspondance. 1884-1918, p. 245 n. 80.
30 Dans une lettre du 4 juillet 1912, Joseph Bédier laisse apparaître le « peu d'espoir d'obtenir quoi que ce soit de son correspondant}) ; cf. A. CORBELLARI, Joseph Bédier. Écrivain et philologue, Genève, Droz (Publications romanes et françaises, 220), 1997, p. 291, n. 420. Cette lettre est actuellement en possession des héritiers du philologue. n s'agit peut-être de la lettre mentionnée lors de la vente de la collection de livres de Debussy; cf. G. ANDRIEUX, Catalogue de vente de livres précieux anciens [ ... J, n° 211.
31 Par contre, après plusieurs tentatives, la pièce de Louis Artus fut créée le 30 janvier 1929 à Nice. Voir A. CORBELLARI, Joseph Bédier. Écrivain et philologue, pp. 290-296.
32 D.LF.M.A., pp. 703-706; Huon de Bordeaux inspira un opéra à Weber (1825-1826) sur une livret de J. R. Planché d'après C. M. Wieland.
33 Claude DEBUSSY, Correspondance. 1884-1918, p. 245. 34 Id., n. 78.
CLAUDE DEBUSSY, MÉDIÉVISTE DILETTANTE? 337
possédait la mise « en nouveau langage par Gaston Paris» parue à Paris en 1898 et pourvue de « caractères nouveaux dessinés par Eugène Grasset, fondus par la maison Peignot » ainsi que d'« aquarelles de Manuel Orazi reproduites en facsimi1é » 35 ... soit un bel exemplaire de bibliophilie.
Villon remplaça les projets théâtraux et Debussy composa des mélodies autour de trois ballades 36, peut-être aussi avec l'aide de Laloy 37 ; la première audition eut lieu le 5 février 1911 dans une interprétation de Paule de Lestang. Dans une lettre du 30 mai 1910 adressée à son éditeur, il notait:
Choisnel m'a dit que vous deviez revenir jeudi prochain? Si cela est exact, j'aurai à vous faire entendre « Trois ballades de F. Villon », auxquelles je mets, présentement, la dernière main 38.
Puis, après avoir reçu l'édition des Ballades, il répondit le 17 septembre 1910 à Jacques Durand:
Aujourd'hui, j'ai reçu les «Ballades ». C'est parfait, quoique j'eusse aimé que le parchemin fût un peu plus «jaulni » ... un temps viendra où tout cela sera «desseiché », la musique aussi! En tous cas, l'édition est jolie 39.
On s'interrogera peut-être sur les raisons qui poussèrent Claude Debussy à s'attacher à la poésie, plus particulièrement aux auteurs médiévaux du xve siècle. Dans un article de la revue Musica (mars 1911), il répondait à une enquête de Fernand Divoire sur la relation entre musique et poésie. Selon lui, la perfection et la conjonction des deux états étaient impossibles, sous-entendant la supériorité de la musique, car « on a plus souvent mis de la belle musique sur de mauvaises poésies que de mauvaise musique sur de vrais vers »40. Malgré tout, dans le même article, il répondit très simplement aux raisons qui le poussèrent à se tourner vers Villon en poursuivant sur les relations entre musique et poésie:
Les vrais vers ont un rythme propre qui est plutôt gênant pour nous. Tenez, dernièrement j'ai mis en musique, je ne sais pas pourquoi, trois ballades de Villon ... Si. je sais pourquoi: parce que j'en avais envie depuis longtemps [nous soulignons]. Eh bien, c'est très difficile de suivre bien, de« plaquer» les rythmes tout en gardant une inspiration 41.
Dans ses moments de délassement, outre le Roman de Tristan, Claude Debussy, amateur et lecteur de littérature, se délectait de prose médiévale du
35 Cf. notices bibliographiques du Service commun de la documentation. Bibliothèque universitaire Paris X -Nanterre et de la B.N.F.
36 Ballade de Villon à s'amye, Ballade que feit Villon à la requeste de sa mere pour prier Nostre-Dame et Ballade des femmes de Paris.
37 Fr. LESURE, Catalogue de l'œuvre de Claude Debussy, p. 124.
38 Claude DEBUSSY et Gabriele D'ANNUNZIO, Correspondance inédite, éd. par G. TOSI , Paris, Denoël, 1948, p.84.
39 Ibid., p. 91. L'édition est effectivement imprimée sur un papier jaune et les initiales des mots de la couverture sont en rouge, reproduisant les caractéristiques d'un manuscrit.
40 Cl. DEBUSSY, Monsieur Croche et autres récits, éd. Fr. LES URE, Paris, Gallimard (N.R.F.), 1971, pp. 201-202.
41 Id.
338 T. VAN HEMELRYCK
XIve siècle, comme il le dit dans une lettre adressée à son ami André Caplet 42,
datée du 15 août 1911, à l'occasion d'un séjourfamilial à Houlgate :
Je lis des romans à 95 c. bien remarquables et j'ai découvert les Chroniques de Joinville qui fut le délicieux biographe du Saint roi Louis XI [sic; s'agit-il d'une coquille, d'une faute, imputable à Debussy ou à son éditeur 7]. Il n'est jamais trop tard pour devenir érudit, on peut d'ailleurs être tranquille, je n'en abuserai pas 43 !
Déjà en 1908, dans une lettre adressée au même André Caplet datée du lundi 18 mai, il faisait allusion à un vers de Charles d'Orléans, incipit et titre d'une ballade pour laquelle il venait de composer une mélodie:
Caplet, vous êtes très gentil... mais! «Caplet vous n'êtes qu'un vilain », comme disait Charles d'Orléans en parlant de « l'Yver ».
M'expliquerez vous jamais cette disparition subite 44 7
De fait, Charles et ses vers émaillent la correspondance du compositeur avec ses amis, soulignant les climats mélancoliques. Ainsi, lors de son voyage en Russie - qu'il entreprit du 1er au 16 décembre 1913 -, Claude Debussy écrivit le jeudi 4 décembre de Moscou, une lettre sentimentale à sa femme, dans laquelle il exprimait tous les regrets de son absence; poursuivant le récit de son arrivée en Russie et de son installation, il notait:
Je me déclare très fatigué, et Koussevitzky me fait visiter mon appartement. .. somptueux. Je pourrais facilement y loger « ma suite » [sa femme Emma, et sa fille Chouchou]. Elle est jolie, « ma suite » ! Chagrin, déplaisir et déconfort, comme disait ce pauvre Charles d'Orléans dans sa prison d'Angleterre 45.
Conformément à la vision romantique, Charles d'Orléans est le poète de la mélancolie des sentiments 46 ; déjà, Gabriele d'Annunzio, dans une lettre adressée à Debussy le 29 décembre 1910, associait la tristesse du temps aux premiers vers d'une des ballades de Charles d'Orléans, mais ici le prince-poète disparaissait au profit de Debussy qui, outre l'invention de la mélodie, se voyait attribuer la paternité des mots :
42 Compositeur et chef d'orchestre (1878-1925), André Caplet composa également une chanson sur une ballade de Charles d'Orléans en 1914: En regardant ces belles fleurs.
43 Claude DEBUSSY, Lettres inédites à André Caplet (/908-1914), éd. par E. LOCKSPEISER, Monaco, Éd. du Rocher (Domaine musical), 1957, p. 55.
44 Ibid., p. 35.
45 Claude DEBUSSY, Lettres à safemme Emma, éd. par P. VALLERY-RADOT, Paris, Flammarion, 1957, p. 103.
46 La même vision romantique donnée au sujet de Villon par certains critiques de Debussy; ainsi, « Koechlin voit un rapport étroit entre les personnalités de Villon et de Debussy: " Je ne pense pas, écrit-il, qu'il se rencontre plus parfaite similitude entre deux génies .• Charme félon, la mort d'un povre cueur ' ... Une grande pitié pour les tristes choses humaines, en cet art debussyste. Angoisses de Golaud, méditations d'Arkel, trouble détresse, intense regret de Villon: qu'en dites-vous, qui ne tenez Debussy que pour un habile impressionniste?" Le rapprochement peut aussi se sentir avec Verlaine, comme Villon, grand poète et mauvais garçon, passant si facilement du trivial au lyrique, de l'immoralisme à la foi ». cf. Br. FRANÇOIS-SAPPEY et G. CANTAGREL, Guide de la mélodie et du lied, Paris, Fayard, 1994, p. 171.
CLAUDE DEBUSSY, MÉDIÉVISTE DILETTANTE?
En cette journée lugubre, votre chanson adorable chante dans mon cœur : «Yver, vous n'estes qu'un villain .. , On vous deust bannir en exil.., »47.
339
La présence de Charles d'Orléans est persistante à travers ses échanges épistolaires. Écrivant au chef d'orchestre D. E. lnghelbrecht, le 18 janvier 1914, il déclara, au sujet d'un portrait de lui réclamé pour un programme de concert et qu'il n'avait pas trouvé:
De plus, en réfléchissant, il me semble que les « tant » illustres auteurs inscrits sur votre programme pourraient se blesser de se voir représenter par le seul Debussy. Laisseznous, tous, sous le patronage de Charles d'Orléans, doux prince et si gentil Français 48.
Bien que la stricte transposition d'œuvres médiévales ne fût plus d'actualité dans sa production, il s'en inspira encore dans une dernière composition pour piano. De fait, dans une lettre écrite le 14 juillet 1915 de Pourville, il notait à l'attention de son éditeur:
Il faut que je vous confie que j'ai un peu changé la couleur du nO 2 des «Caprices» (Ballade de Villon contre les ennemis de la France) ; c'était trop poussé au noir et presque aussi tragique qu'un « Caprice » de Goya 49 !
Quelques jours plus tard, le 22 juillet 1915, il lui écrivit, toujours au sujet du 2e Caprice:
Ce jour, - comme disent les «business-men », j'ai mis le ne Caprice à la poste et j'ai reçu votre lettre. C'est un beau jour ... Vous verrez ce que peut «prendre» l'hymne de Luther pour s'être imprudemment fourvoyé dans un «Caprice» à la française. Vers la fin, un modeste carillon sonne une pré-Marseillaise; tout en m'excusant de cet anachronisme, il est admissible à une époque où les pavés des rues, les arbres des forêts. sont vibrants de ce chant innombrable. Je ne vois pas les choses si « vestues de noir» que vous ... À mon humble avis, les Austro-Boches tirent les dernières flèches d'un mauvais bois 50.
Ainsi naquirent En Blanc et Noir,' Trois morceaux pour 2 pianos à 4 mains, qui furent composés entre le 4 juin et le 20 juillet 1915, comme l'indiquent des mentions dans l'agenda de travail de Debussy. La première audition eut lieu le 21 décembre 1916 par Debussy et Roger Ducasse, chez Mme Georges Guiard, lors d'une matinée au profit du « Vêtement du prisonnier de guerre »51.
On sait que le deuxième Caprice (Lent-Sombre), inspiré de la Ballade contre les ennemis de la France de François Villon, a été dédicacé au neveu de son éditeur, Jacques Durand: «Au lieutenant Jacques Charlot, tué à l'ennemi en
47 Claude DEBUSSY et Gabriele D'ANNUNZIO, Correspondance inédite, p. 55.
48 Claude DEBUSSY, Correspondance. 1884-1918, p. 336.
49 Claude DEBUSSY, Lettres à son éditeur, p. 137 ; nouvelle édition dans Claude DEBUSSY, Correspondance. 18R4-1918, p. 351.
50 Claude DEBUSSY, Lettres à son éditeur, p. 138 ; nouvelle édition dans Claude DEBUSSY, Correspondance. 1884-1918, p. 351.
51 Fr. LESURE. Catalogue de l'œuvre de Claude Debussy, p. 142.
340 T. V AN HEMELR YCK
1915, le 3 mars ». La pièce contient également une épigraphe qui reproduit l'envoi de la Ballade de Villon:
Prince, porté soit des serfs Eolus En laforest ou domine Glaucus. Ou privé soit de paix et d'espérance Car digne n'est de posséder vertus Qui mal vouldroit au royaume de France
(François Villon -« Ballade contre les ennemis de la France» [envoi]) dédicacé au Lieutenant Jacques Charlot tué à l'ennemi en 1915, le 3 mars 52.
De plus, le troisième Caprice, dont Igor Stravinsky est dédicataire, porte à nouveau un vers de Charles d'Orléans en épigraphe:
Yver vous n'este [sic] qu'un vilain (Charles d'Orléans) à mon ami 19or Strawinsky.
La veine nationaliste est clairement imprimée dans le deuxième Caprice et prolonge ainsi le mouvement que le compositeur avait imprimé à certaines de ses œuvres dès 1904. Par ailleurs, à cette même époque 53 traversée par les désordres de la Grande Guerre, Debussy projeta de composer en collaboration avec Laloy une Ode à Jeanne d'Arc, selon les dires de son éditeur 54. Rien ne put se concrétiser, bien que Laloy composât les paroles d'une Ode à la France et la remit à Debussy en 1916 55 . L'ode était traversée par les mêmes élans nationalistes que le Noël de 1915 et la Berceuse 56; elle demeura cependant à l'état d'ébauche en raison de la mort de l'artiste. Emma Debussy donna le brouillon d'orchestre d'une quinzaine de pages sur quatre portées à M. F. Gaillard qui l'arrangea et en donna une première audition le 2 avril 1928 à Paris 57. Claude Debussy, alité depuis janvier 1918, s'était éteint le 25 mars 1918, rongé par le cancer.
* * *
52 Claude DEBUSSY, En blanc et noir: trois morceaux pour 2 pianos à 4 mains, Paris, Durand & Fils, 1915. p.15.
53 En 1915, il composa un Noël des enfants qui n'ont plus de maison, pour chant et piano.
54 Cf. ce qu'il en dit à 1. Durand dans une lettre du 12 août 1915 : «Je n'ai pas de nouvelles de Laloy, ni de l'Ode projetée» (Claude DEBUSSY, Lettres à son éditeur, p. 144). C'est l'éditeur qui précise dans une note en bas de page qu'il s'agit de « L'Ode à Jeanne d'Arc, restée inachevée et à l'état d'esquisse ». La figure de Jeanne d'Arc, associée à celle de Christine de Pizan, fut également mise à l'honneur lors de la seconde guerre mondiale, cf. A. J. KENNEDY, « Gustave Cohen and Christine de Pizan : a re-reading of the Ditié de Jehanne d'Arc for Occupied France », dans Sur le chemin de longue étude ... Actes du colloque d'Orléans, juillet 1995, sous la direction de B. RIBÉMONT, Paris, Champion (Études christiniennes, 3),1998, pp. 101-110.
55 Fr. LESURE. Claude Debussy: biographie critique, p. 405.
56 Berceuse héroïque pour rendre hommage à S. M. le roi Albert 1er de Belgique et à ses soldats, pour piano, novembre 1914; cf. Fr. LESURE, Catalogue de l'œuvre de Claude Debussy, p. 141.
57 Ibid., p. 149.
CLAUDE DEBUSSY, MÉDIÉVISTE DILETIANTE '? 341
Claude Debussy ne fut certes pas le seul à mettre en musique ou à composer des chansons sur des vers médiévaux. De fait, les années 1900-1915 voient di vers musiciens composer sur des poèmes médiévaux, comme Reynaldo Hahn 58 en 1899, Arthur Coquard en 1910, Henri de Fontenailles en 1911 et Philipp Jarnach en 1914 59, entre autres 60. Les symbolistes plasticiens et leurs émules littéraires perdurèrent par ce biais la fascination médiévale des romantiques.
Cependant, force est de remarquer qu'à ce tournant du xxe siècle, le Moyen Âge est également le porte-drapeau du nationalisme français, exacerbé par les menaces extérieures qui se font de plus en plus pressantes, entre les années 1870 et 1914. Ainsi, Charles d'Orléans et François Villon, au même titre que le Tristan de Bédier, incarnent ces figures légendaires d'une France victorieuse qu'il est bon de commémorer en ces temps incertains où l'Allemand menace d'anéantir le génie français. Claude Debussy n'échappe pas aux manifestations de son temps, mais assortit les modes de pensée à ses goûts poétiques personnels 61, offrant à l'auditeur des Temps Modernes un Moyen Âge retrouvé.
Tania V AN HEMELRYCK *
58 Compositeur, chef d'orchestre et critique, Reynaldo Hahn (1875-1947) se distingua par ses compositions et prestations vocales dans les salons parisiens dès son plus jeune âge. Claude Debussy n'aimait pas Hahn, comme le laissent transparaître ses mots dans une lettre du 16 octobre 1898 adressée à Pierre Louys: « Mrs Fragerolle, Paul Demet, et, plus près de nous Reynaldo Hahn, trouvèrent le plus clair de leur gloire dans des exhibitions où l'on exalta diversement leurs manières particulières d'avoir du génie. Le public y prit définitivement le goût de la mauvaise musique, résultat qui ne laisse pas d'être admirable pour la bonne (musique)>> (Claude DEBUSSY, Correspondance 1884-1918, pp. 138-139: Fr. LESURE, Claude Debussy: biographie critique, p. 419).
59 R. HAHN, Rondels sur des poésies de Charles d'Orléans, Théodore de Banville et Catulle Mendès, Paris, Heugel, 1899 : A. COQUARD, Cinq duos ou chœurs pour deux voix de femmes avec accompagnement de piano, Paris, Durand, 1910 [bail. de Charles d'Orléans: Le temps a laissé son manteau] ; H. DE FONTENAILLES, Quatre chansons de Charles d'Orléans, musique de Henri de Fontenailles, Paris, Rouart - Lerolle, 1911 ; Ph. JARNACH, Rondel de Charles d'Orléans. Musique de P. Jamach, Paris, Durand, 1914 [Je me metz en votre mercy].
60 Voir Cl. GALDERISI, Charles d'Orléans: « Plus dire que Penser >' ... Une lecture bibliographique, Bari, Adriatica Editrice (Biblioteca di filologia romanza, 37), 1994, pp. 68-69.
61 Comme il le disait lui-même: « Les vrais beaux vers, il ne faut pas exagérer, il n'yen a pas tant que ça. Qui en fait aujourd'hui'? », cf. texte cité supra.
* Tania Van Hemelryck est chargé de recherches au F.N.R.S.