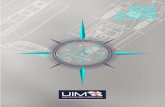La Première Internationale au Portugal. Vue à travers la correspondance internationale,...
-
Upload
ruhr-uni-bochum -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of La Première Internationale au Portugal. Vue à travers la correspondance internationale,...
Dejanirah Couto-Potache
tes de lutter à côté des ouvrières, quoique sur un autre plan U8. Ces dernières, en s'associant entre femmes étaient déjà féministes: l'appel fait aux féministes bourgeoises est déjà éclairant sur cette orientation.
La lutte des femmes ouvrières comme celle des féministes bourgeoises a été poursuivie. Une édition du Ministère du Développement (<< Fomento ») sur le «Travail nocturne des femmes dans les établissements Industriels» 119 établit théoriquement que les femmes ne peuvent plus travailler la nuit dans les entreprises industrielles. Cette loi, qui est de 1911 ne s'appliquait pas aux entreprises de moins de 10 ouvriers, ni aux entreprises de caractère familial 120 • Les dix heures de repos nocturne des femmes étaient suspendues si la matière première était susceptible de se détériorer pendant cet arrêt 121. Ces réformes devaient être appliquées après la publication de la loi. Quelques exceptions: le travail nocturne des femmes dans le textile et le coton (<< cardaçao e fiaçao de la »), dans les mines à ciel ouvert et dans l'industrie sucrière devait continuer sans altération jusqu'en 1919 122
•
Du grand nombre de problèmes non résolus, mais aussi de la détermination des féministes portugaises, fait état le contenu du Premier Congrès Féministe et de l'Education qui a lieu à Lisbonne le 4 mai 1925 et qui se déroulera jusqu'au 9 mai. Organisé par le Conseil National des femmes portugaises (et sous la présidence d'Adelaide Cabctc) il réunit une nouvelle génération de féministes portugaises dont l'œuvre va être décisive jusqu'en 1926.
118 Carlos da Fonseca, op. cit., p. 8. 119 Ministério do Fomento: Trabalho nocturno das mulheres nos Estabeleci
mentos industriaes (Alteraçi5es e additamentos aos decretos de 14 de Abril de 1891 e 16 de Março de 1893, Lisboa, Imprensa Nacional, 1911. Les décrets sont signés par Antonio José d'Almeida, Bernardino Machado, José Relvas, Antonio Xavier Correia Barreto, Amaro de Azevedo Gomes e Manuel de Brito Camacho.
120 Id., ibid., p. 3. 121 Id., ibid., p. 4. 122 Id., ibid., p. 4.
478
d
LA PRE MIE RE INTERNATIONALE AU PORTUGAL, VUE A TRAVERS LA CORRESPONDANCE INTERNATIONALE, PARTICULIEREMENT CELLE AVEC LE CONSEIL GENERAL
BERNHARD BA YERLEIN
1
AUX ORIGINES DE L'INTERNATIONALISME OUVRIER AU PORTUGAL (1866-1872)
La première Internationale s'implante au Portugal en 1871, sept ans après sa constitution formelle au St. Martins Hall de Londres en 1864.
Ce développement tardif, conditionné par des facteurs d'ordre interne et externe, des facteurs inhérents au mouvement ouvrier portugais comme relevant aussi des circonstances nationales et internationales, marque une première contradiction méthodologiquement décisive pour une appréciation historique globale de l'internationalisme ouvrier au Portugal. C'est cette contradiction qui - nous le verrons de plus près - se reflète surtout dans les relations entre l'organe dirigeant de l'Association Internationale des Travailleurs, le Conseil Général (C.G.) avec la section locale, respectivement régionale portugaise.
Au sens strict du terme il ne serait pas légitime de parler d'une « fondation» de l'A.I.T. au Portugal. Il s'agit plutôt d'un processus de formation, au cours duquel se distinguent nettement différentes étapes. Lors d'une première phase, située dans les années 1871/72, un premier groupement de symphatisants de l'Internationale se rassemble grâce à l'effort de divulgation des nouvelles idées, suivi par les premières tentatives d'organisation entreprises par quelques membres du Conseil régional espagnol. La seconde phase, amorcée par la constitution officielle d'une section de l'A.I.T. à Lisbonne au mois de mars 1872, équivaut à un premier début de travail systématique. C'est à
479
Bernhard Bayerlein
partir de 1873 finalement que peut être située l'amorce d'une troisième phase, qui trouve - cette fois-ci sous des signes complètement distmcts - son expression au niveau formel dans la création d'une « Fédération régionale» (nationale) portugaise.
La tentative de situer dans le temps - à travers des phases nettement définies - le développement est indispensable, dans la mesure où elle fait ressortir une coïncidence frappante de la période de formation et d'action de l'Internationale au Portugal avec une période de déclin au niveau international. A ce dernier niveau, son développement atteint sa phase culminante - cela du moins d'après le bilan personnel de Friedrich Engels, qui, dans une rétrospective globale, rattache l'efficacité historique de l'A.I.T. sous sa forme concrète à la période du Second Empire. Toujours d'après l'analyse de l'inlassable dirigeant international, l'Internationale équivalait plutôt à une « société internationale de discussion»; son unité de par là nécessairement fragile devant éclater par la force des choses, ce qui en effet se produit au plus tard au Congrès de Londres en septembre 1871.
Le développement menant à l'éclatement de l'homogénéité relative trouve ses racines objectives dans la transformation politique en Europe centrale (unité italienne et allemande, Commune de Paris 1) ce qui influence directement les luttes (p. ex. par l'essor économique et la garantie relative de l'exercice des libertés démocratiques en Angleterre), particulièrement dans les bastions ouvriers traditionnels. Ces facteurs objectifs coïncident au niveau subjectif avec la tentative marxienne d'orienter - précisément comme tentative d'un bilan positif de ce développement - l'A.I.T. dans une voie éminemment politique et de lui donner une structure organiquement centralisée 2.
Une première tentative de la part du C.G. d'amorcer des contacts avec les portugais est signalée lors d'une réunion de l'organe suprême du 5 mars 1866. Selon toute apparence, elle semble avoir échoué 3. Ce
1 F. Engels an F. A. Sorge, London 12 (et 17) Septembre 1874; dans Briefe und Auszüge aus Briefen von Joh. Phil Becker, Jos. Dietzgen, Friedrich Engels, K. Marx u.A. an F. A. Sorge und Andere, Stuttgart 1906, pp. 138 et suiv. [cité par la suite: Sorge.]
2 Pour ces débuts de l'AIT, voir le travail traditionnel: D. Rjazanov, «Zur Geschichte der Ersten Internationale», dans Marx-Engels Archiv., t. l, pp. 119-202. Pour le congrès de Londres voir l'analyse détaillée de M. Molmir, Le déclin de la Première Internationale, La conférence de Londres de 1871, Genève 1963; en particulier pp. 187-197.
3 D'après le protocole de mémoire de la session: «Citizen Jung said that Citizen Orsini would leave letters of introduction to the leading Socialists of Spain, Portugal and Italy [ ... ].» (Council Meeting of March 20, 1866; dans General Council of the First International (Minutes), 1864-1866, Moscou s.d., p. 173 [cité par la suite: Minutes.]
480
+
La Première Internationale au Portugal, vue à travers la Correspondance [ ... ]
n'est alor~~as la première fois qu'~l faut constater un échec de ce genre: des procede~ semblables, employes lors d'une tentative de rapprochement avec 1 Espagne en 1864, étaient déjà restés sans écho 4.
Les progrès rapides de l'A.I.T. en Espagne, qui effectivement se produisent après l'implantation d'un premier noyau par l'italien Fanelli en 1868, suiv,~s. par la constitution formelle d'une section régionale espagnole en Jum 1870 sont des éléments à retenir dans la mesure ou c' est ~ien d'E~pagne ~ue ~iendra en effet la première impulsion pour orgamser les mternatlOnahstes portugais. . Engels, chargé provisoirement à partir du 7 février 1871 par déci
SlOn du C.G. de la correspondance avec l'Espagne 5, donne lors d'une réunion du Conseil du 3 janvier le compte-rendu d'une lettre du Conseil fédéral espagnol datant du 14 décembre 1871, et qui relate des efforts entrepris afin de trouver des contacts au Portugal:
«Enquiries were made whether there were any sections in Portugal.» 6
Tout indique que néanmoins la mention d'Engels ne rend apparemment pas compte du véritable procédé choisi dans cette affaire, dans laquelle les espagnols servaient d'intermédiaires. Dans une lettre de ces derniers, que nous trouvons partiellement citée chez M. Nettlau, se référant à la prise de contact, il n'est en vérité pas question de recherches faites, bien au contraire, ce sont eux qui demandent à Londres:
«Decidnos si hay establecida alguna secciôn internacional en Portugal y remitidnos las senas de su domicilio social, a fin de ponernos en relaciones con ella.» 7
Il en ressort donc que ni le c.G., ni le Conseil espagnol ne sont véritablement en contact direct avec le Portugal de l'époque. L'Internationale y est inexistante ce qui d'ailleurs est confirmé par la suite
4 Voir à ce, sujet l'ana~yse du problème du développement de l'AIT: J. Freymond / M: Molnar, «The Rlse and FaU of the First International», dans M. M. Drachkovltch (Ed.), The Revolutionary Internationals, 1864-1943 Stanford 1966 pp. 3-35, en particulier p. 18. "
.5. K. Mar~, F. Engels, Werke, herausgegeben vom Institut für MarxismusLemmsmus belm ZK der SED, Berlin (Est), t. XVII, p. 287 [cité par la suite' MEW.] Cf. Rjazanov, op. cit., p. 160. .
~ Supplement to the Minutes of the Meeting of January 3, dans Minutes, op. cu., 1870-71, p. 104.
7 M. Nettlau, Documentos ineditos sobre la Internacional y la Alianza en Espana, Buenos Aires 1930, pp. 29 et suiv.
481 31
Bernhard Bayerlein
dans la réponse d'Engels à la requête des espagnols: il demande à ces derniers de bien vouloir nouer eux-mêmes les premiers contacts avec les travaileurs portugais:
«Wir haben noch keine Sektion in Portugal; es ware vielleicht rur Euch leichter aIs rur uns, Beziehungen zu den ArbeHan dieses Landes anzubahnen. Wenn dem so ist, schreibt uns bitte noch einmal darüber. »8
Pourtant, entre-temps, le Conseil espagnol s'était déjà ne serait-ce que moralement acquitté de la mission d'Engels: le 8 janvier est publié dans La Pederaci6n un appel aux travailleurs portugais, rédigé par une commission formée dans ce but au Congrès de constitution formelle de la Section espagnole, Congrès qui eut lieu à BarcelOne en juin 1870. Empreint de conceptions fédéralistes et «anti-autoritaires », contraire à une conception de l'Internationalisme «marxien» fondé plus concrètement sur l'impératif de défense immédiate des intérêts des travailleurs, l'appel néanmoins fait époque. C'est dans ce document, que pour la première fois dans l'histoire des deux peuples ibériques sont formulées les aspirations communes de classe - i.e. la nécessité d'une union entre les travailleurs de la péninsule:
« Obreros portugueses, hermanos nuestros: aunque pr6ximos, aunque procedentes de iguales tiempos y origenes, portugueses y espafioles, pasamos siglos sin que disminuya nuestro incomprensible alejamiento, sin que nos reconozcamos realmente hermanos, sin
8 F. Engels, «An den spanischen Füderalrat der Internationalen Arbeiterassoziation, London, 13.2.1871 », dans MEW, t. XVII, pp. 287-290. Cf. la version espagnole: «Al Consejo Federal de la Regi6n Espafiola de la Associaci6n Internacional de Trabajadores", dans Minutes, op. cit., 1870-71, pp. 346-349. Nous reviendrons sur la «préhistoire" de l'AIT au Portugal. Nous ne faisons allusion ici qu'à une tentative de différenciation du processus historique entrepris par M. Nettlau dans son œuvre monumentale, non publiée encore, sur l'histoire de l'Anarchisme. (M. Nettlau, Geschichte der Anarchie, manuscrit, IISG, Amsterdam [cité par la suite: Anarchie.] Pour le Portugal, voir chap. XXI, pp. 471 et suiv.). Pour lui, ce qui manquait au prolétariat portugais par rapport à l'espagnol, c'est la «harte Schule der Kampfe und Konspirationen in Spanien", pendant l'époque carliste et migueliste, renforcée politiquement par le Proudhonisme. Toujours d'après Nettlau, c'est surtout «la liberté en apparence» sous les différents régimes constitutionnalistes qui contribuait au retard du «mouvement républicain militant" au Portugal par rapport à celui d'Espagne: «Bis 1871 hatte sich also weder ein einheimischer Sozialismus entwickelt, noch gab es ein pronunziertes politisches oder gewerkschaftliches Auftreten der Arbeiter, [ ... ] obgleich besondere Rindernisse (groEe Reaktions perioden usw.) anscheinend nicht bestanden. Eine Anzahl militanter Arbeiter und junger Intellektueller im Centro hatten die Rand auf allem." (pp. 471 et suiv.).
482
+
La Première Internationale au Portugal, vue à travers la Correspondance [ ... ]
que se unifiquem nuestros intereses y tendencias, siendo asi que unidos han estado y estarim seguramente nuestros destinos. [ ... ]
En Espafia ya tenemos algo adelantado, no dejéis de acomppanarnos vosotros los trabajadores de Portugal. Portugueses y espafioles hemos ido siempre a las grandes cos as, démonos la mana tambien para obtener la emancipaci6n obrera, para que podamos los trabajadores ejercer todos nuestros derechos y dejemos de ser victimas de una organizaci6n social antihumanitaria y antinatural. [ ... ]
Federaos y federémonos todos, obremos internacionalmente, y nuestra emancipaci6n sera.» 9
Et pourtant, le temps pour l'internationalisme luso-espagnol ne paraît pas encore mûr; d'après les recherches entreprises par Carlos da Fonseca, l'initiative espagnole reste sans écho; il n'y est même pas fait allusion dans la presse portugaise contemporaine lO. Le mouvement ouvrier portugais naissant reste sans contact avec l'Internationale jusqu'au mois de juin 1872, l'A.I.T. y reste inconnue, malgré les premières tentatives -d'ailleurs en grande partie avortées - faites dans le cadre des fameuses «conférences démocratiques» en 1870 11 • Ainsi, José Correia Nobre França, futur secrétaire de l'A.I.T. au Portugal avouera à Engels plus tard:
«Nous ignorions l'existence de l'Internationale, dont les newspapers parlaient rarement, mais nous la comprîmes et elle excita notre curiosité.» 12
En effet, les premiers contacts au Portugal s'établissent en quelque sorte grâce à un hasard de l'histoire, eux aussi sans une intervention directe de la part du C.G., en raison de l'exil temporaire et forcé
9 Associaci6n Internacional de los Trabajadores, «Llamamiento a los trabajadores de Portugal", dans La Fédéraci6n, 8.1.1871; reproduit dans A. Lorenzo, El proletariado militante, Pr610go y notas de J. A. Junco, Madrid 1974, pp. 127 et suiv.; d'après Nettlau (Anarchie, p. 472), l'appel date de décembre 1870, les membres de la commission étant: A. Marsal, Juan Nuet, A. G. Garcia Meneses, Rafael Farga Pellicer.
10 Carlos da Fonseca, A origem da 1.a Internacional em Lisboa, Lisboa 1973, p. 43 [cit par la suite: A origem.]
11 Pour les tentatives - vaines - d'une première systématisation des connaissances sur le socialisme «scientifique" dans le cadre des conférences, voir Oliveira Martins, Portugal e 0 Socialismo, Lisboa 1873 et F. Laranjo, «Origens do Socialismo", dans 0 Instituto (Coimbra, t. XX, 1874.
12 J. C. Nobre França à F. Engels, Lisbonne, 24.6.1872, lettre manuscrite, IISG, Amsterdam, Fonds Jung L 5119; publiée dans La Première Internationale, Recueil de documents publiés sous la direction de J. Freymond, t. III, Genève 1871, pp. 400-410 [cité par la suite: Freymond.]
483
Bernhard Bayerlein
de Mora, Morago et Lorenzo, membres du Conseil fédéral espagnol à Lisbonne, de juin à août 1871 13
• Paul Lafargue, futur représentant de la section portugaise auprès du C.G. confirmera cet état de fait plus tard à Engels, dans une lettre du 7 janvier 1872:
«Esos tres hombres [ ... ] han trabajado mucho en Portugal, se puede decir que son ellos los que fundaron la Internacional.» 14
Plei d'opitimisme, Mora, dans une lettre à Engels du 5 juillet 1871, parle à ce sujet de « bonnes relations avec les portugais» :
«grâce auxquelles l'Internationale sera portée au Brésil [ ... ].» 15
L'aide de la part des fédérés espagnols permet non seulement la création d'un premier noyau internationaliste au Portugal au mois de juin 16 mais aussi l'amorce d'une coopération internationaliste entre
13 De l'affirmation de Lorenzo, selon laquelle «[ ... ] la esperanza [ ... ] implantando la lnternacional en un paîs que no habî~ respondid~ atm al moviiniento proletario, nos entusiasmaba» (op. cit., p. 161), Il ne faudrait P?u~tant ?a~ conclure à une mission officielle avec cet objectif déterminé. La CommISSIOn Fe~eraIe Espagnole, craignant une importante répression gouvernementale par sU1~e
(e. a.) de la publication d'une proclamation en faveur de la Commu?e, de ~ans du 3 juin, avait décidé de choisir l'exil portugais: e~plo~ant l~ procede tact1~,u~ suivant: «[ ... ] pour tourner l'article de la ConstItutIOn InterdIsant toute SOCIete dont la direction se trouvait hors d'Espagne, de rien dire aux fédérations locales au sujet de notre siège, de faire acheminer leur correspondance à Madrid,. d'envoyer la nôtre de cette ville, d'établir à, c~tt.e fin Angel Mora à Ma~nd, e? feignant pour y parvenir d'accepter sa dem~s~~on de membre du ~:msell f:deraI [ ... ] ». AIT, Actas de los Consejos y Comlswn Federal de la Regwn Espanola (1870-1874), transcripciôn y estudio preliminar por Carlos S~co Serrano, t. l, Barcelona 1970, p. 63 [cité par la suite: Actas.] Cf. à ce sUJet: C. Seco Se~ra~o, «L'Espagne, la Commune et l'Internationale », dans Jalons pour u.ne ~lstolre de la Commune de Paris, livraison spéciale préparée sous la directIOn de J. Rougerie [ ... ], International Review of Social History, vol. XVII, 1972, parts 1-2, pp. 235 et suiv. .
14 Cité d'après M. Nettlau, «Documentos inéditos », op. cit., p. 65. TouJo.,:rs d'après M. Nettlau, les trois espagnols arrivent le 9 juin (M. Ne~tlau, .La Prem~ere Internationale en Espagne. 1868-1888, révision des textes, traductIOns, IntroductIOn, notes, appendices, tableaux et cartes aux soins "de Renée ~amberet, Dordrecht 1969, pp. 92 et suiv. [cité par la suite: La Premtere Internatwn~le]), pour ~ester au Portugal jusqu'au 23-24 août (M. Nettlau, «Bakunin und ~le. InternatIOnale in Spanien 1868-1873 », dans Archiv für die Geschichte des Soztalt~m~s und der Arbeiterbewegung (Grünberg-Archiv), IV, 1914, pp. 243-332, en partIcuher pp. 276 et suiv.; cf. La Première Internationale, p. 43).
15 M. Nettlau, La Première Internationale, p. 92. 16 Sur les luttes de tendance à l'intérieur de l'AIT et de la section por
tugaise, voir infra, chap. II.
484
+
La Première Internationale au Portugal, vue à travers la Correspondance [ ... ]
les deux régions à partir de l'automne 1871. Ainsi par exemple, en été, les portugais réclament de la part de leurs confrères espagnols une solidarité y compris matérielle pour secourir les ouvriers du tabac en grève, les espagnols ne pouvant y répondre positivement par manque de fonds 17. Dans un contexte semblable est rédigé ce que l'on pourrait appeler le premier document officiel et public de l'A.I.T. portugaise, dont nous avons connaissance, sous forme d'un appel de solidarité avec les ouvriers de la métallurgie «sevillana» en grève, daté du 23 octobre 1871, document historique, qui lui aussi, en dépit d'un avertissement adressé aux travailleurs portugais de ne pas se faire embaucher comme commis de grève, reflète une conception internationaliste imprégnée de principes moralistes;
« É um princîpio sublime da classe operaria ser guiada pelos interesses gerais da humanidade e da justiça em vez dos interesses individuais de cada um dos seus membros. Ao contrario da classe rica e burguesa sempre avida de especulaçôes egoîstas, a alma do povo é naturalmente aberta às ideias nobres e justas, e aos sentimentos de fraternidade.» HI
Grâce au contact avec Francisco Mora, Engels paraît être, pendant cette époque déjà, au courant de la situation, sans pourtant être en mesure d'influencer le processus de formation se dessinant au Portugal.
Mora s'avère, de par ces relations, être à l'époque un des partisans inconditionnels d'Engels et du courant marxien 19. Contrairement aux
17 «Resolveu-se responder telegràficamente que nao podemos assegurar-lhes o apoio, mas que irîamos fazer 0 possîvel para ajuda-Ios e que até la se mantivessem firmes.» (Actas, t. l, p. 83, 17.q.1871; trad. et reproduit comme d'autres documents importants se référant au Portugal de la part du conseil espagnol, par Carlos da Fonseca, Integraçiio e ruptura operaria, Capitalismo, Associacionismo, Socialismo. 1836-1875, Lisboa 1975, p. 299; pour toute la documentation, voir pp. 229-238 [cité par la suite: Ruptura]).
18 « Apelo da Secçao de Lisboa da AIT a favor da Greve dos Mecânicos de Sevilha », dans La Raz6n (Sevilha), novembre 1871, repr. dans Carlos da Fonseca, A origem, pp. 143 et suiv.
19 Mora, qui de Lisbonne communique à Engels brièvement les succès obtenus (le 12 août 1872), indique Antero de Quental comme personne de contact; en outre il demande de remettre presse et correspondance internationale. Probablement cela n'a pas été réalisé. Mora paraît, pendant toute l'année 1872, en contact avec Engels, d'une façon assez irrégulière. C'est ainsi qu'il fait mention dans sa lettre du 12 août à une lettre reçue de Londres datant du 27 janvier (Mora à Engels), Lisbonne, 12 août 1871, partiellement cité, sans indications de source, dans César Oliveira, Treze cartas de Portugal para Engels e Marx, recueil, préface et notes, Lisbonne 1978, pp. 75 et suiv. Vu l'importance de la correspondance, ce recueil de te)Ctes se distingue par le manque de sérieux scientifique.
485
Bernhard Bayerlein
supputations exprimées dans un rapport policier contemporain 20 reconnaissant dans la personne de Paul Lafargue l'élément moteur de la fondation de l'A.I.T. au Portugal, il est certain, qu'il n'y joue - au moins jusqu'en avril de l'année 1872 - aucun rôle effectif: jusqu'à cette époque il ne paraît même pas informé sur les événements au Portugal 21.
L'existence précaire des premiers regroupements ne sera en partie seulement surmontée que par la constitution officielle de la section locale de l'A.I.T. de Lisbonne en février/mars 1872. Un travail réel d'organisation n'est pourtant entamé qu'à partir du mois de mai de cette année-là, après la constitution des premiers noyaux et sections; c'est Nobre França qui en donne un témoignage historique dans sa lettre
du 24 juin 1872. Or, pour ce qui est de la constitution, il semble que ni les espagnols,
ni le C.G. n'y ont contribué d'une manière effective et pratique. La communication officielle sur l'acte de fondation signé Nobre França, José Correia (secrétaire du Comité Central de la section de Lisbonne de l'A.I.T.) et J. M. Tedeschi (secrétaire pour l'étranger) représente en même temps la première prise de contact directe entre Lisbonne et Londres, siège du C.G. jusqu'en 1872.
« Pour garantir l'authenticité de la présente lettre, vous adresser au conseil fédéral d'Espagne, qui nous a donné votre adresse. [ ... ]. Ainsi nous commençons en donnant l'adhésion de la grosse" région portugaise, malheureusement la plus tardive de l'Europe à entrer dans le grand mouvement d'émancip~ti911 ~et d'affran~ chissement économique, politique et social de la classe ouvrière et de l'humanité souffrante.» 22
Cela ne concerne pas seulement le caractère fortuit et creux des notes, mais la transcription des lettres elles-mêmes, effectuée sans indication des sources (Archives Marx-Engels, Fonds Jung à l'IISG, Amsterdam). Quelques lettres sont publiées sous forme de «notas nao identificadas », ce qui fait soupçonner que César Oliveira n'a pas eu à sa disposition l'original. Notre recherche personnelle nous a permis d'« identifier» intégralement une de ces lettres. En plus, ces documents, de par l'IISG lui-même, étaient prévus pour une édition en cours, ce qui en interdisait la publication. C'est pourquoi l'auteur de la présente communication a été amené à respecter ce règlement.
20 L'AIT au Portugal, manuscrit de 19 pp., A:MAE, Lisbonne (rapport rédigé au nom du gouvernement portugais par l'agent de police français, Latour, publ. dans Freymond, t. III, pp. 410-418.
21 Voir Lafargue à Engels, du 27 avril 1872 (référence infra, note 31). 22 Au Conseil Général de rAssociation Internationale des Travailleurs, Lis
bonne, 10 mars 1872, manuscrit dans IISG, Amsterdam, Marx-Engels NachlaB L 5118; repr. dans Freymond, t. III, pp. 398 et suiv.
486
La Première Internationale au Portugal, vue à travers la Correspondance [".]
Il faut placer ce document dans son époque pour se voir confirmer la contradiction inhérente au développement de l'internationalisme ouvrier au Portugal: la Commune de Paris qui - facteur décisifencourage l'action de classe dans ce pays et constitue ainsi une alternative palpable aux types de « révolutions» jusqu'alors connues comme celle d'Espagne de 1868 - c'est précisément à partir de là que l~ radicalisme ibériste traditionnel entre dans sa phase de décadence - s'avère par contre comme étant un élément désagrégeant au niveau de l'Internationale 23.
II
L'INTERNATIONALISME EN ACTION (MARS-SEPTEMBRE 1872)
1. LES DEBUTS D'UN TRAVAIL D'ORGANISATION
A partir de la fondation de la section locale, le développement des relations au niveau international témoigne du côté des portugais d'efforts grandissants pour sortir de leur isolement et du côté du C.G. d'une activité de revalorisation de la section « lisboeta» au niveau international. Et pourtant, les relations mutuelles restent fragiles jusqu'en été 1872. Une lettre d'Engels, écrite probablement vers le 19 mars à l'occasion de la constitution n'est malheureusement pas conservée 24. Son existence est prouvée par le protocole d'une séance tenu par le C.G. le 19 mars; y est exprimée la joie de voir se fonder au Portugal le courant. d'émancipation ouvrière mais aussi le regret de ne pas pouvoir y contnbuer sous forme d'une aide matérielle, allusion à un trait constant dans l'activité des portugais qui s'affirmera par la suite et auquel nous reviendrons:
«He had written back an answer stating that the Council was not in a position to lend the required assistance but had it been able there was no section that it would more cheerfully assist than that of Lisbon.» 25
23 Pour la «revoluci6n gloriosa» voir J. Termes, Anarcismo y sindicalismo en Espafia. La Primera Internacional (1864-1881), Barcelona 1972 et E. Lidia / I. M. Zavala (Sel.) , La Revoluci6n de 1868. Historià, Pensamiento, Literatura, New York 1970.
.24 C'est ce qui ressort d'une note d'Engels au verso de la lettre de ConstitutIOn (Au Conseil Général, cit., 10 mars 1872.
25 « Minutes of Council Meeting held March 19, 1872 »;, dans Minutes, 1871-72, pp. 129 et suiv.
487
Bernhard Bayerlein
Il convient en cet endroit de faire une parenthèse sous la forme d'une remarque quant aux sources disponibles. Il est à peu près certain que toute la correspondance envoyée au Portugal par Engels et même Marx a été irrémédiablement perdue. Contrairement aux affirmations de César Oliveira, il n'en est pas de même pour tous les éléments d'échange avec le C.G. 26
• Les résultats de notre enquête en somme ne peuvent donc être considérés que comme étant une première approche.
D'après quelques allusions dans la correspondance internationale, il est plus que probable que les portugais paraissent approvisionnés par le C.G. en quelques matériaux d'information. Ainsi ils reçoivent quelques organes de la presse internationaliste de l'époque, du moins jusqu'en été 1872 27. C'est à travers le Morning Post - pour ne donner qu'un exemple de l'importance de ces échanges - que le noyau de l'A.I.T. au Portugal prend connaissance de la convocation du Congrès de La Haye pour le mois de septembre de l'année en cours. L'intercommunication paraît facilitée par l'édition du premier journal internationalistes au Portugal - 0 Pensamento Soc.ial 28
- à partir de février.
26 Nous disposons en effet de quelques communications de la part du Conseil Général ou du moins de quelques éléments dans la correspondance et les écrits de Marx et Engels. Les lettres d'Engels et des autres internationalistes dirigées au Portugal semblent définitivement perdues. Voir à ce sujet Carlos da Fonseca, A origem, p. 69, qui évoque des éléments fournis par L. de Figueiredo sur le sort de ce genre de matériel, resté dans les mains de Azedo Gneco, et détruit par mesure de précaution (0 Protesto, 12 janvier 1930).
Pour d'éventuelles nouvelles « découvertes» il faut surtout attendre la publication des tomes correspondants de l'édition « complète» des écrits de Marx / Engels, actuellement en cours (Marx-Engels Gesamtausgabe, MEGA, Berlin [Ost]), dont le tome XXII de la première section, englobant l'activité du Conseil Général pendant la période allant du 21 mars au 7 novembre 1871 est annoncé pour 1979. (Cf. R. Rudich, « Neues über die Protokolle des Generalrats der lAA von 1871 », dans Beitrage zur Geschichte der Arbeiterbewegung, XX, 3, 1978, pp. 398 et suiv.).
27 Pendant cette période, les portugais reçoivent le Morning Post, comme d'autres publications. Important en ce qui concerne le « level» d'informations sur la crise intérieure de l'AIT au Portugal, la réception de la brqchure, éditée au nom du Conseil Général sur les « prétendues scissions» (Les Prétendues Scissions dans l'Internationale, circulaire privée du Conseil Général de l'Association Internationale des Travailleurs, Genève 1872).
28 0 Pensamento Social, « Nao mais deveres sem direitos, nao mais direitos sem deveres », Lisbonne, 1 série, n° 1, février 1872; le journal paraît en une première série en 51 numéros jusqu'en avril 1872. Les numéros de la deuxième série n'ont pas été repérés jusqu'à aujourd'hui, vu que les deux collections jusqu'alors connues (Bibliothèque nationale de Lisbonne et APP /Paris) sont incomplètes (cf. à ce sujet, infra, note 174 [cité par la suite: 0 P.S.]).
488
La Première Internationale au Portugal, vue à travers la Correspondance [ ... ]
Les portugais insistent surtout pour recevoir les «excellentes» publications espagnoles.
Ce premier rapprochement - en fin de compte -ne suffit pourtant pas à colmater l'immense déficit théorique et de connaissances générales 29. A retenir, parmi les articles à ce propos dans l'organe de la section jusqu'au mois de juin, des petits rapports sur les luttes ouvrières menées dans les autres pays sous la forme d'une rubrique internationale à parution régulière (comme p. ex. les appels du C.G. sur la question irlandaise) et particulièrement les règlements et statuts administratifs de l'A.I.T. elle-même, voté en amendement au Congrès de Londres, règlement élargi plus tard aux statuts des associations ouvrières portugaises 30.
Il est néanmoins significatif pour la fragilité des relations au plan international que la section locale de Lisbonne - d'importance nationale - ne soit pas encore alors officiellement reconnue comme membre statutaire de l'A.I.T., ce qui se produira durant la période prépa-. ", ratOlre au Congrès de La Haye. Les divergences idéologiques y jouent sans aucun doute un rôle: preuve en est une communication de Lafargue à Engels du 27 avril. Le gendre de Marx se trouve en Espagne à partir du printemps de l'année afin d'y organiser la résistance contre les adeptes de 1'« Alliance de Démocratie Socialiste », à tendance fédéraliste et anti-autoritaire, inspirée par Bakounine:
«Il paraît que l'alliance s'était formée au Portugal et que les hommes excellents quoique proudhoniens ont beaucoup de mal à luttrer contre. Je suis en communication avec eux; dans mes lettres privées j'ai attaqué Bakounine et Proudhon.» 31
Insistons sur le fait que c'est précisément à partir de cette époque que se nouent des contacts d'apparence assez regulière entre les portugais et Lafargue à Madrid - ce du moins d'après son propre témoignage. Au contraire, il n'en est pas de même pour Engels à Londres. Une nouvelle allusion à la section portugaise, dans laquelle Lafargue, re-
29 Voir à ce sujet, infra, note 59. 30 AIT, « Estatutos Gerais », dans 0 P.S., n° 6, mars 1872; AIT, « Regula
mentos administrativos », dans 0 P.S., n° 7, avril 1872. '31 Paul Lafargue à Friedrich Engels à Londres, Madrid, 27 avril 1872, dans
Friedrich Engels, Paul et Laura Lafargue, Correspondance, textes recueillis, annotés et présentés par A. Bottigelli, t. III (1891-1895), Paris 1959 [cité par la suite: Bottigelli], pp. 459 et suiv,
489
Bernhard Bayerlein
voyant quelque peu son appréciation antérieure, fait part d'une lettre qu'il envoie à Engels au mois de mai en tant que délégué pour l'Espagne.
{{ A propos: [ ... ] En Portugal ils sont très intelligents et très dévoués. »32
D'après nos recherches, la cadence des lettres échangées entre Londres et le Portugal ne s'intensifie guère, du moins jusqu'au mois d'août. Le 26 juin Nobre França répond finalement à la lettre du 19 mars fournissant néanmoins par un « rapport» relativement détaillé des éléments importants d'ordre historique, d'appréciation politique, ainsi que des dates précieuses sur la force et la composition de la section portugaise, détails que l'on chercherait vainement ailleurs 33.
Les statuts de la nouvelle section, publiés au Portugal sous forme de brochure durant l'été sont remis à Engels à cette époque 34 et alors le rythme des échanges avec Londres s'accélère. Au moment où les portugais se plaignent encore auprès de Lafargue du silence d'Engels quant à sa position sur le rapport envoyé, ce dernier s'est déjà adressé aux portugais dans un message daté du 28 juin - qui a certainement dû se croiser avec la longue communication de Nobre França - auquel très probablement sont joints les timbres des membres. Engels en profite pour demander des informations supplémentaires sur certaines particularités propres au régime de propriété rurale au Portugal, attestation indéniable de l'intérêt porté à ce pays par le dirigeant ouvrier 35.
Les portugais, cette fois-ci, ne réagissent pas aussitôt, attendantcomme l'expliquera Nobre França dans sa prochaine lettre du 27 juillet - une réponse détaillée 36. Engels y répond en effet le lS août par une communication plus approfondie. C'est du moins ce qu'il est légitime de déduire de la nouvelle lettre de França du 23 août. Cette dernière pour sa part est importante dans la mesure où elle permet de situer assez bien la date d'entrée au Portugal de Paul Lafargue, qui
32 Paul Lafargue à Friedrich Engels à Londres, Madrid, 29 mai 1872, dans Bottigelli, t. III, pp. 466 et suiv. A l'exception de la communication référenciée supra, note 35, nous n'avons pu trouver aucune trace de la correspondance de Lafargue avec le Portugal lors de son séjour à Madrid.
33 Nobre França à Engels, Lisbonne, 24 juin 1872, dans Treze cartas, cit. 34 Estatutos da Asso.ciaçao Internacional dos Trabalhadores e das Secçoes da
Regiao Portugueza. (Os estatutos das Secç5es regerao até à celebraçao do congresso regional), Lisboa, Typogr. do Futuro 1872 (à l'IISG, Amsterdam).
35 Cf. des allusions dans J. C. Nobre França à F. Engels, Lisbonne, 27 juillet 1872 (signé: N.F., secrétaire du Conseil Général de la Fédération locale de Lisbonne), publ., sans ind. de source, dans Treze cartas, déjà cité, pp. 35-38.
36 Ibidem.
490
" La Première Internationale au Portugal, vue à travers la Correspondance [ ... ]
finalement, et contrairement à sés projets initiaux prend la décision d'alors «porter secours» aux internationalistes po;tugais 37. Les luttes de tendances au niveau de l'Internationale sont indissolublement liées à ce séjour, luttes qui, d'une façon voilée avaient déjà éclaté bien auparavant au Portugal.
2. LE PORTUGAL ET LES CONFLITS DANS L'INTERNATIONALE
C'est dans ce contexte que les sympathies grandissantes des éléme~ts respons~bles du courant marxien international pour la petite sectIOn portugaises - ne comptant à l'époque d'après le récit de Nobre França guère plus de 300 membres - trouvent une explication si l'on considère l'importance stratégique d'une section nationale fidèle au C.G. dans une situation caractérisée par l'exacerbation des luttes entre alliancistes et «autoritaires» dans la voisine Espagne 33.
, . ~ ce nivea~ ce sont précisément les années 1871/72 qui s'avèrent decIsIves pour 1 avenir de l'Internationale en général: à la lutte interne qui amène au courant de l'année 1872 les fédérations belges, anglaise~ et espagnoles à une rebellion ouverte contre le C.G. 39
, correspond un développement inégal de la force des mouvements ouvriers des différents pays. L'attitude fondamentalement optimiste d'Engels est justifiée par la s.ituation générale en Italie, en Belgique, en Espagne et aux E:ats-Ums. Pourtant la situation objective avec ses conséquences immédIates sur le mouvement subjectif surtout dans sa forme associative dans deux bastions ouvriers, à savoir la France et l'Allemagne tend à
1, ,
mettre en cause analyse globale. Le mouvement ouvrier dans les deux p.ays est affaibli - pour ce qui est de la France d'une façon déciSIV~ - par ;tne féroce répression à la suite de la Commune, pour ce q;Ul est de ~ All~m~gne, où des lois restrictives rendent illégale l'affiliatIon collectIVe a 1 A.I.T., par suite surtout des querelles entre les deux courants du mouvement ouvrier, Lassaléens et sociaux-démocrates 40.
37 J. ,~: N?~re França à F. Engels, Lisbonne, 23 août 1872; publ. dans Treze cartas, deJa cIte, pp. 39-42. Lafargue arrive au Portugal probablement le 1er août e? compagni~ de sa femme Laura, fille de K. Marx, pour y rester approxima~ tlvement 15 Jours (cf. Paul Lafargue à Friedrich Engels à Londres Lisbonne 8 août 1872, dans Bottigelli, pp. 49 Oet suiv.). "
38 M. Nettlau, La Première Internationale, pp. 108 et suiv. 39 Cf. F .. Engels à J. A. Sorge, citée dans Freymond, t. III, préface, p. XI.
• 40 Au sUjet de l'AIT en Allemagne, voir le documentaire Die 1. Internationale zn Deutschland (1864-187?), Dokumente und Materialien (éd. par l'IMIL de BerlinEst et celui de Moscou), Berlin (Est) 1964.
491
Bernhard Bayerlein
Pendant la période préparatoire au Congrès de La Haye nous assistons de ce fait à un redoublement de l'effort d'organisation des deux grands courants ennemis. La tendance marxienne tendant à mettre en place une «politique d'ensemble ayant pour but la transformation de l'A.I.T. », jusqu'alors amorphe, en une organisation de classe combative, voire en parti politique 41. Lors de la confrontation qui en résulte et qui force les disciples de Bakounine à une contre-attaque dès le congrès de Londres, la section portugaise revêt une importance, y compris stratégique, dépassant de loin l'envergure relative de son mouvement naissant à la recherche d'une voie d'autonomie dans le combat. L'enjeu d'une prise de position favorable au C.G. de la part des portugais - qu'apparemment rien ne destinait à prendre un chemin différent de celui ,de leurs frères de l'état espagnol- est d'autant plus important qu'il s'agit pour Marx et Engels de préparer le terrain pour mener l'attaque que l'on espère définitive au Congrès de La Haye: la section locale de Lisbonne devient sans que les internationalistes portugais eux-mêmes s'en rendent compte - au moins jusqu'au mois de juin - en quelque sorte une pomme de discorde de premier ordre au niveau international 42.
Un aspect secondaire, mais non moins important: vu l'interdépendance et l'affinité des mouvements au niveau péninsulaire, qui comme nous avions l'occasion de le voir, a été à l'origine même de l'entrée des idées internationalistes au Portugal - les luttes en cours en Espagne sont directement transplantées au pays voisin.
Une étude approfondie de la correspondance internationale disponible vérifierait peut-être la validité de 1'amalgame traditionnellement admis dans l'historiographie, consistant à plaquer sur les pays arriérés, dotés d'une forte proportion d'influences à prédominance rurale, un développement qui, sur le plan idéologique, tendrait à absorber nécessairement les idées fédéralistes et à repousser par contre - soit disant de par une prédisposition spontanée l'autoritarisme formulé par le courant marxien 43.
41 Pour la crise voir aussi M. Molnar, « Quelques remarques à propos de la crise de l'Internationale en 1872», dans La Première Internationale, L'Institution, L'implantation, Le Rayonnement, Colloques [ ... J, C.N.R.S., Paris 1968, pp. 427 et suiv., pp. 434 et suiv; et Freymond, préface, pp. XI et suiv.
42 A ce propos l'affirmation de M. Molnar (op. cit.) ne nous paraît pas caractériser entièrement l'enjeu: « Notons aussi que le camp du Conseil Général compte, vers 1872-1873 encore quelques sections isolées en Italie et des 'fédérations' soit fictives soit minuscules, en Angleterre et au PortugaL»
43 M. M01nàr, op. cît., pp. 434 et suiv.
492
+
La Première Internationale au Portugal, vue à travers la Correspondance [ ... J
Des informations reçues de Lisbonne sur l'activité des sympathisants de l'Alliance dans ce pays sont le motif pour lequel finalement Lafargue se décide à passer par Lisbonne avant de rentrer à Londres:
« Le cons[eil] féd[éral] [il s'agit du C.F. espagnol] fit alors une circulaire privée dont je nai pas eu de connaissance, dans laquelle il dénonçait Morago et ses tendances; en réponse, le cons[eil] féd[éral] reçut de Portugal des lettres précieuses, car il paraît que la même difficulté ait existé là-bas. Avant de quitter le continent, je passerai par Lisbonne et tâcherai d'avoir des détails circonstanciés. » 44
Entretemps le Conseil fédéral s'était déjà prononcé pour la dissolution de l'Alliance, décision purement formelle - aussitôt transmise au Portugal d'après la lettre de Lafargue du 29 mai -<J. Conjointement avec la circulaire éditée au nom du C.G. sur «lys prétendues scissions dans l'Internationale », réquisitoire marxien contre les agissements des adeptes de l'Alliance dans les divers pays, surtout en Espagne que l'on a reçu au Portugal, cette décision a dû provoquer un premier processus de réflexion 46.
Les suppositions exprimées par Lafargue au mois d'avril étaient bien justifiées: sous l'impulsion de Morago qui, à la suite de querelles internes avec ses compatriotes, avait donné sa démission du Conseil fédéral durant son séjour au Portugal, où il resta même après le retour de Lorenzo et Mora en Espagne 47, les débuts de l'A.I.T. s'effec-
44 P. Lafargue à F. Engels, Madrid, 29 mai 1872, dans Botttgelli. 45 « Compaiieros de la secci6n de la A[ ... ])} de Lisbonne, (Madrid) 1er juin
1872 (= Paul Lafargue à F. Engels à Londres, (Madrid) 2 juin 1872, dans Bottigelli, pp. 473 et suiv.).
46 Dans « Les prétendues Scissions» on ne trouve néanmoins pas d'allusion à la situation au Portugal.
47 Le départ des deux derniers se situe vers le 21-24 août (cf. Lorenzo, op. cît., note 77; M. Nettlau, La Première Internationale, p. 43). D'après Nettlau (Anarchie, p. 472) Morago reste « einige Wochen oder sehr wenige Monate» au Portugal. Pour des informations sur le fond des différences à l'intérieur de la section espagnole, cf. Actas, l, pp. 68 et suiv. Lorenzo (op. cit.) les situe au niveau personnel, hypothèse reprise par Nettlau. C'est pourtant Morago lui-même qui, dans une lettre « A los individuos que componen el Consejo de Redacci6n de 'La Federaci6n'» (La Federaci6n, 11 août 1872, dans C. E. Lida, op. cit., pp. 273-277) soutient le fond politique des dissidences. Une brochure allianciste de 1872 (voir infra, note 48) explique les premières dissidences personnelles par une attitude déplaisante de Mora par rapport aux ouvriers: «Una vez en Lisboa éstos se aumentaron a consecuencia deI abandono y dejadez deI senor Mora, que en vez de cumplir con su deber como secretario· deI Consejo federal, se ocupaba en ir a admirar la puesta deI sol, y, para proporcionarse una nueva emoci6n aguardar su salida, y en extasiarse, las noches de luna en las pintorescas orillas deI rajo.» (p. 299).
493
Bernhard Bayerlein
tuèrent sous le sigle de l'Alliance bakouninienne 48. Cette influence se faisait sentir jusque dans l'adaptation des principes fédéralistes à l'organisation des sections, ces dernières étant formées de «nucleos» comportant dix membres et organisées également en «sections mixtes» (<< secç6es vârias ») dont le recrutement n'était soumis à aucun critére de sélection qu'il soit de profession ou de classe 49.
L'origine allianciste transparaît dans une brochure faite de la main de Garcia Vinas, membre du C.f. espagnol dans le but de se défendre contre l'accusation portée par le C.G. d'avoir essayé de monter une société secrète au niveau international et où il avoue:
«Vous savez très bien que la Alianza, société secrète fut fondée en Espagne, sans aucune immixtion extérieure et que c'est en Espagne que son programme et son réglement furent établis. Vous savez que cette société n'avait d'autres sections que celles d'Espagne et de Lisbonne et que son action se limitait à ce cercle, quelque désir que nous ayons pu avoir de l'étendre d'avantage. »50
46 D'après Nettlau (Bakunin und die Internationale in Spanien, cit., pp. 274 et suiv.) l'initiative allianciste ne repose pas uniquement sur Morago mais inclut par contre Mora et Lorenzo. La source indiquée à ce sujet, que nous trouvons reproduite dans une brochure «allianciste» paru en 1872 (<< Cuestion de la Alianza », La Federaci6n, Barcelona, s.d., IISG, Amsterdam, pub. dans C. E. Lida, Antecedentes e desarrollo deI movimiento obrero espanol (1835-1888), textos y documentos, Madrid 1873, pp. 289-332) une lettre de Mora aux membre de la A. (donnée dans la brochure comme «Alianza »), écrite à Lisbonne, du 10 août 1871, permet en effet une telle interprétation: «[ ... ] hemos logrado constituir una seccion de la A[ ... ] en esta ciudad, a la que seguini pronto la constitucion de la Federacion local lisbonense de la M ... ] 1[ ... ] T[ ... ]. Este sera el gérmen de la nueva idéa en la region portoguesa, y esperamos que dé excelentes resultados, pués las noticias que tenemos de Oporto, Coimbra, Ebora y otros pueblos, son buenas. Los elementos de que se compone esta joven A[ ... ] no pueden ser mejores; pues relmen a una inteligencia nada comun, una vasta instruccion y mucha influencia en el naciente partido republicano portugués, por 10 cual no es mucho esperar que éste sea verdaderamente revolucionario, es decir, colectivista.» (pp. 319 et suiv.).
49 Voir lettres de Mora à Engels, 12 août 1871, et de Nobre França à Engels, 24 juin 1872, dans Treze cartas, déjà cit.
50 [Garda Vinas,] Cuesti6n de la Alianza, Barcelona 1872; part. citée dans Archives Bakounine / Bakunin-Archiv, publiées par A. Lehning, A. J. C. Rüter, P. Scheibert (pour l'IISG, Amsterdam), Textes établis et annotés par A. Lehning, t. II _ Michel Bakounine et les conflits dans l'Internationale 1872, Leiden 1965,
p. XXI.
494
Q
La Première Internationale au Portugal, vue à travers la Correspondance [ ... ]
L'évocation d'un « grupo de la Alianza de la democracia socialista» par Lorenzo en se référant au Portugal 51 est confirmé plus tard par Nobre França lui-même: dans sa lettre du 24 juin il donne des indications plus précises et parle de l'existence de deux sections de l'Alliance au Portugal en 1871 et au début de 1872 52.
Etonnante cette autre prise de position de la part d'un allianciste espagnol qui met à jour - même pas un an après - l'échec de la société au Portugal. Francisco Tomâs, secrétaire du Conseil fédéral espagnol doit avouer, non sans quelque rancune, dans une lettre destinée au Pensamento Social:
«[ ... ] puisqu'il est très regrettable que peut-être ceux-mêmes qui firent partie de la Alianza de Lisbonne, s'occupent ae cllscrediter une association à laquelle ils doivent d'être internationaux, parce que vous ne devez pas ignorer que les premiers internationaux de Lisbonne étaient alliancistes.» 53
En effet, la section portugaise s'éloigne progressivement pendant l'été de 1872 du courant bakouninien pour adopter - au moins formellement - une position «marxienne ». Ce revirement s'avère être un point de repère méthodologique important dans la mesure où il va à l'encontre du schème d'interprétation de l'histoire sociale traditionnelle.
Penchons-nous sur la correspondance internationale afin de trouver éventuellement une explication qui permettrait ou bien de considérer l~ développement portugais comme une simple exception à la règle, ou bIen de mettre en question fondamentalement le schéma traditionnel.
C'est relativement tôt, à partir du mois de juin, que la section portugaise prend une position favorable en soutenant par là la conception marxienne pour un C.G. comme organe centralisé et centralisateur. Cette conception est vivement contestée par le courant antiautoritaire et oppositionnel en général, qui, sans mener pourtant déjà à cette époque une politique d'opposition « à fond », s'efforce de réduire
• 51 • A. Lorenzo (O? cit., p. 164) caractérise l'orientation générale du groupe alhanclste comme SUlt: «[ ... ] el segundo, en constante comunicacion con ellos por formar 10 que en la Federacion regional espanola representaron las secciones varias, seria como un grupo de estudios sociales que impulsaria las ciencias desligando las de las torpes ataduras con que el dogma, el privilégio y la autoridad las sujetan en las universidades y dada a los trabajadores la verdad pura.}}
52 Nobre França à Engels, 24 juin 1872, dans Treze cartas, déjà cit. 54 F. Tomas à la rédaction de 0 P.S., 24 mars 1873. Dans M. Nettlau, La Pre
mière Internationale, p. 166.
495
Bernhard Bayerlein
le C.G. à une simple fonction de coordination et de propagan~e. On simagine assez bien l'accueil triomp~al fait à la ~omm~mcatlOn ~~ Nobre França du 24 juin qui juge «fatalement» necessalfe le C.G. . Dans le protocole des séances du C.G. on peut lire à ce sujet:
« Engels a reçu du Portugal une longue lettre do~nant des détai~s statistiques sur la classe ouvrière. Les internatlOnaux portug~ls se déclarent en complète communion d'idées avec le C.G. qu'Ils déclarent indispensable.)} 55
C'est également au mois de juin que Carlo Gafiero, un des pionniers de l' A.l.T. en Italie, dans une lettre amère de rupture personnelle et politique avec Engels lui avoue - ne serait-ce qu'indirectementl'échec anti-autoritaire au Portugal:
«Nous savons quelle communauté de sentiments nous avons avec la France révolutionnaire, avec la Belgique, avec le Jura, avec les peuples slaves, nous savons quelle communauté nous aurons avec le Portugal, à mesure que se développera dans ce pays l'idée révolutionnaire.)} 56
L'adhésion portugaise reste pourtant, jusqu'au mois de juin/juillet 11572 réduite à un consentement défensif des internationaux les plus aevoués. Elle est encore loin d'être engagement actif et combat ouver.t pour les conceptions marxiennes en matière d' organisat.ion et de polItique. Nobre França caractérise assez bien une telle attitude dans u~e lettre envoyée à la Nueva Pederaci6n Madrilena, fondée pa~ le~ ~ISciples de Lafargue en opposition à la majorité du ConseIl feder~l espagnol en été 1872 où est décrite l'attitude prise par les portugais par rapport aux mesures prises contre l'Alliance:
«Alguns de nos, que formavamos uma_ min?ria,. discutimos em reuniao privada a dissoluçao da secçao ahancista, proposta a que nao demos seguimento so porque estavam au~entes alguns indivîduos. Continuamos, pois, a fazer parte da Ahança, apesar da repugnância que manifestamos nas suas proprias secçôes, às quais atribuîmos, alias, pouquîssima importância.)} 57
54 Ibid. 55 Séance du Sous-Comité du Vendredi 5 juillet 1872, dans Minutes, octobre
1871-août 1872. 56 Carlo Cafiero à Friedrich Engels, 12 juin 1872, publ. dans Freymond,
t. III, pp. 298-306, en part. p. 303. . . . 57 Nobre Franca à Nova Federaçao Madrilena, 13 JanVIer 1873, La Emancr-
paci6n, Madrid, 1er • février 1873; cf. Carlos da Fonseca, Ruptura, pp. 234 et suiv.
496
"4
1
Je,
La Première Internationale au Portugal, vue à travers la Correspondance [ ... ]
C'est précisément au mois de juin, que Fontana reçoit une lettre de Bakounine, datée du 7 juin, que ce dernier écrivit - vraisemblablement en présence de C. Cafiero - en Italie, mais à laquelle les portugais ne répondent pas. Il ne reste aucune trace de cette communication, que Lafargue, pendant son séjour, essayait de se procurer 58.
L'affirmation de Nobre França, confirmée par de multiples appréciations contenues dans la correspondance internationale, fait référence à une structure de motivation complexe parmi les internationaux au Portugal, à laquelle on ne rendait pas justice à partir du moment ou l'on partirait d'une différenciation de principe entre les deux forces d'action en jeu. Un tel procédé méthodologique se baserait alors sur un schématisme de notion et d'organisation, qui, non seulement ne cernerait pas la réalité du processus contradictoire en cours, mais encore ne saurait pas apprécier à sa juste valeur ses résultats.
Ainsi la résistance contre l'Alliance ne peut être identifiée en même temps à une assimilation globale des principes marxiens largement inconnus au Portugal jusque dans leurs fondements.
Dans cette mesure le Portugal -loin d'être une exception à la règle - n'échappe pas à une tendance contradictoire généralisée au niveau international, sauf que cette même tendance y est renforcée. La contradiction se manifeste en permanence jusqu'en 1873. Les lettres envoyées à Engels sont quand il y est fait allusion à des questions plus complexes d'ordre théorique - ce qui n'est pas souvent le cas - empreintes du manque de connaissances théoriques et d'expériences pratiques, ce qui rend difficile un processus d'analyse 59.
Les quelques points suivants en sont l'illustration: França a VISI
blement du mal à appréhender le problème de la relation dialectique entre «révolution politique» et «révolution économique»; l'objectif
58 Des allusions à la lettre dans Archives Bakounine, t. II, p. XXVII; M. Netlau, Bakunin e l'Internazionale, cit., pp. 340 et suiv.
59 A ce propos il vaut la peine de suivre de plus près ce que 0 Pensamento Social publie par rapport à l'AIT. Les seuls textes de base d'une certaine valeur d'analyse sont premièrement l'Adresse Inaugurale de l'AIT rédigée par Marx et deuxièmement le Manifeste Communiste (0 P.S., n° 44-46, février-mars 1872, resp. n° 46 et suiv.). Tandis qu'un premier article qui paraît sur les fondements de l'AIT souligne l'unité de l'Internationale autour des statuts formulés par Marx (0 P.S., n° 1), est publié (dans le n° 10, avril 1872) un manifeste fédéraliste, rédigé par le Conseil fédéral espagnol (AIT, Manifesto, Conselho Federal, Regiào hespanhola). Nous rencontrons, pour la première fois, une prise de position programmatique contre la tendance anti-autoritaire, sous la forme d'une critique émise contre la fédération jurassienne, dans le n° 12 (mai 1872). Voir à ce sujet en général: A. Margarido, A introduçao do Marxismo em Portugal, 1850-1930, Lisboa 1975.
497 32
Bernhard Bayerlein
stratégique de la révolution dans sa forme étatique reste dans le vague, ainsi que la conception de la «république fédérale », dont surtout les membres de l'A.I.T. à tendance intellectualisante (Antero, Oliveira Martins, etc.) se faisaient les défenseurs ardents.
Des questions d'ordre «tactique» soulevées par França touchent au problème de la «révolution légale» et surtout à celui de l'autonomie du combat ouvrier par rapport aux autres classes sociales, notion qui est souvent confondue - probablement par une opposition quelque peu démesurée à la conception anarchiste - avec celle de ... l'isolement individuel (etc., etc.) 60. Pour ce qui est de la question centrale, qui différencie les deux camps au niveau international, il s'agit de l'apolitisme resp. du mode d'intervention politique, les « marxiens» portugais adoptent - comme Lafargue le rapporte à Engels à partir de sa propre expérience au Portugal au mois d'août - une position plutôt abstentionniste.
« Le Parti démocrate-socialiste allemand les tracasse beaucoup ici, et les politiques, pour les combattre leur citent toujours ce parti; [ ... ]. Dans l'lnt[ernationale] il Y a quelques hommes beaux parleurs qui rêvent la députation et la formation dans le parlement d'un parti socialiste et ces hommes ne voudraient faire servir l'lnt[ernationale] qu'à leurs fins personnelles: à cause de cela, les éléments les meilleurs d'ici sont opposés à toute action politique avant la constitution de la classe ouvrière.}) 61
Les commentaires de Lafargue nous signalent en même temps des éléments, capables de réduire ces contradictions, d'une portée apparemment insurmontable. Si les internationalistes portugais les plus dévoués se montrent hostiles à toute espèce d'intervention politique, leur réticence s'explique facilement par la connaissance et l'expérience qu'ils
60 Nobre França à Engels, 24 juin et 12 juillet, dans Treze cartas, cit. La seule tentative d'une large divulgation des nouvelles idées est faite en forme d'une brochure, rédigée par Antero de Quental (0 que é a Internacional, Lisboa, Typogr. do Futuro, 1871, 30 pp.). C'est sans aucun doute à cause de son emp~ei~te proudhonienne, qu'elle est aussitôt transmise en espagnol par une « commISSIOn de propagande}) anti-autoritaire espagnole (Lo que es la Internacional. Folleto escrito por la comissi6n de propaganda deI nûcleo organizador de la lnternacion~l en Lisboa. Traducida al castillano por la Comisi6n de propaganda deI Consejo local de la federaci6n de las secciones madrilefias [ ... ], Madrid 1872). Un petit traité historique et théorique, valable vu son contenu objectif, travail unive~sitaire à la faculté de droit de l'Université de Coimbra, ne paraît pas de ce faIt avoir connu une grande diffusion (Manuel Paes de Figueredo Moraes (e.o.), A Internacional e 0 Socialismo, Estudos feitos na aula de direito administrativo da Universidade de Coimbra, 1871-1872, Coimbra 1872).
61 Lafargue à Engels, Lisbonne, 8 août 1872, dans Bottigelli.
498
La Première Internationale au Portugal, vue à travers la Correspondance [ ... ]
avaient des forces politiques ayant traversé le Portugal jusque là. Ces courants sont assimilés avec raison aux tendances bourgeoises et « socialisantes» - qui sous forme du courant constitutionnaliste se distinguent par une pratique d'opportunisme parlementaire 62. Une certaine tendance à l'anti-autoritarisme trouve de par là sa correspondance historique à travers l'opposition contre une telle attitude d'acceptation de l'état, l'état en soi devenant dans leur conscience l'essence même de l'autorité. Il faut pourtant souligner que l'évolution de ce processus n'est pas poussée en avant en conséquence directe des discussions internationales (celles-ci n'y jouent qu'un rôle d'accélération). La cause en est bien plutôt à rechercher dans l'expérience pratique du mouvement ouvrier portugais lui-même. Seuls des facteurs inhérents à celui-ci peuvent donc nous fournir les éléments aptes à expliquer le problème de l'orientation prise par les internationalistes portugais les relations organiques au niveau international y étant en fonction.
Or, même si la période pionnière de l'A.I.T. au Portugal de juin 1871 à mars 1872 est assez bien illustrée soit par des récits des contemporains (A. Lorenzo, Nobre França, etc.) 63, soit par des œuvres monographiques et documentaires 6\ il convient néanmoins de les élargir par quelques remarques supplémentaires pour mieux situer la fonction réelle exercée par le C.G. On peut affirmer avec Carlos da Fonseca 65
que le nombre restreint en soi de la poignée d'internationalistes au Portugal ne peut servir de base pour expliquer l'essor d'une association de résistance qui sous la forme de la « Fraternidade Operâria» débute avec 73 adhérents en janvier 1872 pour atteindre 1.500 en avril/mai et finalement 30.000 membres en décembre de la même année, qui se mêlent à ceux des sections proprement dites de l'A.I.T., association dont l'orientation tend à absorber des fonctions coopérativistes et mutualistes. La création de la F.O. peut être attribuée exclusivement à l'initiative du noyau internationaliste. Même si les chiffres ne correspondent pas tout à fait à la réalité, seule l'existence d'une prédispo-
62 Nobre França à Engels, 24 juin 1872, dans Treze cart as, cit. 63 A. Lorenzo, op. cit., pp. 62 et suiv.; Nobre França, op. cit.; Magalhiies
Lima, 0 Socialismo na Europa, Lisboa 1892; cf. F. Mora, Historia deI Socialismo Obrero Espaiiol, Madrid 1902, pp. 86 et suiv.; César Nogueira, Notas para a hist6ria do Socialismo em Portugal (1871-1910), t. l, Lisboa 1964, pp. 15 et suiv.
64 Voir surtout les œuvres de Carlos da Fonseca citées: Ruptura et Origem, l 'histoire du socialisme par César Nogueira et - dans une moindre mesurer:ésar Oliveira, 0 Socialismo em Portugal, 1850-1900, Porto 1973.
65 Carlos da Fonseca, A origem, pp. 53 et suiv., p. 68.
499
Bernhard Bayerlein
sition du mouvement ouvrier à entamer la voie de la lutte de classes explique l'indéniable succès 66.
«Estamos pois em presença de factores conjugados à ?rigem e que nao podemos separar: 0 movimento real do opera~Ia~o português na procura da sua autonomia, tentando m~tena~Izar as suas aspiraçoes e 0 desenvolvimento das perspectIvas mternacionalistas. » 67
Ce qui ressort également des récits de Nobre ~rança à .E~g~ls, c'est que l'Internationalisme ouvrier au Portugal peut etre consIdere co mm: étant d'origine et d'impulsion purement ouvrières, un groupe compose exclusivement d'ouvriers soutenant inconditionnellement - dans la mesure du possible - les thèses internationalistes (Nobre França lui-mêm:, Tedeschi, Oretti, Tito, Lisboa, etc., auquel se joint Fontana, .fu~ur se~retaire de la F.O. avec Maia et Monteiro) est clairement dlstmct d un groupe d'intellectuels tendant à utiliser le cadre de l'.I~ternat~onale ?a~; une perspective républicaine bourgeoise (Braga, FushmI, Martms, ReIS) . Indiquons dans ce contexte qu'Antero de Quental -d?nt l'adresse s~rvait, d'après les indications de Mora, de contact avec 1 A.I.T. portugaIse des premiers temps 69, avait reçu selon le témoignage de Nobre França une lettre d'Engels qu'il avait laissée sans réponse 70. •
L'époque de la «Fraternidade Opèrâria », «talvez a [ ... ] malS brilhante do movimento operârio no nosso paiz », d'après César Nogueira 71, peut Flinsi être considérée comme étant le refle:, prati~ue de l'intervention internationaliste et donne pour la premlere fOlS aux ouvriers portugais les moyens d'agir en tant que classe indépendante.
66 Le constat d'effectifs, rapporté par Nobre França ~ Engels en aoû,t 1872 (Nobre França à Engels, 23 août 1872, dans. Treze carta~, cIt.) donne un developpement progressif par l'entrée de 200 ouvners par mOlS.
67 Carlos da Fonseca, A origem, p. 53. 68 Contrairement à des propos avancés (e.a.) par César Oliveira, mettant en
relief l'importance du secteur intellectuel, «avant-gardiste», c'est préci~ément l~ correspondance internationale qui fait ressortir un éloignement progreSSIf -,force par le noyau internationaliste ouvrier - des éléments de. ce genre,. ten~ant a des propos bourgeois-réformistes, dans la mesure. où ,la sectIOn es~ onen tee dans un sens purement classiste. Dans cette mesure, Il n.es~ pas ~ortUlt. que la «Fraternidade Operaria » ne trouve de la part de César ?hveIra qu un traItement passager.
69 F. Mora à F. Engels, 12 août 1871, op. Clt. . 70 Ainsi Nobre França (à Engels, 24 juin 1872, op. Clt.) commente: «Nem
elle nem os socialistas, sao internacionaes.» . '71 César Nogueira, A primeira Internacional; Conferência que se devena
effectuar a convite da Federaçao Municipal Socialista do Porto, na Casa do Povo Portuense, em 28 de septembro de 1916, Lisboa 1916, p. 27.
500
4
•
La Première Internationale au Portugal, vue à travers la Correspondance [ ... ]
Le dépassement du pluriclassisme signifie en même temps l'amorce de la liquidation du coopérativisme traditionnel qui trouvait son expression dès 1850 dans le «Centrû Promotor dos Melhoramentos das Classes Laboriosas » ou en 1870 il est déjà question d'une révision des statuts « tendo por bases os princîpios da Internacional » 72. L'attraction de la nouvelle méthode qui donne lieu à la formation de la F.O. en fin de 1871 est relaté de façon significative par 0 Trabalho de mars 1872 :
«Nos fins do ano passado 0 Centro Promotor havia, em consequência de renhidas discussôes sobre a lnternacional e a Comuna de Paris, tomado um caracter socialista na acepçao cientifica da palavra.» 73
Ainsi la pierre de touche, qui démontre aux internationalistes portugais la viabilité potentielle d'un combat autonome menant en même temps à la différenciation des camps ouvriers et républicainsbourgeois est constituée sans aucun doute par la Commune de Paris, analyse confirmée en rétrospective par Nobre França dans une lettre à Engels:
«Quand il y eut ensuite la Commune, notre petit groupe commença à discuter de questions sociales.» 74
La répugnance des internationaux portugais envers la tendance anarchiste s'ancre elle aussi dans l'expérience pratique, dont il faut détacher comme étant l'élément préponderant la spectaculaire «Affaire Bonança ». Ce dernier, ex-curé d'origine aristocratique faisait parti du groupe allianciste et était à l'époque de la constitution de la F.O. en commun avec Antero et Felizardo de Lima initiateur et propulseur d'une association coopérativiste pluriclassiste, 1'« Associaçao Protectora do Trabalho Nacional» qui de par son programme s'engageait dans la voie d'une république démocratico-sociale tout en essayant d'utiliser 1'.A.I.T.
72 César Nogueira, Notas para a Historia do Socialismo [ ... ], p. 13. 73 Movimento operario, Portugal), 0 Trabalho (Jornal Republicano), Lisboa,
n° 9, mars 1872. C'est dans ce journal que l'on trouve un vrai caleïdoscope des luttes menées, au Centre Promotor, entre alliancistes et républicains d'une part et internationalistes «marxiens» d'autre part. Après diverses tentatives, ces derniers reussissent à faire adopter, par le Centro Promotor, des statuts «revolutionnaires» dans la mesure ou ils consignent l'autonomie de classe des travailleurs, ce qui menait à la désertion du Centre par les éléments bourgeois et petit-bourgeois (cf. « Projecto de Estatutos do Centro Promotor», 0 Trabalho, n° 12, mars 1872, signé e.a. par Nobre França et José Fontana; pour les luttes antérieures voir « Centro Promotor», 0 Trabalho, n° 8, février 1872, également n° 11 et 12, mars 1872).
74 Nobre França à Engels, 24 juin 1872, op. cit.
501
Bernhard Bayerlein
à ses fins en général et à des projets de complot politique, fédéralistesbourgeois, dirigés par le Comte de Peniche en particulier.
Un premier signe annonciateur de cette affaire: l'expulsion de deux membres de l'A.I.T., rapportée par Nobre França à Engels le 27 juillet:
«[ ... ] um dos quais esta ou esteve em relaçôes corn Morago. Andava formando secçôes penicheiras e recrutando gente para uma revolta que se espera de um momento para outro.» 75
Il paraît hors de doute que des forces alliancistes étaient mêlées à cette affaire - ainsi p. ex. M. Nettlau ne cache pas ses sympathies pour ce mouvement -, ces dernières utilisent le journal édité par Bonança - 0 Trabalho 76 _ pour combattre à travers 0 Pensamento Social les sympathisants du C.G. C'est précisément en juin 1872 que paraît - pour n'en citer qu'un exemple - dans le premier numéro un article attaquant, au nom du combat pour une «Republica democratica-social» constituée elle par une «federaçao das comunas », la F.O. la traitant d'organisation traîtresse aux intérêts ouvriers. Pour ce qui est du choix des arguments, on puise d'une manière forcée à pleines mains dans le réservoir anticommuniste traditionnel, allant jusqu'à accuser les internationalistes de vouloir détruire toute législation, précipiter le désordre et même d'abolir la famille (!) 77. Nobre França ne semble pas avoir compris tout de suite la tentative Ide captation des ouvriers par le groupe de Bonança qui, à cette fin, se prétendait « internationaliste, en relation avec [ ... ] Londres ». Cette prise de conscience n'a lieu qu'après l'exacerbation des attaques menées contre la F.O. et la mise au jour consécutive des «intrigues» 78.
75 «Penicheiros» = dér. du «Conde de Peniche»; Nobre França à Engels, 27 juillet 1872, op. cit.
76 Dans cet organe, les conceptions ouvertement bourgeoises s'entremêlent souvent à des bas-fonds anarchisants. Ainsi, nous trouvons dans son n° 28 du mois de juin 1872 la convocation, émise par le Conseil Général, du Congrès de La Have. Un article paru dans le n° 24 (également en juin) met en garde les travailleurs devant des «confusionnistes» qui mènent «une guerre infâme», «covarde e desleal», se présentant «comme délégués de l'Internationale, comme agents de la Commune». Les mêmes travailleurs sont exhortés à lutter contre 0 Trabalho en tant que «journal républicain» au nom de la lutte pour «le communisme, l'anarchie» (<< A polîtica das classes operarias», 0 Trabalho, n° 24).
77 « Acautelemo-nos», 0 Trabalho, n° 25, juin 1872. 78 Nobre França à Engels, op. cit., probablement, le noyau internationaliste
espérait-il pouvoir influencer le journal en conséquence d'une victoire politique contre l'ATPN au profit de la FO.
502
q
La Première Internationale au Portugal, vue à travers la Correspondance [ ... ]
L'affaire Bonança acquiert une envergure internationale dans la n:es.ure ~ù elle con~titue un des éléments servant d'indice dans le réquisItOlre fmal dresse contre les adeptes de Bakounine au Congrès de La Haye, indice repris dans la fameuse brochure rédigée par Marx, Engels et Lafargue sur « L'Alliance de la démocratie socialiste et l'Association Internationale des Travailleurs» 79.
Ces événements étaient aussitôt discutés pendant les réunions du Conseil Général.
«In Lissabon wurden mmge Portugiesen, Mitglieder der Internationalen, von Morago in die AlIianz aufgenommen. Da er jedoch fand, dass diese neuen Mitglieder ihm nicht genügend Garantien boten, gründete er ohne ihr Wissen eine andere AlIianzistengruppe, die aus den schlechtesten, den Reihen der Freimaurer entnommenen Bourgeois- und Arbeitere1ementen bestand. Diese neue Gruppe, zu der ein der Kutte entlaufener Pfaffe Bonança gehorte, wollte die Internationale in Sektionen zu je 10 Mitgliedern organisieren, die unter ihrer Leitung den Planen des Grafen von Peniche dienen sollten und die dieser politische Intrigant in einen Schwinde1-Aufstand zu verwickeln verstand, des sen einziger Zweck war, ihm zur Macht zu verhelfen. Angesichts der alIianzistischen Intrigen in Portugal und Spanien zogen sich die portugiesischen Internationalen von dieser geheimen Gesellschaft zurück und verlangten auf dem Haager Kongress ihre AusstoEung aus der Internationalen aIs eine MaEregel des Gemeinwohls.» 80
Ce serait surestimer l'apport personnel de P. Lafargue que d'attribuer le ralliement de 'la section portugaise aux principes marxiens à sa seule et unique influence, bien que celui-ci, c'est ce que l'on peut déduire de sa correspondance, semble avoir réussi pendant son séiour à Lisbonne à renforcer définitivement cette tendance sur la base du développement des événements 81.
79 Londres-Hambourg 1873; cf. l'édition allemande: Ein Complot gegen die Int~rnat~?nale Arbeit.er-Association. lm Auftrag des Haager Congresses verfaf1ter Bencht uber das Trelben Bakunins' und der Allianz der sozialistischen Democratie Braunschweig 1874, dans MEW, t. XVIII, p. 364. '
80 Voir, à ce sujet, supra, note 44. La référence du Conseil Général Séance du Sous-Comité le 4 août 1872, dans Minutes, 1871-72, pp. 314 et suiv. '
81 C'est Nettlau qui soutient cette thèse dans son Histoire de l'Anarchie. D'~l?rès lui, la lettre de Nobre França du 24 juin ne relève pas d'une attitude cntIque envers Morago: « [ ••• ] und man sieht, daE gegen die Anhanger des Grafen Peniche und Bonança keine scharfe Grenze besteht. » (M. Nettlau, A~archie, p. 475). Pour le grand historien, c'est en conséquence d'une politique divisionniste de la part du Conseil Général, poussé par P. Lafargue et secouru par «une intrigue» de Nobre França, que 1"" -portugais seront gagnés au «marxisme». Plein de hargne,
503
Bernhard Bayerlein
III
LE POIDS SPECIFIQUE DE LA SECTION PORTUGAISE AU PLAN INTERNATIONAL:
LE CONGRES DE LA HAYE (SEPTEMBRE 1872)
L'importance internationale de la jeune section culmine au Congrès de La Haye qui - signe de la victoire marxienne - renforce la position du C.G. Y est voté également le fameux amendement aux statuts de l'Internationale, définissant comme tâche centrale du mouvement internationaliste « la constitution du prolétariat comme parti politique» 82.
Représentés par P. Lafargue, les portugais y jouent un rôle considérable qui s'affirme lors du processus de scission qui suit. Contrairement à l'intention initiale de ne pas envoyer de délégués au Congrès - justifiée par Nobre França par l'amorce tardive - à partir du début juin -d'un travail d'organisation 83 - c'est finalement le gendre de Marx qui reçoit les pleins pouvoirs 84. Ce dernier avait encore suggéré début août aux portugais de désigner F. Engels en personne, qui sera finalement mandaté au Congrès par la section de Breslau (Silésie) ainsi que celle de New York 85. Le rapport officiel présenté par le C.G., rédigé
il commente: «[ ... ] aber ich kann die weitere Entwicklung nur in wenigen Worten geben, da es sich eben um frevelhafte ZerstQrung des kaum begonnenen handelt. [ ... ]. Diesen jungen Portugiesen lag teils die foederale und soziale Republik am nachsten, teils Gewerkschaftsorganisationen [ ... ].» (p. 476). Il serait important, dans ce contexte de se référer à l'exclusion de deux membres de la section «mixte» communiquée par Nobre França le 27 juillet, information aussitôt dicutée lors d'une séance du Conseil Général du 4 août 1872.
82 Association internationale des Travailleur, Résolutions du Congrès Général tenu à La Haye du 2 au 7 septembre 1872, Londres 1872.
83 Nobre França à Engels, 27 juillet 1872, op. cit.; c'est là qu'il parle de l'intention d'Antero de se rendre au congrès, intention à laquelle il s'oppose politiquement, vu qu'Antero «confessa que historicamente nao se pode realizar uma revoluçao como a concebemos, crendo que a emancipaçao dos trabalhadores sô se podera efectuar em tempos remotos por meio de evoluçôes politicas.»
84 Nobre França à Engels, 23 août 1872, op. cit. 85 Lafargue à Engels, 8 août 1872, op. cit.; Lafargue représentera en même
temps la Nouvelle Fédération madrilène et «une autre fédération espagnole ».
Cf. à ce sujet le compte-rendu le plus détaillé qui existe sur le congrès, établi à partir d'un protocole non officiel, de la main de F. A. Sorge, The first International. Minutes of the Hague Congress of 1872 wîth relates documents, Madison (USA) 1958 (Edited and translated by Hans Gerth); la traduction française dans Freymond, t. II, pp. 326-372. Pour la réception portugaise, voir «Notîcias sobre 0
Congresso da Haya », 0 Pensamento Social, n° 26, 13 oC'·tnbre 1872.
504
La Première Internationale au Portugal, vue à travers la Correspondance [ ... ]
au mois d'août, très pauvre en matière d'information comme tous les rapports de ce genre, soient-ils officiels ou confidentiels, se borne à tenir compte - quant au Portugal- du démarrage de l'Internationale dans ce pays 86.
Pour ce qui est du problème de la validité du mandat de Lafargue il ne peut être question de le mettre en cause, un soupçon de marchandage ayant été plus ou moins ouvertement formulé par les courants ennemis au C.G. 87
• Avec sa lettre du 23 août, Nobre França envoie à Engels un document approuvé lors d'une session du Conseil local de la section de Lisbonne servant en même temps de mandat impératif pour Lafargue - il est fort probable qu'il ait pris part personnellement à cette session - qui consomme la rupture officielle avec les tendances anarchisantes constituant une première mise au point définitive 88. La motion se prononce contre la convocation d'un congrès mondial « antiautoritaire» convoqué en opposition au Congrès de La Haye au nom d'une «Conférence des sections,italiennes» 89 sous le sigle du combat contre les agissements des bakouniniens en général. Ses signataires étant tous ouvriers, l'hypothèse se confirme selon laquelle c'est précisément ce secteur qui s'aligne sur les positions marxiennes à l'inverse de l'élément intellectuel petit-bourgeois.
«Tendo conhecimento pelos jornais das polémicas que têm sido publicamente provocadas pelos membros da Aliança da Democracia Socialista em divers os paises;
Considerando que a conduta da Aliança tem originado lamentaveis consequências para 0 prestigio da Associaçao Internacional dos Trabalhadores;
• 86 (~. Marx), Offizieller Bericht des Londoner Generalrats, verlesen in offent-ltcher Sztzung des Internationalen Kongresses zu Haag (rédigé fin août), dans MEW, t. XVIII, pp. 129-137.
87 Voir, par ex.: «Le Congrès de la Haye », Bulletin de la Fédération Jurassienne, n° 17/18, 15 septembrell el' octobre 1872; la liste officielle des délégués a été publiée dans 0 Trabalho, n° 39, septembre 1872, conjointement avec une dure critique au Conseil Général, traité de «dictatorial» et «pangermanique ».
88 «Mandato Imperativo da Federaçao Portuguesa para 0 seu delegado ao Congresso de Raia », Lisboa, 23 août 1872, La Emancipaci6n, n° 65, 14 septembre 1872; publ. pour la première fois par Alberto Pedroso, «0 mandato da Federaçao Portuguesa da AIT a Paul Lafargue », Seara Nova, n° 1591, mai 1978. Pour expliquer le contenu du «dandat» il suffit de faire référence à sa lettre à Engels du 8 août 1872 (op. cît.) ou il avoue avoir suggéré aux portugais de voter en même temps une demande de dissolution de l'Alliance.
89 Cf. Associazione Internazionale dei Lavoratori. Federazione Italiana, la Conferenza. Risoluzione, s.l. (1872) ; cf. une traduction française dans Freymond, t. III, pp. 286 et suiv.
505
Bernhard Bayerlein
Que 0 seu objectiva é dominar e desorganizar a nossa Associaçao e conduzir a classe trabalhadora para um fim especifico;
Que se ha um motivo para acusar 0 Conselho GeraI esta acusaçao deveria ter sido submetida à consideraçao das secçôes, resolvida no interior da organizaçao e sancionada pelo Congresso; [ ... ]
Por todas estas razôes nos propomos:
1. Relativamente à Aliança : Que ela seja declarada uma sociedade perigosa e alta
mente prejudicial para a emancipaçao economica da classe trabalhadora e que 0 Congresso deve actuar energicamente contra ela.
2. Relativamente às secçôes italianas: Que a sua resoluçao relativa à convocaçao de um Con
gresso GeraI seja considerada como uma violaçao do principio basico dos Estatutos que unem todos os membros da Interna-cionaI. "
L'importance de la section portugaise au congrès s'exprime en premier lieu par l'exploit de tactique et de propagande de l'adhésion des portugais aux conceptions du C.G. sur l'exclusion des « alliancistes " comme sur la question du parti ouvrier politique qui en est fait 90.
C'est Morago qui - si l'on peut dire - sert de bête noire au congrès. Ainsi Lafargue, pendant les débats, s'appuie sur la position portugaise pour défendre la nécessité du C.G. :
« Le citoyen Paul Lafargue [ ... ] déclare [ ... ] qu'à Lisbonne même, on est d'avis que si le Conseil n'existait pas, il faudrait l'inventer. ,,91
90 A part Nobre França, Daniel Alves, José Almeida e Santos, José Pereira et Santos Leite on trouve les signatures de Agostinho José da Silva et Celestino Aspra (= Aspr;), futurs dirigeants du P.S.O.P., resp. membre de la rédaction de o Protesto (voir à ce propos les éléments biographiques fournis par Carlos da Fonseca, A origem, pp. 179-198.
91 «Le Congrès de La Haye", La Liberté (Bruxelles), VI, n° 36, 8 septembre 1872; dans Archives Bakounine, pp. 323-328, en part. p. 324; cf. The first International. Minutes, cit.,; «Resolutionen des allgemeinen Kongresses zu Haag vom 2. bis 7. September 1872, V. ûberprüfung des Kassenberichts des Generalrats; dans MEW, 1. XVIII, p. 154.
506
La Première Internationale au Portugal, vue à travers la Correspondance [ ... ]
En tirant son propre bilan du Congrès, Engels souligne à l'encontre des doutes émis par le Conseil fédéral anglais et la fédération de Manchester, tous deux dissidents 92, l'alignement _« avec joie" des résolutions prises au Portugal 93. Il est soutenu dans cet effort par Marx lui-même 94 qui confirme d'ailleurs, dans une lettre au Volksstaat le mandat de Paul Lafargue 95. Le jugement des dirigeants internationaux est justifié dans la mesure où, après le congrès, nous trouvons dans les pages d'O Pensamento Social des analyses dont ressort l'identification intégrale avec les résolutions prises par la même occasion avec l'attitude d'Engels. Ce dernier garde son optimisme dans la mesure où il voit dans la diversification au niveau international, conséquence des décisions prises au Congrès sur la formation de partis nationaux, un procédé - et c'est là que les portugais concQrdent pleinement« ouvrant» de grandes perspectives» 96.
Contrairement au déroulement de fait du· Congrès, F. Tomas, dans une lettre envoyée au nom de la fédération espagnole à J. Fontana le 5 octobre 1872, attribue à tort aux portugais une attitude d'opposition, ce qui au·delà des procédés tactiques de part et d'autre 97, pourrait être attribuée au caractère particulier des relations au niveau ibérique, empreintes d'un procédé de diplomatie amicale. Ces relations tendent de
92 Voir British Federation of the International Working Men's Association, « Adress of the British Federal Council to the Branches, Sections, Affiliated Societies, and Members of the Federation" (London 1873); trad. dans Freymond, t. III, pp. 213-222.
93 International Working Men's Association, «The Manchester Foreign Section to all sections and members of the British Federation ", Manchester 1872; trad. dans Freymond, t. III, pp. 241-245; le texte signé par P. Zurcher, F. Kupper et O. Wyss est en vérité de la main d'Engels; cf. à ce sujet, F. Engels, «Die Manchester Foreign Section an alle Sektionen, und Mitglieder der Britischen Faderation» (communiqué, env. 21 décembre 1872), dans MEW, t. XVIII, pp. 197-201.
94 K. Marx, «Adresse des Britischen Faderalrats an die Sektionen, Zweige, anp:eschlossenen Gesellschaften und Mitglieder», London, 23 décembre 1872, dans MEW, t. XVIII, pp. 202-207 et K. Marx, «Antwort auf das neue Zirkularer angeblichen MaioriHit des Britischen Faderalrats» (environ moitié janvier 1873), dans MEW, t. XVIII, pp. 296-298.
95 K. Marx, «An die Redaktion des Volksstaat» (26 octobre 1872), dans MEW, t. XVIII, pp. 180 et suiv.
96 «0 Congresso da Internacional na Haya», 0 Pensamento Social, n° 25, 6 octobre 1872.
97 Ainsi Nobre França (à Engels, 27 juillet 1872, op. cît.): « As noticias relativas a nos publicadas nos jornais espanhois sao fornecidas a Morago por Fontana. Sao exageradas. A verdade ja vo-Ia comunicamos.»
507
Bernhard Bayerlein
par là - nous avions déjà eu l'occasion de le faire remarquer - à dépasser les frontières nationales et politiques 00.
«[ ... ] nous avons vu avec satisfaction que la majorité des internationaux portugais veulent que le Conseil Général soit seulement un centre de correspondance, uniquement, ce qui prouve qu'ils pensent comme les espagnols [ ... ]» (l) 00
Ce n'est apparemment que quelques mois plus tard que Nobre França révise ce jugement dans une lettre à la Nueva Federaci6n Madrilena en y répondant du moins indirectement:
«No que respeita aos 'actos da Aliança nas outras regiôes, os internacionais portugueses nao tiveram até agora a ocasiao de se manifestar eficazmente salvo no congresso de Raia onde 0
nosso delegado apresentou um protesto contra a dissolvente e intriguista sociedade.» 100
L'importance relative de la section au congrès est assez bien documentée par d'autres contributions provenant du Portugal, de caractère politique et syndical. Fut remis à Engels, outre le mandat, «uma pequena mem6ria sobre as condiç6es gerais das indûstrias e da existência das classes trabalhadoras », document mentionné par Nobre França dans sa lettre du 23 août 101 - à laquelle d'ailleurs il rajoute comme il dit des éléments de statistique en plus. Le matériel publié sur le congrès reste muet, aucune allusion n'étant faite à ces deux documents.
Nous disposons par contre d'un petit rapport envoyé par J. Fontana au Congrès, qui relate brièvement les succès obtenus dans le cadre de la «Fraternidade Openiria» 102. De pair avec les dates fournies par França au mois d'août, le petit mémoire restera pour Marx,
98 Voir à ce sujet plus préc. supra, notes 49 et suivs. Nobre França décrit. l'attitude portugaise, fluide à ce propos, mais qui néanmoins met en cause le jugement de M. Nettlau (voir supra, note 81) : «De resto (a Aliança) nao teve aqui influencia, e desde a circular do Jura que discutimos algumas vezes a sua dissoluçao que nao propusemos aos irmaos de Espanha por deferência para corn eles.» Le 14 septembre, par contre, est publiée la résolution des portugais prise contre l'Alliance.
99 Francisco Tomas à José Fontana, 5 octobre 1872; dans M. Nettlau, La Première Internationale, pp. 157 et suiv.
100 Nobre França à Nova Federaçao Madrilena, 13 janvier 1873, La Emancipaciôn (Madrid), 1er février 1873, dans Carlos da Fonseca, Ruptura, pp. 234 et suiv.
101 Nobre França à Engels, 23 août 1872, op. cit. 102 « Mem6ria enviada ao Congresso da Raia pela Fraternidade Operaria »,
Lisboa, 16 août 1872, 0 Trabalho, n° 40, août 1872; cf. Carlos da Fonseca, A origem, pp. 153 et suiv. (le 'texte est signé José Fontana).
508
•
La Première Internationale au Portugal, vue à travers la Correspondance [ ... ]
Engels et Sorge la référence de fond pour leur appréciation de la situation au Portugal, cela même - important d'un point de vue méthodologique - à une époque postérieure, où la seftion est pratiquement anihilée lUJ.
L'~n~e~vention « internationale» de la section portugaise, précipitée et, accel~ree par Lafargue s'e~prime en outre à travers le soutien qu'elle declare a des plans de restructuration émis par quelques sections «centralistes » 104. De pair avec la nouvelle fédération elle présente « au nom de la Fédération portugaise» une motion sur la constitution de « Fédérations syndicales internationales », en tant qu'« Associations internationales de métier ", qui peut être considérée comme un pré-projet pour la création de Fédérations syndicales d'industrie au niveau international. Vu la crise de l'A.I.T., il ne peut pourtant être question d'une réalisation imminente de ces plans lUO.
. 103 Se fondant sur l'affluence régulière et considérable, J. Fontana prévoit un chIffe total de 6000 membre à la fin de l'année 1872, en partant de 2750 membres au mois d'août. Ouvrons ici une parenthèse sur le problème de l'Identité de José Fontana. Contrairement à des suppositions de César Oliveira le J. Fontana dirigeant de la F.O. paraît Identique au tessinois Giuseppe Fontana, ancien mazzinien et, en tant que tel, membre du {( Conseil Général », en 1864-65 et conSIgnataire comme {( Secrétaire correspondant honoraire pour l'Italie}) de l'Adresse inaugurale (voir César de Oliveira, Treze cartas, cit., pp. 15 et suiv.; cf. Vasco de ll;lagalhâes-V,ilhena, Antonio Sérgio, 0 Idealismo Critico e a Crise da Ideologia Burguesa, LIsboa 1975, repr., pp. 171 et suiv., en part. note 42; pour les sources voir: Marx à Engels, 11 avril 1865, où il fait référence à la sortIe de Fontana de l'Ail', sur suggestion de Mazzini. Comp. Freymond, op. cit., note 1019).
Mentionnons quelques indices: dans une lettre adressée par J. Fontana à Marx, du 26 décembre 1873, ce dernier est traité de {( Charo Companheiro e Senhor (cf. référence, note ). La supposition de M. Nettlau, se référant à la ~ettre envoyée par Bakounine à Fontana: «Dies bedeutet dass jemand in Spanien, lU den er Vertrauen hatte, him Fontana unbedingt empfohlen hatte [ ... ] », ne paraît pas tout à fait justifiée dans la mesure où la lettre avait été rédigée non pas en Espagne mais en Italie, et que d'après d'autres sources, elle avait été écrite en présence de Carlo Cafiero, ancien collègue de J. Fontana (M. Nettlau, Anarchie, note p. 476; Id., La Première Internationale, pp. 139 et 157; Freymond, op. cit., note 1019, p. 626). La publication du rapport de Fontana au congrès dans o Trabalho est accompagnée par de rudes attaques, qui précisément essayent de déduire les « manipulations}) du dernier de son origine suisso-italienne. Son travail {( de destruction de l'APTN au nom de la FO» y est décrite comme l'œuvre d'un «étranger» {( comissionado do C.G. da Internacional» essayant de réaliser «a louca pretensao de querer em Portugal parodiar Guilherme Tell." [l] (<< Revista Social», 0 Trabalho, n° 40, octobre 1872).
104 Voir« La Nueva federaci6n madrilena a todas las federaciones y secciones de la Asociaci6n internacional en Espafia", 27 novembre 1872, «La Emancipaciôn (Madrid), II, n° 76, 30 novembre 1872; trad. dans Freymond, t. II, pp. 342 et suiv.
105 Voir le document sur les «Uniôes Internacionais de Oficios", 0 Pensamento Social, n° 26, 21 septembre 1872.
509
Bernhard Bayerlein
IV
LA SECTION PORTUGAISE, PIONNIERE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALISTE
(OCTOBRE-DECEMBRE 1872)
Toutefois, la petite section portugaise n'était pas à elle seule capable de renverser le rapport de forces à l'intérieur de l'A.I.T., ni la situation des mouvements ouvriers dans les divers pays. De même, la victoire marxienne indéniable à La Haye ne fut pas le prélude à une activité concertée internationaliste, centralisée au niveau mondial. Au contraire, la tendance qui s'était manifestée au plus tard lors du Congrès de Londres s'affirme pleinement, empêchant de par là une intégration organique du champ de la lutte des classes, et mène progressivement au déclin de l'action internationaliste au moment même de sa victoire politique la plus importante. Les forces centrifuges s'imposent, paralysant un C.G. qui s'autoparalyse encore par son transfert aux EtatsUnis. Dans une période allant jusqu'en fin 1873 il ne cesse pourtant pas tout à fait son activité coordinatrice sur le plan international, mais est repoussé à l'arrière-plan, au profit de la réalisation des accords fondamentaux de La Haye sur la construction des partis, conçus par les dirigeants marxiens comme seul moyen pour faire renaître de façon différée une Internationale cette foi-ci incontestablement « communiste ». En fait, un signal de la non viabilité d'un projet internationalistepour n'en donner qu'un exemple sur un plan subjectif -, est l'imposition de forces centrifuges en Angleterre même, bastion traditionnel du C.G., dont l'embryon était formé dans les années 60 - rappelons-lepar le Conseil de direction des «Trade-Unions» 106.
La reprise des événements au Portugal fait confirmer la contradiction latente. Curieusement, c'est précisément la période voisine du Congrès de La Haye, qui, en Lusitanie, coïncide avec ce que l'on pourrait appeler le climax de l'internationalisme «primaire », c'est-à-dire une étonnante combativité ouvrière.
D'après une tentative de statistique, entreprise par Carlos da Fonseca, le nombre de grèves, d'abord de 4 en 1871, passe à 15 en 1872, dont 3 au mois de septembre et 4 en octobre 107.
106 F. Engels à J. A. Sorge, London, 12 et 17 septembre 1874, op. cit. 107 Carlos da Fonseca, A origem, p. 87.
510
•
•
La Première Internationale au Portugal, vue à travers la Correspondance [ ... ]
L'optimisme de França, informant Engels le 23 août d'une victoire ,. d If 108 ' grevlste es ca 'ats ,attenue son manque de confiance en la comba-
tivité ouvrière qui ressortait de sa lettre du 24. juin et semble donc parfaitement justifié. Il était pourtant facile de prévoir ce qui devait arriver inévitablement: vu les relations organiques fragiles au niveau international, le développement portugais devait automatiquement se heurter à une A.I.T. n'exerçant aucune des fonctions de centralisation des luttes et se bornant à l'accomplissement des taches administratives nécessaires, rendu de plus en plus difficile par des facteurs d'ordre technique comme l'éloignement du C.G. de l'Europe. La pénurie continuelle de moyens contredit la propagande sensationnaliste des cercles bourgeois intéressés sur une Internationale omnipuissante.
Précisément, dans cette situation, les portugais s'avèrent être les représentants d'un internationalisme «pionnier» des premiers temps de l'A.I.T., ce qui démontre à quel point ils prennent au sérieux leur « victoire» au congrès, et cela sans avoir les éléments indispensables pour analyser le fond de la situation internationale. Cette initiative, allant en quelque sorte à contre-courant, se manifeste par plusieurs appels de solidarité active avec les luttes menées au Portugal, adressés aux ouvriers des autres pays et leurs sections respectives et au C.G. lui-même dont Engels à Londres était resté l'agent financier.
Dans une lettre envoyée par Nobre França à ce dernier le 17 septembre - au nom du Conseil de la fédération locale de Lisbonne 109 -
nous trouvons des premiers éléments permettant de juger la situation des grévistes au Portugal comme tendant à devenir explosive: à travers une grève des fondeurs de fer se dessine la perspective d'un lock-out total dans la métallurgie. En effet, les associations de classe se déclarèrent solidaires avec les ouvriers de chez «Collares » et n'acceptèrent pas l'accélération du rythme des équipes de nuit. Les patrons portugais ne lésinent pas sur le choix de leur méthode, menant une politique d'obstruction aux conquêtes ouvrières obtenues par la grève des calfats, cherchant à pallier la pénurie imminente en matières premières par une importation renforcée en provenance d'Angleterre.
Pour Nobre França, le seul moyen de pallier à une situation, qu'il estime dangereuse,
«A nossa acçao vai produzindo os seus efeitos, infelizmente prematuramente. »
108 Nobre França à Engels, 23 août 1872, op. cil. 109 Nobre França à Engels, Lisboa, 17 septembre 1872 (sign. au nom du Con
seil de la Fédération Locale de Lisbonne), IIISG, Amsterdam, Fonds Jung; publ. dans Treze cartas, cit., pp. 43-46.
511
Bernhard Bayerlein
c'est une intervention directe de l'Internationale qui s'avérerait longue et difficile:
«[ ... ] intemacionais, e nâo-internacionais, pomos as nossas esperanças nos companheiros de outras regiôes. Qualquer auxilio dar-nos-ia muita força material e moral. No caso de empréstimos pagariamos nas prestaçôes que indicasseis, se por acaso nâo fosse necessario fazer um sacrificio grande para acudir a quem respondesse ao nosso apelo.» 110
La grève éclate en effet quelques jours après. Le 29 septembre Engels reçoit un télégramme, signé Nobre França, en signe d'alarme:
«Dois Lock[outs]. 200 parados. grave dependên[cia], resposta urgente. » 111
La réaction à Londres qui y fait suite, souligne l'habileté et l'engagement d'Engels mais démontre aussi la virulence des difficultés regnantes au sein de l'A.LT. de l'époque. Engels se met aussitôt en contact avec le Conseil fédéral anglais. Ne recevant pas immédiatement de réponse, il décide d'agir pour son propre compte en demandant à Herrman Jung les adresses des secrétaires des associations des fondeurs en fer, des charpentiers de vaisseau et des calfats en Angleterre 112.
Les efforts trouvent en effet un premier reflet, ne serait-ce qu'au niveau de la propagande: le 5 octobre l'International Herald de Londres publie un appel de solidarité émis par le Conseil fédéral de Lisbonne au Conseil fédéral anglais, daté du 16 septembre. Les travailleurs anglais y sont exhortés à refuser tout travail de réparation des navires portugais ou en partance pour le Portugal à l'ancre dans les ports anglais 113. Leurs noms avaient été communiqués par França dans la lettre indiquée plus haut. Il fallait absolument éviter que les ouvriers anglais se fassent embaucher comme briseurs de la grève en cours à Lisbonne des charpentiers de vaisseaux et des calfats.
110 Nobre França à Engels, cit. 111 Nobre França à Engels, (Lisboa), 29 septembre 1872 (Télégramme), IISG,
Amsterdam, Marx-Engels NachlaB, MEL L 5123. Le texte est reconstitué par nous. a Trabalho condamne formellement la grève, s'attaquant à ce propos «aux Messieurs Lafargue et Sorge» auxquels on reproche de vouloir s'ériger «en rois absolus»: «0 que n6s nao queremos, portuguezes, é ser escravos d'um grupo de homens inclinados aos interesses germanicos: queremos as liberdades das nossas pessoas, da nossa indus tria e do nosso trabalho." [Il]
11'2 «F. Engels an Herrmann Jung in London >} (London), 1er octobre 1872, dans MEW, t. XXXIII, p. 528.
113 Paru dans The International Herald, Londres, n° 27, du 5 octobre 1872 (d'après Freymond, op. cit., t. III, note 1267, p. 667). La demande portugaise a été transmise au Comité Fédéral Anglais le 26 septembre, par l'intermédiaire de Dupont, membre français du Conseil Général.
512
4
•
La Première Internationale au Portugal, vue à travers la Correspondance [ ... ]
A la même époque les espagnols avaient déjà - il en fut de même lors des premières grèves des calfats au mois de juillet _ répondu positivement à l'appel en le faisant insérer dans plusieurs organes de presse 114 :
«Esperamo.s que os fundidores espanh6is saibam cumprir 0 seu dever ~ hm de que os seus irmâos da Regiao portuguesa possam tnunfar [ ... ] " 115
Bien que n'a~a~~ o~tenu aucune réponse concrète les portugais ne cessent pas leurs Il1ltIatIves. Le 3 octobre un deuxième appel est envo ' à bngels - signé cette fois-ci - par J. Fontana au nom de la « Frat?r~ nid.ade. Op~niria », revendiquant la solidarité compte tenu de la cessatIOn Immmente du travail dans la sidérurgie, conséquence de la poursuite de la grève 116. Engels prie un ami (Friedrich LeBner) de transmettre l'éc~it à, J. Hales. secrétaire du Conseil fédéral anglais dissident 117.
Vu le degre qu ont attemt les luttes de factions en Angleterre ses efforts restent sans aucune réaction et l'appel n'est publié dans aucun des ?rganes de presse .anglais 118. Dans la lettre du 16 oct~bre il reproche donc a . Ha~es de vouloIr sacrifier les intérêts des travailleurs anglais à ces «mtngues personnelles ». Le même jour, il se rend officiellement au C.f. pour exiger des explications et des mesures concrètes 119.
D~ po.int . de vue formel les difficultés trouvent une explication dans l obstmatIOn des anglais à ne pas reconnaître les fonctions d'Engels en tant que correspondant responsable avec le Portugal. D'après une re~arqu~ d~ Marx, Hales fait savoir à Engels deux mois plus tard qu Il avaIt faIt des démarches dans ce sens, sans en préciser le caractère
114 Actas, t. l, p. 189 (18 juillet 1872).
1~5 ,Ca:tas, cit., t. l, p. 47. Il s'agit là d'une communication de F. Tomas à la FederatIOn portugaise datée du 21 septembre.
116 J. Fonta~a à F. Engels, (Lisboa), 2 octobre 1872, IISG, Amsterdam. D'après Freymond,. op. CLt., t. III, ~ote 1267, le manuscrit en anglais porte une vingtaine de correctIOns de la mam d'Engels. Voir à ce sujet la publication dans le V olksstaat, note 124.
117 Engels an Friedrich LeBner in London (16 octobre 1872), dans MEW, t. XXXIII, p. 532.
.118 Le 14 octobre il en avait envoyé une copie à Riley, rédacteur de l'Internatwnal Herald (voir plus préc., note 11).
119 Friedrich Engels, «An den Britischen Foderalrat der I t t' l Arb 't . f W [ ] n erna IOna en
el eraSSOZIa IOn, eg en portg[i:sisc~er] Strikes", London, 16 octobre 1872, dans MEW, t. XVIII, p. 179. Le meme Jour Engels avertit Nobre Franç ( . supra, note 115). a VOIr
513 33
Bernhard Bayerlein
_ et lui demande l'adresse officielle de la fédération à Lisbonne 120, ce qu'Engels, s'appuyant sur son mandat, s'abstient de faire.
« [ ... ]; und wenn Hales jetzt wieder Formfragen und Personalfragen vorbringe, so beweise das blog, dag er nich wolle, da!!. wirkliche Arbeit getan werde, sondern dag nicht nur die Zeit des Federal Council, sonder auch die Interessen der portugiesischen Arbeiter seinen personlichen Intrigen geopfert werden» 121
L'opinion d'Engels sera confirmée plus tard par le témoignage des portugais eux-mêmes de n'avoir pu compter sur aucune activité concrète de la part du Conseil fédéral anglais 122.
Il est intéressant de voir à quel point le conflit autour des portugais servait à Marx et Engels aussi de séism~graphe, leur p~rmetta~t de mesurer à partir d'un cas concret leur empnse sur le ConseIl anglais et leur influence sur la rédaction de l'International Herald. A ce propos il est légitime de parler d'un bilan négatif 123.
Vraisemblablement pour compenser cet échec, Engels réussit à faire publier l'appel - sous une forme dûment corrigée - dans le Volkst~at, journal du parti social-démocrate ouvrier allemand de Bebel et W. LIebknecht. Les ouvriers allemands n'y paraissent pas avoir réagi d'une façon concrète, pourtant le document en soi constitue l'exemple le pl.us clair que nous ayons pu trouver de la fidélité des portugais aux pnn-
cipes de l'Internationalisme:
«Unter diesen UmsHinden [".] wendet sich die Arbeiterverbrüderung, welche in Lissabon die Bannertdigerin im Kampf der Arbeit gegen das Kapital ist, an die Arbeiter der übrigen Llinder,
120 K. Marx, F. Engels «An den Redakteur des International Herald» The International Herald, na 38, 21 décembre 1872 (1), dans MEW, t. XXXIII, p. 532.
121 Engels an F. Le!!.ner in London, 16 octobre, op. cit. 122 «Elle [Hales] escreveu uma vez que estava em relaç6es connosco. Julga
mos que sabeis que elle se referia a uma carta de Fontana [.,.] em que se pedia a intercessilo e auxilio dos operarios inglêses para a fabrica social. Nilo houve mais nada.» (Nobre França à F. Engels, (Lisboa), 17 août 1873, IISB, Amsterdam, Marx-Engels Nachlag, L 5124. Servant comme élément supplémentaire. ~e ~e~roche au Conseil Général «dictatorial», Hales, dans une lettre au ComIte Federal antiautoritaire de la Fédération Jurassienne, se plaint en effet qu'Engels s'obstinait à lui transmettre les adresses des fédérations portugaises et espagnoles. «Association Internationale des Travailleurs. Conseil Fédéral anglais, Londres 6 novembre 1872. Au comité fédéral de la Fédération jurassienne» (sig. J. Hales), Bulletin de la Fédération Jurassienne de L'Association [.,,], na 23, 1er décembre 1872.
123 Comp. au sujet des dissidences intérieures en Angleterre: Henry Collin, « The English Branches of the First International ", dans Essays in Labour History, New York 1967, pp. 242-275, en part.: pp. 266 et suiv.
514
4
La Première Internationale au Portugal, vue à travers la Correspondance [",]
voller Vertrauen, da!!. die Solidaritlit die Gleichheit der Interessen der Arbeiter des ganzen Erdenrunds nicht eine blo!!.e Redensart, sondern eine begriffene, in das Leben, in die Praxis übergeführte Wahrheit ist [ ... ]. Wir sind überzeugt, es bedarf nur dieser Andeutung, um den Plan unserer Kapitalisten zu vereiteln: die ausllindischen Arbeiter werden sich nicht aIs Werkzeuge zur Unterdrückung ihrer portugiesischen Brüder gebrauchen lassen; sie werden nicht in unserem gemeinsamen Klassenkampf auf seiten der gemeinsamen Gegner treten 1 " 124
La seule réaction de solidarité plus concrète provient du Conseil espagnol sous la forme d'une adresse aux grévistes, dont les conceptions politiques sont pourtant diamétralement opposées à l'orientation des portugais, suite à la victoire obtenue au Congrès régional de Cordoue à la fin de l'année par les tendances anti-autoritaires 125.
v
DE LA CRISE DU MOUVEMENT OUVRIER PORTUGAIS A LA CRISE DES RELATIONS INTERNATIONALES
(DECEMBRE 1872 - JUILLET 1873)
Après les vaines tentatives d'Engels de répondre aux aspirations internationalistes portugaises, nous assistons pendant les premiers mois de l'année 1873 à un arrêt quasiment total des échanges avec Engels à Londres, qui garde sa fonction d'agent financier du C.G., et avec ce dernier dont le secrétaire, F. A. Sorge, avait encore -le 30 décembreprié par une circulaires les portugais de bien vouloir prendre en considération la nécessité d'une solidarité active avec les travailleurs en bijouterie genevois, en grève pour la journée de travail de 9 heures 126.
124 «Arbeiter 1 Brüder ", Lissabon, den 3. Oktober 1871 (sign. José Fontana), Der Volksstaat, na 84, 19 octobre 1872.
• 125 F. Tomas (secr. gén. du C.F.) «aos ferreiros grevistas de Lisboa ", Valen-CIa, 5 octobre 1872, dans Cartas, cit., t. l, pp. 155 et suiv.; voir Carlos da Fonseca, op. cit., pp. 232-233.
126 Au Conseil F. portugais, New York, 30 décembre 1872, signé F. A. Sorge au nom du Conseil Général, dans Paper of the General Council of the' International Workingmens Association New York (1872-1876), Edited by Samuel Bernstein (cité par la suite: Papers) , dans Annali, IV, 1961, pp. 41-549, en part. p. 432.
515
Bernhard Bayerlein
Jusqu'au .début de l'année des contacts réguliers semblent ainsi maintenus. Engels communique à Sorge le 4 janvier qu'un message du Portugal était parvenu à Lafargue et qu'il en attendait lui aussi un pour bientôt 127. Il ne reste aucune trace de ce message, ce qui pourrait être interprété comme signe annonciateur d'une interruption des relations. Dans une lettre du 2 novembre Engels avait promis à Sorge un rapport sur l'Espagne, le Portugal et l'Italie, dont seule la partie espagnole semble avoir été terminée 128.
Quelques allusions faites par Nobre França plus tavd permettent de déduire que les portugais continuaient à être, du moins en partie, approvisionnés en journaux internationalistes, dont: Le Mira~eau, L'Internationale, Der Volkswille, Der Volkstaat et The InternatlOnal Herald 129.
La crise, qui éclate au sein de la section portugaise et du mouvement ouvrier portugais en général au plus tavd en février '73, passe entièrement inaperçue au niveau international: la raréfaction des échanges en est certainement une raison majeure. La crise de l'A.I.T. se jumelle avec la crise au Portugal.
Le rapport policier déjà mentionné invoque à ce propos la dissolution forcée de la «Fraternidade Operâria », la série successive de grèves ayant épuisé tous les moyens financiers à sa disposition 130. César Nogueira brosse par la même occasion un portrait d'un mouvement ouvrier réduit à néant par les grandes grèves de 1872 131. Le bilan de Nobre França confirme l'hypothèse de debâcle, pertinemment décrite dans ce court passage:
«Depois das greves repetidas e feitas sem recursos as associaçôes de Lisboa e dos arredores sofreram um formidavel desânimo. Rouve mesmo uma dispersao geral, a que resistiram apenas meia duzia de secçôes.» 132
127 F. Engels an F. A. Sorge, London, 4 janvier 1873, dans MEW, t. XXXIII, pp. 555-558; la lettre est de la main de Tedeschi, ce qu'il confirme lui-même (voir Tedeschi à Engels, 29 mai 1873, IISG, Amsterdam).. .
128 Cf. Fo Engels, «Bericht an den Generalrat der InternatlOnalen ArbeIterAssoziation über die Lage der Assoziation in Spanien, Portugal und Italien)} (31 décembre 1872), dans MEW, to XXIII, pp. 182-186.
129 Voir les allusions dans Nobre França à Engels, Lisboa, 17 août 1872, IISG, Amsterdam, MEL 5124.
130 Opo cito, po 414. 131 Op. cito,po 35. 132 Nobre França à Engels, 17 août 1873, op. cit.
516
•
+
La Première Internationale au Portugal, vue à travers la Correspondance [000]
Plus importantes que les chiffres 133 sont les tentatives d'analyse fournies par le secrétaire général, qui font ressortir une contradiction fondamentale inhérente au mouvement ouvrier portugais et surtout au type d'intervention du noyau internationaliste quant aux questions des rapports «entre stratégie et tactique ». A vrai dire, il apparaît clairement qu'il ne s'était jamais posé le problème d'une façon systématique. Les dirigeants au Portugal prônaient ~ sous l'égide du coopérativisme ~ l'apolitisme traditionnel d'influence proudhonienne, tout en soutenant un activisme gréviste, une « révolution par les grèves », avec le résultat suivant:
«[000] ninguém pensava em associaçoes de resistência ["0] 0
movimento (cooperativo) chegou a tomar um caracter feio.» 134
Dans ce cadre, Carlos da Fonseca souligne avec raison le caractère éminemment «politique» du mouvement gréviste, qui, dépourvu d'une perspective d'intervention globale et internationaliste devait mener tout droit à la débâcle. C'est bien un problème d'ordre stratégique qui se cache derrière le phenomène apparemment banal de l'épuisemen() des caisses.
«Porém, 0 aspecta mais contraditôrio da sua resistência efémera é 0 abstencionismo poIitico estatutario e a acentuaçao (dinamos orientaçao) inspirada pelos internacionalistas. 0 apoliticismo oficial é assim contrariado na prâtica por uma greve contra '0 governo'o As suas intervençoes internacionais contrastam também com 0 seu programa puramente reivindicativo e de caracter nacional.)} 135
Dans ses lettres Nobre França attaque quelques-uns des dirigeants portugais, dont il rend en premier lieu les capacités théoriques déficientes responsables de la débâcle. Il nous livre ainsi de précieux détails biographiques quand il décrit p. exo un Fontana « absorbant le proudhonisme d'Antero» et les tendances blanquistes d'un Felizardo de Lima à Porto.
L'appel internationaliste fervent paraît avoir été ~ dans cette affaire - poussé à l'extrême dans le but d'encourager et de provoquer des luttes grévistes, tactique -les lettres de França en sont un témoignage - qui aboutit à une surestimation dans les faits des capacités
133 Gneco parle de 200 militants -« se tanto» - qui auraient survécu à la crise. (Azedo Gneco à Friedrich Engels, Lisboa, 10 avril 1876; publ. dans Treze cart as, cit., pp. 59-66).
134 Nobre França à Engels, 17 août 1872, op. cit. 135 Carlos da Fonseca, A origem, cit., pp. 85 et suiv.
517
Bernhard Bayerlein
politiques d'intervention et surtout des ressources matérielles effecti
ves de l' A.I.T. :
«Muitos iniciadores (de greves) mesmo tinham cometido 0 erra de fazerem conceber esperanças nos auxilios das associaçôes dos outros paises, sem mais deveres do que as boas palavras. » 136
Et pourtant ce n'était certainement pas exclusivement la naïveté ou bien la volonté de « captation» qui faisait agir ainsi. La vision d'une Internationale omnipuissante sur tous les plans faisait partie intégrante à l'époque d'une mentalité renforçant la prédisposition généralisée pour « se plonger dans la lutte ».
Une bonne partie de la renommée de l'Internationale chez les bour-geois comme chez les prolétaires s'explique précisément par le fait que l' A.I.T. avait secouru - fréquemment par l'intermédiaire des sections « riches» - et de façon très intensive durant les années précédentes, les luttes grévistes dans les divers pays. Ces actions de sauvetage s'effectuèrent sous forme d'emprunts réciproques, de crédits et, dans une moindre mesure, par des subsides directs. Ainsi toute une série de grèves avait pu être menée jusqu'à satisfaction des revendications 137.
Dans ce contexte seulement il nous est possible de mesurer toute la portée de la correspondance entre Fontana et Engels début 1873 car elle n'entre pas dans la lignée des principes de lutte internationaliste. Comme un moyen de remédier au chômage s'étendant dans quelques entreprises suite à des licenciements dans la métallurgie, le secrétaire de la F.O. demande à Engels de faire vérifier par des personnes compétentes un tour et une fraiseuse commandés à Leeds par un propriétaire d'une usine portugaise. De l'avis de Fontana l'achat d'une machine de bonne qualité entraînerait une réembauche de 80 ouvriers licenciés lors des grèves et serait censé symboliser l'acte d'entraide véritablement internationaliste pour la classe ouvrière portugaise 138. Il ressort d'une deuxième lettre de Fontana qu'Engels se chargea de cette tâche inhabituelle pour un dirigeant ouvrier international 139.
Toute la correspondance de Fontana est exclusivement axée sur cette affaire, on y chercherait en vain la moindre allusion à la crise
136 Nobre França à Engels, 17 août 1872, op. cit. 137 Voir à ce sujet la description bien faite dans J. Braunthal, Geschichte der
Internationale, t. l, pp. 127 et suiv. 138 J. Fontana à Engels, Lisboa, 24 janvier 1872, pub!. dans Treze cartas,
cit., pp. 47 et suiv. 139 J. Fontana à F. Engels, Lisboa, 8 février 1873, pub!. dans Treze cartas,
cit., pp. 48 et suiv.
518
• La Première Internationale au Portugal, vue à travers la Correspondance [ ... ]
qui éclate à cette époque, ce qui pourrait éventuellement servir comme élément d'appréciation politique personnelle.
La compilation des documents provenant du C.G. de l'époque à notre disposition confirment l'hypothèse quant aux espérances placées en une section réduite à l'état d'agonie. Ainsi Engels communique à Sorge le 4 janvier:
«In Portugal ist alles in Ordnung. Lafargue hat einen llingeren Brief erhaIten, worin ein llingerer an mich in Aussicht gestellt wird.» 140
Un communiqué officiel de la main d'Engels du 2 janvier s'appuie donc sur des éléments vieux déjà de quelques mois:
«Aus einem Brief aus Portugal war zu ersehen, dass dort die von der Internationale organisierte Bewegung der Arbeiterklasse aussergewèihnliche Dimensionen annimmt. Allein in Lissabon und der Nachbarschaft sind über fünfzehntausend Arbeiter in Gewerksvereinen organisert worden, und die Organisation dehnte sich schon nach Op orto und dem Norden aus. Alle diese Vereine sind durch die Internationale gebildet worden und stehen weiterhin unter ihrem direkten Einfluss. Die Internationale wird jedoch durch die Gesetze des Landes daran gehindert, sich selbst in voller Freiheit zu organisieren. Die Zeitung der Internationale '0 Pensamento Social', trligt sich jetzt selbst. Wir kèinnen hinzufügen, dass es in Portugal keine Sezessionisten gibt. Die Haager Resolutionen sind nicht nur einstimmig bestatigt, sondern mit Begeisterung auf genommen worden. Das 'Pensamento' enthliIt in seiner Nr. 25 einen Artikel, der den Haager Kongress für den bedeutendsten erkllirt, der überhaupt seit Gründung der Internationale abgehalten worden ist, und der seine Resolutionen aIs die Manifestation eines gewaItigen Fortschritts in der Entwicklung der Assoziation begrüsst. » 141
140 Engels an Friedrich Adolph Sorge, London, 4 janvier 1873, dans MEW, t. :X:XXIII, pp. 555-558, en part. p. 556. La version donnée par J. Guillaume (L'Interna!wnale. Documents et souvenirs (1864-1878), t. III, Paris 1909, p. 31) de cette me~e ~ettre .es~ d'u~ t?n différent, si l'on peut dire, opposé: «En Portugal le drOIt d aSSOCiatIOn n eXIste pas; aussi l'Internationale n'y est-elle pas officiellement constituée.» (1).
141 F. Engels, «Mitteilungen über die Tlitigkeit der Internationale auf dem Kontinent », dans MEW, t. XVIII, p. 309; pub!. dans The International Herald, du 11 janvier 1873. La publication d'O Pensamento Social, signe annonciateur de la crise, a été suspendue à partir d'avril 1873 pour n'être reprise qu'en automne (voir supra, note 28).
519
Bernhard Bayerlein
Le bilan optimiste d'Engels est repris dans une communication
du C.G. du 26 janvier:
«Le zèle de nos amis du Portugal est digne d'émulation et nous assure de bons résultats.» 142
L'affirmation est reprise dans une circulaire confidentielle du C.G.
datée du 2 février:
«Au Portugal notre influence s'étend et les lois du pays seulement empêchent l'affiliation de nombreuses organisations ouvrières. »143
Engels tombe dans le même panneau, ses notes du 8 février pour
le C.G. en sont un exemple frappant:
«In Portugal geht alles gut, wie die heute gesandte 'Emanc[ipacion] , zeigt. Wir hab en auch Privatbriefe von dort, die Leute arbeiten enorm an den Trade-Unions.» 144
Le 1S février, Engels résume lors d'une réunion du C.G. la lettre envoyée par Nobre França à la Nueva Federaci6n Madrilena; il s'agit là en fait du premier document au plan international de démarcation nette et publique d'avec la majorité espagnole, ce qui pourrait expliquer en
même temps un certain ton jubilant:
« Aus Portugal horen wir, dass die Portugiesische Foderation, aIs sie erfuhr dass der sogenannte spanische Kongress zu Cordoba sich für die Sezession erkHirt hatte, sich sofort an die neue Madrider Foderation (der Internationale) wandte und erkHirte, dass Portugal wie ein Mann auf Seiten der Assoziation gegen die Sezessionisten stehe, dass Versuche gemacht worden seien, der geheimen Allianz Eingang in ihren Reihen zu verschaffen und dass Bakunin selbst einem von ihnen geschrieben habe, um sie zu überreden, diese geheime Gesellschaft zu unterstützen; dass sie jedoch einmütig beschlossen ha>tten, Bakunin ihre ausdrückliche Missbilligung hinsichtlich der Aktionen der Allianz auszudrücken. [ ... ] Die Portugiesische Foderation zahlt jetzt
142 Aux membres de l'Association Internationale des Travailleurs, aux ouvriers, New York, 26 janvier 1873, dans Papers, cit., pp. 437 et suiv'.; cf. la version allemande dans Der Volksstaat, n° 17, 26 février 1873.
143 Circulaire confidentielle du Conseil Général de l'Association Internationale des Travailleurs, New York, 2 février 1873, dans Papers, cit., pp. 442 et suiv,
144 F. Engels, «Notizen für den G[eneral]-Rat », London, 8 février 1873, dans MEW, t. XIII, pp. 314 et suiv,
520
• La Première Internationale au Portugal, vue à travers la Correspondance [ ... ]
mehr aIs 15000 Mitglieder; sie umfasst allein in Lissabon 48 Sektionen, unterteilt nach Berufen, von denen jede einen Berufsverband bildet. Soviel zu der Behauptung der Sezessionisten, dass aIle organisierten Foderationen auf ihrer Seite seien.» 145
Pour ce qui est des relations avec les espagnols, une remarque de Tedeschi nous laisse entrevoir qu'elles ont probablement cessé dès janvier 146.
Au moment où la suspension de 1'« excellent paper» 0 Pensamento Social - signe ouvert de la crise - est communiqué par Engels au C.G. le 1S avril sans aucun commentaire supplémentaire, un rapport de ce dernier et qui date de la même époque - paraissant dans le Volksstaat 146bis - persiste à évoquer les « progrès» au Portugal, parlant à
ce sujet d'une « centralisation progressive des syndicats », cela même à une époque où la F.O. para.ît déjà avoir amorcé sa phase de dislocation:
{{ Die Vereinigung und Centralisation der verschiedenen Gewerksgenossenschaften in Portugal macht groEe Fortschritte.» 147
Tedeschi tente de renouer des contacts au mois d'avril en écrivant à Lafargue, une première démarche en début de l'année étant restée sans réponse 1-N!. Ce dernier, ne répondant toujours pas, Tedeschi s'adresse -le 27 mai - à Sorge à New York 149 et deux jours après, il expédie à Engels une lettre regorgeant d'amertume et de résignation:
{< Je racontais dans ma précedente lettre [ ... ] comme on subissait une crise [ ... ]. [ ... ] j'attendais un mot, un conseil, un encouragement, un avertissement quelconque. Rien n'est venu [ ... ]. Nous voilà bien isolés! Séquestrés du courant enropéen comme si nous étions dans les îles Sandwich [ ... ]. }} 150
145 F. Engels, {{ Mitteilungen über die Tatigkeit der Internationale auf dem Kontinent », International Herald, n° 46, 15 février 1873, dans MEW, t. XVIII, pp. 313 et suiv.; une note portugaise, protestant contre les résolutions votées au Congrès de Cordoba, avait été antérieurement publiée dans La Emancipaci6n (voir Carlos da Fonseca, A origem, cit., p. 74).
146 Tedeschi à Engels, 29 mai 1873, op. cit. 146bis Engels to the General Council of the LW.M.A., London, 15 avril 1873, dans
Sorge, op. cit., p. 101. 147 «Bericht des Generalraths an die Mitglieder der Internationalen Arbeiter
Assozjation », New York, 25 avril 1873. Der Volksstaat, n° 45, 4 juin 1873. 148 C'est au moins ce qui ressort d'allusions faites à un tel message dans
la lettre de Tedeschi du 29 mai citée. 149 Voir la confirmation dans {{ Au c. local de Lisbonne», New York, 20 juin
1873, dans Papers, cit., p. 483. Comme déjà la précédente, la lettre elle-même ne put être localisée.
150 Tedeschi à Engels, 29 mai 1873, op. cit.
521
Bernhard Bayerlein
Cette fois-ci, Engels réagit aussitôt 151 et communique les mauvaises nouvelles à Sorge, soulignant une fois de plus l'importance de la section portugaise:
«Bye the bye- die Portugiesen klagen, daB sie gar nichts von Euch erhalten und doch sind sie sehr, sehr wichtig für uns.» 152
Sorge prend la remontrance à cœur, la communication qu'il expédie le 20 juin aux portugais recèle en même temps la première allusiondans un texte international- à la crise au Portugal, qui d'ailleurs semble déjà se trouver sur le point d'être surmontée.
«Le C.G. [ ... ] vous exprime sa satisfaction de voir renaître l'esprit du mouvement ouvrier international au Portugal. Espérons que vos efforts soient couronnés de succès.» 153
C'est visiblement une nouvelle étape qu'entame dès lors le mouvement ouvrier et l'avant-garde internationaliste au Portugal.
Les portugais profitent de leur retour précaire mais indiscutable sur la scène internationale pour formuler le 27 juillet une protestation officielle à destination du Conseil fédéral espagnol, en signe de solidarité avec les internationalistes de l'état voisin, victimes de la répression gouvernementale qui suivit les soulèvements cantonaux et les événements tristement connus d'Alcoy 154.
Contrairement aux incertitudes et hésitations émises par Tedeschi au mois de mai quant à l'appréciation et à l'analyse de la situation espagnole,
«Nous nous confirmons dans l'idée qu'il faut soutenir à tout prix la république en Espagne; la république des républicain bien entendu, soit Castelar, soit Barcia.» 155
151 Voir ibid., la note d'Engels au verso, «répondu le 16 juin ». 152 Engels an F. A. Sorge, 14 juin 1873, dans Sorge, op. cit., pp. 110 et suiv. 153 Au C. local de Lisbonne, 20 juin 1873, op. cit.; c'est à partir de cette
époque que les portugais paraissent disposer des adresses des autres Fédéra-tions européennes, envoyées par Sorge en annexe. .
154 Associaçao Internacional dos Trabalhadores. «Protesto », s.l., (1873), LISboa, 27 juillet 1873 (sign. « em nome e por acordo da Fed. local de Lisboa. Os secretarios do conselho C. Fernandes, S. Lisboa, Azedo Gneco (secr. geral) ». Sur les événements d'Alcoy, voir C. L. Lida, Anarquismo y Revoluci6n en la Espana del siglo XIX, Madrid 1972. La documentation fondamentale est réunie dans C. E. Lida, Antecedentes y desarrollo del movimiento obrero espanol (1835-1888), textos y documentos, Madrid 1973, pp. 345-395. Sur le rôle effectif joué par l'AIT, voir J. Termes Ardévol, «Aspects inédits de l'activité de l'Internationale en Espagne sous la Première République (1873) », dans Colloques C.N.R.S., cit., pp. 321-329.
155 Tedeschi à Engels, 29 mai 1873, op. cit. Son affirmation est d'autant plus étonnante que le P.S. (n° 49, 23 mars 1873) avait publié un article de fond (de la
522
•
•
La Première Internationale au Portugal, vue à travers la Correspondance [ ... ]
Cette déclaration est claire et nette dans la mesure où, sans pourtant dire mot des questions politiques et stratégiques, elle se borne, mais d'une façon conséquente et inconditionnelle à défendre l'Internationale des calomnies émanant des cercles bourgeois, la rendant responsable d'une politique de désordre et de terreur. Cela dit, la prise de position n'implique aucunement un ralliement des portugais aux principes d'action des anti-autoritaires espagnols, sévèrement critiqués de façon exhaustive par Engels dans sa brochure sur le «putsch des bakouniniens » 15
6, seul leur effort de légitimation le laisse supposer 157.
L'intransigeance des portugais -la lettre de Nobre França du 17 aout nous l'expose bien - est à comprendre en réaction aux avances des espagnols qui essaient « d'exploiter» la déclaration de solidarité 158. La prise de position y est également justifiée par la nécessité de manifester « l'esprit de classe» luso-espagnol ce qui témoigne de l'échec des avances idéologiques entreprises par les espagnols:
«Depois dos acontecimentos de Alcoy julgamos por um momento que tinham reflectido, reconhecendo a necessidade de coesao da classe trabalhadora; porém enganamo-nos [ ... ]. Tendo travado relaç6es connosco por ocasiao dos acontecimentos de Alcoy, a comissao federal mandou-nos perguntar se mandavamos delegados ao Congresso autonomo. Nao hao de gostar da resposta resolvida em sessao.» 159
main d'Engels) sur «A Republica na Espanha» (<< Die Republik in Spanien », Der Volksstaat, n° 18, 1er mars 1873), dont la conclusion est claire: «Quelques années de régime républicain bourgeois et calme prépareraient en Espagne le terrain pour une révolution prolétarienne, d'une façon qui surprendrait même les travailleurs espagnols les plus avancés. Plutôt que de répéter la farce sanglante de la révolution précédente [ ... ] les travailleurs espagnols [ ... ] utiliseront la république f ... ] pour s'organiser en vue d'une révolution imminente, une révolution. dont ils seront les maîtres.» Ce paragraphe avait été omis dans la traduction espagnole! (voir Freymond. op. cit., t. III, note 1175, p. 651).
156 F. Engels. «Die Bakunisten an der Arbeit, Denkschrift über den Aufstand in Spanien im Sommer 1873 », Der Volksstaat, n° 105-107, du 31 octobre, 2 et 5 novembre 1873 (paru comme brochure en 1894), repr. dans MEW, t. XVIII, pp. 476-93 ..
157 Ainsi p. ex. l'inclusion de la déclaration dans le n° 19 du Bulletin de la Fédération Jurassienne (du 17 août 1873).
158 Pour la réponse du côté espagnol voir: Actas, cit., Comunicaciones, n° 982, la déclaration étant publiée dans El Condenado (11 août 1873), et La Federaci6n (9 août 1873).
159 Nobre França à Engels, 17 août 1873, op. cit.; Freymond (op. cît.), t. III, note 1266, mentionne à ce propos l'insertion dans l'International Herald, du 30 août (n° 74) des « circulaires du Conseil fédéral portugais» critiquant la Fédération espagnole et ses agissements à Alcoy. C'est probablement avec l'objectif de mener une discussion sur ces points d'après des documents et des prises de positions
523
Bernhard Bayerlein
La correspondance internationale donne quelques éclaircissements sur la question de la réorganisation de la section portugaise en 1873. C'est vraisemblablement Tedeschi qui a fait part dans sa lettre au C.G. des projets de restructuration; il en salue d'ailleurs l'initiative et en précise le caractère organique:
«Aussitôt que plusieurs bonnes sections seront constituées, vous ferez bien de former un C.F. provisoire qui devra fonctionner jusqu'à l'assemblée d'un congrès régional portugais, lequel seul pourra établir un C. fédéral défini.» 160
D'après les événements survenus, la constitution « définitive» de la Fédération portugaise s'avère plutôt être une réorganisation globale et non pas le fruit d'un développement continu et harmonieux.
La Fédération - comportant trois sections initialement - est constituée officiellement le 17 septembre, à une époque ou Marx et Engels jugent l'Internationale, du moins dans sa forme traditionnelle, comme définitivement condamnée. Son nouveau secrétaire général - Azedo Gneco - s'imposera par la suite comme figure dominante du mouvement ouvrier au Portugal 161. La création est néanmoins annoncée par le C.G. et signalée dans le Volksstaat du 28 septembre 162.
Le rapport confidentiel du C.G. qui sera présenté au Congrès de Genève de l'A.I.T. en septembre - il s'agit du dernier rapport de ce genre - parle d'une constitution imminente et souligne le mauvais état
espagnols, que les portugais demandent le 8 août à la Commission fédérale de leur envoyer les matériaux sur le conflit dans l'Internationale (Actas, cit., 8 août; cf. Nettlau, Anarchie, dt., p. 477). Les espagnols répondent favorablement, ce qui témoigne d'un changement d'attitude vu que (c'est au moins ce qui ressort de la lettre de N. França à Engels du 17 août) les alliancistes n'envoyaient plus de matériel au Portugal. M. Nettlau, dont les sympathies sont connues, cite à ce propos une lettre d'Albarradn, membre du conseil fédéral espagnol, du 22 juin 1873, déplorant que «lamentablement les camarades là-bas sont autoritaires.» (M. Nettlau, Anarchie, cit., p. 477).
160 Au C. local, 20 juin 1873, op. cit. 161 Voir à ce propos César Oliveira (Treze cartas, cit., pp. 12 et suiv.), où il
parle d'une «visao subjectiva e excessivamente personalista» des lettres de Gneco. 162 Association Internationale des Travailleurs. Conseil Régional Portugais.
«Circulaire à toutes les Fédérations régionales et locales de l'AIT et aux sociétés ouvrières» (Lisboa), 17 septembre 1873, Bulletin de la Fédération Jurassienne, Le Locle, n° 27, 12 octobre 1873; cf. une traduction allemande: «An aIle Bezirksund Orts-Foderationen der internationalen Arbeiterassoziation und an alle Arbeiterverbindungen », Der Volksstaat, n° 91, 28 septembre 1873; cf. la reproduction dans Freymond, op. cit., t. III, pp. 397 et suiv.
524
•
La Première Internationale au Portugal, vue cl travers la Correspondance [ ... ]
des contacts 103. Y est également établie une relation la crise au Portugal et les agissements de l'Alliance façon imprécise et sommaire: '
organique entre mais ceci d'une
«L'~llian~e a ~galement tenté sa chance au Portugal, mais en vm?, meme SI elle a causé une certaine dépression, les vrais ~rll1s d~. Travail ont rejeté l"Alliance', ont bravement soutenu ~ Op~OSItIOn espagnole à cette société, formé un Conseil local a LIsbo~ne . et ils devraient bientôt créer un Comité fédéral. CommUnICatIOns assez irrégulières. Redevances promises.» 164
Vu l'état de désorganisation de leur section, les portugais ne sont pas en mes~re d'envoyer un délégué au Congrès de Genève, ce que Marx au molUS semble avoir vu venir 165.
«0 nosso estado precario nao nos deixou ocupar como deviamos do Congresso internadonal, chegando ainda assim a empregarn?s (pouco?) para enviar um delegado. [ ... ] Apenas se mandar[Ia] uma magra memôria.» 166
Les élémen:s di~ponibles de c~rrespondance internationale à partir de 1873 sont d une importance pnmordiale pour une appréciation du p:ocessu~ ?e réo:-g~nisation. Ils permettent de caractériser ce qu'une simp~e. r~f~rence a 1 acte formel laisserait dans l'ombre: nous assistons en vent.e a u.rle volte;face dans l'appréciation théorique et à une nouvelle o~lentatlO~ de 1 interv.ention tactique. La nouvelle ligne politique donne a la sectlOn portugaise les moyens de jeter les premières bases d'un parti ouvrier et de dresser sur le plan syndical un bilan positif des eX?érience,s .de .luttes. ,Tout ce processus est accompagné d'un effort Jus~ue la lUexlstant d assimilation théorique du marxisme. C'est l~ noyau lU:ernationaliste qui le premier se met à la réalisation au lllveau syndical des résolutions de La Haye, dans la situation parti-
16~ ~< Adress~ und ?ahresber~cht des General-Raths der Internationalen Arbeiter-AssozratIOn », Mrtarbelter, 8 aout 1873 Der Volksstaat n° 91 28 t b f d · ' " sep em re' c. ans Papers, Clt., pp. 500 et suiv. '
164 Cf.« Annual Confidential report of the G.C. to the Sixth General Congress of the I.W.~. at Geneva, September 8, 1873 », New York, 11 août 1873, dans Freymond, op. Clt., t. IV, pp. 177-184, en part. p. 184; voir aussi dans Papers . dt pp. 504-509. 1 .,
, 165. Voir ,à c~ sujet .les instructions au délégué du Conseil Général au Congrès, l autonsant a fmre cotIser les portugais: «Instructions for the delegate of the G.C. to the 6th Congress» (A. Serraillier) dans Papers dt pp 495-498' t aU" ..., ' , .,. , une au re
us IOn a une partICIpatIOn eventuelle des portugais: Karl Marx an Sorge, London, 27 septembre 1873, dans Sorge, op. cit., pp. 120 et suiv.
166 Nobre França à Engels, 17 août 1873" op. cit.
525
Bernhard Bayerlein
culière au Portugal «rompendo 0 fogo contra a cooperaçâo» - ainsi dépeint par Nobre França dans sa lettre du 17 août 167.
C'est dans la lettre de Tedeschi du 29 mai que nous trouvons la première allusion à la réalisation des objectifs au niveau politique:
« J['ai] demand[é] énergiquement de créer immédiatement le parti socialiste; mais jusqu'à présent on fait la sourde oreille. C'est prouvé à l'évidence le besoin d'une politique indépendante. On hésite pourtant.» 168
Dans ce cadre nous disposons des éléments - i.e. surtout la correspondance échangée entre Engels et Gneco à ce sujet trois ans plus tard - nous autorisant à qualifier l'activité du noyau portugais à partir de 1873 de combat permanent pour la création du parti ouvrier. Ces éléments gagneraient à être élargis par des sources portugaises - inexistantes ou bien restées inutilisées - ils révèlent tout de même e.a. le rôle prépondérant dans ce processus de A. Gneco. D'un autre côté ils relèvent d'une contribution des plus réduites et même nulle de la part du C.G., ne fonctionnant pas même au niveau «de boîte aux lettres ». Les portugais -l'histoire se répète - restent encore une
fois seuls. Gneco qualifie 1'« Associaçâo 18 de Março »169, créée juste avant la
constitution de la Fédération, d'« association sociologique », appellation qui laisse présumer que le processus de clarification était toujours en cours. Il est néanmoins justifié de considérer l'Association comme le prédécesseur immédiat du Parti Socialiste 170.
Contrairement à Tedeschi, qu'il traite d'ailleurs (de même que Nobre França) de «mandriâo », Gneco reprend à son propre compte l'initiative de construction du parti, il est l'instigateur et l'initiateur d'une commission créée en automne 1873 dans le but d'élaborer un programme 171. Les âpres luttes retracées par Gneco quand il aborde la période de 1873 à 1875 passent inaperçues au plan international,
167 Ibidem. 163 Tedeschi à Engels, 29 mai 1873, op. cit. 169 Azedo Gneco à Friedrich Engels, Lisboa, 10 avril 1876, repr. dans Treze
cartas, cit., pp. 59-66. 170 Nobre França à Engels, 17 août 1873, op. cit. 171 Ibidem; la commission étant composée de Antero, N. França, J. Fontana,
S. Lisboa, Felizardo Lima, J. Caetano da Silva, Azedo Gneco; S. Lisboa et F. Lima étant expulsés par la suite.
526
•
•
La Première Internationale au Portugal, vue à travers la Correspondance [ ... ]
témoignage flagrant de l'incapacité du C.G. à appréhender la portée aes événements:
« Que luta entao se travou amigo Engels. Nunca na minha vida assistirei a um combate mais renhido.» 172
Le processus de formation, qui ne sera clos qu'en 1875, s'allonge au fur et à mesure que se multiplient les situations difficiles. Quelques notices en sont un symptôme: elles annoncent la réapparition de l'organe 0 PensamentoSocial et qualifient d'anarchisante sa nouvelle tenaance, qualificatif qui s'avèrera faux d'apres le propre aveu de Ni. Nettlau et contrairement à ce qu'essayent de faire croire des sources contemporaines anti-autoritaires 1'1". Ainsi Nettlau sur la réapparition:
« Dies ist, soviel man weiss, nicht geschehen und über dies es spate freiheitliche Aufflackern ist gar nichts bekannt geworden.»174
Les rapports de Gneco font part d'une contre-offensive anarchiste ainsi que de plusieurs tentatives de reprise de la section par un groupement à tendance bourgeoise-libérale, traité même de « jesuita », les « republicanos-federais ».
« 0 que porém me espantou foi que os antigos sectarios da Aliança se colocaram ao meu lado e que do meio da assembleia saîsse um certo numero de indivîduos proclamando-se republicanos-federais e combatendo a constituiçao do Partido Socialista e defendendo e propondo para se constituir um club republicano-burguês. » 175
172 Gneco à Engels, 10 avril 1876, op. cit.; les suppositions de César Oliveira, voyant dans ces formules de Gneco des signes de surestimation personnelle, n'ont apparemment pas de fond vu sa personne, qui s'impose comme figure dominante du mouvement ouvrier portugais, cela au niveau pratique ainsi qu'au niveau de perception théorique.
173 Dans les Actas, nous trouvons la référence suivante du 8 août (op. cit., t. II, pp. 96-97): « Em Lisboa a nossa Associaçao sofreu muito corn estas dissençôes. Porém, ja reorganizada, animam-na ideias mais revolucionarias como 0
demonstrara brevemente a reapariçao na imprensa do peri6dico 0 Pensamento Social." (cit. de Carlos da Fonseca, Ruptura, cit., p. 238).
174 M. Nettlau, Anarchie, cit., p. 477; cf. à ce sujet Freymond, op. cit., t. III, note 41, qui se base sur: Actas, II, du 29 août 1873 et l'Ami du Peuple, de Liège, du 28 septembre 1873 (n° 13), deux sources confirmant un sursaut anti-autoritaire. Les Actas (l, p. 124) eux-mêmes contiennent un article tiré de El Condenado, du 11 septembre: « Reapareceu na imprensa 0 Pensamento Social de Lisboa que defende os principios anti-autoritarios proclamados pela imensa maioria dos internacionais." C'est là que nous sachions la seule référence à la facticité de l'événement (cit. de Carlos da Fonseca, Ruptura, cit., p. 238).
175 Gneco à Engels, 10 avril 1876, op. cit.
527
Bernhard Bayerlein
Dans ce contexte, il est important de signaler que le Volksstaat du 29 août publie, - et cela sans aucun commentaire aprofondi - le programme des républicains-fédéraux de tendance bourgeoise-fédéraliste 176 dont les finalités se réduisent en fait à transplanter l'expérience républicaine espagnole manquée au Portugal. Cet article relativement long vaut d'être cité, d'autant plus qu'il représente la seule et unique référence de fond au Portugal que nous ayons pu trouver dans cet organe jusqu'en 1875/76. Voilà bien une preuve frappante des contacts déficients au niveau international.
C'est au niveau du secteur « syndical» que les difficultés semblent être surmontées le plus rapidement, sans se heurter à de graves obstacles après les échecs des mouvements grévistes -laissant entrevoir une tendance réformiste sous-jacente, qui n'y était cachée que d'une manière imparfaite -, les internationalistes s'emploient à consolider l'aspect de la défense des organisations, négligé jusqu'alors.
Ainsi Gneco:
{( Reconhecendo esta necessidade os restos das classes e das associaçoes nomearam uma comissao que elaborou 0 estatuto que ha-de reger todas. Na nova organizaçao aproveita-se a da lnternacional espanhola (de Valencia) 177; sendo novas as bases da resistência, da contribuiçao e dos socorros.» 178
En effet, en automne 1873 est créée, à contre-courant du coopérativisme traditionnel, 1'« Associaçâo dos Trabalhadores na Regiâo Portuguesa », forte à ses débuts de quelques 3.000 membres, adoptant dès sa phase d'expansion la conception d'une association syndicale constituée au niveau national, bâtie selon le modèle esquissé au Congrès de l'A.I.T., collant à celui des unions nationales tout en restant enraciné dans un nouveau type d'associations de résistance au niveau local et régional 179.
176 {( Politische übersicht », Der Volksstaat, 29 août 1873. D'après l'indication, l'article se présente comme une transcription directe d'O Debate.
177 Au sujet de la déclaration de la Fédération de Valence, un des points forts des marxiens en Espagne, qui s'intégrait dans une tentative éphémère de construire une {( Fédération» espagnole, voir les deux documents programmatiques: «Declaracion deI Consejo Federal Marxista contra la Alianza bakuninista », Consejo Federal de la region espafiola, Valencia, 2 février 1873, La Emancipaci6n (Madrid), 8 février 1873, dans C. E. Lidia, Antecedentes y desarrollo, cit., pp. 336 et suiv. et {( Manifiesto-protesta", Federacion Valenciana, 3 février 1873, dans ibid., pp. 339 et suiv.
178 Cf. Gneco à Engels, 10 avril, op. cit. 179 Au sujet de l'A. T. n. R. P., très mal documentée jusqu'alors, voir Carlos
da Fonseca, A origem, cit., p. 86, note 20.
528
•
•
La Première Internationale au Portugal, vue à travers la Correspondance [ ... ]
Oliveira Martins commentera plus tard en ces termes dans un court aperçu sur l'histoire du mouvement ouvrier portugais rédigé pour une revue social-démocrate allemande parue en Suisse e~ raison des lois d'exception décrétées à l'époque par Bismarck, la nouvelle tentative:
{( Die Bewegung nahm in Foige des sen allmiihlig wieder zu und z::var auf s.iche.rer Basis, da die gesammelte Erfahrung d;s Zuruckfallen m die alten Fehler verhinderte. Die Lissaboner Sektionen gewannen einige Tausend neuer Mitglieder, und die Federation organisierte sich definitiv und regelrecht in Porto.» 180
C'est Gne~o qui, par une sorte d'analyse de style, communique à Engels la ~enese du nom de la nouvelle association en soulignant à cette occaSIOn une continuité ininterrompue de la virulence de la pensée internationaliste au Portugal:
{( Como vê falta ali (na palavra A.T.n.R.P.) uma palavra colocada entre Associaçao e Trabalhadores, a palavra Internacional. Contudo ha uma subtileza que tem feito desesperar a muitos: é a preposiçao na em vez de da. 0 Cosmopolitismo fica expresso por es sa ~ubtileza. A Associaçao dos Trabalhadores realiza pois um dos fms da nossa associaçao,,, 181
A ~~ mê~e époque le,s, internati,onalistes. paraissent vouloir pour la premIere fOlS - comme 1 etude des echanges mternationaux l'attesterem~dier, aux la~~nes d.ans leu:s co.nnaissances théoriques. Jusque là, le, ~e.le ~ un. a~tlV:sme l~te:natIOnahste avait quelque peu suppléé le d~fIcIt d aSSImIlatIOn theonque et la médiocrité au niveau «pédagogIque ». Or ce n'est qu'à partir d'avril-mai 1873 que l'on paraît disposer au Portugal de quelques exemplaires du Capltal sous la forme de l'édition française, que l'on devait d'ailleurs se procurer auprès d'un libraire parisien, Lafargue n'ayant pas donné suite à la demande, comme le relate Tedeschi à Engels 1'82.
{( Il [le Capital] a été recherché avec empressement dans la mesure du pays. Plus de trente exemplaires ont été immédiatement vendus. Je suis à lire celui de Nobre França." 183
180 O. Martins, «Portugal", lahrbuch für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik Hrg. von Dr. Ludwig Richter, Zürich, l, 1879-(80), 2. Halbbd., pp. 330 et suiv.: en part. p. 332.
181 Gneco à Engels, 10 avril, op. cit. 182 Il s'agit là de la première édition du tome l du Capital paru en 1873
chez Lachâtre à Paris (en livraisons).
183 Te~eschi à E~gels, 29 mai 1872, op. cit.; Nobre França à Engels, 17 août 1872, op. Clt., parle d une brochure envoyée par Lafargue.
529 34
Bernhard Bayerlein
L'effort indéniable est récompensé: le 8 août les portugais reçoivent deux exemplaires de la part de Marx, Nobre França remerciant Engels de son entremise 184.
VI
DE L'AGONIE DE L'INTERNATIONALE A L'AGONIE DES RELATIONS
(1873-1875)
A l'époque où précisément l'internationalisme au Portugal amorce un nouveau début prometteur, la correspondance, indicateur de la qualité des relations internationales, s'espace de plus en plus jusqu'à l'interruption complète en 1874/75. La lettre envoyée par Fontana à Marx en décembre 1873 paraît - tout l'indique - être le dernier signe de vie des portugais au plan international· pour longtemps. Cette communication dénote un optimisme inhabituel de la part de l'ancien dirigeant de la {( Fraternidade Operaria» :
« Aqui vai-se desenvolvendo muito a nossa assodaçao e corn muito bom espirito.» 185
Fontana prie Marx de bien vouloir rédiger un message de salutation, qui serait lu à l'occasion d'une {( soirée socialiste» prévue da~s le courant de janvier 1874, et organisée spécialement pour secounr les travailleurs du tabac, poursuivis à la suite d'une grève menée en 1873
186
•
L'ultime trace d'une correspondance entre Londres et Lisbonne date _ d'après notre inventaire - de juillet-août 1873. Dans sa lettre du 17 août citée plus haut Nobre França accuse la réception de deux lettres de la main d'Engels. Il s'agit là probablement de la réponse à l'inquiétude exprimée par Tedeschi au mois de mai et à une le~tre de Marx datée du 8 août jointe à la livraison des deux exemplaIres du Capital 187. Aucune indication ne permet d'en déduire une continuité des échanges, qui d'après des indices relativement sûrs s'interrompent abruptement à partir de la constitution de la fédération régionale.
184 Une allusion à ce sujet, ibid. 18& José Fontana à Karl Marx, Lisboa, 26 décembre 1873, IISG, Amsterdam,
Marx-Engels NachlaP.. L 1874/325. 186 Ibidem. 187 Cf. Nobre França à Engels, 17 août 1872, op. cit.
530
• La Première Internationale au Portugal, vue à travers la Correspondance [ ... ]
Ainsi il ne paraît même pas certain qu'Engels ait répondu à la lettre de França au mois d'août. En effet, le 27 août il prie Lafargue de bien vouloir lui remettre une lettre arrivée du Portugal et qu'il croit en sa possession afin de pouvoir y répondre. Lafargue dément ce fait ce qui laisse supposer qu'Engels a dû égarer la lettre à lui adressée 188.
Le hasard paraît ici - en tant qu'élément actif de l'histoire - confirmer les tendances inhérentes.
Les échanges avec le C.G. à New York paraissent poser des problèmes semblables. La dernière allusion directe à la section portugaise que nous ayons pu repérer dans la documentation de l'organe dirigeant (publiée jusqu'à présent), en forme d'une brève remarque d'Engels à Sorge, date du 25 novembre 1873, elle se borne à signaler un renforcement de la répression au Portugal.
«In Portugal sind die Leute verfolgt und müssen sich in Acht nehmen. » 189
Plus de deux ans après cette date, le secrétaire de la fédération de l'époque, A. Gneco résume l'évolution des relations internationales en indiquant que c'était après avoir reçu une communication du C.G. dans laquelle ce dernier annonçait une restructuration intérieure que le silence mutuel s'était établi :
«[ ... ] [0] Conselho GeraI do quaI recebi ha muito tempo uma carta dizendo-me que em breve me escreveria por que ia ser nomeado outro de entre os membros das federaç6es americanas segundo 0 resolvido no Congresso de 72 e até hoje nunca mais ouvi falar des te. » 190
La coupure des relations paraît évidente étant donné le rôle éphémère joué par le C.G. pendant cette période: il ne paraît même plus assumer sa fonction de {( boîte aux lettres» 191. Un exemple frappant en est l'aveu de Sorge, qui confesse dans une lettre du 12 décembre n'avoir pas jusqu'alors connaissance des résolutions et décisions prises au Congrès de Genève du mois de septembre (1), le C.G. s'y étant fait
188 Paul Lafargue à Friedrich Engels, à Londres, 27 août 1873, dans Bottigelli, op. cit., p. 493.
189 F. Engels an A. Sorge, London, 25 novembre 1873, dans Sorge, op. cit., pp. 128 et suiv.
190 A. Gneco à F. Engels, Lisboa, 18 janvier 1876, dans Treze cartas, dt., pp. 55 et suiv.
191 Papers, dt.; la restructuration dont parle Gneco pouvait être située vers 1873.
531
Bernhard Bayerlein
répresenter par un délégué ({ indirect », le vieil internationaliste français Serraillier 192. Le Volksstaat, servant durant cette période en quelque sorte de ({ bulletin d'information international », ne publie aucun texte sur le Portugal en 1874. Les internationalistes portugais, après avoir été livrés à eux-mêmes lors du difficile processus de formation à partir de 1872, puis celui de la réorganisation en 1873, sont une fois de plus abandonnés au niveau international. La constante historique et méthodologique s'impose. Seuls, ils jettent les premières bases de leur parti socialiste, qu'ils conçoivent quand même comme expression nationale d'une unité de lutte internationale.
La manière dont Engels clôt en quelque sorte le chapitre des relations, dans une lettre du 13 août 1875 qu'il envoie à Sorge, est bien révélatrice de leur lamentable état. Il doit avouer qu'il n'est pas en mesure d'envoyer aux portugais la circulaire confidentielle, servant d'invitation au Congrès de Philadelphie en 1876, congrès qui dissout de façon formelle l'Internationale, vu qu'il . .. ne possède pas les adresses (1) Hl3.
Ce n'est qu'en 1876 que la correspondance est reprise, bien sûr en d'autres circonstances, Engels répondant à une lettre de Gneco du mois de janvier de cette année-là 194. Le 14 septembre 1876 le nouveau secrétaire général du P.S.O.P. demande à Engels de lui envoyer l'adresse du C.G. -« se a hà (l) »-. Ce n'est alors que début 1877 que les portugais semblent avoir été informés de la dissolution de l'A.I.T., nouvelle que Gneco considère «bien attristante» 195.
Dans un bilan de la situation des mouvements ouvriers dans les divers pays en 1877, Engels retrace sommairement l'histoire portugaise. Il l'évoque, plein d'optimisme et de confiance en la démarquant positivement de l'exemple espagnol.
192 Cf. supra, note 165. 193 F. Engels, «Brief an den Generalrat der Internationalen Arbeiterassozla
tion in New York », 13 août 1875, dans MEW, t. XIX, p. 32. D'après cette version, il en est de même pour l'Italie. Dans la version publiée dans Sorge (op. cit., p. 146) l'Espagne est mentionnée au lieu de l'Italie.
194 Gneco à Engels, 18 janvier 1876; on trouve une référence à la réponse d'Engels dans Gneco à Engels, 10 avril, op. cit.
195 A. Gneco à F. Engels, (Lisboa), 21 janvier 1877, dans Treze cartas, cit., pp. 69 et suiv.
532
• La Première Internationale au Portugal, vue à travers la Correspondance [ ... ]
Compte tenu de la situation contemporaine, mais surtout du dévelo~pe~ent postérieur, son optimisme doit nous paraître quelque peu deplace:
«In. ~ortug~l blieb die Bewegung immer frei von der 'anarChlstIschen .. Anste~ku~g und schritt auf derselben vernünftigen Bahn vorwarts Wle III den meisten anderen Uinderni.}} 196
C'est e~, 1874/75 qu: se clôt définitivement au Portugal la période de la premlere InternatIOnale. L'époque qui s'en suit de préparation de la deuxième Internationale doit - du point de vue de ses relations internationales - être réservée à une étude postérieure.
196 F. Engels, « Die Europaischen Arbeiter im Jahre 1877 }} (The Labor Standard 1878), dans MEW, t. XIX, pp. 119-137, en part. p. 125.
533
•
J. C. SEABRA PEREIRA M. VILAVERDE CABRAL A. SILBERT J. GENTIL DA SILVA • D. H. PAGEAUX • F. MAURO • S. LOPES • M. L. NABINGER DE ALMEIDA • J. PACHECO • M. C. VOLOVITCH • E. LOURENÇO • A. NUNES M. T. SALGADO • P. RIVAS • JOEL SERRÂO • C. DA FONSECA • F. MEDEIROS • D. courO-POTACHE • B. BAYERLEIN • A. MARGARIDO • T. DUIJKER
ACTES DU COLLOQUE PARIS, 10 - 13 JANVIER 1979
FONDATION CALOUSTE GULBENKIAN
CENTRE CULTUREL PORTUGAIS
PARIS • 1982