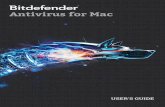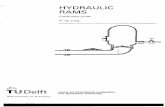Intercomparison of Two Models, ETA and RAMS, with TRACT Field Campaign Data
Introduction aux oeuvres d'Igor mac rams
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Introduction aux oeuvres d'Igor mac rams
2
Cosmogonie de la révolte
Au commencement était la musique. Car avant toutes choses, Igor était un astre errant,
une comète qui avait volé des sons aux confins de l’univers. Tombé sur terre par hasard,
il s’efforçait comme les gnostiques de retrouver des sons venus d’ailleurs.
Il composait à l’époque une musique incorporelle, mystérieusement détachée de la
chair, tout à la fois céleste et infernale, faite de volutes sonores, d’envolées, de
tournoiements de sons lancinants et répétitifs. Parfois, une voix féminine salvatrice
accompagnait le maëlstrom des mélodies naissantes, en réminiscence probable d’un
lointain paradis perdu…
Et puis il y avait eu la chute. Un déluge d’eau, une inondation qui avait emporté ses
compositions et ses projets, noyé ses rêves et son matériel.
Une chute dure et incompréhensible comme le Fatum, chassant définitivement la
musique dans un au-delà inaccessible, exilant l’artiste sur une terre battue par les
embruns marins, l’enfermant dans les frontières étriquées du petit port de Trouville.
Le peintre ayant toujours représenté pour Igor un musicien et un ange déchu, il s’était
alors tourné vers la peinture, en espérant y transcrire la voix et la musique intérieure qui
continuaient à lui parler secrètement. Il n’était pas question, pour lui, de s’y adonner de
manière mièvre et gentille, en cherchant à se souvenir du monde perdu. Pas plus que de
représenter une jolie fresque figurative de la réalité, ou encore de jouer avec les
savantes combinaisons de l’abstraction.
Puisqu’il se retrouvait englué dans la
matière, il allait la saisir à pleines mains, la
projeter dans les moindres recoins de ses
tableaux, l’amener à se reproduire jusqu’à la
nausée, en occupant le moindre centimètre de
toile vierge, avec une rage et une violence
confinant au défoulement obsessionnel.
Comme si, en triturant et en entassant cette
matière dans ses toiles, elle allait finalement
s’épuiser et le libérer –à l’image du gnostique Simon le Magicien et de ses disciples du
premier siècle qui prônaient la débauche et l’orgie pour faire jaillir l’étincelle divine
d’une chair épuisée.
Huile sur toile 60 x 80 (à vérifier)
3
Et puisque le monde n’a plus rien à voir avec la nature, il chasserait impitoyablement
cette dernière de ses œuvres, pour ne montrer
qu’un enchevêtrement de villes, de voitures, de
machines et de tuyaux, d’animaux plus ou
moins humanisés contrastant cruellement avec
des hommes bestiaux ou robotisés. Tout cela
sous un ciel apocalyptique, dans des cités
surpeuplées qui étouffent et semblent à
l’agonie.
N’y a t’il pas, dans ce geste indéfiniment
répété qui l’amène à entasser les uns sur les
autres les éléments de notre environnement
moderne, un défi ou une révolte démiurgique
qui l’amène à recréer l’univers à sa manière, à renvoyer au Créateur et à ses créatures
l’image de ce que la terre déchue est devenue, de manière parfaitement obscène ?
Langage transversal aux œuvres : une grammaire de la métamorphose
Le monde peint et restitué par Igor Mc Rams repose sur plusieurs principes, qui ne
cherchent aucunement à reproduire le réel ou à inventer une nouvelle abstraction. Elles
tendent plutôt à rendre au réel son aspect étrange et inquiétant, par une logique de la
métamorphose perpétuelle qui se moque des principes de la logique identitaire. Sans
être aucunement exhaustif, citons en quelques uns :
-Le principe de démultiplication, de mise en abysse et d’emboîtement, empêche de
croire en l’unicité d’une figure ou existence. A peine Igor dessine t’il un humain ou un
animal, qu’il va en effet le reproduire quasiment à l’infini dans l’espace de sa toile, mais
aussi dans les tableaux suivants, si bien que ses personnages sont toujours, à l’instar des
poupées russes emboîtées les unes dans les autres, unes et multiples ; à la fois ici et déjà
ailleurs, ne cessant de circuler et de se métamorphoser pour se retrouver en d’autres
lieux, dans des situations qu’il faudrait parcourir simultanément pour tenter de suivre
leur destin individuel –ce qui est bien entendu parfaitement impossible.
Huile sur toile 80 x 60 (à vérifier)
4
-Le jeu du branchement machinique et erratique du désir. Pour parodier les premières
lignes de l’Anti-Œdipe de Deleuze : partout, dans ses tableaux, ça pète, ça copule, ça
jouit et ça souffre, ça crie et ça tue, ça se met
ensemble et ça se sépare, la vie étant un
immense courant d’énergie panthéiste qui
relie entre elles les formes animées et
inanimées, au prix de monstrueux
croisements qui ne sont pas sans rappeler,
parfois, le souffle d’un Jérôme Bosch qui se
serait perdu en plein milieu du vingtième
siècle…
-La projection et la reproduction de machines sociales qui, partout, tentent de contrôler
ces flux perpétuellement mouvants du désir. Si les êtres vivants se démultiplient sans
cesse dans des tableaux métamorphosés en autant de kaléidoscopes, si le désir semble
circuler anarchiquement au mépris de toute norme morale ou sociale, ce premier
mouvement se heurte en effet perpétuellement à un ordre social qui est là pour le
contenir, le réprimer et le normaliser, en rêvant de produire un citoyen lobotomisé,
robotisé, parfaitement standardisé et interchangeable. Les tuyaux, rouages et
machineries du monde moderne, omniprésents, reçoivent ironiquement chez Igor Mac
Rams la double fonction de contenir une vie anarchique qui déborde de toutes parts, et
de constituer le cadre même du tableau…
-La trame ésotérique de mandalas aléatoires : la rencontre entre les êtres « vivants »
démultipliés à l’infini et les machineries
sociales s’organise autour de pôles latents,
répond à des logiques et à des formes qui
renouent avec les archétypes les plus profonds
de l’esprit humain. Les tableaux se déploient en
effet, tantôt sur un modèle symétrique faisant
penser à des reproductions fractales du monde,
tantôt sur des modèles énigmatiques de
mandalas, ces représentations géométriques
Huile sur toile 100x100
Huile sur toile 100x100
5
tibétaines et ésotériques supposées représenter autant le macrocosme se déployant à
partir d’un point central, que le microcosme se résorbant en un point originel. Comme
pour inciter à un autre type de lecture de chacun des tableaux, appelé à se déployer et se
résorber en chacun de nous…
Lecture chronologique : Première période microscopique et moléculaire
Sur la centaine d’œuvres d’Igor, la première partie de ses oeuvres a en commun
d’explorer la vie en se situant sur un plan microcosmique et moléculaire, c’est-à-dire en
cherchant à saisir ses manifestations humaines ou animales dans ses dimensions les plus
intimes et les plus sauvages.
Le peintre ressemble alors à un
entomologiste examinant ses congénères
comme s’il les voyait entassés dans un
zoo surpeuplé. D’où ces représentations
saisissantes d’instincts primaires : la rage
intérieure d’automobilistes coincés dans
d’improbables embouteillages,
l’abrutissement d’humains en phase de
robotisation, le déchaînement de leurs pulsions sexuelles, sodomites ou meurtrières, qui
les amènent à créer le chaos autour d’eux et à se transformer en bêtes, en découvrant ce
devenir-animal que Deleuze disait tapis au fond de chacun d’entre nous.
Dans cette première série de toiles, les personnages sont encore un minimum figuratifs
et reconnaissables, même s’ils sont issus parfois
d’un croisement entre homme et animal, souvent
sous les traits ironique d’un cochon humain. Le
monde dans lequel évoluent ces personnages est
surpeuplé et pollué, les foules étant entassées
indifféremment dans des automobiles-autocars
fantasmagoriques, des fusées ou des cités
improbables du futur, des usines d’hier et
d’aujourd’hui. Malgré l’entassement et le
confinement, la vie explose de toutes parts, avec
Huile sur toile 60 x 80 ( à vérifier)
Huile sur toile 60 x 60 (à vérifier)
6
une violence qui naît à chaque fois de l’intérieur : elle semble innerver chaque artère,
chaque vaisseau sanguin, au point que le tableau peut apparaître comme la métaphore
d’un écorché vivant, cette coupe du corps permettant de voir les viscères et les humeurs
habituellement cachées.
La construction des tableaux est beaucoup moins géométrique que courbe, faite de
formes qui se pénètrent, se mélangent, se métamorphosent et s’agrègent comme autant
de cellules vues sous l’objectif grossissant d’un microscope.
Et puis, peu à peu, au fil des toiles, les formes commencent à s’organiser de manière
plus stable, le principe d’un ordre caché semblant de plus en plus interpeller l’artiste,
jusqu’à atteindre un point d’équilibre fragile où le mouvant chaos semble enfin contenu.
Mais à quel prix ?
Seconde période macrocosmique et molaire
Dans la seconde partie de ses œuvres, Igor s’attaque à ce principe d’ordre qui structure,
encadre et organise inéluctablement le mouvant
chaos de la vie, en montrant que c’est au prix
d’un terrible nivellement, d’une standardisation
du vivant, l’individu étant alors condamné à
devenir un numéro, un rouage dans la grande
machine de la société.
Témoin de ce passage d’un ordre moléculaire (ou
nagual et invisible chez Castaneda), à un ordre
macro-social molaire (ou tonal et organisateur du
monde chez Castaneda), ses toiles changent d’ailleurs de dimension et de tonalité. Huile sur toile 100x100
Huile sur toile 100x100
7
Leur surface augmente, empruntant la forme inhabituelle d’un carré d’à peu près 1m x
1m ; leur structure devient plus rigide et géométrique, évoquant de grands symboles,
rosaces chrétiennes et mandalas orientales ;
elles mettent en exergue, de manière
obsédante, de gigantesques machines dignes
des Temps Modernes de Chaplin, aux
mécanismes et aux roues dentelées, entre
lesquelles l’individu va être impitoyablement
broyé.
La dénonciation se fait alors beaucoup plus
politique, la figure énigmatique d’un Grand
Cerf omni-puissant évoquant, au grès de l’imagination de chacun, les grandes figures du
monothéisme, le culte du chef, de l’armée ou de la police -ces forces noires et
maléfiques dénoncées par Artaud, qui tout à la fois secrètent et défendent le monstre
froid de l’Etat et de l’Unité réductrice.
Comme s’il s’attaquait à une hydre dont les têtes repoussent aussitôt que peintes, les
peintures de cette seconde période prolifèrent, Igor semblant s’épuiser à pourchasser
chaque nouvelle formation territoriale, chaque nouvel agencement machinique destiné à
organiser le monde et à broyer l’individu.
Partout, des machines découpent des corps humains, des pinces cerclent des seins ou
des sexes, broient des membres, dans une
fumée apocalyptique et asphyxiante.
Jusqu’à ne plus présenter, à la fin de ce cycle,
qu’un univers machinique dont les êtres
humains, et même le Grand Cerf en tant que
Grand Ordonnateur paranoïaque, semblent
étrangement absents. La machinerie politico-
économique du monde moderne n’est-elle pas
devenue à ce point folle, qu’elle fonctionne
désormais de manière autonome, sans contrôle
et sans besoin des humains ? Huile sur toile 60 x 60 (à vérifier)
8
Les apories de la dernière période
Plus le temps passe, plus Igor Mac Rams peint de manière frénétique, souvent toute la
nuit, sans s’arrêter pour prendre le temps de sortir ou de manger. Il nous disait alors
qu’il avait besoin de finir sa série pour s’en libérer et revenir, peut-être, à la musique.
Comme s’il avait besoin d’expulser ces créatures et ces formes démoniaques sur la toile,
pour mieux s’en libérer définitivement. Mais à chaque fois, il annonçait qu’il lui
faudrait encore quelques toiles, 4 ou 5 , pour définitivement finir son cycle...
Les machines et les personnages se démultiplient à l’infini, la plongée dans les tréfonds
du corps et dans ses viscères semble encore
s’approfondir : poumons, cœur, organes sexuels,
seins, cellules, apparaissent parfois au centre de
la toile, toujours encadrés par les forces de la
société et d’un corps machinique soumis aux lois
de la productivité. Ils sont souvent menacés,
gangrenés par la figure du Grand Crabe, comme
la menace d’un cancer innommable qui rongerait
la vie de l’intérieur.
Comme si le peintre pressentait la présence d’un mal invisible qui, tapi au plus profond
de ses chairs, s’apprêtait à ronger ses nerfs et à
s’étendre à tous ses organes, à tous ses
membres. Alors, comme pour exorciser ce mal,
il peint des tableaux qui ressemblent désormais
à des vitraux, dans les couleurs froides et
bleues du ciel, mais aussi de la mort…
A la fin, surgissent dans ses dernières toiles le
thème des têtes humaines, qui occupent
désormais tout l’espace de la toile, et dans
lesquelles on a l’impression que ses mondes
précédents viennent se résorber. Est-ce pour indiquer que, finalement, tout se trouve à
l’intérieur de soi, que le combat se livre dans la tête et le cerveau de chacun ? Nul ne
saurait le dire. Même pas Igor Mac Rams, qui s’est consumé et brûlé à son art, en étant
frappé soudainement par une terrible maladie qui allait le laisser la plupart du temps
Huile sur toile 60 x 60 (à vérifier)
Huile sur toile 60 x 60 (à vérifier)
9
alité et incapable de se servir de ses pinceaux. Une nouvelle et seconde chute dont il ne
se remettrait pas.
Pourtant, je suis persuadé que jamais il n’a cessé d’entendre, même dans la symphonie
grinçante de ses tableaux et malgré les souffrances de sa maladie, les mesures cachées
d’un air de musique indicible, venue d’ailleurs : jusqu’à la fin, les rares amis qui lui
demeuraient fidèles ont pu le voir se raccrocher à sa guitare, à tenter de saisir des
gammes et des notes venues de nulle part…