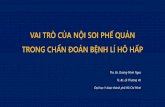Analyse critique du modèle immunologique du soi et du non-soi et de ses fondements métaphysiques...
-
Upload
thomaspradeu -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Analyse critique du modèle immunologique du soi et du non-soi et de ses fondements métaphysiques...
i
unologieseet mecircmee rejeteacuteotion deant aux
erningich
yfnon-selfhypothesisn of
C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
Immunologie Immunology
Analyse critique du modegravele immunologique du soi et du non-soet de ses fondements meacutetaphysiques implicites
Thomas Pradeuablowast Edgardo D Carosellac
a Agreacutegeacute de philosophie deacutepartement de philosophie de lrsquoEacutecole normale supeacuterieure UlmndashParis Franceb Visiting Fellow at Harvard University History of Science Department Science Center 1 Oxford Street Cambridge MA 02138 USA
c Commissariat agrave lrsquoeacutenergie atomique amp Service de recherches en heacutemato-immunologie (DSVCEA) agrave lrsquoInstitutuniversitaire drsquoheacutematologie de lrsquohocircpital Saint-Louis CEA 1 av Claude-Vellefaux 75475 Paris cedex 10 France
Reccedilu le 16 janvier 2004 accepteacute le 26 avril 2004
Preacutesenteacute par Edgardo D Carosella
Reacutesumeacute
Un examen des concepts utiliseacutes par lrsquoimmunologie conduit agrave srsquointerroger sur lrsquoorigine et la leacutegitimiteacute des notions desoiet denon-soi situeacutees au cœur du modegravele theacuteorique dominant dans cette science Toute reacuteflexion theacuteorique sur lrsquoimmdoit se donner pour fin la deacutetermination drsquouncritegravere drsquoimmunogeacuteniciteacute crsquoest-agrave-dire la deacutefinition opeacuteratoire des conditiondans lesquelles une reacuteaction immunitaire a lieu ou nrsquoa pas lieu Or une double critique conceptuelle drsquoune part et fondeacutesur des reacutesultats expeacuterimentaux drsquoautre part du vocabulaire du soi et du non-soi permet de montrer lrsquoimpreacutecisionlrsquoinadeacutequation de la dichotomie soinon-soi Il apparaicirct alors que le modegravele du soi et du non-soi doit ecirctre revu voirAgrave partir de cette critique on peut proposer une autre hypothegravese theacuteorique pour lrsquoimmunologie fondeacutee sur la ncontinuiteacute Lrsquolaquo hypothegravese de la continuiteacute raquo preacutesenteacutee ici srsquoefforce de suggeacuterer un critegravere drsquoimmunogeacuteniciteacute eacutechappreproches preacuteceacutedemment adresseacutes au modegravele du soiPour citer cet article T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327(2004) 2004 Acadeacutemie des sciences Publieacute par Elsevier SAS Tous droits reacuteserveacutes
Abstract
Critical analysis of the immunological selfnon-self model and of its implicit metaphysical foundations An examinationof the concepts used in immunology prompts us to wonder about the origins and the legitimacy of the notions ofself andnon-self which constitute the core of the dominant theoretical model in this science All theoretical reflection concimmunology must aim at determining a criterion ofimmunogenicity that is an operational definition of the conditions in whan immune reaction occurs or does not occur By criticizing both conceptually and experimentally the selfnon-self vocabularwe can demonstrate the inaccuracy and even the inadequacy of the dichotomy of selfnon-self Accordingly the selmodel must be reexamined or even rejected On the basis of this critique we can suggest an alternative theoreticalfor immunology based on the notion ofcontinuity The lsquocontinuity hypothesisrsquo developed here attempts to give a criterio
Auteur correspondantAdresse e-mail thomaspradeuensfr (T Pradeu)
1631-0691$ ndash see front matter 2004 Acadeacutemie des sciences Publieacute par Elsevier SAS Tous droits reacuteserveacutesdoi101016jcrvi200404003
482 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
immunogenicity that avoids the reproaches leveled at the self modelTo cite this article T Pradeu ED Carosella C RBiologies 327 (2004) 2004 Acadeacutemie des sciences Publieacute par Elsevier SAS Tous droits reacuteserveacutes
Mots-cleacutes soi autoimmuniteacute toleacuterance systegraveme immunitaire philosophie de lrsquoimmunologie continuiteacute
Keywordsself autoimmunity tolerance immune system philosophy of immunology continuity
0sicalthey
emunectly
of
an
n-iswein
ntis
itydid
forpicthefsthethefut
ted
ndchshe
t asthe
st-
delintine
asrela-nota-notn-
therrel-an
ich
usttwosesex-we
rstel
f
tedi-
Abridged English version
Since it was suggested by Burnet in the 194the selfnon-self model has formed the theoretbackdrop to all immunology This model answersquestion of giving a criterion of immunogenicity btendering two propositions (1) the immune systdoes not react against the self and (2) the immsystem reacts against the non-self But what exadoes the use of such metaphysical notions asself andnon-self mean in an experimental field of biologyWhy should there be a relation between the issueidentity (the self) and the system of defense oforganism (immunity)
Herein lies the inherent tension in the selfnoself model Biological identity is not merely butpredominantly genetic we are all unique becauseare distinguishable by our genomes understoodtheir relations to the cellular and general environmeand not by the specificity of our immune cells whichsimply a phenotypic manifestation of the individualof our genes Thus the question remains whyimmunologists elect to use the termself to describeorganismal defense We can give two reasonsthis choice The first is the extraordinary phenotydiversity of immune components The second isimplicit conceptual shift fromidentity to defense ointegrity relying on the definition of immune cellas lsquodefensiversquo cells immunologists postulated thatissue faced by the immune lsquoselfrsquo was not properlyquestion of identity (who am I) but the question omaintaining the integrity of the organism throughoits changes (how am I protected that is againswhich foreign entities do I have to be protectto remain myself) As we will show this tensionand this conceptual shift have metaphysically ainappropriately burdened the immune lsquoselfrsquo whiis not the synonym of lsquoidentityrsquo that it pretendto be Burnet introduced a dynamic vision of tself as somethingacquired Following in his wake
immunologists have tried to understand the self noa fixed and determined thing but on the basis ofprocesses by which the immune systemlearnsnot toattack the self in its embryogenic or immediately ponatal periods
Under close examination the immunological moof selfnon-self proves to be false The starting poof our criticism is an examination of the negationthe notionnon-self what does the lsquonon-rsquo mean in thphrase lsquonon-selfrsquo As Aristotlersquos philosophy of logicshows there are only four meanings ofoppositionthings can be opposed as affirmation and negationprivation and possession as contraries and astives To take the first meaning the non-self canbe thenegationof the self since affirmation and negtion characterize propositions not notions It canbe theprivationof the self either because for an orgaism the self and the non-selfcoexist But it is equallyimpossible to say that the self is thecontrary of thenon-self because as Aristotleexplains theindividualsubstance (which is precisely what the notion ofselfaims to represent) has no contrary Since all the omeanings have been ruled out only opposition asatives remains conceivable One may think this isadequate meaning the lsquonon-selfrsquo is everything whdoes not belong to the lsquoselfrsquo so it is definedin relationto the lsquoselfrsquo However an opposition as relatives mbe founded on a trenchant distinction between therelative parts The second part of our criticism uarguments derived from experiments to show the inistence of such a clear-cut distinction from whichconclude that the notion of lsquonon-selfrsquo is meaningless
Three elements show the inaccuracy of the fifundamental proposition of the selfnon-self mod(the immune system does not react against the sel)
(1) Non-pathological autoreactivity of immune cellsafter selection in the thymus cells are selecwhen they reactweakly to the endogenous antgens and not when theydo not react Lympho-
T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492 483
llsby ais
us
ge
del
psu
ho-kin
l
hatriesotate
eofate
o-st
ival
ebutenyr extwo
therd)an-
eto
u-
he-ivene akof
rsbalcerytol-hadd
lieelf
thatingb-hetio-iesentep--
one
Wem-nd
sisbe-ry-
m-d
f astyen-ne
cytes can be understood on the model of NK cewhich do not go through the selection processgeneration of diversity but play nonethelesskey role in the body Everything in the thymusa question ofactivatoryandinhibitory signals
(2) Peripheral autoreactivity lymphocytes surviveon-ly if they are regularly stimulated by endogenoantigens
(3) Autoimmune diseases if understood in linkawith normal autoreactivity
The second proposition of the selfnon-self mo(the immune system reacts against the non-self) is alsoinadequate as three experimental remarks encalated by the notion of immunetolerance prove
(i) tolerance of exogenous and potentially patgenic entities (for example bacteria on the sor in the gut)
(ii ) tolerance of grafts especially the foeto-maternatolerance
(iii ) chimerism
From all these observations we can conclude tcontrary to what the self model asserts the categoof lsquoimmunogenrsquo and lsquoexogenousrsquo are actually nequivalent Thus the only remaining possibility this the opposition asrelative cannot define the immunnon-self The opposition in the term lsquonon-selfrsquo isthereforemeaningless The self model fails to definthe limit of self and non-self and so the dialecticself and non-self initiated by Burnet seems inadequas a whole
However to show the inadequacy of the immunlogical selfnon-self model is not enough We musuggest another hypothesis for immunology The rhypothesis we develop here can be called thecon-tinuity hypothesis According to this hypothesis thimmune system does not respond to lsquonon-selfrsquoto every break of spatio-temporal continuity betwethe immune receptors and the antigens to which thereact (whether these antigens are endogenous oogenous) The continuity hypothesis is based onmain ideas First immunity has abeginning since or-ganisms have a period of immune tolerance (wheembryonic period or immediately post-natal periothus immunity is not an innate characteristic oforganism Everything that ispresentwhen the selec
-
-
tion of lymphocytes occurs will not trigger an immunreaction later Secondly autoreactivity is inherentnormal immunity the immune system demands acon-tinuous selection since a lymphocyte must be stimlated regularly byendogenousantigens to survive
Why is the continuity hypothesis better than tselfnon-self model Mainly because it is more explicative that is it provides a single comprehensexplanation for the triggering of immune reactiowhereas the selfnon-self model is obliged to definmultiplicity of exceptions to its general rule We thinthat at least five domains display the superioritythe continuity model (1) autoimmunity (2) cance(3) uninterruptedness between immunity and gloregulation of the organism (4) immune toleran(5) induction of tolerance (desensitization provisotolerance for paternal antigens after pregnancyerance for some pathogens with which we havea long contact greater graft tolerance after a blootransfusion from the organ donor etc)
Two philosophical conceptions of identity underthe self model and the continuity hypothesis The smodel understands identity as asubstance(the preser-vation of a metaphysical core throughout changesis defense of integrity only the changes originatfrom the lsquoinsidersquo are tolerable) on the model of Leinizrsquos philosophy The continuity hypothesis on tother hand leans on the definition of identity as spatemporal continuity on the model of the philosophof Locke and Hume Since their philosophies represa metaphysical deflation of the substantialist conction we think that it is time for immunology to reproduce this deflation in its own domain
Is the continuity hypothesis a simple reformulatiof the self model the only difference being that wdefine identity by continuity instead of substancethink not the continuity hypothesis explains phenoena that cannot be explained by the self model amoreover if we assimilate the continuity hypotheand the self model we risk repeating the confusiontween the two meanings and lsquosubstantializingrsquo evething in immunology
The continuity hypothesis has one feature in comon with the network theories of immunity initiateby N Jerne immune reactions are conceived operturbationsof the system However the continuihypothesis differs from these theories on a fundamtal issue while network theories describe the immu
484 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
nrsquoler-
iveon-itythe
us)anex-theof
an-rsquoileulvo-
te
olo-e
seacutesge) Laeacutevi-
ac-treitrmeern-nereacute-
iffeacute-elle
leeeacute-es
foistrentn-ffeacute-ter-iron-ett duestla-
aceala-
t agrave
tdif-rmeegrave-me
tsite
est
ri-on-enim-s
system as closed and self-defining the continuity hy-pothesis aims atopeningthe system mainly with theidea of induction of tolerance (a supposedly lsquoforeigelement can be integrated into an organism and toated)
Thus immune identity is defined not by defensreactions towards all exogenous entities but in a lsquoctinuistrsquo way that is as the spatio-temporal continuof the reactions between the immune receptors andantigenic sites (whether endogenous or exogenoWe can then conceive of the biological identity asopenidentity that deals with both endogenous andogenous elements in order to determine eventuallycombined (lsquoimpurersquo) and always precarious naturea given organism
1 Introduction
Depuis sa formulation par Burnet agrave partir desneacutees 1940[1] le modegravele du soi et du non-soi ndash qusoit implicitement accepteacute (pour ne citer qursquoun sexemple mais dont le titre est particuliegraverement eacutecateur voir[2]) clairement revendiqueacute[3] ou criti-queacute [4] ndash constitue lrsquoarriegravere-plan theacuteorique de toula production scientifique en immunologie[5] Lrsquouti-lisation des termes meacutetaphysiques desoiet denon-soidans une science expeacuterimentale comme lrsquoimmungie est eacutetonnante drsquoougrave lrsquoideacutee drsquoune eacutevaluation critiqude ce modegravele (nous eacutecrirons les motssoi et non-soien italiques lorsqursquoil srsquoagit des termes ou notionentre guillemets lorsqursquoil srsquoagit des concepts utilispar le modegravele du soi et dont nous critiquons lrsquousaet sans signe particulier dans tous les autres casviseacutee drsquoensemble de notre examen est la mise endence drsquouncritegravere drsquoimmunogeacuteniciteacute crsquoest-agrave-dire ladeacutetermination de ce qui deacuteclenche ou non une reacutetion immunitaire dans un mecircme organisme Agrave ce tilrsquoobjectif de cet article est triple Drsquoabord il srsquoagde comprendre quel est le sens speacutecifique des tesoi et non-soien immunologie Ensuite de montrpourquoi le modegravele immunologique du soi et du nosoi devrait ecirctre revu voire abandonneacute agrave partir drsquoudouble critique conceptuelle et fondeacutee sur dessultats expeacuterimentaux des termessoi et non-soi En-fin nous proposerons une hypothegravese explicative drente mettant en avant la continuiteacute spatio-tempordes reacuteactions entre les reacutecepteurs et les ligands
s
2 Lrsquoeacutequivoque situeacutee au cœur du modegravele du soi etdu non-soi
Agrave titre provisoire nous pouvons consideacuterer queterme desoi biologique est un synonyme du termdrsquoidentiteacutebiologique qui deacutesigne lrsquoensemble des dterminants qui font qursquoun organisme est diffeacuterent dautres organismes Un tel laquo soi raquo deacutesigne agrave lalrsquo uniciteacute de chaque individu (qui est le seul agrave ecirctel qursquoil est agrave lrsquoexception drsquoindividus geacuteneacutetiquemeidentiques) et sadistinction spatiale et environnemetale(mecircme des jumeaux vrais par exemple sont dirents en ce qursquoils occupent des lieux distincts et inagissent de maniegraveres dissemblables avec leur envnement) Or puisque lrsquoimmunologie depuis Burnse deacutefinit elle-mecircme comme la laquo science du soi enon-soi raquo[6] la question se pose de savoir quelle rapport entre lrsquoidentiteacute telle que nous venons dedeacutefinir et lrsquoimmuniteacute Lrsquoimmuniteacute qui deacutesigne eacutetymologiquement une exemption (immunitas) a eacuteteacute deacutefiniecomme la capaciteacute qursquoa un organisme de reacuteagir fagrave des agents pathogegravenes afin drsquoeacutechapper agrave la mdie et donc comme sa reacuteaction dedeacutefensecontre detels agents Lrsquoeacutequivoque du modegravele du laquo soi raquo tience rapprochement implicite entreidentiteacute (uniciteacute etdistinction) etsystegraveme de deacutefensede lrsquoorganisme Eneffet si drsquoune part le termesoi deacutesigne simplemenun organisme et le fait que chaque organisme estfeacuterent des autres alors on ne voit pas en quoi ce terelegraveverait de lrsquoimmunologie (nous verrons qursquoil relverait plutocirct de la geacuteneacutetique) si drsquoautre part le tersoi fait reacutefeacuterence agrave uneinteacutegriteacute de lrsquoindividu qursquoilsrsquoagirait dedeacutefendre de maintenir (contre des agenpathogegravenes) alors il dissimule une confusion implicentre lrsquoexogegraveneet le dangereux puisque lrsquoon postulealors que tout ce qui est exteacuterieur agrave lrsquoorganismesusceptible de lui nuire
3 Soi biologique et soi immunitaire
Le soi biologique est principalementgeacuteneacutetiquemecircme srsquoil nrsquoest pas uniquement geacuteneacutetique[7] Lrsquouni-citeacute de lrsquoindividu repose sur lrsquouniciteacute de son patmoine geacuteneacutetique comprise en relation avec lrsquoenvirnement cellulaire et avec le milieu de lrsquoorganismegeacuteneacuteral et non sur la speacutecificiteacute de ses cellulesmunitaires Les reacutecepteurs immunitaires ainsi que le
T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492 485
liteacuteuesanthro-
es-e
uiteonsrs
untheacute-
im-nitrai-cep
t
e
ourt agrave
enteeacute-
saireire
m-
rendtionaisi denuer
leire
uende
on-mele
m-hi-
ntri-r
sens
clu-uelnousce
non-aunesiga-estsoi raquo
e laon-
rtente le
So-
esseacute-ant
moleacutecules du complexe majeur drsquohistocompatibi(CMH) ne sont qursquoune manifestation pheacutenotypiqdrsquoune diversiteacute fondamentalement geacuteneacutetique reposur la combinatoire de lrsquoheacutereacutediteacute (brassages intercmosomique et intrachromosomique) Lrsquoidentiteacutebiolo-gique de chaque ecirctre vivant autrement dit ladiversiteacutedes organismes y compris au sein drsquoune mecircmepegravece relegraveve prioritairement de lrsquoheacutereacutediteacute qui se situen amont de la speacutecificiteacute immunitaire
Deux raisons cependant expliquent que agrave la sde Burnet les immunologistes aient placeacute les notide soi et denon-soiau cœur de leur discipline alomecircme que rien ne laisse penser a priori que lrsquoimmuniteacuterenvoie agrave lrsquoidentiteacute La premiegravere raison repose surfait clairement eacutetabli lesreacutecepteurs immunitaires eles moleacutecules du CMH appartiennent certes au pnotype mais leur diversiteacute est de tregraves loin la plusportante de lrsquoorganisme agrave tel point qursquoon les deacutefiparfois comme sa laquo carte drsquoidentiteacute raquo La deuxiegravemeson en revanche se fonde sur un glissement contuel implicite et non deacutemontreacute de lrsquoideacutee drsquoidentiteacuteagrave lrsquoideacutee dedeacutefense de lrsquointeacutegriteacuteet enfin agrave lrsquoideacutee delutte contre tout ce qui estexogegravene une fois lrsquoim-muniteacute deacutefinie comme ladeacutefensecontre tout agenpathogegravene son rocircle a eacuteteacute penseacute comme lemaintiendans le tempsde lrsquoidentiteacute de lrsquoorganisme crsquoest-agrave-dirlrsquoabsence drsquoune quelconquemodificationde lrsquoindividupar des entiteacutesexogegravenes(seules les modificationsen-dogegraveneseacutetant consideacutereacutees comme acceptables plrsquoorganisme) Or le modegravele du soi et du non-soi eslrsquoorigine de ce glissement preacutesent de maniegravere eacutevidchez Burnet[8] alors qursquoil est absent chez un prdeacutecesseur de Burnet comme Metchnikoff[9] Un telmaintiende lrsquoidentiteacute qui fait du laquo soi raquo uneforteresseagrave deacutefendre perpeacutetuellement a un point de deacutepart danle temps agrave savoir la fin de la toleacuterance embryonnou immeacutediatement post-natale le laquo soi raquo immunitaestacquis(par la seacutelection des cellules immunocopeacutetentes) et non inneacute[10] Degraves lors que lrsquoon prendconscience de ce glissement conceptuel on compque le laquo soi raquo immunitaire ne reacutepond pas agrave la queslaquo qui suis-je raquo (dans mon uniciteacute drsquoecirctre vivant) mlaquo comment suis-je proteacutegeacute raquo (crsquoest-agrave-dire agrave lrsquoabrquelles entiteacutes eacutetrangegraveres dois-je rester pour contiagrave ecirctremoi-mecircme) et en ce sens ilnrsquoest pasle syno-nyme de lrsquoidentiteacute biologique qursquoil preacutetend ecirctre
Nous voudrions agrave preacutesent montrer pourquoimodegravele du soi et du non-soi doit ecirctre revu vo
-
rejeteacute[11] Nous emprunterons deux voies de critiqla premiegravere philosophique (conceptuelle) la secofondeacutee sur des reacutesultats expeacuterimentaux
4 Rejet philosophique du modegravele du soi et dunon-soi
Lrsquoexamen conceptuel du modegravele du soi et du nsoi conduit agrave la remise en question de la notion mecircde non-soi Le problegraveme est le suivant quel estsens de la neacutegation dans lrsquoexpression laquonon-soi raquo Pour reacutepondre agrave cette question il est utile de coprendre quelles sont les diffeacuterentes significations plosophiques de lrsquoideacutee drsquoopposition Comme le montreAristote[12] on peut en logique distinguer seulemequatre types drsquooppositions (1) la neacutegation (2) la pvation (3) la contrarieacuteteacute (4) lrsquoopposition relative Onous allons prouver agrave preacutesent qursquoaucun de cesne peut srsquoappliquer agrave lrsquoexpression laquonon-soi immuni-taire raquo Pour ce faire nous allons proceacuteder par exsion nous allons montrer par lrsquoexamen conceptque seul le quatriegraveme sens est envisageable puismontrerons par lrsquoexamen expeacuterimental que mecircmequatriegraveme sens est inapplicable
Premiegraverement on ne peut pas comprendre le laquosoi raquo comme lrsquoopposeacuteneacutegatif du laquo soi raquo car dans llogique aristoteacutelicienne la neacutegation consiste agrave nierproposition(ce qui veut dire tregraves simplement ceci la proposition laquo il est assis raquo est vraie alors sa neacutetion agrave savoir la proposition laquo il nrsquoest pas assis raquoneacutecessairement fausse) Or le laquo soi raquo et le laquo non-sont desnotions et non despropositions Deuxiegraveme-ment le laquo non-soi raquo nrsquoest pas laprivation du laquo soi raquoau sens par exemple ougrave la ceacuteciteacute est la privation dvue puisque lrsquoon constate que le laquo soi raquo et le laquo nsoi raquo pour un individu donneacutecoexistent Troisiegraveme-ment lrsquoopposition commecontrarieacuteteacutedoit-elle aussiecirctre rejeteacutee car comme le montre Aristotela sub-stance premiegraverendash qui deacutesigne tel individu particuliele support permanent des changements qui affeccet individu crsquoest-agrave-dire tregraves exactement ce que vislaquo soi raquo ndashnrsquoa pas de contraire[13] En effetrien nrsquoestle contraire de lrsquoindividualiteacute on ne peut pas direpar exemple que Protagoras est le laquo contraire raquo decrate Lrsquoindividu se comprend agrave partir de lrsquoalteacuteriteacute (dautres individus) ndash sans quoi il ne pourrait preacuteciment pas srsquoindividualiser ndash mais il nrsquoa pas pour aut
486 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
le
par-ent
uxs al-ntalent
mblear-urrai raquo
ulede
unelaquo lee leen-en-eacutevi-
oi raquo
gu-cel-ires paibi-es
ledes
et
hy-
uessusiqueaite-rsquoor-
rpreacute-lantpli-sles
lade
arceto-ais
t agraveme
yteir auest
metretidera-t agravereacute-
e lapo-
des
lesineacute-lec-rsquoougrave
-
de contraire Seul reste possible par conseacutequentquatriegraveme sens lrsquooppositionrelative le laquo non-soi raquoest au sens matheacutematique lecompleacutementdu laquo soi raquocar tout eacuteleacutement qui nrsquoappartient pas au laquo soi raquo aptient neacutecessairement au laquo non-soi raquo et reacuteciproquemCependant lrsquoopposition des relatifs doit pouvoir srsquoap-puyer sur un critegravere de distinction clair entre les deensembles compleacutementaires ainsi deacutefinis Or noulons montrer agrave preacutesent gracircce agrave lrsquoexamen expeacuterimeque le laquo soi raquo et le laquo non-soi raquo immunitaires ne peuvpreacuteciseacutement pas ecirctre consideacutereacutes comme des enseexclusifs tout ce qui nrsquoappartient pas agrave lrsquoun apptenant neacutecessairement agrave lrsquoautre Degraves lors on porejeter lrsquoideacutee selon laquelle lrsquoopposition entre le laquo soet le laquo non-soi raquo est drsquoordrerelatif (seul sens retenapregraves lrsquoexamen conceptuel) et donc affirmer queterme mecircme de laquo non-soi raquo immunitaire est deacutenueacutefondement
5 Rejet expeacuterimental du modegravele du soi et dunon-soi
Les deux propositions fondamentales du modegravele dsoi et du non-soi sont (a) laquo le systegraveme immunitairedeacuteclenche pas de reacuteaction contre le soi raquo et (b)systegraveme immunitaire deacuteclenche une reacuteaction contrnon-soi raquo Or toute une seacuterie de donneacutees expeacuterimtales prouvent que ces deux propositions fondamtales sont erroneacutees Commenccedilons par mettre endence lrsquoinexactitude de la premiegravere proposition
51 Inexactitude de la proposition laquo le systegravemeimmunitaire ne deacuteclenche pas de reacuteaction contre s
511 Seacutelection thymique la neacutecessaireautoreacuteactiviteacute non-pathologique et la notion delaquo fenecirctre de reacuteactiviteacute raquo
La seacutelection thymique se situe au cœur de lrsquoarmentation en faveur du modegravele du soi Pour leslules T seul importe le laquo soi peptidique raquo crsquoest-agrave-dlrsquoensemble des peptides seacutelectionneacutes et preacutesenteacuteles moleacutecules du complexe majeur drsquohistocompatliteacute [14] Or les lymphocytes ne sont que lrsquoun dacteurs de lrsquoimmuniteacute Degraves lors est-on certain quemodegravele du soi et du non-soi vaut au-delagrave du caslymphocytes pour tous les acteurs de lrsquoimmuniteacute
s
r
mecircme qursquoil convient pour comprendre la seacutelection tmique en tant que telle Les cellulesnatural killers(NK) par exemple nrsquoont pas de reacutecepteurs speacutecifiqdrsquoun antigegravene preacutecis elles nrsquoont pas subi le procesde seacutelection par geacuteneacuteration de diversiteacute caracteacuteristdes lymphocytes et pourtant elles assurent parfment des fonctions immunitaires indispensables agrave lganisme sans deacuteclencher de reacuteaction contre lui[15]Peut-ecirctre avons-nous eu jusqursquoagrave preacutesent une intetation abusive de la seacutelection lymphocytaire en parde laquo soi raquo et de laquo non-soi raquo alors qursquoavancer une excation en termes drsquointeacutegration de signaux activateuret inhibiteurs permettrait de ne pas opposer celluNK et lymphocytes B et T Lrsquoideacutee selon laquelleseacutelection lymphocytaire assurerait la suppressiontoute autoreacuteactiviteacute est erroneacutee non seulement pqursquoenviron 4 agrave 6 des lymphocytes fortement aureacuteactifs eacutechappent agrave lrsquoeacutelimination dans le thymus maussi et surtout parce que seuls les lymphocytesfaible-ment autoreacuteactifssont seacutelectionneacutes Contrairemence qursquoavance le modegravele du soi et du non-soi et mecircen conservant sa propre terminologie un lymphocpour ecirctre seacutelectionneacute doit non pas ne pas reacuteaglaquo soi raquo mais reacuteagir faiblement au laquo soi raquo Lrsquoenjeudonc la deacutefinition drsquounefenecirctre de reacuteactiviteacute La seacute-lection des lymphocytes pose en effet un problegravedeacutecisif comment dans le thymus lrsquointeraction enun reacutecepteur de lymphocyte T et un complexe pep+ moleacutecule du CMH peut-elle conduire agrave la matution des thymocytes durant la seacutelection positive ela mort cellulaire durant la seacutelection neacutegative Laponse tient sans doute en ceci lrsquoaffiniteacuteet lrsquointensiteacutedes signaux doivent ecirctre diffeacuterentes dans le cas dseacutelection neacutegative et dans le cas de la seacutelectionsitive [16] Par conseacutequent non seulement onpeutramener les notions de laquo soi raquo et de laquo non-soi raquo agravedonneacutees plus claires relatives agrave dessignauxactivateursou inhibiteurs (possibiliteacute largement suggeacutereacutee parcellules NK) mais mecircme ondoit le faire sans quolrsquoon ne pourrait pas comprendre que la seacutelectiongative ne vienne pas tout simplement annuler la seacutetion positive en deacutetruisant toutes les cellules T Dlrsquoideacutee de laquo fenecirctre de reacuteactiviteacute raquo une reacuteactionfaibleinduit la seacutelectionpositive (survie) alors qursquoune reacuteaction forte a pour conseacutequence la seacutelectionneacutegative(mort par apoptose)
T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492 487
onsom-our
des
ourin-rieneacute-eti seme
cep-
in-nteacute
ivegitel-
n-ionresrsquoenunhescel-
antqueageleacuteeor-
nce
yan
dece
ulesim-
raitsoi
ndreca-t lesialeest
tretionu-
tielsrsdes
o-ans
a-le deires lend
ndeon-r du-ouveuneagrave
i-a-ventsoi
ur la
par
512 Lrsquoautoreacuteactiviteacute des lymphocytes dans lesystegraveme peacuteripheacuterique
Reacutecemment il a eacuteteacute montreacute que les interactientre les reacutecepteurs des lymphocytes T et les cplexes CMH + peptide sont aussi fondamentales ple maintiendes cellules T dans les organes lymphoiumlpeacuteripheacuteriques que pour leurseacutelectiondans le thy-mus[17] Loin donc drsquoecirctre seulement essentielles pla seacutelection initiale des lymphocytes T seules cesteractions peuvent garantir leur survie agrave la peacuteripheacuteLe maintien des cellules T naiumlves agrave la peacuteripheacuteriecessite un contactcontinu entre leurs reacutecepteursles complexes CMHndashpeptide Ces interactions quproduisent dans le systegraveme peacuteripheacuterique tout comcelles qui ont lieu dans le thymus engagent les reacuteteurs T et des constituantsendogegravenes(du laquo soi raquo) ilnrsquoy a rien drsquoexogegravene dans la moleacutecule du CMH de lrsquodividu et dans ses propres peptides qui sont preacuteseagrave la surface des cellules de lrsquoorganisme En deacutefinitun lymphocyte T ne se maintient en vie que srsquoil reacuteacontinucircment au laquo soi raquo Ainsi non seulement les clules lymphocytairespeuventreacuteagir au laquo soi raquo mais eoutre elles ne peuvent survivreqursquoenreacuteagissant continucircment au laquosoi raquo Lrsquoautoreacuteactiviteacute est une conditsine qua non de la survie des cellules immunitaiet donc elle se situe au cœur de lrsquoimmuniteacute loin dconstituer comme on lrsquoa cru pendant longtempsessentiel dysfonctionnement Agrave ce titre les rechercreacutecentes sur la genegravese et le fonctionnement deslules T reacutegulatrices (TReg) CD4+CD25+ qui inhibentlrsquoactiviteacute des autres cellules immunitaires permettde mettre fin agrave une reacuteponse immune et drsquoeacuteviterles tissus de lrsquoorganisme ne subissent des dommconseacutecutifs agrave une reacuteponse inflammatoire incontrocircsont venues confirmer les ideacutees drsquoautoreacuteactiviteacute nmale (non pathologique) et de maintien de la toleacuterapeacuteripheacuterique En effet drsquoune part les cellules TReg re-quiegraverent pour ecirctre seacutelectionneacutees un reacutecepteur T aune forte affiniteacute pour un peptide du laquo soi raquo[18] etdrsquoautre part on constate que des souris priveacuteescellules TReg meurent de maladies auto-immunesqui indique que la geacuteneacuteration systeacutematique de cellTReg est indispensable pour maintenir la toleacuterancemunitaire agrave la peacuteripheacuterie[19]
513 Les maladies auto-immunesLrsquoexistence de maladies auto-immunes ne sau
ecirctre en soi un argument contre le modegravele du
s
s
t
puisque celui-ci a preacuteciseacutement eacuteteacute eacutelaboreacute pour recompte de la possibiliteacute et indissociablement duractegravere exceptionnel de telles maladies Cependanmaladies auto-immunes montrent la faiblesse initde la formulation du modegravele degraves le deacutepart il srsquodonneacute pour objectif de deacutemontrer larareteacuteextrecircme delrsquoauto-immuniteacute et non sonimpossibiliteacute admettant lapossibiliteacute des reacuteactions immunitaires dirigeacutees conle laquo soi raquo mais la consideacuterant comme une exceppathologique Or comme nous lrsquoavons souligneacute lrsquoatoreacuteactiviteacute est en fait lrsquoun des fondements essendrsquoun fonctionnement normal de lrsquoimmuniteacute Degraves lonous pouvons dire que lrsquoargument de lrsquoexistencemaladies auto-immunes peut servir de critique du mdegravele du soi et du non-soi agrave condition drsquoecirctre inclus dune reacuteflexion drsquoensemble sur lrsquoautoreacuteactiviteacute Les mladies auto-immunes ne sont pas en rupture radicaprincipe avec lrsquoimmuniteacute normale mais au contraelles sont un dysfonctionnement qui se situe danprolongement de lrsquoimmuniteacute normale (on comprealors lrsquoautoreacuteactiviteacute commesurveillanceet non pluscommeagression)
52 Inexactitude de la proposition laquo le systegravemeimmunitaire deacuteclenche une reacuteaction contre lenon-soi raquo
Pour comprendre agrave preacutesent pourquoi la secoproposition fondamentale du modegravele du soi et du nsoi doit ecirctre remise en cause nous devons particoncept-cleacute detoleacuterance immunitaire La toleacuterance deacutesigne un eacutetat dans lequel un eacuteleacutement exogegravene se trdans un organisme sans pour autant deacuteclencherreacuteaction immunitaire Il srsquoagit donc de laquo non-soi raquolrsquoorigine drsquoune acceptation par le systegraveme immuntaire ce qui va agrave lrsquoencontre de la proposition fondmentale eacutenonceacutee ci-dessus Trois eacuteleacutements prouainsi que la deuxiegraveme proposition du modegravele duest erroneacutee
521 La toleacuterance drsquoagents exogegravenespotentiellement pathogegravenes
Crsquoest le cas par exemple des bacteacuteries situeacutees speau ou dans lrsquointestin
522 La toleacuterance des greffesDans certaines conditions non-pathologiques
exemple la toleacuterance fœto-maternelle on constate
488 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
defreacute-parmi-duegravere
o-er-eacuteeor-reacutesest
tersquoun
deent
cinqnies
elulesdesos-iteacuteel-ansles
les
onsle
on-nc
ee laegravelece
desouson-ent
tiono-ns
eeys-
unecetortelesdeacute-t duseuoi
llo-lle
laec le
im-rsquoilsns
estrsquoestreacute-il y
e il
n-antale)
im-
eser
du
une absence de rejet de greffe[20] Le modegravele dusoi et du non-soi ainsi nrsquoest pas en mesurerendre compte du cas de greffe agrave la fois le plusquent et le plus important celui du fœtus porteacutela megravere Le fœtus en effet est une greffe seallogeacutenique qui est toleacutereacutee bien que la moitieacutepatrimoine geacuteneacutetique de lrsquoenfant soit issue du pet donc soit eacutetrangegravere agrave la megravere En outre le mdegravele du soi est incapable drsquoexpliquer pourquoi ctains organes ndash dits laquo immunoprivileacutegieacutes raquo (la cornpar exemple) ndash sont toleacutereacutes ni pourquoi drsquoautresganes comme le foie sont drsquoautant mieux toleacuteque la diffeacuterence HLA entre donneur et receveurforte
523 Le chimeacuterismeLe chimeacuterisme deacutesigne le fait qursquoun individu por
en lui en faibles quantiteacutes des cellules issues dautre individu Le cas le plus significatif est celuila femme enceinte des cellules du fœtus peuvecirctre deacutetecteacutees chez la megravere au bout drsquoagrave peinesemaines de gestation et jusqursquoagrave plusieurs deacutecenapregraves lrsquoaccouchement[21] Le chimeacuterisme deacutesigneacutegalement le cas des enfants qui portent des celde leur megravere et le cas drsquoun faux jumeau portantcellules de son fregravere Le chimeacuterisme prouve la psibiliteacute drsquoun laquo partage raquo du laquo soi raquo voire la possibilpour le laquo non-soi raquo drsquoecirctre constitutif du laquo soi raquo Les clules chimeacuteriques au lieu de rester laquo endormies raquo dlrsquoorganisme peuvent mecircme se diffeacuterencier en cellutumorales[22] voire peut-ecirctrefonctionnelles(deve-nant par exemple des cellules du foie des cellude la peau etc)
De lrsquoensemble de ces observations nous pouvconclure ceci contrairement agrave ce que postulemodegravele du laquo soi raquo les cateacutegories drsquoimmunogegraveneetdrsquoexogegravenene sont pas confondues Degraves lors le laquo nsoi raquo nrsquoest pas le compleacutement du laquo soi raquo et dolrsquoopposition dans le terme laquonon-soi raquo est deacutenueacutede sens Crsquoest par conseacutequent lrsquoensemble ddialectique du soi et du non-soi au cœur du modinitieacute par Burnet qui srsquoavegravere inadeacutequate puisquemodegravele eacutechoue agrave deacutefinir la limitation de chacundeux concepts Si ce raisonnement est exact npouvons en deacuteduire que le modegravele du soi et du nsoi est impropre agrave rendre compte du fonctionnemde lrsquoimmuniteacute
6 Pour un autre modegravele theacuteorique enimmunologie la continuiteacute spatio-temporelle
Nous tentons ici de proposer une autre orientatheacuteorique ndash imparfaite et provisoire ndash pour lrsquoimmunlogie Le critegravere drsquoimmunogeacuteniciteacute que nous mettoen avant est celui de lacontinuiteacute spatio-temporellequi srsquoappuie sur la deacutefinition de lrsquoimmuniteacute commsystegravemeeneacutequilibre La proposition fondamentale dlrsquohypothegravese de la continuiteacute est la suivante le stegraveme immunitaire reacuteagit agrave ce quirompt la continuiteacuteentre les reacutecepteurs des acteurs de lrsquoimmuniteacute drsquopart et les motifs antigeacuteniques drsquoautre part (queantigegravene soit endogegravene ou exogegravene) Seule impautrement dit la continuiteacute spatio-temporelle entrecomposants immunitaires et leurs cibles le critegravereterminant nrsquoeacutetant pas de savoir si ces cibles sonlaquo soi raquo ou du laquo non-soi raquo Ainsi selon cette hypothegravele systegraveme immunitaire ne reacuteagit pas agrave ce avec qil est en contact continu(et agrave partir de quoi il a eacuteteacuteseacutelectionneacute) alors qursquoil reacuteagit agrave ce qui vientbriserla continuiteacute(un motif antigeacutenique jamais rencontreacutebacteacuterie virus organe comme dans le cas drsquoune agreffe etc) et donc la distinction pertinente est ceentrecontinuiteacuteet rupture de continuiteacute et non la dis-tinction entre laquo soi raquo et laquo non-soi raquo Ce critegravere decontinuiteacute demande agrave ecirctre penseacute en correacutelation avconcept deressemblance Il srsquoagit drsquoune continuiteacute agrave lafois spatiale et temporelle tant que les reacutecepteursmunitaires continuent de reacuteagir aussi faiblement qulrsquoont fait jusqursquoici avec les antigegravenes preacutesents dalrsquoorganisme aucune reacuteaction immunitaire forte nrsquodeacuteclencheacutee Ce qui provoque une reacuteaction forte cla nouveauteacute crsquoest-agrave-dire le laquo jamais vu raquo pour lescepteurs de lrsquoimmuniteacute et crsquoest dans ce cas-lagrave qursquoa rupture de continuiteacute
Le point de deacutepart de cette hypothegravese est doublrepose sur lrsquoideacutee decommencementde lrsquoimmuniteacute etsur lrsquoideacutee drsquoautoreacuteactiviteacutecomme auto-reconnaissace Premiegraverement il existe initialement (soit pendla peacuteriode fœtale soit pendant la peacuteriode post-natpour chaque organisme une peacuteriode de toleacuterancemunitaire ce qui indique que lrsquoimmuniteacute a uncom-mencement Ce qui estpreacutesentau moment de cettseacutelection fondatricene deacuteclenchera pas de reacuteponimmune Deuxiegravemement lrsquoautoreacuteactiviteacute est au cœude lrsquoimmuniteacute normale le bon fonctionnementsystegraveme immunitaire repose sur uneseacutelection conti-
T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492 489
tre
er-niteacute
st-on-nir
eacuteestionnqtion
f-
tionles
el-s leca-lulesdeo-
rsquoilsme
ssimeeacute-
ap-
on
iiso-onc-resla
gu--rup-fsxo-(parle
agrave
onc-el-ncecel-turereacute-ent
medegraves
esdi-sonoi raquoeacuteesle
nti-
anti-ro-
ma-nti-aceinslaiteacuteionour
uelseauffet duam-eanse
tion
nue puisque pour survivre un lymphocyte doit ecircreacuteguliegraverementstimuleacute par des antigegravenesendogegravenes(a priori non pathogegravenes) Lrsquoorganisme doit en pmanence assurer pour lui-mecircme une auto-immucontenue et continue
En quoi un modegravele insistant sur la continuiteacute eil plus satisfaisant que le modegravele du soi et du nsoi Lagrave ougrave le modegravele du soi est contraint de deacutefide multiplesexceptions lrsquohypothegravese de la continuitse veut unificatrice capable de rassembler toutles observations connues sous une mecircme explicaNous consideacuterons ainsi qursquoil y a pour lrsquoessentiel cidomaines qui montrent la supeacuterioriteacute drsquoune concepde ce type
(1) Lrsquoauto-immuniteacute Lrsquohypothegravese de la continuiteacute afirme qursquoil nrsquoy a pas de diffeacuterence deprincipeentre une reacuteaction auto-immune et une reacuteacimmunitaire visant un antigegravene exogegravene dansdeux cas il se produit unerupture de continuiteacutelieacutee agrave une modification de ce avec quoi les clules immunitaires se trouvent en contact Dancas des maladies auto-immunes il y a modifition des peptides preacutesenteacutes agrave la surface des celde lrsquoorganisme ce qui aboutit agrave une rupturecontinuiteacute alors mecircme que les peptides ainsi mdifieacutes restent du laquo soi raquo preacuteciseacutement parce qusont issus du mateacuteriel geacuteneacutetique de lrsquoorganisconsideacutereacute
(2) Les cancers Les cellules canceacutereuses elles ausont issues du mateacuteriel geacuteneacutetique de lrsquoorganiset donc sont du laquo soi raquo mais les motifs antigniques agrave leur surface brisent la continuiteacute par rport agrave des tissus sains
(3) Le prolongement entre immuniteacute et reacutegulatidrsquoensemble de lrsquoorganismeContrairement agrave ceque lrsquoimmunologie contemporaine a fait jusqursquoiclrsquohypothegravese de la continuiteacute permet de ne pasler dans lrsquoorganisme les agents assurant des ftions dedeacutefense des agents responsables drsquoautfonctions Lrsquoimmuniteacute est selon lrsquohypothegravese decontinuiteacute seulement lrsquoune des activiteacutes de reacutelation de lrsquoorganisme Ainsi lrsquoactiviteacute drsquoun macrophage par exemple est deacutetermineacutee par lature de continuiteacute entre ses reacutecepteurs et les motiavec lesquels il reacuteagit que ceux-ci soient egegravenes (bacteacuterie par exemple) ou endogegravenesexemple dans le cas drsquoune cellule morte que
macrophage doit ingeacuterer) donc il nrsquoy a pasenvisager pour le macrophagedeux tacircches dis-tinctes comme le fait le modegravele du soi (fonctidrsquolaquoeacuteboueur raquo de lrsquoorganisme drsquoune part fontion immune drsquoautre part) De mecircme les clules TReg ne sont pas stimuleacutees par la preacutesede laquo non-soi raquo puisqursquoelles reacuteagissent agrave deslules immunitaires endogegravenes mais par la rupde continuiteacute exprimeacutee preacuteciseacutement par lescepteurs des cellules immunitaires qui constituleur cible
(4) Les cas de toleacuterance immunitaire La continuiteacuterend compte de lrsquoeacutetat drsquoeacutequilibre qui srsquoeacutetablitentre lrsquoindividu et des agents pathogegravenes comles bacteacuteries sur la peau On constate queqursquoapparaicirct un deacuteficit immunitaire ces bacteacuteriqui jusque-lagrave eacutetaient sans effet neacutegatif sur lrsquoinvidu concerneacute provoquent des dommages agraveencontre Le critegravere nrsquoest donc pas celui du laquo set du laquo non-soi raquo puisque les bacteacuteries concernsont tout autant du laquo non-soi raquo avant qursquoapregravesdeacuteficit immunitaire mais bien larupture de conti-nuiteacutedans les interactions reacutecepteurs-motifs ageacuteniques
(5) Les meacutecanismes drsquoinduction drsquoune toleacuterance Mecirc-me dans le systegraveme immunitairemature on cons-tate parfois une absence de reacuteaction agrave desgegravenes avec lesquels lrsquoindividu est en contact plongeacute Il est difficile de deacuteterminer lescritegraveresdecette induction de toleacuterance puisque dans lajoriteacute des cas apregraves le premier contact avec lrsquoagegravene une reacuteponse immunitaire rapide et efficse deacuteclenche au deuxiegraveme contact Neacuteanmoil existe plusieurs meacutecanismes drsquoinduction detoleacuterance dont seule lrsquohypothegravese de la continusemble pouvoir rendre compte deacutesensibilisatdans le cas des allergies toleacuterance provisoire pcertains antigegravenes du pegravere apregraves la grossesse[21]toleacuterance pour certains pathogegravenes avec lesqon est en contact prolongeacute (bacteacuteries de la pde lrsquointestin) toleacuterance plus probable drsquoune gredrsquoorgane apregraves transfusion sanguine provenanmecircme donneur drsquoorgane etc Cela permet notment drsquoarticuler lacontinuiteacute avec les eacutetats dsymbiose les nombreuses bacteacuteries situeacutees dnotre intestin facilitent la digestion et de mecircmles bacteacuteries sur notre peau assurent lrsquoeacutelimina
490 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
se-
aisreacute-ffeonthy-nceire
quemeso-
vantttreonttiondit
euxaisionen-
sursene deques Ellau raquo
a-
eacuteo-en
u-nsheacuteo-tionis-quei-
sesce
ent
s a
queuto-
si-ous
n-Lemes
titeacuteoutge-
lo-
o-eacute
n-eacute-
ionsmet cardonc
en-iteacutehegravesesde-
up-sub-vec
y-tre-com-
drsquoautres pathogegravenes qui pour leur part cauraient des dommages agrave lrsquoorganisme
Une autogreffe ou une greffe entre jumeaux vrbien qursquoelles semblent rompre la continuiteacute entrecepteurs et motifs antigeacuteniques puisque lrsquoon grepar exemple un tissu agrave la place drsquoun autre tissu stoleacutereacutees ce qui paraicirct constituer une objection agrave lrsquopothegravese de la continuiteacute Cependant cette toleacuterasrsquoexplique par le fait que pour le systegraveme immunitareceveur il nrsquoy a pas de rupture de continuiteacute puisles reacuteactions reacutecepteursndashantigegravenes restent les mecirceacutetant donneacute qursquoil nrsquoy a aucune diffeacuterence dans les mtifs antigeacuteniques et donc dans les signaux eacutemis aet apregraves la greffe De faccedilon similaire on peut eacutemelrsquohypothegravese que ce qui fait que certaines greffes smieux toleacutereacutees que drsquoautres ce nrsquoest pas la distincsoinon-soi (conformeacutement agrave ce que nous avonscertains organes comme le foie sont drsquoautant mitoleacutereacutes qursquoils sont diffeacuterents de lrsquoorgane hocircte) mla plus grande continuiteacute dans lrsquoactiviteacute de stimulatdes agents immunitaires Ce qui importe crsquoest bientendu la continuiteacutepour les cellules immunitaires etnon la continuiteacutepour nous
Les avantages de lrsquohypothegravese de la continuiteacutele modegravele du soi tels que nous venons de les preacuteter nous permettent de preacuteciser quelle est la placcette hypothegravese au sein des theacuteories immunologiproposeacutees au cours des trente derniegraveres anneacuteessrsquoappuie incontestablement sur la theacuteorie du laquo reacuteseimmunitaire apparue chez Jerne[23] puis deacuteveloppeacuteesous la forme de la reacutegulation de lrsquoauto-immuniteacute nturelle ouimmunological homunculus[24] ainsi quesous le terme controverseacute drsquoautopoiesis[25] Lrsquohy-pothegravese de la continuiteacute a en commun avec les thries du reacuteseau lrsquoideacutee qursquoune reacuteaction immune estfait uneperturbation du systegraveme[26] crsquoest-agrave-dire unemodification du comportement que le systegraveme immnitaire a eu jusqursquoici (laquo rupture de continuiteacute raquo dale cadre de notre hypothegravese) Cependant les tries du reacuteseau immunitaire proposent une concepclosede lrsquoimmuniteacute selon ses promoteurs si la dtinction soinon-soi est insatisfaisante crsquoest parcele systegraveme immunitaire nrsquoa jamais affaire qursquoagrave lumecircme[24] Agrave lrsquoopposeacute lrsquohypothegravese de la continuiteacutedonne pour objectif drsquoouvrir le systegraveme comme noulrsquoavons vu avec les cas drsquoinduction drsquoune toleacuteranimmunitaire Lrsquohypothegravese de la continuiteacute autrem
-
e
dit srsquoefforce de comprendre comment des entiteacutepriori distinctes de lrsquoorganisme peuventsrsquointeacutegrer agravelui (processus drsquoouverture et de toleacuterance) alorsles theacuteories du reacuteseau insistent sur la clocircture et lrsquoadeacutefinition de lrsquoimmuniteacute
7 Identiteacute immunitaire et identiteacute philosophique
Lrsquohypothegravese de la continuiteacute nous eacuteloigne condeacuterablement du modegravele du soi mais elle ne neacuteloigne pas pour autant de la question de lrsquoidentiteacuteNotre conviction est qursquoil est possible de penser lrsquoidetiteacute biologique sans la deacutefinir comme un laquo soi raquoconcept philosophique drsquoidentiteacute repose sur les terlatins idem (fait drsquoecirctre identique agrave soi ideacutee deper-manencedans le temps) etipse (fait de demeurer lemecircme tout en changeant partiellement il y aeacutevolu-tion dans le temps) drsquoun cocircteacute nous avons lrsquoidenimmuable dans le temps et de lrsquoautre lrsquoideacutee que tecirctre reste le mecircme tout en accueillant en lui le chanment Cette distinction rejoint la probleacutematique phisophique de lasubstance la substance est uninvariantsusceptible drsquoecirctre pour chaque individu lesupportdetoutes lesvariations[27] Deux grandes thegraveses philsophiques srsquoaffrontent sur la question de lrsquoidentitla premiegravere deacutefinit lrsquoidentiteacute par lasubstance tandisque la seconde deacutefinit lrsquoidentiteacute par lacontinuiteacute Se-lon la premiegravere thegravese ce qui fait lrsquoidentiteacute drsquoun idividu crsquoest la substance crsquoest-agrave-dire le support mtaphysique de toutes ses deacuteterminations et variatSelon la deuxiegraveme thegravese agrave lrsquoopposeacute rien ne perde preacutesupposer qursquoil existe une telle laquo substance raquocette substance est par deacutefinition inaccessible etlrsquoidentiteacute repose seulement sur lacontinuiteacutedans letemps continuiteacute des changements physiques oucore concernant lrsquoidentiteacute psychologique continudes eacutetats de conscience Le deacutebat entre ces deux tphilosophiques pourrait ecirctre illustreacute par les figuresLocke[28] et de Leibniz[29] La conception substantialiste de lrsquoidentiteacute consiste agravesupposerplus que laconception fondeacutee sur la continuiteacute (ce que lrsquoon spose en plus crsquoest preacuteciseacutement un laquo noyau raquo destantialiteacute) Or on peut agrave bon droit ecirctre drsquoaccord ale soupccedilon de Locke renforceacute par Hume[30] puisquela substanceest en elle-mecircme un noyau meacutetaphsique inatteignable pourquoi la preacutesupposer Aument dit si on peut se passer de la substance pour
T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492 491
eacute--parsesutuisuesyer
degraveler il
unuedu
-
-rerionpar
deplecele
voirneors
etezper-du
po-quiiegrave-net re-s aus
euxvec
gielleenrsquoest
soiqueeacute
en-me
en-pasni-reacute-isnti-rsn-r en-
os--
que)s
pourpreacute-me
ienge
c-
nse-
ow2)
elf12
prendre lrsquoidentiteacute pourquoi y ferait-on appel La dmarche de Locke relegraveve alors de ladeacuteflation meacutetaphysique si un mecircme pheacutenomegravene peut ecirctre expliqueacutedeux modegraveles dont lrsquoun repose sur moins drsquohypothegraveque lrsquoautre alors crsquoest le modegravele minimal qursquoil vamieux adopter Lrsquoimmunologie est au moins deples anneacutees 1940 peacutetrie de concepts philosophiqNotre rocircle devrait ecirctre dans ces conditions drsquoessadrsquoaccorder agrave ces concepts leur juste place Le modu soi se situe du cocircteacute de lrsquoidentiteacute-substance catente de deacutefinir lrsquoidentiteacute de lrsquoorganisme commenoyau substantiel dont lrsquointeacutegriteacute doit ecirctre deacutefendtandis que lrsquohypothegravese de la continuiteacute se rangecocircteacute de lrsquoidentiteacute-continuiteacute Lrsquohypothegravese de la continuiteacute par conseacutequent constitue une propositionphi-losophiquepour limiter lrsquousage des concepts philosophiques en immunologie elle srsquoefforce de reacuteiteacutedans le domaine propre de lrsquoimmunologie la deacuteflatmeacutetaphysique que lrsquoidentiteacute-continuiteacute repreacutesenterapport agrave lrsquoidentiteacute-substance
Une question cependant surgit ici lrsquohypothegravesela continuiteacute nrsquoest-elle pas finalement qursquoune simreformulation du modegravele du soi Ne dit-elle pasque les immunologistes ont toujours dit Nous nepensons pas Rien bien entendu nrsquoempecircche delrsquohypothegravese de la continuiteacute simplement comme uconception renouveleacutee du laquo soi raquo On affirmerait alseulement qursquoil srsquoagit dans ce cas dusoi compriscomme continuiteacute (comme chez Locke ou Hume)non dusoi compris comme substance (comme chLeibniz) Cette suggestion est seacuteduisante car ellemettrait une fois encore de laquo sauver raquo le modegravelesoi et du non-soi Neacuteanmoins premiegraverement lrsquohythegravese de la continuiteacute explique des pheacutenomegraveneseacutetaient mal expliqueacutes par le modegravele du soi Deuxmement et surtout faire de lrsquoidentiteacute-continuiteacute uconception renouveleacutee du laquo soi raquo serait preacuteciseacutementomber dans lrsquoerreur qui consiste en ayant recourterme trop large desoi agrave recouvrir deux significationbien distinctes lasubstanceet lacontinuiteacute Parler delaquo soi raquo crsquoest se condamner agrave ne pas distinguer les dsens agrave passer de lrsquoun agrave lrsquoautre sans justification ale risque de tout laquo substantialiser raquo en immunoloOn pourrait donc accepter lrsquoobjection selon laquece que lrsquoon propose nrsquoest qursquoune redeacutefinition du soiimmunologie mais ce que lrsquoon ne peut accepter clrsquoideacutee que le terme desoi doit ecirctre conserveacute
8 Conclusion philosophie de lrsquoidentiteacutebiologique
Quelles questions pose lrsquoanalyse du modegravele duet du non-soi pour une compreacutehension philosophide la deacutefinition biologique de lrsquoidentiteacute Lrsquoidentitbiologique pour tout ecirctre vivant deacutesignece qursquoil estbiologiquement crsquoest-agrave-dire son uniciteacute et sa diffeacuterciation spatiale Nous avons montreacute que le systegraveimmunitaire constituait bien une sorte de carte drsquoidtiteacute de lrsquoorganisme mais que cette identiteacute nrsquoeacutetaitclose agrave toute influence exteacuterieure lrsquoidentiteacute immutaire nrsquoest pas deacutefinie agrave partir drsquoun ensemble deactions de deacutefense agrave toutesles entiteacutes exogegravenes made maniegravere continuiste crsquoest-agrave-dire comme la conuiteacute spatio-temporelle des reacuteactions entre reacutecepteude lrsquoimmuniteacute et motifs antigeacuteniques (qursquoils soient edogegravenes ou exogegravenes) Degraves lors peut se dessineparticulier agrave partir de lrsquoideacutee drsquoinduction de la toleacuterance immunitaire une reacuteflexion eacutelargie sur la psibiliteacute de deacutefinir lrsquoidentiteacute biologique (agrave la fois pheacutenotypique et en amont geacuteneacutetique ou para-geacuteneacuteticomme une identiteacuteouverte articulant agrave la fois deeacuteleacutements endogegravenes et des eacuteleacutements exogegravenesdeacuteterminer en derniegravere instance le propre toujourscaire et toujours combineacute (laquo impur raquo) drsquoun organisvivant donneacute
Remerciements
Nous remercions pour leur aide et leur soutAnouk Barberousse Claude Debru Michel MoranJean Gayon Ceacutedric Brun et Hannah-Louise Clark
Reacutefeacuterences
[1] FM Burnet F Fenner The Production of Antibodies Mamillan Melbourne 1941 2e eacutedition en 1949
[2] MS Anderson ES Venanzi L Klein Z Chen SP BerziSJ Turley H von Boehmer R Bronson A Dierich C Bnoist D Mathis Projection of an Immunological Self ShadWithin the Thymus by the Aire Protein Science 298 (2001395ndash1401
[3] RE Langman M Cohn A minimal model for the self-nonsdiscrimination a return to the basics Semin Immunol(2000) 189ndash195
492 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
self
uil
ty
ofd
de
-
aelf
rrs
ha8
Ho-nlf-
f6
-G
odSci
itet
em
ical
ei-
u-
[4] P Matzinger The danger model a renewed sense ofScience 296 (2002) 301ndash305
[5] J Bernard M Bessis C Debru (dir) Soi et non-soi SeParis 1990
[6] FM Burnet Changing Patterns An Atypical AutobiographyHeinemann Melbourne 1968
[7] M Morange La part des gegravenes Odile Jacob Paris 1998[8] FM Burnet The Integrity of the Body Harvard Universi
Press Cambridge 1962[9] AI Tauber L Chernyak Metchnikoff and the Origins
Immunology Oxford University Press New York Oxfor1991
[10] A-M Moulin Le dernier langage de la meacutedecine ndash histoirelrsquoimmunologie de Pasteur au Sida PUF Paris 1991
[11] AI Tauber The Immune Self Theory or metaphor Cambridge University Press Cambridge 1994
[12] Aristote Cateacutegories Vrin Paris 1994 chapitres 10 et 11[13] Aristote Cateacutegories chapitre 5 3b22ndash33[14] P Kourilsky J-M Claverie The peptidic self model
hypothesis on the molecular nature of the immunological sAnn Immunol 137 (1986) 3ndash21
[15] DH Raulet RE VanceCW McMahon Regulation of thenatural killer cell receptor repertoire Annu Rev Immunol 19(2001) 291ndash330
[16] PG Ashton-Rickardt A Bandeira JR Delaney L Van KaeHP Pircher RM Zinkernagel S Tonegawa Evidence foa differential avidity model of T-cell selection in the thymuCell 76 (1994) 651ndash663
[17] C Tanchot B Lemonnier A Perarnau A Freitas B RocDifferential requirements for survival and proliferation of CDnaive or memory T cells Science 276 (1997) 2057ndash2062
[18] MS Jordan A Boesteanu AJ Reed AL Petrone AElenbeck MA Lerman A Naji AJ Caton Thymic selectioof CD4+CD25+ regulatory T cells induced by an agonist sepeptide Nat Immunol 2 (2001) 301ndash306
[19] Z Feheacutervari S Sakaguchi Development and function oCD25+CD4+ regulatory T cells Curr Opin Immunol 1(2004) 203ndash208
[20] ED Carosella N Rouas-Freiss P Paul J Dausset HLAa tolerance molecule from themajor histocompatibility com-plex Immunol Today 20 (1999) 60ndash62
[21] DW Bianchi GK Zickwolf GJ Weil S Sylvester MADeMaria Male fetal progenitor cells persist in maternal blofor as long as 27 years postpartum Proc Natl AcadUSA 93 (1996) 705ndash708
[22] D Cha K Khosrotehrani Y Kim H Stroh DW BianchKL Johnson Cervical cancer and microchimerism ObsGynecol 102 (2003) 774ndash781
[23] NK Jerne Towards a network theory of the immune systAnn Immunol 125 C (1974) 373ndash389
[24] IR Cohen The cognitive paradigm and the immunologhomunculus Immunol Today 13 (1992) 490ndash494
[25] HR Maturna FJ Varela Autopoiesis and cognition D Rdel Dordrecht The Netherlands 1980
[26] AI Tauber Moving beyond the immune self Semin Immnol 12 (2000) 241ndash248
[27] Aristote Cateacutegories chapitre 5[28] J Locke Essai sur lrsquoentendement humain 1690[29] GW Leibniz Nouveaux Essais sur lrsquoentendement humain
1765[30] D Hume Traiteacute de la nature humaine 1739
482 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
immunogenicity that avoids the reproaches leveled at the self modelTo cite this article T Pradeu ED Carosella C RBiologies 327 (2004) 2004 Acadeacutemie des sciences Publieacute par Elsevier SAS Tous droits reacuteserveacutes
Mots-cleacutes soi autoimmuniteacute toleacuterance systegraveme immunitaire philosophie de lrsquoimmunologie continuiteacute
Keywordsself autoimmunity tolerance immune system philosophy of immunology continuity
0sicalthey
emunectly
of
an
n-iswein
ntis
itydid
forpicthefsthethefut
ted
ndchshe
t asthe
st-
delintine
asrela-nota-notn-
therrel-an
ich
usttwosesex-we
rstel
f
tedi-
Abridged English version
Since it was suggested by Burnet in the 194the selfnon-self model has formed the theoretbackdrop to all immunology This model answersquestion of giving a criterion of immunogenicity btendering two propositions (1) the immune systdoes not react against the self and (2) the immsystem reacts against the non-self But what exadoes the use of such metaphysical notions asself andnon-self mean in an experimental field of biologyWhy should there be a relation between the issueidentity (the self) and the system of defense oforganism (immunity)
Herein lies the inherent tension in the selfnoself model Biological identity is not merely butpredominantly genetic we are all unique becauseare distinguishable by our genomes understoodtheir relations to the cellular and general environmeand not by the specificity of our immune cells whichsimply a phenotypic manifestation of the individualof our genes Thus the question remains whyimmunologists elect to use the termself to describeorganismal defense We can give two reasonsthis choice The first is the extraordinary phenotydiversity of immune components The second isimplicit conceptual shift fromidentity to defense ointegrity relying on the definition of immune cellas lsquodefensiversquo cells immunologists postulated thatissue faced by the immune lsquoselfrsquo was not properlyquestion of identity (who am I) but the question omaintaining the integrity of the organism throughoits changes (how am I protected that is againswhich foreign entities do I have to be protectto remain myself) As we will show this tensionand this conceptual shift have metaphysically ainappropriately burdened the immune lsquoselfrsquo whiis not the synonym of lsquoidentityrsquo that it pretendto be Burnet introduced a dynamic vision of tself as somethingacquired Following in his wake
immunologists have tried to understand the self noa fixed and determined thing but on the basis ofprocesses by which the immune systemlearnsnot toattack the self in its embryogenic or immediately ponatal periods
Under close examination the immunological moof selfnon-self proves to be false The starting poof our criticism is an examination of the negationthe notionnon-self what does the lsquonon-rsquo mean in thphrase lsquonon-selfrsquo As Aristotlersquos philosophy of logicshows there are only four meanings ofoppositionthings can be opposed as affirmation and negationprivation and possession as contraries and astives To take the first meaning the non-self canbe thenegationof the self since affirmation and negtion characterize propositions not notions It canbe theprivationof the self either because for an orgaism the self and the non-selfcoexist But it is equallyimpossible to say that the self is thecontrary of thenon-self because as Aristotleexplains theindividualsubstance (which is precisely what the notion ofselfaims to represent) has no contrary Since all the omeanings have been ruled out only opposition asatives remains conceivable One may think this isadequate meaning the lsquonon-selfrsquo is everything whdoes not belong to the lsquoselfrsquo so it is definedin relationto the lsquoselfrsquo However an opposition as relatives mbe founded on a trenchant distinction between therelative parts The second part of our criticism uarguments derived from experiments to show the inistence of such a clear-cut distinction from whichconclude that the notion of lsquonon-selfrsquo is meaningless
Three elements show the inaccuracy of the fifundamental proposition of the selfnon-self mod(the immune system does not react against the sel)
(1) Non-pathological autoreactivity of immune cellsafter selection in the thymus cells are selecwhen they reactweakly to the endogenous antgens and not when theydo not react Lympho-
T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492 483
llsby ais
us
ge
del
psu
ho-kin
l
hatriesotate
eofate
o-st
ival
ebutenyr extwo
therd)an-
eto
u-
he-ivene akof
rsbalcerytol-hadd
lieelf
thatingb-hetio-iesentep--
one
Wem-nd
sisbe-ry-
m-d
f astyen-ne
cytes can be understood on the model of NK cewhich do not go through the selection processgeneration of diversity but play nonethelesskey role in the body Everything in the thymusa question ofactivatoryandinhibitory signals
(2) Peripheral autoreactivity lymphocytes surviveon-ly if they are regularly stimulated by endogenoantigens
(3) Autoimmune diseases if understood in linkawith normal autoreactivity
The second proposition of the selfnon-self mo(the immune system reacts against the non-self) is alsoinadequate as three experimental remarks encalated by the notion of immunetolerance prove
(i) tolerance of exogenous and potentially patgenic entities (for example bacteria on the sor in the gut)
(ii ) tolerance of grafts especially the foeto-maternatolerance
(iii ) chimerism
From all these observations we can conclude tcontrary to what the self model asserts the categoof lsquoimmunogenrsquo and lsquoexogenousrsquo are actually nequivalent Thus the only remaining possibility this the opposition asrelative cannot define the immunnon-self The opposition in the term lsquonon-selfrsquo isthereforemeaningless The self model fails to definthe limit of self and non-self and so the dialecticself and non-self initiated by Burnet seems inadequas a whole
However to show the inadequacy of the immunlogical selfnon-self model is not enough We musuggest another hypothesis for immunology The rhypothesis we develop here can be called thecon-tinuity hypothesis According to this hypothesis thimmune system does not respond to lsquonon-selfrsquoto every break of spatio-temporal continuity betwethe immune receptors and the antigens to which thereact (whether these antigens are endogenous oogenous) The continuity hypothesis is based onmain ideas First immunity has abeginning since or-ganisms have a period of immune tolerance (wheembryonic period or immediately post-natal periothus immunity is not an innate characteristic oforganism Everything that ispresentwhen the selec
-
-
tion of lymphocytes occurs will not trigger an immunreaction later Secondly autoreactivity is inherentnormal immunity the immune system demands acon-tinuous selection since a lymphocyte must be stimlated regularly byendogenousantigens to survive
Why is the continuity hypothesis better than tselfnon-self model Mainly because it is more explicative that is it provides a single comprehensexplanation for the triggering of immune reactiowhereas the selfnon-self model is obliged to definmultiplicity of exceptions to its general rule We thinthat at least five domains display the superioritythe continuity model (1) autoimmunity (2) cance(3) uninterruptedness between immunity and gloregulation of the organism (4) immune toleran(5) induction of tolerance (desensitization provisotolerance for paternal antigens after pregnancyerance for some pathogens with which we havea long contact greater graft tolerance after a blootransfusion from the organ donor etc)
Two philosophical conceptions of identity underthe self model and the continuity hypothesis The smodel understands identity as asubstance(the preser-vation of a metaphysical core throughout changesis defense of integrity only the changes originatfrom the lsquoinsidersquo are tolerable) on the model of Leinizrsquos philosophy The continuity hypothesis on tother hand leans on the definition of identity as spatemporal continuity on the model of the philosophof Locke and Hume Since their philosophies represa metaphysical deflation of the substantialist conction we think that it is time for immunology to reproduce this deflation in its own domain
Is the continuity hypothesis a simple reformulatiof the self model the only difference being that wdefine identity by continuity instead of substancethink not the continuity hypothesis explains phenoena that cannot be explained by the self model amoreover if we assimilate the continuity hypotheand the self model we risk repeating the confusiontween the two meanings and lsquosubstantializingrsquo evething in immunology
The continuity hypothesis has one feature in comon with the network theories of immunity initiateby N Jerne immune reactions are conceived operturbationsof the system However the continuihypothesis differs from these theories on a fundamtal issue while network theories describe the immu
484 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
nrsquoler-
iveon-itythe
us)anex-theof
an-rsquoileulvo-
te
olo-e
seacutesge) Laeacutevi-
ac-treitrmeern-nereacute-
iffeacute-elle
leeeacute-es
foistrentn-ffeacute-ter-iron-ett duestla-
aceala-
t agrave
tdif-rmeegrave-me
tsite
est
ri-on-enim-s
system as closed and self-defining the continuity hy-pothesis aims atopeningthe system mainly with theidea of induction of tolerance (a supposedly lsquoforeigelement can be integrated into an organism and toated)
Thus immune identity is defined not by defensreactions towards all exogenous entities but in a lsquoctinuistrsquo way that is as the spatio-temporal continuof the reactions between the immune receptors andantigenic sites (whether endogenous or exogenoWe can then conceive of the biological identity asopenidentity that deals with both endogenous andogenous elements in order to determine eventuallycombined (lsquoimpurersquo) and always precarious naturea given organism
1 Introduction
Depuis sa formulation par Burnet agrave partir desneacutees 1940[1] le modegravele du soi et du non-soi ndash qusoit implicitement accepteacute (pour ne citer qursquoun sexemple mais dont le titre est particuliegraverement eacutecateur voir[2]) clairement revendiqueacute[3] ou criti-queacute [4] ndash constitue lrsquoarriegravere-plan theacuteorique de toula production scientifique en immunologie[5] Lrsquouti-lisation des termes meacutetaphysiques desoiet denon-soidans une science expeacuterimentale comme lrsquoimmungie est eacutetonnante drsquoougrave lrsquoideacutee drsquoune eacutevaluation critiqude ce modegravele (nous eacutecrirons les motssoi et non-soien italiques lorsqursquoil srsquoagit des termes ou notionentre guillemets lorsqursquoil srsquoagit des concepts utilispar le modegravele du soi et dont nous critiquons lrsquousaet sans signe particulier dans tous les autres casviseacutee drsquoensemble de notre examen est la mise endence drsquouncritegravere drsquoimmunogeacuteniciteacute crsquoest-agrave-dire ladeacutetermination de ce qui deacuteclenche ou non une reacutetion immunitaire dans un mecircme organisme Agrave ce tilrsquoobjectif de cet article est triple Drsquoabord il srsquoagde comprendre quel est le sens speacutecifique des tesoi et non-soien immunologie Ensuite de montrpourquoi le modegravele immunologique du soi et du nosoi devrait ecirctre revu voire abandonneacute agrave partir drsquoudouble critique conceptuelle et fondeacutee sur dessultats expeacuterimentaux des termessoi et non-soi En-fin nous proposerons une hypothegravese explicative drente mettant en avant la continuiteacute spatio-tempordes reacuteactions entre les reacutecepteurs et les ligands
s
2 Lrsquoeacutequivoque situeacutee au cœur du modegravele du soi etdu non-soi
Agrave titre provisoire nous pouvons consideacuterer queterme desoi biologique est un synonyme du termdrsquoidentiteacutebiologique qui deacutesigne lrsquoensemble des dterminants qui font qursquoun organisme est diffeacuterent dautres organismes Un tel laquo soi raquo deacutesigne agrave lalrsquo uniciteacute de chaque individu (qui est le seul agrave ecirctel qursquoil est agrave lrsquoexception drsquoindividus geacuteneacutetiquemeidentiques) et sadistinction spatiale et environnemetale(mecircme des jumeaux vrais par exemple sont dirents en ce qursquoils occupent des lieux distincts et inagissent de maniegraveres dissemblables avec leur envnement) Or puisque lrsquoimmunologie depuis Burnse deacutefinit elle-mecircme comme la laquo science du soi enon-soi raquo[6] la question se pose de savoir quelle rapport entre lrsquoidentiteacute telle que nous venons dedeacutefinir et lrsquoimmuniteacute Lrsquoimmuniteacute qui deacutesigne eacutetymologiquement une exemption (immunitas) a eacuteteacute deacutefiniecomme la capaciteacute qursquoa un organisme de reacuteagir fagrave des agents pathogegravenes afin drsquoeacutechapper agrave la mdie et donc comme sa reacuteaction dedeacutefensecontre detels agents Lrsquoeacutequivoque du modegravele du laquo soi raquo tience rapprochement implicite entreidentiteacute (uniciteacute etdistinction) etsystegraveme de deacutefensede lrsquoorganisme Eneffet si drsquoune part le termesoi deacutesigne simplemenun organisme et le fait que chaque organisme estfeacuterent des autres alors on ne voit pas en quoi ce terelegraveverait de lrsquoimmunologie (nous verrons qursquoil relverait plutocirct de la geacuteneacutetique) si drsquoautre part le tersoi fait reacutefeacuterence agrave uneinteacutegriteacute de lrsquoindividu qursquoilsrsquoagirait dedeacutefendre de maintenir (contre des agenpathogegravenes) alors il dissimule une confusion implicentre lrsquoexogegraveneet le dangereux puisque lrsquoon postulealors que tout ce qui est exteacuterieur agrave lrsquoorganismesusceptible de lui nuire
3 Soi biologique et soi immunitaire
Le soi biologique est principalementgeacuteneacutetiquemecircme srsquoil nrsquoest pas uniquement geacuteneacutetique[7] Lrsquouni-citeacute de lrsquoindividu repose sur lrsquouniciteacute de son patmoine geacuteneacutetique comprise en relation avec lrsquoenvirnement cellulaire et avec le milieu de lrsquoorganismegeacuteneacuteral et non sur la speacutecificiteacute de ses cellulesmunitaires Les reacutecepteurs immunitaires ainsi que le
T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492 485
liteacuteuesanthro-
es-e
uiteonsrs
untheacute-
im-nitrai-cep
t
e
ourt agrave
enteeacute-
saireire
m-
rendtionaisi denuer
leire
uende
on-mele
m-hi-
ntri-r
sens
clu-uelnousce
non-aunesiga-estsoi raquo
e laon-
rtente le
So-
esseacute-ant
moleacutecules du complexe majeur drsquohistocompatibi(CMH) ne sont qursquoune manifestation pheacutenotypiqdrsquoune diversiteacute fondamentalement geacuteneacutetique reposur la combinatoire de lrsquoheacutereacutediteacute (brassages intercmosomique et intrachromosomique) Lrsquoidentiteacutebiolo-gique de chaque ecirctre vivant autrement dit ladiversiteacutedes organismes y compris au sein drsquoune mecircmepegravece relegraveve prioritairement de lrsquoheacutereacutediteacute qui se situen amont de la speacutecificiteacute immunitaire
Deux raisons cependant expliquent que agrave la sde Burnet les immunologistes aient placeacute les notide soi et denon-soiau cœur de leur discipline alomecircme que rien ne laisse penser a priori que lrsquoimmuniteacuterenvoie agrave lrsquoidentiteacute La premiegravere raison repose surfait clairement eacutetabli lesreacutecepteurs immunitaires eles moleacutecules du CMH appartiennent certes au pnotype mais leur diversiteacute est de tregraves loin la plusportante de lrsquoorganisme agrave tel point qursquoon les deacutefiparfois comme sa laquo carte drsquoidentiteacute raquo La deuxiegravemeson en revanche se fonde sur un glissement contuel implicite et non deacutemontreacute de lrsquoideacutee drsquoidentiteacuteagrave lrsquoideacutee dedeacutefense de lrsquointeacutegriteacuteet enfin agrave lrsquoideacutee delutte contre tout ce qui estexogegravene une fois lrsquoim-muniteacute deacutefinie comme ladeacutefensecontre tout agenpathogegravene son rocircle a eacuteteacute penseacute comme lemaintiendans le tempsde lrsquoidentiteacute de lrsquoorganisme crsquoest-agrave-dirlrsquoabsence drsquoune quelconquemodificationde lrsquoindividupar des entiteacutesexogegravenes(seules les modificationsen-dogegraveneseacutetant consideacutereacutees comme acceptables plrsquoorganisme) Or le modegravele du soi et du non-soi eslrsquoorigine de ce glissement preacutesent de maniegravere eacutevidchez Burnet[8] alors qursquoil est absent chez un prdeacutecesseur de Burnet comme Metchnikoff[9] Un telmaintiende lrsquoidentiteacute qui fait du laquo soi raquo uneforteresseagrave deacutefendre perpeacutetuellement a un point de deacutepart danle temps agrave savoir la fin de la toleacuterance embryonnou immeacutediatement post-natale le laquo soi raquo immunitaestacquis(par la seacutelection des cellules immunocopeacutetentes) et non inneacute[10] Degraves lors que lrsquoon prendconscience de ce glissement conceptuel on compque le laquo soi raquo immunitaire ne reacutepond pas agrave la queslaquo qui suis-je raquo (dans mon uniciteacute drsquoecirctre vivant) mlaquo comment suis-je proteacutegeacute raquo (crsquoest-agrave-dire agrave lrsquoabrquelles entiteacutes eacutetrangegraveres dois-je rester pour contiagrave ecirctremoi-mecircme) et en ce sens ilnrsquoest pasle syno-nyme de lrsquoidentiteacute biologique qursquoil preacutetend ecirctre
Nous voudrions agrave preacutesent montrer pourquoimodegravele du soi et du non-soi doit ecirctre revu vo
-
rejeteacute[11] Nous emprunterons deux voies de critiqla premiegravere philosophique (conceptuelle) la secofondeacutee sur des reacutesultats expeacuterimentaux
4 Rejet philosophique du modegravele du soi et dunon-soi
Lrsquoexamen conceptuel du modegravele du soi et du nsoi conduit agrave la remise en question de la notion mecircde non-soi Le problegraveme est le suivant quel estsens de la neacutegation dans lrsquoexpression laquonon-soi raquo Pour reacutepondre agrave cette question il est utile de coprendre quelles sont les diffeacuterentes significations plosophiques de lrsquoideacutee drsquoopposition Comme le montreAristote[12] on peut en logique distinguer seulemequatre types drsquooppositions (1) la neacutegation (2) la pvation (3) la contrarieacuteteacute (4) lrsquoopposition relative Onous allons prouver agrave preacutesent qursquoaucun de cesne peut srsquoappliquer agrave lrsquoexpression laquonon-soi immuni-taire raquo Pour ce faire nous allons proceacuteder par exsion nous allons montrer par lrsquoexamen conceptque seul le quatriegraveme sens est envisageable puismontrerons par lrsquoexamen expeacuterimental que mecircmequatriegraveme sens est inapplicable
Premiegraverement on ne peut pas comprendre le laquosoi raquo comme lrsquoopposeacuteneacutegatif du laquo soi raquo car dans llogique aristoteacutelicienne la neacutegation consiste agrave nierproposition(ce qui veut dire tregraves simplement ceci la proposition laquo il est assis raquo est vraie alors sa neacutetion agrave savoir la proposition laquo il nrsquoest pas assis raquoneacutecessairement fausse) Or le laquo soi raquo et le laquo non-sont desnotions et non despropositions Deuxiegraveme-ment le laquo non-soi raquo nrsquoest pas laprivation du laquo soi raquoau sens par exemple ougrave la ceacuteciteacute est la privation dvue puisque lrsquoon constate que le laquo soi raquo et le laquo nsoi raquo pour un individu donneacutecoexistent Troisiegraveme-ment lrsquoopposition commecontrarieacuteteacutedoit-elle aussiecirctre rejeteacutee car comme le montre Aristotela sub-stance premiegraverendash qui deacutesigne tel individu particuliele support permanent des changements qui affeccet individu crsquoest-agrave-dire tregraves exactement ce que vislaquo soi raquo ndashnrsquoa pas de contraire[13] En effetrien nrsquoestle contraire de lrsquoindividualiteacute on ne peut pas direpar exemple que Protagoras est le laquo contraire raquo decrate Lrsquoindividu se comprend agrave partir de lrsquoalteacuteriteacute (dautres individus) ndash sans quoi il ne pourrait preacuteciment pas srsquoindividualiser ndash mais il nrsquoa pas pour aut
486 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
le
par-ent
uxs al-ntalent
mblear-urrai raquo
ulede
unelaquo lee leen-en-eacutevi-
oi raquo
gu-cel-ires paibi-es
ledes
et
hy-
uessusiqueaite-rsquoor-
rpreacute-lantpli-sles
lade
arceto-ais
t agraveme
yteir auest
metretidera-t agravereacute-
e lapo-
des
lesineacute-lec-rsquoougrave
-
de contraire Seul reste possible par conseacutequentquatriegraveme sens lrsquooppositionrelative le laquo non-soi raquoest au sens matheacutematique lecompleacutementdu laquo soi raquocar tout eacuteleacutement qui nrsquoappartient pas au laquo soi raquo aptient neacutecessairement au laquo non-soi raquo et reacuteciproquemCependant lrsquoopposition des relatifs doit pouvoir srsquoap-puyer sur un critegravere de distinction clair entre les deensembles compleacutementaires ainsi deacutefinis Or noulons montrer agrave preacutesent gracircce agrave lrsquoexamen expeacuterimeque le laquo soi raquo et le laquo non-soi raquo immunitaires ne peuvpreacuteciseacutement pas ecirctre consideacutereacutes comme des enseexclusifs tout ce qui nrsquoappartient pas agrave lrsquoun apptenant neacutecessairement agrave lrsquoautre Degraves lors on porejeter lrsquoideacutee selon laquelle lrsquoopposition entre le laquo soet le laquo non-soi raquo est drsquoordrerelatif (seul sens retenapregraves lrsquoexamen conceptuel) et donc affirmer queterme mecircme de laquo non-soi raquo immunitaire est deacutenueacutefondement
5 Rejet expeacuterimental du modegravele du soi et dunon-soi
Les deux propositions fondamentales du modegravele dsoi et du non-soi sont (a) laquo le systegraveme immunitairedeacuteclenche pas de reacuteaction contre le soi raquo et (b)systegraveme immunitaire deacuteclenche une reacuteaction contrnon-soi raquo Or toute une seacuterie de donneacutees expeacuterimtales prouvent que ces deux propositions fondamtales sont erroneacutees Commenccedilons par mettre endence lrsquoinexactitude de la premiegravere proposition
51 Inexactitude de la proposition laquo le systegravemeimmunitaire ne deacuteclenche pas de reacuteaction contre s
511 Seacutelection thymique la neacutecessaireautoreacuteactiviteacute non-pathologique et la notion delaquo fenecirctre de reacuteactiviteacute raquo
La seacutelection thymique se situe au cœur de lrsquoarmentation en faveur du modegravele du soi Pour leslules T seul importe le laquo soi peptidique raquo crsquoest-agrave-dlrsquoensemble des peptides seacutelectionneacutes et preacutesenteacuteles moleacutecules du complexe majeur drsquohistocompatliteacute [14] Or les lymphocytes ne sont que lrsquoun dacteurs de lrsquoimmuniteacute Degraves lors est-on certain quemodegravele du soi et du non-soi vaut au-delagrave du caslymphocytes pour tous les acteurs de lrsquoimmuniteacute
s
r
mecircme qursquoil convient pour comprendre la seacutelection tmique en tant que telle Les cellulesnatural killers(NK) par exemple nrsquoont pas de reacutecepteurs speacutecifiqdrsquoun antigegravene preacutecis elles nrsquoont pas subi le procesde seacutelection par geacuteneacuteration de diversiteacute caracteacuteristdes lymphocytes et pourtant elles assurent parfment des fonctions immunitaires indispensables agrave lganisme sans deacuteclencher de reacuteaction contre lui[15]Peut-ecirctre avons-nous eu jusqursquoagrave preacutesent une intetation abusive de la seacutelection lymphocytaire en parde laquo soi raquo et de laquo non-soi raquo alors qursquoavancer une excation en termes drsquointeacutegration de signaux activateuret inhibiteurs permettrait de ne pas opposer celluNK et lymphocytes B et T Lrsquoideacutee selon laquelleseacutelection lymphocytaire assurerait la suppressiontoute autoreacuteactiviteacute est erroneacutee non seulement pqursquoenviron 4 agrave 6 des lymphocytes fortement aureacuteactifs eacutechappent agrave lrsquoeacutelimination dans le thymus maussi et surtout parce que seuls les lymphocytesfaible-ment autoreacuteactifssont seacutelectionneacutes Contrairemence qursquoavance le modegravele du soi et du non-soi et mecircen conservant sa propre terminologie un lymphocpour ecirctre seacutelectionneacute doit non pas ne pas reacuteaglaquo soi raquo mais reacuteagir faiblement au laquo soi raquo Lrsquoenjeudonc la deacutefinition drsquounefenecirctre de reacuteactiviteacute La seacute-lection des lymphocytes pose en effet un problegravedeacutecisif comment dans le thymus lrsquointeraction enun reacutecepteur de lymphocyte T et un complexe pep+ moleacutecule du CMH peut-elle conduire agrave la matution des thymocytes durant la seacutelection positive ela mort cellulaire durant la seacutelection neacutegative Laponse tient sans doute en ceci lrsquoaffiniteacuteet lrsquointensiteacutedes signaux doivent ecirctre diffeacuterentes dans le cas dseacutelection neacutegative et dans le cas de la seacutelectionsitive [16] Par conseacutequent non seulement onpeutramener les notions de laquo soi raquo et de laquo non-soi raquo agravedonneacutees plus claires relatives agrave dessignauxactivateursou inhibiteurs (possibiliteacute largement suggeacutereacutee parcellules NK) mais mecircme ondoit le faire sans quolrsquoon ne pourrait pas comprendre que la seacutelectiongative ne vienne pas tout simplement annuler la seacutetion positive en deacutetruisant toutes les cellules T Dlrsquoideacutee de laquo fenecirctre de reacuteactiviteacute raquo une reacuteactionfaibleinduit la seacutelectionpositive (survie) alors qursquoune reacuteaction forte a pour conseacutequence la seacutelectionneacutegative(mort par apoptose)
T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492 487
onsom-our
des
ourin-rieneacute-eti seme
cep-
in-nteacute
ivegitel-
n-ionresrsquoenunhescel-
antqueageleacuteeor-
nce
yan
dece
ulesim-
raitsoi
ndreca-t lesialeest
tretionu-
tielsrsdes
o-ans
a-le deires lend
ndeon-r du-ouveuneagrave
i-a-ventsoi
ur la
par
512 Lrsquoautoreacuteactiviteacute des lymphocytes dans lesystegraveme peacuteripheacuterique
Reacutecemment il a eacuteteacute montreacute que les interactientre les reacutecepteurs des lymphocytes T et les cplexes CMH + peptide sont aussi fondamentales ple maintiendes cellules T dans les organes lymphoiumlpeacuteripheacuteriques que pour leurseacutelectiondans le thy-mus[17] Loin donc drsquoecirctre seulement essentielles pla seacutelection initiale des lymphocytes T seules cesteractions peuvent garantir leur survie agrave la peacuteripheacuteLe maintien des cellules T naiumlves agrave la peacuteripheacuteriecessite un contactcontinu entre leurs reacutecepteursles complexes CMHndashpeptide Ces interactions quproduisent dans le systegraveme peacuteripheacuterique tout comcelles qui ont lieu dans le thymus engagent les reacuteteurs T et des constituantsendogegravenes(du laquo soi raquo) ilnrsquoy a rien drsquoexogegravene dans la moleacutecule du CMH de lrsquodividu et dans ses propres peptides qui sont preacuteseagrave la surface des cellules de lrsquoorganisme En deacutefinitun lymphocyte T ne se maintient en vie que srsquoil reacuteacontinucircment au laquo soi raquo Ainsi non seulement les clules lymphocytairespeuventreacuteagir au laquo soi raquo mais eoutre elles ne peuvent survivreqursquoenreacuteagissant continucircment au laquosoi raquo Lrsquoautoreacuteactiviteacute est une conditsine qua non de la survie des cellules immunitaiet donc elle se situe au cœur de lrsquoimmuniteacute loin dconstituer comme on lrsquoa cru pendant longtempsessentiel dysfonctionnement Agrave ce titre les rechercreacutecentes sur la genegravese et le fonctionnement deslules T reacutegulatrices (TReg) CD4+CD25+ qui inhibentlrsquoactiviteacute des autres cellules immunitaires permettde mettre fin agrave une reacuteponse immune et drsquoeacuteviterles tissus de lrsquoorganisme ne subissent des dommconseacutecutifs agrave une reacuteponse inflammatoire incontrocircsont venues confirmer les ideacutees drsquoautoreacuteactiviteacute nmale (non pathologique) et de maintien de la toleacuterapeacuteripheacuterique En effet drsquoune part les cellules TReg re-quiegraverent pour ecirctre seacutelectionneacutees un reacutecepteur T aune forte affiniteacute pour un peptide du laquo soi raquo[18] etdrsquoautre part on constate que des souris priveacuteescellules TReg meurent de maladies auto-immunesqui indique que la geacuteneacuteration systeacutematique de cellTReg est indispensable pour maintenir la toleacuterancemunitaire agrave la peacuteripheacuterie[19]
513 Les maladies auto-immunesLrsquoexistence de maladies auto-immunes ne sau
ecirctre en soi un argument contre le modegravele du
s
s
t
puisque celui-ci a preacuteciseacutement eacuteteacute eacutelaboreacute pour recompte de la possibiliteacute et indissociablement duractegravere exceptionnel de telles maladies Cependanmaladies auto-immunes montrent la faiblesse initde la formulation du modegravele degraves le deacutepart il srsquodonneacute pour objectif de deacutemontrer larareteacuteextrecircme delrsquoauto-immuniteacute et non sonimpossibiliteacute admettant lapossibiliteacute des reacuteactions immunitaires dirigeacutees conle laquo soi raquo mais la consideacuterant comme une exceppathologique Or comme nous lrsquoavons souligneacute lrsquoatoreacuteactiviteacute est en fait lrsquoun des fondements essendrsquoun fonctionnement normal de lrsquoimmuniteacute Degraves lonous pouvons dire que lrsquoargument de lrsquoexistencemaladies auto-immunes peut servir de critique du mdegravele du soi et du non-soi agrave condition drsquoecirctre inclus dune reacuteflexion drsquoensemble sur lrsquoautoreacuteactiviteacute Les mladies auto-immunes ne sont pas en rupture radicaprincipe avec lrsquoimmuniteacute normale mais au contraelles sont un dysfonctionnement qui se situe danprolongement de lrsquoimmuniteacute normale (on comprealors lrsquoautoreacuteactiviteacute commesurveillanceet non pluscommeagression)
52 Inexactitude de la proposition laquo le systegravemeimmunitaire deacuteclenche une reacuteaction contre lenon-soi raquo
Pour comprendre agrave preacutesent pourquoi la secoproposition fondamentale du modegravele du soi et du nsoi doit ecirctre remise en cause nous devons particoncept-cleacute detoleacuterance immunitaire La toleacuterance deacutesigne un eacutetat dans lequel un eacuteleacutement exogegravene se trdans un organisme sans pour autant deacuteclencherreacuteaction immunitaire Il srsquoagit donc de laquo non-soi raquolrsquoorigine drsquoune acceptation par le systegraveme immuntaire ce qui va agrave lrsquoencontre de la proposition fondmentale eacutenonceacutee ci-dessus Trois eacuteleacutements prouainsi que la deuxiegraveme proposition du modegravele duest erroneacutee
521 La toleacuterance drsquoagents exogegravenespotentiellement pathogegravenes
Crsquoest le cas par exemple des bacteacuteries situeacutees speau ou dans lrsquointestin
522 La toleacuterance des greffesDans certaines conditions non-pathologiques
exemple la toleacuterance fœto-maternelle on constate
488 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
defreacute-parmi-duegravere
o-er-eacuteeor-reacutesest
tersquoun
deent
cinqnies
elulesdesos-iteacuteel-ansles
les
onsle
on-nc
ee laegravelece
desouson-ent
tiono-ns
eeys-
unecetortelesdeacute-t duseuoi
llo-lle
laec le
im-rsquoilsns
estrsquoestreacute-il y
e il
n-antale)
im-
eser
du
une absence de rejet de greffe[20] Le modegravele dusoi et du non-soi ainsi nrsquoest pas en mesurerendre compte du cas de greffe agrave la fois le plusquent et le plus important celui du fœtus porteacutela megravere Le fœtus en effet est une greffe seallogeacutenique qui est toleacutereacutee bien que la moitieacutepatrimoine geacuteneacutetique de lrsquoenfant soit issue du pet donc soit eacutetrangegravere agrave la megravere En outre le mdegravele du soi est incapable drsquoexpliquer pourquoi ctains organes ndash dits laquo immunoprivileacutegieacutes raquo (la cornpar exemple) ndash sont toleacutereacutes ni pourquoi drsquoautresganes comme le foie sont drsquoautant mieux toleacuteque la diffeacuterence HLA entre donneur et receveurforte
523 Le chimeacuterismeLe chimeacuterisme deacutesigne le fait qursquoun individu por
en lui en faibles quantiteacutes des cellules issues dautre individu Le cas le plus significatif est celuila femme enceinte des cellules du fœtus peuvecirctre deacutetecteacutees chez la megravere au bout drsquoagrave peinesemaines de gestation et jusqursquoagrave plusieurs deacutecenapregraves lrsquoaccouchement[21] Le chimeacuterisme deacutesigneacutegalement le cas des enfants qui portent des celde leur megravere et le cas drsquoun faux jumeau portantcellules de son fregravere Le chimeacuterisme prouve la psibiliteacute drsquoun laquo partage raquo du laquo soi raquo voire la possibilpour le laquo non-soi raquo drsquoecirctre constitutif du laquo soi raquo Les clules chimeacuteriques au lieu de rester laquo endormies raquo dlrsquoorganisme peuvent mecircme se diffeacuterencier en cellutumorales[22] voire peut-ecirctrefonctionnelles(deve-nant par exemple des cellules du foie des cellude la peau etc)
De lrsquoensemble de ces observations nous pouvconclure ceci contrairement agrave ce que postulemodegravele du laquo soi raquo les cateacutegories drsquoimmunogegraveneetdrsquoexogegravenene sont pas confondues Degraves lors le laquo nsoi raquo nrsquoest pas le compleacutement du laquo soi raquo et dolrsquoopposition dans le terme laquonon-soi raquo est deacutenueacutede sens Crsquoest par conseacutequent lrsquoensemble ddialectique du soi et du non-soi au cœur du modinitieacute par Burnet qui srsquoavegravere inadeacutequate puisquemodegravele eacutechoue agrave deacutefinir la limitation de chacundeux concepts Si ce raisonnement est exact npouvons en deacuteduire que le modegravele du soi et du nsoi est impropre agrave rendre compte du fonctionnemde lrsquoimmuniteacute
6 Pour un autre modegravele theacuteorique enimmunologie la continuiteacute spatio-temporelle
Nous tentons ici de proposer une autre orientatheacuteorique ndash imparfaite et provisoire ndash pour lrsquoimmunlogie Le critegravere drsquoimmunogeacuteniciteacute que nous mettoen avant est celui de lacontinuiteacute spatio-temporellequi srsquoappuie sur la deacutefinition de lrsquoimmuniteacute commsystegravemeeneacutequilibre La proposition fondamentale dlrsquohypothegravese de la continuiteacute est la suivante le stegraveme immunitaire reacuteagit agrave ce quirompt la continuiteacuteentre les reacutecepteurs des acteurs de lrsquoimmuniteacute drsquopart et les motifs antigeacuteniques drsquoautre part (queantigegravene soit endogegravene ou exogegravene) Seule impautrement dit la continuiteacute spatio-temporelle entrecomposants immunitaires et leurs cibles le critegravereterminant nrsquoeacutetant pas de savoir si ces cibles sonlaquo soi raquo ou du laquo non-soi raquo Ainsi selon cette hypothegravele systegraveme immunitaire ne reacuteagit pas agrave ce avec qil est en contact continu(et agrave partir de quoi il a eacuteteacuteseacutelectionneacute) alors qursquoil reacuteagit agrave ce qui vientbriserla continuiteacute(un motif antigeacutenique jamais rencontreacutebacteacuterie virus organe comme dans le cas drsquoune agreffe etc) et donc la distinction pertinente est ceentrecontinuiteacuteet rupture de continuiteacute et non la dis-tinction entre laquo soi raquo et laquo non-soi raquo Ce critegravere decontinuiteacute demande agrave ecirctre penseacute en correacutelation avconcept deressemblance Il srsquoagit drsquoune continuiteacute agrave lafois spatiale et temporelle tant que les reacutecepteursmunitaires continuent de reacuteagir aussi faiblement qulrsquoont fait jusqursquoici avec les antigegravenes preacutesents dalrsquoorganisme aucune reacuteaction immunitaire forte nrsquodeacuteclencheacutee Ce qui provoque une reacuteaction forte cla nouveauteacute crsquoest-agrave-dire le laquo jamais vu raquo pour lescepteurs de lrsquoimmuniteacute et crsquoest dans ce cas-lagrave qursquoa rupture de continuiteacute
Le point de deacutepart de cette hypothegravese est doublrepose sur lrsquoideacutee decommencementde lrsquoimmuniteacute etsur lrsquoideacutee drsquoautoreacuteactiviteacutecomme auto-reconnaissace Premiegraverement il existe initialement (soit pendla peacuteriode fœtale soit pendant la peacuteriode post-natpour chaque organisme une peacuteriode de toleacuterancemunitaire ce qui indique que lrsquoimmuniteacute a uncom-mencement Ce qui estpreacutesentau moment de cettseacutelection fondatricene deacuteclenchera pas de reacuteponimmune Deuxiegravemement lrsquoautoreacuteactiviteacute est au cœude lrsquoimmuniteacute normale le bon fonctionnementsystegraveme immunitaire repose sur uneseacutelection conti-
T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492 489
tre
er-niteacute
st-on-nir
eacuteestionnqtion
f-
tionles
el-s leca-lulesdeo-
rsquoilsme
ssimeeacute-
ap-
on
iiso-onc-resla
gu--rup-fsxo-(parle
agrave
onc-el-ncecel-turereacute-ent
medegraves
esdi-sonoi raquoeacuteesle
nti-
anti-ro-
ma-nti-aceinslaiteacuteionour
uelseauffet duam-eanse
tion
nue puisque pour survivre un lymphocyte doit ecircreacuteguliegraverementstimuleacute par des antigegravenesendogegravenes(a priori non pathogegravenes) Lrsquoorganisme doit en pmanence assurer pour lui-mecircme une auto-immucontenue et continue
En quoi un modegravele insistant sur la continuiteacute eil plus satisfaisant que le modegravele du soi et du nsoi Lagrave ougrave le modegravele du soi est contraint de deacutefide multiplesexceptions lrsquohypothegravese de la continuitse veut unificatrice capable de rassembler toutles observations connues sous une mecircme explicaNous consideacuterons ainsi qursquoil y a pour lrsquoessentiel cidomaines qui montrent la supeacuterioriteacute drsquoune concepde ce type
(1) Lrsquoauto-immuniteacute Lrsquohypothegravese de la continuiteacute afirme qursquoil nrsquoy a pas de diffeacuterence deprincipeentre une reacuteaction auto-immune et une reacuteacimmunitaire visant un antigegravene exogegravene dansdeux cas il se produit unerupture de continuiteacutelieacutee agrave une modification de ce avec quoi les clules immunitaires se trouvent en contact Dancas des maladies auto-immunes il y a modifition des peptides preacutesenteacutes agrave la surface des celde lrsquoorganisme ce qui aboutit agrave une rupturecontinuiteacute alors mecircme que les peptides ainsi mdifieacutes restent du laquo soi raquo preacuteciseacutement parce qusont issus du mateacuteriel geacuteneacutetique de lrsquoorganisconsideacutereacute
(2) Les cancers Les cellules canceacutereuses elles ausont issues du mateacuteriel geacuteneacutetique de lrsquoorganiset donc sont du laquo soi raquo mais les motifs antigniques agrave leur surface brisent la continuiteacute par rport agrave des tissus sains
(3) Le prolongement entre immuniteacute et reacutegulatidrsquoensemble de lrsquoorganismeContrairement agrave ceque lrsquoimmunologie contemporaine a fait jusqursquoiclrsquohypothegravese de la continuiteacute permet de ne pasler dans lrsquoorganisme les agents assurant des ftions dedeacutefense des agents responsables drsquoautfonctions Lrsquoimmuniteacute est selon lrsquohypothegravese decontinuiteacute seulement lrsquoune des activiteacutes de reacutelation de lrsquoorganisme Ainsi lrsquoactiviteacute drsquoun macrophage par exemple est deacutetermineacutee par lature de continuiteacute entre ses reacutecepteurs et les motiavec lesquels il reacuteagit que ceux-ci soient egegravenes (bacteacuterie par exemple) ou endogegravenesexemple dans le cas drsquoune cellule morte que
macrophage doit ingeacuterer) donc il nrsquoy a pasenvisager pour le macrophagedeux tacircches dis-tinctes comme le fait le modegravele du soi (fonctidrsquolaquoeacuteboueur raquo de lrsquoorganisme drsquoune part fontion immune drsquoautre part) De mecircme les clules TReg ne sont pas stimuleacutees par la preacutesede laquo non-soi raquo puisqursquoelles reacuteagissent agrave deslules immunitaires endogegravenes mais par la rupde continuiteacute exprimeacutee preacuteciseacutement par lescepteurs des cellules immunitaires qui constituleur cible
(4) Les cas de toleacuterance immunitaire La continuiteacuterend compte de lrsquoeacutetat drsquoeacutequilibre qui srsquoeacutetablitentre lrsquoindividu et des agents pathogegravenes comles bacteacuteries sur la peau On constate queqursquoapparaicirct un deacuteficit immunitaire ces bacteacuteriqui jusque-lagrave eacutetaient sans effet neacutegatif sur lrsquoinvidu concerneacute provoquent des dommages agraveencontre Le critegravere nrsquoest donc pas celui du laquo set du laquo non-soi raquo puisque les bacteacuteries concernsont tout autant du laquo non-soi raquo avant qursquoapregravesdeacuteficit immunitaire mais bien larupture de conti-nuiteacutedans les interactions reacutecepteurs-motifs ageacuteniques
(5) Les meacutecanismes drsquoinduction drsquoune toleacuterance Mecirc-me dans le systegraveme immunitairemature on cons-tate parfois une absence de reacuteaction agrave desgegravenes avec lesquels lrsquoindividu est en contact plongeacute Il est difficile de deacuteterminer lescritegraveresdecette induction de toleacuterance puisque dans lajoriteacute des cas apregraves le premier contact avec lrsquoagegravene une reacuteponse immunitaire rapide et efficse deacuteclenche au deuxiegraveme contact Neacuteanmoil existe plusieurs meacutecanismes drsquoinduction detoleacuterance dont seule lrsquohypothegravese de la continusemble pouvoir rendre compte deacutesensibilisatdans le cas des allergies toleacuterance provisoire pcertains antigegravenes du pegravere apregraves la grossesse[21]toleacuterance pour certains pathogegravenes avec lesqon est en contact prolongeacute (bacteacuteries de la pde lrsquointestin) toleacuterance plus probable drsquoune gredrsquoorgane apregraves transfusion sanguine provenanmecircme donneur drsquoorgane etc Cela permet notment drsquoarticuler lacontinuiteacute avec les eacutetats dsymbiose les nombreuses bacteacuteries situeacutees dnotre intestin facilitent la digestion et de mecircmles bacteacuteries sur notre peau assurent lrsquoeacutelimina
490 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
se-
aisreacute-ffeonthy-nceire
quemeso-
vantttreonttiondit
euxaisionen-
sursene deques Ellau raquo
a-
eacuteo-en
u-nsheacuteo-tionis-quei-
sesce
ent
s a
queuto-
si-ous
n-Lemes
titeacuteoutge-
lo-
o-eacute
n-eacute-
ionsmet cardonc
en-iteacutehegravesesde-
up-sub-vec
y-tre-com-
drsquoautres pathogegravenes qui pour leur part cauraient des dommages agrave lrsquoorganisme
Une autogreffe ou une greffe entre jumeaux vrbien qursquoelles semblent rompre la continuiteacute entrecepteurs et motifs antigeacuteniques puisque lrsquoon grepar exemple un tissu agrave la place drsquoun autre tissu stoleacutereacutees ce qui paraicirct constituer une objection agrave lrsquopothegravese de la continuiteacute Cependant cette toleacuterasrsquoexplique par le fait que pour le systegraveme immunitareceveur il nrsquoy a pas de rupture de continuiteacute puisles reacuteactions reacutecepteursndashantigegravenes restent les mecirceacutetant donneacute qursquoil nrsquoy a aucune diffeacuterence dans les mtifs antigeacuteniques et donc dans les signaux eacutemis aet apregraves la greffe De faccedilon similaire on peut eacutemelrsquohypothegravese que ce qui fait que certaines greffes smieux toleacutereacutees que drsquoautres ce nrsquoest pas la distincsoinon-soi (conformeacutement agrave ce que nous avonscertains organes comme le foie sont drsquoautant mitoleacutereacutes qursquoils sont diffeacuterents de lrsquoorgane hocircte) mla plus grande continuiteacute dans lrsquoactiviteacute de stimulatdes agents immunitaires Ce qui importe crsquoest bientendu la continuiteacutepour les cellules immunitaires etnon la continuiteacutepour nous
Les avantages de lrsquohypothegravese de la continuiteacutele modegravele du soi tels que nous venons de les preacuteter nous permettent de preacuteciser quelle est la placcette hypothegravese au sein des theacuteories immunologiproposeacutees au cours des trente derniegraveres anneacuteessrsquoappuie incontestablement sur la theacuteorie du laquo reacuteseimmunitaire apparue chez Jerne[23] puis deacuteveloppeacuteesous la forme de la reacutegulation de lrsquoauto-immuniteacute nturelle ouimmunological homunculus[24] ainsi quesous le terme controverseacute drsquoautopoiesis[25] Lrsquohy-pothegravese de la continuiteacute a en commun avec les thries du reacuteseau lrsquoideacutee qursquoune reacuteaction immune estfait uneperturbation du systegraveme[26] crsquoest-agrave-dire unemodification du comportement que le systegraveme immnitaire a eu jusqursquoici (laquo rupture de continuiteacute raquo dale cadre de notre hypothegravese) Cependant les tries du reacuteseau immunitaire proposent une concepclosede lrsquoimmuniteacute selon ses promoteurs si la dtinction soinon-soi est insatisfaisante crsquoest parcele systegraveme immunitaire nrsquoa jamais affaire qursquoagrave lumecircme[24] Agrave lrsquoopposeacute lrsquohypothegravese de la continuiteacutedonne pour objectif drsquoouvrir le systegraveme comme noulrsquoavons vu avec les cas drsquoinduction drsquoune toleacuteranimmunitaire Lrsquohypothegravese de la continuiteacute autrem
-
e
dit srsquoefforce de comprendre comment des entiteacutepriori distinctes de lrsquoorganisme peuventsrsquointeacutegrer agravelui (processus drsquoouverture et de toleacuterance) alorsles theacuteories du reacuteseau insistent sur la clocircture et lrsquoadeacutefinition de lrsquoimmuniteacute
7 Identiteacute immunitaire et identiteacute philosophique
Lrsquohypothegravese de la continuiteacute nous eacuteloigne condeacuterablement du modegravele du soi mais elle ne neacuteloigne pas pour autant de la question de lrsquoidentiteacuteNotre conviction est qursquoil est possible de penser lrsquoidetiteacute biologique sans la deacutefinir comme un laquo soi raquoconcept philosophique drsquoidentiteacute repose sur les terlatins idem (fait drsquoecirctre identique agrave soi ideacutee deper-manencedans le temps) etipse (fait de demeurer lemecircme tout en changeant partiellement il y aeacutevolu-tion dans le temps) drsquoun cocircteacute nous avons lrsquoidenimmuable dans le temps et de lrsquoautre lrsquoideacutee que tecirctre reste le mecircme tout en accueillant en lui le chanment Cette distinction rejoint la probleacutematique phisophique de lasubstance la substance est uninvariantsusceptible drsquoecirctre pour chaque individu lesupportdetoutes lesvariations[27] Deux grandes thegraveses philsophiques srsquoaffrontent sur la question de lrsquoidentitla premiegravere deacutefinit lrsquoidentiteacute par lasubstance tandisque la seconde deacutefinit lrsquoidentiteacute par lacontinuiteacute Se-lon la premiegravere thegravese ce qui fait lrsquoidentiteacute drsquoun idividu crsquoest la substance crsquoest-agrave-dire le support mtaphysique de toutes ses deacuteterminations et variatSelon la deuxiegraveme thegravese agrave lrsquoopposeacute rien ne perde preacutesupposer qursquoil existe une telle laquo substance raquocette substance est par deacutefinition inaccessible etlrsquoidentiteacute repose seulement sur lacontinuiteacutedans letemps continuiteacute des changements physiques oucore concernant lrsquoidentiteacute psychologique continudes eacutetats de conscience Le deacutebat entre ces deux tphilosophiques pourrait ecirctre illustreacute par les figuresLocke[28] et de Leibniz[29] La conception substantialiste de lrsquoidentiteacute consiste agravesupposerplus que laconception fondeacutee sur la continuiteacute (ce que lrsquoon spose en plus crsquoest preacuteciseacutement un laquo noyau raquo destantialiteacute) Or on peut agrave bon droit ecirctre drsquoaccord ale soupccedilon de Locke renforceacute par Hume[30] puisquela substanceest en elle-mecircme un noyau meacutetaphsique inatteignable pourquoi la preacutesupposer Aument dit si on peut se passer de la substance pour
T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492 491
eacute--parsesutuisuesyer
degraveler il
unuedu
-
-rerionpar
deplecele
voirneors
etezper-du
po-quiiegrave-net re-s aus
euxvec
gielleenrsquoest
soiqueeacute
en-me
en-pasni-reacute-isnti-rsn-r en-
os--
que)s
pourpreacute-me
ienge
c-
nse-
ow2)
elf12
prendre lrsquoidentiteacute pourquoi y ferait-on appel La dmarche de Locke relegraveve alors de ladeacuteflation meacutetaphysique si un mecircme pheacutenomegravene peut ecirctre expliqueacutedeux modegraveles dont lrsquoun repose sur moins drsquohypothegraveque lrsquoautre alors crsquoest le modegravele minimal qursquoil vamieux adopter Lrsquoimmunologie est au moins deples anneacutees 1940 peacutetrie de concepts philosophiqNotre rocircle devrait ecirctre dans ces conditions drsquoessadrsquoaccorder agrave ces concepts leur juste place Le modu soi se situe du cocircteacute de lrsquoidentiteacute-substance catente de deacutefinir lrsquoidentiteacute de lrsquoorganisme commenoyau substantiel dont lrsquointeacutegriteacute doit ecirctre deacutefendtandis que lrsquohypothegravese de la continuiteacute se rangecocircteacute de lrsquoidentiteacute-continuiteacute Lrsquohypothegravese de la continuiteacute par conseacutequent constitue une propositionphi-losophiquepour limiter lrsquousage des concepts philosophiques en immunologie elle srsquoefforce de reacuteiteacutedans le domaine propre de lrsquoimmunologie la deacuteflatmeacutetaphysique que lrsquoidentiteacute-continuiteacute repreacutesenterapport agrave lrsquoidentiteacute-substance
Une question cependant surgit ici lrsquohypothegravesela continuiteacute nrsquoest-elle pas finalement qursquoune simreformulation du modegravele du soi Ne dit-elle pasque les immunologistes ont toujours dit Nous nepensons pas Rien bien entendu nrsquoempecircche delrsquohypothegravese de la continuiteacute simplement comme uconception renouveleacutee du laquo soi raquo On affirmerait alseulement qursquoil srsquoagit dans ce cas dusoi compriscomme continuiteacute (comme chez Locke ou Hume)non dusoi compris comme substance (comme chLeibniz) Cette suggestion est seacuteduisante car ellemettrait une fois encore de laquo sauver raquo le modegravelesoi et du non-soi Neacuteanmoins premiegraverement lrsquohythegravese de la continuiteacute explique des pheacutenomegraveneseacutetaient mal expliqueacutes par le modegravele du soi Deuxmement et surtout faire de lrsquoidentiteacute-continuiteacute uconception renouveleacutee du laquo soi raquo serait preacuteciseacutementomber dans lrsquoerreur qui consiste en ayant recourterme trop large desoi agrave recouvrir deux significationbien distinctes lasubstanceet lacontinuiteacute Parler delaquo soi raquo crsquoest se condamner agrave ne pas distinguer les dsens agrave passer de lrsquoun agrave lrsquoautre sans justification ale risque de tout laquo substantialiser raquo en immunoloOn pourrait donc accepter lrsquoobjection selon laquece que lrsquoon propose nrsquoest qursquoune redeacutefinition du soiimmunologie mais ce que lrsquoon ne peut accepter clrsquoideacutee que le terme desoi doit ecirctre conserveacute
8 Conclusion philosophie de lrsquoidentiteacutebiologique
Quelles questions pose lrsquoanalyse du modegravele duet du non-soi pour une compreacutehension philosophide la deacutefinition biologique de lrsquoidentiteacute Lrsquoidentitbiologique pour tout ecirctre vivant deacutesignece qursquoil estbiologiquement crsquoest-agrave-dire son uniciteacute et sa diffeacuterciation spatiale Nous avons montreacute que le systegraveimmunitaire constituait bien une sorte de carte drsquoidtiteacute de lrsquoorganisme mais que cette identiteacute nrsquoeacutetaitclose agrave toute influence exteacuterieure lrsquoidentiteacute immutaire nrsquoest pas deacutefinie agrave partir drsquoun ensemble deactions de deacutefense agrave toutesles entiteacutes exogegravenes made maniegravere continuiste crsquoest-agrave-dire comme la conuiteacute spatio-temporelle des reacuteactions entre reacutecepteude lrsquoimmuniteacute et motifs antigeacuteniques (qursquoils soient edogegravenes ou exogegravenes) Degraves lors peut se dessineparticulier agrave partir de lrsquoideacutee drsquoinduction de la toleacuterance immunitaire une reacuteflexion eacutelargie sur la psibiliteacute de deacutefinir lrsquoidentiteacute biologique (agrave la fois pheacutenotypique et en amont geacuteneacutetique ou para-geacuteneacuteticomme une identiteacuteouverte articulant agrave la fois deeacuteleacutements endogegravenes et des eacuteleacutements exogegravenesdeacuteterminer en derniegravere instance le propre toujourscaire et toujours combineacute (laquo impur raquo) drsquoun organisvivant donneacute
Remerciements
Nous remercions pour leur aide et leur soutAnouk Barberousse Claude Debru Michel MoranJean Gayon Ceacutedric Brun et Hannah-Louise Clark
Reacutefeacuterences
[1] FM Burnet F Fenner The Production of Antibodies Mamillan Melbourne 1941 2e eacutedition en 1949
[2] MS Anderson ES Venanzi L Klein Z Chen SP BerziSJ Turley H von Boehmer R Bronson A Dierich C Bnoist D Mathis Projection of an Immunological Self ShadWithin the Thymus by the Aire Protein Science 298 (2001395ndash1401
[3] RE Langman M Cohn A minimal model for the self-nonsdiscrimination a return to the basics Semin Immunol(2000) 189ndash195
492 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
self
uil
ty
ofd
de
-
aelf
rrs
ha8
Ho-nlf-
f6
-G
odSci
itet
em
ical
ei-
u-
[4] P Matzinger The danger model a renewed sense ofScience 296 (2002) 301ndash305
[5] J Bernard M Bessis C Debru (dir) Soi et non-soi SeParis 1990
[6] FM Burnet Changing Patterns An Atypical AutobiographyHeinemann Melbourne 1968
[7] M Morange La part des gegravenes Odile Jacob Paris 1998[8] FM Burnet The Integrity of the Body Harvard Universi
Press Cambridge 1962[9] AI Tauber L Chernyak Metchnikoff and the Origins
Immunology Oxford University Press New York Oxfor1991
[10] A-M Moulin Le dernier langage de la meacutedecine ndash histoirelrsquoimmunologie de Pasteur au Sida PUF Paris 1991
[11] AI Tauber The Immune Self Theory or metaphor Cambridge University Press Cambridge 1994
[12] Aristote Cateacutegories Vrin Paris 1994 chapitres 10 et 11[13] Aristote Cateacutegories chapitre 5 3b22ndash33[14] P Kourilsky J-M Claverie The peptidic self model
hypothesis on the molecular nature of the immunological sAnn Immunol 137 (1986) 3ndash21
[15] DH Raulet RE VanceCW McMahon Regulation of thenatural killer cell receptor repertoire Annu Rev Immunol 19(2001) 291ndash330
[16] PG Ashton-Rickardt A Bandeira JR Delaney L Van KaeHP Pircher RM Zinkernagel S Tonegawa Evidence foa differential avidity model of T-cell selection in the thymuCell 76 (1994) 651ndash663
[17] C Tanchot B Lemonnier A Perarnau A Freitas B RocDifferential requirements for survival and proliferation of CDnaive or memory T cells Science 276 (1997) 2057ndash2062
[18] MS Jordan A Boesteanu AJ Reed AL Petrone AElenbeck MA Lerman A Naji AJ Caton Thymic selectioof CD4+CD25+ regulatory T cells induced by an agonist sepeptide Nat Immunol 2 (2001) 301ndash306
[19] Z Feheacutervari S Sakaguchi Development and function oCD25+CD4+ regulatory T cells Curr Opin Immunol 1(2004) 203ndash208
[20] ED Carosella N Rouas-Freiss P Paul J Dausset HLAa tolerance molecule from themajor histocompatibility com-plex Immunol Today 20 (1999) 60ndash62
[21] DW Bianchi GK Zickwolf GJ Weil S Sylvester MADeMaria Male fetal progenitor cells persist in maternal blofor as long as 27 years postpartum Proc Natl AcadUSA 93 (1996) 705ndash708
[22] D Cha K Khosrotehrani Y Kim H Stroh DW BianchKL Johnson Cervical cancer and microchimerism ObsGynecol 102 (2003) 774ndash781
[23] NK Jerne Towards a network theory of the immune systAnn Immunol 125 C (1974) 373ndash389
[24] IR Cohen The cognitive paradigm and the immunologhomunculus Immunol Today 13 (1992) 490ndash494
[25] HR Maturna FJ Varela Autopoiesis and cognition D Rdel Dordrecht The Netherlands 1980
[26] AI Tauber Moving beyond the immune self Semin Immnol 12 (2000) 241ndash248
[27] Aristote Cateacutegories chapitre 5[28] J Locke Essai sur lrsquoentendement humain 1690[29] GW Leibniz Nouveaux Essais sur lrsquoentendement humain
1765[30] D Hume Traiteacute de la nature humaine 1739
T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492 483
llsby ais
us
ge
del
psu
ho-kin
l
hatriesotate
eofate
o-st
ival
ebutenyr extwo
therd)an-
eto
u-
he-ivene akof
rsbalcerytol-hadd
lieelf
thatingb-hetio-iesentep--
one
Wem-nd
sisbe-ry-
m-d
f astyen-ne
cytes can be understood on the model of NK cewhich do not go through the selection processgeneration of diversity but play nonethelesskey role in the body Everything in the thymusa question ofactivatoryandinhibitory signals
(2) Peripheral autoreactivity lymphocytes surviveon-ly if they are regularly stimulated by endogenoantigens
(3) Autoimmune diseases if understood in linkawith normal autoreactivity
The second proposition of the selfnon-self mo(the immune system reacts against the non-self) is alsoinadequate as three experimental remarks encalated by the notion of immunetolerance prove
(i) tolerance of exogenous and potentially patgenic entities (for example bacteria on the sor in the gut)
(ii ) tolerance of grafts especially the foeto-maternatolerance
(iii ) chimerism
From all these observations we can conclude tcontrary to what the self model asserts the categoof lsquoimmunogenrsquo and lsquoexogenousrsquo are actually nequivalent Thus the only remaining possibility this the opposition asrelative cannot define the immunnon-self The opposition in the term lsquonon-selfrsquo isthereforemeaningless The self model fails to definthe limit of self and non-self and so the dialecticself and non-self initiated by Burnet seems inadequas a whole
However to show the inadequacy of the immunlogical selfnon-self model is not enough We musuggest another hypothesis for immunology The rhypothesis we develop here can be called thecon-tinuity hypothesis According to this hypothesis thimmune system does not respond to lsquonon-selfrsquoto every break of spatio-temporal continuity betwethe immune receptors and the antigens to which thereact (whether these antigens are endogenous oogenous) The continuity hypothesis is based onmain ideas First immunity has abeginning since or-ganisms have a period of immune tolerance (wheembryonic period or immediately post-natal periothus immunity is not an innate characteristic oforganism Everything that ispresentwhen the selec
-
-
tion of lymphocytes occurs will not trigger an immunreaction later Secondly autoreactivity is inherentnormal immunity the immune system demands acon-tinuous selection since a lymphocyte must be stimlated regularly byendogenousantigens to survive
Why is the continuity hypothesis better than tselfnon-self model Mainly because it is more explicative that is it provides a single comprehensexplanation for the triggering of immune reactiowhereas the selfnon-self model is obliged to definmultiplicity of exceptions to its general rule We thinthat at least five domains display the superioritythe continuity model (1) autoimmunity (2) cance(3) uninterruptedness between immunity and gloregulation of the organism (4) immune toleran(5) induction of tolerance (desensitization provisotolerance for paternal antigens after pregnancyerance for some pathogens with which we havea long contact greater graft tolerance after a blootransfusion from the organ donor etc)
Two philosophical conceptions of identity underthe self model and the continuity hypothesis The smodel understands identity as asubstance(the preser-vation of a metaphysical core throughout changesis defense of integrity only the changes originatfrom the lsquoinsidersquo are tolerable) on the model of Leinizrsquos philosophy The continuity hypothesis on tother hand leans on the definition of identity as spatemporal continuity on the model of the philosophof Locke and Hume Since their philosophies represa metaphysical deflation of the substantialist conction we think that it is time for immunology to reproduce this deflation in its own domain
Is the continuity hypothesis a simple reformulatiof the self model the only difference being that wdefine identity by continuity instead of substancethink not the continuity hypothesis explains phenoena that cannot be explained by the self model amoreover if we assimilate the continuity hypotheand the self model we risk repeating the confusiontween the two meanings and lsquosubstantializingrsquo evething in immunology
The continuity hypothesis has one feature in comon with the network theories of immunity initiateby N Jerne immune reactions are conceived operturbationsof the system However the continuihypothesis differs from these theories on a fundamtal issue while network theories describe the immu
484 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
nrsquoler-
iveon-itythe
us)anex-theof
an-rsquoileulvo-
te
olo-e
seacutesge) Laeacutevi-
ac-treitrmeern-nereacute-
iffeacute-elle
leeeacute-es
foistrentn-ffeacute-ter-iron-ett duestla-
aceala-
t agrave
tdif-rmeegrave-me
tsite
est
ri-on-enim-s
system as closed and self-defining the continuity hy-pothesis aims atopeningthe system mainly with theidea of induction of tolerance (a supposedly lsquoforeigelement can be integrated into an organism and toated)
Thus immune identity is defined not by defensreactions towards all exogenous entities but in a lsquoctinuistrsquo way that is as the spatio-temporal continuof the reactions between the immune receptors andantigenic sites (whether endogenous or exogenoWe can then conceive of the biological identity asopenidentity that deals with both endogenous andogenous elements in order to determine eventuallycombined (lsquoimpurersquo) and always precarious naturea given organism
1 Introduction
Depuis sa formulation par Burnet agrave partir desneacutees 1940[1] le modegravele du soi et du non-soi ndash qusoit implicitement accepteacute (pour ne citer qursquoun sexemple mais dont le titre est particuliegraverement eacutecateur voir[2]) clairement revendiqueacute[3] ou criti-queacute [4] ndash constitue lrsquoarriegravere-plan theacuteorique de toula production scientifique en immunologie[5] Lrsquouti-lisation des termes meacutetaphysiques desoiet denon-soidans une science expeacuterimentale comme lrsquoimmungie est eacutetonnante drsquoougrave lrsquoideacutee drsquoune eacutevaluation critiqude ce modegravele (nous eacutecrirons les motssoi et non-soien italiques lorsqursquoil srsquoagit des termes ou notionentre guillemets lorsqursquoil srsquoagit des concepts utilispar le modegravele du soi et dont nous critiquons lrsquousaet sans signe particulier dans tous les autres casviseacutee drsquoensemble de notre examen est la mise endence drsquouncritegravere drsquoimmunogeacuteniciteacute crsquoest-agrave-dire ladeacutetermination de ce qui deacuteclenche ou non une reacutetion immunitaire dans un mecircme organisme Agrave ce tilrsquoobjectif de cet article est triple Drsquoabord il srsquoagde comprendre quel est le sens speacutecifique des tesoi et non-soien immunologie Ensuite de montrpourquoi le modegravele immunologique du soi et du nosoi devrait ecirctre revu voire abandonneacute agrave partir drsquoudouble critique conceptuelle et fondeacutee sur dessultats expeacuterimentaux des termessoi et non-soi En-fin nous proposerons une hypothegravese explicative drente mettant en avant la continuiteacute spatio-tempordes reacuteactions entre les reacutecepteurs et les ligands
s
2 Lrsquoeacutequivoque situeacutee au cœur du modegravele du soi etdu non-soi
Agrave titre provisoire nous pouvons consideacuterer queterme desoi biologique est un synonyme du termdrsquoidentiteacutebiologique qui deacutesigne lrsquoensemble des dterminants qui font qursquoun organisme est diffeacuterent dautres organismes Un tel laquo soi raquo deacutesigne agrave lalrsquo uniciteacute de chaque individu (qui est le seul agrave ecirctel qursquoil est agrave lrsquoexception drsquoindividus geacuteneacutetiquemeidentiques) et sadistinction spatiale et environnemetale(mecircme des jumeaux vrais par exemple sont dirents en ce qursquoils occupent des lieux distincts et inagissent de maniegraveres dissemblables avec leur envnement) Or puisque lrsquoimmunologie depuis Burnse deacutefinit elle-mecircme comme la laquo science du soi enon-soi raquo[6] la question se pose de savoir quelle rapport entre lrsquoidentiteacute telle que nous venons dedeacutefinir et lrsquoimmuniteacute Lrsquoimmuniteacute qui deacutesigne eacutetymologiquement une exemption (immunitas) a eacuteteacute deacutefiniecomme la capaciteacute qursquoa un organisme de reacuteagir fagrave des agents pathogegravenes afin drsquoeacutechapper agrave la mdie et donc comme sa reacuteaction dedeacutefensecontre detels agents Lrsquoeacutequivoque du modegravele du laquo soi raquo tience rapprochement implicite entreidentiteacute (uniciteacute etdistinction) etsystegraveme de deacutefensede lrsquoorganisme Eneffet si drsquoune part le termesoi deacutesigne simplemenun organisme et le fait que chaque organisme estfeacuterent des autres alors on ne voit pas en quoi ce terelegraveverait de lrsquoimmunologie (nous verrons qursquoil relverait plutocirct de la geacuteneacutetique) si drsquoautre part le tersoi fait reacutefeacuterence agrave uneinteacutegriteacute de lrsquoindividu qursquoilsrsquoagirait dedeacutefendre de maintenir (contre des agenpathogegravenes) alors il dissimule une confusion implicentre lrsquoexogegraveneet le dangereux puisque lrsquoon postulealors que tout ce qui est exteacuterieur agrave lrsquoorganismesusceptible de lui nuire
3 Soi biologique et soi immunitaire
Le soi biologique est principalementgeacuteneacutetiquemecircme srsquoil nrsquoest pas uniquement geacuteneacutetique[7] Lrsquouni-citeacute de lrsquoindividu repose sur lrsquouniciteacute de son patmoine geacuteneacutetique comprise en relation avec lrsquoenvirnement cellulaire et avec le milieu de lrsquoorganismegeacuteneacuteral et non sur la speacutecificiteacute de ses cellulesmunitaires Les reacutecepteurs immunitaires ainsi que le
T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492 485
liteacuteuesanthro-
es-e
uiteonsrs
untheacute-
im-nitrai-cep
t
e
ourt agrave
enteeacute-
saireire
m-
rendtionaisi denuer
leire
uende
on-mele
m-hi-
ntri-r
sens
clu-uelnousce
non-aunesiga-estsoi raquo
e laon-
rtente le
So-
esseacute-ant
moleacutecules du complexe majeur drsquohistocompatibi(CMH) ne sont qursquoune manifestation pheacutenotypiqdrsquoune diversiteacute fondamentalement geacuteneacutetique reposur la combinatoire de lrsquoheacutereacutediteacute (brassages intercmosomique et intrachromosomique) Lrsquoidentiteacutebiolo-gique de chaque ecirctre vivant autrement dit ladiversiteacutedes organismes y compris au sein drsquoune mecircmepegravece relegraveve prioritairement de lrsquoheacutereacutediteacute qui se situen amont de la speacutecificiteacute immunitaire
Deux raisons cependant expliquent que agrave la sde Burnet les immunologistes aient placeacute les notide soi et denon-soiau cœur de leur discipline alomecircme que rien ne laisse penser a priori que lrsquoimmuniteacuterenvoie agrave lrsquoidentiteacute La premiegravere raison repose surfait clairement eacutetabli lesreacutecepteurs immunitaires eles moleacutecules du CMH appartiennent certes au pnotype mais leur diversiteacute est de tregraves loin la plusportante de lrsquoorganisme agrave tel point qursquoon les deacutefiparfois comme sa laquo carte drsquoidentiteacute raquo La deuxiegravemeson en revanche se fonde sur un glissement contuel implicite et non deacutemontreacute de lrsquoideacutee drsquoidentiteacuteagrave lrsquoideacutee dedeacutefense de lrsquointeacutegriteacuteet enfin agrave lrsquoideacutee delutte contre tout ce qui estexogegravene une fois lrsquoim-muniteacute deacutefinie comme ladeacutefensecontre tout agenpathogegravene son rocircle a eacuteteacute penseacute comme lemaintiendans le tempsde lrsquoidentiteacute de lrsquoorganisme crsquoest-agrave-dirlrsquoabsence drsquoune quelconquemodificationde lrsquoindividupar des entiteacutesexogegravenes(seules les modificationsen-dogegraveneseacutetant consideacutereacutees comme acceptables plrsquoorganisme) Or le modegravele du soi et du non-soi eslrsquoorigine de ce glissement preacutesent de maniegravere eacutevidchez Burnet[8] alors qursquoil est absent chez un prdeacutecesseur de Burnet comme Metchnikoff[9] Un telmaintiende lrsquoidentiteacute qui fait du laquo soi raquo uneforteresseagrave deacutefendre perpeacutetuellement a un point de deacutepart danle temps agrave savoir la fin de la toleacuterance embryonnou immeacutediatement post-natale le laquo soi raquo immunitaestacquis(par la seacutelection des cellules immunocopeacutetentes) et non inneacute[10] Degraves lors que lrsquoon prendconscience de ce glissement conceptuel on compque le laquo soi raquo immunitaire ne reacutepond pas agrave la queslaquo qui suis-je raquo (dans mon uniciteacute drsquoecirctre vivant) mlaquo comment suis-je proteacutegeacute raquo (crsquoest-agrave-dire agrave lrsquoabrquelles entiteacutes eacutetrangegraveres dois-je rester pour contiagrave ecirctremoi-mecircme) et en ce sens ilnrsquoest pasle syno-nyme de lrsquoidentiteacute biologique qursquoil preacutetend ecirctre
Nous voudrions agrave preacutesent montrer pourquoimodegravele du soi et du non-soi doit ecirctre revu vo
-
rejeteacute[11] Nous emprunterons deux voies de critiqla premiegravere philosophique (conceptuelle) la secofondeacutee sur des reacutesultats expeacuterimentaux
4 Rejet philosophique du modegravele du soi et dunon-soi
Lrsquoexamen conceptuel du modegravele du soi et du nsoi conduit agrave la remise en question de la notion mecircde non-soi Le problegraveme est le suivant quel estsens de la neacutegation dans lrsquoexpression laquonon-soi raquo Pour reacutepondre agrave cette question il est utile de coprendre quelles sont les diffeacuterentes significations plosophiques de lrsquoideacutee drsquoopposition Comme le montreAristote[12] on peut en logique distinguer seulemequatre types drsquooppositions (1) la neacutegation (2) la pvation (3) la contrarieacuteteacute (4) lrsquoopposition relative Onous allons prouver agrave preacutesent qursquoaucun de cesne peut srsquoappliquer agrave lrsquoexpression laquonon-soi immuni-taire raquo Pour ce faire nous allons proceacuteder par exsion nous allons montrer par lrsquoexamen conceptque seul le quatriegraveme sens est envisageable puismontrerons par lrsquoexamen expeacuterimental que mecircmequatriegraveme sens est inapplicable
Premiegraverement on ne peut pas comprendre le laquosoi raquo comme lrsquoopposeacuteneacutegatif du laquo soi raquo car dans llogique aristoteacutelicienne la neacutegation consiste agrave nierproposition(ce qui veut dire tregraves simplement ceci la proposition laquo il est assis raquo est vraie alors sa neacutetion agrave savoir la proposition laquo il nrsquoest pas assis raquoneacutecessairement fausse) Or le laquo soi raquo et le laquo non-sont desnotions et non despropositions Deuxiegraveme-ment le laquo non-soi raquo nrsquoest pas laprivation du laquo soi raquoau sens par exemple ougrave la ceacuteciteacute est la privation dvue puisque lrsquoon constate que le laquo soi raquo et le laquo nsoi raquo pour un individu donneacutecoexistent Troisiegraveme-ment lrsquoopposition commecontrarieacuteteacutedoit-elle aussiecirctre rejeteacutee car comme le montre Aristotela sub-stance premiegraverendash qui deacutesigne tel individu particuliele support permanent des changements qui affeccet individu crsquoest-agrave-dire tregraves exactement ce que vislaquo soi raquo ndashnrsquoa pas de contraire[13] En effetrien nrsquoestle contraire de lrsquoindividualiteacute on ne peut pas direpar exemple que Protagoras est le laquo contraire raquo decrate Lrsquoindividu se comprend agrave partir de lrsquoalteacuteriteacute (dautres individus) ndash sans quoi il ne pourrait preacuteciment pas srsquoindividualiser ndash mais il nrsquoa pas pour aut
486 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
le
par-ent
uxs al-ntalent
mblear-urrai raquo
ulede
unelaquo lee leen-en-eacutevi-
oi raquo
gu-cel-ires paibi-es
ledes
et
hy-
uessusiqueaite-rsquoor-
rpreacute-lantpli-sles
lade
arceto-ais
t agraveme
yteir auest
metretidera-t agravereacute-
e lapo-
des
lesineacute-lec-rsquoougrave
-
de contraire Seul reste possible par conseacutequentquatriegraveme sens lrsquooppositionrelative le laquo non-soi raquoest au sens matheacutematique lecompleacutementdu laquo soi raquocar tout eacuteleacutement qui nrsquoappartient pas au laquo soi raquo aptient neacutecessairement au laquo non-soi raquo et reacuteciproquemCependant lrsquoopposition des relatifs doit pouvoir srsquoap-puyer sur un critegravere de distinction clair entre les deensembles compleacutementaires ainsi deacutefinis Or noulons montrer agrave preacutesent gracircce agrave lrsquoexamen expeacuterimeque le laquo soi raquo et le laquo non-soi raquo immunitaires ne peuvpreacuteciseacutement pas ecirctre consideacutereacutes comme des enseexclusifs tout ce qui nrsquoappartient pas agrave lrsquoun apptenant neacutecessairement agrave lrsquoautre Degraves lors on porejeter lrsquoideacutee selon laquelle lrsquoopposition entre le laquo soet le laquo non-soi raquo est drsquoordrerelatif (seul sens retenapregraves lrsquoexamen conceptuel) et donc affirmer queterme mecircme de laquo non-soi raquo immunitaire est deacutenueacutefondement
5 Rejet expeacuterimental du modegravele du soi et dunon-soi
Les deux propositions fondamentales du modegravele dsoi et du non-soi sont (a) laquo le systegraveme immunitairedeacuteclenche pas de reacuteaction contre le soi raquo et (b)systegraveme immunitaire deacuteclenche une reacuteaction contrnon-soi raquo Or toute une seacuterie de donneacutees expeacuterimtales prouvent que ces deux propositions fondamtales sont erroneacutees Commenccedilons par mettre endence lrsquoinexactitude de la premiegravere proposition
51 Inexactitude de la proposition laquo le systegravemeimmunitaire ne deacuteclenche pas de reacuteaction contre s
511 Seacutelection thymique la neacutecessaireautoreacuteactiviteacute non-pathologique et la notion delaquo fenecirctre de reacuteactiviteacute raquo
La seacutelection thymique se situe au cœur de lrsquoarmentation en faveur du modegravele du soi Pour leslules T seul importe le laquo soi peptidique raquo crsquoest-agrave-dlrsquoensemble des peptides seacutelectionneacutes et preacutesenteacuteles moleacutecules du complexe majeur drsquohistocompatliteacute [14] Or les lymphocytes ne sont que lrsquoun dacteurs de lrsquoimmuniteacute Degraves lors est-on certain quemodegravele du soi et du non-soi vaut au-delagrave du caslymphocytes pour tous les acteurs de lrsquoimmuniteacute
s
r
mecircme qursquoil convient pour comprendre la seacutelection tmique en tant que telle Les cellulesnatural killers(NK) par exemple nrsquoont pas de reacutecepteurs speacutecifiqdrsquoun antigegravene preacutecis elles nrsquoont pas subi le procesde seacutelection par geacuteneacuteration de diversiteacute caracteacuteristdes lymphocytes et pourtant elles assurent parfment des fonctions immunitaires indispensables agrave lganisme sans deacuteclencher de reacuteaction contre lui[15]Peut-ecirctre avons-nous eu jusqursquoagrave preacutesent une intetation abusive de la seacutelection lymphocytaire en parde laquo soi raquo et de laquo non-soi raquo alors qursquoavancer une excation en termes drsquointeacutegration de signaux activateuret inhibiteurs permettrait de ne pas opposer celluNK et lymphocytes B et T Lrsquoideacutee selon laquelleseacutelection lymphocytaire assurerait la suppressiontoute autoreacuteactiviteacute est erroneacutee non seulement pqursquoenviron 4 agrave 6 des lymphocytes fortement aureacuteactifs eacutechappent agrave lrsquoeacutelimination dans le thymus maussi et surtout parce que seuls les lymphocytesfaible-ment autoreacuteactifssont seacutelectionneacutes Contrairemence qursquoavance le modegravele du soi et du non-soi et mecircen conservant sa propre terminologie un lymphocpour ecirctre seacutelectionneacute doit non pas ne pas reacuteaglaquo soi raquo mais reacuteagir faiblement au laquo soi raquo Lrsquoenjeudonc la deacutefinition drsquounefenecirctre de reacuteactiviteacute La seacute-lection des lymphocytes pose en effet un problegravedeacutecisif comment dans le thymus lrsquointeraction enun reacutecepteur de lymphocyte T et un complexe pep+ moleacutecule du CMH peut-elle conduire agrave la matution des thymocytes durant la seacutelection positive ela mort cellulaire durant la seacutelection neacutegative Laponse tient sans doute en ceci lrsquoaffiniteacuteet lrsquointensiteacutedes signaux doivent ecirctre diffeacuterentes dans le cas dseacutelection neacutegative et dans le cas de la seacutelectionsitive [16] Par conseacutequent non seulement onpeutramener les notions de laquo soi raquo et de laquo non-soi raquo agravedonneacutees plus claires relatives agrave dessignauxactivateursou inhibiteurs (possibiliteacute largement suggeacutereacutee parcellules NK) mais mecircme ondoit le faire sans quolrsquoon ne pourrait pas comprendre que la seacutelectiongative ne vienne pas tout simplement annuler la seacutetion positive en deacutetruisant toutes les cellules T Dlrsquoideacutee de laquo fenecirctre de reacuteactiviteacute raquo une reacuteactionfaibleinduit la seacutelectionpositive (survie) alors qursquoune reacuteaction forte a pour conseacutequence la seacutelectionneacutegative(mort par apoptose)
T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492 487
onsom-our
des
ourin-rieneacute-eti seme
cep-
in-nteacute
ivegitel-
n-ionresrsquoenunhescel-
antqueageleacuteeor-
nce
yan
dece
ulesim-
raitsoi
ndreca-t lesialeest
tretionu-
tielsrsdes
o-ans
a-le deires lend
ndeon-r du-ouveuneagrave
i-a-ventsoi
ur la
par
512 Lrsquoautoreacuteactiviteacute des lymphocytes dans lesystegraveme peacuteripheacuterique
Reacutecemment il a eacuteteacute montreacute que les interactientre les reacutecepteurs des lymphocytes T et les cplexes CMH + peptide sont aussi fondamentales ple maintiendes cellules T dans les organes lymphoiumlpeacuteripheacuteriques que pour leurseacutelectiondans le thy-mus[17] Loin donc drsquoecirctre seulement essentielles pla seacutelection initiale des lymphocytes T seules cesteractions peuvent garantir leur survie agrave la peacuteripheacuteLe maintien des cellules T naiumlves agrave la peacuteripheacuteriecessite un contactcontinu entre leurs reacutecepteursles complexes CMHndashpeptide Ces interactions quproduisent dans le systegraveme peacuteripheacuterique tout comcelles qui ont lieu dans le thymus engagent les reacuteteurs T et des constituantsendogegravenes(du laquo soi raquo) ilnrsquoy a rien drsquoexogegravene dans la moleacutecule du CMH de lrsquodividu et dans ses propres peptides qui sont preacuteseagrave la surface des cellules de lrsquoorganisme En deacutefinitun lymphocyte T ne se maintient en vie que srsquoil reacuteacontinucircment au laquo soi raquo Ainsi non seulement les clules lymphocytairespeuventreacuteagir au laquo soi raquo mais eoutre elles ne peuvent survivreqursquoenreacuteagissant continucircment au laquosoi raquo Lrsquoautoreacuteactiviteacute est une conditsine qua non de la survie des cellules immunitaiet donc elle se situe au cœur de lrsquoimmuniteacute loin dconstituer comme on lrsquoa cru pendant longtempsessentiel dysfonctionnement Agrave ce titre les rechercreacutecentes sur la genegravese et le fonctionnement deslules T reacutegulatrices (TReg) CD4+CD25+ qui inhibentlrsquoactiviteacute des autres cellules immunitaires permettde mettre fin agrave une reacuteponse immune et drsquoeacuteviterles tissus de lrsquoorganisme ne subissent des dommconseacutecutifs agrave une reacuteponse inflammatoire incontrocircsont venues confirmer les ideacutees drsquoautoreacuteactiviteacute nmale (non pathologique) et de maintien de la toleacuterapeacuteripheacuterique En effet drsquoune part les cellules TReg re-quiegraverent pour ecirctre seacutelectionneacutees un reacutecepteur T aune forte affiniteacute pour un peptide du laquo soi raquo[18] etdrsquoautre part on constate que des souris priveacuteescellules TReg meurent de maladies auto-immunesqui indique que la geacuteneacuteration systeacutematique de cellTReg est indispensable pour maintenir la toleacuterancemunitaire agrave la peacuteripheacuterie[19]
513 Les maladies auto-immunesLrsquoexistence de maladies auto-immunes ne sau
ecirctre en soi un argument contre le modegravele du
s
s
t
puisque celui-ci a preacuteciseacutement eacuteteacute eacutelaboreacute pour recompte de la possibiliteacute et indissociablement duractegravere exceptionnel de telles maladies Cependanmaladies auto-immunes montrent la faiblesse initde la formulation du modegravele degraves le deacutepart il srsquodonneacute pour objectif de deacutemontrer larareteacuteextrecircme delrsquoauto-immuniteacute et non sonimpossibiliteacute admettant lapossibiliteacute des reacuteactions immunitaires dirigeacutees conle laquo soi raquo mais la consideacuterant comme une exceppathologique Or comme nous lrsquoavons souligneacute lrsquoatoreacuteactiviteacute est en fait lrsquoun des fondements essendrsquoun fonctionnement normal de lrsquoimmuniteacute Degraves lonous pouvons dire que lrsquoargument de lrsquoexistencemaladies auto-immunes peut servir de critique du mdegravele du soi et du non-soi agrave condition drsquoecirctre inclus dune reacuteflexion drsquoensemble sur lrsquoautoreacuteactiviteacute Les mladies auto-immunes ne sont pas en rupture radicaprincipe avec lrsquoimmuniteacute normale mais au contraelles sont un dysfonctionnement qui se situe danprolongement de lrsquoimmuniteacute normale (on comprealors lrsquoautoreacuteactiviteacute commesurveillanceet non pluscommeagression)
52 Inexactitude de la proposition laquo le systegravemeimmunitaire deacuteclenche une reacuteaction contre lenon-soi raquo
Pour comprendre agrave preacutesent pourquoi la secoproposition fondamentale du modegravele du soi et du nsoi doit ecirctre remise en cause nous devons particoncept-cleacute detoleacuterance immunitaire La toleacuterance deacutesigne un eacutetat dans lequel un eacuteleacutement exogegravene se trdans un organisme sans pour autant deacuteclencherreacuteaction immunitaire Il srsquoagit donc de laquo non-soi raquolrsquoorigine drsquoune acceptation par le systegraveme immuntaire ce qui va agrave lrsquoencontre de la proposition fondmentale eacutenonceacutee ci-dessus Trois eacuteleacutements prouainsi que la deuxiegraveme proposition du modegravele duest erroneacutee
521 La toleacuterance drsquoagents exogegravenespotentiellement pathogegravenes
Crsquoest le cas par exemple des bacteacuteries situeacutees speau ou dans lrsquointestin
522 La toleacuterance des greffesDans certaines conditions non-pathologiques
exemple la toleacuterance fœto-maternelle on constate
488 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
defreacute-parmi-duegravere
o-er-eacuteeor-reacutesest
tersquoun
deent
cinqnies
elulesdesos-iteacuteel-ansles
les
onsle
on-nc
ee laegravelece
desouson-ent
tiono-ns
eeys-
unecetortelesdeacute-t duseuoi
llo-lle
laec le
im-rsquoilsns
estrsquoestreacute-il y
e il
n-antale)
im-
eser
du
une absence de rejet de greffe[20] Le modegravele dusoi et du non-soi ainsi nrsquoest pas en mesurerendre compte du cas de greffe agrave la fois le plusquent et le plus important celui du fœtus porteacutela megravere Le fœtus en effet est une greffe seallogeacutenique qui est toleacutereacutee bien que la moitieacutepatrimoine geacuteneacutetique de lrsquoenfant soit issue du pet donc soit eacutetrangegravere agrave la megravere En outre le mdegravele du soi est incapable drsquoexpliquer pourquoi ctains organes ndash dits laquo immunoprivileacutegieacutes raquo (la cornpar exemple) ndash sont toleacutereacutes ni pourquoi drsquoautresganes comme le foie sont drsquoautant mieux toleacuteque la diffeacuterence HLA entre donneur et receveurforte
523 Le chimeacuterismeLe chimeacuterisme deacutesigne le fait qursquoun individu por
en lui en faibles quantiteacutes des cellules issues dautre individu Le cas le plus significatif est celuila femme enceinte des cellules du fœtus peuvecirctre deacutetecteacutees chez la megravere au bout drsquoagrave peinesemaines de gestation et jusqursquoagrave plusieurs deacutecenapregraves lrsquoaccouchement[21] Le chimeacuterisme deacutesigneacutegalement le cas des enfants qui portent des celde leur megravere et le cas drsquoun faux jumeau portantcellules de son fregravere Le chimeacuterisme prouve la psibiliteacute drsquoun laquo partage raquo du laquo soi raquo voire la possibilpour le laquo non-soi raquo drsquoecirctre constitutif du laquo soi raquo Les clules chimeacuteriques au lieu de rester laquo endormies raquo dlrsquoorganisme peuvent mecircme se diffeacuterencier en cellutumorales[22] voire peut-ecirctrefonctionnelles(deve-nant par exemple des cellules du foie des cellude la peau etc)
De lrsquoensemble de ces observations nous pouvconclure ceci contrairement agrave ce que postulemodegravele du laquo soi raquo les cateacutegories drsquoimmunogegraveneetdrsquoexogegravenene sont pas confondues Degraves lors le laquo nsoi raquo nrsquoest pas le compleacutement du laquo soi raquo et dolrsquoopposition dans le terme laquonon-soi raquo est deacutenueacutede sens Crsquoest par conseacutequent lrsquoensemble ddialectique du soi et du non-soi au cœur du modinitieacute par Burnet qui srsquoavegravere inadeacutequate puisquemodegravele eacutechoue agrave deacutefinir la limitation de chacundeux concepts Si ce raisonnement est exact npouvons en deacuteduire que le modegravele du soi et du nsoi est impropre agrave rendre compte du fonctionnemde lrsquoimmuniteacute
6 Pour un autre modegravele theacuteorique enimmunologie la continuiteacute spatio-temporelle
Nous tentons ici de proposer une autre orientatheacuteorique ndash imparfaite et provisoire ndash pour lrsquoimmunlogie Le critegravere drsquoimmunogeacuteniciteacute que nous mettoen avant est celui de lacontinuiteacute spatio-temporellequi srsquoappuie sur la deacutefinition de lrsquoimmuniteacute commsystegravemeeneacutequilibre La proposition fondamentale dlrsquohypothegravese de la continuiteacute est la suivante le stegraveme immunitaire reacuteagit agrave ce quirompt la continuiteacuteentre les reacutecepteurs des acteurs de lrsquoimmuniteacute drsquopart et les motifs antigeacuteniques drsquoautre part (queantigegravene soit endogegravene ou exogegravene) Seule impautrement dit la continuiteacute spatio-temporelle entrecomposants immunitaires et leurs cibles le critegravereterminant nrsquoeacutetant pas de savoir si ces cibles sonlaquo soi raquo ou du laquo non-soi raquo Ainsi selon cette hypothegravele systegraveme immunitaire ne reacuteagit pas agrave ce avec qil est en contact continu(et agrave partir de quoi il a eacuteteacuteseacutelectionneacute) alors qursquoil reacuteagit agrave ce qui vientbriserla continuiteacute(un motif antigeacutenique jamais rencontreacutebacteacuterie virus organe comme dans le cas drsquoune agreffe etc) et donc la distinction pertinente est ceentrecontinuiteacuteet rupture de continuiteacute et non la dis-tinction entre laquo soi raquo et laquo non-soi raquo Ce critegravere decontinuiteacute demande agrave ecirctre penseacute en correacutelation avconcept deressemblance Il srsquoagit drsquoune continuiteacute agrave lafois spatiale et temporelle tant que les reacutecepteursmunitaires continuent de reacuteagir aussi faiblement qulrsquoont fait jusqursquoici avec les antigegravenes preacutesents dalrsquoorganisme aucune reacuteaction immunitaire forte nrsquodeacuteclencheacutee Ce qui provoque une reacuteaction forte cla nouveauteacute crsquoest-agrave-dire le laquo jamais vu raquo pour lescepteurs de lrsquoimmuniteacute et crsquoest dans ce cas-lagrave qursquoa rupture de continuiteacute
Le point de deacutepart de cette hypothegravese est doublrepose sur lrsquoideacutee decommencementde lrsquoimmuniteacute etsur lrsquoideacutee drsquoautoreacuteactiviteacutecomme auto-reconnaissace Premiegraverement il existe initialement (soit pendla peacuteriode fœtale soit pendant la peacuteriode post-natpour chaque organisme une peacuteriode de toleacuterancemunitaire ce qui indique que lrsquoimmuniteacute a uncom-mencement Ce qui estpreacutesentau moment de cettseacutelection fondatricene deacuteclenchera pas de reacuteponimmune Deuxiegravemement lrsquoautoreacuteactiviteacute est au cœude lrsquoimmuniteacute normale le bon fonctionnementsystegraveme immunitaire repose sur uneseacutelection conti-
T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492 489
tre
er-niteacute
st-on-nir
eacuteestionnqtion
f-
tionles
el-s leca-lulesdeo-
rsquoilsme
ssimeeacute-
ap-
on
iiso-onc-resla
gu--rup-fsxo-(parle
agrave
onc-el-ncecel-turereacute-ent
medegraves
esdi-sonoi raquoeacuteesle
nti-
anti-ro-
ma-nti-aceinslaiteacuteionour
uelseauffet duam-eanse
tion
nue puisque pour survivre un lymphocyte doit ecircreacuteguliegraverementstimuleacute par des antigegravenesendogegravenes(a priori non pathogegravenes) Lrsquoorganisme doit en pmanence assurer pour lui-mecircme une auto-immucontenue et continue
En quoi un modegravele insistant sur la continuiteacute eil plus satisfaisant que le modegravele du soi et du nsoi Lagrave ougrave le modegravele du soi est contraint de deacutefide multiplesexceptions lrsquohypothegravese de la continuitse veut unificatrice capable de rassembler toutles observations connues sous une mecircme explicaNous consideacuterons ainsi qursquoil y a pour lrsquoessentiel cidomaines qui montrent la supeacuterioriteacute drsquoune concepde ce type
(1) Lrsquoauto-immuniteacute Lrsquohypothegravese de la continuiteacute afirme qursquoil nrsquoy a pas de diffeacuterence deprincipeentre une reacuteaction auto-immune et une reacuteacimmunitaire visant un antigegravene exogegravene dansdeux cas il se produit unerupture de continuiteacutelieacutee agrave une modification de ce avec quoi les clules immunitaires se trouvent en contact Dancas des maladies auto-immunes il y a modifition des peptides preacutesenteacutes agrave la surface des celde lrsquoorganisme ce qui aboutit agrave une rupturecontinuiteacute alors mecircme que les peptides ainsi mdifieacutes restent du laquo soi raquo preacuteciseacutement parce qusont issus du mateacuteriel geacuteneacutetique de lrsquoorganisconsideacutereacute
(2) Les cancers Les cellules canceacutereuses elles ausont issues du mateacuteriel geacuteneacutetique de lrsquoorganiset donc sont du laquo soi raquo mais les motifs antigniques agrave leur surface brisent la continuiteacute par rport agrave des tissus sains
(3) Le prolongement entre immuniteacute et reacutegulatidrsquoensemble de lrsquoorganismeContrairement agrave ceque lrsquoimmunologie contemporaine a fait jusqursquoiclrsquohypothegravese de la continuiteacute permet de ne pasler dans lrsquoorganisme les agents assurant des ftions dedeacutefense des agents responsables drsquoautfonctions Lrsquoimmuniteacute est selon lrsquohypothegravese decontinuiteacute seulement lrsquoune des activiteacutes de reacutelation de lrsquoorganisme Ainsi lrsquoactiviteacute drsquoun macrophage par exemple est deacutetermineacutee par lature de continuiteacute entre ses reacutecepteurs et les motiavec lesquels il reacuteagit que ceux-ci soient egegravenes (bacteacuterie par exemple) ou endogegravenesexemple dans le cas drsquoune cellule morte que
macrophage doit ingeacuterer) donc il nrsquoy a pasenvisager pour le macrophagedeux tacircches dis-tinctes comme le fait le modegravele du soi (fonctidrsquolaquoeacuteboueur raquo de lrsquoorganisme drsquoune part fontion immune drsquoautre part) De mecircme les clules TReg ne sont pas stimuleacutees par la preacutesede laquo non-soi raquo puisqursquoelles reacuteagissent agrave deslules immunitaires endogegravenes mais par la rupde continuiteacute exprimeacutee preacuteciseacutement par lescepteurs des cellules immunitaires qui constituleur cible
(4) Les cas de toleacuterance immunitaire La continuiteacuterend compte de lrsquoeacutetat drsquoeacutequilibre qui srsquoeacutetablitentre lrsquoindividu et des agents pathogegravenes comles bacteacuteries sur la peau On constate queqursquoapparaicirct un deacuteficit immunitaire ces bacteacuteriqui jusque-lagrave eacutetaient sans effet neacutegatif sur lrsquoinvidu concerneacute provoquent des dommages agraveencontre Le critegravere nrsquoest donc pas celui du laquo set du laquo non-soi raquo puisque les bacteacuteries concernsont tout autant du laquo non-soi raquo avant qursquoapregravesdeacuteficit immunitaire mais bien larupture de conti-nuiteacutedans les interactions reacutecepteurs-motifs ageacuteniques
(5) Les meacutecanismes drsquoinduction drsquoune toleacuterance Mecirc-me dans le systegraveme immunitairemature on cons-tate parfois une absence de reacuteaction agrave desgegravenes avec lesquels lrsquoindividu est en contact plongeacute Il est difficile de deacuteterminer lescritegraveresdecette induction de toleacuterance puisque dans lajoriteacute des cas apregraves le premier contact avec lrsquoagegravene une reacuteponse immunitaire rapide et efficse deacuteclenche au deuxiegraveme contact Neacuteanmoil existe plusieurs meacutecanismes drsquoinduction detoleacuterance dont seule lrsquohypothegravese de la continusemble pouvoir rendre compte deacutesensibilisatdans le cas des allergies toleacuterance provisoire pcertains antigegravenes du pegravere apregraves la grossesse[21]toleacuterance pour certains pathogegravenes avec lesqon est en contact prolongeacute (bacteacuteries de la pde lrsquointestin) toleacuterance plus probable drsquoune gredrsquoorgane apregraves transfusion sanguine provenanmecircme donneur drsquoorgane etc Cela permet notment drsquoarticuler lacontinuiteacute avec les eacutetats dsymbiose les nombreuses bacteacuteries situeacutees dnotre intestin facilitent la digestion et de mecircmles bacteacuteries sur notre peau assurent lrsquoeacutelimina
490 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
se-
aisreacute-ffeonthy-nceire
quemeso-
vantttreonttiondit
euxaisionen-
sursene deques Ellau raquo
a-
eacuteo-en
u-nsheacuteo-tionis-quei-
sesce
ent
s a
queuto-
si-ous
n-Lemes
titeacuteoutge-
lo-
o-eacute
n-eacute-
ionsmet cardonc
en-iteacutehegravesesde-
up-sub-vec
y-tre-com-
drsquoautres pathogegravenes qui pour leur part cauraient des dommages agrave lrsquoorganisme
Une autogreffe ou une greffe entre jumeaux vrbien qursquoelles semblent rompre la continuiteacute entrecepteurs et motifs antigeacuteniques puisque lrsquoon grepar exemple un tissu agrave la place drsquoun autre tissu stoleacutereacutees ce qui paraicirct constituer une objection agrave lrsquopothegravese de la continuiteacute Cependant cette toleacuterasrsquoexplique par le fait que pour le systegraveme immunitareceveur il nrsquoy a pas de rupture de continuiteacute puisles reacuteactions reacutecepteursndashantigegravenes restent les mecirceacutetant donneacute qursquoil nrsquoy a aucune diffeacuterence dans les mtifs antigeacuteniques et donc dans les signaux eacutemis aet apregraves la greffe De faccedilon similaire on peut eacutemelrsquohypothegravese que ce qui fait que certaines greffes smieux toleacutereacutees que drsquoautres ce nrsquoest pas la distincsoinon-soi (conformeacutement agrave ce que nous avonscertains organes comme le foie sont drsquoautant mitoleacutereacutes qursquoils sont diffeacuterents de lrsquoorgane hocircte) mla plus grande continuiteacute dans lrsquoactiviteacute de stimulatdes agents immunitaires Ce qui importe crsquoest bientendu la continuiteacutepour les cellules immunitaires etnon la continuiteacutepour nous
Les avantages de lrsquohypothegravese de la continuiteacutele modegravele du soi tels que nous venons de les preacuteter nous permettent de preacuteciser quelle est la placcette hypothegravese au sein des theacuteories immunologiproposeacutees au cours des trente derniegraveres anneacuteessrsquoappuie incontestablement sur la theacuteorie du laquo reacuteseimmunitaire apparue chez Jerne[23] puis deacuteveloppeacuteesous la forme de la reacutegulation de lrsquoauto-immuniteacute nturelle ouimmunological homunculus[24] ainsi quesous le terme controverseacute drsquoautopoiesis[25] Lrsquohy-pothegravese de la continuiteacute a en commun avec les thries du reacuteseau lrsquoideacutee qursquoune reacuteaction immune estfait uneperturbation du systegraveme[26] crsquoest-agrave-dire unemodification du comportement que le systegraveme immnitaire a eu jusqursquoici (laquo rupture de continuiteacute raquo dale cadre de notre hypothegravese) Cependant les tries du reacuteseau immunitaire proposent une concepclosede lrsquoimmuniteacute selon ses promoteurs si la dtinction soinon-soi est insatisfaisante crsquoest parcele systegraveme immunitaire nrsquoa jamais affaire qursquoagrave lumecircme[24] Agrave lrsquoopposeacute lrsquohypothegravese de la continuiteacutedonne pour objectif drsquoouvrir le systegraveme comme noulrsquoavons vu avec les cas drsquoinduction drsquoune toleacuteranimmunitaire Lrsquohypothegravese de la continuiteacute autrem
-
e
dit srsquoefforce de comprendre comment des entiteacutepriori distinctes de lrsquoorganisme peuventsrsquointeacutegrer agravelui (processus drsquoouverture et de toleacuterance) alorsles theacuteories du reacuteseau insistent sur la clocircture et lrsquoadeacutefinition de lrsquoimmuniteacute
7 Identiteacute immunitaire et identiteacute philosophique
Lrsquohypothegravese de la continuiteacute nous eacuteloigne condeacuterablement du modegravele du soi mais elle ne neacuteloigne pas pour autant de la question de lrsquoidentiteacuteNotre conviction est qursquoil est possible de penser lrsquoidetiteacute biologique sans la deacutefinir comme un laquo soi raquoconcept philosophique drsquoidentiteacute repose sur les terlatins idem (fait drsquoecirctre identique agrave soi ideacutee deper-manencedans le temps) etipse (fait de demeurer lemecircme tout en changeant partiellement il y aeacutevolu-tion dans le temps) drsquoun cocircteacute nous avons lrsquoidenimmuable dans le temps et de lrsquoautre lrsquoideacutee que tecirctre reste le mecircme tout en accueillant en lui le chanment Cette distinction rejoint la probleacutematique phisophique de lasubstance la substance est uninvariantsusceptible drsquoecirctre pour chaque individu lesupportdetoutes lesvariations[27] Deux grandes thegraveses philsophiques srsquoaffrontent sur la question de lrsquoidentitla premiegravere deacutefinit lrsquoidentiteacute par lasubstance tandisque la seconde deacutefinit lrsquoidentiteacute par lacontinuiteacute Se-lon la premiegravere thegravese ce qui fait lrsquoidentiteacute drsquoun idividu crsquoest la substance crsquoest-agrave-dire le support mtaphysique de toutes ses deacuteterminations et variatSelon la deuxiegraveme thegravese agrave lrsquoopposeacute rien ne perde preacutesupposer qursquoil existe une telle laquo substance raquocette substance est par deacutefinition inaccessible etlrsquoidentiteacute repose seulement sur lacontinuiteacutedans letemps continuiteacute des changements physiques oucore concernant lrsquoidentiteacute psychologique continudes eacutetats de conscience Le deacutebat entre ces deux tphilosophiques pourrait ecirctre illustreacute par les figuresLocke[28] et de Leibniz[29] La conception substantialiste de lrsquoidentiteacute consiste agravesupposerplus que laconception fondeacutee sur la continuiteacute (ce que lrsquoon spose en plus crsquoest preacuteciseacutement un laquo noyau raquo destantialiteacute) Or on peut agrave bon droit ecirctre drsquoaccord ale soupccedilon de Locke renforceacute par Hume[30] puisquela substanceest en elle-mecircme un noyau meacutetaphsique inatteignable pourquoi la preacutesupposer Aument dit si on peut se passer de la substance pour
T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492 491
eacute--parsesutuisuesyer
degraveler il
unuedu
-
-rerionpar
deplecele
voirneors
etezper-du
po-quiiegrave-net re-s aus
euxvec
gielleenrsquoest
soiqueeacute
en-me
en-pasni-reacute-isnti-rsn-r en-
os--
que)s
pourpreacute-me
ienge
c-
nse-
ow2)
elf12
prendre lrsquoidentiteacute pourquoi y ferait-on appel La dmarche de Locke relegraveve alors de ladeacuteflation meacutetaphysique si un mecircme pheacutenomegravene peut ecirctre expliqueacutedeux modegraveles dont lrsquoun repose sur moins drsquohypothegraveque lrsquoautre alors crsquoest le modegravele minimal qursquoil vamieux adopter Lrsquoimmunologie est au moins deples anneacutees 1940 peacutetrie de concepts philosophiqNotre rocircle devrait ecirctre dans ces conditions drsquoessadrsquoaccorder agrave ces concepts leur juste place Le modu soi se situe du cocircteacute de lrsquoidentiteacute-substance catente de deacutefinir lrsquoidentiteacute de lrsquoorganisme commenoyau substantiel dont lrsquointeacutegriteacute doit ecirctre deacutefendtandis que lrsquohypothegravese de la continuiteacute se rangecocircteacute de lrsquoidentiteacute-continuiteacute Lrsquohypothegravese de la continuiteacute par conseacutequent constitue une propositionphi-losophiquepour limiter lrsquousage des concepts philosophiques en immunologie elle srsquoefforce de reacuteiteacutedans le domaine propre de lrsquoimmunologie la deacuteflatmeacutetaphysique que lrsquoidentiteacute-continuiteacute repreacutesenterapport agrave lrsquoidentiteacute-substance
Une question cependant surgit ici lrsquohypothegravesela continuiteacute nrsquoest-elle pas finalement qursquoune simreformulation du modegravele du soi Ne dit-elle pasque les immunologistes ont toujours dit Nous nepensons pas Rien bien entendu nrsquoempecircche delrsquohypothegravese de la continuiteacute simplement comme uconception renouveleacutee du laquo soi raquo On affirmerait alseulement qursquoil srsquoagit dans ce cas dusoi compriscomme continuiteacute (comme chez Locke ou Hume)non dusoi compris comme substance (comme chLeibniz) Cette suggestion est seacuteduisante car ellemettrait une fois encore de laquo sauver raquo le modegravelesoi et du non-soi Neacuteanmoins premiegraverement lrsquohythegravese de la continuiteacute explique des pheacutenomegraveneseacutetaient mal expliqueacutes par le modegravele du soi Deuxmement et surtout faire de lrsquoidentiteacute-continuiteacute uconception renouveleacutee du laquo soi raquo serait preacuteciseacutementomber dans lrsquoerreur qui consiste en ayant recourterme trop large desoi agrave recouvrir deux significationbien distinctes lasubstanceet lacontinuiteacute Parler delaquo soi raquo crsquoest se condamner agrave ne pas distinguer les dsens agrave passer de lrsquoun agrave lrsquoautre sans justification ale risque de tout laquo substantialiser raquo en immunoloOn pourrait donc accepter lrsquoobjection selon laquece que lrsquoon propose nrsquoest qursquoune redeacutefinition du soiimmunologie mais ce que lrsquoon ne peut accepter clrsquoideacutee que le terme desoi doit ecirctre conserveacute
8 Conclusion philosophie de lrsquoidentiteacutebiologique
Quelles questions pose lrsquoanalyse du modegravele duet du non-soi pour une compreacutehension philosophide la deacutefinition biologique de lrsquoidentiteacute Lrsquoidentitbiologique pour tout ecirctre vivant deacutesignece qursquoil estbiologiquement crsquoest-agrave-dire son uniciteacute et sa diffeacuterciation spatiale Nous avons montreacute que le systegraveimmunitaire constituait bien une sorte de carte drsquoidtiteacute de lrsquoorganisme mais que cette identiteacute nrsquoeacutetaitclose agrave toute influence exteacuterieure lrsquoidentiteacute immutaire nrsquoest pas deacutefinie agrave partir drsquoun ensemble deactions de deacutefense agrave toutesles entiteacutes exogegravenes made maniegravere continuiste crsquoest-agrave-dire comme la conuiteacute spatio-temporelle des reacuteactions entre reacutecepteude lrsquoimmuniteacute et motifs antigeacuteniques (qursquoils soient edogegravenes ou exogegravenes) Degraves lors peut se dessineparticulier agrave partir de lrsquoideacutee drsquoinduction de la toleacuterance immunitaire une reacuteflexion eacutelargie sur la psibiliteacute de deacutefinir lrsquoidentiteacute biologique (agrave la fois pheacutenotypique et en amont geacuteneacutetique ou para-geacuteneacuteticomme une identiteacuteouverte articulant agrave la fois deeacuteleacutements endogegravenes et des eacuteleacutements exogegravenesdeacuteterminer en derniegravere instance le propre toujourscaire et toujours combineacute (laquo impur raquo) drsquoun organisvivant donneacute
Remerciements
Nous remercions pour leur aide et leur soutAnouk Barberousse Claude Debru Michel MoranJean Gayon Ceacutedric Brun et Hannah-Louise Clark
Reacutefeacuterences
[1] FM Burnet F Fenner The Production of Antibodies Mamillan Melbourne 1941 2e eacutedition en 1949
[2] MS Anderson ES Venanzi L Klein Z Chen SP BerziSJ Turley H von Boehmer R Bronson A Dierich C Bnoist D Mathis Projection of an Immunological Self ShadWithin the Thymus by the Aire Protein Science 298 (2001395ndash1401
[3] RE Langman M Cohn A minimal model for the self-nonsdiscrimination a return to the basics Semin Immunol(2000) 189ndash195
492 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
self
uil
ty
ofd
de
-
aelf
rrs
ha8
Ho-nlf-
f6
-G
odSci
itet
em
ical
ei-
u-
[4] P Matzinger The danger model a renewed sense ofScience 296 (2002) 301ndash305
[5] J Bernard M Bessis C Debru (dir) Soi et non-soi SeParis 1990
[6] FM Burnet Changing Patterns An Atypical AutobiographyHeinemann Melbourne 1968
[7] M Morange La part des gegravenes Odile Jacob Paris 1998[8] FM Burnet The Integrity of the Body Harvard Universi
Press Cambridge 1962[9] AI Tauber L Chernyak Metchnikoff and the Origins
Immunology Oxford University Press New York Oxfor1991
[10] A-M Moulin Le dernier langage de la meacutedecine ndash histoirelrsquoimmunologie de Pasteur au Sida PUF Paris 1991
[11] AI Tauber The Immune Self Theory or metaphor Cambridge University Press Cambridge 1994
[12] Aristote Cateacutegories Vrin Paris 1994 chapitres 10 et 11[13] Aristote Cateacutegories chapitre 5 3b22ndash33[14] P Kourilsky J-M Claverie The peptidic self model
hypothesis on the molecular nature of the immunological sAnn Immunol 137 (1986) 3ndash21
[15] DH Raulet RE VanceCW McMahon Regulation of thenatural killer cell receptor repertoire Annu Rev Immunol 19(2001) 291ndash330
[16] PG Ashton-Rickardt A Bandeira JR Delaney L Van KaeHP Pircher RM Zinkernagel S Tonegawa Evidence foa differential avidity model of T-cell selection in the thymuCell 76 (1994) 651ndash663
[17] C Tanchot B Lemonnier A Perarnau A Freitas B RocDifferential requirements for survival and proliferation of CDnaive or memory T cells Science 276 (1997) 2057ndash2062
[18] MS Jordan A Boesteanu AJ Reed AL Petrone AElenbeck MA Lerman A Naji AJ Caton Thymic selectioof CD4+CD25+ regulatory T cells induced by an agonist sepeptide Nat Immunol 2 (2001) 301ndash306
[19] Z Feheacutervari S Sakaguchi Development and function oCD25+CD4+ regulatory T cells Curr Opin Immunol 1(2004) 203ndash208
[20] ED Carosella N Rouas-Freiss P Paul J Dausset HLAa tolerance molecule from themajor histocompatibility com-plex Immunol Today 20 (1999) 60ndash62
[21] DW Bianchi GK Zickwolf GJ Weil S Sylvester MADeMaria Male fetal progenitor cells persist in maternal blofor as long as 27 years postpartum Proc Natl AcadUSA 93 (1996) 705ndash708
[22] D Cha K Khosrotehrani Y Kim H Stroh DW BianchKL Johnson Cervical cancer and microchimerism ObsGynecol 102 (2003) 774ndash781
[23] NK Jerne Towards a network theory of the immune systAnn Immunol 125 C (1974) 373ndash389
[24] IR Cohen The cognitive paradigm and the immunologhomunculus Immunol Today 13 (1992) 490ndash494
[25] HR Maturna FJ Varela Autopoiesis and cognition D Rdel Dordrecht The Netherlands 1980
[26] AI Tauber Moving beyond the immune self Semin Immnol 12 (2000) 241ndash248
[27] Aristote Cateacutegories chapitre 5[28] J Locke Essai sur lrsquoentendement humain 1690[29] GW Leibniz Nouveaux Essais sur lrsquoentendement humain
1765[30] D Hume Traiteacute de la nature humaine 1739
484 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
nrsquoler-
iveon-itythe
us)anex-theof
an-rsquoileulvo-
te
olo-e
seacutesge) Laeacutevi-
ac-treitrmeern-nereacute-
iffeacute-elle
leeeacute-es
foistrentn-ffeacute-ter-iron-ett duestla-
aceala-
t agrave
tdif-rmeegrave-me
tsite
est
ri-on-enim-s
system as closed and self-defining the continuity hy-pothesis aims atopeningthe system mainly with theidea of induction of tolerance (a supposedly lsquoforeigelement can be integrated into an organism and toated)
Thus immune identity is defined not by defensreactions towards all exogenous entities but in a lsquoctinuistrsquo way that is as the spatio-temporal continuof the reactions between the immune receptors andantigenic sites (whether endogenous or exogenoWe can then conceive of the biological identity asopenidentity that deals with both endogenous andogenous elements in order to determine eventuallycombined (lsquoimpurersquo) and always precarious naturea given organism
1 Introduction
Depuis sa formulation par Burnet agrave partir desneacutees 1940[1] le modegravele du soi et du non-soi ndash qusoit implicitement accepteacute (pour ne citer qursquoun sexemple mais dont le titre est particuliegraverement eacutecateur voir[2]) clairement revendiqueacute[3] ou criti-queacute [4] ndash constitue lrsquoarriegravere-plan theacuteorique de toula production scientifique en immunologie[5] Lrsquouti-lisation des termes meacutetaphysiques desoiet denon-soidans une science expeacuterimentale comme lrsquoimmungie est eacutetonnante drsquoougrave lrsquoideacutee drsquoune eacutevaluation critiqude ce modegravele (nous eacutecrirons les motssoi et non-soien italiques lorsqursquoil srsquoagit des termes ou notionentre guillemets lorsqursquoil srsquoagit des concepts utilispar le modegravele du soi et dont nous critiquons lrsquousaet sans signe particulier dans tous les autres casviseacutee drsquoensemble de notre examen est la mise endence drsquouncritegravere drsquoimmunogeacuteniciteacute crsquoest-agrave-dire ladeacutetermination de ce qui deacuteclenche ou non une reacutetion immunitaire dans un mecircme organisme Agrave ce tilrsquoobjectif de cet article est triple Drsquoabord il srsquoagde comprendre quel est le sens speacutecifique des tesoi et non-soien immunologie Ensuite de montrpourquoi le modegravele immunologique du soi et du nosoi devrait ecirctre revu voire abandonneacute agrave partir drsquoudouble critique conceptuelle et fondeacutee sur dessultats expeacuterimentaux des termessoi et non-soi En-fin nous proposerons une hypothegravese explicative drente mettant en avant la continuiteacute spatio-tempordes reacuteactions entre les reacutecepteurs et les ligands
s
2 Lrsquoeacutequivoque situeacutee au cœur du modegravele du soi etdu non-soi
Agrave titre provisoire nous pouvons consideacuterer queterme desoi biologique est un synonyme du termdrsquoidentiteacutebiologique qui deacutesigne lrsquoensemble des dterminants qui font qursquoun organisme est diffeacuterent dautres organismes Un tel laquo soi raquo deacutesigne agrave lalrsquo uniciteacute de chaque individu (qui est le seul agrave ecirctel qursquoil est agrave lrsquoexception drsquoindividus geacuteneacutetiquemeidentiques) et sadistinction spatiale et environnemetale(mecircme des jumeaux vrais par exemple sont dirents en ce qursquoils occupent des lieux distincts et inagissent de maniegraveres dissemblables avec leur envnement) Or puisque lrsquoimmunologie depuis Burnse deacutefinit elle-mecircme comme la laquo science du soi enon-soi raquo[6] la question se pose de savoir quelle rapport entre lrsquoidentiteacute telle que nous venons dedeacutefinir et lrsquoimmuniteacute Lrsquoimmuniteacute qui deacutesigne eacutetymologiquement une exemption (immunitas) a eacuteteacute deacutefiniecomme la capaciteacute qursquoa un organisme de reacuteagir fagrave des agents pathogegravenes afin drsquoeacutechapper agrave la mdie et donc comme sa reacuteaction dedeacutefensecontre detels agents Lrsquoeacutequivoque du modegravele du laquo soi raquo tience rapprochement implicite entreidentiteacute (uniciteacute etdistinction) etsystegraveme de deacutefensede lrsquoorganisme Eneffet si drsquoune part le termesoi deacutesigne simplemenun organisme et le fait que chaque organisme estfeacuterent des autres alors on ne voit pas en quoi ce terelegraveverait de lrsquoimmunologie (nous verrons qursquoil relverait plutocirct de la geacuteneacutetique) si drsquoautre part le tersoi fait reacutefeacuterence agrave uneinteacutegriteacute de lrsquoindividu qursquoilsrsquoagirait dedeacutefendre de maintenir (contre des agenpathogegravenes) alors il dissimule une confusion implicentre lrsquoexogegraveneet le dangereux puisque lrsquoon postulealors que tout ce qui est exteacuterieur agrave lrsquoorganismesusceptible de lui nuire
3 Soi biologique et soi immunitaire
Le soi biologique est principalementgeacuteneacutetiquemecircme srsquoil nrsquoest pas uniquement geacuteneacutetique[7] Lrsquouni-citeacute de lrsquoindividu repose sur lrsquouniciteacute de son patmoine geacuteneacutetique comprise en relation avec lrsquoenvirnement cellulaire et avec le milieu de lrsquoorganismegeacuteneacuteral et non sur la speacutecificiteacute de ses cellulesmunitaires Les reacutecepteurs immunitaires ainsi que le
T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492 485
liteacuteuesanthro-
es-e
uiteonsrs
untheacute-
im-nitrai-cep
t
e
ourt agrave
enteeacute-
saireire
m-
rendtionaisi denuer
leire
uende
on-mele
m-hi-
ntri-r
sens
clu-uelnousce
non-aunesiga-estsoi raquo
e laon-
rtente le
So-
esseacute-ant
moleacutecules du complexe majeur drsquohistocompatibi(CMH) ne sont qursquoune manifestation pheacutenotypiqdrsquoune diversiteacute fondamentalement geacuteneacutetique reposur la combinatoire de lrsquoheacutereacutediteacute (brassages intercmosomique et intrachromosomique) Lrsquoidentiteacutebiolo-gique de chaque ecirctre vivant autrement dit ladiversiteacutedes organismes y compris au sein drsquoune mecircmepegravece relegraveve prioritairement de lrsquoheacutereacutediteacute qui se situen amont de la speacutecificiteacute immunitaire
Deux raisons cependant expliquent que agrave la sde Burnet les immunologistes aient placeacute les notide soi et denon-soiau cœur de leur discipline alomecircme que rien ne laisse penser a priori que lrsquoimmuniteacuterenvoie agrave lrsquoidentiteacute La premiegravere raison repose surfait clairement eacutetabli lesreacutecepteurs immunitaires eles moleacutecules du CMH appartiennent certes au pnotype mais leur diversiteacute est de tregraves loin la plusportante de lrsquoorganisme agrave tel point qursquoon les deacutefiparfois comme sa laquo carte drsquoidentiteacute raquo La deuxiegravemeson en revanche se fonde sur un glissement contuel implicite et non deacutemontreacute de lrsquoideacutee drsquoidentiteacuteagrave lrsquoideacutee dedeacutefense de lrsquointeacutegriteacuteet enfin agrave lrsquoideacutee delutte contre tout ce qui estexogegravene une fois lrsquoim-muniteacute deacutefinie comme ladeacutefensecontre tout agenpathogegravene son rocircle a eacuteteacute penseacute comme lemaintiendans le tempsde lrsquoidentiteacute de lrsquoorganisme crsquoest-agrave-dirlrsquoabsence drsquoune quelconquemodificationde lrsquoindividupar des entiteacutesexogegravenes(seules les modificationsen-dogegraveneseacutetant consideacutereacutees comme acceptables plrsquoorganisme) Or le modegravele du soi et du non-soi eslrsquoorigine de ce glissement preacutesent de maniegravere eacutevidchez Burnet[8] alors qursquoil est absent chez un prdeacutecesseur de Burnet comme Metchnikoff[9] Un telmaintiende lrsquoidentiteacute qui fait du laquo soi raquo uneforteresseagrave deacutefendre perpeacutetuellement a un point de deacutepart danle temps agrave savoir la fin de la toleacuterance embryonnou immeacutediatement post-natale le laquo soi raquo immunitaestacquis(par la seacutelection des cellules immunocopeacutetentes) et non inneacute[10] Degraves lors que lrsquoon prendconscience de ce glissement conceptuel on compque le laquo soi raquo immunitaire ne reacutepond pas agrave la queslaquo qui suis-je raquo (dans mon uniciteacute drsquoecirctre vivant) mlaquo comment suis-je proteacutegeacute raquo (crsquoest-agrave-dire agrave lrsquoabrquelles entiteacutes eacutetrangegraveres dois-je rester pour contiagrave ecirctremoi-mecircme) et en ce sens ilnrsquoest pasle syno-nyme de lrsquoidentiteacute biologique qursquoil preacutetend ecirctre
Nous voudrions agrave preacutesent montrer pourquoimodegravele du soi et du non-soi doit ecirctre revu vo
-
rejeteacute[11] Nous emprunterons deux voies de critiqla premiegravere philosophique (conceptuelle) la secofondeacutee sur des reacutesultats expeacuterimentaux
4 Rejet philosophique du modegravele du soi et dunon-soi
Lrsquoexamen conceptuel du modegravele du soi et du nsoi conduit agrave la remise en question de la notion mecircde non-soi Le problegraveme est le suivant quel estsens de la neacutegation dans lrsquoexpression laquonon-soi raquo Pour reacutepondre agrave cette question il est utile de coprendre quelles sont les diffeacuterentes significations plosophiques de lrsquoideacutee drsquoopposition Comme le montreAristote[12] on peut en logique distinguer seulemequatre types drsquooppositions (1) la neacutegation (2) la pvation (3) la contrarieacuteteacute (4) lrsquoopposition relative Onous allons prouver agrave preacutesent qursquoaucun de cesne peut srsquoappliquer agrave lrsquoexpression laquonon-soi immuni-taire raquo Pour ce faire nous allons proceacuteder par exsion nous allons montrer par lrsquoexamen conceptque seul le quatriegraveme sens est envisageable puismontrerons par lrsquoexamen expeacuterimental que mecircmequatriegraveme sens est inapplicable
Premiegraverement on ne peut pas comprendre le laquosoi raquo comme lrsquoopposeacuteneacutegatif du laquo soi raquo car dans llogique aristoteacutelicienne la neacutegation consiste agrave nierproposition(ce qui veut dire tregraves simplement ceci la proposition laquo il est assis raquo est vraie alors sa neacutetion agrave savoir la proposition laquo il nrsquoest pas assis raquoneacutecessairement fausse) Or le laquo soi raquo et le laquo non-sont desnotions et non despropositions Deuxiegraveme-ment le laquo non-soi raquo nrsquoest pas laprivation du laquo soi raquoau sens par exemple ougrave la ceacuteciteacute est la privation dvue puisque lrsquoon constate que le laquo soi raquo et le laquo nsoi raquo pour un individu donneacutecoexistent Troisiegraveme-ment lrsquoopposition commecontrarieacuteteacutedoit-elle aussiecirctre rejeteacutee car comme le montre Aristotela sub-stance premiegraverendash qui deacutesigne tel individu particuliele support permanent des changements qui affeccet individu crsquoest-agrave-dire tregraves exactement ce que vislaquo soi raquo ndashnrsquoa pas de contraire[13] En effetrien nrsquoestle contraire de lrsquoindividualiteacute on ne peut pas direpar exemple que Protagoras est le laquo contraire raquo decrate Lrsquoindividu se comprend agrave partir de lrsquoalteacuteriteacute (dautres individus) ndash sans quoi il ne pourrait preacuteciment pas srsquoindividualiser ndash mais il nrsquoa pas pour aut
486 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
le
par-ent
uxs al-ntalent
mblear-urrai raquo
ulede
unelaquo lee leen-en-eacutevi-
oi raquo
gu-cel-ires paibi-es
ledes
et
hy-
uessusiqueaite-rsquoor-
rpreacute-lantpli-sles
lade
arceto-ais
t agraveme
yteir auest
metretidera-t agravereacute-
e lapo-
des
lesineacute-lec-rsquoougrave
-
de contraire Seul reste possible par conseacutequentquatriegraveme sens lrsquooppositionrelative le laquo non-soi raquoest au sens matheacutematique lecompleacutementdu laquo soi raquocar tout eacuteleacutement qui nrsquoappartient pas au laquo soi raquo aptient neacutecessairement au laquo non-soi raquo et reacuteciproquemCependant lrsquoopposition des relatifs doit pouvoir srsquoap-puyer sur un critegravere de distinction clair entre les deensembles compleacutementaires ainsi deacutefinis Or noulons montrer agrave preacutesent gracircce agrave lrsquoexamen expeacuterimeque le laquo soi raquo et le laquo non-soi raquo immunitaires ne peuvpreacuteciseacutement pas ecirctre consideacutereacutes comme des enseexclusifs tout ce qui nrsquoappartient pas agrave lrsquoun apptenant neacutecessairement agrave lrsquoautre Degraves lors on porejeter lrsquoideacutee selon laquelle lrsquoopposition entre le laquo soet le laquo non-soi raquo est drsquoordrerelatif (seul sens retenapregraves lrsquoexamen conceptuel) et donc affirmer queterme mecircme de laquo non-soi raquo immunitaire est deacutenueacutefondement
5 Rejet expeacuterimental du modegravele du soi et dunon-soi
Les deux propositions fondamentales du modegravele dsoi et du non-soi sont (a) laquo le systegraveme immunitairedeacuteclenche pas de reacuteaction contre le soi raquo et (b)systegraveme immunitaire deacuteclenche une reacuteaction contrnon-soi raquo Or toute une seacuterie de donneacutees expeacuterimtales prouvent que ces deux propositions fondamtales sont erroneacutees Commenccedilons par mettre endence lrsquoinexactitude de la premiegravere proposition
51 Inexactitude de la proposition laquo le systegravemeimmunitaire ne deacuteclenche pas de reacuteaction contre s
511 Seacutelection thymique la neacutecessaireautoreacuteactiviteacute non-pathologique et la notion delaquo fenecirctre de reacuteactiviteacute raquo
La seacutelection thymique se situe au cœur de lrsquoarmentation en faveur du modegravele du soi Pour leslules T seul importe le laquo soi peptidique raquo crsquoest-agrave-dlrsquoensemble des peptides seacutelectionneacutes et preacutesenteacuteles moleacutecules du complexe majeur drsquohistocompatliteacute [14] Or les lymphocytes ne sont que lrsquoun dacteurs de lrsquoimmuniteacute Degraves lors est-on certain quemodegravele du soi et du non-soi vaut au-delagrave du caslymphocytes pour tous les acteurs de lrsquoimmuniteacute
s
r
mecircme qursquoil convient pour comprendre la seacutelection tmique en tant que telle Les cellulesnatural killers(NK) par exemple nrsquoont pas de reacutecepteurs speacutecifiqdrsquoun antigegravene preacutecis elles nrsquoont pas subi le procesde seacutelection par geacuteneacuteration de diversiteacute caracteacuteristdes lymphocytes et pourtant elles assurent parfment des fonctions immunitaires indispensables agrave lganisme sans deacuteclencher de reacuteaction contre lui[15]Peut-ecirctre avons-nous eu jusqursquoagrave preacutesent une intetation abusive de la seacutelection lymphocytaire en parde laquo soi raquo et de laquo non-soi raquo alors qursquoavancer une excation en termes drsquointeacutegration de signaux activateuret inhibiteurs permettrait de ne pas opposer celluNK et lymphocytes B et T Lrsquoideacutee selon laquelleseacutelection lymphocytaire assurerait la suppressiontoute autoreacuteactiviteacute est erroneacutee non seulement pqursquoenviron 4 agrave 6 des lymphocytes fortement aureacuteactifs eacutechappent agrave lrsquoeacutelimination dans le thymus maussi et surtout parce que seuls les lymphocytesfaible-ment autoreacuteactifssont seacutelectionneacutes Contrairemence qursquoavance le modegravele du soi et du non-soi et mecircen conservant sa propre terminologie un lymphocpour ecirctre seacutelectionneacute doit non pas ne pas reacuteaglaquo soi raquo mais reacuteagir faiblement au laquo soi raquo Lrsquoenjeudonc la deacutefinition drsquounefenecirctre de reacuteactiviteacute La seacute-lection des lymphocytes pose en effet un problegravedeacutecisif comment dans le thymus lrsquointeraction enun reacutecepteur de lymphocyte T et un complexe pep+ moleacutecule du CMH peut-elle conduire agrave la matution des thymocytes durant la seacutelection positive ela mort cellulaire durant la seacutelection neacutegative Laponse tient sans doute en ceci lrsquoaffiniteacuteet lrsquointensiteacutedes signaux doivent ecirctre diffeacuterentes dans le cas dseacutelection neacutegative et dans le cas de la seacutelectionsitive [16] Par conseacutequent non seulement onpeutramener les notions de laquo soi raquo et de laquo non-soi raquo agravedonneacutees plus claires relatives agrave dessignauxactivateursou inhibiteurs (possibiliteacute largement suggeacutereacutee parcellules NK) mais mecircme ondoit le faire sans quolrsquoon ne pourrait pas comprendre que la seacutelectiongative ne vienne pas tout simplement annuler la seacutetion positive en deacutetruisant toutes les cellules T Dlrsquoideacutee de laquo fenecirctre de reacuteactiviteacute raquo une reacuteactionfaibleinduit la seacutelectionpositive (survie) alors qursquoune reacuteaction forte a pour conseacutequence la seacutelectionneacutegative(mort par apoptose)
T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492 487
onsom-our
des
ourin-rieneacute-eti seme
cep-
in-nteacute
ivegitel-
n-ionresrsquoenunhescel-
antqueageleacuteeor-
nce
yan
dece
ulesim-
raitsoi
ndreca-t lesialeest
tretionu-
tielsrsdes
o-ans
a-le deires lend
ndeon-r du-ouveuneagrave
i-a-ventsoi
ur la
par
512 Lrsquoautoreacuteactiviteacute des lymphocytes dans lesystegraveme peacuteripheacuterique
Reacutecemment il a eacuteteacute montreacute que les interactientre les reacutecepteurs des lymphocytes T et les cplexes CMH + peptide sont aussi fondamentales ple maintiendes cellules T dans les organes lymphoiumlpeacuteripheacuteriques que pour leurseacutelectiondans le thy-mus[17] Loin donc drsquoecirctre seulement essentielles pla seacutelection initiale des lymphocytes T seules cesteractions peuvent garantir leur survie agrave la peacuteripheacuteLe maintien des cellules T naiumlves agrave la peacuteripheacuteriecessite un contactcontinu entre leurs reacutecepteursles complexes CMHndashpeptide Ces interactions quproduisent dans le systegraveme peacuteripheacuterique tout comcelles qui ont lieu dans le thymus engagent les reacuteteurs T et des constituantsendogegravenes(du laquo soi raquo) ilnrsquoy a rien drsquoexogegravene dans la moleacutecule du CMH de lrsquodividu et dans ses propres peptides qui sont preacuteseagrave la surface des cellules de lrsquoorganisme En deacutefinitun lymphocyte T ne se maintient en vie que srsquoil reacuteacontinucircment au laquo soi raquo Ainsi non seulement les clules lymphocytairespeuventreacuteagir au laquo soi raquo mais eoutre elles ne peuvent survivreqursquoenreacuteagissant continucircment au laquosoi raquo Lrsquoautoreacuteactiviteacute est une conditsine qua non de la survie des cellules immunitaiet donc elle se situe au cœur de lrsquoimmuniteacute loin dconstituer comme on lrsquoa cru pendant longtempsessentiel dysfonctionnement Agrave ce titre les rechercreacutecentes sur la genegravese et le fonctionnement deslules T reacutegulatrices (TReg) CD4+CD25+ qui inhibentlrsquoactiviteacute des autres cellules immunitaires permettde mettre fin agrave une reacuteponse immune et drsquoeacuteviterles tissus de lrsquoorganisme ne subissent des dommconseacutecutifs agrave une reacuteponse inflammatoire incontrocircsont venues confirmer les ideacutees drsquoautoreacuteactiviteacute nmale (non pathologique) et de maintien de la toleacuterapeacuteripheacuterique En effet drsquoune part les cellules TReg re-quiegraverent pour ecirctre seacutelectionneacutees un reacutecepteur T aune forte affiniteacute pour un peptide du laquo soi raquo[18] etdrsquoautre part on constate que des souris priveacuteescellules TReg meurent de maladies auto-immunesqui indique que la geacuteneacuteration systeacutematique de cellTReg est indispensable pour maintenir la toleacuterancemunitaire agrave la peacuteripheacuterie[19]
513 Les maladies auto-immunesLrsquoexistence de maladies auto-immunes ne sau
ecirctre en soi un argument contre le modegravele du
s
s
t
puisque celui-ci a preacuteciseacutement eacuteteacute eacutelaboreacute pour recompte de la possibiliteacute et indissociablement duractegravere exceptionnel de telles maladies Cependanmaladies auto-immunes montrent la faiblesse initde la formulation du modegravele degraves le deacutepart il srsquodonneacute pour objectif de deacutemontrer larareteacuteextrecircme delrsquoauto-immuniteacute et non sonimpossibiliteacute admettant lapossibiliteacute des reacuteactions immunitaires dirigeacutees conle laquo soi raquo mais la consideacuterant comme une exceppathologique Or comme nous lrsquoavons souligneacute lrsquoatoreacuteactiviteacute est en fait lrsquoun des fondements essendrsquoun fonctionnement normal de lrsquoimmuniteacute Degraves lonous pouvons dire que lrsquoargument de lrsquoexistencemaladies auto-immunes peut servir de critique du mdegravele du soi et du non-soi agrave condition drsquoecirctre inclus dune reacuteflexion drsquoensemble sur lrsquoautoreacuteactiviteacute Les mladies auto-immunes ne sont pas en rupture radicaprincipe avec lrsquoimmuniteacute normale mais au contraelles sont un dysfonctionnement qui se situe danprolongement de lrsquoimmuniteacute normale (on comprealors lrsquoautoreacuteactiviteacute commesurveillanceet non pluscommeagression)
52 Inexactitude de la proposition laquo le systegravemeimmunitaire deacuteclenche une reacuteaction contre lenon-soi raquo
Pour comprendre agrave preacutesent pourquoi la secoproposition fondamentale du modegravele du soi et du nsoi doit ecirctre remise en cause nous devons particoncept-cleacute detoleacuterance immunitaire La toleacuterance deacutesigne un eacutetat dans lequel un eacuteleacutement exogegravene se trdans un organisme sans pour autant deacuteclencherreacuteaction immunitaire Il srsquoagit donc de laquo non-soi raquolrsquoorigine drsquoune acceptation par le systegraveme immuntaire ce qui va agrave lrsquoencontre de la proposition fondmentale eacutenonceacutee ci-dessus Trois eacuteleacutements prouainsi que la deuxiegraveme proposition du modegravele duest erroneacutee
521 La toleacuterance drsquoagents exogegravenespotentiellement pathogegravenes
Crsquoest le cas par exemple des bacteacuteries situeacutees speau ou dans lrsquointestin
522 La toleacuterance des greffesDans certaines conditions non-pathologiques
exemple la toleacuterance fœto-maternelle on constate
488 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
defreacute-parmi-duegravere
o-er-eacuteeor-reacutesest
tersquoun
deent
cinqnies
elulesdesos-iteacuteel-ansles
les
onsle
on-nc
ee laegravelece
desouson-ent
tiono-ns
eeys-
unecetortelesdeacute-t duseuoi
llo-lle
laec le
im-rsquoilsns
estrsquoestreacute-il y
e il
n-antale)
im-
eser
du
une absence de rejet de greffe[20] Le modegravele dusoi et du non-soi ainsi nrsquoest pas en mesurerendre compte du cas de greffe agrave la fois le plusquent et le plus important celui du fœtus porteacutela megravere Le fœtus en effet est une greffe seallogeacutenique qui est toleacutereacutee bien que la moitieacutepatrimoine geacuteneacutetique de lrsquoenfant soit issue du pet donc soit eacutetrangegravere agrave la megravere En outre le mdegravele du soi est incapable drsquoexpliquer pourquoi ctains organes ndash dits laquo immunoprivileacutegieacutes raquo (la cornpar exemple) ndash sont toleacutereacutes ni pourquoi drsquoautresganes comme le foie sont drsquoautant mieux toleacuteque la diffeacuterence HLA entre donneur et receveurforte
523 Le chimeacuterismeLe chimeacuterisme deacutesigne le fait qursquoun individu por
en lui en faibles quantiteacutes des cellules issues dautre individu Le cas le plus significatif est celuila femme enceinte des cellules du fœtus peuvecirctre deacutetecteacutees chez la megravere au bout drsquoagrave peinesemaines de gestation et jusqursquoagrave plusieurs deacutecenapregraves lrsquoaccouchement[21] Le chimeacuterisme deacutesigneacutegalement le cas des enfants qui portent des celde leur megravere et le cas drsquoun faux jumeau portantcellules de son fregravere Le chimeacuterisme prouve la psibiliteacute drsquoun laquo partage raquo du laquo soi raquo voire la possibilpour le laquo non-soi raquo drsquoecirctre constitutif du laquo soi raquo Les clules chimeacuteriques au lieu de rester laquo endormies raquo dlrsquoorganisme peuvent mecircme se diffeacuterencier en cellutumorales[22] voire peut-ecirctrefonctionnelles(deve-nant par exemple des cellules du foie des cellude la peau etc)
De lrsquoensemble de ces observations nous pouvconclure ceci contrairement agrave ce que postulemodegravele du laquo soi raquo les cateacutegories drsquoimmunogegraveneetdrsquoexogegravenene sont pas confondues Degraves lors le laquo nsoi raquo nrsquoest pas le compleacutement du laquo soi raquo et dolrsquoopposition dans le terme laquonon-soi raquo est deacutenueacutede sens Crsquoest par conseacutequent lrsquoensemble ddialectique du soi et du non-soi au cœur du modinitieacute par Burnet qui srsquoavegravere inadeacutequate puisquemodegravele eacutechoue agrave deacutefinir la limitation de chacundeux concepts Si ce raisonnement est exact npouvons en deacuteduire que le modegravele du soi et du nsoi est impropre agrave rendre compte du fonctionnemde lrsquoimmuniteacute
6 Pour un autre modegravele theacuteorique enimmunologie la continuiteacute spatio-temporelle
Nous tentons ici de proposer une autre orientatheacuteorique ndash imparfaite et provisoire ndash pour lrsquoimmunlogie Le critegravere drsquoimmunogeacuteniciteacute que nous mettoen avant est celui de lacontinuiteacute spatio-temporellequi srsquoappuie sur la deacutefinition de lrsquoimmuniteacute commsystegravemeeneacutequilibre La proposition fondamentale dlrsquohypothegravese de la continuiteacute est la suivante le stegraveme immunitaire reacuteagit agrave ce quirompt la continuiteacuteentre les reacutecepteurs des acteurs de lrsquoimmuniteacute drsquopart et les motifs antigeacuteniques drsquoautre part (queantigegravene soit endogegravene ou exogegravene) Seule impautrement dit la continuiteacute spatio-temporelle entrecomposants immunitaires et leurs cibles le critegravereterminant nrsquoeacutetant pas de savoir si ces cibles sonlaquo soi raquo ou du laquo non-soi raquo Ainsi selon cette hypothegravele systegraveme immunitaire ne reacuteagit pas agrave ce avec qil est en contact continu(et agrave partir de quoi il a eacuteteacuteseacutelectionneacute) alors qursquoil reacuteagit agrave ce qui vientbriserla continuiteacute(un motif antigeacutenique jamais rencontreacutebacteacuterie virus organe comme dans le cas drsquoune agreffe etc) et donc la distinction pertinente est ceentrecontinuiteacuteet rupture de continuiteacute et non la dis-tinction entre laquo soi raquo et laquo non-soi raquo Ce critegravere decontinuiteacute demande agrave ecirctre penseacute en correacutelation avconcept deressemblance Il srsquoagit drsquoune continuiteacute agrave lafois spatiale et temporelle tant que les reacutecepteursmunitaires continuent de reacuteagir aussi faiblement qulrsquoont fait jusqursquoici avec les antigegravenes preacutesents dalrsquoorganisme aucune reacuteaction immunitaire forte nrsquodeacuteclencheacutee Ce qui provoque une reacuteaction forte cla nouveauteacute crsquoest-agrave-dire le laquo jamais vu raquo pour lescepteurs de lrsquoimmuniteacute et crsquoest dans ce cas-lagrave qursquoa rupture de continuiteacute
Le point de deacutepart de cette hypothegravese est doublrepose sur lrsquoideacutee decommencementde lrsquoimmuniteacute etsur lrsquoideacutee drsquoautoreacuteactiviteacutecomme auto-reconnaissace Premiegraverement il existe initialement (soit pendla peacuteriode fœtale soit pendant la peacuteriode post-natpour chaque organisme une peacuteriode de toleacuterancemunitaire ce qui indique que lrsquoimmuniteacute a uncom-mencement Ce qui estpreacutesentau moment de cettseacutelection fondatricene deacuteclenchera pas de reacuteponimmune Deuxiegravemement lrsquoautoreacuteactiviteacute est au cœude lrsquoimmuniteacute normale le bon fonctionnementsystegraveme immunitaire repose sur uneseacutelection conti-
T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492 489
tre
er-niteacute
st-on-nir
eacuteestionnqtion
f-
tionles
el-s leca-lulesdeo-
rsquoilsme
ssimeeacute-
ap-
on
iiso-onc-resla
gu--rup-fsxo-(parle
agrave
onc-el-ncecel-turereacute-ent
medegraves
esdi-sonoi raquoeacuteesle
nti-
anti-ro-
ma-nti-aceinslaiteacuteionour
uelseauffet duam-eanse
tion
nue puisque pour survivre un lymphocyte doit ecircreacuteguliegraverementstimuleacute par des antigegravenesendogegravenes(a priori non pathogegravenes) Lrsquoorganisme doit en pmanence assurer pour lui-mecircme une auto-immucontenue et continue
En quoi un modegravele insistant sur la continuiteacute eil plus satisfaisant que le modegravele du soi et du nsoi Lagrave ougrave le modegravele du soi est contraint de deacutefide multiplesexceptions lrsquohypothegravese de la continuitse veut unificatrice capable de rassembler toutles observations connues sous une mecircme explicaNous consideacuterons ainsi qursquoil y a pour lrsquoessentiel cidomaines qui montrent la supeacuterioriteacute drsquoune concepde ce type
(1) Lrsquoauto-immuniteacute Lrsquohypothegravese de la continuiteacute afirme qursquoil nrsquoy a pas de diffeacuterence deprincipeentre une reacuteaction auto-immune et une reacuteacimmunitaire visant un antigegravene exogegravene dansdeux cas il se produit unerupture de continuiteacutelieacutee agrave une modification de ce avec quoi les clules immunitaires se trouvent en contact Dancas des maladies auto-immunes il y a modifition des peptides preacutesenteacutes agrave la surface des celde lrsquoorganisme ce qui aboutit agrave une rupturecontinuiteacute alors mecircme que les peptides ainsi mdifieacutes restent du laquo soi raquo preacuteciseacutement parce qusont issus du mateacuteriel geacuteneacutetique de lrsquoorganisconsideacutereacute
(2) Les cancers Les cellules canceacutereuses elles ausont issues du mateacuteriel geacuteneacutetique de lrsquoorganiset donc sont du laquo soi raquo mais les motifs antigniques agrave leur surface brisent la continuiteacute par rport agrave des tissus sains
(3) Le prolongement entre immuniteacute et reacutegulatidrsquoensemble de lrsquoorganismeContrairement agrave ceque lrsquoimmunologie contemporaine a fait jusqursquoiclrsquohypothegravese de la continuiteacute permet de ne pasler dans lrsquoorganisme les agents assurant des ftions dedeacutefense des agents responsables drsquoautfonctions Lrsquoimmuniteacute est selon lrsquohypothegravese decontinuiteacute seulement lrsquoune des activiteacutes de reacutelation de lrsquoorganisme Ainsi lrsquoactiviteacute drsquoun macrophage par exemple est deacutetermineacutee par lature de continuiteacute entre ses reacutecepteurs et les motiavec lesquels il reacuteagit que ceux-ci soient egegravenes (bacteacuterie par exemple) ou endogegravenesexemple dans le cas drsquoune cellule morte que
macrophage doit ingeacuterer) donc il nrsquoy a pasenvisager pour le macrophagedeux tacircches dis-tinctes comme le fait le modegravele du soi (fonctidrsquolaquoeacuteboueur raquo de lrsquoorganisme drsquoune part fontion immune drsquoautre part) De mecircme les clules TReg ne sont pas stimuleacutees par la preacutesede laquo non-soi raquo puisqursquoelles reacuteagissent agrave deslules immunitaires endogegravenes mais par la rupde continuiteacute exprimeacutee preacuteciseacutement par lescepteurs des cellules immunitaires qui constituleur cible
(4) Les cas de toleacuterance immunitaire La continuiteacuterend compte de lrsquoeacutetat drsquoeacutequilibre qui srsquoeacutetablitentre lrsquoindividu et des agents pathogegravenes comles bacteacuteries sur la peau On constate queqursquoapparaicirct un deacuteficit immunitaire ces bacteacuteriqui jusque-lagrave eacutetaient sans effet neacutegatif sur lrsquoinvidu concerneacute provoquent des dommages agraveencontre Le critegravere nrsquoest donc pas celui du laquo set du laquo non-soi raquo puisque les bacteacuteries concernsont tout autant du laquo non-soi raquo avant qursquoapregravesdeacuteficit immunitaire mais bien larupture de conti-nuiteacutedans les interactions reacutecepteurs-motifs ageacuteniques
(5) Les meacutecanismes drsquoinduction drsquoune toleacuterance Mecirc-me dans le systegraveme immunitairemature on cons-tate parfois une absence de reacuteaction agrave desgegravenes avec lesquels lrsquoindividu est en contact plongeacute Il est difficile de deacuteterminer lescritegraveresdecette induction de toleacuterance puisque dans lajoriteacute des cas apregraves le premier contact avec lrsquoagegravene une reacuteponse immunitaire rapide et efficse deacuteclenche au deuxiegraveme contact Neacuteanmoil existe plusieurs meacutecanismes drsquoinduction detoleacuterance dont seule lrsquohypothegravese de la continusemble pouvoir rendre compte deacutesensibilisatdans le cas des allergies toleacuterance provisoire pcertains antigegravenes du pegravere apregraves la grossesse[21]toleacuterance pour certains pathogegravenes avec lesqon est en contact prolongeacute (bacteacuteries de la pde lrsquointestin) toleacuterance plus probable drsquoune gredrsquoorgane apregraves transfusion sanguine provenanmecircme donneur drsquoorgane etc Cela permet notment drsquoarticuler lacontinuiteacute avec les eacutetats dsymbiose les nombreuses bacteacuteries situeacutees dnotre intestin facilitent la digestion et de mecircmles bacteacuteries sur notre peau assurent lrsquoeacutelimina
490 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
se-
aisreacute-ffeonthy-nceire
quemeso-
vantttreonttiondit
euxaisionen-
sursene deques Ellau raquo
a-
eacuteo-en
u-nsheacuteo-tionis-quei-
sesce
ent
s a
queuto-
si-ous
n-Lemes
titeacuteoutge-
lo-
o-eacute
n-eacute-
ionsmet cardonc
en-iteacutehegravesesde-
up-sub-vec
y-tre-com-
drsquoautres pathogegravenes qui pour leur part cauraient des dommages agrave lrsquoorganisme
Une autogreffe ou une greffe entre jumeaux vrbien qursquoelles semblent rompre la continuiteacute entrecepteurs et motifs antigeacuteniques puisque lrsquoon grepar exemple un tissu agrave la place drsquoun autre tissu stoleacutereacutees ce qui paraicirct constituer une objection agrave lrsquopothegravese de la continuiteacute Cependant cette toleacuterasrsquoexplique par le fait que pour le systegraveme immunitareceveur il nrsquoy a pas de rupture de continuiteacute puisles reacuteactions reacutecepteursndashantigegravenes restent les mecirceacutetant donneacute qursquoil nrsquoy a aucune diffeacuterence dans les mtifs antigeacuteniques et donc dans les signaux eacutemis aet apregraves la greffe De faccedilon similaire on peut eacutemelrsquohypothegravese que ce qui fait que certaines greffes smieux toleacutereacutees que drsquoautres ce nrsquoest pas la distincsoinon-soi (conformeacutement agrave ce que nous avonscertains organes comme le foie sont drsquoautant mitoleacutereacutes qursquoils sont diffeacuterents de lrsquoorgane hocircte) mla plus grande continuiteacute dans lrsquoactiviteacute de stimulatdes agents immunitaires Ce qui importe crsquoest bientendu la continuiteacutepour les cellules immunitaires etnon la continuiteacutepour nous
Les avantages de lrsquohypothegravese de la continuiteacutele modegravele du soi tels que nous venons de les preacuteter nous permettent de preacuteciser quelle est la placcette hypothegravese au sein des theacuteories immunologiproposeacutees au cours des trente derniegraveres anneacuteessrsquoappuie incontestablement sur la theacuteorie du laquo reacuteseimmunitaire apparue chez Jerne[23] puis deacuteveloppeacuteesous la forme de la reacutegulation de lrsquoauto-immuniteacute nturelle ouimmunological homunculus[24] ainsi quesous le terme controverseacute drsquoautopoiesis[25] Lrsquohy-pothegravese de la continuiteacute a en commun avec les thries du reacuteseau lrsquoideacutee qursquoune reacuteaction immune estfait uneperturbation du systegraveme[26] crsquoest-agrave-dire unemodification du comportement que le systegraveme immnitaire a eu jusqursquoici (laquo rupture de continuiteacute raquo dale cadre de notre hypothegravese) Cependant les tries du reacuteseau immunitaire proposent une concepclosede lrsquoimmuniteacute selon ses promoteurs si la dtinction soinon-soi est insatisfaisante crsquoest parcele systegraveme immunitaire nrsquoa jamais affaire qursquoagrave lumecircme[24] Agrave lrsquoopposeacute lrsquohypothegravese de la continuiteacutedonne pour objectif drsquoouvrir le systegraveme comme noulrsquoavons vu avec les cas drsquoinduction drsquoune toleacuteranimmunitaire Lrsquohypothegravese de la continuiteacute autrem
-
e
dit srsquoefforce de comprendre comment des entiteacutepriori distinctes de lrsquoorganisme peuventsrsquointeacutegrer agravelui (processus drsquoouverture et de toleacuterance) alorsles theacuteories du reacuteseau insistent sur la clocircture et lrsquoadeacutefinition de lrsquoimmuniteacute
7 Identiteacute immunitaire et identiteacute philosophique
Lrsquohypothegravese de la continuiteacute nous eacuteloigne condeacuterablement du modegravele du soi mais elle ne neacuteloigne pas pour autant de la question de lrsquoidentiteacuteNotre conviction est qursquoil est possible de penser lrsquoidetiteacute biologique sans la deacutefinir comme un laquo soi raquoconcept philosophique drsquoidentiteacute repose sur les terlatins idem (fait drsquoecirctre identique agrave soi ideacutee deper-manencedans le temps) etipse (fait de demeurer lemecircme tout en changeant partiellement il y aeacutevolu-tion dans le temps) drsquoun cocircteacute nous avons lrsquoidenimmuable dans le temps et de lrsquoautre lrsquoideacutee que tecirctre reste le mecircme tout en accueillant en lui le chanment Cette distinction rejoint la probleacutematique phisophique de lasubstance la substance est uninvariantsusceptible drsquoecirctre pour chaque individu lesupportdetoutes lesvariations[27] Deux grandes thegraveses philsophiques srsquoaffrontent sur la question de lrsquoidentitla premiegravere deacutefinit lrsquoidentiteacute par lasubstance tandisque la seconde deacutefinit lrsquoidentiteacute par lacontinuiteacute Se-lon la premiegravere thegravese ce qui fait lrsquoidentiteacute drsquoun idividu crsquoest la substance crsquoest-agrave-dire le support mtaphysique de toutes ses deacuteterminations et variatSelon la deuxiegraveme thegravese agrave lrsquoopposeacute rien ne perde preacutesupposer qursquoil existe une telle laquo substance raquocette substance est par deacutefinition inaccessible etlrsquoidentiteacute repose seulement sur lacontinuiteacutedans letemps continuiteacute des changements physiques oucore concernant lrsquoidentiteacute psychologique continudes eacutetats de conscience Le deacutebat entre ces deux tphilosophiques pourrait ecirctre illustreacute par les figuresLocke[28] et de Leibniz[29] La conception substantialiste de lrsquoidentiteacute consiste agravesupposerplus que laconception fondeacutee sur la continuiteacute (ce que lrsquoon spose en plus crsquoest preacuteciseacutement un laquo noyau raquo destantialiteacute) Or on peut agrave bon droit ecirctre drsquoaccord ale soupccedilon de Locke renforceacute par Hume[30] puisquela substanceest en elle-mecircme un noyau meacutetaphsique inatteignable pourquoi la preacutesupposer Aument dit si on peut se passer de la substance pour
T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492 491
eacute--parsesutuisuesyer
degraveler il
unuedu
-
-rerionpar
deplecele
voirneors
etezper-du
po-quiiegrave-net re-s aus
euxvec
gielleenrsquoest
soiqueeacute
en-me
en-pasni-reacute-isnti-rsn-r en-
os--
que)s
pourpreacute-me
ienge
c-
nse-
ow2)
elf12
prendre lrsquoidentiteacute pourquoi y ferait-on appel La dmarche de Locke relegraveve alors de ladeacuteflation meacutetaphysique si un mecircme pheacutenomegravene peut ecirctre expliqueacutedeux modegraveles dont lrsquoun repose sur moins drsquohypothegraveque lrsquoautre alors crsquoest le modegravele minimal qursquoil vamieux adopter Lrsquoimmunologie est au moins deples anneacutees 1940 peacutetrie de concepts philosophiqNotre rocircle devrait ecirctre dans ces conditions drsquoessadrsquoaccorder agrave ces concepts leur juste place Le modu soi se situe du cocircteacute de lrsquoidentiteacute-substance catente de deacutefinir lrsquoidentiteacute de lrsquoorganisme commenoyau substantiel dont lrsquointeacutegriteacute doit ecirctre deacutefendtandis que lrsquohypothegravese de la continuiteacute se rangecocircteacute de lrsquoidentiteacute-continuiteacute Lrsquohypothegravese de la continuiteacute par conseacutequent constitue une propositionphi-losophiquepour limiter lrsquousage des concepts philosophiques en immunologie elle srsquoefforce de reacuteiteacutedans le domaine propre de lrsquoimmunologie la deacuteflatmeacutetaphysique que lrsquoidentiteacute-continuiteacute repreacutesenterapport agrave lrsquoidentiteacute-substance
Une question cependant surgit ici lrsquohypothegravesela continuiteacute nrsquoest-elle pas finalement qursquoune simreformulation du modegravele du soi Ne dit-elle pasque les immunologistes ont toujours dit Nous nepensons pas Rien bien entendu nrsquoempecircche delrsquohypothegravese de la continuiteacute simplement comme uconception renouveleacutee du laquo soi raquo On affirmerait alseulement qursquoil srsquoagit dans ce cas dusoi compriscomme continuiteacute (comme chez Locke ou Hume)non dusoi compris comme substance (comme chLeibniz) Cette suggestion est seacuteduisante car ellemettrait une fois encore de laquo sauver raquo le modegravelesoi et du non-soi Neacuteanmoins premiegraverement lrsquohythegravese de la continuiteacute explique des pheacutenomegraveneseacutetaient mal expliqueacutes par le modegravele du soi Deuxmement et surtout faire de lrsquoidentiteacute-continuiteacute uconception renouveleacutee du laquo soi raquo serait preacuteciseacutementomber dans lrsquoerreur qui consiste en ayant recourterme trop large desoi agrave recouvrir deux significationbien distinctes lasubstanceet lacontinuiteacute Parler delaquo soi raquo crsquoest se condamner agrave ne pas distinguer les dsens agrave passer de lrsquoun agrave lrsquoautre sans justification ale risque de tout laquo substantialiser raquo en immunoloOn pourrait donc accepter lrsquoobjection selon laquece que lrsquoon propose nrsquoest qursquoune redeacutefinition du soiimmunologie mais ce que lrsquoon ne peut accepter clrsquoideacutee que le terme desoi doit ecirctre conserveacute
8 Conclusion philosophie de lrsquoidentiteacutebiologique
Quelles questions pose lrsquoanalyse du modegravele duet du non-soi pour une compreacutehension philosophide la deacutefinition biologique de lrsquoidentiteacute Lrsquoidentitbiologique pour tout ecirctre vivant deacutesignece qursquoil estbiologiquement crsquoest-agrave-dire son uniciteacute et sa diffeacuterciation spatiale Nous avons montreacute que le systegraveimmunitaire constituait bien une sorte de carte drsquoidtiteacute de lrsquoorganisme mais que cette identiteacute nrsquoeacutetaitclose agrave toute influence exteacuterieure lrsquoidentiteacute immutaire nrsquoest pas deacutefinie agrave partir drsquoun ensemble deactions de deacutefense agrave toutesles entiteacutes exogegravenes made maniegravere continuiste crsquoest-agrave-dire comme la conuiteacute spatio-temporelle des reacuteactions entre reacutecepteude lrsquoimmuniteacute et motifs antigeacuteniques (qursquoils soient edogegravenes ou exogegravenes) Degraves lors peut se dessineparticulier agrave partir de lrsquoideacutee drsquoinduction de la toleacuterance immunitaire une reacuteflexion eacutelargie sur la psibiliteacute de deacutefinir lrsquoidentiteacute biologique (agrave la fois pheacutenotypique et en amont geacuteneacutetique ou para-geacuteneacuteticomme une identiteacuteouverte articulant agrave la fois deeacuteleacutements endogegravenes et des eacuteleacutements exogegravenesdeacuteterminer en derniegravere instance le propre toujourscaire et toujours combineacute (laquo impur raquo) drsquoun organisvivant donneacute
Remerciements
Nous remercions pour leur aide et leur soutAnouk Barberousse Claude Debru Michel MoranJean Gayon Ceacutedric Brun et Hannah-Louise Clark
Reacutefeacuterences
[1] FM Burnet F Fenner The Production of Antibodies Mamillan Melbourne 1941 2e eacutedition en 1949
[2] MS Anderson ES Venanzi L Klein Z Chen SP BerziSJ Turley H von Boehmer R Bronson A Dierich C Bnoist D Mathis Projection of an Immunological Self ShadWithin the Thymus by the Aire Protein Science 298 (2001395ndash1401
[3] RE Langman M Cohn A minimal model for the self-nonsdiscrimination a return to the basics Semin Immunol(2000) 189ndash195
492 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
self
uil
ty
ofd
de
-
aelf
rrs
ha8
Ho-nlf-
f6
-G
odSci
itet
em
ical
ei-
u-
[4] P Matzinger The danger model a renewed sense ofScience 296 (2002) 301ndash305
[5] J Bernard M Bessis C Debru (dir) Soi et non-soi SeParis 1990
[6] FM Burnet Changing Patterns An Atypical AutobiographyHeinemann Melbourne 1968
[7] M Morange La part des gegravenes Odile Jacob Paris 1998[8] FM Burnet The Integrity of the Body Harvard Universi
Press Cambridge 1962[9] AI Tauber L Chernyak Metchnikoff and the Origins
Immunology Oxford University Press New York Oxfor1991
[10] A-M Moulin Le dernier langage de la meacutedecine ndash histoirelrsquoimmunologie de Pasteur au Sida PUF Paris 1991
[11] AI Tauber The Immune Self Theory or metaphor Cambridge University Press Cambridge 1994
[12] Aristote Cateacutegories Vrin Paris 1994 chapitres 10 et 11[13] Aristote Cateacutegories chapitre 5 3b22ndash33[14] P Kourilsky J-M Claverie The peptidic self model
hypothesis on the molecular nature of the immunological sAnn Immunol 137 (1986) 3ndash21
[15] DH Raulet RE VanceCW McMahon Regulation of thenatural killer cell receptor repertoire Annu Rev Immunol 19(2001) 291ndash330
[16] PG Ashton-Rickardt A Bandeira JR Delaney L Van KaeHP Pircher RM Zinkernagel S Tonegawa Evidence foa differential avidity model of T-cell selection in the thymuCell 76 (1994) 651ndash663
[17] C Tanchot B Lemonnier A Perarnau A Freitas B RocDifferential requirements for survival and proliferation of CDnaive or memory T cells Science 276 (1997) 2057ndash2062
[18] MS Jordan A Boesteanu AJ Reed AL Petrone AElenbeck MA Lerman A Naji AJ Caton Thymic selectioof CD4+CD25+ regulatory T cells induced by an agonist sepeptide Nat Immunol 2 (2001) 301ndash306
[19] Z Feheacutervari S Sakaguchi Development and function oCD25+CD4+ regulatory T cells Curr Opin Immunol 1(2004) 203ndash208
[20] ED Carosella N Rouas-Freiss P Paul J Dausset HLAa tolerance molecule from themajor histocompatibility com-plex Immunol Today 20 (1999) 60ndash62
[21] DW Bianchi GK Zickwolf GJ Weil S Sylvester MADeMaria Male fetal progenitor cells persist in maternal blofor as long as 27 years postpartum Proc Natl AcadUSA 93 (1996) 705ndash708
[22] D Cha K Khosrotehrani Y Kim H Stroh DW BianchKL Johnson Cervical cancer and microchimerism ObsGynecol 102 (2003) 774ndash781
[23] NK Jerne Towards a network theory of the immune systAnn Immunol 125 C (1974) 373ndash389
[24] IR Cohen The cognitive paradigm and the immunologhomunculus Immunol Today 13 (1992) 490ndash494
[25] HR Maturna FJ Varela Autopoiesis and cognition D Rdel Dordrecht The Netherlands 1980
[26] AI Tauber Moving beyond the immune self Semin Immnol 12 (2000) 241ndash248
[27] Aristote Cateacutegories chapitre 5[28] J Locke Essai sur lrsquoentendement humain 1690[29] GW Leibniz Nouveaux Essais sur lrsquoentendement humain
1765[30] D Hume Traiteacute de la nature humaine 1739
T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492 485
liteacuteuesanthro-
es-e
uiteonsrs
untheacute-
im-nitrai-cep
t
e
ourt agrave
enteeacute-
saireire
m-
rendtionaisi denuer
leire
uende
on-mele
m-hi-
ntri-r
sens
clu-uelnousce
non-aunesiga-estsoi raquo
e laon-
rtente le
So-
esseacute-ant
moleacutecules du complexe majeur drsquohistocompatibi(CMH) ne sont qursquoune manifestation pheacutenotypiqdrsquoune diversiteacute fondamentalement geacuteneacutetique reposur la combinatoire de lrsquoheacutereacutediteacute (brassages intercmosomique et intrachromosomique) Lrsquoidentiteacutebiolo-gique de chaque ecirctre vivant autrement dit ladiversiteacutedes organismes y compris au sein drsquoune mecircmepegravece relegraveve prioritairement de lrsquoheacutereacutediteacute qui se situen amont de la speacutecificiteacute immunitaire
Deux raisons cependant expliquent que agrave la sde Burnet les immunologistes aient placeacute les notide soi et denon-soiau cœur de leur discipline alomecircme que rien ne laisse penser a priori que lrsquoimmuniteacuterenvoie agrave lrsquoidentiteacute La premiegravere raison repose surfait clairement eacutetabli lesreacutecepteurs immunitaires eles moleacutecules du CMH appartiennent certes au pnotype mais leur diversiteacute est de tregraves loin la plusportante de lrsquoorganisme agrave tel point qursquoon les deacutefiparfois comme sa laquo carte drsquoidentiteacute raquo La deuxiegravemeson en revanche se fonde sur un glissement contuel implicite et non deacutemontreacute de lrsquoideacutee drsquoidentiteacuteagrave lrsquoideacutee dedeacutefense de lrsquointeacutegriteacuteet enfin agrave lrsquoideacutee delutte contre tout ce qui estexogegravene une fois lrsquoim-muniteacute deacutefinie comme ladeacutefensecontre tout agenpathogegravene son rocircle a eacuteteacute penseacute comme lemaintiendans le tempsde lrsquoidentiteacute de lrsquoorganisme crsquoest-agrave-dirlrsquoabsence drsquoune quelconquemodificationde lrsquoindividupar des entiteacutesexogegravenes(seules les modificationsen-dogegraveneseacutetant consideacutereacutees comme acceptables plrsquoorganisme) Or le modegravele du soi et du non-soi eslrsquoorigine de ce glissement preacutesent de maniegravere eacutevidchez Burnet[8] alors qursquoil est absent chez un prdeacutecesseur de Burnet comme Metchnikoff[9] Un telmaintiende lrsquoidentiteacute qui fait du laquo soi raquo uneforteresseagrave deacutefendre perpeacutetuellement a un point de deacutepart danle temps agrave savoir la fin de la toleacuterance embryonnou immeacutediatement post-natale le laquo soi raquo immunitaestacquis(par la seacutelection des cellules immunocopeacutetentes) et non inneacute[10] Degraves lors que lrsquoon prendconscience de ce glissement conceptuel on compque le laquo soi raquo immunitaire ne reacutepond pas agrave la queslaquo qui suis-je raquo (dans mon uniciteacute drsquoecirctre vivant) mlaquo comment suis-je proteacutegeacute raquo (crsquoest-agrave-dire agrave lrsquoabrquelles entiteacutes eacutetrangegraveres dois-je rester pour contiagrave ecirctremoi-mecircme) et en ce sens ilnrsquoest pasle syno-nyme de lrsquoidentiteacute biologique qursquoil preacutetend ecirctre
Nous voudrions agrave preacutesent montrer pourquoimodegravele du soi et du non-soi doit ecirctre revu vo
-
rejeteacute[11] Nous emprunterons deux voies de critiqla premiegravere philosophique (conceptuelle) la secofondeacutee sur des reacutesultats expeacuterimentaux
4 Rejet philosophique du modegravele du soi et dunon-soi
Lrsquoexamen conceptuel du modegravele du soi et du nsoi conduit agrave la remise en question de la notion mecircde non-soi Le problegraveme est le suivant quel estsens de la neacutegation dans lrsquoexpression laquonon-soi raquo Pour reacutepondre agrave cette question il est utile de coprendre quelles sont les diffeacuterentes significations plosophiques de lrsquoideacutee drsquoopposition Comme le montreAristote[12] on peut en logique distinguer seulemequatre types drsquooppositions (1) la neacutegation (2) la pvation (3) la contrarieacuteteacute (4) lrsquoopposition relative Onous allons prouver agrave preacutesent qursquoaucun de cesne peut srsquoappliquer agrave lrsquoexpression laquonon-soi immuni-taire raquo Pour ce faire nous allons proceacuteder par exsion nous allons montrer par lrsquoexamen conceptque seul le quatriegraveme sens est envisageable puismontrerons par lrsquoexamen expeacuterimental que mecircmequatriegraveme sens est inapplicable
Premiegraverement on ne peut pas comprendre le laquosoi raquo comme lrsquoopposeacuteneacutegatif du laquo soi raquo car dans llogique aristoteacutelicienne la neacutegation consiste agrave nierproposition(ce qui veut dire tregraves simplement ceci la proposition laquo il est assis raquo est vraie alors sa neacutetion agrave savoir la proposition laquo il nrsquoest pas assis raquoneacutecessairement fausse) Or le laquo soi raquo et le laquo non-sont desnotions et non despropositions Deuxiegraveme-ment le laquo non-soi raquo nrsquoest pas laprivation du laquo soi raquoau sens par exemple ougrave la ceacuteciteacute est la privation dvue puisque lrsquoon constate que le laquo soi raquo et le laquo nsoi raquo pour un individu donneacutecoexistent Troisiegraveme-ment lrsquoopposition commecontrarieacuteteacutedoit-elle aussiecirctre rejeteacutee car comme le montre Aristotela sub-stance premiegraverendash qui deacutesigne tel individu particuliele support permanent des changements qui affeccet individu crsquoest-agrave-dire tregraves exactement ce que vislaquo soi raquo ndashnrsquoa pas de contraire[13] En effetrien nrsquoestle contraire de lrsquoindividualiteacute on ne peut pas direpar exemple que Protagoras est le laquo contraire raquo decrate Lrsquoindividu se comprend agrave partir de lrsquoalteacuteriteacute (dautres individus) ndash sans quoi il ne pourrait preacuteciment pas srsquoindividualiser ndash mais il nrsquoa pas pour aut
486 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
le
par-ent
uxs al-ntalent
mblear-urrai raquo
ulede
unelaquo lee leen-en-eacutevi-
oi raquo
gu-cel-ires paibi-es
ledes
et
hy-
uessusiqueaite-rsquoor-
rpreacute-lantpli-sles
lade
arceto-ais
t agraveme
yteir auest
metretidera-t agravereacute-
e lapo-
des
lesineacute-lec-rsquoougrave
-
de contraire Seul reste possible par conseacutequentquatriegraveme sens lrsquooppositionrelative le laquo non-soi raquoest au sens matheacutematique lecompleacutementdu laquo soi raquocar tout eacuteleacutement qui nrsquoappartient pas au laquo soi raquo aptient neacutecessairement au laquo non-soi raquo et reacuteciproquemCependant lrsquoopposition des relatifs doit pouvoir srsquoap-puyer sur un critegravere de distinction clair entre les deensembles compleacutementaires ainsi deacutefinis Or noulons montrer agrave preacutesent gracircce agrave lrsquoexamen expeacuterimeque le laquo soi raquo et le laquo non-soi raquo immunitaires ne peuvpreacuteciseacutement pas ecirctre consideacutereacutes comme des enseexclusifs tout ce qui nrsquoappartient pas agrave lrsquoun apptenant neacutecessairement agrave lrsquoautre Degraves lors on porejeter lrsquoideacutee selon laquelle lrsquoopposition entre le laquo soet le laquo non-soi raquo est drsquoordrerelatif (seul sens retenapregraves lrsquoexamen conceptuel) et donc affirmer queterme mecircme de laquo non-soi raquo immunitaire est deacutenueacutefondement
5 Rejet expeacuterimental du modegravele du soi et dunon-soi
Les deux propositions fondamentales du modegravele dsoi et du non-soi sont (a) laquo le systegraveme immunitairedeacuteclenche pas de reacuteaction contre le soi raquo et (b)systegraveme immunitaire deacuteclenche une reacuteaction contrnon-soi raquo Or toute une seacuterie de donneacutees expeacuterimtales prouvent que ces deux propositions fondamtales sont erroneacutees Commenccedilons par mettre endence lrsquoinexactitude de la premiegravere proposition
51 Inexactitude de la proposition laquo le systegravemeimmunitaire ne deacuteclenche pas de reacuteaction contre s
511 Seacutelection thymique la neacutecessaireautoreacuteactiviteacute non-pathologique et la notion delaquo fenecirctre de reacuteactiviteacute raquo
La seacutelection thymique se situe au cœur de lrsquoarmentation en faveur du modegravele du soi Pour leslules T seul importe le laquo soi peptidique raquo crsquoest-agrave-dlrsquoensemble des peptides seacutelectionneacutes et preacutesenteacuteles moleacutecules du complexe majeur drsquohistocompatliteacute [14] Or les lymphocytes ne sont que lrsquoun dacteurs de lrsquoimmuniteacute Degraves lors est-on certain quemodegravele du soi et du non-soi vaut au-delagrave du caslymphocytes pour tous les acteurs de lrsquoimmuniteacute
s
r
mecircme qursquoil convient pour comprendre la seacutelection tmique en tant que telle Les cellulesnatural killers(NK) par exemple nrsquoont pas de reacutecepteurs speacutecifiqdrsquoun antigegravene preacutecis elles nrsquoont pas subi le procesde seacutelection par geacuteneacuteration de diversiteacute caracteacuteristdes lymphocytes et pourtant elles assurent parfment des fonctions immunitaires indispensables agrave lganisme sans deacuteclencher de reacuteaction contre lui[15]Peut-ecirctre avons-nous eu jusqursquoagrave preacutesent une intetation abusive de la seacutelection lymphocytaire en parde laquo soi raquo et de laquo non-soi raquo alors qursquoavancer une excation en termes drsquointeacutegration de signaux activateuret inhibiteurs permettrait de ne pas opposer celluNK et lymphocytes B et T Lrsquoideacutee selon laquelleseacutelection lymphocytaire assurerait la suppressiontoute autoreacuteactiviteacute est erroneacutee non seulement pqursquoenviron 4 agrave 6 des lymphocytes fortement aureacuteactifs eacutechappent agrave lrsquoeacutelimination dans le thymus maussi et surtout parce que seuls les lymphocytesfaible-ment autoreacuteactifssont seacutelectionneacutes Contrairemence qursquoavance le modegravele du soi et du non-soi et mecircen conservant sa propre terminologie un lymphocpour ecirctre seacutelectionneacute doit non pas ne pas reacuteaglaquo soi raquo mais reacuteagir faiblement au laquo soi raquo Lrsquoenjeudonc la deacutefinition drsquounefenecirctre de reacuteactiviteacute La seacute-lection des lymphocytes pose en effet un problegravedeacutecisif comment dans le thymus lrsquointeraction enun reacutecepteur de lymphocyte T et un complexe pep+ moleacutecule du CMH peut-elle conduire agrave la matution des thymocytes durant la seacutelection positive ela mort cellulaire durant la seacutelection neacutegative Laponse tient sans doute en ceci lrsquoaffiniteacuteet lrsquointensiteacutedes signaux doivent ecirctre diffeacuterentes dans le cas dseacutelection neacutegative et dans le cas de la seacutelectionsitive [16] Par conseacutequent non seulement onpeutramener les notions de laquo soi raquo et de laquo non-soi raquo agravedonneacutees plus claires relatives agrave dessignauxactivateursou inhibiteurs (possibiliteacute largement suggeacutereacutee parcellules NK) mais mecircme ondoit le faire sans quolrsquoon ne pourrait pas comprendre que la seacutelectiongative ne vienne pas tout simplement annuler la seacutetion positive en deacutetruisant toutes les cellules T Dlrsquoideacutee de laquo fenecirctre de reacuteactiviteacute raquo une reacuteactionfaibleinduit la seacutelectionpositive (survie) alors qursquoune reacuteaction forte a pour conseacutequence la seacutelectionneacutegative(mort par apoptose)
T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492 487
onsom-our
des
ourin-rieneacute-eti seme
cep-
in-nteacute
ivegitel-
n-ionresrsquoenunhescel-
antqueageleacuteeor-
nce
yan
dece
ulesim-
raitsoi
ndreca-t lesialeest
tretionu-
tielsrsdes
o-ans
a-le deires lend
ndeon-r du-ouveuneagrave
i-a-ventsoi
ur la
par
512 Lrsquoautoreacuteactiviteacute des lymphocytes dans lesystegraveme peacuteripheacuterique
Reacutecemment il a eacuteteacute montreacute que les interactientre les reacutecepteurs des lymphocytes T et les cplexes CMH + peptide sont aussi fondamentales ple maintiendes cellules T dans les organes lymphoiumlpeacuteripheacuteriques que pour leurseacutelectiondans le thy-mus[17] Loin donc drsquoecirctre seulement essentielles pla seacutelection initiale des lymphocytes T seules cesteractions peuvent garantir leur survie agrave la peacuteripheacuteLe maintien des cellules T naiumlves agrave la peacuteripheacuteriecessite un contactcontinu entre leurs reacutecepteursles complexes CMHndashpeptide Ces interactions quproduisent dans le systegraveme peacuteripheacuterique tout comcelles qui ont lieu dans le thymus engagent les reacuteteurs T et des constituantsendogegravenes(du laquo soi raquo) ilnrsquoy a rien drsquoexogegravene dans la moleacutecule du CMH de lrsquodividu et dans ses propres peptides qui sont preacuteseagrave la surface des cellules de lrsquoorganisme En deacutefinitun lymphocyte T ne se maintient en vie que srsquoil reacuteacontinucircment au laquo soi raquo Ainsi non seulement les clules lymphocytairespeuventreacuteagir au laquo soi raquo mais eoutre elles ne peuvent survivreqursquoenreacuteagissant continucircment au laquosoi raquo Lrsquoautoreacuteactiviteacute est une conditsine qua non de la survie des cellules immunitaiet donc elle se situe au cœur de lrsquoimmuniteacute loin dconstituer comme on lrsquoa cru pendant longtempsessentiel dysfonctionnement Agrave ce titre les rechercreacutecentes sur la genegravese et le fonctionnement deslules T reacutegulatrices (TReg) CD4+CD25+ qui inhibentlrsquoactiviteacute des autres cellules immunitaires permettde mettre fin agrave une reacuteponse immune et drsquoeacuteviterles tissus de lrsquoorganisme ne subissent des dommconseacutecutifs agrave une reacuteponse inflammatoire incontrocircsont venues confirmer les ideacutees drsquoautoreacuteactiviteacute nmale (non pathologique) et de maintien de la toleacuterapeacuteripheacuterique En effet drsquoune part les cellules TReg re-quiegraverent pour ecirctre seacutelectionneacutees un reacutecepteur T aune forte affiniteacute pour un peptide du laquo soi raquo[18] etdrsquoautre part on constate que des souris priveacuteescellules TReg meurent de maladies auto-immunesqui indique que la geacuteneacuteration systeacutematique de cellTReg est indispensable pour maintenir la toleacuterancemunitaire agrave la peacuteripheacuterie[19]
513 Les maladies auto-immunesLrsquoexistence de maladies auto-immunes ne sau
ecirctre en soi un argument contre le modegravele du
s
s
t
puisque celui-ci a preacuteciseacutement eacuteteacute eacutelaboreacute pour recompte de la possibiliteacute et indissociablement duractegravere exceptionnel de telles maladies Cependanmaladies auto-immunes montrent la faiblesse initde la formulation du modegravele degraves le deacutepart il srsquodonneacute pour objectif de deacutemontrer larareteacuteextrecircme delrsquoauto-immuniteacute et non sonimpossibiliteacute admettant lapossibiliteacute des reacuteactions immunitaires dirigeacutees conle laquo soi raquo mais la consideacuterant comme une exceppathologique Or comme nous lrsquoavons souligneacute lrsquoatoreacuteactiviteacute est en fait lrsquoun des fondements essendrsquoun fonctionnement normal de lrsquoimmuniteacute Degraves lonous pouvons dire que lrsquoargument de lrsquoexistencemaladies auto-immunes peut servir de critique du mdegravele du soi et du non-soi agrave condition drsquoecirctre inclus dune reacuteflexion drsquoensemble sur lrsquoautoreacuteactiviteacute Les mladies auto-immunes ne sont pas en rupture radicaprincipe avec lrsquoimmuniteacute normale mais au contraelles sont un dysfonctionnement qui se situe danprolongement de lrsquoimmuniteacute normale (on comprealors lrsquoautoreacuteactiviteacute commesurveillanceet non pluscommeagression)
52 Inexactitude de la proposition laquo le systegravemeimmunitaire deacuteclenche une reacuteaction contre lenon-soi raquo
Pour comprendre agrave preacutesent pourquoi la secoproposition fondamentale du modegravele du soi et du nsoi doit ecirctre remise en cause nous devons particoncept-cleacute detoleacuterance immunitaire La toleacuterance deacutesigne un eacutetat dans lequel un eacuteleacutement exogegravene se trdans un organisme sans pour autant deacuteclencherreacuteaction immunitaire Il srsquoagit donc de laquo non-soi raquolrsquoorigine drsquoune acceptation par le systegraveme immuntaire ce qui va agrave lrsquoencontre de la proposition fondmentale eacutenonceacutee ci-dessus Trois eacuteleacutements prouainsi que la deuxiegraveme proposition du modegravele duest erroneacutee
521 La toleacuterance drsquoagents exogegravenespotentiellement pathogegravenes
Crsquoest le cas par exemple des bacteacuteries situeacutees speau ou dans lrsquointestin
522 La toleacuterance des greffesDans certaines conditions non-pathologiques
exemple la toleacuterance fœto-maternelle on constate
488 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
defreacute-parmi-duegravere
o-er-eacuteeor-reacutesest
tersquoun
deent
cinqnies
elulesdesos-iteacuteel-ansles
les
onsle
on-nc
ee laegravelece
desouson-ent
tiono-ns
eeys-
unecetortelesdeacute-t duseuoi
llo-lle
laec le
im-rsquoilsns
estrsquoestreacute-il y
e il
n-antale)
im-
eser
du
une absence de rejet de greffe[20] Le modegravele dusoi et du non-soi ainsi nrsquoest pas en mesurerendre compte du cas de greffe agrave la fois le plusquent et le plus important celui du fœtus porteacutela megravere Le fœtus en effet est une greffe seallogeacutenique qui est toleacutereacutee bien que la moitieacutepatrimoine geacuteneacutetique de lrsquoenfant soit issue du pet donc soit eacutetrangegravere agrave la megravere En outre le mdegravele du soi est incapable drsquoexpliquer pourquoi ctains organes ndash dits laquo immunoprivileacutegieacutes raquo (la cornpar exemple) ndash sont toleacutereacutes ni pourquoi drsquoautresganes comme le foie sont drsquoautant mieux toleacuteque la diffeacuterence HLA entre donneur et receveurforte
523 Le chimeacuterismeLe chimeacuterisme deacutesigne le fait qursquoun individu por
en lui en faibles quantiteacutes des cellules issues dautre individu Le cas le plus significatif est celuila femme enceinte des cellules du fœtus peuvecirctre deacutetecteacutees chez la megravere au bout drsquoagrave peinesemaines de gestation et jusqursquoagrave plusieurs deacutecenapregraves lrsquoaccouchement[21] Le chimeacuterisme deacutesigneacutegalement le cas des enfants qui portent des celde leur megravere et le cas drsquoun faux jumeau portantcellules de son fregravere Le chimeacuterisme prouve la psibiliteacute drsquoun laquo partage raquo du laquo soi raquo voire la possibilpour le laquo non-soi raquo drsquoecirctre constitutif du laquo soi raquo Les clules chimeacuteriques au lieu de rester laquo endormies raquo dlrsquoorganisme peuvent mecircme se diffeacuterencier en cellutumorales[22] voire peut-ecirctrefonctionnelles(deve-nant par exemple des cellules du foie des cellude la peau etc)
De lrsquoensemble de ces observations nous pouvconclure ceci contrairement agrave ce que postulemodegravele du laquo soi raquo les cateacutegories drsquoimmunogegraveneetdrsquoexogegravenene sont pas confondues Degraves lors le laquo nsoi raquo nrsquoest pas le compleacutement du laquo soi raquo et dolrsquoopposition dans le terme laquonon-soi raquo est deacutenueacutede sens Crsquoest par conseacutequent lrsquoensemble ddialectique du soi et du non-soi au cœur du modinitieacute par Burnet qui srsquoavegravere inadeacutequate puisquemodegravele eacutechoue agrave deacutefinir la limitation de chacundeux concepts Si ce raisonnement est exact npouvons en deacuteduire que le modegravele du soi et du nsoi est impropre agrave rendre compte du fonctionnemde lrsquoimmuniteacute
6 Pour un autre modegravele theacuteorique enimmunologie la continuiteacute spatio-temporelle
Nous tentons ici de proposer une autre orientatheacuteorique ndash imparfaite et provisoire ndash pour lrsquoimmunlogie Le critegravere drsquoimmunogeacuteniciteacute que nous mettoen avant est celui de lacontinuiteacute spatio-temporellequi srsquoappuie sur la deacutefinition de lrsquoimmuniteacute commsystegravemeeneacutequilibre La proposition fondamentale dlrsquohypothegravese de la continuiteacute est la suivante le stegraveme immunitaire reacuteagit agrave ce quirompt la continuiteacuteentre les reacutecepteurs des acteurs de lrsquoimmuniteacute drsquopart et les motifs antigeacuteniques drsquoautre part (queantigegravene soit endogegravene ou exogegravene) Seule impautrement dit la continuiteacute spatio-temporelle entrecomposants immunitaires et leurs cibles le critegravereterminant nrsquoeacutetant pas de savoir si ces cibles sonlaquo soi raquo ou du laquo non-soi raquo Ainsi selon cette hypothegravele systegraveme immunitaire ne reacuteagit pas agrave ce avec qil est en contact continu(et agrave partir de quoi il a eacuteteacuteseacutelectionneacute) alors qursquoil reacuteagit agrave ce qui vientbriserla continuiteacute(un motif antigeacutenique jamais rencontreacutebacteacuterie virus organe comme dans le cas drsquoune agreffe etc) et donc la distinction pertinente est ceentrecontinuiteacuteet rupture de continuiteacute et non la dis-tinction entre laquo soi raquo et laquo non-soi raquo Ce critegravere decontinuiteacute demande agrave ecirctre penseacute en correacutelation avconcept deressemblance Il srsquoagit drsquoune continuiteacute agrave lafois spatiale et temporelle tant que les reacutecepteursmunitaires continuent de reacuteagir aussi faiblement qulrsquoont fait jusqursquoici avec les antigegravenes preacutesents dalrsquoorganisme aucune reacuteaction immunitaire forte nrsquodeacuteclencheacutee Ce qui provoque une reacuteaction forte cla nouveauteacute crsquoest-agrave-dire le laquo jamais vu raquo pour lescepteurs de lrsquoimmuniteacute et crsquoest dans ce cas-lagrave qursquoa rupture de continuiteacute
Le point de deacutepart de cette hypothegravese est doublrepose sur lrsquoideacutee decommencementde lrsquoimmuniteacute etsur lrsquoideacutee drsquoautoreacuteactiviteacutecomme auto-reconnaissace Premiegraverement il existe initialement (soit pendla peacuteriode fœtale soit pendant la peacuteriode post-natpour chaque organisme une peacuteriode de toleacuterancemunitaire ce qui indique que lrsquoimmuniteacute a uncom-mencement Ce qui estpreacutesentau moment de cettseacutelection fondatricene deacuteclenchera pas de reacuteponimmune Deuxiegravemement lrsquoautoreacuteactiviteacute est au cœude lrsquoimmuniteacute normale le bon fonctionnementsystegraveme immunitaire repose sur uneseacutelection conti-
T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492 489
tre
er-niteacute
st-on-nir
eacuteestionnqtion
f-
tionles
el-s leca-lulesdeo-
rsquoilsme
ssimeeacute-
ap-
on
iiso-onc-resla
gu--rup-fsxo-(parle
agrave
onc-el-ncecel-turereacute-ent
medegraves
esdi-sonoi raquoeacuteesle
nti-
anti-ro-
ma-nti-aceinslaiteacuteionour
uelseauffet duam-eanse
tion
nue puisque pour survivre un lymphocyte doit ecircreacuteguliegraverementstimuleacute par des antigegravenesendogegravenes(a priori non pathogegravenes) Lrsquoorganisme doit en pmanence assurer pour lui-mecircme une auto-immucontenue et continue
En quoi un modegravele insistant sur la continuiteacute eil plus satisfaisant que le modegravele du soi et du nsoi Lagrave ougrave le modegravele du soi est contraint de deacutefide multiplesexceptions lrsquohypothegravese de la continuitse veut unificatrice capable de rassembler toutles observations connues sous une mecircme explicaNous consideacuterons ainsi qursquoil y a pour lrsquoessentiel cidomaines qui montrent la supeacuterioriteacute drsquoune concepde ce type
(1) Lrsquoauto-immuniteacute Lrsquohypothegravese de la continuiteacute afirme qursquoil nrsquoy a pas de diffeacuterence deprincipeentre une reacuteaction auto-immune et une reacuteacimmunitaire visant un antigegravene exogegravene dansdeux cas il se produit unerupture de continuiteacutelieacutee agrave une modification de ce avec quoi les clules immunitaires se trouvent en contact Dancas des maladies auto-immunes il y a modifition des peptides preacutesenteacutes agrave la surface des celde lrsquoorganisme ce qui aboutit agrave une rupturecontinuiteacute alors mecircme que les peptides ainsi mdifieacutes restent du laquo soi raquo preacuteciseacutement parce qusont issus du mateacuteriel geacuteneacutetique de lrsquoorganisconsideacutereacute
(2) Les cancers Les cellules canceacutereuses elles ausont issues du mateacuteriel geacuteneacutetique de lrsquoorganiset donc sont du laquo soi raquo mais les motifs antigniques agrave leur surface brisent la continuiteacute par rport agrave des tissus sains
(3) Le prolongement entre immuniteacute et reacutegulatidrsquoensemble de lrsquoorganismeContrairement agrave ceque lrsquoimmunologie contemporaine a fait jusqursquoiclrsquohypothegravese de la continuiteacute permet de ne pasler dans lrsquoorganisme les agents assurant des ftions dedeacutefense des agents responsables drsquoautfonctions Lrsquoimmuniteacute est selon lrsquohypothegravese decontinuiteacute seulement lrsquoune des activiteacutes de reacutelation de lrsquoorganisme Ainsi lrsquoactiviteacute drsquoun macrophage par exemple est deacutetermineacutee par lature de continuiteacute entre ses reacutecepteurs et les motiavec lesquels il reacuteagit que ceux-ci soient egegravenes (bacteacuterie par exemple) ou endogegravenesexemple dans le cas drsquoune cellule morte que
macrophage doit ingeacuterer) donc il nrsquoy a pasenvisager pour le macrophagedeux tacircches dis-tinctes comme le fait le modegravele du soi (fonctidrsquolaquoeacuteboueur raquo de lrsquoorganisme drsquoune part fontion immune drsquoautre part) De mecircme les clules TReg ne sont pas stimuleacutees par la preacutesede laquo non-soi raquo puisqursquoelles reacuteagissent agrave deslules immunitaires endogegravenes mais par la rupde continuiteacute exprimeacutee preacuteciseacutement par lescepteurs des cellules immunitaires qui constituleur cible
(4) Les cas de toleacuterance immunitaire La continuiteacuterend compte de lrsquoeacutetat drsquoeacutequilibre qui srsquoeacutetablitentre lrsquoindividu et des agents pathogegravenes comles bacteacuteries sur la peau On constate queqursquoapparaicirct un deacuteficit immunitaire ces bacteacuteriqui jusque-lagrave eacutetaient sans effet neacutegatif sur lrsquoinvidu concerneacute provoquent des dommages agraveencontre Le critegravere nrsquoest donc pas celui du laquo set du laquo non-soi raquo puisque les bacteacuteries concernsont tout autant du laquo non-soi raquo avant qursquoapregravesdeacuteficit immunitaire mais bien larupture de conti-nuiteacutedans les interactions reacutecepteurs-motifs ageacuteniques
(5) Les meacutecanismes drsquoinduction drsquoune toleacuterance Mecirc-me dans le systegraveme immunitairemature on cons-tate parfois une absence de reacuteaction agrave desgegravenes avec lesquels lrsquoindividu est en contact plongeacute Il est difficile de deacuteterminer lescritegraveresdecette induction de toleacuterance puisque dans lajoriteacute des cas apregraves le premier contact avec lrsquoagegravene une reacuteponse immunitaire rapide et efficse deacuteclenche au deuxiegraveme contact Neacuteanmoil existe plusieurs meacutecanismes drsquoinduction detoleacuterance dont seule lrsquohypothegravese de la continusemble pouvoir rendre compte deacutesensibilisatdans le cas des allergies toleacuterance provisoire pcertains antigegravenes du pegravere apregraves la grossesse[21]toleacuterance pour certains pathogegravenes avec lesqon est en contact prolongeacute (bacteacuteries de la pde lrsquointestin) toleacuterance plus probable drsquoune gredrsquoorgane apregraves transfusion sanguine provenanmecircme donneur drsquoorgane etc Cela permet notment drsquoarticuler lacontinuiteacute avec les eacutetats dsymbiose les nombreuses bacteacuteries situeacutees dnotre intestin facilitent la digestion et de mecircmles bacteacuteries sur notre peau assurent lrsquoeacutelimina
490 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
se-
aisreacute-ffeonthy-nceire
quemeso-
vantttreonttiondit
euxaisionen-
sursene deques Ellau raquo
a-
eacuteo-en
u-nsheacuteo-tionis-quei-
sesce
ent
s a
queuto-
si-ous
n-Lemes
titeacuteoutge-
lo-
o-eacute
n-eacute-
ionsmet cardonc
en-iteacutehegravesesde-
up-sub-vec
y-tre-com-
drsquoautres pathogegravenes qui pour leur part cauraient des dommages agrave lrsquoorganisme
Une autogreffe ou une greffe entre jumeaux vrbien qursquoelles semblent rompre la continuiteacute entrecepteurs et motifs antigeacuteniques puisque lrsquoon grepar exemple un tissu agrave la place drsquoun autre tissu stoleacutereacutees ce qui paraicirct constituer une objection agrave lrsquopothegravese de la continuiteacute Cependant cette toleacuterasrsquoexplique par le fait que pour le systegraveme immunitareceveur il nrsquoy a pas de rupture de continuiteacute puisles reacuteactions reacutecepteursndashantigegravenes restent les mecirceacutetant donneacute qursquoil nrsquoy a aucune diffeacuterence dans les mtifs antigeacuteniques et donc dans les signaux eacutemis aet apregraves la greffe De faccedilon similaire on peut eacutemelrsquohypothegravese que ce qui fait que certaines greffes smieux toleacutereacutees que drsquoautres ce nrsquoest pas la distincsoinon-soi (conformeacutement agrave ce que nous avonscertains organes comme le foie sont drsquoautant mitoleacutereacutes qursquoils sont diffeacuterents de lrsquoorgane hocircte) mla plus grande continuiteacute dans lrsquoactiviteacute de stimulatdes agents immunitaires Ce qui importe crsquoest bientendu la continuiteacutepour les cellules immunitaires etnon la continuiteacutepour nous
Les avantages de lrsquohypothegravese de la continuiteacutele modegravele du soi tels que nous venons de les preacuteter nous permettent de preacuteciser quelle est la placcette hypothegravese au sein des theacuteories immunologiproposeacutees au cours des trente derniegraveres anneacuteessrsquoappuie incontestablement sur la theacuteorie du laquo reacuteseimmunitaire apparue chez Jerne[23] puis deacuteveloppeacuteesous la forme de la reacutegulation de lrsquoauto-immuniteacute nturelle ouimmunological homunculus[24] ainsi quesous le terme controverseacute drsquoautopoiesis[25] Lrsquohy-pothegravese de la continuiteacute a en commun avec les thries du reacuteseau lrsquoideacutee qursquoune reacuteaction immune estfait uneperturbation du systegraveme[26] crsquoest-agrave-dire unemodification du comportement que le systegraveme immnitaire a eu jusqursquoici (laquo rupture de continuiteacute raquo dale cadre de notre hypothegravese) Cependant les tries du reacuteseau immunitaire proposent une concepclosede lrsquoimmuniteacute selon ses promoteurs si la dtinction soinon-soi est insatisfaisante crsquoest parcele systegraveme immunitaire nrsquoa jamais affaire qursquoagrave lumecircme[24] Agrave lrsquoopposeacute lrsquohypothegravese de la continuiteacutedonne pour objectif drsquoouvrir le systegraveme comme noulrsquoavons vu avec les cas drsquoinduction drsquoune toleacuteranimmunitaire Lrsquohypothegravese de la continuiteacute autrem
-
e
dit srsquoefforce de comprendre comment des entiteacutepriori distinctes de lrsquoorganisme peuventsrsquointeacutegrer agravelui (processus drsquoouverture et de toleacuterance) alorsles theacuteories du reacuteseau insistent sur la clocircture et lrsquoadeacutefinition de lrsquoimmuniteacute
7 Identiteacute immunitaire et identiteacute philosophique
Lrsquohypothegravese de la continuiteacute nous eacuteloigne condeacuterablement du modegravele du soi mais elle ne neacuteloigne pas pour autant de la question de lrsquoidentiteacuteNotre conviction est qursquoil est possible de penser lrsquoidetiteacute biologique sans la deacutefinir comme un laquo soi raquoconcept philosophique drsquoidentiteacute repose sur les terlatins idem (fait drsquoecirctre identique agrave soi ideacutee deper-manencedans le temps) etipse (fait de demeurer lemecircme tout en changeant partiellement il y aeacutevolu-tion dans le temps) drsquoun cocircteacute nous avons lrsquoidenimmuable dans le temps et de lrsquoautre lrsquoideacutee que tecirctre reste le mecircme tout en accueillant en lui le chanment Cette distinction rejoint la probleacutematique phisophique de lasubstance la substance est uninvariantsusceptible drsquoecirctre pour chaque individu lesupportdetoutes lesvariations[27] Deux grandes thegraveses philsophiques srsquoaffrontent sur la question de lrsquoidentitla premiegravere deacutefinit lrsquoidentiteacute par lasubstance tandisque la seconde deacutefinit lrsquoidentiteacute par lacontinuiteacute Se-lon la premiegravere thegravese ce qui fait lrsquoidentiteacute drsquoun idividu crsquoest la substance crsquoest-agrave-dire le support mtaphysique de toutes ses deacuteterminations et variatSelon la deuxiegraveme thegravese agrave lrsquoopposeacute rien ne perde preacutesupposer qursquoil existe une telle laquo substance raquocette substance est par deacutefinition inaccessible etlrsquoidentiteacute repose seulement sur lacontinuiteacutedans letemps continuiteacute des changements physiques oucore concernant lrsquoidentiteacute psychologique continudes eacutetats de conscience Le deacutebat entre ces deux tphilosophiques pourrait ecirctre illustreacute par les figuresLocke[28] et de Leibniz[29] La conception substantialiste de lrsquoidentiteacute consiste agravesupposerplus que laconception fondeacutee sur la continuiteacute (ce que lrsquoon spose en plus crsquoest preacuteciseacutement un laquo noyau raquo destantialiteacute) Or on peut agrave bon droit ecirctre drsquoaccord ale soupccedilon de Locke renforceacute par Hume[30] puisquela substanceest en elle-mecircme un noyau meacutetaphsique inatteignable pourquoi la preacutesupposer Aument dit si on peut se passer de la substance pour
T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492 491
eacute--parsesutuisuesyer
degraveler il
unuedu
-
-rerionpar
deplecele
voirneors
etezper-du
po-quiiegrave-net re-s aus
euxvec
gielleenrsquoest
soiqueeacute
en-me
en-pasni-reacute-isnti-rsn-r en-
os--
que)s
pourpreacute-me
ienge
c-
nse-
ow2)
elf12
prendre lrsquoidentiteacute pourquoi y ferait-on appel La dmarche de Locke relegraveve alors de ladeacuteflation meacutetaphysique si un mecircme pheacutenomegravene peut ecirctre expliqueacutedeux modegraveles dont lrsquoun repose sur moins drsquohypothegraveque lrsquoautre alors crsquoest le modegravele minimal qursquoil vamieux adopter Lrsquoimmunologie est au moins deples anneacutees 1940 peacutetrie de concepts philosophiqNotre rocircle devrait ecirctre dans ces conditions drsquoessadrsquoaccorder agrave ces concepts leur juste place Le modu soi se situe du cocircteacute de lrsquoidentiteacute-substance catente de deacutefinir lrsquoidentiteacute de lrsquoorganisme commenoyau substantiel dont lrsquointeacutegriteacute doit ecirctre deacutefendtandis que lrsquohypothegravese de la continuiteacute se rangecocircteacute de lrsquoidentiteacute-continuiteacute Lrsquohypothegravese de la continuiteacute par conseacutequent constitue une propositionphi-losophiquepour limiter lrsquousage des concepts philosophiques en immunologie elle srsquoefforce de reacuteiteacutedans le domaine propre de lrsquoimmunologie la deacuteflatmeacutetaphysique que lrsquoidentiteacute-continuiteacute repreacutesenterapport agrave lrsquoidentiteacute-substance
Une question cependant surgit ici lrsquohypothegravesela continuiteacute nrsquoest-elle pas finalement qursquoune simreformulation du modegravele du soi Ne dit-elle pasque les immunologistes ont toujours dit Nous nepensons pas Rien bien entendu nrsquoempecircche delrsquohypothegravese de la continuiteacute simplement comme uconception renouveleacutee du laquo soi raquo On affirmerait alseulement qursquoil srsquoagit dans ce cas dusoi compriscomme continuiteacute (comme chez Locke ou Hume)non dusoi compris comme substance (comme chLeibniz) Cette suggestion est seacuteduisante car ellemettrait une fois encore de laquo sauver raquo le modegravelesoi et du non-soi Neacuteanmoins premiegraverement lrsquohythegravese de la continuiteacute explique des pheacutenomegraveneseacutetaient mal expliqueacutes par le modegravele du soi Deuxmement et surtout faire de lrsquoidentiteacute-continuiteacute uconception renouveleacutee du laquo soi raquo serait preacuteciseacutementomber dans lrsquoerreur qui consiste en ayant recourterme trop large desoi agrave recouvrir deux significationbien distinctes lasubstanceet lacontinuiteacute Parler delaquo soi raquo crsquoest se condamner agrave ne pas distinguer les dsens agrave passer de lrsquoun agrave lrsquoautre sans justification ale risque de tout laquo substantialiser raquo en immunoloOn pourrait donc accepter lrsquoobjection selon laquece que lrsquoon propose nrsquoest qursquoune redeacutefinition du soiimmunologie mais ce que lrsquoon ne peut accepter clrsquoideacutee que le terme desoi doit ecirctre conserveacute
8 Conclusion philosophie de lrsquoidentiteacutebiologique
Quelles questions pose lrsquoanalyse du modegravele duet du non-soi pour une compreacutehension philosophide la deacutefinition biologique de lrsquoidentiteacute Lrsquoidentitbiologique pour tout ecirctre vivant deacutesignece qursquoil estbiologiquement crsquoest-agrave-dire son uniciteacute et sa diffeacuterciation spatiale Nous avons montreacute que le systegraveimmunitaire constituait bien une sorte de carte drsquoidtiteacute de lrsquoorganisme mais que cette identiteacute nrsquoeacutetaitclose agrave toute influence exteacuterieure lrsquoidentiteacute immutaire nrsquoest pas deacutefinie agrave partir drsquoun ensemble deactions de deacutefense agrave toutesles entiteacutes exogegravenes made maniegravere continuiste crsquoest-agrave-dire comme la conuiteacute spatio-temporelle des reacuteactions entre reacutecepteude lrsquoimmuniteacute et motifs antigeacuteniques (qursquoils soient edogegravenes ou exogegravenes) Degraves lors peut se dessineparticulier agrave partir de lrsquoideacutee drsquoinduction de la toleacuterance immunitaire une reacuteflexion eacutelargie sur la psibiliteacute de deacutefinir lrsquoidentiteacute biologique (agrave la fois pheacutenotypique et en amont geacuteneacutetique ou para-geacuteneacuteticomme une identiteacuteouverte articulant agrave la fois deeacuteleacutements endogegravenes et des eacuteleacutements exogegravenesdeacuteterminer en derniegravere instance le propre toujourscaire et toujours combineacute (laquo impur raquo) drsquoun organisvivant donneacute
Remerciements
Nous remercions pour leur aide et leur soutAnouk Barberousse Claude Debru Michel MoranJean Gayon Ceacutedric Brun et Hannah-Louise Clark
Reacutefeacuterences
[1] FM Burnet F Fenner The Production of Antibodies Mamillan Melbourne 1941 2e eacutedition en 1949
[2] MS Anderson ES Venanzi L Klein Z Chen SP BerziSJ Turley H von Boehmer R Bronson A Dierich C Bnoist D Mathis Projection of an Immunological Self ShadWithin the Thymus by the Aire Protein Science 298 (2001395ndash1401
[3] RE Langman M Cohn A minimal model for the self-nonsdiscrimination a return to the basics Semin Immunol(2000) 189ndash195
492 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
self
uil
ty
ofd
de
-
aelf
rrs
ha8
Ho-nlf-
f6
-G
odSci
itet
em
ical
ei-
u-
[4] P Matzinger The danger model a renewed sense ofScience 296 (2002) 301ndash305
[5] J Bernard M Bessis C Debru (dir) Soi et non-soi SeParis 1990
[6] FM Burnet Changing Patterns An Atypical AutobiographyHeinemann Melbourne 1968
[7] M Morange La part des gegravenes Odile Jacob Paris 1998[8] FM Burnet The Integrity of the Body Harvard Universi
Press Cambridge 1962[9] AI Tauber L Chernyak Metchnikoff and the Origins
Immunology Oxford University Press New York Oxfor1991
[10] A-M Moulin Le dernier langage de la meacutedecine ndash histoirelrsquoimmunologie de Pasteur au Sida PUF Paris 1991
[11] AI Tauber The Immune Self Theory or metaphor Cambridge University Press Cambridge 1994
[12] Aristote Cateacutegories Vrin Paris 1994 chapitres 10 et 11[13] Aristote Cateacutegories chapitre 5 3b22ndash33[14] P Kourilsky J-M Claverie The peptidic self model
hypothesis on the molecular nature of the immunological sAnn Immunol 137 (1986) 3ndash21
[15] DH Raulet RE VanceCW McMahon Regulation of thenatural killer cell receptor repertoire Annu Rev Immunol 19(2001) 291ndash330
[16] PG Ashton-Rickardt A Bandeira JR Delaney L Van KaeHP Pircher RM Zinkernagel S Tonegawa Evidence foa differential avidity model of T-cell selection in the thymuCell 76 (1994) 651ndash663
[17] C Tanchot B Lemonnier A Perarnau A Freitas B RocDifferential requirements for survival and proliferation of CDnaive or memory T cells Science 276 (1997) 2057ndash2062
[18] MS Jordan A Boesteanu AJ Reed AL Petrone AElenbeck MA Lerman A Naji AJ Caton Thymic selectioof CD4+CD25+ regulatory T cells induced by an agonist sepeptide Nat Immunol 2 (2001) 301ndash306
[19] Z Feheacutervari S Sakaguchi Development and function oCD25+CD4+ regulatory T cells Curr Opin Immunol 1(2004) 203ndash208
[20] ED Carosella N Rouas-Freiss P Paul J Dausset HLAa tolerance molecule from themajor histocompatibility com-plex Immunol Today 20 (1999) 60ndash62
[21] DW Bianchi GK Zickwolf GJ Weil S Sylvester MADeMaria Male fetal progenitor cells persist in maternal blofor as long as 27 years postpartum Proc Natl AcadUSA 93 (1996) 705ndash708
[22] D Cha K Khosrotehrani Y Kim H Stroh DW BianchKL Johnson Cervical cancer and microchimerism ObsGynecol 102 (2003) 774ndash781
[23] NK Jerne Towards a network theory of the immune systAnn Immunol 125 C (1974) 373ndash389
[24] IR Cohen The cognitive paradigm and the immunologhomunculus Immunol Today 13 (1992) 490ndash494
[25] HR Maturna FJ Varela Autopoiesis and cognition D Rdel Dordrecht The Netherlands 1980
[26] AI Tauber Moving beyond the immune self Semin Immnol 12 (2000) 241ndash248
[27] Aristote Cateacutegories chapitre 5[28] J Locke Essai sur lrsquoentendement humain 1690[29] GW Leibniz Nouveaux Essais sur lrsquoentendement humain
1765[30] D Hume Traiteacute de la nature humaine 1739
486 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
le
par-ent
uxs al-ntalent
mblear-urrai raquo
ulede
unelaquo lee leen-en-eacutevi-
oi raquo
gu-cel-ires paibi-es
ledes
et
hy-
uessusiqueaite-rsquoor-
rpreacute-lantpli-sles
lade
arceto-ais
t agraveme
yteir auest
metretidera-t agravereacute-
e lapo-
des
lesineacute-lec-rsquoougrave
-
de contraire Seul reste possible par conseacutequentquatriegraveme sens lrsquooppositionrelative le laquo non-soi raquoest au sens matheacutematique lecompleacutementdu laquo soi raquocar tout eacuteleacutement qui nrsquoappartient pas au laquo soi raquo aptient neacutecessairement au laquo non-soi raquo et reacuteciproquemCependant lrsquoopposition des relatifs doit pouvoir srsquoap-puyer sur un critegravere de distinction clair entre les deensembles compleacutementaires ainsi deacutefinis Or noulons montrer agrave preacutesent gracircce agrave lrsquoexamen expeacuterimeque le laquo soi raquo et le laquo non-soi raquo immunitaires ne peuvpreacuteciseacutement pas ecirctre consideacutereacutes comme des enseexclusifs tout ce qui nrsquoappartient pas agrave lrsquoun apptenant neacutecessairement agrave lrsquoautre Degraves lors on porejeter lrsquoideacutee selon laquelle lrsquoopposition entre le laquo soet le laquo non-soi raquo est drsquoordrerelatif (seul sens retenapregraves lrsquoexamen conceptuel) et donc affirmer queterme mecircme de laquo non-soi raquo immunitaire est deacutenueacutefondement
5 Rejet expeacuterimental du modegravele du soi et dunon-soi
Les deux propositions fondamentales du modegravele dsoi et du non-soi sont (a) laquo le systegraveme immunitairedeacuteclenche pas de reacuteaction contre le soi raquo et (b)systegraveme immunitaire deacuteclenche une reacuteaction contrnon-soi raquo Or toute une seacuterie de donneacutees expeacuterimtales prouvent que ces deux propositions fondamtales sont erroneacutees Commenccedilons par mettre endence lrsquoinexactitude de la premiegravere proposition
51 Inexactitude de la proposition laquo le systegravemeimmunitaire ne deacuteclenche pas de reacuteaction contre s
511 Seacutelection thymique la neacutecessaireautoreacuteactiviteacute non-pathologique et la notion delaquo fenecirctre de reacuteactiviteacute raquo
La seacutelection thymique se situe au cœur de lrsquoarmentation en faveur du modegravele du soi Pour leslules T seul importe le laquo soi peptidique raquo crsquoest-agrave-dlrsquoensemble des peptides seacutelectionneacutes et preacutesenteacuteles moleacutecules du complexe majeur drsquohistocompatliteacute [14] Or les lymphocytes ne sont que lrsquoun dacteurs de lrsquoimmuniteacute Degraves lors est-on certain quemodegravele du soi et du non-soi vaut au-delagrave du caslymphocytes pour tous les acteurs de lrsquoimmuniteacute
s
r
mecircme qursquoil convient pour comprendre la seacutelection tmique en tant que telle Les cellulesnatural killers(NK) par exemple nrsquoont pas de reacutecepteurs speacutecifiqdrsquoun antigegravene preacutecis elles nrsquoont pas subi le procesde seacutelection par geacuteneacuteration de diversiteacute caracteacuteristdes lymphocytes et pourtant elles assurent parfment des fonctions immunitaires indispensables agrave lganisme sans deacuteclencher de reacuteaction contre lui[15]Peut-ecirctre avons-nous eu jusqursquoagrave preacutesent une intetation abusive de la seacutelection lymphocytaire en parde laquo soi raquo et de laquo non-soi raquo alors qursquoavancer une excation en termes drsquointeacutegration de signaux activateuret inhibiteurs permettrait de ne pas opposer celluNK et lymphocytes B et T Lrsquoideacutee selon laquelleseacutelection lymphocytaire assurerait la suppressiontoute autoreacuteactiviteacute est erroneacutee non seulement pqursquoenviron 4 agrave 6 des lymphocytes fortement aureacuteactifs eacutechappent agrave lrsquoeacutelimination dans le thymus maussi et surtout parce que seuls les lymphocytesfaible-ment autoreacuteactifssont seacutelectionneacutes Contrairemence qursquoavance le modegravele du soi et du non-soi et mecircen conservant sa propre terminologie un lymphocpour ecirctre seacutelectionneacute doit non pas ne pas reacuteaglaquo soi raquo mais reacuteagir faiblement au laquo soi raquo Lrsquoenjeudonc la deacutefinition drsquounefenecirctre de reacuteactiviteacute La seacute-lection des lymphocytes pose en effet un problegravedeacutecisif comment dans le thymus lrsquointeraction enun reacutecepteur de lymphocyte T et un complexe pep+ moleacutecule du CMH peut-elle conduire agrave la matution des thymocytes durant la seacutelection positive ela mort cellulaire durant la seacutelection neacutegative Laponse tient sans doute en ceci lrsquoaffiniteacuteet lrsquointensiteacutedes signaux doivent ecirctre diffeacuterentes dans le cas dseacutelection neacutegative et dans le cas de la seacutelectionsitive [16] Par conseacutequent non seulement onpeutramener les notions de laquo soi raquo et de laquo non-soi raquo agravedonneacutees plus claires relatives agrave dessignauxactivateursou inhibiteurs (possibiliteacute largement suggeacutereacutee parcellules NK) mais mecircme ondoit le faire sans quolrsquoon ne pourrait pas comprendre que la seacutelectiongative ne vienne pas tout simplement annuler la seacutetion positive en deacutetruisant toutes les cellules T Dlrsquoideacutee de laquo fenecirctre de reacuteactiviteacute raquo une reacuteactionfaibleinduit la seacutelectionpositive (survie) alors qursquoune reacuteaction forte a pour conseacutequence la seacutelectionneacutegative(mort par apoptose)
T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492 487
onsom-our
des
ourin-rieneacute-eti seme
cep-
in-nteacute
ivegitel-
n-ionresrsquoenunhescel-
antqueageleacuteeor-
nce
yan
dece
ulesim-
raitsoi
ndreca-t lesialeest
tretionu-
tielsrsdes
o-ans
a-le deires lend
ndeon-r du-ouveuneagrave
i-a-ventsoi
ur la
par
512 Lrsquoautoreacuteactiviteacute des lymphocytes dans lesystegraveme peacuteripheacuterique
Reacutecemment il a eacuteteacute montreacute que les interactientre les reacutecepteurs des lymphocytes T et les cplexes CMH + peptide sont aussi fondamentales ple maintiendes cellules T dans les organes lymphoiumlpeacuteripheacuteriques que pour leurseacutelectiondans le thy-mus[17] Loin donc drsquoecirctre seulement essentielles pla seacutelection initiale des lymphocytes T seules cesteractions peuvent garantir leur survie agrave la peacuteripheacuteLe maintien des cellules T naiumlves agrave la peacuteripheacuteriecessite un contactcontinu entre leurs reacutecepteursles complexes CMHndashpeptide Ces interactions quproduisent dans le systegraveme peacuteripheacuterique tout comcelles qui ont lieu dans le thymus engagent les reacuteteurs T et des constituantsendogegravenes(du laquo soi raquo) ilnrsquoy a rien drsquoexogegravene dans la moleacutecule du CMH de lrsquodividu et dans ses propres peptides qui sont preacuteseagrave la surface des cellules de lrsquoorganisme En deacutefinitun lymphocyte T ne se maintient en vie que srsquoil reacuteacontinucircment au laquo soi raquo Ainsi non seulement les clules lymphocytairespeuventreacuteagir au laquo soi raquo mais eoutre elles ne peuvent survivreqursquoenreacuteagissant continucircment au laquosoi raquo Lrsquoautoreacuteactiviteacute est une conditsine qua non de la survie des cellules immunitaiet donc elle se situe au cœur de lrsquoimmuniteacute loin dconstituer comme on lrsquoa cru pendant longtempsessentiel dysfonctionnement Agrave ce titre les rechercreacutecentes sur la genegravese et le fonctionnement deslules T reacutegulatrices (TReg) CD4+CD25+ qui inhibentlrsquoactiviteacute des autres cellules immunitaires permettde mettre fin agrave une reacuteponse immune et drsquoeacuteviterles tissus de lrsquoorganisme ne subissent des dommconseacutecutifs agrave une reacuteponse inflammatoire incontrocircsont venues confirmer les ideacutees drsquoautoreacuteactiviteacute nmale (non pathologique) et de maintien de la toleacuterapeacuteripheacuterique En effet drsquoune part les cellules TReg re-quiegraverent pour ecirctre seacutelectionneacutees un reacutecepteur T aune forte affiniteacute pour un peptide du laquo soi raquo[18] etdrsquoautre part on constate que des souris priveacuteescellules TReg meurent de maladies auto-immunesqui indique que la geacuteneacuteration systeacutematique de cellTReg est indispensable pour maintenir la toleacuterancemunitaire agrave la peacuteripheacuterie[19]
513 Les maladies auto-immunesLrsquoexistence de maladies auto-immunes ne sau
ecirctre en soi un argument contre le modegravele du
s
s
t
puisque celui-ci a preacuteciseacutement eacuteteacute eacutelaboreacute pour recompte de la possibiliteacute et indissociablement duractegravere exceptionnel de telles maladies Cependanmaladies auto-immunes montrent la faiblesse initde la formulation du modegravele degraves le deacutepart il srsquodonneacute pour objectif de deacutemontrer larareteacuteextrecircme delrsquoauto-immuniteacute et non sonimpossibiliteacute admettant lapossibiliteacute des reacuteactions immunitaires dirigeacutees conle laquo soi raquo mais la consideacuterant comme une exceppathologique Or comme nous lrsquoavons souligneacute lrsquoatoreacuteactiviteacute est en fait lrsquoun des fondements essendrsquoun fonctionnement normal de lrsquoimmuniteacute Degraves lonous pouvons dire que lrsquoargument de lrsquoexistencemaladies auto-immunes peut servir de critique du mdegravele du soi et du non-soi agrave condition drsquoecirctre inclus dune reacuteflexion drsquoensemble sur lrsquoautoreacuteactiviteacute Les mladies auto-immunes ne sont pas en rupture radicaprincipe avec lrsquoimmuniteacute normale mais au contraelles sont un dysfonctionnement qui se situe danprolongement de lrsquoimmuniteacute normale (on comprealors lrsquoautoreacuteactiviteacute commesurveillanceet non pluscommeagression)
52 Inexactitude de la proposition laquo le systegravemeimmunitaire deacuteclenche une reacuteaction contre lenon-soi raquo
Pour comprendre agrave preacutesent pourquoi la secoproposition fondamentale du modegravele du soi et du nsoi doit ecirctre remise en cause nous devons particoncept-cleacute detoleacuterance immunitaire La toleacuterance deacutesigne un eacutetat dans lequel un eacuteleacutement exogegravene se trdans un organisme sans pour autant deacuteclencherreacuteaction immunitaire Il srsquoagit donc de laquo non-soi raquolrsquoorigine drsquoune acceptation par le systegraveme immuntaire ce qui va agrave lrsquoencontre de la proposition fondmentale eacutenonceacutee ci-dessus Trois eacuteleacutements prouainsi que la deuxiegraveme proposition du modegravele duest erroneacutee
521 La toleacuterance drsquoagents exogegravenespotentiellement pathogegravenes
Crsquoest le cas par exemple des bacteacuteries situeacutees speau ou dans lrsquointestin
522 La toleacuterance des greffesDans certaines conditions non-pathologiques
exemple la toleacuterance fœto-maternelle on constate
488 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
defreacute-parmi-duegravere
o-er-eacuteeor-reacutesest
tersquoun
deent
cinqnies
elulesdesos-iteacuteel-ansles
les
onsle
on-nc
ee laegravelece
desouson-ent
tiono-ns
eeys-
unecetortelesdeacute-t duseuoi
llo-lle
laec le
im-rsquoilsns
estrsquoestreacute-il y
e il
n-antale)
im-
eser
du
une absence de rejet de greffe[20] Le modegravele dusoi et du non-soi ainsi nrsquoest pas en mesurerendre compte du cas de greffe agrave la fois le plusquent et le plus important celui du fœtus porteacutela megravere Le fœtus en effet est une greffe seallogeacutenique qui est toleacutereacutee bien que la moitieacutepatrimoine geacuteneacutetique de lrsquoenfant soit issue du pet donc soit eacutetrangegravere agrave la megravere En outre le mdegravele du soi est incapable drsquoexpliquer pourquoi ctains organes ndash dits laquo immunoprivileacutegieacutes raquo (la cornpar exemple) ndash sont toleacutereacutes ni pourquoi drsquoautresganes comme le foie sont drsquoautant mieux toleacuteque la diffeacuterence HLA entre donneur et receveurforte
523 Le chimeacuterismeLe chimeacuterisme deacutesigne le fait qursquoun individu por
en lui en faibles quantiteacutes des cellules issues dautre individu Le cas le plus significatif est celuila femme enceinte des cellules du fœtus peuvecirctre deacutetecteacutees chez la megravere au bout drsquoagrave peinesemaines de gestation et jusqursquoagrave plusieurs deacutecenapregraves lrsquoaccouchement[21] Le chimeacuterisme deacutesigneacutegalement le cas des enfants qui portent des celde leur megravere et le cas drsquoun faux jumeau portantcellules de son fregravere Le chimeacuterisme prouve la psibiliteacute drsquoun laquo partage raquo du laquo soi raquo voire la possibilpour le laquo non-soi raquo drsquoecirctre constitutif du laquo soi raquo Les clules chimeacuteriques au lieu de rester laquo endormies raquo dlrsquoorganisme peuvent mecircme se diffeacuterencier en cellutumorales[22] voire peut-ecirctrefonctionnelles(deve-nant par exemple des cellules du foie des cellude la peau etc)
De lrsquoensemble de ces observations nous pouvconclure ceci contrairement agrave ce que postulemodegravele du laquo soi raquo les cateacutegories drsquoimmunogegraveneetdrsquoexogegravenene sont pas confondues Degraves lors le laquo nsoi raquo nrsquoest pas le compleacutement du laquo soi raquo et dolrsquoopposition dans le terme laquonon-soi raquo est deacutenueacutede sens Crsquoest par conseacutequent lrsquoensemble ddialectique du soi et du non-soi au cœur du modinitieacute par Burnet qui srsquoavegravere inadeacutequate puisquemodegravele eacutechoue agrave deacutefinir la limitation de chacundeux concepts Si ce raisonnement est exact npouvons en deacuteduire que le modegravele du soi et du nsoi est impropre agrave rendre compte du fonctionnemde lrsquoimmuniteacute
6 Pour un autre modegravele theacuteorique enimmunologie la continuiteacute spatio-temporelle
Nous tentons ici de proposer une autre orientatheacuteorique ndash imparfaite et provisoire ndash pour lrsquoimmunlogie Le critegravere drsquoimmunogeacuteniciteacute que nous mettoen avant est celui de lacontinuiteacute spatio-temporellequi srsquoappuie sur la deacutefinition de lrsquoimmuniteacute commsystegravemeeneacutequilibre La proposition fondamentale dlrsquohypothegravese de la continuiteacute est la suivante le stegraveme immunitaire reacuteagit agrave ce quirompt la continuiteacuteentre les reacutecepteurs des acteurs de lrsquoimmuniteacute drsquopart et les motifs antigeacuteniques drsquoautre part (queantigegravene soit endogegravene ou exogegravene) Seule impautrement dit la continuiteacute spatio-temporelle entrecomposants immunitaires et leurs cibles le critegravereterminant nrsquoeacutetant pas de savoir si ces cibles sonlaquo soi raquo ou du laquo non-soi raquo Ainsi selon cette hypothegravele systegraveme immunitaire ne reacuteagit pas agrave ce avec qil est en contact continu(et agrave partir de quoi il a eacuteteacuteseacutelectionneacute) alors qursquoil reacuteagit agrave ce qui vientbriserla continuiteacute(un motif antigeacutenique jamais rencontreacutebacteacuterie virus organe comme dans le cas drsquoune agreffe etc) et donc la distinction pertinente est ceentrecontinuiteacuteet rupture de continuiteacute et non la dis-tinction entre laquo soi raquo et laquo non-soi raquo Ce critegravere decontinuiteacute demande agrave ecirctre penseacute en correacutelation avconcept deressemblance Il srsquoagit drsquoune continuiteacute agrave lafois spatiale et temporelle tant que les reacutecepteursmunitaires continuent de reacuteagir aussi faiblement qulrsquoont fait jusqursquoici avec les antigegravenes preacutesents dalrsquoorganisme aucune reacuteaction immunitaire forte nrsquodeacuteclencheacutee Ce qui provoque une reacuteaction forte cla nouveauteacute crsquoest-agrave-dire le laquo jamais vu raquo pour lescepteurs de lrsquoimmuniteacute et crsquoest dans ce cas-lagrave qursquoa rupture de continuiteacute
Le point de deacutepart de cette hypothegravese est doublrepose sur lrsquoideacutee decommencementde lrsquoimmuniteacute etsur lrsquoideacutee drsquoautoreacuteactiviteacutecomme auto-reconnaissace Premiegraverement il existe initialement (soit pendla peacuteriode fœtale soit pendant la peacuteriode post-natpour chaque organisme une peacuteriode de toleacuterancemunitaire ce qui indique que lrsquoimmuniteacute a uncom-mencement Ce qui estpreacutesentau moment de cettseacutelection fondatricene deacuteclenchera pas de reacuteponimmune Deuxiegravemement lrsquoautoreacuteactiviteacute est au cœude lrsquoimmuniteacute normale le bon fonctionnementsystegraveme immunitaire repose sur uneseacutelection conti-
T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492 489
tre
er-niteacute
st-on-nir
eacuteestionnqtion
f-
tionles
el-s leca-lulesdeo-
rsquoilsme
ssimeeacute-
ap-
on
iiso-onc-resla
gu--rup-fsxo-(parle
agrave
onc-el-ncecel-turereacute-ent
medegraves
esdi-sonoi raquoeacuteesle
nti-
anti-ro-
ma-nti-aceinslaiteacuteionour
uelseauffet duam-eanse
tion
nue puisque pour survivre un lymphocyte doit ecircreacuteguliegraverementstimuleacute par des antigegravenesendogegravenes(a priori non pathogegravenes) Lrsquoorganisme doit en pmanence assurer pour lui-mecircme une auto-immucontenue et continue
En quoi un modegravele insistant sur la continuiteacute eil plus satisfaisant que le modegravele du soi et du nsoi Lagrave ougrave le modegravele du soi est contraint de deacutefide multiplesexceptions lrsquohypothegravese de la continuitse veut unificatrice capable de rassembler toutles observations connues sous une mecircme explicaNous consideacuterons ainsi qursquoil y a pour lrsquoessentiel cidomaines qui montrent la supeacuterioriteacute drsquoune concepde ce type
(1) Lrsquoauto-immuniteacute Lrsquohypothegravese de la continuiteacute afirme qursquoil nrsquoy a pas de diffeacuterence deprincipeentre une reacuteaction auto-immune et une reacuteacimmunitaire visant un antigegravene exogegravene dansdeux cas il se produit unerupture de continuiteacutelieacutee agrave une modification de ce avec quoi les clules immunitaires se trouvent en contact Dancas des maladies auto-immunes il y a modifition des peptides preacutesenteacutes agrave la surface des celde lrsquoorganisme ce qui aboutit agrave une rupturecontinuiteacute alors mecircme que les peptides ainsi mdifieacutes restent du laquo soi raquo preacuteciseacutement parce qusont issus du mateacuteriel geacuteneacutetique de lrsquoorganisconsideacutereacute
(2) Les cancers Les cellules canceacutereuses elles ausont issues du mateacuteriel geacuteneacutetique de lrsquoorganiset donc sont du laquo soi raquo mais les motifs antigniques agrave leur surface brisent la continuiteacute par rport agrave des tissus sains
(3) Le prolongement entre immuniteacute et reacutegulatidrsquoensemble de lrsquoorganismeContrairement agrave ceque lrsquoimmunologie contemporaine a fait jusqursquoiclrsquohypothegravese de la continuiteacute permet de ne pasler dans lrsquoorganisme les agents assurant des ftions dedeacutefense des agents responsables drsquoautfonctions Lrsquoimmuniteacute est selon lrsquohypothegravese decontinuiteacute seulement lrsquoune des activiteacutes de reacutelation de lrsquoorganisme Ainsi lrsquoactiviteacute drsquoun macrophage par exemple est deacutetermineacutee par lature de continuiteacute entre ses reacutecepteurs et les motiavec lesquels il reacuteagit que ceux-ci soient egegravenes (bacteacuterie par exemple) ou endogegravenesexemple dans le cas drsquoune cellule morte que
macrophage doit ingeacuterer) donc il nrsquoy a pasenvisager pour le macrophagedeux tacircches dis-tinctes comme le fait le modegravele du soi (fonctidrsquolaquoeacuteboueur raquo de lrsquoorganisme drsquoune part fontion immune drsquoautre part) De mecircme les clules TReg ne sont pas stimuleacutees par la preacutesede laquo non-soi raquo puisqursquoelles reacuteagissent agrave deslules immunitaires endogegravenes mais par la rupde continuiteacute exprimeacutee preacuteciseacutement par lescepteurs des cellules immunitaires qui constituleur cible
(4) Les cas de toleacuterance immunitaire La continuiteacuterend compte de lrsquoeacutetat drsquoeacutequilibre qui srsquoeacutetablitentre lrsquoindividu et des agents pathogegravenes comles bacteacuteries sur la peau On constate queqursquoapparaicirct un deacuteficit immunitaire ces bacteacuteriqui jusque-lagrave eacutetaient sans effet neacutegatif sur lrsquoinvidu concerneacute provoquent des dommages agraveencontre Le critegravere nrsquoest donc pas celui du laquo set du laquo non-soi raquo puisque les bacteacuteries concernsont tout autant du laquo non-soi raquo avant qursquoapregravesdeacuteficit immunitaire mais bien larupture de conti-nuiteacutedans les interactions reacutecepteurs-motifs ageacuteniques
(5) Les meacutecanismes drsquoinduction drsquoune toleacuterance Mecirc-me dans le systegraveme immunitairemature on cons-tate parfois une absence de reacuteaction agrave desgegravenes avec lesquels lrsquoindividu est en contact plongeacute Il est difficile de deacuteterminer lescritegraveresdecette induction de toleacuterance puisque dans lajoriteacute des cas apregraves le premier contact avec lrsquoagegravene une reacuteponse immunitaire rapide et efficse deacuteclenche au deuxiegraveme contact Neacuteanmoil existe plusieurs meacutecanismes drsquoinduction detoleacuterance dont seule lrsquohypothegravese de la continusemble pouvoir rendre compte deacutesensibilisatdans le cas des allergies toleacuterance provisoire pcertains antigegravenes du pegravere apregraves la grossesse[21]toleacuterance pour certains pathogegravenes avec lesqon est en contact prolongeacute (bacteacuteries de la pde lrsquointestin) toleacuterance plus probable drsquoune gredrsquoorgane apregraves transfusion sanguine provenanmecircme donneur drsquoorgane etc Cela permet notment drsquoarticuler lacontinuiteacute avec les eacutetats dsymbiose les nombreuses bacteacuteries situeacutees dnotre intestin facilitent la digestion et de mecircmles bacteacuteries sur notre peau assurent lrsquoeacutelimina
490 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
se-
aisreacute-ffeonthy-nceire
quemeso-
vantttreonttiondit
euxaisionen-
sursene deques Ellau raquo
a-
eacuteo-en
u-nsheacuteo-tionis-quei-
sesce
ent
s a
queuto-
si-ous
n-Lemes
titeacuteoutge-
lo-
o-eacute
n-eacute-
ionsmet cardonc
en-iteacutehegravesesde-
up-sub-vec
y-tre-com-
drsquoautres pathogegravenes qui pour leur part cauraient des dommages agrave lrsquoorganisme
Une autogreffe ou une greffe entre jumeaux vrbien qursquoelles semblent rompre la continuiteacute entrecepteurs et motifs antigeacuteniques puisque lrsquoon grepar exemple un tissu agrave la place drsquoun autre tissu stoleacutereacutees ce qui paraicirct constituer une objection agrave lrsquopothegravese de la continuiteacute Cependant cette toleacuterasrsquoexplique par le fait que pour le systegraveme immunitareceveur il nrsquoy a pas de rupture de continuiteacute puisles reacuteactions reacutecepteursndashantigegravenes restent les mecirceacutetant donneacute qursquoil nrsquoy a aucune diffeacuterence dans les mtifs antigeacuteniques et donc dans les signaux eacutemis aet apregraves la greffe De faccedilon similaire on peut eacutemelrsquohypothegravese que ce qui fait que certaines greffes smieux toleacutereacutees que drsquoautres ce nrsquoest pas la distincsoinon-soi (conformeacutement agrave ce que nous avonscertains organes comme le foie sont drsquoautant mitoleacutereacutes qursquoils sont diffeacuterents de lrsquoorgane hocircte) mla plus grande continuiteacute dans lrsquoactiviteacute de stimulatdes agents immunitaires Ce qui importe crsquoest bientendu la continuiteacutepour les cellules immunitaires etnon la continuiteacutepour nous
Les avantages de lrsquohypothegravese de la continuiteacutele modegravele du soi tels que nous venons de les preacuteter nous permettent de preacuteciser quelle est la placcette hypothegravese au sein des theacuteories immunologiproposeacutees au cours des trente derniegraveres anneacuteessrsquoappuie incontestablement sur la theacuteorie du laquo reacuteseimmunitaire apparue chez Jerne[23] puis deacuteveloppeacuteesous la forme de la reacutegulation de lrsquoauto-immuniteacute nturelle ouimmunological homunculus[24] ainsi quesous le terme controverseacute drsquoautopoiesis[25] Lrsquohy-pothegravese de la continuiteacute a en commun avec les thries du reacuteseau lrsquoideacutee qursquoune reacuteaction immune estfait uneperturbation du systegraveme[26] crsquoest-agrave-dire unemodification du comportement que le systegraveme immnitaire a eu jusqursquoici (laquo rupture de continuiteacute raquo dale cadre de notre hypothegravese) Cependant les tries du reacuteseau immunitaire proposent une concepclosede lrsquoimmuniteacute selon ses promoteurs si la dtinction soinon-soi est insatisfaisante crsquoest parcele systegraveme immunitaire nrsquoa jamais affaire qursquoagrave lumecircme[24] Agrave lrsquoopposeacute lrsquohypothegravese de la continuiteacutedonne pour objectif drsquoouvrir le systegraveme comme noulrsquoavons vu avec les cas drsquoinduction drsquoune toleacuteranimmunitaire Lrsquohypothegravese de la continuiteacute autrem
-
e
dit srsquoefforce de comprendre comment des entiteacutepriori distinctes de lrsquoorganisme peuventsrsquointeacutegrer agravelui (processus drsquoouverture et de toleacuterance) alorsles theacuteories du reacuteseau insistent sur la clocircture et lrsquoadeacutefinition de lrsquoimmuniteacute
7 Identiteacute immunitaire et identiteacute philosophique
Lrsquohypothegravese de la continuiteacute nous eacuteloigne condeacuterablement du modegravele du soi mais elle ne neacuteloigne pas pour autant de la question de lrsquoidentiteacuteNotre conviction est qursquoil est possible de penser lrsquoidetiteacute biologique sans la deacutefinir comme un laquo soi raquoconcept philosophique drsquoidentiteacute repose sur les terlatins idem (fait drsquoecirctre identique agrave soi ideacutee deper-manencedans le temps) etipse (fait de demeurer lemecircme tout en changeant partiellement il y aeacutevolu-tion dans le temps) drsquoun cocircteacute nous avons lrsquoidenimmuable dans le temps et de lrsquoautre lrsquoideacutee que tecirctre reste le mecircme tout en accueillant en lui le chanment Cette distinction rejoint la probleacutematique phisophique de lasubstance la substance est uninvariantsusceptible drsquoecirctre pour chaque individu lesupportdetoutes lesvariations[27] Deux grandes thegraveses philsophiques srsquoaffrontent sur la question de lrsquoidentitla premiegravere deacutefinit lrsquoidentiteacute par lasubstance tandisque la seconde deacutefinit lrsquoidentiteacute par lacontinuiteacute Se-lon la premiegravere thegravese ce qui fait lrsquoidentiteacute drsquoun idividu crsquoest la substance crsquoest-agrave-dire le support mtaphysique de toutes ses deacuteterminations et variatSelon la deuxiegraveme thegravese agrave lrsquoopposeacute rien ne perde preacutesupposer qursquoil existe une telle laquo substance raquocette substance est par deacutefinition inaccessible etlrsquoidentiteacute repose seulement sur lacontinuiteacutedans letemps continuiteacute des changements physiques oucore concernant lrsquoidentiteacute psychologique continudes eacutetats de conscience Le deacutebat entre ces deux tphilosophiques pourrait ecirctre illustreacute par les figuresLocke[28] et de Leibniz[29] La conception substantialiste de lrsquoidentiteacute consiste agravesupposerplus que laconception fondeacutee sur la continuiteacute (ce que lrsquoon spose en plus crsquoest preacuteciseacutement un laquo noyau raquo destantialiteacute) Or on peut agrave bon droit ecirctre drsquoaccord ale soupccedilon de Locke renforceacute par Hume[30] puisquela substanceest en elle-mecircme un noyau meacutetaphsique inatteignable pourquoi la preacutesupposer Aument dit si on peut se passer de la substance pour
T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492 491
eacute--parsesutuisuesyer
degraveler il
unuedu
-
-rerionpar
deplecele
voirneors
etezper-du
po-quiiegrave-net re-s aus
euxvec
gielleenrsquoest
soiqueeacute
en-me
en-pasni-reacute-isnti-rsn-r en-
os--
que)s
pourpreacute-me
ienge
c-
nse-
ow2)
elf12
prendre lrsquoidentiteacute pourquoi y ferait-on appel La dmarche de Locke relegraveve alors de ladeacuteflation meacutetaphysique si un mecircme pheacutenomegravene peut ecirctre expliqueacutedeux modegraveles dont lrsquoun repose sur moins drsquohypothegraveque lrsquoautre alors crsquoest le modegravele minimal qursquoil vamieux adopter Lrsquoimmunologie est au moins deples anneacutees 1940 peacutetrie de concepts philosophiqNotre rocircle devrait ecirctre dans ces conditions drsquoessadrsquoaccorder agrave ces concepts leur juste place Le modu soi se situe du cocircteacute de lrsquoidentiteacute-substance catente de deacutefinir lrsquoidentiteacute de lrsquoorganisme commenoyau substantiel dont lrsquointeacutegriteacute doit ecirctre deacutefendtandis que lrsquohypothegravese de la continuiteacute se rangecocircteacute de lrsquoidentiteacute-continuiteacute Lrsquohypothegravese de la continuiteacute par conseacutequent constitue une propositionphi-losophiquepour limiter lrsquousage des concepts philosophiques en immunologie elle srsquoefforce de reacuteiteacutedans le domaine propre de lrsquoimmunologie la deacuteflatmeacutetaphysique que lrsquoidentiteacute-continuiteacute repreacutesenterapport agrave lrsquoidentiteacute-substance
Une question cependant surgit ici lrsquohypothegravesela continuiteacute nrsquoest-elle pas finalement qursquoune simreformulation du modegravele du soi Ne dit-elle pasque les immunologistes ont toujours dit Nous nepensons pas Rien bien entendu nrsquoempecircche delrsquohypothegravese de la continuiteacute simplement comme uconception renouveleacutee du laquo soi raquo On affirmerait alseulement qursquoil srsquoagit dans ce cas dusoi compriscomme continuiteacute (comme chez Locke ou Hume)non dusoi compris comme substance (comme chLeibniz) Cette suggestion est seacuteduisante car ellemettrait une fois encore de laquo sauver raquo le modegravelesoi et du non-soi Neacuteanmoins premiegraverement lrsquohythegravese de la continuiteacute explique des pheacutenomegraveneseacutetaient mal expliqueacutes par le modegravele du soi Deuxmement et surtout faire de lrsquoidentiteacute-continuiteacute uconception renouveleacutee du laquo soi raquo serait preacuteciseacutementomber dans lrsquoerreur qui consiste en ayant recourterme trop large desoi agrave recouvrir deux significationbien distinctes lasubstanceet lacontinuiteacute Parler delaquo soi raquo crsquoest se condamner agrave ne pas distinguer les dsens agrave passer de lrsquoun agrave lrsquoautre sans justification ale risque de tout laquo substantialiser raquo en immunoloOn pourrait donc accepter lrsquoobjection selon laquece que lrsquoon propose nrsquoest qursquoune redeacutefinition du soiimmunologie mais ce que lrsquoon ne peut accepter clrsquoideacutee que le terme desoi doit ecirctre conserveacute
8 Conclusion philosophie de lrsquoidentiteacutebiologique
Quelles questions pose lrsquoanalyse du modegravele duet du non-soi pour une compreacutehension philosophide la deacutefinition biologique de lrsquoidentiteacute Lrsquoidentitbiologique pour tout ecirctre vivant deacutesignece qursquoil estbiologiquement crsquoest-agrave-dire son uniciteacute et sa diffeacuterciation spatiale Nous avons montreacute que le systegraveimmunitaire constituait bien une sorte de carte drsquoidtiteacute de lrsquoorganisme mais que cette identiteacute nrsquoeacutetaitclose agrave toute influence exteacuterieure lrsquoidentiteacute immutaire nrsquoest pas deacutefinie agrave partir drsquoun ensemble deactions de deacutefense agrave toutesles entiteacutes exogegravenes made maniegravere continuiste crsquoest-agrave-dire comme la conuiteacute spatio-temporelle des reacuteactions entre reacutecepteude lrsquoimmuniteacute et motifs antigeacuteniques (qursquoils soient edogegravenes ou exogegravenes) Degraves lors peut se dessineparticulier agrave partir de lrsquoideacutee drsquoinduction de la toleacuterance immunitaire une reacuteflexion eacutelargie sur la psibiliteacute de deacutefinir lrsquoidentiteacute biologique (agrave la fois pheacutenotypique et en amont geacuteneacutetique ou para-geacuteneacuteticomme une identiteacuteouverte articulant agrave la fois deeacuteleacutements endogegravenes et des eacuteleacutements exogegravenesdeacuteterminer en derniegravere instance le propre toujourscaire et toujours combineacute (laquo impur raquo) drsquoun organisvivant donneacute
Remerciements
Nous remercions pour leur aide et leur soutAnouk Barberousse Claude Debru Michel MoranJean Gayon Ceacutedric Brun et Hannah-Louise Clark
Reacutefeacuterences
[1] FM Burnet F Fenner The Production of Antibodies Mamillan Melbourne 1941 2e eacutedition en 1949
[2] MS Anderson ES Venanzi L Klein Z Chen SP BerziSJ Turley H von Boehmer R Bronson A Dierich C Bnoist D Mathis Projection of an Immunological Self ShadWithin the Thymus by the Aire Protein Science 298 (2001395ndash1401
[3] RE Langman M Cohn A minimal model for the self-nonsdiscrimination a return to the basics Semin Immunol(2000) 189ndash195
492 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
self
uil
ty
ofd
de
-
aelf
rrs
ha8
Ho-nlf-
f6
-G
odSci
itet
em
ical
ei-
u-
[4] P Matzinger The danger model a renewed sense ofScience 296 (2002) 301ndash305
[5] J Bernard M Bessis C Debru (dir) Soi et non-soi SeParis 1990
[6] FM Burnet Changing Patterns An Atypical AutobiographyHeinemann Melbourne 1968
[7] M Morange La part des gegravenes Odile Jacob Paris 1998[8] FM Burnet The Integrity of the Body Harvard Universi
Press Cambridge 1962[9] AI Tauber L Chernyak Metchnikoff and the Origins
Immunology Oxford University Press New York Oxfor1991
[10] A-M Moulin Le dernier langage de la meacutedecine ndash histoirelrsquoimmunologie de Pasteur au Sida PUF Paris 1991
[11] AI Tauber The Immune Self Theory or metaphor Cambridge University Press Cambridge 1994
[12] Aristote Cateacutegories Vrin Paris 1994 chapitres 10 et 11[13] Aristote Cateacutegories chapitre 5 3b22ndash33[14] P Kourilsky J-M Claverie The peptidic self model
hypothesis on the molecular nature of the immunological sAnn Immunol 137 (1986) 3ndash21
[15] DH Raulet RE VanceCW McMahon Regulation of thenatural killer cell receptor repertoire Annu Rev Immunol 19(2001) 291ndash330
[16] PG Ashton-Rickardt A Bandeira JR Delaney L Van KaeHP Pircher RM Zinkernagel S Tonegawa Evidence foa differential avidity model of T-cell selection in the thymuCell 76 (1994) 651ndash663
[17] C Tanchot B Lemonnier A Perarnau A Freitas B RocDifferential requirements for survival and proliferation of CDnaive or memory T cells Science 276 (1997) 2057ndash2062
[18] MS Jordan A Boesteanu AJ Reed AL Petrone AElenbeck MA Lerman A Naji AJ Caton Thymic selectioof CD4+CD25+ regulatory T cells induced by an agonist sepeptide Nat Immunol 2 (2001) 301ndash306
[19] Z Feheacutervari S Sakaguchi Development and function oCD25+CD4+ regulatory T cells Curr Opin Immunol 1(2004) 203ndash208
[20] ED Carosella N Rouas-Freiss P Paul J Dausset HLAa tolerance molecule from themajor histocompatibility com-plex Immunol Today 20 (1999) 60ndash62
[21] DW Bianchi GK Zickwolf GJ Weil S Sylvester MADeMaria Male fetal progenitor cells persist in maternal blofor as long as 27 years postpartum Proc Natl AcadUSA 93 (1996) 705ndash708
[22] D Cha K Khosrotehrani Y Kim H Stroh DW BianchKL Johnson Cervical cancer and microchimerism ObsGynecol 102 (2003) 774ndash781
[23] NK Jerne Towards a network theory of the immune systAnn Immunol 125 C (1974) 373ndash389
[24] IR Cohen The cognitive paradigm and the immunologhomunculus Immunol Today 13 (1992) 490ndash494
[25] HR Maturna FJ Varela Autopoiesis and cognition D Rdel Dordrecht The Netherlands 1980
[26] AI Tauber Moving beyond the immune self Semin Immnol 12 (2000) 241ndash248
[27] Aristote Cateacutegories chapitre 5[28] J Locke Essai sur lrsquoentendement humain 1690[29] GW Leibniz Nouveaux Essais sur lrsquoentendement humain
1765[30] D Hume Traiteacute de la nature humaine 1739
T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492 487
onsom-our
des
ourin-rieneacute-eti seme
cep-
in-nteacute
ivegitel-
n-ionresrsquoenunhescel-
antqueageleacuteeor-
nce
yan
dece
ulesim-
raitsoi
ndreca-t lesialeest
tretionu-
tielsrsdes
o-ans
a-le deires lend
ndeon-r du-ouveuneagrave
i-a-ventsoi
ur la
par
512 Lrsquoautoreacuteactiviteacute des lymphocytes dans lesystegraveme peacuteripheacuterique
Reacutecemment il a eacuteteacute montreacute que les interactientre les reacutecepteurs des lymphocytes T et les cplexes CMH + peptide sont aussi fondamentales ple maintiendes cellules T dans les organes lymphoiumlpeacuteripheacuteriques que pour leurseacutelectiondans le thy-mus[17] Loin donc drsquoecirctre seulement essentielles pla seacutelection initiale des lymphocytes T seules cesteractions peuvent garantir leur survie agrave la peacuteripheacuteLe maintien des cellules T naiumlves agrave la peacuteripheacuteriecessite un contactcontinu entre leurs reacutecepteursles complexes CMHndashpeptide Ces interactions quproduisent dans le systegraveme peacuteripheacuterique tout comcelles qui ont lieu dans le thymus engagent les reacuteteurs T et des constituantsendogegravenes(du laquo soi raquo) ilnrsquoy a rien drsquoexogegravene dans la moleacutecule du CMH de lrsquodividu et dans ses propres peptides qui sont preacuteseagrave la surface des cellules de lrsquoorganisme En deacutefinitun lymphocyte T ne se maintient en vie que srsquoil reacuteacontinucircment au laquo soi raquo Ainsi non seulement les clules lymphocytairespeuventreacuteagir au laquo soi raquo mais eoutre elles ne peuvent survivreqursquoenreacuteagissant continucircment au laquosoi raquo Lrsquoautoreacuteactiviteacute est une conditsine qua non de la survie des cellules immunitaiet donc elle se situe au cœur de lrsquoimmuniteacute loin dconstituer comme on lrsquoa cru pendant longtempsessentiel dysfonctionnement Agrave ce titre les rechercreacutecentes sur la genegravese et le fonctionnement deslules T reacutegulatrices (TReg) CD4+CD25+ qui inhibentlrsquoactiviteacute des autres cellules immunitaires permettde mettre fin agrave une reacuteponse immune et drsquoeacuteviterles tissus de lrsquoorganisme ne subissent des dommconseacutecutifs agrave une reacuteponse inflammatoire incontrocircsont venues confirmer les ideacutees drsquoautoreacuteactiviteacute nmale (non pathologique) et de maintien de la toleacuterapeacuteripheacuterique En effet drsquoune part les cellules TReg re-quiegraverent pour ecirctre seacutelectionneacutees un reacutecepteur T aune forte affiniteacute pour un peptide du laquo soi raquo[18] etdrsquoautre part on constate que des souris priveacuteescellules TReg meurent de maladies auto-immunesqui indique que la geacuteneacuteration systeacutematique de cellTReg est indispensable pour maintenir la toleacuterancemunitaire agrave la peacuteripheacuterie[19]
513 Les maladies auto-immunesLrsquoexistence de maladies auto-immunes ne sau
ecirctre en soi un argument contre le modegravele du
s
s
t
puisque celui-ci a preacuteciseacutement eacuteteacute eacutelaboreacute pour recompte de la possibiliteacute et indissociablement duractegravere exceptionnel de telles maladies Cependanmaladies auto-immunes montrent la faiblesse initde la formulation du modegravele degraves le deacutepart il srsquodonneacute pour objectif de deacutemontrer larareteacuteextrecircme delrsquoauto-immuniteacute et non sonimpossibiliteacute admettant lapossibiliteacute des reacuteactions immunitaires dirigeacutees conle laquo soi raquo mais la consideacuterant comme une exceppathologique Or comme nous lrsquoavons souligneacute lrsquoatoreacuteactiviteacute est en fait lrsquoun des fondements essendrsquoun fonctionnement normal de lrsquoimmuniteacute Degraves lonous pouvons dire que lrsquoargument de lrsquoexistencemaladies auto-immunes peut servir de critique du mdegravele du soi et du non-soi agrave condition drsquoecirctre inclus dune reacuteflexion drsquoensemble sur lrsquoautoreacuteactiviteacute Les mladies auto-immunes ne sont pas en rupture radicaprincipe avec lrsquoimmuniteacute normale mais au contraelles sont un dysfonctionnement qui se situe danprolongement de lrsquoimmuniteacute normale (on comprealors lrsquoautoreacuteactiviteacute commesurveillanceet non pluscommeagression)
52 Inexactitude de la proposition laquo le systegravemeimmunitaire deacuteclenche une reacuteaction contre lenon-soi raquo
Pour comprendre agrave preacutesent pourquoi la secoproposition fondamentale du modegravele du soi et du nsoi doit ecirctre remise en cause nous devons particoncept-cleacute detoleacuterance immunitaire La toleacuterance deacutesigne un eacutetat dans lequel un eacuteleacutement exogegravene se trdans un organisme sans pour autant deacuteclencherreacuteaction immunitaire Il srsquoagit donc de laquo non-soi raquolrsquoorigine drsquoune acceptation par le systegraveme immuntaire ce qui va agrave lrsquoencontre de la proposition fondmentale eacutenonceacutee ci-dessus Trois eacuteleacutements prouainsi que la deuxiegraveme proposition du modegravele duest erroneacutee
521 La toleacuterance drsquoagents exogegravenespotentiellement pathogegravenes
Crsquoest le cas par exemple des bacteacuteries situeacutees speau ou dans lrsquointestin
522 La toleacuterance des greffesDans certaines conditions non-pathologiques
exemple la toleacuterance fœto-maternelle on constate
488 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
defreacute-parmi-duegravere
o-er-eacuteeor-reacutesest
tersquoun
deent
cinqnies
elulesdesos-iteacuteel-ansles
les
onsle
on-nc
ee laegravelece
desouson-ent
tiono-ns
eeys-
unecetortelesdeacute-t duseuoi
llo-lle
laec le
im-rsquoilsns
estrsquoestreacute-il y
e il
n-antale)
im-
eser
du
une absence de rejet de greffe[20] Le modegravele dusoi et du non-soi ainsi nrsquoest pas en mesurerendre compte du cas de greffe agrave la fois le plusquent et le plus important celui du fœtus porteacutela megravere Le fœtus en effet est une greffe seallogeacutenique qui est toleacutereacutee bien que la moitieacutepatrimoine geacuteneacutetique de lrsquoenfant soit issue du pet donc soit eacutetrangegravere agrave la megravere En outre le mdegravele du soi est incapable drsquoexpliquer pourquoi ctains organes ndash dits laquo immunoprivileacutegieacutes raquo (la cornpar exemple) ndash sont toleacutereacutes ni pourquoi drsquoautresganes comme le foie sont drsquoautant mieux toleacuteque la diffeacuterence HLA entre donneur et receveurforte
523 Le chimeacuterismeLe chimeacuterisme deacutesigne le fait qursquoun individu por
en lui en faibles quantiteacutes des cellules issues dautre individu Le cas le plus significatif est celuila femme enceinte des cellules du fœtus peuvecirctre deacutetecteacutees chez la megravere au bout drsquoagrave peinesemaines de gestation et jusqursquoagrave plusieurs deacutecenapregraves lrsquoaccouchement[21] Le chimeacuterisme deacutesigneacutegalement le cas des enfants qui portent des celde leur megravere et le cas drsquoun faux jumeau portantcellules de son fregravere Le chimeacuterisme prouve la psibiliteacute drsquoun laquo partage raquo du laquo soi raquo voire la possibilpour le laquo non-soi raquo drsquoecirctre constitutif du laquo soi raquo Les clules chimeacuteriques au lieu de rester laquo endormies raquo dlrsquoorganisme peuvent mecircme se diffeacuterencier en cellutumorales[22] voire peut-ecirctrefonctionnelles(deve-nant par exemple des cellules du foie des cellude la peau etc)
De lrsquoensemble de ces observations nous pouvconclure ceci contrairement agrave ce que postulemodegravele du laquo soi raquo les cateacutegories drsquoimmunogegraveneetdrsquoexogegravenene sont pas confondues Degraves lors le laquo nsoi raquo nrsquoest pas le compleacutement du laquo soi raquo et dolrsquoopposition dans le terme laquonon-soi raquo est deacutenueacutede sens Crsquoest par conseacutequent lrsquoensemble ddialectique du soi et du non-soi au cœur du modinitieacute par Burnet qui srsquoavegravere inadeacutequate puisquemodegravele eacutechoue agrave deacutefinir la limitation de chacundeux concepts Si ce raisonnement est exact npouvons en deacuteduire que le modegravele du soi et du nsoi est impropre agrave rendre compte du fonctionnemde lrsquoimmuniteacute
6 Pour un autre modegravele theacuteorique enimmunologie la continuiteacute spatio-temporelle
Nous tentons ici de proposer une autre orientatheacuteorique ndash imparfaite et provisoire ndash pour lrsquoimmunlogie Le critegravere drsquoimmunogeacuteniciteacute que nous mettoen avant est celui de lacontinuiteacute spatio-temporellequi srsquoappuie sur la deacutefinition de lrsquoimmuniteacute commsystegravemeeneacutequilibre La proposition fondamentale dlrsquohypothegravese de la continuiteacute est la suivante le stegraveme immunitaire reacuteagit agrave ce quirompt la continuiteacuteentre les reacutecepteurs des acteurs de lrsquoimmuniteacute drsquopart et les motifs antigeacuteniques drsquoautre part (queantigegravene soit endogegravene ou exogegravene) Seule impautrement dit la continuiteacute spatio-temporelle entrecomposants immunitaires et leurs cibles le critegravereterminant nrsquoeacutetant pas de savoir si ces cibles sonlaquo soi raquo ou du laquo non-soi raquo Ainsi selon cette hypothegravele systegraveme immunitaire ne reacuteagit pas agrave ce avec qil est en contact continu(et agrave partir de quoi il a eacuteteacuteseacutelectionneacute) alors qursquoil reacuteagit agrave ce qui vientbriserla continuiteacute(un motif antigeacutenique jamais rencontreacutebacteacuterie virus organe comme dans le cas drsquoune agreffe etc) et donc la distinction pertinente est ceentrecontinuiteacuteet rupture de continuiteacute et non la dis-tinction entre laquo soi raquo et laquo non-soi raquo Ce critegravere decontinuiteacute demande agrave ecirctre penseacute en correacutelation avconcept deressemblance Il srsquoagit drsquoune continuiteacute agrave lafois spatiale et temporelle tant que les reacutecepteursmunitaires continuent de reacuteagir aussi faiblement qulrsquoont fait jusqursquoici avec les antigegravenes preacutesents dalrsquoorganisme aucune reacuteaction immunitaire forte nrsquodeacuteclencheacutee Ce qui provoque une reacuteaction forte cla nouveauteacute crsquoest-agrave-dire le laquo jamais vu raquo pour lescepteurs de lrsquoimmuniteacute et crsquoest dans ce cas-lagrave qursquoa rupture de continuiteacute
Le point de deacutepart de cette hypothegravese est doublrepose sur lrsquoideacutee decommencementde lrsquoimmuniteacute etsur lrsquoideacutee drsquoautoreacuteactiviteacutecomme auto-reconnaissace Premiegraverement il existe initialement (soit pendla peacuteriode fœtale soit pendant la peacuteriode post-natpour chaque organisme une peacuteriode de toleacuterancemunitaire ce qui indique que lrsquoimmuniteacute a uncom-mencement Ce qui estpreacutesentau moment de cettseacutelection fondatricene deacuteclenchera pas de reacuteponimmune Deuxiegravemement lrsquoautoreacuteactiviteacute est au cœude lrsquoimmuniteacute normale le bon fonctionnementsystegraveme immunitaire repose sur uneseacutelection conti-
T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492 489
tre
er-niteacute
st-on-nir
eacuteestionnqtion
f-
tionles
el-s leca-lulesdeo-
rsquoilsme
ssimeeacute-
ap-
on
iiso-onc-resla
gu--rup-fsxo-(parle
agrave
onc-el-ncecel-turereacute-ent
medegraves
esdi-sonoi raquoeacuteesle
nti-
anti-ro-
ma-nti-aceinslaiteacuteionour
uelseauffet duam-eanse
tion
nue puisque pour survivre un lymphocyte doit ecircreacuteguliegraverementstimuleacute par des antigegravenesendogegravenes(a priori non pathogegravenes) Lrsquoorganisme doit en pmanence assurer pour lui-mecircme une auto-immucontenue et continue
En quoi un modegravele insistant sur la continuiteacute eil plus satisfaisant que le modegravele du soi et du nsoi Lagrave ougrave le modegravele du soi est contraint de deacutefide multiplesexceptions lrsquohypothegravese de la continuitse veut unificatrice capable de rassembler toutles observations connues sous une mecircme explicaNous consideacuterons ainsi qursquoil y a pour lrsquoessentiel cidomaines qui montrent la supeacuterioriteacute drsquoune concepde ce type
(1) Lrsquoauto-immuniteacute Lrsquohypothegravese de la continuiteacute afirme qursquoil nrsquoy a pas de diffeacuterence deprincipeentre une reacuteaction auto-immune et une reacuteacimmunitaire visant un antigegravene exogegravene dansdeux cas il se produit unerupture de continuiteacutelieacutee agrave une modification de ce avec quoi les clules immunitaires se trouvent en contact Dancas des maladies auto-immunes il y a modifition des peptides preacutesenteacutes agrave la surface des celde lrsquoorganisme ce qui aboutit agrave une rupturecontinuiteacute alors mecircme que les peptides ainsi mdifieacutes restent du laquo soi raquo preacuteciseacutement parce qusont issus du mateacuteriel geacuteneacutetique de lrsquoorganisconsideacutereacute
(2) Les cancers Les cellules canceacutereuses elles ausont issues du mateacuteriel geacuteneacutetique de lrsquoorganiset donc sont du laquo soi raquo mais les motifs antigniques agrave leur surface brisent la continuiteacute par rport agrave des tissus sains
(3) Le prolongement entre immuniteacute et reacutegulatidrsquoensemble de lrsquoorganismeContrairement agrave ceque lrsquoimmunologie contemporaine a fait jusqursquoiclrsquohypothegravese de la continuiteacute permet de ne pasler dans lrsquoorganisme les agents assurant des ftions dedeacutefense des agents responsables drsquoautfonctions Lrsquoimmuniteacute est selon lrsquohypothegravese decontinuiteacute seulement lrsquoune des activiteacutes de reacutelation de lrsquoorganisme Ainsi lrsquoactiviteacute drsquoun macrophage par exemple est deacutetermineacutee par lature de continuiteacute entre ses reacutecepteurs et les motiavec lesquels il reacuteagit que ceux-ci soient egegravenes (bacteacuterie par exemple) ou endogegravenesexemple dans le cas drsquoune cellule morte que
macrophage doit ingeacuterer) donc il nrsquoy a pasenvisager pour le macrophagedeux tacircches dis-tinctes comme le fait le modegravele du soi (fonctidrsquolaquoeacuteboueur raquo de lrsquoorganisme drsquoune part fontion immune drsquoautre part) De mecircme les clules TReg ne sont pas stimuleacutees par la preacutesede laquo non-soi raquo puisqursquoelles reacuteagissent agrave deslules immunitaires endogegravenes mais par la rupde continuiteacute exprimeacutee preacuteciseacutement par lescepteurs des cellules immunitaires qui constituleur cible
(4) Les cas de toleacuterance immunitaire La continuiteacuterend compte de lrsquoeacutetat drsquoeacutequilibre qui srsquoeacutetablitentre lrsquoindividu et des agents pathogegravenes comles bacteacuteries sur la peau On constate queqursquoapparaicirct un deacuteficit immunitaire ces bacteacuteriqui jusque-lagrave eacutetaient sans effet neacutegatif sur lrsquoinvidu concerneacute provoquent des dommages agraveencontre Le critegravere nrsquoest donc pas celui du laquo set du laquo non-soi raquo puisque les bacteacuteries concernsont tout autant du laquo non-soi raquo avant qursquoapregravesdeacuteficit immunitaire mais bien larupture de conti-nuiteacutedans les interactions reacutecepteurs-motifs ageacuteniques
(5) Les meacutecanismes drsquoinduction drsquoune toleacuterance Mecirc-me dans le systegraveme immunitairemature on cons-tate parfois une absence de reacuteaction agrave desgegravenes avec lesquels lrsquoindividu est en contact plongeacute Il est difficile de deacuteterminer lescritegraveresdecette induction de toleacuterance puisque dans lajoriteacute des cas apregraves le premier contact avec lrsquoagegravene une reacuteponse immunitaire rapide et efficse deacuteclenche au deuxiegraveme contact Neacuteanmoil existe plusieurs meacutecanismes drsquoinduction detoleacuterance dont seule lrsquohypothegravese de la continusemble pouvoir rendre compte deacutesensibilisatdans le cas des allergies toleacuterance provisoire pcertains antigegravenes du pegravere apregraves la grossesse[21]toleacuterance pour certains pathogegravenes avec lesqon est en contact prolongeacute (bacteacuteries de la pde lrsquointestin) toleacuterance plus probable drsquoune gredrsquoorgane apregraves transfusion sanguine provenanmecircme donneur drsquoorgane etc Cela permet notment drsquoarticuler lacontinuiteacute avec les eacutetats dsymbiose les nombreuses bacteacuteries situeacutees dnotre intestin facilitent la digestion et de mecircmles bacteacuteries sur notre peau assurent lrsquoeacutelimina
490 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
se-
aisreacute-ffeonthy-nceire
quemeso-
vantttreonttiondit
euxaisionen-
sursene deques Ellau raquo
a-
eacuteo-en
u-nsheacuteo-tionis-quei-
sesce
ent
s a
queuto-
si-ous
n-Lemes
titeacuteoutge-
lo-
o-eacute
n-eacute-
ionsmet cardonc
en-iteacutehegravesesde-
up-sub-vec
y-tre-com-
drsquoautres pathogegravenes qui pour leur part cauraient des dommages agrave lrsquoorganisme
Une autogreffe ou une greffe entre jumeaux vrbien qursquoelles semblent rompre la continuiteacute entrecepteurs et motifs antigeacuteniques puisque lrsquoon grepar exemple un tissu agrave la place drsquoun autre tissu stoleacutereacutees ce qui paraicirct constituer une objection agrave lrsquopothegravese de la continuiteacute Cependant cette toleacuterasrsquoexplique par le fait que pour le systegraveme immunitareceveur il nrsquoy a pas de rupture de continuiteacute puisles reacuteactions reacutecepteursndashantigegravenes restent les mecirceacutetant donneacute qursquoil nrsquoy a aucune diffeacuterence dans les mtifs antigeacuteniques et donc dans les signaux eacutemis aet apregraves la greffe De faccedilon similaire on peut eacutemelrsquohypothegravese que ce qui fait que certaines greffes smieux toleacutereacutees que drsquoautres ce nrsquoest pas la distincsoinon-soi (conformeacutement agrave ce que nous avonscertains organes comme le foie sont drsquoautant mitoleacutereacutes qursquoils sont diffeacuterents de lrsquoorgane hocircte) mla plus grande continuiteacute dans lrsquoactiviteacute de stimulatdes agents immunitaires Ce qui importe crsquoest bientendu la continuiteacutepour les cellules immunitaires etnon la continuiteacutepour nous
Les avantages de lrsquohypothegravese de la continuiteacutele modegravele du soi tels que nous venons de les preacuteter nous permettent de preacuteciser quelle est la placcette hypothegravese au sein des theacuteories immunologiproposeacutees au cours des trente derniegraveres anneacuteessrsquoappuie incontestablement sur la theacuteorie du laquo reacuteseimmunitaire apparue chez Jerne[23] puis deacuteveloppeacuteesous la forme de la reacutegulation de lrsquoauto-immuniteacute nturelle ouimmunological homunculus[24] ainsi quesous le terme controverseacute drsquoautopoiesis[25] Lrsquohy-pothegravese de la continuiteacute a en commun avec les thries du reacuteseau lrsquoideacutee qursquoune reacuteaction immune estfait uneperturbation du systegraveme[26] crsquoest-agrave-dire unemodification du comportement que le systegraveme immnitaire a eu jusqursquoici (laquo rupture de continuiteacute raquo dale cadre de notre hypothegravese) Cependant les tries du reacuteseau immunitaire proposent une concepclosede lrsquoimmuniteacute selon ses promoteurs si la dtinction soinon-soi est insatisfaisante crsquoest parcele systegraveme immunitaire nrsquoa jamais affaire qursquoagrave lumecircme[24] Agrave lrsquoopposeacute lrsquohypothegravese de la continuiteacutedonne pour objectif drsquoouvrir le systegraveme comme noulrsquoavons vu avec les cas drsquoinduction drsquoune toleacuteranimmunitaire Lrsquohypothegravese de la continuiteacute autrem
-
e
dit srsquoefforce de comprendre comment des entiteacutepriori distinctes de lrsquoorganisme peuventsrsquointeacutegrer agravelui (processus drsquoouverture et de toleacuterance) alorsles theacuteories du reacuteseau insistent sur la clocircture et lrsquoadeacutefinition de lrsquoimmuniteacute
7 Identiteacute immunitaire et identiteacute philosophique
Lrsquohypothegravese de la continuiteacute nous eacuteloigne condeacuterablement du modegravele du soi mais elle ne neacuteloigne pas pour autant de la question de lrsquoidentiteacuteNotre conviction est qursquoil est possible de penser lrsquoidetiteacute biologique sans la deacutefinir comme un laquo soi raquoconcept philosophique drsquoidentiteacute repose sur les terlatins idem (fait drsquoecirctre identique agrave soi ideacutee deper-manencedans le temps) etipse (fait de demeurer lemecircme tout en changeant partiellement il y aeacutevolu-tion dans le temps) drsquoun cocircteacute nous avons lrsquoidenimmuable dans le temps et de lrsquoautre lrsquoideacutee que tecirctre reste le mecircme tout en accueillant en lui le chanment Cette distinction rejoint la probleacutematique phisophique de lasubstance la substance est uninvariantsusceptible drsquoecirctre pour chaque individu lesupportdetoutes lesvariations[27] Deux grandes thegraveses philsophiques srsquoaffrontent sur la question de lrsquoidentitla premiegravere deacutefinit lrsquoidentiteacute par lasubstance tandisque la seconde deacutefinit lrsquoidentiteacute par lacontinuiteacute Se-lon la premiegravere thegravese ce qui fait lrsquoidentiteacute drsquoun idividu crsquoest la substance crsquoest-agrave-dire le support mtaphysique de toutes ses deacuteterminations et variatSelon la deuxiegraveme thegravese agrave lrsquoopposeacute rien ne perde preacutesupposer qursquoil existe une telle laquo substance raquocette substance est par deacutefinition inaccessible etlrsquoidentiteacute repose seulement sur lacontinuiteacutedans letemps continuiteacute des changements physiques oucore concernant lrsquoidentiteacute psychologique continudes eacutetats de conscience Le deacutebat entre ces deux tphilosophiques pourrait ecirctre illustreacute par les figuresLocke[28] et de Leibniz[29] La conception substantialiste de lrsquoidentiteacute consiste agravesupposerplus que laconception fondeacutee sur la continuiteacute (ce que lrsquoon spose en plus crsquoest preacuteciseacutement un laquo noyau raquo destantialiteacute) Or on peut agrave bon droit ecirctre drsquoaccord ale soupccedilon de Locke renforceacute par Hume[30] puisquela substanceest en elle-mecircme un noyau meacutetaphsique inatteignable pourquoi la preacutesupposer Aument dit si on peut se passer de la substance pour
T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492 491
eacute--parsesutuisuesyer
degraveler il
unuedu
-
-rerionpar
deplecele
voirneors
etezper-du
po-quiiegrave-net re-s aus
euxvec
gielleenrsquoest
soiqueeacute
en-me
en-pasni-reacute-isnti-rsn-r en-
os--
que)s
pourpreacute-me
ienge
c-
nse-
ow2)
elf12
prendre lrsquoidentiteacute pourquoi y ferait-on appel La dmarche de Locke relegraveve alors de ladeacuteflation meacutetaphysique si un mecircme pheacutenomegravene peut ecirctre expliqueacutedeux modegraveles dont lrsquoun repose sur moins drsquohypothegraveque lrsquoautre alors crsquoest le modegravele minimal qursquoil vamieux adopter Lrsquoimmunologie est au moins deples anneacutees 1940 peacutetrie de concepts philosophiqNotre rocircle devrait ecirctre dans ces conditions drsquoessadrsquoaccorder agrave ces concepts leur juste place Le modu soi se situe du cocircteacute de lrsquoidentiteacute-substance catente de deacutefinir lrsquoidentiteacute de lrsquoorganisme commenoyau substantiel dont lrsquointeacutegriteacute doit ecirctre deacutefendtandis que lrsquohypothegravese de la continuiteacute se rangecocircteacute de lrsquoidentiteacute-continuiteacute Lrsquohypothegravese de la continuiteacute par conseacutequent constitue une propositionphi-losophiquepour limiter lrsquousage des concepts philosophiques en immunologie elle srsquoefforce de reacuteiteacutedans le domaine propre de lrsquoimmunologie la deacuteflatmeacutetaphysique que lrsquoidentiteacute-continuiteacute repreacutesenterapport agrave lrsquoidentiteacute-substance
Une question cependant surgit ici lrsquohypothegravesela continuiteacute nrsquoest-elle pas finalement qursquoune simreformulation du modegravele du soi Ne dit-elle pasque les immunologistes ont toujours dit Nous nepensons pas Rien bien entendu nrsquoempecircche delrsquohypothegravese de la continuiteacute simplement comme uconception renouveleacutee du laquo soi raquo On affirmerait alseulement qursquoil srsquoagit dans ce cas dusoi compriscomme continuiteacute (comme chez Locke ou Hume)non dusoi compris comme substance (comme chLeibniz) Cette suggestion est seacuteduisante car ellemettrait une fois encore de laquo sauver raquo le modegravelesoi et du non-soi Neacuteanmoins premiegraverement lrsquohythegravese de la continuiteacute explique des pheacutenomegraveneseacutetaient mal expliqueacutes par le modegravele du soi Deuxmement et surtout faire de lrsquoidentiteacute-continuiteacute uconception renouveleacutee du laquo soi raquo serait preacuteciseacutementomber dans lrsquoerreur qui consiste en ayant recourterme trop large desoi agrave recouvrir deux significationbien distinctes lasubstanceet lacontinuiteacute Parler delaquo soi raquo crsquoest se condamner agrave ne pas distinguer les dsens agrave passer de lrsquoun agrave lrsquoautre sans justification ale risque de tout laquo substantialiser raquo en immunoloOn pourrait donc accepter lrsquoobjection selon laquece que lrsquoon propose nrsquoest qursquoune redeacutefinition du soiimmunologie mais ce que lrsquoon ne peut accepter clrsquoideacutee que le terme desoi doit ecirctre conserveacute
8 Conclusion philosophie de lrsquoidentiteacutebiologique
Quelles questions pose lrsquoanalyse du modegravele duet du non-soi pour une compreacutehension philosophide la deacutefinition biologique de lrsquoidentiteacute Lrsquoidentitbiologique pour tout ecirctre vivant deacutesignece qursquoil estbiologiquement crsquoest-agrave-dire son uniciteacute et sa diffeacuterciation spatiale Nous avons montreacute que le systegraveimmunitaire constituait bien une sorte de carte drsquoidtiteacute de lrsquoorganisme mais que cette identiteacute nrsquoeacutetaitclose agrave toute influence exteacuterieure lrsquoidentiteacute immutaire nrsquoest pas deacutefinie agrave partir drsquoun ensemble deactions de deacutefense agrave toutesles entiteacutes exogegravenes made maniegravere continuiste crsquoest-agrave-dire comme la conuiteacute spatio-temporelle des reacuteactions entre reacutecepteude lrsquoimmuniteacute et motifs antigeacuteniques (qursquoils soient edogegravenes ou exogegravenes) Degraves lors peut se dessineparticulier agrave partir de lrsquoideacutee drsquoinduction de la toleacuterance immunitaire une reacuteflexion eacutelargie sur la psibiliteacute de deacutefinir lrsquoidentiteacute biologique (agrave la fois pheacutenotypique et en amont geacuteneacutetique ou para-geacuteneacuteticomme une identiteacuteouverte articulant agrave la fois deeacuteleacutements endogegravenes et des eacuteleacutements exogegravenesdeacuteterminer en derniegravere instance le propre toujourscaire et toujours combineacute (laquo impur raquo) drsquoun organisvivant donneacute
Remerciements
Nous remercions pour leur aide et leur soutAnouk Barberousse Claude Debru Michel MoranJean Gayon Ceacutedric Brun et Hannah-Louise Clark
Reacutefeacuterences
[1] FM Burnet F Fenner The Production of Antibodies Mamillan Melbourne 1941 2e eacutedition en 1949
[2] MS Anderson ES Venanzi L Klein Z Chen SP BerziSJ Turley H von Boehmer R Bronson A Dierich C Bnoist D Mathis Projection of an Immunological Self ShadWithin the Thymus by the Aire Protein Science 298 (2001395ndash1401
[3] RE Langman M Cohn A minimal model for the self-nonsdiscrimination a return to the basics Semin Immunol(2000) 189ndash195
492 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
self
uil
ty
ofd
de
-
aelf
rrs
ha8
Ho-nlf-
f6
-G
odSci
itet
em
ical
ei-
u-
[4] P Matzinger The danger model a renewed sense ofScience 296 (2002) 301ndash305
[5] J Bernard M Bessis C Debru (dir) Soi et non-soi SeParis 1990
[6] FM Burnet Changing Patterns An Atypical AutobiographyHeinemann Melbourne 1968
[7] M Morange La part des gegravenes Odile Jacob Paris 1998[8] FM Burnet The Integrity of the Body Harvard Universi
Press Cambridge 1962[9] AI Tauber L Chernyak Metchnikoff and the Origins
Immunology Oxford University Press New York Oxfor1991
[10] A-M Moulin Le dernier langage de la meacutedecine ndash histoirelrsquoimmunologie de Pasteur au Sida PUF Paris 1991
[11] AI Tauber The Immune Self Theory or metaphor Cambridge University Press Cambridge 1994
[12] Aristote Cateacutegories Vrin Paris 1994 chapitres 10 et 11[13] Aristote Cateacutegories chapitre 5 3b22ndash33[14] P Kourilsky J-M Claverie The peptidic self model
hypothesis on the molecular nature of the immunological sAnn Immunol 137 (1986) 3ndash21
[15] DH Raulet RE VanceCW McMahon Regulation of thenatural killer cell receptor repertoire Annu Rev Immunol 19(2001) 291ndash330
[16] PG Ashton-Rickardt A Bandeira JR Delaney L Van KaeHP Pircher RM Zinkernagel S Tonegawa Evidence foa differential avidity model of T-cell selection in the thymuCell 76 (1994) 651ndash663
[17] C Tanchot B Lemonnier A Perarnau A Freitas B RocDifferential requirements for survival and proliferation of CDnaive or memory T cells Science 276 (1997) 2057ndash2062
[18] MS Jordan A Boesteanu AJ Reed AL Petrone AElenbeck MA Lerman A Naji AJ Caton Thymic selectioof CD4+CD25+ regulatory T cells induced by an agonist sepeptide Nat Immunol 2 (2001) 301ndash306
[19] Z Feheacutervari S Sakaguchi Development and function oCD25+CD4+ regulatory T cells Curr Opin Immunol 1(2004) 203ndash208
[20] ED Carosella N Rouas-Freiss P Paul J Dausset HLAa tolerance molecule from themajor histocompatibility com-plex Immunol Today 20 (1999) 60ndash62
[21] DW Bianchi GK Zickwolf GJ Weil S Sylvester MADeMaria Male fetal progenitor cells persist in maternal blofor as long as 27 years postpartum Proc Natl AcadUSA 93 (1996) 705ndash708
[22] D Cha K Khosrotehrani Y Kim H Stroh DW BianchKL Johnson Cervical cancer and microchimerism ObsGynecol 102 (2003) 774ndash781
[23] NK Jerne Towards a network theory of the immune systAnn Immunol 125 C (1974) 373ndash389
[24] IR Cohen The cognitive paradigm and the immunologhomunculus Immunol Today 13 (1992) 490ndash494
[25] HR Maturna FJ Varela Autopoiesis and cognition D Rdel Dordrecht The Netherlands 1980
[26] AI Tauber Moving beyond the immune self Semin Immnol 12 (2000) 241ndash248
[27] Aristote Cateacutegories chapitre 5[28] J Locke Essai sur lrsquoentendement humain 1690[29] GW Leibniz Nouveaux Essais sur lrsquoentendement humain
1765[30] D Hume Traiteacute de la nature humaine 1739
488 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
defreacute-parmi-duegravere
o-er-eacuteeor-reacutesest
tersquoun
deent
cinqnies
elulesdesos-iteacuteel-ansles
les
onsle
on-nc
ee laegravelece
desouson-ent
tiono-ns
eeys-
unecetortelesdeacute-t duseuoi
llo-lle
laec le
im-rsquoilsns
estrsquoestreacute-il y
e il
n-antale)
im-
eser
du
une absence de rejet de greffe[20] Le modegravele dusoi et du non-soi ainsi nrsquoest pas en mesurerendre compte du cas de greffe agrave la fois le plusquent et le plus important celui du fœtus porteacutela megravere Le fœtus en effet est une greffe seallogeacutenique qui est toleacutereacutee bien que la moitieacutepatrimoine geacuteneacutetique de lrsquoenfant soit issue du pet donc soit eacutetrangegravere agrave la megravere En outre le mdegravele du soi est incapable drsquoexpliquer pourquoi ctains organes ndash dits laquo immunoprivileacutegieacutes raquo (la cornpar exemple) ndash sont toleacutereacutes ni pourquoi drsquoautresganes comme le foie sont drsquoautant mieux toleacuteque la diffeacuterence HLA entre donneur et receveurforte
523 Le chimeacuterismeLe chimeacuterisme deacutesigne le fait qursquoun individu por
en lui en faibles quantiteacutes des cellules issues dautre individu Le cas le plus significatif est celuila femme enceinte des cellules du fœtus peuvecirctre deacutetecteacutees chez la megravere au bout drsquoagrave peinesemaines de gestation et jusqursquoagrave plusieurs deacutecenapregraves lrsquoaccouchement[21] Le chimeacuterisme deacutesigneacutegalement le cas des enfants qui portent des celde leur megravere et le cas drsquoun faux jumeau portantcellules de son fregravere Le chimeacuterisme prouve la psibiliteacute drsquoun laquo partage raquo du laquo soi raquo voire la possibilpour le laquo non-soi raquo drsquoecirctre constitutif du laquo soi raquo Les clules chimeacuteriques au lieu de rester laquo endormies raquo dlrsquoorganisme peuvent mecircme se diffeacuterencier en cellutumorales[22] voire peut-ecirctrefonctionnelles(deve-nant par exemple des cellules du foie des cellude la peau etc)
De lrsquoensemble de ces observations nous pouvconclure ceci contrairement agrave ce que postulemodegravele du laquo soi raquo les cateacutegories drsquoimmunogegraveneetdrsquoexogegravenene sont pas confondues Degraves lors le laquo nsoi raquo nrsquoest pas le compleacutement du laquo soi raquo et dolrsquoopposition dans le terme laquonon-soi raquo est deacutenueacutede sens Crsquoest par conseacutequent lrsquoensemble ddialectique du soi et du non-soi au cœur du modinitieacute par Burnet qui srsquoavegravere inadeacutequate puisquemodegravele eacutechoue agrave deacutefinir la limitation de chacundeux concepts Si ce raisonnement est exact npouvons en deacuteduire que le modegravele du soi et du nsoi est impropre agrave rendre compte du fonctionnemde lrsquoimmuniteacute
6 Pour un autre modegravele theacuteorique enimmunologie la continuiteacute spatio-temporelle
Nous tentons ici de proposer une autre orientatheacuteorique ndash imparfaite et provisoire ndash pour lrsquoimmunlogie Le critegravere drsquoimmunogeacuteniciteacute que nous mettoen avant est celui de lacontinuiteacute spatio-temporellequi srsquoappuie sur la deacutefinition de lrsquoimmuniteacute commsystegravemeeneacutequilibre La proposition fondamentale dlrsquohypothegravese de la continuiteacute est la suivante le stegraveme immunitaire reacuteagit agrave ce quirompt la continuiteacuteentre les reacutecepteurs des acteurs de lrsquoimmuniteacute drsquopart et les motifs antigeacuteniques drsquoautre part (queantigegravene soit endogegravene ou exogegravene) Seule impautrement dit la continuiteacute spatio-temporelle entrecomposants immunitaires et leurs cibles le critegravereterminant nrsquoeacutetant pas de savoir si ces cibles sonlaquo soi raquo ou du laquo non-soi raquo Ainsi selon cette hypothegravele systegraveme immunitaire ne reacuteagit pas agrave ce avec qil est en contact continu(et agrave partir de quoi il a eacuteteacuteseacutelectionneacute) alors qursquoil reacuteagit agrave ce qui vientbriserla continuiteacute(un motif antigeacutenique jamais rencontreacutebacteacuterie virus organe comme dans le cas drsquoune agreffe etc) et donc la distinction pertinente est ceentrecontinuiteacuteet rupture de continuiteacute et non la dis-tinction entre laquo soi raquo et laquo non-soi raquo Ce critegravere decontinuiteacute demande agrave ecirctre penseacute en correacutelation avconcept deressemblance Il srsquoagit drsquoune continuiteacute agrave lafois spatiale et temporelle tant que les reacutecepteursmunitaires continuent de reacuteagir aussi faiblement qulrsquoont fait jusqursquoici avec les antigegravenes preacutesents dalrsquoorganisme aucune reacuteaction immunitaire forte nrsquodeacuteclencheacutee Ce qui provoque une reacuteaction forte cla nouveauteacute crsquoest-agrave-dire le laquo jamais vu raquo pour lescepteurs de lrsquoimmuniteacute et crsquoest dans ce cas-lagrave qursquoa rupture de continuiteacute
Le point de deacutepart de cette hypothegravese est doublrepose sur lrsquoideacutee decommencementde lrsquoimmuniteacute etsur lrsquoideacutee drsquoautoreacuteactiviteacutecomme auto-reconnaissace Premiegraverement il existe initialement (soit pendla peacuteriode fœtale soit pendant la peacuteriode post-natpour chaque organisme une peacuteriode de toleacuterancemunitaire ce qui indique que lrsquoimmuniteacute a uncom-mencement Ce qui estpreacutesentau moment de cettseacutelection fondatricene deacuteclenchera pas de reacuteponimmune Deuxiegravemement lrsquoautoreacuteactiviteacute est au cœude lrsquoimmuniteacute normale le bon fonctionnementsystegraveme immunitaire repose sur uneseacutelection conti-
T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492 489
tre
er-niteacute
st-on-nir
eacuteestionnqtion
f-
tionles
el-s leca-lulesdeo-
rsquoilsme
ssimeeacute-
ap-
on
iiso-onc-resla
gu--rup-fsxo-(parle
agrave
onc-el-ncecel-turereacute-ent
medegraves
esdi-sonoi raquoeacuteesle
nti-
anti-ro-
ma-nti-aceinslaiteacuteionour
uelseauffet duam-eanse
tion
nue puisque pour survivre un lymphocyte doit ecircreacuteguliegraverementstimuleacute par des antigegravenesendogegravenes(a priori non pathogegravenes) Lrsquoorganisme doit en pmanence assurer pour lui-mecircme une auto-immucontenue et continue
En quoi un modegravele insistant sur la continuiteacute eil plus satisfaisant que le modegravele du soi et du nsoi Lagrave ougrave le modegravele du soi est contraint de deacutefide multiplesexceptions lrsquohypothegravese de la continuitse veut unificatrice capable de rassembler toutles observations connues sous une mecircme explicaNous consideacuterons ainsi qursquoil y a pour lrsquoessentiel cidomaines qui montrent la supeacuterioriteacute drsquoune concepde ce type
(1) Lrsquoauto-immuniteacute Lrsquohypothegravese de la continuiteacute afirme qursquoil nrsquoy a pas de diffeacuterence deprincipeentre une reacuteaction auto-immune et une reacuteacimmunitaire visant un antigegravene exogegravene dansdeux cas il se produit unerupture de continuiteacutelieacutee agrave une modification de ce avec quoi les clules immunitaires se trouvent en contact Dancas des maladies auto-immunes il y a modifition des peptides preacutesenteacutes agrave la surface des celde lrsquoorganisme ce qui aboutit agrave une rupturecontinuiteacute alors mecircme que les peptides ainsi mdifieacutes restent du laquo soi raquo preacuteciseacutement parce qusont issus du mateacuteriel geacuteneacutetique de lrsquoorganisconsideacutereacute
(2) Les cancers Les cellules canceacutereuses elles ausont issues du mateacuteriel geacuteneacutetique de lrsquoorganiset donc sont du laquo soi raquo mais les motifs antigniques agrave leur surface brisent la continuiteacute par rport agrave des tissus sains
(3) Le prolongement entre immuniteacute et reacutegulatidrsquoensemble de lrsquoorganismeContrairement agrave ceque lrsquoimmunologie contemporaine a fait jusqursquoiclrsquohypothegravese de la continuiteacute permet de ne pasler dans lrsquoorganisme les agents assurant des ftions dedeacutefense des agents responsables drsquoautfonctions Lrsquoimmuniteacute est selon lrsquohypothegravese decontinuiteacute seulement lrsquoune des activiteacutes de reacutelation de lrsquoorganisme Ainsi lrsquoactiviteacute drsquoun macrophage par exemple est deacutetermineacutee par lature de continuiteacute entre ses reacutecepteurs et les motiavec lesquels il reacuteagit que ceux-ci soient egegravenes (bacteacuterie par exemple) ou endogegravenesexemple dans le cas drsquoune cellule morte que
macrophage doit ingeacuterer) donc il nrsquoy a pasenvisager pour le macrophagedeux tacircches dis-tinctes comme le fait le modegravele du soi (fonctidrsquolaquoeacuteboueur raquo de lrsquoorganisme drsquoune part fontion immune drsquoautre part) De mecircme les clules TReg ne sont pas stimuleacutees par la preacutesede laquo non-soi raquo puisqursquoelles reacuteagissent agrave deslules immunitaires endogegravenes mais par la rupde continuiteacute exprimeacutee preacuteciseacutement par lescepteurs des cellules immunitaires qui constituleur cible
(4) Les cas de toleacuterance immunitaire La continuiteacuterend compte de lrsquoeacutetat drsquoeacutequilibre qui srsquoeacutetablitentre lrsquoindividu et des agents pathogegravenes comles bacteacuteries sur la peau On constate queqursquoapparaicirct un deacuteficit immunitaire ces bacteacuteriqui jusque-lagrave eacutetaient sans effet neacutegatif sur lrsquoinvidu concerneacute provoquent des dommages agraveencontre Le critegravere nrsquoest donc pas celui du laquo set du laquo non-soi raquo puisque les bacteacuteries concernsont tout autant du laquo non-soi raquo avant qursquoapregravesdeacuteficit immunitaire mais bien larupture de conti-nuiteacutedans les interactions reacutecepteurs-motifs ageacuteniques
(5) Les meacutecanismes drsquoinduction drsquoune toleacuterance Mecirc-me dans le systegraveme immunitairemature on cons-tate parfois une absence de reacuteaction agrave desgegravenes avec lesquels lrsquoindividu est en contact plongeacute Il est difficile de deacuteterminer lescritegraveresdecette induction de toleacuterance puisque dans lajoriteacute des cas apregraves le premier contact avec lrsquoagegravene une reacuteponse immunitaire rapide et efficse deacuteclenche au deuxiegraveme contact Neacuteanmoil existe plusieurs meacutecanismes drsquoinduction detoleacuterance dont seule lrsquohypothegravese de la continusemble pouvoir rendre compte deacutesensibilisatdans le cas des allergies toleacuterance provisoire pcertains antigegravenes du pegravere apregraves la grossesse[21]toleacuterance pour certains pathogegravenes avec lesqon est en contact prolongeacute (bacteacuteries de la pde lrsquointestin) toleacuterance plus probable drsquoune gredrsquoorgane apregraves transfusion sanguine provenanmecircme donneur drsquoorgane etc Cela permet notment drsquoarticuler lacontinuiteacute avec les eacutetats dsymbiose les nombreuses bacteacuteries situeacutees dnotre intestin facilitent la digestion et de mecircmles bacteacuteries sur notre peau assurent lrsquoeacutelimina
490 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
se-
aisreacute-ffeonthy-nceire
quemeso-
vantttreonttiondit
euxaisionen-
sursene deques Ellau raquo
a-
eacuteo-en
u-nsheacuteo-tionis-quei-
sesce
ent
s a
queuto-
si-ous
n-Lemes
titeacuteoutge-
lo-
o-eacute
n-eacute-
ionsmet cardonc
en-iteacutehegravesesde-
up-sub-vec
y-tre-com-
drsquoautres pathogegravenes qui pour leur part cauraient des dommages agrave lrsquoorganisme
Une autogreffe ou une greffe entre jumeaux vrbien qursquoelles semblent rompre la continuiteacute entrecepteurs et motifs antigeacuteniques puisque lrsquoon grepar exemple un tissu agrave la place drsquoun autre tissu stoleacutereacutees ce qui paraicirct constituer une objection agrave lrsquopothegravese de la continuiteacute Cependant cette toleacuterasrsquoexplique par le fait que pour le systegraveme immunitareceveur il nrsquoy a pas de rupture de continuiteacute puisles reacuteactions reacutecepteursndashantigegravenes restent les mecirceacutetant donneacute qursquoil nrsquoy a aucune diffeacuterence dans les mtifs antigeacuteniques et donc dans les signaux eacutemis aet apregraves la greffe De faccedilon similaire on peut eacutemelrsquohypothegravese que ce qui fait que certaines greffes smieux toleacutereacutees que drsquoautres ce nrsquoest pas la distincsoinon-soi (conformeacutement agrave ce que nous avonscertains organes comme le foie sont drsquoautant mitoleacutereacutes qursquoils sont diffeacuterents de lrsquoorgane hocircte) mla plus grande continuiteacute dans lrsquoactiviteacute de stimulatdes agents immunitaires Ce qui importe crsquoest bientendu la continuiteacutepour les cellules immunitaires etnon la continuiteacutepour nous
Les avantages de lrsquohypothegravese de la continuiteacutele modegravele du soi tels que nous venons de les preacuteter nous permettent de preacuteciser quelle est la placcette hypothegravese au sein des theacuteories immunologiproposeacutees au cours des trente derniegraveres anneacuteessrsquoappuie incontestablement sur la theacuteorie du laquo reacuteseimmunitaire apparue chez Jerne[23] puis deacuteveloppeacuteesous la forme de la reacutegulation de lrsquoauto-immuniteacute nturelle ouimmunological homunculus[24] ainsi quesous le terme controverseacute drsquoautopoiesis[25] Lrsquohy-pothegravese de la continuiteacute a en commun avec les thries du reacuteseau lrsquoideacutee qursquoune reacuteaction immune estfait uneperturbation du systegraveme[26] crsquoest-agrave-dire unemodification du comportement que le systegraveme immnitaire a eu jusqursquoici (laquo rupture de continuiteacute raquo dale cadre de notre hypothegravese) Cependant les tries du reacuteseau immunitaire proposent une concepclosede lrsquoimmuniteacute selon ses promoteurs si la dtinction soinon-soi est insatisfaisante crsquoest parcele systegraveme immunitaire nrsquoa jamais affaire qursquoagrave lumecircme[24] Agrave lrsquoopposeacute lrsquohypothegravese de la continuiteacutedonne pour objectif drsquoouvrir le systegraveme comme noulrsquoavons vu avec les cas drsquoinduction drsquoune toleacuteranimmunitaire Lrsquohypothegravese de la continuiteacute autrem
-
e
dit srsquoefforce de comprendre comment des entiteacutepriori distinctes de lrsquoorganisme peuventsrsquointeacutegrer agravelui (processus drsquoouverture et de toleacuterance) alorsles theacuteories du reacuteseau insistent sur la clocircture et lrsquoadeacutefinition de lrsquoimmuniteacute
7 Identiteacute immunitaire et identiteacute philosophique
Lrsquohypothegravese de la continuiteacute nous eacuteloigne condeacuterablement du modegravele du soi mais elle ne neacuteloigne pas pour autant de la question de lrsquoidentiteacuteNotre conviction est qursquoil est possible de penser lrsquoidetiteacute biologique sans la deacutefinir comme un laquo soi raquoconcept philosophique drsquoidentiteacute repose sur les terlatins idem (fait drsquoecirctre identique agrave soi ideacutee deper-manencedans le temps) etipse (fait de demeurer lemecircme tout en changeant partiellement il y aeacutevolu-tion dans le temps) drsquoun cocircteacute nous avons lrsquoidenimmuable dans le temps et de lrsquoautre lrsquoideacutee que tecirctre reste le mecircme tout en accueillant en lui le chanment Cette distinction rejoint la probleacutematique phisophique de lasubstance la substance est uninvariantsusceptible drsquoecirctre pour chaque individu lesupportdetoutes lesvariations[27] Deux grandes thegraveses philsophiques srsquoaffrontent sur la question de lrsquoidentitla premiegravere deacutefinit lrsquoidentiteacute par lasubstance tandisque la seconde deacutefinit lrsquoidentiteacute par lacontinuiteacute Se-lon la premiegravere thegravese ce qui fait lrsquoidentiteacute drsquoun idividu crsquoest la substance crsquoest-agrave-dire le support mtaphysique de toutes ses deacuteterminations et variatSelon la deuxiegraveme thegravese agrave lrsquoopposeacute rien ne perde preacutesupposer qursquoil existe une telle laquo substance raquocette substance est par deacutefinition inaccessible etlrsquoidentiteacute repose seulement sur lacontinuiteacutedans letemps continuiteacute des changements physiques oucore concernant lrsquoidentiteacute psychologique continudes eacutetats de conscience Le deacutebat entre ces deux tphilosophiques pourrait ecirctre illustreacute par les figuresLocke[28] et de Leibniz[29] La conception substantialiste de lrsquoidentiteacute consiste agravesupposerplus que laconception fondeacutee sur la continuiteacute (ce que lrsquoon spose en plus crsquoest preacuteciseacutement un laquo noyau raquo destantialiteacute) Or on peut agrave bon droit ecirctre drsquoaccord ale soupccedilon de Locke renforceacute par Hume[30] puisquela substanceest en elle-mecircme un noyau meacutetaphsique inatteignable pourquoi la preacutesupposer Aument dit si on peut se passer de la substance pour
T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492 491
eacute--parsesutuisuesyer
degraveler il
unuedu
-
-rerionpar
deplecele
voirneors
etezper-du
po-quiiegrave-net re-s aus
euxvec
gielleenrsquoest
soiqueeacute
en-me
en-pasni-reacute-isnti-rsn-r en-
os--
que)s
pourpreacute-me
ienge
c-
nse-
ow2)
elf12
prendre lrsquoidentiteacute pourquoi y ferait-on appel La dmarche de Locke relegraveve alors de ladeacuteflation meacutetaphysique si un mecircme pheacutenomegravene peut ecirctre expliqueacutedeux modegraveles dont lrsquoun repose sur moins drsquohypothegraveque lrsquoautre alors crsquoest le modegravele minimal qursquoil vamieux adopter Lrsquoimmunologie est au moins deples anneacutees 1940 peacutetrie de concepts philosophiqNotre rocircle devrait ecirctre dans ces conditions drsquoessadrsquoaccorder agrave ces concepts leur juste place Le modu soi se situe du cocircteacute de lrsquoidentiteacute-substance catente de deacutefinir lrsquoidentiteacute de lrsquoorganisme commenoyau substantiel dont lrsquointeacutegriteacute doit ecirctre deacutefendtandis que lrsquohypothegravese de la continuiteacute se rangecocircteacute de lrsquoidentiteacute-continuiteacute Lrsquohypothegravese de la continuiteacute par conseacutequent constitue une propositionphi-losophiquepour limiter lrsquousage des concepts philosophiques en immunologie elle srsquoefforce de reacuteiteacutedans le domaine propre de lrsquoimmunologie la deacuteflatmeacutetaphysique que lrsquoidentiteacute-continuiteacute repreacutesenterapport agrave lrsquoidentiteacute-substance
Une question cependant surgit ici lrsquohypothegravesela continuiteacute nrsquoest-elle pas finalement qursquoune simreformulation du modegravele du soi Ne dit-elle pasque les immunologistes ont toujours dit Nous nepensons pas Rien bien entendu nrsquoempecircche delrsquohypothegravese de la continuiteacute simplement comme uconception renouveleacutee du laquo soi raquo On affirmerait alseulement qursquoil srsquoagit dans ce cas dusoi compriscomme continuiteacute (comme chez Locke ou Hume)non dusoi compris comme substance (comme chLeibniz) Cette suggestion est seacuteduisante car ellemettrait une fois encore de laquo sauver raquo le modegravelesoi et du non-soi Neacuteanmoins premiegraverement lrsquohythegravese de la continuiteacute explique des pheacutenomegraveneseacutetaient mal expliqueacutes par le modegravele du soi Deuxmement et surtout faire de lrsquoidentiteacute-continuiteacute uconception renouveleacutee du laquo soi raquo serait preacuteciseacutementomber dans lrsquoerreur qui consiste en ayant recourterme trop large desoi agrave recouvrir deux significationbien distinctes lasubstanceet lacontinuiteacute Parler delaquo soi raquo crsquoest se condamner agrave ne pas distinguer les dsens agrave passer de lrsquoun agrave lrsquoautre sans justification ale risque de tout laquo substantialiser raquo en immunoloOn pourrait donc accepter lrsquoobjection selon laquece que lrsquoon propose nrsquoest qursquoune redeacutefinition du soiimmunologie mais ce que lrsquoon ne peut accepter clrsquoideacutee que le terme desoi doit ecirctre conserveacute
8 Conclusion philosophie de lrsquoidentiteacutebiologique
Quelles questions pose lrsquoanalyse du modegravele duet du non-soi pour une compreacutehension philosophide la deacutefinition biologique de lrsquoidentiteacute Lrsquoidentitbiologique pour tout ecirctre vivant deacutesignece qursquoil estbiologiquement crsquoest-agrave-dire son uniciteacute et sa diffeacuterciation spatiale Nous avons montreacute que le systegraveimmunitaire constituait bien une sorte de carte drsquoidtiteacute de lrsquoorganisme mais que cette identiteacute nrsquoeacutetaitclose agrave toute influence exteacuterieure lrsquoidentiteacute immutaire nrsquoest pas deacutefinie agrave partir drsquoun ensemble deactions de deacutefense agrave toutesles entiteacutes exogegravenes made maniegravere continuiste crsquoest-agrave-dire comme la conuiteacute spatio-temporelle des reacuteactions entre reacutecepteude lrsquoimmuniteacute et motifs antigeacuteniques (qursquoils soient edogegravenes ou exogegravenes) Degraves lors peut se dessineparticulier agrave partir de lrsquoideacutee drsquoinduction de la toleacuterance immunitaire une reacuteflexion eacutelargie sur la psibiliteacute de deacutefinir lrsquoidentiteacute biologique (agrave la fois pheacutenotypique et en amont geacuteneacutetique ou para-geacuteneacuteticomme une identiteacuteouverte articulant agrave la fois deeacuteleacutements endogegravenes et des eacuteleacutements exogegravenesdeacuteterminer en derniegravere instance le propre toujourscaire et toujours combineacute (laquo impur raquo) drsquoun organisvivant donneacute
Remerciements
Nous remercions pour leur aide et leur soutAnouk Barberousse Claude Debru Michel MoranJean Gayon Ceacutedric Brun et Hannah-Louise Clark
Reacutefeacuterences
[1] FM Burnet F Fenner The Production of Antibodies Mamillan Melbourne 1941 2e eacutedition en 1949
[2] MS Anderson ES Venanzi L Klein Z Chen SP BerziSJ Turley H von Boehmer R Bronson A Dierich C Bnoist D Mathis Projection of an Immunological Self ShadWithin the Thymus by the Aire Protein Science 298 (2001395ndash1401
[3] RE Langman M Cohn A minimal model for the self-nonsdiscrimination a return to the basics Semin Immunol(2000) 189ndash195
492 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
self
uil
ty
ofd
de
-
aelf
rrs
ha8
Ho-nlf-
f6
-G
odSci
itet
em
ical
ei-
u-
[4] P Matzinger The danger model a renewed sense ofScience 296 (2002) 301ndash305
[5] J Bernard M Bessis C Debru (dir) Soi et non-soi SeParis 1990
[6] FM Burnet Changing Patterns An Atypical AutobiographyHeinemann Melbourne 1968
[7] M Morange La part des gegravenes Odile Jacob Paris 1998[8] FM Burnet The Integrity of the Body Harvard Universi
Press Cambridge 1962[9] AI Tauber L Chernyak Metchnikoff and the Origins
Immunology Oxford University Press New York Oxfor1991
[10] A-M Moulin Le dernier langage de la meacutedecine ndash histoirelrsquoimmunologie de Pasteur au Sida PUF Paris 1991
[11] AI Tauber The Immune Self Theory or metaphor Cambridge University Press Cambridge 1994
[12] Aristote Cateacutegories Vrin Paris 1994 chapitres 10 et 11[13] Aristote Cateacutegories chapitre 5 3b22ndash33[14] P Kourilsky J-M Claverie The peptidic self model
hypothesis on the molecular nature of the immunological sAnn Immunol 137 (1986) 3ndash21
[15] DH Raulet RE VanceCW McMahon Regulation of thenatural killer cell receptor repertoire Annu Rev Immunol 19(2001) 291ndash330
[16] PG Ashton-Rickardt A Bandeira JR Delaney L Van KaeHP Pircher RM Zinkernagel S Tonegawa Evidence foa differential avidity model of T-cell selection in the thymuCell 76 (1994) 651ndash663
[17] C Tanchot B Lemonnier A Perarnau A Freitas B RocDifferential requirements for survival and proliferation of CDnaive or memory T cells Science 276 (1997) 2057ndash2062
[18] MS Jordan A Boesteanu AJ Reed AL Petrone AElenbeck MA Lerman A Naji AJ Caton Thymic selectioof CD4+CD25+ regulatory T cells induced by an agonist sepeptide Nat Immunol 2 (2001) 301ndash306
[19] Z Feheacutervari S Sakaguchi Development and function oCD25+CD4+ regulatory T cells Curr Opin Immunol 1(2004) 203ndash208
[20] ED Carosella N Rouas-Freiss P Paul J Dausset HLAa tolerance molecule from themajor histocompatibility com-plex Immunol Today 20 (1999) 60ndash62
[21] DW Bianchi GK Zickwolf GJ Weil S Sylvester MADeMaria Male fetal progenitor cells persist in maternal blofor as long as 27 years postpartum Proc Natl AcadUSA 93 (1996) 705ndash708
[22] D Cha K Khosrotehrani Y Kim H Stroh DW BianchKL Johnson Cervical cancer and microchimerism ObsGynecol 102 (2003) 774ndash781
[23] NK Jerne Towards a network theory of the immune systAnn Immunol 125 C (1974) 373ndash389
[24] IR Cohen The cognitive paradigm and the immunologhomunculus Immunol Today 13 (1992) 490ndash494
[25] HR Maturna FJ Varela Autopoiesis and cognition D Rdel Dordrecht The Netherlands 1980
[26] AI Tauber Moving beyond the immune self Semin Immnol 12 (2000) 241ndash248
[27] Aristote Cateacutegories chapitre 5[28] J Locke Essai sur lrsquoentendement humain 1690[29] GW Leibniz Nouveaux Essais sur lrsquoentendement humain
1765[30] D Hume Traiteacute de la nature humaine 1739
T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492 489
tre
er-niteacute
st-on-nir
eacuteestionnqtion
f-
tionles
el-s leca-lulesdeo-
rsquoilsme
ssimeeacute-
ap-
on
iiso-onc-resla
gu--rup-fsxo-(parle
agrave
onc-el-ncecel-turereacute-ent
medegraves
esdi-sonoi raquoeacuteesle
nti-
anti-ro-
ma-nti-aceinslaiteacuteionour
uelseauffet duam-eanse
tion
nue puisque pour survivre un lymphocyte doit ecircreacuteguliegraverementstimuleacute par des antigegravenesendogegravenes(a priori non pathogegravenes) Lrsquoorganisme doit en pmanence assurer pour lui-mecircme une auto-immucontenue et continue
En quoi un modegravele insistant sur la continuiteacute eil plus satisfaisant que le modegravele du soi et du nsoi Lagrave ougrave le modegravele du soi est contraint de deacutefide multiplesexceptions lrsquohypothegravese de la continuitse veut unificatrice capable de rassembler toutles observations connues sous une mecircme explicaNous consideacuterons ainsi qursquoil y a pour lrsquoessentiel cidomaines qui montrent la supeacuterioriteacute drsquoune concepde ce type
(1) Lrsquoauto-immuniteacute Lrsquohypothegravese de la continuiteacute afirme qursquoil nrsquoy a pas de diffeacuterence deprincipeentre une reacuteaction auto-immune et une reacuteacimmunitaire visant un antigegravene exogegravene dansdeux cas il se produit unerupture de continuiteacutelieacutee agrave une modification de ce avec quoi les clules immunitaires se trouvent en contact Dancas des maladies auto-immunes il y a modifition des peptides preacutesenteacutes agrave la surface des celde lrsquoorganisme ce qui aboutit agrave une rupturecontinuiteacute alors mecircme que les peptides ainsi mdifieacutes restent du laquo soi raquo preacuteciseacutement parce qusont issus du mateacuteriel geacuteneacutetique de lrsquoorganisconsideacutereacute
(2) Les cancers Les cellules canceacutereuses elles ausont issues du mateacuteriel geacuteneacutetique de lrsquoorganiset donc sont du laquo soi raquo mais les motifs antigniques agrave leur surface brisent la continuiteacute par rport agrave des tissus sains
(3) Le prolongement entre immuniteacute et reacutegulatidrsquoensemble de lrsquoorganismeContrairement agrave ceque lrsquoimmunologie contemporaine a fait jusqursquoiclrsquohypothegravese de la continuiteacute permet de ne pasler dans lrsquoorganisme les agents assurant des ftions dedeacutefense des agents responsables drsquoautfonctions Lrsquoimmuniteacute est selon lrsquohypothegravese decontinuiteacute seulement lrsquoune des activiteacutes de reacutelation de lrsquoorganisme Ainsi lrsquoactiviteacute drsquoun macrophage par exemple est deacutetermineacutee par lature de continuiteacute entre ses reacutecepteurs et les motiavec lesquels il reacuteagit que ceux-ci soient egegravenes (bacteacuterie par exemple) ou endogegravenesexemple dans le cas drsquoune cellule morte que
macrophage doit ingeacuterer) donc il nrsquoy a pasenvisager pour le macrophagedeux tacircches dis-tinctes comme le fait le modegravele du soi (fonctidrsquolaquoeacuteboueur raquo de lrsquoorganisme drsquoune part fontion immune drsquoautre part) De mecircme les clules TReg ne sont pas stimuleacutees par la preacutesede laquo non-soi raquo puisqursquoelles reacuteagissent agrave deslules immunitaires endogegravenes mais par la rupde continuiteacute exprimeacutee preacuteciseacutement par lescepteurs des cellules immunitaires qui constituleur cible
(4) Les cas de toleacuterance immunitaire La continuiteacuterend compte de lrsquoeacutetat drsquoeacutequilibre qui srsquoeacutetablitentre lrsquoindividu et des agents pathogegravenes comles bacteacuteries sur la peau On constate queqursquoapparaicirct un deacuteficit immunitaire ces bacteacuteriqui jusque-lagrave eacutetaient sans effet neacutegatif sur lrsquoinvidu concerneacute provoquent des dommages agraveencontre Le critegravere nrsquoest donc pas celui du laquo set du laquo non-soi raquo puisque les bacteacuteries concernsont tout autant du laquo non-soi raquo avant qursquoapregravesdeacuteficit immunitaire mais bien larupture de conti-nuiteacutedans les interactions reacutecepteurs-motifs ageacuteniques
(5) Les meacutecanismes drsquoinduction drsquoune toleacuterance Mecirc-me dans le systegraveme immunitairemature on cons-tate parfois une absence de reacuteaction agrave desgegravenes avec lesquels lrsquoindividu est en contact plongeacute Il est difficile de deacuteterminer lescritegraveresdecette induction de toleacuterance puisque dans lajoriteacute des cas apregraves le premier contact avec lrsquoagegravene une reacuteponse immunitaire rapide et efficse deacuteclenche au deuxiegraveme contact Neacuteanmoil existe plusieurs meacutecanismes drsquoinduction detoleacuterance dont seule lrsquohypothegravese de la continusemble pouvoir rendre compte deacutesensibilisatdans le cas des allergies toleacuterance provisoire pcertains antigegravenes du pegravere apregraves la grossesse[21]toleacuterance pour certains pathogegravenes avec lesqon est en contact prolongeacute (bacteacuteries de la pde lrsquointestin) toleacuterance plus probable drsquoune gredrsquoorgane apregraves transfusion sanguine provenanmecircme donneur drsquoorgane etc Cela permet notment drsquoarticuler lacontinuiteacute avec les eacutetats dsymbiose les nombreuses bacteacuteries situeacutees dnotre intestin facilitent la digestion et de mecircmles bacteacuteries sur notre peau assurent lrsquoeacutelimina
490 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
se-
aisreacute-ffeonthy-nceire
quemeso-
vantttreonttiondit
euxaisionen-
sursene deques Ellau raquo
a-
eacuteo-en
u-nsheacuteo-tionis-quei-
sesce
ent
s a
queuto-
si-ous
n-Lemes
titeacuteoutge-
lo-
o-eacute
n-eacute-
ionsmet cardonc
en-iteacutehegravesesde-
up-sub-vec
y-tre-com-
drsquoautres pathogegravenes qui pour leur part cauraient des dommages agrave lrsquoorganisme
Une autogreffe ou une greffe entre jumeaux vrbien qursquoelles semblent rompre la continuiteacute entrecepteurs et motifs antigeacuteniques puisque lrsquoon grepar exemple un tissu agrave la place drsquoun autre tissu stoleacutereacutees ce qui paraicirct constituer une objection agrave lrsquopothegravese de la continuiteacute Cependant cette toleacuterasrsquoexplique par le fait que pour le systegraveme immunitareceveur il nrsquoy a pas de rupture de continuiteacute puisles reacuteactions reacutecepteursndashantigegravenes restent les mecirceacutetant donneacute qursquoil nrsquoy a aucune diffeacuterence dans les mtifs antigeacuteniques et donc dans les signaux eacutemis aet apregraves la greffe De faccedilon similaire on peut eacutemelrsquohypothegravese que ce qui fait que certaines greffes smieux toleacutereacutees que drsquoautres ce nrsquoest pas la distincsoinon-soi (conformeacutement agrave ce que nous avonscertains organes comme le foie sont drsquoautant mitoleacutereacutes qursquoils sont diffeacuterents de lrsquoorgane hocircte) mla plus grande continuiteacute dans lrsquoactiviteacute de stimulatdes agents immunitaires Ce qui importe crsquoest bientendu la continuiteacutepour les cellules immunitaires etnon la continuiteacutepour nous
Les avantages de lrsquohypothegravese de la continuiteacutele modegravele du soi tels que nous venons de les preacuteter nous permettent de preacuteciser quelle est la placcette hypothegravese au sein des theacuteories immunologiproposeacutees au cours des trente derniegraveres anneacuteessrsquoappuie incontestablement sur la theacuteorie du laquo reacuteseimmunitaire apparue chez Jerne[23] puis deacuteveloppeacuteesous la forme de la reacutegulation de lrsquoauto-immuniteacute nturelle ouimmunological homunculus[24] ainsi quesous le terme controverseacute drsquoautopoiesis[25] Lrsquohy-pothegravese de la continuiteacute a en commun avec les thries du reacuteseau lrsquoideacutee qursquoune reacuteaction immune estfait uneperturbation du systegraveme[26] crsquoest-agrave-dire unemodification du comportement que le systegraveme immnitaire a eu jusqursquoici (laquo rupture de continuiteacute raquo dale cadre de notre hypothegravese) Cependant les tries du reacuteseau immunitaire proposent une concepclosede lrsquoimmuniteacute selon ses promoteurs si la dtinction soinon-soi est insatisfaisante crsquoest parcele systegraveme immunitaire nrsquoa jamais affaire qursquoagrave lumecircme[24] Agrave lrsquoopposeacute lrsquohypothegravese de la continuiteacutedonne pour objectif drsquoouvrir le systegraveme comme noulrsquoavons vu avec les cas drsquoinduction drsquoune toleacuteranimmunitaire Lrsquohypothegravese de la continuiteacute autrem
-
e
dit srsquoefforce de comprendre comment des entiteacutepriori distinctes de lrsquoorganisme peuventsrsquointeacutegrer agravelui (processus drsquoouverture et de toleacuterance) alorsles theacuteories du reacuteseau insistent sur la clocircture et lrsquoadeacutefinition de lrsquoimmuniteacute
7 Identiteacute immunitaire et identiteacute philosophique
Lrsquohypothegravese de la continuiteacute nous eacuteloigne condeacuterablement du modegravele du soi mais elle ne neacuteloigne pas pour autant de la question de lrsquoidentiteacuteNotre conviction est qursquoil est possible de penser lrsquoidetiteacute biologique sans la deacutefinir comme un laquo soi raquoconcept philosophique drsquoidentiteacute repose sur les terlatins idem (fait drsquoecirctre identique agrave soi ideacutee deper-manencedans le temps) etipse (fait de demeurer lemecircme tout en changeant partiellement il y aeacutevolu-tion dans le temps) drsquoun cocircteacute nous avons lrsquoidenimmuable dans le temps et de lrsquoautre lrsquoideacutee que tecirctre reste le mecircme tout en accueillant en lui le chanment Cette distinction rejoint la probleacutematique phisophique de lasubstance la substance est uninvariantsusceptible drsquoecirctre pour chaque individu lesupportdetoutes lesvariations[27] Deux grandes thegraveses philsophiques srsquoaffrontent sur la question de lrsquoidentitla premiegravere deacutefinit lrsquoidentiteacute par lasubstance tandisque la seconde deacutefinit lrsquoidentiteacute par lacontinuiteacute Se-lon la premiegravere thegravese ce qui fait lrsquoidentiteacute drsquoun idividu crsquoest la substance crsquoest-agrave-dire le support mtaphysique de toutes ses deacuteterminations et variatSelon la deuxiegraveme thegravese agrave lrsquoopposeacute rien ne perde preacutesupposer qursquoil existe une telle laquo substance raquocette substance est par deacutefinition inaccessible etlrsquoidentiteacute repose seulement sur lacontinuiteacutedans letemps continuiteacute des changements physiques oucore concernant lrsquoidentiteacute psychologique continudes eacutetats de conscience Le deacutebat entre ces deux tphilosophiques pourrait ecirctre illustreacute par les figuresLocke[28] et de Leibniz[29] La conception substantialiste de lrsquoidentiteacute consiste agravesupposerplus que laconception fondeacutee sur la continuiteacute (ce que lrsquoon spose en plus crsquoest preacuteciseacutement un laquo noyau raquo destantialiteacute) Or on peut agrave bon droit ecirctre drsquoaccord ale soupccedilon de Locke renforceacute par Hume[30] puisquela substanceest en elle-mecircme un noyau meacutetaphsique inatteignable pourquoi la preacutesupposer Aument dit si on peut se passer de la substance pour
T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492 491
eacute--parsesutuisuesyer
degraveler il
unuedu
-
-rerionpar
deplecele
voirneors
etezper-du
po-quiiegrave-net re-s aus
euxvec
gielleenrsquoest
soiqueeacute
en-me
en-pasni-reacute-isnti-rsn-r en-
os--
que)s
pourpreacute-me
ienge
c-
nse-
ow2)
elf12
prendre lrsquoidentiteacute pourquoi y ferait-on appel La dmarche de Locke relegraveve alors de ladeacuteflation meacutetaphysique si un mecircme pheacutenomegravene peut ecirctre expliqueacutedeux modegraveles dont lrsquoun repose sur moins drsquohypothegraveque lrsquoautre alors crsquoest le modegravele minimal qursquoil vamieux adopter Lrsquoimmunologie est au moins deples anneacutees 1940 peacutetrie de concepts philosophiqNotre rocircle devrait ecirctre dans ces conditions drsquoessadrsquoaccorder agrave ces concepts leur juste place Le modu soi se situe du cocircteacute de lrsquoidentiteacute-substance catente de deacutefinir lrsquoidentiteacute de lrsquoorganisme commenoyau substantiel dont lrsquointeacutegriteacute doit ecirctre deacutefendtandis que lrsquohypothegravese de la continuiteacute se rangecocircteacute de lrsquoidentiteacute-continuiteacute Lrsquohypothegravese de la continuiteacute par conseacutequent constitue une propositionphi-losophiquepour limiter lrsquousage des concepts philosophiques en immunologie elle srsquoefforce de reacuteiteacutedans le domaine propre de lrsquoimmunologie la deacuteflatmeacutetaphysique que lrsquoidentiteacute-continuiteacute repreacutesenterapport agrave lrsquoidentiteacute-substance
Une question cependant surgit ici lrsquohypothegravesela continuiteacute nrsquoest-elle pas finalement qursquoune simreformulation du modegravele du soi Ne dit-elle pasque les immunologistes ont toujours dit Nous nepensons pas Rien bien entendu nrsquoempecircche delrsquohypothegravese de la continuiteacute simplement comme uconception renouveleacutee du laquo soi raquo On affirmerait alseulement qursquoil srsquoagit dans ce cas dusoi compriscomme continuiteacute (comme chez Locke ou Hume)non dusoi compris comme substance (comme chLeibniz) Cette suggestion est seacuteduisante car ellemettrait une fois encore de laquo sauver raquo le modegravelesoi et du non-soi Neacuteanmoins premiegraverement lrsquohythegravese de la continuiteacute explique des pheacutenomegraveneseacutetaient mal expliqueacutes par le modegravele du soi Deuxmement et surtout faire de lrsquoidentiteacute-continuiteacute uconception renouveleacutee du laquo soi raquo serait preacuteciseacutementomber dans lrsquoerreur qui consiste en ayant recourterme trop large desoi agrave recouvrir deux significationbien distinctes lasubstanceet lacontinuiteacute Parler delaquo soi raquo crsquoest se condamner agrave ne pas distinguer les dsens agrave passer de lrsquoun agrave lrsquoautre sans justification ale risque de tout laquo substantialiser raquo en immunoloOn pourrait donc accepter lrsquoobjection selon laquece que lrsquoon propose nrsquoest qursquoune redeacutefinition du soiimmunologie mais ce que lrsquoon ne peut accepter clrsquoideacutee que le terme desoi doit ecirctre conserveacute
8 Conclusion philosophie de lrsquoidentiteacutebiologique
Quelles questions pose lrsquoanalyse du modegravele duet du non-soi pour une compreacutehension philosophide la deacutefinition biologique de lrsquoidentiteacute Lrsquoidentitbiologique pour tout ecirctre vivant deacutesignece qursquoil estbiologiquement crsquoest-agrave-dire son uniciteacute et sa diffeacuterciation spatiale Nous avons montreacute que le systegraveimmunitaire constituait bien une sorte de carte drsquoidtiteacute de lrsquoorganisme mais que cette identiteacute nrsquoeacutetaitclose agrave toute influence exteacuterieure lrsquoidentiteacute immutaire nrsquoest pas deacutefinie agrave partir drsquoun ensemble deactions de deacutefense agrave toutesles entiteacutes exogegravenes made maniegravere continuiste crsquoest-agrave-dire comme la conuiteacute spatio-temporelle des reacuteactions entre reacutecepteude lrsquoimmuniteacute et motifs antigeacuteniques (qursquoils soient edogegravenes ou exogegravenes) Degraves lors peut se dessineparticulier agrave partir de lrsquoideacutee drsquoinduction de la toleacuterance immunitaire une reacuteflexion eacutelargie sur la psibiliteacute de deacutefinir lrsquoidentiteacute biologique (agrave la fois pheacutenotypique et en amont geacuteneacutetique ou para-geacuteneacuteticomme une identiteacuteouverte articulant agrave la fois deeacuteleacutements endogegravenes et des eacuteleacutements exogegravenesdeacuteterminer en derniegravere instance le propre toujourscaire et toujours combineacute (laquo impur raquo) drsquoun organisvivant donneacute
Remerciements
Nous remercions pour leur aide et leur soutAnouk Barberousse Claude Debru Michel MoranJean Gayon Ceacutedric Brun et Hannah-Louise Clark
Reacutefeacuterences
[1] FM Burnet F Fenner The Production of Antibodies Mamillan Melbourne 1941 2e eacutedition en 1949
[2] MS Anderson ES Venanzi L Klein Z Chen SP BerziSJ Turley H von Boehmer R Bronson A Dierich C Bnoist D Mathis Projection of an Immunological Self ShadWithin the Thymus by the Aire Protein Science 298 (2001395ndash1401
[3] RE Langman M Cohn A minimal model for the self-nonsdiscrimination a return to the basics Semin Immunol(2000) 189ndash195
492 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
self
uil
ty
ofd
de
-
aelf
rrs
ha8
Ho-nlf-
f6
-G
odSci
itet
em
ical
ei-
u-
[4] P Matzinger The danger model a renewed sense ofScience 296 (2002) 301ndash305
[5] J Bernard M Bessis C Debru (dir) Soi et non-soi SeParis 1990
[6] FM Burnet Changing Patterns An Atypical AutobiographyHeinemann Melbourne 1968
[7] M Morange La part des gegravenes Odile Jacob Paris 1998[8] FM Burnet The Integrity of the Body Harvard Universi
Press Cambridge 1962[9] AI Tauber L Chernyak Metchnikoff and the Origins
Immunology Oxford University Press New York Oxfor1991
[10] A-M Moulin Le dernier langage de la meacutedecine ndash histoirelrsquoimmunologie de Pasteur au Sida PUF Paris 1991
[11] AI Tauber The Immune Self Theory or metaphor Cambridge University Press Cambridge 1994
[12] Aristote Cateacutegories Vrin Paris 1994 chapitres 10 et 11[13] Aristote Cateacutegories chapitre 5 3b22ndash33[14] P Kourilsky J-M Claverie The peptidic self model
hypothesis on the molecular nature of the immunological sAnn Immunol 137 (1986) 3ndash21
[15] DH Raulet RE VanceCW McMahon Regulation of thenatural killer cell receptor repertoire Annu Rev Immunol 19(2001) 291ndash330
[16] PG Ashton-Rickardt A Bandeira JR Delaney L Van KaeHP Pircher RM Zinkernagel S Tonegawa Evidence foa differential avidity model of T-cell selection in the thymuCell 76 (1994) 651ndash663
[17] C Tanchot B Lemonnier A Perarnau A Freitas B RocDifferential requirements for survival and proliferation of CDnaive or memory T cells Science 276 (1997) 2057ndash2062
[18] MS Jordan A Boesteanu AJ Reed AL Petrone AElenbeck MA Lerman A Naji AJ Caton Thymic selectioof CD4+CD25+ regulatory T cells induced by an agonist sepeptide Nat Immunol 2 (2001) 301ndash306
[19] Z Feheacutervari S Sakaguchi Development and function oCD25+CD4+ regulatory T cells Curr Opin Immunol 1(2004) 203ndash208
[20] ED Carosella N Rouas-Freiss P Paul J Dausset HLAa tolerance molecule from themajor histocompatibility com-plex Immunol Today 20 (1999) 60ndash62
[21] DW Bianchi GK Zickwolf GJ Weil S Sylvester MADeMaria Male fetal progenitor cells persist in maternal blofor as long as 27 years postpartum Proc Natl AcadUSA 93 (1996) 705ndash708
[22] D Cha K Khosrotehrani Y Kim H Stroh DW BianchKL Johnson Cervical cancer and microchimerism ObsGynecol 102 (2003) 774ndash781
[23] NK Jerne Towards a network theory of the immune systAnn Immunol 125 C (1974) 373ndash389
[24] IR Cohen The cognitive paradigm and the immunologhomunculus Immunol Today 13 (1992) 490ndash494
[25] HR Maturna FJ Varela Autopoiesis and cognition D Rdel Dordrecht The Netherlands 1980
[26] AI Tauber Moving beyond the immune self Semin Immnol 12 (2000) 241ndash248
[27] Aristote Cateacutegories chapitre 5[28] J Locke Essai sur lrsquoentendement humain 1690[29] GW Leibniz Nouveaux Essais sur lrsquoentendement humain
1765[30] D Hume Traiteacute de la nature humaine 1739
490 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
se-
aisreacute-ffeonthy-nceire
quemeso-
vantttreonttiondit
euxaisionen-
sursene deques Ellau raquo
a-
eacuteo-en
u-nsheacuteo-tionis-quei-
sesce
ent
s a
queuto-
si-ous
n-Lemes
titeacuteoutge-
lo-
o-eacute
n-eacute-
ionsmet cardonc
en-iteacutehegravesesde-
up-sub-vec
y-tre-com-
drsquoautres pathogegravenes qui pour leur part cauraient des dommages agrave lrsquoorganisme
Une autogreffe ou une greffe entre jumeaux vrbien qursquoelles semblent rompre la continuiteacute entrecepteurs et motifs antigeacuteniques puisque lrsquoon grepar exemple un tissu agrave la place drsquoun autre tissu stoleacutereacutees ce qui paraicirct constituer une objection agrave lrsquopothegravese de la continuiteacute Cependant cette toleacuterasrsquoexplique par le fait que pour le systegraveme immunitareceveur il nrsquoy a pas de rupture de continuiteacute puisles reacuteactions reacutecepteursndashantigegravenes restent les mecirceacutetant donneacute qursquoil nrsquoy a aucune diffeacuterence dans les mtifs antigeacuteniques et donc dans les signaux eacutemis aet apregraves la greffe De faccedilon similaire on peut eacutemelrsquohypothegravese que ce qui fait que certaines greffes smieux toleacutereacutees que drsquoautres ce nrsquoest pas la distincsoinon-soi (conformeacutement agrave ce que nous avonscertains organes comme le foie sont drsquoautant mitoleacutereacutes qursquoils sont diffeacuterents de lrsquoorgane hocircte) mla plus grande continuiteacute dans lrsquoactiviteacute de stimulatdes agents immunitaires Ce qui importe crsquoest bientendu la continuiteacutepour les cellules immunitaires etnon la continuiteacutepour nous
Les avantages de lrsquohypothegravese de la continuiteacutele modegravele du soi tels que nous venons de les preacuteter nous permettent de preacuteciser quelle est la placcette hypothegravese au sein des theacuteories immunologiproposeacutees au cours des trente derniegraveres anneacuteessrsquoappuie incontestablement sur la theacuteorie du laquo reacuteseimmunitaire apparue chez Jerne[23] puis deacuteveloppeacuteesous la forme de la reacutegulation de lrsquoauto-immuniteacute nturelle ouimmunological homunculus[24] ainsi quesous le terme controverseacute drsquoautopoiesis[25] Lrsquohy-pothegravese de la continuiteacute a en commun avec les thries du reacuteseau lrsquoideacutee qursquoune reacuteaction immune estfait uneperturbation du systegraveme[26] crsquoest-agrave-dire unemodification du comportement que le systegraveme immnitaire a eu jusqursquoici (laquo rupture de continuiteacute raquo dale cadre de notre hypothegravese) Cependant les tries du reacuteseau immunitaire proposent une concepclosede lrsquoimmuniteacute selon ses promoteurs si la dtinction soinon-soi est insatisfaisante crsquoest parcele systegraveme immunitaire nrsquoa jamais affaire qursquoagrave lumecircme[24] Agrave lrsquoopposeacute lrsquohypothegravese de la continuiteacutedonne pour objectif drsquoouvrir le systegraveme comme noulrsquoavons vu avec les cas drsquoinduction drsquoune toleacuteranimmunitaire Lrsquohypothegravese de la continuiteacute autrem
-
e
dit srsquoefforce de comprendre comment des entiteacutepriori distinctes de lrsquoorganisme peuventsrsquointeacutegrer agravelui (processus drsquoouverture et de toleacuterance) alorsles theacuteories du reacuteseau insistent sur la clocircture et lrsquoadeacutefinition de lrsquoimmuniteacute
7 Identiteacute immunitaire et identiteacute philosophique
Lrsquohypothegravese de la continuiteacute nous eacuteloigne condeacuterablement du modegravele du soi mais elle ne neacuteloigne pas pour autant de la question de lrsquoidentiteacuteNotre conviction est qursquoil est possible de penser lrsquoidetiteacute biologique sans la deacutefinir comme un laquo soi raquoconcept philosophique drsquoidentiteacute repose sur les terlatins idem (fait drsquoecirctre identique agrave soi ideacutee deper-manencedans le temps) etipse (fait de demeurer lemecircme tout en changeant partiellement il y aeacutevolu-tion dans le temps) drsquoun cocircteacute nous avons lrsquoidenimmuable dans le temps et de lrsquoautre lrsquoideacutee que tecirctre reste le mecircme tout en accueillant en lui le chanment Cette distinction rejoint la probleacutematique phisophique de lasubstance la substance est uninvariantsusceptible drsquoecirctre pour chaque individu lesupportdetoutes lesvariations[27] Deux grandes thegraveses philsophiques srsquoaffrontent sur la question de lrsquoidentitla premiegravere deacutefinit lrsquoidentiteacute par lasubstance tandisque la seconde deacutefinit lrsquoidentiteacute par lacontinuiteacute Se-lon la premiegravere thegravese ce qui fait lrsquoidentiteacute drsquoun idividu crsquoest la substance crsquoest-agrave-dire le support mtaphysique de toutes ses deacuteterminations et variatSelon la deuxiegraveme thegravese agrave lrsquoopposeacute rien ne perde preacutesupposer qursquoil existe une telle laquo substance raquocette substance est par deacutefinition inaccessible etlrsquoidentiteacute repose seulement sur lacontinuiteacutedans letemps continuiteacute des changements physiques oucore concernant lrsquoidentiteacute psychologique continudes eacutetats de conscience Le deacutebat entre ces deux tphilosophiques pourrait ecirctre illustreacute par les figuresLocke[28] et de Leibniz[29] La conception substantialiste de lrsquoidentiteacute consiste agravesupposerplus que laconception fondeacutee sur la continuiteacute (ce que lrsquoon spose en plus crsquoest preacuteciseacutement un laquo noyau raquo destantialiteacute) Or on peut agrave bon droit ecirctre drsquoaccord ale soupccedilon de Locke renforceacute par Hume[30] puisquela substanceest en elle-mecircme un noyau meacutetaphsique inatteignable pourquoi la preacutesupposer Aument dit si on peut se passer de la substance pour
T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492 491
eacute--parsesutuisuesyer
degraveler il
unuedu
-
-rerionpar
deplecele
voirneors
etezper-du
po-quiiegrave-net re-s aus
euxvec
gielleenrsquoest
soiqueeacute
en-me
en-pasni-reacute-isnti-rsn-r en-
os--
que)s
pourpreacute-me
ienge
c-
nse-
ow2)
elf12
prendre lrsquoidentiteacute pourquoi y ferait-on appel La dmarche de Locke relegraveve alors de ladeacuteflation meacutetaphysique si un mecircme pheacutenomegravene peut ecirctre expliqueacutedeux modegraveles dont lrsquoun repose sur moins drsquohypothegraveque lrsquoautre alors crsquoest le modegravele minimal qursquoil vamieux adopter Lrsquoimmunologie est au moins deples anneacutees 1940 peacutetrie de concepts philosophiqNotre rocircle devrait ecirctre dans ces conditions drsquoessadrsquoaccorder agrave ces concepts leur juste place Le modu soi se situe du cocircteacute de lrsquoidentiteacute-substance catente de deacutefinir lrsquoidentiteacute de lrsquoorganisme commenoyau substantiel dont lrsquointeacutegriteacute doit ecirctre deacutefendtandis que lrsquohypothegravese de la continuiteacute se rangecocircteacute de lrsquoidentiteacute-continuiteacute Lrsquohypothegravese de la continuiteacute par conseacutequent constitue une propositionphi-losophiquepour limiter lrsquousage des concepts philosophiques en immunologie elle srsquoefforce de reacuteiteacutedans le domaine propre de lrsquoimmunologie la deacuteflatmeacutetaphysique que lrsquoidentiteacute-continuiteacute repreacutesenterapport agrave lrsquoidentiteacute-substance
Une question cependant surgit ici lrsquohypothegravesela continuiteacute nrsquoest-elle pas finalement qursquoune simreformulation du modegravele du soi Ne dit-elle pasque les immunologistes ont toujours dit Nous nepensons pas Rien bien entendu nrsquoempecircche delrsquohypothegravese de la continuiteacute simplement comme uconception renouveleacutee du laquo soi raquo On affirmerait alseulement qursquoil srsquoagit dans ce cas dusoi compriscomme continuiteacute (comme chez Locke ou Hume)non dusoi compris comme substance (comme chLeibniz) Cette suggestion est seacuteduisante car ellemettrait une fois encore de laquo sauver raquo le modegravelesoi et du non-soi Neacuteanmoins premiegraverement lrsquohythegravese de la continuiteacute explique des pheacutenomegraveneseacutetaient mal expliqueacutes par le modegravele du soi Deuxmement et surtout faire de lrsquoidentiteacute-continuiteacute uconception renouveleacutee du laquo soi raquo serait preacuteciseacutementomber dans lrsquoerreur qui consiste en ayant recourterme trop large desoi agrave recouvrir deux significationbien distinctes lasubstanceet lacontinuiteacute Parler delaquo soi raquo crsquoest se condamner agrave ne pas distinguer les dsens agrave passer de lrsquoun agrave lrsquoautre sans justification ale risque de tout laquo substantialiser raquo en immunoloOn pourrait donc accepter lrsquoobjection selon laquece que lrsquoon propose nrsquoest qursquoune redeacutefinition du soiimmunologie mais ce que lrsquoon ne peut accepter clrsquoideacutee que le terme desoi doit ecirctre conserveacute
8 Conclusion philosophie de lrsquoidentiteacutebiologique
Quelles questions pose lrsquoanalyse du modegravele duet du non-soi pour une compreacutehension philosophide la deacutefinition biologique de lrsquoidentiteacute Lrsquoidentitbiologique pour tout ecirctre vivant deacutesignece qursquoil estbiologiquement crsquoest-agrave-dire son uniciteacute et sa diffeacuterciation spatiale Nous avons montreacute que le systegraveimmunitaire constituait bien une sorte de carte drsquoidtiteacute de lrsquoorganisme mais que cette identiteacute nrsquoeacutetaitclose agrave toute influence exteacuterieure lrsquoidentiteacute immutaire nrsquoest pas deacutefinie agrave partir drsquoun ensemble deactions de deacutefense agrave toutesles entiteacutes exogegravenes made maniegravere continuiste crsquoest-agrave-dire comme la conuiteacute spatio-temporelle des reacuteactions entre reacutecepteude lrsquoimmuniteacute et motifs antigeacuteniques (qursquoils soient edogegravenes ou exogegravenes) Degraves lors peut se dessineparticulier agrave partir de lrsquoideacutee drsquoinduction de la toleacuterance immunitaire une reacuteflexion eacutelargie sur la psibiliteacute de deacutefinir lrsquoidentiteacute biologique (agrave la fois pheacutenotypique et en amont geacuteneacutetique ou para-geacuteneacuteticomme une identiteacuteouverte articulant agrave la fois deeacuteleacutements endogegravenes et des eacuteleacutements exogegravenesdeacuteterminer en derniegravere instance le propre toujourscaire et toujours combineacute (laquo impur raquo) drsquoun organisvivant donneacute
Remerciements
Nous remercions pour leur aide et leur soutAnouk Barberousse Claude Debru Michel MoranJean Gayon Ceacutedric Brun et Hannah-Louise Clark
Reacutefeacuterences
[1] FM Burnet F Fenner The Production of Antibodies Mamillan Melbourne 1941 2e eacutedition en 1949
[2] MS Anderson ES Venanzi L Klein Z Chen SP BerziSJ Turley H von Boehmer R Bronson A Dierich C Bnoist D Mathis Projection of an Immunological Self ShadWithin the Thymus by the Aire Protein Science 298 (2001395ndash1401
[3] RE Langman M Cohn A minimal model for the self-nonsdiscrimination a return to the basics Semin Immunol(2000) 189ndash195
492 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
self
uil
ty
ofd
de
-
aelf
rrs
ha8
Ho-nlf-
f6
-G
odSci
itet
em
ical
ei-
u-
[4] P Matzinger The danger model a renewed sense ofScience 296 (2002) 301ndash305
[5] J Bernard M Bessis C Debru (dir) Soi et non-soi SeParis 1990
[6] FM Burnet Changing Patterns An Atypical AutobiographyHeinemann Melbourne 1968
[7] M Morange La part des gegravenes Odile Jacob Paris 1998[8] FM Burnet The Integrity of the Body Harvard Universi
Press Cambridge 1962[9] AI Tauber L Chernyak Metchnikoff and the Origins
Immunology Oxford University Press New York Oxfor1991
[10] A-M Moulin Le dernier langage de la meacutedecine ndash histoirelrsquoimmunologie de Pasteur au Sida PUF Paris 1991
[11] AI Tauber The Immune Self Theory or metaphor Cambridge University Press Cambridge 1994
[12] Aristote Cateacutegories Vrin Paris 1994 chapitres 10 et 11[13] Aristote Cateacutegories chapitre 5 3b22ndash33[14] P Kourilsky J-M Claverie The peptidic self model
hypothesis on the molecular nature of the immunological sAnn Immunol 137 (1986) 3ndash21
[15] DH Raulet RE VanceCW McMahon Regulation of thenatural killer cell receptor repertoire Annu Rev Immunol 19(2001) 291ndash330
[16] PG Ashton-Rickardt A Bandeira JR Delaney L Van KaeHP Pircher RM Zinkernagel S Tonegawa Evidence foa differential avidity model of T-cell selection in the thymuCell 76 (1994) 651ndash663
[17] C Tanchot B Lemonnier A Perarnau A Freitas B RocDifferential requirements for survival and proliferation of CDnaive or memory T cells Science 276 (1997) 2057ndash2062
[18] MS Jordan A Boesteanu AJ Reed AL Petrone AElenbeck MA Lerman A Naji AJ Caton Thymic selectioof CD4+CD25+ regulatory T cells induced by an agonist sepeptide Nat Immunol 2 (2001) 301ndash306
[19] Z Feheacutervari S Sakaguchi Development and function oCD25+CD4+ regulatory T cells Curr Opin Immunol 1(2004) 203ndash208
[20] ED Carosella N Rouas-Freiss P Paul J Dausset HLAa tolerance molecule from themajor histocompatibility com-plex Immunol Today 20 (1999) 60ndash62
[21] DW Bianchi GK Zickwolf GJ Weil S Sylvester MADeMaria Male fetal progenitor cells persist in maternal blofor as long as 27 years postpartum Proc Natl AcadUSA 93 (1996) 705ndash708
[22] D Cha K Khosrotehrani Y Kim H Stroh DW BianchKL Johnson Cervical cancer and microchimerism ObsGynecol 102 (2003) 774ndash781
[23] NK Jerne Towards a network theory of the immune systAnn Immunol 125 C (1974) 373ndash389
[24] IR Cohen The cognitive paradigm and the immunologhomunculus Immunol Today 13 (1992) 490ndash494
[25] HR Maturna FJ Varela Autopoiesis and cognition D Rdel Dordrecht The Netherlands 1980
[26] AI Tauber Moving beyond the immune self Semin Immnol 12 (2000) 241ndash248
[27] Aristote Cateacutegories chapitre 5[28] J Locke Essai sur lrsquoentendement humain 1690[29] GW Leibniz Nouveaux Essais sur lrsquoentendement humain
1765[30] D Hume Traiteacute de la nature humaine 1739
T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492 491
eacute--parsesutuisuesyer
degraveler il
unuedu
-
-rerionpar
deplecele
voirneors
etezper-du
po-quiiegrave-net re-s aus
euxvec
gielleenrsquoest
soiqueeacute
en-me
en-pasni-reacute-isnti-rsn-r en-
os--
que)s
pourpreacute-me
ienge
c-
nse-
ow2)
elf12
prendre lrsquoidentiteacute pourquoi y ferait-on appel La dmarche de Locke relegraveve alors de ladeacuteflation meacutetaphysique si un mecircme pheacutenomegravene peut ecirctre expliqueacutedeux modegraveles dont lrsquoun repose sur moins drsquohypothegraveque lrsquoautre alors crsquoest le modegravele minimal qursquoil vamieux adopter Lrsquoimmunologie est au moins deples anneacutees 1940 peacutetrie de concepts philosophiqNotre rocircle devrait ecirctre dans ces conditions drsquoessadrsquoaccorder agrave ces concepts leur juste place Le modu soi se situe du cocircteacute de lrsquoidentiteacute-substance catente de deacutefinir lrsquoidentiteacute de lrsquoorganisme commenoyau substantiel dont lrsquointeacutegriteacute doit ecirctre deacutefendtandis que lrsquohypothegravese de la continuiteacute se rangecocircteacute de lrsquoidentiteacute-continuiteacute Lrsquohypothegravese de la continuiteacute par conseacutequent constitue une propositionphi-losophiquepour limiter lrsquousage des concepts philosophiques en immunologie elle srsquoefforce de reacuteiteacutedans le domaine propre de lrsquoimmunologie la deacuteflatmeacutetaphysique que lrsquoidentiteacute-continuiteacute repreacutesenterapport agrave lrsquoidentiteacute-substance
Une question cependant surgit ici lrsquohypothegravesela continuiteacute nrsquoest-elle pas finalement qursquoune simreformulation du modegravele du soi Ne dit-elle pasque les immunologistes ont toujours dit Nous nepensons pas Rien bien entendu nrsquoempecircche delrsquohypothegravese de la continuiteacute simplement comme uconception renouveleacutee du laquo soi raquo On affirmerait alseulement qursquoil srsquoagit dans ce cas dusoi compriscomme continuiteacute (comme chez Locke ou Hume)non dusoi compris comme substance (comme chLeibniz) Cette suggestion est seacuteduisante car ellemettrait une fois encore de laquo sauver raquo le modegravelesoi et du non-soi Neacuteanmoins premiegraverement lrsquohythegravese de la continuiteacute explique des pheacutenomegraveneseacutetaient mal expliqueacutes par le modegravele du soi Deuxmement et surtout faire de lrsquoidentiteacute-continuiteacute uconception renouveleacutee du laquo soi raquo serait preacuteciseacutementomber dans lrsquoerreur qui consiste en ayant recourterme trop large desoi agrave recouvrir deux significationbien distinctes lasubstanceet lacontinuiteacute Parler delaquo soi raquo crsquoest se condamner agrave ne pas distinguer les dsens agrave passer de lrsquoun agrave lrsquoautre sans justification ale risque de tout laquo substantialiser raquo en immunoloOn pourrait donc accepter lrsquoobjection selon laquece que lrsquoon propose nrsquoest qursquoune redeacutefinition du soiimmunologie mais ce que lrsquoon ne peut accepter clrsquoideacutee que le terme desoi doit ecirctre conserveacute
8 Conclusion philosophie de lrsquoidentiteacutebiologique
Quelles questions pose lrsquoanalyse du modegravele duet du non-soi pour une compreacutehension philosophide la deacutefinition biologique de lrsquoidentiteacute Lrsquoidentitbiologique pour tout ecirctre vivant deacutesignece qursquoil estbiologiquement crsquoest-agrave-dire son uniciteacute et sa diffeacuterciation spatiale Nous avons montreacute que le systegraveimmunitaire constituait bien une sorte de carte drsquoidtiteacute de lrsquoorganisme mais que cette identiteacute nrsquoeacutetaitclose agrave toute influence exteacuterieure lrsquoidentiteacute immutaire nrsquoest pas deacutefinie agrave partir drsquoun ensemble deactions de deacutefense agrave toutesles entiteacutes exogegravenes made maniegravere continuiste crsquoest-agrave-dire comme la conuiteacute spatio-temporelle des reacuteactions entre reacutecepteude lrsquoimmuniteacute et motifs antigeacuteniques (qursquoils soient edogegravenes ou exogegravenes) Degraves lors peut se dessineparticulier agrave partir de lrsquoideacutee drsquoinduction de la toleacuterance immunitaire une reacuteflexion eacutelargie sur la psibiliteacute de deacutefinir lrsquoidentiteacute biologique (agrave la fois pheacutenotypique et en amont geacuteneacutetique ou para-geacuteneacuteticomme une identiteacuteouverte articulant agrave la fois deeacuteleacutements endogegravenes et des eacuteleacutements exogegravenesdeacuteterminer en derniegravere instance le propre toujourscaire et toujours combineacute (laquo impur raquo) drsquoun organisvivant donneacute
Remerciements
Nous remercions pour leur aide et leur soutAnouk Barberousse Claude Debru Michel MoranJean Gayon Ceacutedric Brun et Hannah-Louise Clark
Reacutefeacuterences
[1] FM Burnet F Fenner The Production of Antibodies Mamillan Melbourne 1941 2e eacutedition en 1949
[2] MS Anderson ES Venanzi L Klein Z Chen SP BerziSJ Turley H von Boehmer R Bronson A Dierich C Bnoist D Mathis Projection of an Immunological Self ShadWithin the Thymus by the Aire Protein Science 298 (2001395ndash1401
[3] RE Langman M Cohn A minimal model for the self-nonsdiscrimination a return to the basics Semin Immunol(2000) 189ndash195
492 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
self
uil
ty
ofd
de
-
aelf
rrs
ha8
Ho-nlf-
f6
-G
odSci
itet
em
ical
ei-
u-
[4] P Matzinger The danger model a renewed sense ofScience 296 (2002) 301ndash305
[5] J Bernard M Bessis C Debru (dir) Soi et non-soi SeParis 1990
[6] FM Burnet Changing Patterns An Atypical AutobiographyHeinemann Melbourne 1968
[7] M Morange La part des gegravenes Odile Jacob Paris 1998[8] FM Burnet The Integrity of the Body Harvard Universi
Press Cambridge 1962[9] AI Tauber L Chernyak Metchnikoff and the Origins
Immunology Oxford University Press New York Oxfor1991
[10] A-M Moulin Le dernier langage de la meacutedecine ndash histoirelrsquoimmunologie de Pasteur au Sida PUF Paris 1991
[11] AI Tauber The Immune Self Theory or metaphor Cambridge University Press Cambridge 1994
[12] Aristote Cateacutegories Vrin Paris 1994 chapitres 10 et 11[13] Aristote Cateacutegories chapitre 5 3b22ndash33[14] P Kourilsky J-M Claverie The peptidic self model
hypothesis on the molecular nature of the immunological sAnn Immunol 137 (1986) 3ndash21
[15] DH Raulet RE VanceCW McMahon Regulation of thenatural killer cell receptor repertoire Annu Rev Immunol 19(2001) 291ndash330
[16] PG Ashton-Rickardt A Bandeira JR Delaney L Van KaeHP Pircher RM Zinkernagel S Tonegawa Evidence foa differential avidity model of T-cell selection in the thymuCell 76 (1994) 651ndash663
[17] C Tanchot B Lemonnier A Perarnau A Freitas B RocDifferential requirements for survival and proliferation of CDnaive or memory T cells Science 276 (1997) 2057ndash2062
[18] MS Jordan A Boesteanu AJ Reed AL Petrone AElenbeck MA Lerman A Naji AJ Caton Thymic selectioof CD4+CD25+ regulatory T cells induced by an agonist sepeptide Nat Immunol 2 (2001) 301ndash306
[19] Z Feheacutervari S Sakaguchi Development and function oCD25+CD4+ regulatory T cells Curr Opin Immunol 1(2004) 203ndash208
[20] ED Carosella N Rouas-Freiss P Paul J Dausset HLAa tolerance molecule from themajor histocompatibility com-plex Immunol Today 20 (1999) 60ndash62
[21] DW Bianchi GK Zickwolf GJ Weil S Sylvester MADeMaria Male fetal progenitor cells persist in maternal blofor as long as 27 years postpartum Proc Natl AcadUSA 93 (1996) 705ndash708
[22] D Cha K Khosrotehrani Y Kim H Stroh DW BianchKL Johnson Cervical cancer and microchimerism ObsGynecol 102 (2003) 774ndash781
[23] NK Jerne Towards a network theory of the immune systAnn Immunol 125 C (1974) 373ndash389
[24] IR Cohen The cognitive paradigm and the immunologhomunculus Immunol Today 13 (1992) 490ndash494
[25] HR Maturna FJ Varela Autopoiesis and cognition D Rdel Dordrecht The Netherlands 1980
[26] AI Tauber Moving beyond the immune self Semin Immnol 12 (2000) 241ndash248
[27] Aristote Cateacutegories chapitre 5[28] J Locke Essai sur lrsquoentendement humain 1690[29] GW Leibniz Nouveaux Essais sur lrsquoentendement humain
1765[30] D Hume Traiteacute de la nature humaine 1739
492 T Pradeu ED Carosella C R Biologies 327 (2004) 481ndash492
self
uil
ty
ofd
de
-
aelf
rrs
ha8
Ho-nlf-
f6
-G
odSci
itet
em
ical
ei-
u-
[4] P Matzinger The danger model a renewed sense ofScience 296 (2002) 301ndash305
[5] J Bernard M Bessis C Debru (dir) Soi et non-soi SeParis 1990
[6] FM Burnet Changing Patterns An Atypical AutobiographyHeinemann Melbourne 1968
[7] M Morange La part des gegravenes Odile Jacob Paris 1998[8] FM Burnet The Integrity of the Body Harvard Universi
Press Cambridge 1962[9] AI Tauber L Chernyak Metchnikoff and the Origins
Immunology Oxford University Press New York Oxfor1991
[10] A-M Moulin Le dernier langage de la meacutedecine ndash histoirelrsquoimmunologie de Pasteur au Sida PUF Paris 1991
[11] AI Tauber The Immune Self Theory or metaphor Cambridge University Press Cambridge 1994
[12] Aristote Cateacutegories Vrin Paris 1994 chapitres 10 et 11[13] Aristote Cateacutegories chapitre 5 3b22ndash33[14] P Kourilsky J-M Claverie The peptidic self model
hypothesis on the molecular nature of the immunological sAnn Immunol 137 (1986) 3ndash21
[15] DH Raulet RE VanceCW McMahon Regulation of thenatural killer cell receptor repertoire Annu Rev Immunol 19(2001) 291ndash330
[16] PG Ashton-Rickardt A Bandeira JR Delaney L Van KaeHP Pircher RM Zinkernagel S Tonegawa Evidence foa differential avidity model of T-cell selection in the thymuCell 76 (1994) 651ndash663
[17] C Tanchot B Lemonnier A Perarnau A Freitas B RocDifferential requirements for survival and proliferation of CDnaive or memory T cells Science 276 (1997) 2057ndash2062
[18] MS Jordan A Boesteanu AJ Reed AL Petrone AElenbeck MA Lerman A Naji AJ Caton Thymic selectioof CD4+CD25+ regulatory T cells induced by an agonist sepeptide Nat Immunol 2 (2001) 301ndash306
[19] Z Feheacutervari S Sakaguchi Development and function oCD25+CD4+ regulatory T cells Curr Opin Immunol 1(2004) 203ndash208
[20] ED Carosella N Rouas-Freiss P Paul J Dausset HLAa tolerance molecule from themajor histocompatibility com-plex Immunol Today 20 (1999) 60ndash62
[21] DW Bianchi GK Zickwolf GJ Weil S Sylvester MADeMaria Male fetal progenitor cells persist in maternal blofor as long as 27 years postpartum Proc Natl AcadUSA 93 (1996) 705ndash708
[22] D Cha K Khosrotehrani Y Kim H Stroh DW BianchKL Johnson Cervical cancer and microchimerism ObsGynecol 102 (2003) 774ndash781
[23] NK Jerne Towards a network theory of the immune systAnn Immunol 125 C (1974) 373ndash389
[24] IR Cohen The cognitive paradigm and the immunologhomunculus Immunol Today 13 (1992) 490ndash494
[25] HR Maturna FJ Varela Autopoiesis and cognition D Rdel Dordrecht The Netherlands 1980
[26] AI Tauber Moving beyond the immune self Semin Immnol 12 (2000) 241ndash248
[27] Aristote Cateacutegories chapitre 5[28] J Locke Essai sur lrsquoentendement humain 1690[29] GW Leibniz Nouveaux Essais sur lrsquoentendement humain
1765[30] D Hume Traiteacute de la nature humaine 1739