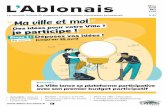La modalisation du discours de soi : éléments de description sémantique des expressions pour moi,...
-
Upload
uantwerpen -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of La modalisation du discours de soi : éléments de description sémantique des expressions pour moi,...
Armand Colin is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Langue Française.
http://www.jstor.org
Armand Colin
La modalisation du discours de soi : éléments de description sémantique des expressions "pourmoi, selon moi" et "à mon avis" Author(s): Danielle COLTIER and Patrick DENDALE Source: Langue Française, No. 142, Procédés de modalisation : l'atténuation (JUIN 2004), pp. 41-57
Published by: Armand ColinStable URL: http://www.jstor.org/stable/41559126Accessed: 08-04-2015 10:10 UTC
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of contentin a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship.For more information about JSTOR, please contact [email protected].
This content downloaded from 146.175.13.30 on Wed, 08 Apr 2015 10:10:26 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Danielle COLTIER Université du Maine & Université de Metz Patrick PENDALE Université d'Anvers & Université de Metz
La modalisation du discours de soi :
éléments de description sémantique
des expressions pour moi, selon moi
et à mon avis1
I. EXPRESSIONS DE MODALISATION
Ce qui caractérise à première vue des expressions comme selon N, pour N, et à son avis , c'est qu'elles permettent, dans au moins un de leurs emplois, de rapporter les propos ou les pensées d'autrui :
(1) Selon elle, ce terrain, endigué, appartient au domaine public de l'État, ce qui le rend inaliénable et incessible. (Le Point)
(2) Cécile tente de la détacher de cette histoire qui ne peut, à son avis, que mal finir. (Le Point)
(3) Mais, même si le nouveau président renonce aux méthodes guerrières qu'il prônait il y a peu, ses objectifs n'ont pas changé : pour lui, l'avenir de la RS se joue en Serbie, pas en Bosnie. (Le Point)
Authier-Revuz (1992-1993) regroupe ces expressions dans une catégorie qu'elle appelle marqueurs de « modalisation en discours second », distincte de celle des marqueurs de « représentation du discours autre ». Les marqueurs de modalisa- tion en discours second constituent chez elle une classe très large d'expressions, à l'intérieur de laquelle ces trois marqueurs constituent un sous-groupe que nous pensons pouvoir qualifier de « médiatifs » ou d'« évidentiels » (cf. Dendale & Coltier, à paraître).
1. Nous remercions les deux lecteurs anonymes de leurs remarques sur une version antérieure de cet article. Elles ont permis de préciser le texte sur certains points.
LANGUI FRANÇAISE 142 41
This content downloaded from 146.175.13.30 on Wed, 08 Apr 2015 10:10:26 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Procédés de modalisation : l'atténuation
Accompagnées d'un pronom personnel ou d'un adjectif possessif de la première personne plutôt que d'un groupe nominal, pronom ou adjectif possessif de la troi- sième personne, ces trois expressions ont généralement une tout autre fonction que de renvoyer à un discours (ou une pensée) autre :
(4) Selon moi, le sens de la vie consiste à se mettre en état de réaliser une vie commune. (Le Point)
(5) Pour moi, tous les juifs sont blancs, portent des lunettes et sont cultivés. (Le Point)
(6) Organiser une fusion artificielle est à mon avis contre-productif. (Le Point) Le but de cet article est d'essayer de définir la fonction ou la valeur sémantique de ces trois expressions, selon moi , pour moi et à mon avis lorsqu'elles sont exophrastiques, et de mettre au jour quelques-unes de leurs différences d'emploi. Leur description sémantique nous permettra de définir aussi quel type de modalisation elles opèrent.
2. LES DIFFÉRENTS EMPLOIS SYNTAXIQUES ET SÉMANTIQUES DE POUR MOI, SELON MOI ET À MON AVIS
2.L II est important de noter tout d'abord qu'il y a entre les trois expressions des différences dans le nombre de constructions syntaxiques dans lesquelles elles peuvent s'insérer.
L'expression pour moi , se prête, syntaxiquement, à deux types de fonctionnements : des fonctionnements intégrés , liés (cf. (7)) et des fonctionne- ments non intégrés , détachés (cf. (8)) :
(7) Jeanne a parlé pour moi / est venue pour moi. (8) Pour moi, Jeanne est incapable d'avoir commis cette erreur.
D'un point de vue sémantique , pour moi se prête à deux types de lectures : des lectures que Cadiot (1991) appelle participatives (ou actancielles) (9), et des lectures qu'il appelle non participatives (non actancielles), (10) à (13) :
(9) Pour moi, Jeanne a apporté des fleurs. Pour Pierre, elle a apporté un livre. (10) Restez, si vous le voulez. Pour moi, je pars. (D'après Cadiot, 1991 : 219) (11) Pour moi, je refuse - sans que je puisse justifier ce refus - de faire de la
signification une partie du sens. Je préfère [...] (Ducrot, 1984 : 181) (12) Pour moi, Paul est sympathique /honteux. (D'après Cadiot, 1991 : 34) (13) Pour moi, Jules s'en moque éperdument.
Les lectures actancielles , paraphrasables par à ma place, à mon intention, allouent au référent du moi un rôle sémantique de bénéficiaire, de destinataire, etc. : il est ainsi dans un certain sens un des actants de la situation dénotée2. L'énoncé, globale- ment, dénote un fait, une situation dans le monde.
Les lectures non actancielles de pour moi se distinguent en deux valeurs : une valeur thématique, que nous noterons TH (cf. (10)-(11)), et une valeur point de vue, notée PDV (cf. (12)-(13)). La différence, sensible à l'intuition, entre TH et PDV n'est pas facile à justifier par des substitutions. Remarquons simplement (a) que en ce
2. « Actant » au sens de Tesnière (1969 : 103) : « Les actants sont des êtres ou des choses qui, à un titre quelconque et de quelque façon que ce soit, même au titre de simples figurants et de la façon la plus passive, participent au procès. »
42
This content downloaded from 146.175.13.30 on Wed, 08 Apr 2015 10:10:26 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
La modalisation du discours de soi
qui me concerne et quant à moi sont des substituts possibles de pour moi- TH et (b) qu'aucun des verbes de jugement analysés par Ducrot (1980) - je considère que, je trouve que, j'estime que, je juge que, j'ai l'impression que, je suis sûr que, je pense que, je crois que - ne lui est substituable. C'est l'inverse qui est vrai avec les pour moi-PUV, qui commutent, eux, avec à mes yeux.
Pour ce qui est de la différence entre les interprétations TH et PDV de pour moi, elle est principalement une différence de statut donné au contenu de p. Dans la lecture TH - tout comme dans les lectures actancielles - le contenu de p a le statut d'un fait (effectif ou à venir), d'un état de choses, bref, p est un énoncé constatif et le moi désigne l'individu à la fois en tant que thème de discours et en tant qu'il a, a eu, ou aura, une activité dans le monde extra-linguistique. Dans la lecture PDV, le contenu de p a le statut d'une opinion, d'un jugement, d'une pensée, d'une suppu- tation, d'une hypothèse, bref, p est ce que nous appellerons, faute de mieux, en nous inspirant de Riegel et al (1996 : 319), une vue de l'esprit, par quoi nous dési- gnons le fait que le contenu de p n'a, pour le sujet, « d'autre existence que dans sa conscience ». Le moi réfère alors à l'individu en tant que responsable de l'activité de production de cette vue de l'esprit.
Pour moi en emploi exophrastique est, des trois expressions étudiées, la plus ambiguë. Ainsi (14),
(14) Pour moi, Jules s'est fait teindre en blond. est passible aussi bien d'une lecture PDV (« Je pense que Jules s'est fait teindre en blond ») que d'une interprétation actancielle (« Jules s'est fait teindre en blond pour me faire plaisir »). Et (15),
(15) Pour moi, c'est un type utile (d'après Cadiot, 1991 : 127)
qui contient un évaluatif (cf. Cadiot 1991 : 125-126) se prête à une interprétation dans laquelle les deux lectures, participative et non participative, sont en coales- cence, i.e., présentes simultanément.
2.2. Face à cette pluralité de valeurs de pour moi exophrastiques, selon moi et à mon avis exophrastiques paraissent bien n'avoir qu'une seule interprétation, celle qui correspond à la valeur PDV de pour moi : leur commutation avec pour moi, quand elle est possible, ne l'est qu'avec un pour moi qui a cette valeur :
(16) Alors que, à mon avis/selon moi, l'objectif ultime de la sagesse est surtout la « vie commune » avec les sujets, avec les autres êtres humains.
(17) *Selon moi,/*À mon avis, je refuse - sans que je puisse justifier ce refus - de faire de la signification une partie du sens. Je préfère [...].
ou transforme la lecture des énoncés de départ en une lecture PDV : (18) À mon avis/ selon moi, Jules s'est fait teindre en blond. Dans ce qui suit, nous montrerons que les lectures PDV des expressions Pour
moi, Selon moi et À mon avis ne sont cependant pas strictement équivalentes.
3. LES POSSIBILITÉS D'EMPLOI DE SELON MOI ET À MON AVIS SELON LES DIFFÉRENTS TYPES DE VÉRITÉ
3.1. Dans son ouvrage de 1981, A. Berrendonner propose une analyse séman- tique des verbes d'assertion prétendre et convenir qui débouche sur une théorie de
[AKCIE FRANÇAISE 142 43
This content downloaded from 146.175.13.30 on Wed, 08 Apr 2015 10:10:26 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Procédés de modalisation : l'atténuation
l'assertion et de la vérité assertée, dans laquelle l'auteur pose l'idée que la vérité est toujours une vérité « pour quelqu'un » (1981 : 59). Cette idée le conduit à distinguer ensuite plusieurs sortes de vérité (1981 : 58 e.s.) : la L-vérité (ou vérité pour le locuteur), la ON-vérité (ou vérité pour l'opinion publique ou la doxa anonyme) et la 0-vérité (ou vérité pour le « fantôme », la personne d'univers ou l'ordre des choses) et à poser que « toutes les propositions ne sont pas candidates à la même sorte de vérité » (1981 : 67). Certaines propositions, qu'il appelle idio- aléthiques (1981 : 68), prétendent à la L-vérité (par exemple (19)), d'autres, appelées onto-aléthiques sont candidates à la 0-vérité (par exemple (20)) :
(19) Je ne me sens pas bien (20) Le chat est sur le paillasson
Pour étayer la distinction entre propositions idio-aléthiques et propositions onto- aléthiques, l'auteur conduit une rapide analyse des expressions à mon avis , selon moi , je pense et personnellement , dont la fonction sémantique, selon l'auteur, est de « restreindre la portée d'un acte d'assertion, en le commentant » (1981 : 67). Dans cette analyse, l'auteur constate tout d'abord la différence d'acceptabilité entre (21) d'un côté et (22) à (24) de l'autre3 :
(21) À mon avis, le chat est sur le paillasson. (22) *À mon avis, je ne me sens pas bien. (23) *A mon avis, j'ai le cafard. (24) *A mon avis, j'aime les épinards.
L'explication fournie à la malformation de (22) à (24) est la suivante. Dans ces trois énoncés, les états de choses dénotés dans p ne peuvent être validés que par L. Ils sont donc l'objet d'une L-vérité. Or, cette vérité restreinte de p n'est apparemment pas compatible avec l'opérateur à mon avis, dont la fonction sémantique selon l'auteur (1981 : 67) est justement de restreindre la portée de p à une L-vérité. Bref, c'est en somme à un effet de redondance que serait liée l'impossibilité d'associer l'expression à mon avis aux propositions p dans (22) à (24).
ЗЛ. Si on place selon moi et pour moi 4 dans les cotextes idio-aléthiques sur lesquels Berrendonner a testé l'expression à mon avis , les jugements sont unanimes ; selon moi n'y est pas à sa place :
(25) *Selon moi, je ne me sens pas bien. (26) *Selon moi, j'ai le cafard. (27) *Selon moi, j'aime les épinards.
Ces mêmes trois énoncés avec pour moi donnent lieu ou bien à des énoncés prag- matiquement non recevables en lecture PDV, ou bien à des énoncés acceptables, mais en interprétation TH, paraphrasables, lorsqu'ils sont mis en contraste, par en ce qui me concerne :
(28) ??Pour moi, je ne me sens pas bien. (29) ??Pour moi, j'ai le cafard. (30) ??Pour moi, j'aime les épinards.
3. Ces trois derniers exemples refusent aussi l'enchâssement à je pense que , à la différence de l'exemple (21). Il y a là tout un travail de comparaison des verbes d'opinion à faire, car l'enchâsse- ment à je crois que ne pose pas les mêmes contraintes. 4. Rappelons que Berrendonner ne cite pas explicitement pour moi.
44
This content downloaded from 146.175.13.30 on Wed, 08 Apr 2015 10:10:26 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
La modalisation du discours de soi
Les trois expressions s'associent donc mal à des propositions idio-aléthiques. Leur association à une proposition onto-aléthic¡ue, contexte en principe favorable d'après Berrendonner à leur utilisation, ne conduit pas toutefois à des jugements univo- quement bons :
(31) À mon avis,/??Selon moi,/??Pour moi, le chat est sur le paillasson. Aucun des énoncés n'est vraiment rejeté, mais hors contexte, on préfère générale- ment à mon avis à selon moi , voire à pour moi5.
3 • 3 • Avec les exemples qui précèdent, Berrendonner a essayé de montrer que à mon avis et selon moi ne s'associent pas à des propositions idio-aléthiques. Or, il existe une classe de propositions qu'on pourrait considérer, avec Kerbrat-Orec- chioni (1978), comme idio-aléthiques et qui acceptent apparemment sans problèmes d'être combinées avec à mon avis, selon moi et pour moi. Ce sont des propositions qui contiennent des axiologiques, du type intelligent, imbécile, génial :
(32) Pour moi, Jules est intelligent /est un imbécile /L'idée est géniale. (33) A mon avis, Jules est intelligent /est un imbécile /L'idée est géniale. (34) Selon moi, Jules est intelligent /est un imbécile /L'idée est géniale.
Pour expliquer leur acceptabilité, deux hypothèses viennent à l'esprit : ou bien les prédications être intelligent /être un imbécile/ être génial ne donnent pas lieu à des propositions idio-aléthiques, contrairement à ce qu'affirme Kerbrat-Orecchioni (1978 : 64-67) ou bien le test de à mon avis, proposé par Berrendonner pour distin- guer les propositions idio-aléthiques des propositions onto-aléthiques, n'est pas réellement décisif. Aucune des deux hypothèses n'est vraiment satisfaisante. Nous en proposerions une troisième : parmi les propositions idio-aléthiques, certaines seulement sont « réfractaires » à une combinaison avec à mon avis, selon moi et pour moi. C'est ce que nous essaierons de montrer ci-dessous.
3.4. Il y a en effet encore d'autres types de propositions, à notre sens idio- aléthiques, qui ne s'associent pas mieux que (22) à (24) aux trois expressions qui nous intéressent. C'est l'analyse de Martin (1987 : 53-64) du verbe croire qui nous a mis sur cette piste. Pour Martin, « l'opérateur croire » présente un « cinétisme qui va du faux au vrai ». Ainsi l'auteur note (1987 : 56) qu'un locuteur peut fort bien au moyen de croire à la première personne (et, précisons-le, à la forme pronomi- nale) énoncer des faits qu'il sait parfaitement faux, ce que R. Martin appelle des « illusions éphémères » (1987 : 56). Un locuteur, sain d'esprit, qui se trouve dans un endroit donné, par exemple à la terrasse d'un café d'une ville de province, peut éprouver l'impression d'être ailleurs. Pour signaler cela, il pourra dire (35) mais pas (36), si son intention est bien de verbaliser cette illusion :
(35) Je me crois à Paris6. (36) *A mon avis,/*Selon moi,/??Pour moi, je suis à Paris.
De ces observations on peut conclure que les trois expressions n'excluent que certains types de propositions idio-aléthiques. Lesquels donc ?
5. Avec le même énoncé, les jugements sur pour moi varient beaucoup en fonction du contexte imaginé (cf. le point 5). 6. Le conditionnel est également possible dans ces contextes avec le même effet de sens, surtout avec comme sujet on (on se croirait. . .) ou avec des ajouts comme presque (je me croirais presque. . .).
IlItlE FRANÇAISE 142 45
This content downloaded from 146.175.13.30 on Wed, 08 Apr 2015 10:10:26 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Procédés de modolisation : l'atténuation
I.S. Le propre du tour je me crois dans (35) est qu'il exprime une impression 7 , c'est-à-dire, selon Le Petit Robert , une sensation. Or, une sensation est quelque chose qui s'éprouve et donc en somme se constate. Si on revient maintenant aux exemples (21) à (23) traités par Berrendonner, on observe que les propositions p y dénotent également des sensations ou des affects éprouvés par le locuteur - la faim, le cafard ou le mal (cf. Martin, 1987 : 57) - et donc constatés par lui. Ce sont des faits - sensi- tifs, subjectifs, certes - mais des faits. Ils sont de l'ordre du savoir. Il semble donc que l'impossibilité de mettre dans le champ de pour moi , selon moi et à mon avis des propositions telles que (22) à (24) tienne au caractère constaté , éprouvé des faits dénotés et pas seulement à leur caractère idio-aléthique de L-vérité8.
Ceci nous amène à la conclusion que les trois expressions sont incompatibles avec tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, s'atteste. Ce sont des expressions qui donnent une information médiative (Guentchéva 1996) ou évidentielle (Dendale 1991), au moins de façon négative, à savoir que p ne résulte pas d'une constata- tion, n'est pas expérientiel. Elles signalent toutes trois que p est une vue de l'esprit.
4. LES DIFFÉRENTES VUES DE L'ESPRIT EXPRIMÉES PAR POUR MOI , À MON AVIS ET SELON MOI
Des vues de l'esprit ou productions de l'esprit , il y en a de toutes sortes. Il y a des vues de l'esprit qui résultent d'une activité intellectuelle (la généralisation (vérité générale), Y hypothèse, la supposition , etc.), mais il y en a aussi qui sont plus subjec- tives, plus ou moins fausses au regard du monde, et qui vont de l'illusion aux différentes productions de l'imagination , qui inventent des mondes (ou qui corri- gent celui qui est), en passant par des jugements axiologiques, des souhaits , des ordres ou autres attitudes propositionnelles où L tente de faire correspondre le monde à ce qu'il désire.
Ce qui est intéressant à signaler pour nous, c'est que les trois expressions étudiées ne s'associent pas de façon égale à toutes les vues de l'esprit : à mon avis et selon moi paraissent bien exclure certaines des possibilités. Pour le montrer, nous examinerons dans ce qui suit une série de vues de l'esprit différentes.
4.1. Pour mol , À mon avis, Selon mol , et la verbalisation de contre-vérités assumées
Considérons les exemples suivants : (37) Sors ! Pour moi, tu n'es pas ma fille. /À mon avis, tu n'es pas ma fille/
Selon moi, tu n'es pas ma fille. (38) Sors ! Pour moi, tu n'es plus ma fille/??A mon avis, tu n'es plus ma fille/
*Selon moi, tu n'es plus ma fille.
7. On peut substituer cette expression dans les énoncés qui nous occupent. 8. Par contre, à mon avis et selon moi, comme pour moi, paraphrasent parfaitement Je crois que je suis à Paris, énoncé qui ne dit pas une illusion éphémère basée sur une impression imposée par des lieux et leur ambiance, mais est énoncé dans une situation de recherche et où je crois que est consi- déré comme une modalité de la connaissance (Le Goffic, 1993 : 263). Un otage emprisonné dans un lieu inconnu écrira encore bien : Pour moi/À mon avis/Selon moi, je suis à Paris.
46
This content downloaded from 146.175.13.30 on Wed, 08 Apr 2015 10:10:26 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
La modalisation du discours de soi
Ce sont des énoncés qui contiennent une proposition p (Tu n'es pas ma fille) que l'on peut qualifier sans trop de risques à' onto-aléthique. Les trois expressions passent bien avec pas. Dans la version avec plus , qui présuppose l'existence et la vérité antérieures de <toi être ma fille> et qui pose sa fausseté actuelle, pour moi passe bien, selon moi et à mon avis ne vont pas.
Dans l'énoncé (38), p verbalise une proposition qui ne correspond pas à un état du monde, qui est référentiellement fausse. L'existence « dans le monde » et dans la réalité n'est donc pas ce à quoi s'attache pour moi. Seul compte ce que veut croire L, et plus encore ce qu'il décrète vrai. Notons que la valeur de pour moi dans (38) est bel et bien une valeur PDV. On peut en effet remplacer pour moi par un verbe de jugement, de PDV, du type je considère que :
(39) Sors : je considère que tu n'es plus ma fille. Dans (38), pour moi ne s'associe pas à une description du monde, mais à celle d'un état mental, à un contenu ou état psychologique, à une façon singulière qu'a le locuteur de considérer les faits du monde. Contenu psychologique que le terme même de « croyance » est impropre à désigner. Ici L crée le monde. Dans ce cas, le réfèrent de moi est en somme encore un peu actant dans la mesure précisément où il va régler son comportement sur ce qu'il a décrété.
Des trois expressions étudiées ici, pour moi est la seule à s'associer naturelle- ment à ce que le locuteur décrète vrai. C'est la seule qui puisse revendiquer la totale singularité9 de cette vérité, vérité sans lien avec les faits empiriques. Â mon avis et selon moi tendent plutôt vers la vérité commune (objective) et désertent la pure subjectivité (cf. sur ce point, et à propos de à mon avis , Marque-Pucheu). Ils sont du côté d'une certaine adéquation référentielle (Kerbrat-Orecchioni 1978 : 154) entre le contenu de p et le monde. Avec selon moi, comme avec je crois que et à mon avis cités par Cervoni (1991 : 232), il faut que le locuteur qui énonce p estime que p décrit le réel. Selon moi et à mon avis paraissent être soumis à l'ordre des choses ; pour moi est capable d'imposer un ordre au monde.
4.2. Pour mol ; À mon avis, Selon mol et la recatégorisation subjective des objets du monde
Une autre différence sémantique manifeste entre pour moi d'un côté et selon moi et à mon avis de l'autre est celle illustrée par les énoncés :
(40) Selon moi/À mon avis, c'est un fauteuil. (41) Pour moi, c'est un fauteuil.
Ce sont des énoncés dans lesquels p est construit sur le modèle « Pronom être un N » et où N désigne un objet concret (fenêtre, chien, fauteuil, etc.). Dans ces énoncés,
9. Cette dimension singulière de pour moi , dont découle sa possible association avec des proposi- tions sans relation aux faits réels, a depuis longtemps été relevée par Jaeggi (1956) et précisée par Cervoni (1991 : 231), qui analyse l'exemple suivant, prononcé par le locuteur avant d'avoir de l'expérience à propos des faits : Pour moi, il [le troupeau] est perdu (p. 230), comme suit : « [...] en disant pour moi, on appuie sur la subjectivité de l'assertion, on souligne même qu'elle n'a d'autre source que l'imagination de celui qui parle [...] le locuteur souligne la singularité de son énoncia- tion [...]. » (p. 231). Nous préférons, en l'occurrence, singularité à subjectivité parce que le mot permet de renvoyer éventuellement à la non-conformité à l'ordre des choses.
1 Д N С I E FRANÇAISE 143 47
This content downloaded from 146.175.13.30 on Wed, 08 Apr 2015 10:10:26 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Procédés de modalisation : l'atténuation
selon moi et à mon avis ne laissent guère qu'une possibilité d'interprétation de l'acte que fait L et mobilisent des situations d'emploi spécifiques. Ainsi, dans la situa- tion illustrée par (42), selon moi et à mon avis sont plutôt mal adaptés, alors que dans la situation illustrée par (43) ils sont possibles :
(42) La vieille chaise bancale ?... Je l'ai fabriquée il y a plus de trente ans. ??Selon moi/??à mon avis, c'est un fauteuil. /ок Pour moi, c'est un fauteuil.
(43) Ll - Qu'est-ce que ça peut être, cet objet ? L2 - Selon moi/à mon avis, c'est un fauteuil/Pour moi c'est un fauteuil.
Quelle est la différence entre les deux situations ? Dans (43) 10, l'énonciation de pour moi p, selon moi p ou à mon avis p est associée à la solution d'une « énigme » : L est amené à verbaliser une supputation sur la véritable nature de l'objet qui est sous ses yeux et qui est présentée par le cotexte comme inaccessible à l'expérience, non évidente. Selon moi et à mon avis y sont à leur place. Dans (42) n, le cotexte est tel qu'il bloque tout renvoi à une situation dans laquelle la nature de l'objet référé (la chaise) serait problématique : seul pour moi passe. L'énonciation de « Pour moi p » correspond à une recatégorisation de la chaise par L, à une qualification de l'objet qui constitue une contre-vérité. Cette recatégorisation contre nature n'est visiblement permise ni avec à mon avis , ni avec selon moi12. Cf. encore l'énoncé attesté suivant :
(44) Il est vrai que la chapelle a été sécularisée, mais pour moi, c'est toujours un lieu saint. (P. D. James, Les enquêtes d'Adam Dalgliesh , tome 2, Livre de poche, p. 269)
(45) Il est vrai que la chapelle a été sécularisée, mais à mon avis /selon moi, c'est toujours un lieu saint.
la substitution de à mon avis et selon moi à pour moi dans (45) introduit automati- quement une dimension qu'on peut paraphraser par « mais je subodore que cette chapelle est encore utilisée par certains comme un lieu de culte ». Avec pour moi la validité de p est fondée pour le locuteur sur sa pratique, son utilisation singulière de l'objet. La différence entre pour moi et selon moi/à mon avis permet d'expliquer aussi des différences dans les enchaînements :
(46) - Il est vrai que la chapelle a été sécularisée. Mais, pour moi, c'est toujours un lieu saint. - ??Ça m' étonnerait /??Ça me surprendrait/ /ок Ça m'étonne/OKÇa me surprend /ок Ça ne m'étonne pas de toi/OKÇa ne me surprend pas de toi.
(47) - Il est vrai que la chapelle a été sécularisée. Mais à mon avis /selon moi c'est toujours un lieu saint. - Ça m'étonnerait/Ça me surprendrait (ou Ça, ça m'étonnerait/me surprendrait).
(48) - Il est vrai que la chapelle a été sécularisée. Mais, selon moi/à mon avis c'est toujours un lieu saint. - Ça, ça m'étonnenwf /Ça, ça me surprendra#. - Ça, ça me surprend.
10. Où, notons-le, en ce qui me concerne ne peut paraphraser pour moi. 11. Où la paraphrase par en ce qui me concerne n'est pas plus possible. 12. Pour une observation analogue, voir Cadiot (1991 : 84) et l'énoncé : Pour moi, Paul est un frère qui suppose que l'individu dénommé frère ne soit justement pas un frère de L, mais en ait « le rôle stéréotypique ». Pour moi y correspond également à une recatégorisation.
48
This content downloaded from 146.175.13.30 on Wed, 08 Apr 2015 10:10:26 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
La modalisation du discours de soi
Les répliques Ça m étonnerait /Ça me surprendrait servent à nier la validité de p, vali- dité qui peut logiquement être niée si p est bien une hypothèse. Qu'elles passent mal avec pour moi tient au fait que p est présenté comme une façon singulière du « moi » de voir les choses, façon de voir qui, même fausse, ne peut pas être niée. Tout ce que l'on peut faire est d'en contester le bien-fondé, de s'en étonner (d'où la possibilité de ça m'étonne, ça me surprend) ou au contraire de signaler la cohérence de cette vision des choses relativement aux façons habituelles de penser du réfè- rent de moi (ça ne m'étonne pas de toi, sous-entendu : c'ue tu penses comme ça).
De ces données on peut conclure que selon moi et à mon avis ne permettent pas d'exprimer un rapport personnel aux choses, une façon singulière de les considérer. Ce qui paraît confirmer qu'avec à mon avis et selon moi on ne décrit pas le point de vue singulier de L, mais le monde. C'est l'inverse qui est vrai avec pour moi.
4. J. Pour moU À mon avis. Selon moi et la verbalisation des productions de l'imaginaire/l'imaginé
Observons maintenant des énoncés tels que : (49) Pour moi, Jeanne est blonde. (50) Selon moi/A mon avis, Jeanne est blonde.
L'énoncé (49) avec Pour moi offre plus de possibilités d'emploi que (50) avec Selon moi ou À mon avis. Le premier peut en effet s'employer pour décrire aussi bien des productions de l'imaginaire - qui sont des vues de l'esprit d'un type particulier - que pour décrire des situations réelles dans le monde (des faits). Â mon avis et selon moi n'offrent que la seconde possibilité. Examinons de plus près les deux interprétations.
Premier type d'interprétation : Jeanne est le nom d'un personnage romanesque que L est en train de construire, d'imaginer, par exemple, « à haute voix » (i.e. en présence d'un interlocuteur), comme dans (51). Pour moi est adapté, à mon avis et selon moi ne le sont pas :
(51) Ll - Comment tu le vois, toi, ce personnage de Jeanne ? L2 - Pour moi,/* A mon avis,/*Selon moi, Jeanne est blonde, elle a la tren- taine, elle habite la montagne. . .
Deuxième type d'interprétation : Jeanne est le nom d'un personnage de roman dont les aventures ont été portées à l'écran. Après visionnement du film, L dit à un tiers :
(52) C'est drôle, cette Jeanne, je ne la voyais /je ne l'imaginais pas du tout comme cela. OK Pour moi, elle était blonde./* A mon avis/*Selon moi, elle était blonde.
Encore une fois Pour moi convient, Â mon avis et Selon moi non. Dans les deux interprétations L verbalise en p le contenu d'une image mentale
qu'il a de Jeanne, un pur produit de son imagination. Dans ce cas-ci, contrairement à ce qui se passe dans les situations étudiées précédemment pour les énoncés (37) et (42), L n'énonce rien de faux au regard du réel. Il ne fait que décrire ce qu'il a créé en pensée13. L'impossibilité d'utiliser à mon avis et selon moi dans des emplois de ce type est manifestement due au fait que p verbalise un produit de l'imagination
13. On peut observer que les meilleures paraphrases de pour moi ici sont des verbes de perception, en l'occurrence voir au présent ou à l'imparfait.
IIICIIE FRANÇAISE 142 49
This content downloaded from 146.175.13.30 on Wed, 08 Apr 2015 10:10:26 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Procédés de modalisotion : l'atténuation
du L, c'est-à-dire, une proposition très liée à la subjectivité de L. Si l'imagination est incontestablement une vue de l'esprit, il faut croire que c'est sa singularité subjective et le fait qu'il n'y ait pas de lien au réel qui l'empêchent de faire bon ménage avec selon moi .
4.4. Pour moi, À mon avis, Selon moi et la discussion sur le sens des mots/fixation du sens des mots
Les propositions p des exemples ci-dessus peuvent être utilisées aussi dans des contextes où l'on discute du sens du mot. Considérons les exemples suivants :
(53) Tu vois la blonde, là-bas? Pour moi/A mon avis/Selon moi c'est une fausse blonde.
(54) Tu vois la fille brune, devant toi. Eh bien, pour moi, /à mon avis/ selon moi elle est blonde.
Dans cette situation d'expérience directe, l'énonciation de (53) et (54) indique que L subodore que la fille qui est sous ses yeux a la propriété « blond », même s'il constate qu'elle est châtain ou brune, mais pas blonde. Selon moi dans cette situa- tion peut servir à signifier que sous telle apparence se cache en fait une autre réalité, qui n'est, en l'occurrence, pas directement perceptible, mais qui peut être inférée à partir d'indices. On est dans l'ordre de l'hypothèse. Les trois expressions sont possibles.
L'énoncé ci-dessus peut être légèrement modifié sous la forme : (55) Regarde la fille, là-bas. Elle s'appelle Jeanne, eh bien, OK pour moi, elle est
blonde !/eh bien ??à mon avis/?selon moi, elle est blonde ! Si aucune des expressions n'est absolument impossible, pour moi est la plus appro- priée. Dans cette situation communicative, L précise ce que lui met sous le terme blond , il précise en somme l'extension de blond pour lui.
Si on prend enfin un énoncé comme (56) ou (57) prononcé par un locuteur qui montre du doigt la chevelure d'un individu :
(56) Pour moi,/??À mon avis,/??Selon moi, blond, c'est ça. (57) Pour moi,/A mon avis,/ Selon moi, châtain, c'est ça.
(56) est assez étrange hors contexte avec À mon avis et Selon moi ; il l'est moins si l'on utilise châtain (57). D'où vient cette différence ? Du fait sans doute que à mon avis et selon moi sont liés à l'expression d'une hypothèse. Ils contraignent donc à imaginer qu'un L, ignorant ce qu'est blond, fasse, en voyant des objets, des hypo- thèses sur le sens même du mot. Étant donné le caractère commun du mot blond , et le relatif consensus sur son extension, la situation nécessaire à l'énonciation de (56) paraît un peu étrange, et l'énoncé peu naturel, si ce n'est impossible. La bizarrerie est un peu moindre avec châtain , terme dont les locuteurs ont souvent le sentiment de ne pas connaître exactement l'extension. Ce qui montre encore que à mon avis et selon moi sont, dans de tels cas, du côté de la conjecture (du non-savoir).
Les observations qui précèdent - et qui valent aussi pour des propositions qui ne contiennent pas d'axiologiques - paraissent bien indiquer que pour moi est capable de s'associer à des vues de l'esprit qui au final décrivent la vision singulière du moi et sont revendiquées comme telles, alors que à mon avis et selon moi (pré-)supposent nécessairement une situation d'interrogation qui au final donne p comme une hypothèse.
50
This content downloaded from 146.175.13.30 on Wed, 08 Apr 2015 10:10:26 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
La modalisation du discours de soi
4. 5. Pour moU à mon avis , selon moi et la conjecture sur le futur Considérons enfin un énoncé où p dénote une situation future qui concerne
directement L : (58) - Il paraît que tu pars dimanche ?
- C'est nouveau, ça ! Pour moi,/?A mon avis,/?Selon moi, je pars demain. Pour moi y est l'expression qui passe le mieux, du moins à l'oral14. Ce que dit L dans cet énoncé, c'est quelque chose comme : « ce que j'ai comme savoir actuel concernant mon départ, c'est qu'il aura lieu demain ». Pour moi y marque p comme quelque chose qui n'est plus une question pour L, qui est mentalement acquis , qui décrit l'état actuel des savoirs de L plutôt que son opinion.
Avec les deux autres expressions, Â mon avis et Selon moi , p n'a pas le statut de contenu acquis, de savoir, de certitude concernant le futur fondée sur ce qui a été antérieurement décidé. Si à mon avis et selon moi diminuent la certitude de l'affir- mation, c'est sans doute que ces expressions dotent automatiquement p d'un statut particulier, celle d'être une production de l'esprit qui ne fait pas encore partie de celles auxquelles le locuteur a accordé définitivement un statut de vérité ; elle reste à valider 15. Bref, pour emprunter à Martin une formulation caractéristique, on pourrait dire que dans ce genre d'énoncés factuels mais non factifs, pour moi marque l'idée que la proposition qui figure dans son champ appartient à l'univers de croyance du sujet et y appartient en tant que savoir ; les expressions à mon avis et selon moi, dans ces mêmes co(n)textes, laissent à p le statut d'hypothèse .
4.6. Synthèse provisoire Dans les diverses situations observées jusqu'ici, pour moi - qui ne s'associe pas
avec les sensations, donc avec ce dont le locuteur a l'expérience intime - s'associe sans problèmes avec des propositions p que le co(n)texte signale comme la verbali- sation d'un point de vue plus singulier : recatégorisation personnelle, décret, imaginé, imaginaire, explication du sens ou de l'extension d'un mot, hypothèse sur le futur colorée d'intime conviction. Autant de vues de l'esprit singulières dotées de réalité dans l'esprit du locuteur. Relativement aux questions de vérité, tout ce que dit l'expression pour moi est que p est une vérité singulièrement assumée , éventuellement même dans la totale indifférence à la rationalité, à la réalité du monde. Avec pour , moi constitue un centre, un parangon : seul compte ce que croit ou veut croire L. Le point commun aux emplois qu'admet pour moi - et que refu- sent à mon avis et selon moi - est sans doute que dans tous ces emplois L avant tout, se décrit, parle de lui. Ce qui est en somme conforme au trait principal de la description que Cadiot donne de pour, la destination : p est en somme « spatialement » dirigé vers le référent du SN régi par la préposition.
Au contraire, à mon avis (ce qu'ont remarqué Jaeggi et Cervoni) mais aussi selon moi dotent automatiquement le contenu propositionnel p d'un statut de pure vue de l'esprit, d'hypothèse, qui, par définition, est en attente de vérification, toujours en suspens, et qui ne dépend jamais de la seule décision, volonté, du seul décret de L.
14. À l'écrit il est effectivement un peu difficile, comme un des lecteurs nous a fait remarquer. 15. L dit ici encore sa certitude, dénote, au fond, ce qu'il a dans la tête comme croyance, comme certitude, sinon comme savoir sur ce qui concerne l'avenir. Pour moi donne à p le statut de croyance au sens de ce queje pense, de ce dont je suis, ici-maintenant, convaincu.
IHCIIE FRANÇAISE 1 4 2 51
This content downloaded from 146.175.13.30 on Wed, 08 Apr 2015 10:10:26 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Procédés de modalisation : l'atténuation
Ayant essayé jusqu'ici d'opposer pour moi au couple selon moi , à mon avis , il s'agit maintenant de raffiner la distinction et d'essayer d'opposer à mon avis à selon moi. C'est que nous ferons dans la dernière partie de cet article.
5. HYPOTHÈSES SUR CE QUI DISTINGUE À MON AVIS DE SELON MOI : UNE DIFFÉRENCE FONCTIONNELLE ?
Marque-Pucheu (2000), dans une étude consacrée à à mon avis et à mon goût , estime que à mon avis et selon moi sont à ranger dans une même catégorie 16 . Par ailleurs, si l'on applique à selon moi les tests grâce auxquels l'auteur distingue à mon avis et à mon goût , on observe que selon moi réagit exactement de la même façon que à mon avis. La distinction entre les deux expressions risque donc d'être difficile. Nous allons cependant tenter de cerner ce qui fait que dans certains cas au moins, des jugements - labiles, c'est vrai - de manque de naturel sont néan- moins portés par les interprétants sur certains emplois de selon moi.
5.1. Enchaîner versus inaugurer Observons d'abord un exemple où l'emploi de selon moi apparaît moins naturel
que celui de à mon avis. C'est le cas de (59), lorsqu'il est considéré comme énoncé isolé :
(59) À mon avis/?Selon moi, le chat est sur le paillasson. Mettons-le dans un contexte.
Imaginons un couple. Chacun est plongé dans sa lecture. L'un, ayant perçu un bruit, pourra dire sans qu'aucune interrogation, ni verbale ni gestuelle, n'ait eu lieu :
(60) À mon avis, le chat est sur le paillasson. Pour moi et surtout selon moi paraissent plus difficiles dans la même situation :
(61) ??Pour moi/??Selon moi, le chat est sur le paillasson. Que se passe-t-il exactement ? Au moyen de (60), le locuteur, qui a entendu un bruit, formule une hypothèse sur son origine, activité qui devrait normalement permettre aussi bien pour moi que selon moi. Or, ce n'est pas le cas. À quoi cela peut-il tenir ?
Ce que la situation dans laquelle sont produits ces énoncés a de particulier, c'est que L rompt un silence et inaugure un dialogue. Â mon avis est la seule des trois expressions qui peut avoir ce rôle phatique. L'emploi de pour moi et de selon moi semblent plus adéquats lorsque L répond à une question , posée verbalement ou non, mais existant préalablement à la réaction de L. Pour moi et selon moi marquent plutôt une forme d'enchaînement ou de continuité discursive. D'où leur bizarrerie dans des situations où les énoncés ont bien l'air d'être énoncés indépendamment de tout questionnement et/ou discours antérieur. Cette différence, si elle permet d'expliquer un certain nombre de possibilités d'emploi de à mon avis , n'explique
16. « Parmi les adverbiaux d'énonciation, certains, [...] constituent donc une évaluation du locu- teur sur son propre énoncé. D'autres limitent l'univers du discours. Les expressions entre nous , à mon avis et selon moi ressortissent à la seconde catégorie. » « Dans la sous-catégorie que consti- tuent les adverbiaux d'interlocuteurs comme entre nous, selon moi, etc., eux-mêmes à l'intérieur des adverbiaux d'énonciation, nous avons choisi deux adverbiaux : à mon avis et à mon goût . » (Marque-Pucheu, 2000).
52
This content downloaded from 146.175.13.30 on Wed, 08 Apr 2015 10:10:26 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
La modalisation du discours de soi
pas seule tous les emplois un peu maladroits de selon moi. Il s'agit donc de trouver ces autres facteurs.
S .2. Différences dans le contenu de p Revenons à l'exemple (31) et à la scène imaginée ci-dessus pour (60), avec les
différences suivantes : cette fois-ci le bruit a été perçu par les deux personnages, et l'un interroge l'autre, cf. (62) :
(31) À mon avis,/??Selon moi,/??Pour moi, le chat est sur le paillasson. (62) Ll - Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ?
L2 a) - ?A mon avis, /"Pour moi,/??Selon moi, le chat est sur le paillasson.
b) - A mon avis,/??Pour moi,/??Selon moi, c'est le chat : il est sur le paillasson.
Là encore, et malgré la question préalable, selon moi paraît peu approprié, alors que à mon avis est meilleur, et surtout quand on ajoute le présentatif c'est , comme dans b). Il ne suffit donc pas que l'énoncé indexé enchaîne explicitement sur une question pour que selon moi devienne approprié.
D'où une seconde hypothèse. Elle part du constat que dans les conversations quotidiennes, un peu triviales, à mon avis est plus fréquent que selon moi. Considé- rons les exemples suivants :
(63) - À quelle heure peuvent-ils bien ouvrir, les magasins, ici ? - A mon avis, /Pour moi,/?SeIon moi, à 9 heures, comme partout. (64) - Mais que se passe-t-il encore ?
- A mon avis, /Pour moi,/?Selon moi, elle n'arrive pas à ouvrir la porte. Certes, selon moi n'y est pas impossible, mais à mon avis paraît plus naturel. Dans tous ces emplois, L énonce des hypothèses qui ont la caractéristique de provenir de déductions simples basées sur des connaissances pratiques.
D'où cette idée : à mon avis sélectionnerait des hypothèses fondées sur des connaissances pratiques, des savoirs empiriques puisés dans l'expérience quoti- dienne et appliqués mécaniquement aux situations particulières dans lesquelles L se trouve17. Selon moi , de son côté, sélectionnerait des hypothèses associées à des domaines moins quotidiens, moins triviaux.
Selon moi se trouve en effet mieux à sa place dans le genre d'hypothèse illustrée par (65) que dans celle illustrée par (63) ou (66) :
(65) Sans se prononcer sur la question matérielle de savoir quelle main a tracé le quatrième Évangile, et même en étant persuadé que ce n'est pas celle du fils de Zébédée, on peut admettre que cet ouvrage possède quelques titres à s'appeler « l'Évangile selon Jean ». Le canevas historique du quatrième Évangile est, selon moi, la vie de Jésus telle qu'on la savait dans l'entourage immédiat de Jean. J'ajoute que, d'après mon opinion, cette école savait mieux diverses circonstances extérieures de la vie du fondateur que le
17. Un autre exemple, attesté : - A mon avis, elle doit pas être si heureuse que ça ! - Sur quoi tu te bases ? - Eh ben ! Sa voix justement. Comme essoufflée. Mon père avait de l'asthme. C'est pareil. (Pelman, La véritable histoire du chat jaune, Denoël, p. 124).
incili FRANÇAISE 1 4 2 53
This content downloaded from 146.175.13.30 on Wed, 08 Apr 2015 10:10:26 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Procédés de modalisation : l'atténuation
groupe dont les souvenirs ont constitué les Évangiles synoptiques. (Renan, la Vie de Jésus , Folio, p. 91)
(66) - Dans combien de temps le repas va-t-il être prêt ? - A mon avis,/??Selon moi dans dix minutes.
L'emploi de selon moi donne assez systématiquement aux énoncés un air fort péremptoire, qui, selon les contextes - à contenu trivial ou non trivial - peut paraître adéquat ou déplacé.
L'ennui avec cette deuxième hypothèse est que là aussi certains énoncés la contredisent, par exemple, des énoncés où on sent l'ironie :
(67) De même qu'il est nécessaire, selon moi, de défaire les valises dès la porte ouverte, sinon c'est la fin des haricots. (Brisac, 1996 dans Frantext)
D'où une troisième hypothèse. Ce qui fait la maladresse de selon moi dans les énoncés ci-dessus, c'est que ces énoncés s'insèrent dans des contextes où L est mis chaque fois dans une situation où il doit répondre de façon impromptue à une ques- tion qui se pose dans ce contexte, sans avoir eu le temps de réfléchir, de soupeser ses propos. Et c'est, nous semble-t-il, le caractère improvisé qui convient mal à selon moi et qui lui confère ce caractère péremptoire quand il est néanmoins employé dans des contextes dans lesquels on n'attend justement pas une réponse absolument fondée, pesée, réfléchie. Selon moi présente en fait p comme venant après 18 une certaine réflexion intellectuelle, après une certaine recherche 19 , dont p est le résultat, d'où sans doute l'effet que p n'est pas une opinion quelconque, triviale et d'où aussi que la réflexion paraît un peu déplacée dans des énoncés comme (64). Dans (67), le carac- tère péremptoire, qui est responsable du ton de dérision ou d'humour, est attaché à l'expression déontique il est nécessaire, associée ici à l'énonciation d'un principe réfléchi , dont L signale, au moyen de selon moi, qu'il y adhère, voire dont il insinue qu'il en a la paternité amusée. L'effet vient de ce que selon moi est associé à un contenu trivial, et qui acquiert ainsi automatiquement la caractéristique d'avoir été pensé. On observe que la suppression de selon moi dans (67) retire beaucoup à la déri- sion (à l'humour) que comporte l'énoncé, comme le montre (68) :
(68) De même qu'il est nécessaire de défaire les valises dès la porte ouverte, sinon c'est la fin des haricots.
Cette hypothèse sur selon moi n'est pas contradictoire avec l'hypothèse formulée plus haut que selon moi peut moins facilement que à mon avis servir à initier un discours, voire à introduire un thème nouveau dans le discours. Elle semble par ailleurs pouvoir être corroborée par quelques autres différences de « comportement » entre les deux expressions.
5.3. Aspects perlocutoires de la distinction entre selon mol et i mon avis
5.3. 1 . Le caractère phatique de à mon avis, sa capacité d'initier réellement un discours, sont sensibles dans les situations suivantes : un locuteur, qui aperçoit un enfant en équilibre sur un parapet, pourrait lui dire :
(69) À mon avis,/*Selon moi,/*Pour moi, toi, tu vas te faire gronder.
18. Idée que pourrait étayer Tune des étymologies proposées pour selon : selon viendrait de secondum, « second », i.e. qui vient après. 19. Notons que ce caractère réfléchi, de recherche sérieuse, qui oppose selon moi à à mon avis, entre aussi selon Dendale (2001) dans l'opposition entre devoir épistémique et le futur conjectural.
54
This content downloaded from 146.175.13.30 on Wed, 08 Apr 2015 10:10:26 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
La modal ¡sation du discours de soi
Seul A mon avis convient à la situation. La raison est que À mon avis enchaîne faci- lement sur une situation, peut rompre un silence et inaugurer une prise de parole.
Cet emploi phatique de à mon avis est également à l'œuvre, il nous semble, dans l'énoncé (70) : le locuteur, qui est depuis un moment dans une autre pièce que celle à qui il va s'adresser, vient dans la pièce de son interlocutrice et dit :
(70) À mon avis, faudrait refaire ton pansement, j'ai dit. /"Selon moi. . . Je suis resté debout comme le type qui attend la commande. Mais elle n'a pas bougé. [...] Elle dormait. (P. Djian, 37°2 le matin, J'ai lu, p. 189)
Ce côté phatique de à mon avis explique encore qu'à la caisse d'un magasin, un locuteur, voyant la caissière s'empêtrer dans les rouleaux de son tiroir-caisse, peut se retourner vers un autre client de la file, et lui dire, sans que l'autre n'ait rien demandé, ni rien manifesté :
(71) À mon avis, on n'est pas sorti de l'auberge/on en a pour un moment. Pour moi et selon moi seraient quelque peu incongrus dans la même situation :
(72) ??Pour moi,/??Selon moi, on n'est pas sortis de l'auberge/on en a pour un moment.
Même chose dans (73) énoncé par un locuteur qui voit le chat de la famille s'agiter devant la porte (qui est bien une hypothèse, car comment savoir ce que veut un chat ?) :
(73) ??Pour moi,/??Selon moi,/ À mon avis, le chat veut sortir. A mon avis y sert à atténuer en une invitation l'ordre fait à un tiers d'aller ouvrir la porte au chat. Pour moi et selon moi , dans la même situation, ne seraient guère à leur place.
Dans tous ces exemples, à mon avis fonctionne un peu comme un « si vous voulez mon avis, p », expression que l'on emploie en général précisément quand personne ne vous demande rien. Le locuteur, enchaînant sur la situation, formule chaque fois dans p son opinion, son hypothèse sur la situation ou son évaluation, toutes vues de l'esprit que à mon avis présente comme des propositions suspen- dues à la ratification de la personne à laquelle elles sont adressées. Le locuteur cherche en effet à établir une forme de connivence avec un tiers, son but étant de voir l'autre répondre positivement aux suggestions qu'il fait ou au moins de les cautionner , d'une façon ou d'une autre. Il y donc une dimension inter subjective de à mon avis qui n'est pas (ou beaucoup moins) présente avec pour moi et selon moi.
5.3.2. Le côté soupesé des énoncés introduits par selon moi semble, lui, être confirmé par le fait que certains actes, facilement réalisables au moyen de à mon avis , paraissent plus difficiles à effectuer au moyen de selon moi. Il s'agit d'actes qui visent davantage l'obtention d'un effet perlocutoire intersubjectif que l'expression d'un contenu censé décrire adéquatement le monde et soumis à l'évaluation en vrai /faux.
Ainsi  mon avis permet plus facilement que selon moi de rassurer - de façon impromptue20 - comme le montrent (74) et (75) :
(74) - Je n'arrête pas de tousser. Je me demande bien ce que j'ai.
20. Ici aussi on remarque un parallélisme frappant entre l'opposition à mon avis/selon moi d'un côté et le futur conjectural /devoir épistémique de l'autre (cf. Dendale, 2001).
1 ANGUE FRANÇAISE 142 55
This content downloaded from 146.175.13.30 on Wed, 08 Apr 2015 10:10:26 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Procédés de modolisation : l'atténuation
a) - À mon avis, c'est un petit/bon rhume. /??Selon moi, c'est un petit rhume.
b) - Ne t'inquiète pas. . . c'est un petit/bon rhume, à mon avis./ Ne t'inquiète pas... c'est un petit /bon rhume, "selon moi.
(75) - Mais pourquoi n' appelle- t-il pas ? - Pour moi/ A mon avis,/??Selon moi, /il a oublié. L dans ces cas s'appuie encore sur des connaissances empiriques, pratiques (« on peut être malade sans que cela soit grave » ; « il arrive qu'on ne téléphone pas, simplement par oubli »). En fait, L s'avance un peu imprudemment : il n'est, après tout, sûr de rien. Â mon avis et pour moi se satisfont de ces hypothèses-explications approximatives, qui n'ont comme autre fonction que de rassurer l'autre. Selon moi y est peu approprié et si l'expression est employée, elle prend un caractère péremptoire et donne à la réplique un degré de certitude qui apparaît souvent déplacé. C'est que selon moi , encore une fois, donne du L l'image de celui qui sait, qui a soupesé ce qu'il dit. Dans ces cas, d'ailleurs, L prend le risque de se tromper « pour le bien-être de l'autre ». D'une certaine façon, ce qui est dit est dit pour Vautre, pas pour la vérité. Et ce que L attend ce n'est pas tant que p soit admis, en soi, mais que p ait sur l'autre un réel effet d'apaisement. Ce qui tend à montrer qu'avec selon moi, on est moins dans l'intersubjectivité qu'avec à mon avis.
6. CONCLUSION
Dans ce travail, qui prolonge des réflexions déjà menées par d'autres, nous avons étudié le sémantisme de trois expressions qui modalisent l'énoncé : à mon avis, pour moi et selon moi. Les conclusions provisoires auxquelles nous sommes parvenus sont, premièrement, que les trois expressions signalent, chacune à sa façon, que p exprime une vue de l'esprit et deuxièmement, qu'elles se distinguent toutefois entre elles sur plusieurs points.
Sur le point sémantique, elles se distinguent par les indications qu'elles fournis- sent sur la proposition p. Ces indications concernent d'une part la qualité (validité) du contenu de p, à savoir que selon moi présente p comme pensé, soupesé alors que à mon avis et pour moi ne disent rien à ce sujet. Elles concernent d'autre part le parangon où peut s'évaluer p, à savoir que seul pour moi offre à L la possibilité de dire la grande singularité de la proposition.
Elles se distinguent sur le plan discursif : pour moi et selon moi situent le discours de L dans la continuité : tout se passe comme si au moyen de pour moi et de selon moi L enchaînait sur un discours ou une réflexion en cours ou sur une question existant antérieurement.
Elles se distinguent sur le plan pragmatique : à mon avis, toujours peu ou prou dans l'intersubjectivité, permet des actes perlocutoires qui sont très difficiles à selon moi (et permis à pour moi sous la condition de continuité).
Au total, les images du moi que donnent les trois expressions sont sensible- ment différentes. Avec à mon avis, L se présente avant tout comme prêt au dialogue, soumettant toujours ce qu'il dit à la ratification d'autrui. Avec pour, c'est la singularité du référent du moi, voire son aspect d'être au monde concret (celui de l'individu qui décrète), qui est mise en avant. Avec selon, c'est l'aspect réfléchi, « pensant », qui est sélectionné.
56
This content downloaded from 146.175.13.30 on Wed, 08 Apr 2015 10:10:26 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
La modalisation du discours de soi
Les trois expressions participent toutes de la modalisation du discours dans la mesure où elles permettent de limiter ou de spécifier le champ de validité de p, mais elles effectuent toutes cette modalisation de façon particulière.
Références bibliographiques
Authier-Revuz, J. (1992), « Repères dans le champ du discours rapporté (I) », L'information grammaticale, 55, pp. 38-42.
Authier-Revuz, J. (1993), « Repères dans le champ du discours rapporté (II) », L'information grammaticale, 56, pp. 10-15.
Berrendonner, A. (1981), Éléments de pragmatique linguistique, Paris, Minuit. Cadiot, P. (199 1), De la grammaire à la cognition. La préposition pour, Paris, Éditions du CNRS. Cervoni, J. (1991), La préposition. Etude sémantique et pragmatique, Louvain-la-Neuve, Duculot (coll.
Champs linguistiques). Dendale, P. & COLTIER, D. (à paraître), « Discours rapporté et évidentialité. Comparaison du
conditionnel épistémique et des constructions en selon S », in Lopez-Muñoz, J.-M., Mamette, S. & Rosier, L. (éds), Le Discours rapporté dans tous ses états : question de frontières ?, Paris, L'Harmattan.
Dendale, P. (1991), Le marquage épistémique de l'énoncé : esquisse d'une théorie avec applications au français, Thèse de doctorat, Université d'Anvers.
Dendale, P. (2001), « Le futur conjectural versus devoir épistémique : différences de valeur et restrictions d'emploi », Le Français Moderne, 69, I , pp. I -20.
DUCROT, O. e.a. (1980), Les mots du discours, Paris, Minuit. DUCROT, O. (1984), Le Dire et le dit, Paris, Minuit. Guentchéva, Z. (éd.), (1996), Lenoncation médiatisée, Louvain/Paris, Peeters. JAEGGI, A. (1956), Le rôle de la préposition et de la locution prépositive dans les rapports abstraits en
français modeme, Francké, Berne. Kerbrat-Orecchioni, C. (1978), « Déambulation en territoire aléthique », Stratégies discursives, Lyon,
P.U.L.. DD. 53-102. Le Goffic, P. (1993), Grammaire de la phrase française, Paris, Hachette. Marque-Pucheu, C. (2000), « À mon avis et à mon goût : jugement de réalité et jugement de valeur »
in : Englebert, A., et al. (éds.), 2000, Actes du XIIe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes, Bruxelles, 23-29 juillet 1 998, Tübingen, Niemeyer, vol. VII, pp. 459-472.
Martin, R. (1983), Pour une logique du sens, Paris, PUR Martin, R. (1987), Langage et croyance. Les « univers de croyances » dans la théorie sémantique,
Bruxelles, Mardaga. RIEGEL, M, et al. ( 1 996), « Les noms à compléments propositionnels : en quoi sont-ils plus abstraits que
les autres ? », in Les noms abstraits. Histoire et théories, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion.
TesniÈRE, L. (1969), Éléments de syntaxe structurale (deuxième édition), Paris, Klincksieck.
ItlCUE FRANÇAISE 142 57
This content downloaded from 146.175.13.30 on Wed, 08 Apr 2015 10:10:26 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions