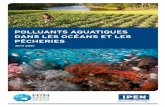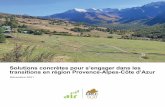Les “récits de désaveu” ou comment faire son autocritique de manière critique ? (dans \"Moi...
-
Upload
sorbonne-fr -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Les “récits de désaveu” ou comment faire son autocritique de manière critique ? (dans \"Moi...
dans les mémoires
et les écrits
autobiographiques
du xviie siècle à nos jours
Études réunies et présentées par Rolf Wintermeyer
en collaboration avec Corinne Bouillot
PUBLICATIONS
DES UNIVERSITÉS
DE ROUEN ET DU HAVRE
Moipublic
Moipr ivé
ET
Les « récits de désaveu »
ou comment faire son autocritique de manière critique ?
Jean-Louis JEANNELLE
Régis Debray s’étonne, dans Loués soient nos seigneurs, que si peu de romanciers aient consacré leur talent à ce qui suscita les passions les plus fortes au XXe siècle, à savoir la politique. Des années 20 à la fin des années 70, des générations entières lui consacrèrent le plus clair de leur existence et firent de la lutte politique un objet d’investissement privilégié et parfois quasi-exclusif. Comment expliquer alors que nous sachions si peu de choses sur les mécanismes qui régissent l’intérêt que nous prenons au sort de la collectivité ?
Entre suicides et crimes passionnels, la passion amoureuse fait quelques centaines de morts par an ; entre guerres civiles et internationales, la passion politique en fait des centaines de mille, en année moyenne, des dizaines de millions dans les coups de feux. Or, si le rapport en « dangerosité » est de un à mille, il est de mille à un dans les bibliothèques. Nous connaissons mille fois mieux les ressorts de l’« amour sexuel exclusif » que ceux de l’adhésion exclusive à une cause ou à un chef. Et que dire des rescapés ? Au moment où j’écris ces lignes, il y a sur cette terre des millions de Swann vieillissants dont l’Odette s’est appelée, à l’Est, Staline, Mao ou Tito, au Sud, Fidel Castro, Mobutu ou Sankara et, à l’Ouest, Mitterrand, Mme Thatcher ou Nixon. Aucun Proust ne daigne s’occuper d’eux, comme si la chose publique n’était pas digne des microchirurgiens du chagrin1.
––––– 1. Régis Debray, Loués soient nos seigneurs. Une éducation politique, Paris,
Gallimard, 1996, p. 20.
Jean-Louis JEANNELLE
284
Le rapide calcul de Régis Debray est difficilement contestable : que représentent la folie que partagent deux individus se désirant l’un l’autre au regard de cette ferveur exclusive avec laquelle des millions d’individus s’adonnèrent à l’avènement de la Révolution ?
Certains d’entre eux, libérés des puissantes attaches du militantisme, sont toutefois revenus sur ces années d’égarement partagé afin d’en saisir la logique. Parmi eux, les staliniens repentis furent les plus nombreux : au cours des années 70 et 80, quantités de textes ont paru, dans lesquels étaient disséquées les racines de cet engagement politique particulier, à la fois délire amoureux et croyance quasi-religieuse. L’effondrement du communisme à la fin des années 80 rendit, toutefois, toute la littérature consacrée à l’examen minutieux de la foi révolutionnaire plus difficilement lisible : ceux qui avaient été possédés par l’idéal prolétarien devinrent ce que Malraux nomme dans Le Miroir des limbes, lors de sa discussion avec un personnage nommé Max Torrès, les « émigrés d’un passé ».
Comment restituer, en effet, l’enthousiasme et la force de conviction d’un engagement qui n’apparaît plus qu’à travers le prisme d’une mémoire historicisée, systématiquement déconstruite et réduite à des mécanismes de conditionnement idéologique ou à une longue suite de manœuvres politiques ? Car c’est bien ce qui frappe dans les récits d’ex-communistes : on y saisit mal la puissance du mythe pour lequel tant d’individus ont sacrifié leur existence. On s’étonne d’y trouver si peu des émotions auxquelles on s’attendait : tant de dévotions réduites à néant, racontées froidement, reconstituées en détails sans que l’on puisse saisir les raisons ultimes d’un tel aveuglement ! Les récits d’anciens staliniens repentis ne visent pas simplement à restituer le déroulement d’une aventure collective, ainsi que le fait tout mémorialiste, mais exigent des procédures d’attestation plus poussées, propres à rendre crédible une expérience devenue en peu de temps incompréhensible.
Mon hypothèse sera la suivante : le communisme ou plus précisément le stalinisme est la seule passion politique à avoir donné naissance au XXe siècle à un sous-genre des récits de soi bien précis. Ce sous-genre constitue ce que j’appellerai ici les « récits de désaveu » : l’accent y est mis sur l’examen des circonstances et des raisons de la déviation ayant mis fin à une période plus ou moins longue de dévouement idéologique total. Situés à l’intersection du genre des Mémoires et de celui de l’autobiographie, les récits de désaveu sont un cas particulièrement fécond d’autoreprésentation d’une passion politique. À travers eux, je tenterai de saisir l’effet de
Les récits de désaveu
283
coïncidence entre une expérience politique (le stalinisme), un contexte historique (la génération d’intellectuels ayant subi de plein fouet les révélations de l’année 1956) et une forme générique se situant au croisement de la longue tradition mémoriale et du modèle autobiographique, plus conforme aux attentes contemporaines mais encore très lié à l’exploration de la psyché, ceci afin de lier de manière aussi étroite que possible étude des genres et histoire des idées.
Faire l’histoire
Le recours au genre des Mémoires n’a, pour la gauche
révolutionnaire, rien d’immédiat : le genre est, en pratique sinon en droit, fortement ancré dans les classes dominantes et se développe, depuis ses origines, en sous-genres attachés à certains groupes sociaux, comme les Mémoires aristocratiques, les Mémoires d’État ou les Mémoires militaires par exemple. C’est, de plus, le général de Gaulle qui a, en France, redonné au genre ses lettres de noblesse ; ses Mémoires de guerre, publiés entre 1954 et 1959, ont relancé une tradition mémoriale qui a dès lors connu une grande fortune dans les rangs gaullistes. Il en résulte un certain déséquilibre dans les pratiques d’écriture en fonction des appartenances politiques. Les exemples de mémorialistes ne manquent pourtant pas à gauche : ils se trouvent surtout parmi les militants les plus fidèles et les cadres dirigeants comme Jacques Duclos (pas moins de sept tomes entre 1968 et 1972) ou Georges Cogniot, historien de son état.
Mais c’est sous une forme plus adaptée aux exigences de la propagande que s’est fixée la formule générique qui a longtemps régné sur la littérature communiste, à savoir le récit de parcours exemplaire dont Fils du peuple, publié en 1937 par Maurice Thorez, représente tout à la fois l’origine, le modèle et l’aboutissement. On sait aujourd’hui que l’ouvrage fut commandé par l’Internationale communiste et écrit par Jean Fréville, critique littéraire à L’Humanité, certainement secondé par d’autres collaborateurs2. L’ouvrage, qui vise à renforcer l’autorité de Maurice Thorez au sein du parti, fut aussitôt encensé par les intellectuels du parti, très largement diffusé et devint
––––– 2. C’est Philippe Robrieux qui a lancé l’entreprise de démystification
historiographique du héros en révélant que l’auteur du livre n’était pas Thorez (Maurice Thorez, vie secrète et vie publique, Paris, Fayard, 1975, voir p. 201 et suiv.). Sur Fils du peuple, voir Bernard Pudal, Prendre parti. Pour une sociologie historique du P.C.F., Paris, Presses de la fondation nationale des sciences politiques, 1989.
Jean-Louis JEANNELLE
284
un manuel des écoles du P.C.F. lors de sa seconde édition, expurgée et actualisée, en 1949, durant la guerre froide3. La vie de Thorez y était reconstituée en vue d’illustrer chacune des qualités que valorisait le parti ; elle n’était que le support idéalisé d’un modèle de comportement qui s’imposait à tout militant. On y faisait l’impasse sur ce qui dérogeait à l’image idéalisée du chef du parti – comme le fait qu’il soit le fils naturel d’un boutiquier – et le « je » autobiographique s’y effaçait au profit du « nous » du dirigeant communiste modèle.
La forme stéréotypée de ce type de parcours ne les rendait que plus lisibles et plus efficaces : peinture du milieu social d’origine, dont les vertus, pauvreté et honnêteté, étaient vantées, expérience du monde du travail et de la lutte des classes, engagement idéologique précoce et confiance sans faille dans l’issue du combat et la ligne du parti – cela ne faisait qu’un. Bien des militants se sont exercés à ce type de récits comme Fernand Grenier, Lucien Midol ou Étienne Fajon, dont les textes remplissaient deux fonctions principales. La première, à usage interne, était de fournir un cadre d’identification à une trajectoire idéologique conforme aux exigences du P.C.F. et servant à l’encadrement des militants. La seconde, à usage externe, était de construire une mémoire exemplaire du passé communiste. On peut parler d’une forme de devoir d’histoire – comme on parle d’un devoir de mémoire – s’imposant aux membres du parti et plus particulièrement à ses dirigeants. Virgile Barel, militant communiste actif et homme politique central dans la région niçoise, cite par exemple dans Cinquante années de luttes une lettre de Pierre Abraham l’exhortant à publier son récit de parcours ; le directeur de la revue Europe voit dans ce texte une mine d’informations propres à encourager les nouvelles générations dans l’édification de la future République socialiste et déclare :
Vois-tu, et que nous le voulions ou non (or nous le voulons pour d’autres raisons que des raisons personnelles), nous tous du Parti, nous faisons l’histoire. Nous faisons l’Histoire. Ce n’est pas tous les jours agréable de se convaincre qu’on fait l’histoire de France, mais c’est un fait. Un fait qui a pour conséquence qu’on n’a guère le droit de minimiser les événements, les hommes, et soi-même. Il ne s’agit pas, bien sûr de se coller sur un piédestal et de se couler en bronze… il n’y aurait pas assez de bronze4.
––––– 3. Une version augmentée est publiée en 1960, quatre ans avant la mort de Maurice
Thorez. 4. Virgile Barel, Cinquante années de luttes, préface de Georges Cogniot, Paris,
Éditions sociales, 1966, p. 12-13.
Les récits de désaveu
283
Ainsi les communistes étaient-ils, de connaissance positive, dans le
sens de l’Histoire ; leur action politique avait pour conséquence directe de faire advenir l’inévitable cours des choses. Leur conscience des enjeux historiques de leur action n’en devait être que plus vive : elle seule justifiait l’usage de la première personne. Si tout mémorialiste a une tendance naturelle à se statufier, le militant communiste, lui, ne devait se réclamer que de sa participation à la construction du monde future. Son témoignage avait pour fonction d’en accélérer l’avènement5.
Dévouement et déviation
D’autres modèles comme le journal intime, l’entretien ou le roman
ont pu être employés pour transmettre la nature de l’engagement communiste, mais c’est dans le cas des récits d’ex-communistes que l’on rencontre les œuvres les plus originales. Et ceci en raison notamment de la situation de double rupture qui y est rapportée : rupture première que représente la conversion révolutionnaire, puis prise de conscience des erreurs et acte de reniement ; métanoïa et apostasie ; encadrement et désaveu. Il ne s’agit plus de reconstituer une carrière politique, un parcours singulier ou une action historique, mais de restituer les circonstances et les motifs d’un mouvement d’engagement puis d’un second mouvement de désengagement. Alors que l’homme d’État, le dirigeant communiste ou le militant fidèle sont justifiés à prendre publiquement la parole par le statut qui est le leur et l’autorité sociale qui en découle, l’apostat ne peut se prévaloir d’aucune position de maîtrise ni d’aucun résultat positif. Son parcours est fait de changements brusques qui fragilisent sa position. Il lui faut, par conséquent, compenser cette incohérence par un travail de justification et d’argumentation qui confère en retour une valeur heuristique plus élevée à son récit. Et cela non sans peine, puisqu’au désaveu de ses croyances passées par le stalinien répond non seulement le désaveu officiel de ses anciens camarades mais aussi et ––––– 5. Virgile Barel ajoute qu’il n’écrit pas de thèse, mais ne fait qu’aligner des souvenirs
qu’il accompagne de quelques commentaires. Étonnante modestie pour l’un des acteurs de l’Histoire : pour ce qui est des circonstances sociales et politiques, l’auteur renvoie à « l’Histoire du Parti communiste français, Fils du peuple (Maurice Thorez), Le Chemin de l’Honneur (Florimond Bonte), La Nuit finit à Tours (Jean Fréville), publiés aux Éditions sociales, etc. » (Ibid., p. 14). C’est qu’en réalité, l’histoire a été écrite par le parti avant même que ceux qui l’ont accomplie en témoignent !
Jean-Louis JEANNELLE
284
surtout le soupçon du public jugeant à la fois les actions rapportées et la sincérité en quelque sorte clivée de l’auteur, puisque désavouer son passé, c’est inévitablement se désavouer en partie soi-même et mettre en péril sa propre crédibilité. Toute rétractation expose à la condamnation publique.
Les récits de désaveu ont pu prendre au début la forme traditionnelle de Mémoires, comme c’est le cas chez Victor Serge, célèbre opposant à Staline déporté dans les années trente et sauvé grâce à sa notoriété d’écrivain en France6. Les Mémoires d’un révolutionnaire sont écrits durant la guerre et ne sont publiés qu’en 19517. L’auteur y rapporte l’ensemble de son parcours politique, de l’anarchisme (il fut inculpé parmi les membres de la bande à Bonnot) jusqu’à l’opposition au stalinisme en passant par son travail à l’Internationale communiste aux côtés de Zinoviev. Malgré sa valeur exceptionnelle, le texte de Victor Serge n’a pas joui de la notoriété à laquelle il aurait pu prétendre et n’a pas eu de réelle postérité. Serge écrivait sous la menace permanente d’une arrestation et d’une liquidation ; les campagnes orchestrées contre lui et répercutés dans tous les milieux communistes orthodoxes rendaient la diffusion de son témoignage extrêmement limitée, voire quasi-confidentielle. Lorsque les Mémoires d’un révolutionnaire parurent, Staline détenait un pouvoir plus grand que celui de la plupart des potentats avant lui dans l’histoire. Il s’agissait pour Serge moins de raconter sa « déviation idéologique » que d’opposer à la mémoire de plomb du stalinisme une contre-mémoire, celle de la fidélité d’un ancien anarchiste aux principes de liberté et de respect de l’être humain que bafouait le système totalitaire soviétique. Une contre-mémoire laissée en testament dans l’espoir qu’elle puisse atteindre un jour ses destinataires. Il n’est aujourd’hui malheureusement pas sûr que l’effondrement du communisme ait rendu le texte de Victor Serge plus lisible.
Mais il n’en va plus de même après 1956. Lorsqu’un ancien militant communiste raconte son exclusion, il le fait contre un parti communiste certes tout-puissant, mais dont la légitimité institutionnelle, idéologique et symbolique a déjà été ébranlée par la ––––– 6. Voir « l’affaire Victor Serge » lors du congrès des écrivains pour la défense de la
culture à Paris en 1935. 7. Le titre des Mémoires de Victor Serge rappelle l’ouvrage de Kropotkine publié à
Londres en 1906 et traduit en 1921 sous le titre : Autour d’une vie. Mémoires ou, dans une autre édition : Mémoires d’un révolutionnaire, mais aussi le texte de Vera Nikolaïevna Figner, publié au début des années vingt et traduit en 1930 par Serge en collaboration avec l’auteur sous le titre : Mémoires d’une révolutionnaire.
Les récits de désaveu
283
dénonciation du culte de la personnalité et les violations de la légalité socialiste lors du XXe Congrès du parti. C’est un geste de désaveu publique qu’il engage, ainsi que le fit Edgar Morin lorsqu’il publia Autocritique en 1959 : ce texte, qui ne ressemblait à rien de ce qui s’était écrit auparavant, condensait la plupart des arguments qu’invoqueraient par la suite les staliniens repentis afin d’expliquer ou même de justifier leur engagement politique. Le titre en est lourd de sens : l’autocritique, telle qu’elle était pratiquée à l’intérieur même du parti, obéissait à une fonction prophylactique essentielle. Elle instaurait, en effet, le leurre d’une remise en cause permanente et consentie, ainsi que dans l’ouvrage que Pierre Juquin, ancien porte-parole écarté (et non exclu) un temps du parti, publia en 1985 sous le titre Autocritiques et sur la quatrième de couverture duquel on pouvait lire : « Plus de 30 ans de parti, 22 ans dans ses instances dirigeantes, j’ai ma part de responsabilité dans les erreurs commises. »8
À l’inverse, Edgar Morin livre, dès les premières phrases d’Autocritique, tout à la fois le désaveu attendu et le programme d’autocritique « critique » qu’il s’est fixé :
Je m’étais joint à la troisième ou quatrième Croisade. J’avais endossé une armure que rien pendant dix ans n’a pu briser. J’ai chevauché l’Histoire. J’étais au parti communiste. Aujourd’hui tout est devenu mirage et en même temps le sens même de la vie me semble vidé. Je veux repartir à la recherche de la vérité, comme à quinze ans9.
D’emblée sont avancés et reconfigurés les principes qui sont au fondement des grands genres à la première personne : l’auteur se fait à la fois mémorialiste, en arguant de sa participation au cours de l’Histoire, et autobiographe, en s’engageant dans une quête d’élucidation de soi. Remarquons cependant qu’il s’agit moins de reconstituer la formation d’une subjectivité, comme c’est le cas dans l’autobiographie traditionnelle, que de rechercher une « vérité », celle d’une personnalité collective imposée par le parti. Écartant les charmes de « la liqueur du temps retrouvé » ou les ambiguïtés de « la confession publique », Edgar Morin établit un programme qui va au-delà de l’exercice d’introspection traditionnel : « Je cherche à me vider, me nettoyer, me rendre transparent, afin de voir clair, à travers
––––– 8. Pierre Juquin, Autocritiques, Paris, Grasset, 1985. 9. Edgar Morin, Autocritique, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points essais », 1970
[1959], p. 13.
Jean-Louis JEANNELLE
284
moi-même, par-delà moi-même. »10 À l’autoanalyse, Morin substitue un projet de refondation, d’éradication de toute une partie de son identité gangrenée par l’aliénation idéologique. L’autocritique n’obéit pas seulement au désir de dévoilement sincère qui anime l’autobiographe, mais aussi à une nécessité plus impérieuse, celle d’aller au-delà des limites qui s’attachent généralement à toute entreprise réflexive : narcissisme, complaisance ou exhibitionnisme. C’est ainsi qu’il faut entendre l’expression « voir clair par-delà soi-même », assez énigmatique au premier abord. La prise de parole personnelle doit permettre d’objectiver une réalité vécue collectivement, ce que l’auteur nomme, « une foi, hier source de toute assurance, aujourd’hui étrangère et ennemie ».11 Derrière le « je » de la narration se trouve le « nous » regroupant les croyances de toute une génération. C’est par le détour de la reconstitution mémoriale que Morin entend donc mettre au jour les motivations qui l’ont animé à son insu pendant dix ans.
De Proust à la chose publique
On voit l’intérêt de cet étrange pacte autocritique : la peinture
d’événements collectifs y est mise au service d’un travail sur sa propre identité et sur les forces de dépersonnalisation qu’imposait autrefois le dévouement absolu au parti. En cela, Autocritique me paraît être le modèle d’une série de publications d’ex-communistes, engagés dans la quête d’une même forme narrative située à l’intermédiaire des Mémoires et de l’autobiographie et dont voici les exemples les plus remarquables : la même année, en 1959, La Somme et le reste d’Henri Lefebvre, la trilogie de Claude Roy, Moi je en 1969, Nous en 1972 et Somme toute en 1976, Les Staliniens de Dominique Desanti en 1974, Le Ça perché de Jean Duvignaud en 1976, Paris-Montpellier : P.C.-P.S.U. d’Emmanuel Le Roy Ladurie en 1982, Le Temps d’apprendre à vivre de Régis Debray (Les Masques en 1987, Loués soient nos seigneurs en 1996 et Par amour de l’art en 1998) et enfin L’Avenir dure longtemps de Louis Althusser en 1992. Il me semble que ces œuvres ont pour point commun un ensemble de facteurs socio-culturels qui en expliquent la singularité : tous sont écrits par des intellectuels de gauche, influencés par le modèle historiographique marxiste et participant de plus ou moins près au développement fulgurant des sciences sociales à cette époque. Ils rompent en cela ––––– 10. Ibid., p. 13. 11. Ibid., p. 13.
Les récits de désaveu
283
avec les modèles traditionnels du mémorialiste (notamment les modèles de l’homme de pouvoir et celui de l’homme d’action) et incarnent une tout autre image : celle de militants engagés sur le front des idées. Ces auteurs ébauchent un nouveau modèle du récit de soi, assez éloigné du simple tracé chronologique et s’attachant au contraire à reconstituer la cohérence d’un parcours idéologique, circonscrit dans le temps. Leur fonction est d’opposer à une pseudo-logique du déroulement d’une histoire dont la finalité était la Révolution une autre rationalité. Celle-ci leur est fournie par l’apport épistémologique des sciences sociales : la philosophie pour Henri Lefebvre ou Louis Althusser, la sociologie, l’ethnologie et la psychanalyse pour Jean Duvignaud, l’histoire pour Emmanuel Le Roy Ladurie et, de manière encore plus intéressante, puisqu’il en est l’auteur, la médiologie pour Régis Debray.
Il y avait lieu de penser, toutefois, à l’époque que les sciences sociales rendraient inutile tout discours autobiographique, ainsi que Jean Daniel l’affirme dans l’avant-propos du Temps qui reste :
Ainsi le marxisme, la psychanalyse, le structuralisme et la sémiologie, unis pour nous priver de toute illusion concernant notre liberté, ont-ils achevé de tuer cet homme que Nietzsche, déjà, avait privé de Dieu. Engoncé dans de si nombreuses nécessités, comment ce hasard garderait-il le moindre intérêt ? Comment, s’il n’est exceptionnel, l’individu pourrait-il prétendre inspirer plus de curiosité que les mécanismes savants qui s’entrecroisent pour le produire ? Comment oserait-il dire « je », alors que de tout côté il est sommé d’être à l’écoute de ce « on » qui est censé parler pour lui ? Il fallait jadis du narcissisme pour se raconter. Il faut en plus, aujourd’hui, un défi candide à toute science12.
Si la remarque de Jean Daniel paraît peut-être plus fondée en ce qui concerne l’idéal de dévoilement de vérités intérieures, psychologiques ou morales, il semble à l’inverse que l’apport des sciences humaines s’est révélé d’une grande fécondité dans le cas de tentatives comme celle d’Edgar Morin ou de ses successeurs. Leurs textes offrent de nouveaux modèles de reconstitution du passé et de nouvelles sources d’intelligibilité du révolu, propres à se combiner au traditionnel récit historique. Au témoignage des faits auxquels l’auteur a pu assister, les sciences sociales ajoutent la possibilité de modéliser les données observées et d’en proposer une explication en se référant aux ––––– 12. Jean Daniel, Le Temps qui reste. Essai d’autobiographie professionnelle, Paris,
Stock, 1973, p. 6-7.
Jean-Louis JEANNELLE
284
processus de surdétermination psycho-sociologiques. L’autocritique ne relève alors plus d’un simple désir narcissique d’introspection, mais d’un projet de refondation qu’engage un sujet autrefois aliéné par sa croyance en l’avènement d’une histoire idéale. Les sciences sociales sont en quelque sorte ses véritables armes.
C’est là, me semble-t-il, ce qui définit en propre ce type de récits : l’instance mémoriale peut s’y détacher d’elle-même, prendre suffisamment de distance avec son propre passé et manifester, grâce au savoir dont elle dispose, une maîtrise de la logique à l’œuvre dans le cours des événements passés – logique dont ne disposent traditionnellement pas les mémorialistes. Le texte d’Edgar Morin vise à manifester cette capacité du sujet à reconquérir l’autonomie critique qui est l’apanage de l’intellectuel : il déploie à cet effet un discours savant, crée des concepts, brise le fil chronologique pour lui substituer un ordre logique plus proche de l’argumentation de l’essai technique et ordonne son récit en fonction d’une démonstration. On voit bien ce qui le distingue des deux modèles génériques les plus proches : l’autobiographie intellectuelle dont Valéry, Péguy ou Benda ont donné des exemples célèbres et où il s’agit de donner accès aux mécanismes psychiques les plus fondamentaux (formation d’une doctrine ou d’une activité intellectuelle et artistique, par exemple) et les Mémoires d’intellectuels, qui fleurirent à partir des années 70 (qu’on pense aux Mémoires de Raymond Aron, de Vidal-Naquet, d’Alfred Grosser et de bien d’autres) et dans lesquels l’auteur reconstitue son parcours dans le siècle afin de manifester la cohérence de son intervention sociale et intellectuelle. Dans les récits de désaveu se trouve mise en œuvre cette « narration analytique » que Barthes évoque au sujet des Pousse-au-jouir du maréchal Pétain de Gérard Miller :
Ensuite, un nouveau mode de discours est créé, bien plus scientifique que l’ancien, en ce qu’il s’adapte subtilement à son objet (la science de demain devra être subtile) : puisque cet objet est un discours passé, prélevé dans l’Histoire récente de la France, le mode proposé unit légitimement le récit et la distance critique (c’est un mode épique, au sens brechtien). Miller, d’une façon incisive et discrète, produit un genre nouveau : la narration analytique : il raconte, il décrit et dans une certaine mesure, il représente la sinistre aventure ; mais en même temps, rapidement, il projette la description ainsi amorcée à un autre niveau du réel, là où il se démontre sans se montrer : on ne rejette pas la narration – inséparable de toute l’Histoire – mais on l’empêche d’épaissir, de tourner à l’état de nature. Parodiant Pascal, on pourrait
Les récits de désaveu
283
dire que Miller évite deux erreurs : 1) prendre tout littéralement ; 2) prendre tout analytiquement13.
Edgar Morin et ses successeurs s’écartent donc d’une très longue pratique du récit mémorial sur un point essentiel : ils ne visent pas une forme d’exemplarité et ne se donnent pas comme les témoins privilégiés (en raison des actions qu’ils ont accomplies ou de leur proximité avec les événements rapportés) d’un passé qui intéresserait l’ensemble de la communauté nationale. Le recours à la première personne du singulier ne se justifie dans leur cas que par le degré de lucidité qu’ils tirent de leur expérience de la déviation idéologique. En sorte qu’ils ne peuvent prétendre s’adresser à leurs contemporains ou à leurs successeurs qu’au nom d’une forme de contre-exemplarité : un égarement passé dont il y a lieu de tirer une leçon et rendu profitable par une distance intellectuelle chèrement acquise, garante de l’opportunité du témoignage apporté – témoignage qui reste, néanmoins, toujours suspect, puisque cette distance intellectuelle n’a été acquise que sous le coup d’une condamnation par le parti et après plusieurs années ou plusieurs décennies d’aveuglement volontaire. C’est donc une double expérience de rupture (l’une subie et l’autre voulue) que rapportent ces récits de dévoiement.
En cela, les textes d’Edgar Morin, de Claude Roy, de Jean
Duvignaud ou de Régis Debray renouvellent indiscutablement la tradition des Mémoires et en soulignent à la fois la solidité et la flexibilité. Mais ceci non sans se heurter à une infranchissable limite intellectuelle, puisque la lucidité dont témoignent les auteurs de ces récits fait fond sur un processus d’auto-aveuglement qui met inévitablement en question les pouvoirs de la raison. L’hypothèse d’un phénomène de possession par un imaginaire ou par une forme de religion séculaire ne peut qu’apparaître sujette à caution lorsqu’on la trouve sous la plume d’un intéressé : invoquer l’embrigadement dans un système de croyances à la limite de l’irrationnel comme beaucoup d’ex-communistes le font relève inévitablement d’une forme de mauvaise foi. À ce titre, il est frappant de constater que tous ces auteurs n’expliquent pas mieux ce qu’ils ont vécu que Benda ne l’avait fait dans La Trahison des clercs en dénonçant la religion de
––––– 13. Roland Barthes, « Préface », dans Gérard Miller, Les Pousse-au-jouir du
maréchal Pétain, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Connexions du champ freudien », 1975, p. 8.
Jean-Louis JEANNELLE
284
l’Histoire à laquelle les intellectuels se vouaient dès cette époque. Dans ce texte publié en 1927, Benda anticipait sur le paradoxe auquel se heurteraient la plupart des staliniens repentis plusieurs décennies plus tard : comment des individus se voulant positivistes peuvent-ils placer à ce point leur engagement politique dans l’ordre de l’irrationnel ? La lucidité dont faisait preuve Benda n’a rien d’étonnant ; lui-même déclarait au début d’Un régulier dans le siècle : « Je voudrais qu’il existât comme une affaire Dreyfus en permanence14. » Le communisme fut pour beaucoup l’équivalent de cette affaire Dreyfus permanente. À cette crise du sens que provoque l’aberration d’un tel comportement, les récits de dévoiement tentent d’apporter une réponse, quand bien même cette réponse risque à son tour de montrer l’impuissance de la raison à prévenir tout délire collectif.
Maître de Conférences Université Paris IV-Sorbonne
––––– 14. « Je voudrais qu’il existât comme une affaire Dreyfus en permanence, qui permît
de toujours reconnaître ceux qui sont de notre race morale et les autres, au lieu que, dans le mensonge de la vie courante, ces distinctions sont estompées et je dois, parce qu’ils relèvent d’un certain ton et d’une certaine coupe d’habits, serrer la main de gens que je méprise pleinement. » (Julien Benda, Un régulier dans le siècle, dans La Jeunesse d’un clerc, suivi de Un régulier dans le siècle et de Exercice d’un enterré vif, préface d’Étiemble, Paris, Gallimard, 1968, p. 143).