« Le relief dit des suovétauriles de Beaujeu : une image sacrificielle hors de l'Italie », dans...
-
Upload
univ-brest -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of « Le relief dit des suovétauriles de Beaujeu : une image sacrificielle hors de l'Italie », dans...
Le relief dit des suovétauriles de Beaujeu: une image sacrificielle hors de l'Italie
Valérie Huet*
" Limage ne répète pas du déjà dit, elle élabore à son tour et sert, à sa façon, à penser le rituel ,,'
Les conquêtes romaines dans des territoires de plus en plus lointains ont entraîné, on le sait, tout un ensemble d'échanges, d'emprunts, de mélanges aisément perceptibles dans la culture matérielle des provinces ainsi que dans celle de Rome. Que les processus ou/et r ésultats soient appelés" romanisation» ou « acculturation}) 2, peu importe ici. Ce qui m'intéressera davantage, c'est la marque éventuelle d'identités plurielles au sein d'un même monument. Pour ce fa ire, je centrerai m on analyse sur le relief di t des suovétauriles de Beaujeu, conservé au Musée de la civilisation gallo-romaine de Lyon, et le comparerai en premier au corpus de reliefs sacrificiels existant en Italie et en second à celui provenant de la Gaule romaine.
À Rome et en Italie, le sacrifice est omniprésent sur les monuments, qu'il s'agisse de grands monuments officiels ou de documents privés'. Le premier monument connu est une des faces de la base dite de Cn. Domit ius Ahenobarbus, trouvée sur le champ de Mars et datée aujourd'hui autour de 105 av. J.-c.' ; le dernier fut érigé sur le forum de Rome au début du IY< s. ap. J.-C., c'est la base des decennalia s Les reliefs - environ 150 documents proposent une interpré tation implicite du rite en présentant au spectateur une juxtaposition ou un e fusion de diverses séquences et gestes de la céré
monie : par exemple, dans un sacrifice d'animaux, les phases de la pompa (procession) et de la praefatio (libation par l'encens et le vin) peuvent être
... Centre Louis Gernet, UMR 8587.
La première analyse que j'ai faite de ce relief a été présentée au collège de France au séminaire de Paul Veyne le 28 février 1996. Mon propos consistait à prouver qu'il ne s'agissaÎl pas d'un suovétaurile tout en insis tant sur la "romanité" du rite exposé. Paul Veyne ava it alors été tout à fair convaincu par mes arguments et m'ava it fortemenL encouragée à poursujvre mes recherches, ce dont je le remercie vivement.
1 F. Lissarrague, La libation : essai de mise au point, in: hl1age et rituel en Grèce ancienne, Recherches et dOCtiments du Cèntre Thomas More, 48, 1985, p. 15.
2 Voir dans les études récentes, par exemple S. Keay et N. TetTenato (ed.) , llaly and the West. Comparative Issues in Romanit.ation, Oxford, 2001 ; P. Le Roux, La romanisation en question, Annales, Histoire, Sciences sociales, 59, n° 2, mars-aw. 2004, p. 287-311; H. Inglebert (éd.), Histoire de la civilisation romaine, Paris, 2005; V. Huet, E. Valette-Cagnac (éd .), Et si les Romains avaient inventé la Grèce ?, Mètis. N.S. 3, 2005.
J Scott Ryberg 1955 ; V. Huet, Le sacdlke romain sur les reliefs hisroriques en Italie, thèse de doctorat (nouveau régime), Paris, EHESS, 1992; V. Huet, J. Scheid, F. Prescendi, A.-v. Siebert, W. Van Andringa, S. Wyler. ThesCRA I , 2004, s.v. Les sacdlices dans le monde ramai/7, p. 183-235.
4 Paris , Musée du Louvre.
5 Elle es t in situ.
• •
Valérie Huet
réunies, ou celles de la praeratio et de la mise à mort des animaux; d'autres moments rituels tels que l'immolatio (la mise à mort symbolique par le sacrifiant qui verse du vin au-dessus de la tête de la victime, répand de la mola salsa et passe le couteau sacrificiel sur son échine), la litatio (acception de la victime par la divinité), la cuisine sacrificielle et le banquet sont quasiment exclus des représentations. À l'époque impériale, l'insistance des grands reliefs publics porte très souvent sur la pietas exemplaire de l'empereur, et par effet de contamination, les images privées exposent la piété du sacrifiant. Dans ces espaces imagés très hiérarchisés, les divinités sont peu visibles, si ce n'est sous leur aspect physique matériel tels que sous la forme d'une statue, ou par la représentation de leur temple, ou encore par l'inscription de leur nom '.
Qu'en est-il du relief dit des suovétauriles de Beaujeu conservé au Musée de la civilisation galloromaine de Lyon (fig. 1- 4) ? Curieusement, alors que sa facture est très soignée, il a été relativement négligé par les chercheurs '. Selon les commentateurs, il s'agit soit de l'entablement d'un édicule, soit de l'élément antérieur d 'un couronnement d'autel, cette dernière hypothèse retenant ma faveurS. Cet élément taillé dans une pierre commune est décoré d'un relief figuré alors que la face postérieure est ornée seulement de reliefs décoratifs et qu'apparaissent en dessous des rosaces. Ce qui m'intéresse bien sûr, c'est la frise figurée. Je commencerai par proposer une brève description à l'éclairage du corpus d'images sacrificielles provenant de Rome et d'Italie , avant d'examiner brièvement les diverses interprétations qui ont été données de la frise. Pour décrire, je prendrai le parti d 'E. Espérandieu en commençant par le milieu (fig. la et 3)9.
Au centre, un autel au feu apparent (n° 20) entouré de trois personnages: à droite, le sacrifiant (n° 21), togatus capite velato, fait une libation à l'aide d'une patère; derrière l'autel , un tibicen (n° 19) de profil, tourné vers le sacrifiant, joue de son instrument ; à gauche, un jeune assistant (n° 18), en tunique, de face, porte de la main droite un vase et de la gauche une patère à long manche (très mal conservée). À ce groupe, on peut rattacher un homme en toge (n° 22) porteur probablement de rasces, ce qui permet d'identifier alors sa fonction
de licteur: il est à droite du sacrifiant. I:ensemble des acteurs participe à la phase qu'on dénomme praeratio. La séquence représentée est en pleine conformité avec celles présentes sur les reliefs sacrificiels romains qui déploient souvent autour de l'autel et du sacrifiant, ses acolytes, le tibicel1, le porteur de vase et de patère et/ou le porteur d'acerra (boite à encens) ; que l'un des porteurs soit absent n'a rien d'anormal.
À gauche de la scène de praeratio, s'effectue un mouvement de la gauche vers la droite, à savoir une procession sacrificielle ou pompa. Un taureau (n° 17) orné d'une parure entre les cornes, communément appelé par les historiens d'art triumphale, et probablement d'infulae (l'une semble pendre de l'oreille gauche de l'animal) est accompagné de son victimarius (n° 16). Le suit un togatus (n° 15) dont la tête semble retournée vers le reste de la pompa. Un homme (n° 14), vêtu soit d'une tunique soit d'un manteau , apparat! au-dessus de la tête d'un ovin à la toison bien visible, peut-être un bélier (n° 13); la victime est tenue par un victimaire (n° 12) qui est placé derrière; celui-ci a la tête tournée dans le sens contraire de la procession. Deux hommes continuent la marche (fig. 1 b et 2) : le premier (n° 10), vêtu d'une tunique, porte un objet difficilement identifiable (une ace rra ?) ; le second (n° 9)
6 Cf. la communication, Présence des divinités dans les scènes sacrificielles romaines, que j'avais présentée lors du deuxième séminaire du groupe Image et religion : Le rôle de l'image divine dans la définiriol1 de l'espace sacré, École française de Rome, le 26 mai 2000.
7 E. Espérandieu, Recueil généra! des bas-reliefs, stafues et bustes de la Gaule rOmai1"le, liI, Paris, 1910, n° 1801, p. 42-43; J. Descroix, Les "suove taurilia" de Beaujeu, BulferirJ de l'Associalioulyonnaise de recherches archéologiques, 1935, p. 15-18; Scou Ryberg 1955, p. 11 5-117, pl. 40, fig. 60a-c ; Veyne 1959 ; Audin 1986; J.-J . Hatt. Problèmes d 'Archéologie lyonnaise. M. - Le double suoueraurile de Beaujeu el le culte des Déesses-Mères et de la Tutelle à Lyon, RAE, 37 , 1986, p. 263-267 ; E. Rosso, Le «relief historique » : Rome el la Gaule, Revue Archéologique, 2004, l, p. 163-168; V. Huet, ThesCRA l, 2004, S.v. Les sacrifices dans le monde romain , n° 86, p. 208.
B Sa longueur est d't, 82 m, sa hauteur de 0, 375 m, sa largeur au sommet de 0, 29 m, à la base de 0, 175 m.
9 Pa r souci de clarté, j'ai numéroté les divers personnages, an imaux. et éléments en continu de gauche à droite dans la fig . 1 b, que j'ai reportés entre parenthèses dans la description.
400
Le relief dit des suovétauriJes de Beaujeu : une image sacrific ie lle hors de l'Italie
, ~
3 4 5 , 6 7 e 129 ~ 33
7 2B ~1 ~2 34 35 36
J
Fig. 1 a - Relief de Beaujeu , Lyon, Musée de la civilisation gallo·romaine de Lyon.
Fig. 1 b - Relief de Beaujeu numéroté, V. Huet.
Relief de Beaujeu
1 - arbre 2 . victimarius de face, derrière l'animal, tête tournée
vers la droite 3 . truie de profU tournée vers la droite 4 . arbre 5 . victimariu5 de dos, tête se retournant vers la gauche 6· homme à tunique, LOU1ïlé ver s la droi te 7 · victimarius de face, tête tournée vers la droite,
tenant de la ma in gauche une corne de l'ani ma l devant lequel il est placé
8 - taureau de profil vers la droite 9 . victimarius de dos, tête se retournant vers la gauche
10 - homme en tunique avec objet dans la main gauche, tourné vers la droi te
Il - arbre (mauvais état de conservation) 12 - victùnantLS de face, derrière l'anim al, tête tournée
vers la gauche 13 - ovidé d e profil vers la droite 14 - homme avec tunique ou manteau descendant jus
qu'aux genoux, de trois-quarts face, tê te tournée vers la droi te
15 - togatus , tête peut·être retournée, c'est-à-d ire vers la gauche
16 - victimarius de face devant animal, tête tournée vers la droite
17 - taureau, corps de profil, tête de face 18 - camillus en tunique, face au spectateur, tenant de la
main droite un vase, de la gauche une patère à long manohe (très mal conservée)
19 - tibicen de profi l, tourné vers la droite
20 - autel avec fla mmes 21 - sacrifiant, togarus capite velaLo , avec une patère
dans la ma in droite, corps e t tê te tournés vers la gauche
22 - togatus avec fasces , tête tournée vers la gauche 23 - togatus tourné vers la droite 24 - figu re en très bas-relief, de profil , tournée vers la
droite 25 - figure féminine assise, de face , corps légèrement
tourné vers la gauche 26 - figure en très bas-relief, de profil , to urnée vers la
gauche 27 - victimarius, de profil, tourné vers la droite , tenant
de la main droite une olla
28 - victimarius portant sur son dos un animal renversé, allant vers la droite
29 - truie renversée 30 - homme en tunique de face 31 - togatus presque de face, corps légèrement tourné
vers la droite, tête tournée vers la gauche 32 - homme en tunique, de face, légèrement tourné vers
la droite 33 - togatus de face 34 - lOgatus aux trois-quarts de face, légèrement tourné
vers la dro ite, avec fasces 35 - homme en tunique non serrée appuyé sur un
bâton, tête tournée vers la gauche 36 - foga/us presque de face , corps tourné légèrement
vers la droite.
401
Valé rie Hue L
Fig. 2 - Relief de Beaujeu, partie gauche de la process ion.
est un victÎ1narius comme l'indiqu e le port d'un limus (sorte de pagne enroulé a utour des hanches): il es t prése nté de dos, la lête de profil tou rn ée vers le bovidé qui le suit. li s'agit d'un autre taureau (n' 8) orné d'infulae (ba nde le ttes sacrées), m ais a ucUll triu111.phale , dans l'état de préserva tion actuel. n'apparaît entre ses corn es. Un victimarius (nO 7) l'accompagne en le tenant par une corne. Juste derrière la croupe de l'animal , un homme en tunique (n" 6) précède un victimaire (n° 5) vu de dos se retournant vers une t.ruie (n° 3) conduite par un autre vicrimarius (n' 2). La procession sacrificielle se déroul e en plein air, en partie peut-être dans un bois comme semble l'indiquer la représenta tion d'arbres (n' 1, 4 et Il ); elle comprend qua tre victimes animales, dont deux (les bovidés) sont parés pour le sacrifice; comme le révèlent les sources littéraires romaines, l'ov in n'a pas bes oin de parure, sa toi son cons ti tuant un OrnelTIent en soi: on peut par contre supposer que la tru ie avait des in fulae, mais la disparition de sa tête e mpêche de le véri fier. Comme su r les relie fs sacrifi ciels romains provenant d'Italie, les vict imes sont accompagnées de victimarii , esclaves chargés de les conduire, puis de les asso mmer et de les égorger.
Sur le tiers droit du re lief (fig. J b et 4) , de l'autre côté de la scène de praefatio, un togatus (n' 23 ),
portant de la main gauche un rouleau, fa it face à une femme assise (n" 25) qui, s i on la mettai t debo ut, serait clairement d'une ta ille supérieure à tous les perso nnages ; voilée et diadémée, elle ne peut être qu'une déesse; sa main gauche repose sur une sor te de fl ambeau. En très bas-relief, deux visages de profil l'entourent (n ' 24 et 26). Le reste de la fri se n'est pas du tou t tourné vers la déesse, mais au contraire s'en écarte en continuant de créer un mouvement de la gauche vers la droite: le pre mier personnage est un v i.crimarius (n" 27) avec une al/a dans la main droite et peut-être un maillet dans la gauche 10. Le précédant, un autre victimaire (n° 28) porte sur ses épaules une truie renversée (n' 29). Celle-ci n'a au cune pa rure sacrificielle; son ventre rebondi touche le bord du relief. Caché en partie par la tê te de la bête, un homme de face vêtu d 'une tunique (n' 30) laisse au premier plan un togalus (n' 31) dont la tête se retourne vers l'arrière, corrune s'il surveillail la progression des deux vicr;nwIi;. À côté de lui, sont juxtaposés trois hommes de troi s-quarts de face, à la tê te légèrement tournée vers la droite: le premier en tunique (n' 32) tienl
10 L'état actuel de conselvalion ne permet pas de préciser.
402
Le relief dIt des suovétauriles de Beaujeu: lIne îmage sacrificielle hors de YItalic
de chaque main un objet inidentifiable dans l'état de conservation actuel; le second à l'arrière plan est vêtu de la toge (n° 33) ; le troisième (n° 34), de nouveau au pren1ier plant est aussi un tagatus : il porte sur l'épaule gauche les faisceaux du licteur. Un homme en tunique (n° toujours de face, mais à la tête légèrement tournée vers la gauche, s'appuie de la main droite sur un bâton tandis qu'il porte de la main gauche une cassetle qui ressemble à une acerra. Le dernier homme à apparaître avant la cassure du monument (n° 36 . cf. la et bJ est un togatus au corps légèrerrlent tourné vers la droi~ te, dont l'épaule gauche soutenait peut-être des fèlsces, ce qui en ferait un autre licteur. Ce fragment de la frise pose problème, car comment le lire en accord avec les scènes de praeFalio et de pompa aisément reconna1ss3 bies ?
Si la fracture du monument s'était opérée juste après le licteur assistant à la praef'atio (n° 22), le
témoignerait sans problènle d'un rituel romain; mais la partie droite de la frise en décide autrement. En effet, deux éléments au moins étonnent : la représentation d'au nl0ins une divinité (n° 25), et ceile du victimaire porrant sur son dos une truie renversée (n° 28 et 29). De plus, malgré des changements de direction des personnages, la cadence générale de l'ensemble de la frise marche de gauche à droite, Aussi est-on en demeure de se poser la question de la cohérence temporelle et spatiale de l'image, ce que n'ont pas manqué de faire les quelques commentateurs du relief,
Selon Paul Veyne, il faut y voir une narration continue dans Je temps! avec deux processions qui n'en font qu'une aboutissant à l'autel: " A première vue f la scène qui y est représentée eSL incohérente: à gauche, unë pompa amène deux taureaux, un bélier et une truie vers un sur lequel opère Un prêtre voilé; à droite une seconde pompa, où figure une autre truie, sèn1ble s'éloigner de l'autel; lequel est au centre du tableau. En réalité, il d'une narration continue dans le temps. Les deux processions n'en font qu'une ct ne s'ordonnent pas par rapport à j'autel; cette pompa unique, et le sacrifice qui est célébré devant l'autel, sont deux scè-nes chronologiquerrH:nt distinctes, qui se sont succédées dans le temps. Mais le sculpteur a inséré, au milieu de la procession, la représentaüon du sacrifice qui en était vraisemblablement la conclusion, ce qui crée la fausse apparence d'une pompa coupée en deux tronçons. "H. Un peu plus loin,
l'auteur revient sur le sens de la procession et propose d'y voir la transposition sculptée d'une lustration décrivant un cercle autour de l'autel 12. Ceci est fortement mis en doute par Amable Audin qui voit bien une procession SUI' la gauche, mals le sàcriJice déjà accompli sur la droite, avec la présence de la victime déjà sacrifiée: « Ainsi un point sur lequel nous serons réservé: l'ensemble des 27 personnages et des 5 animaux représenLés constituerait une seule procession marchant de gauche Il droite et dépassant la déesse sans rupture de cadence. Or, la déesse est assise en un point situé eXactement au tiers droit et l'autel au centre du relief. Si effectivement touS les participants de gauche conduisaient ~Fers eUe les victimes, ceux de droite paraissent éloigner. la tâche accomplie. A preuve, celui qui porte sur les épaules une truie en laquelle rien ne permet de voir un animal "récalcitrant" mais bien plutôt la dépouille d'une victime déjà égorgée. Le personnage qui suit porte d'une lnain un seau pouvant contenir le sang d'une victime, de l'autre une patère. Telle était déjà l'interprétation de Comarmond el d'Espérandieu" 13. Aux arguments d'A. Audin, rajouterai que la truie portée n'a aucun ornement sacrificiel; or les images de mise à mort sacrHicieHe montrent sans conteste que ceux-ci étaient enlevés au cours de, ou juste après, la phase de j'immolalio, c'est-à·dire que la mise à mort se faisait sur une victime mise à nu 14 ;
aussi l'absence d'l11fulae tend-il à prouver que J'animal est déjà mort, ce qui est renforcé par l'attitude de l'animal et la manière dont il est porté ainsi que, comme l'a écrit A. Audin, par la proximité de la représentation du vielimarius à l'olla (n' 27). Bien sur, la perte de la tête de la truie dans la pompa (n' 3) empêche de vérifier l'adéquation totale cet argument; néanmoins tendance à affu hier de bandelettes cette truie bien vivante.
Il Veyr:e J959, p. 80.
u Veync 1959, p. 94-95. u Audin 1986.
14 J, Scbeid, La mise à mort de la victime sacrificielle, A propos de quelques iorerpré-mlions antiques du sacrifice, m : A. (düller-Karpe, H. Brandt, H. Jons, D, Kraufx:, A. Wigg (cd.), .$tudien Zflr Archaologie der Kelten, Romer und Gennal1EI1 111 3tilnei·lfruj R'esrcumpo, A. ZU!1'f- 60. &btlrf!iwg g6.widrnet, Rahdeo, 1998, p. 519-529; V. Huet, La mise à mort saclifi,aelle sur !es reliefs romains: une jmage banalisée el ritualisée de la violence ?, in ; J.-;\I1, Bertnmd (lfd.), lA violence dans les Yr,'ondéi grec et rOmal11, Acles du colloque infernationai, Paris, 2-4 mai
2002, Paris. 2005, p. 91-119.
403
Valérie Huet
Mais revenonS au rite lui-mêm e. Il s'agit bien d 'un sacrifice accompli selon le rite romain, puisque le sacrifiant a la tête vo ilée d'un pan de sa toge à la manière ro maine et puisque les acte urs principaux (musicien, porteurs, vi ctimaires, anim a ux) sont présents. Le relief est typique du début de l'empire, comme le montre l'ins istance sur le bon déroulement du sacrifice, sur l'ampleur du rite comm émoré qui comprend des victimes appartenant aux t rois espèces les plus communément offertes, comme le révèle la mode vestimentaire (par exemple la longueur du limus porté par les victimaires, encore au-dessus ou à la hau teur du genou, les toges relativement étroites et s'arrêtant à la cheville) ; le rythme donné par l'alternance des têtes et les corps tournés rappelle des monuments augus téens tels qu e par exemple les deux fri ses du couronnement de l'ara Paeis. Si ce n 'était la pierre qui semble locale, on pourrait tout à fait imaginer que le monument ait été produit dans un atelier de Rome. Le rite est publi c, ce qu'attestent le nombre des victimes et la présence des li cteurs . Mais contrairement aux interprétations habituelles, il ne s'agit pas d 'un double suovétauril e, ni m ême d'un s imple. Je résumerai rapidement ici les arguments qui permettent d 'écarter définitivement cette hypothèse. .
Premièreme nt, comme nous le révèlent les sources littéraires IS et imagées l6 , le suovétauri le est un sacrifice qui prescrit strictement des victimes mâles non castrées : un taureau, un bélier et un verra t qui peuvent être jeunes (poreus, ag"us, vitu/us quand il s'agit d'hostiae laetemes) ou avoir atteint l'âge adulte (verres, aries, tau.rus quand ce sont des hostiae maiol'es). Or ici, si l'ovidé peut être un bélier (n' 13), le porcin est bien une femelle , une truie aussi bien dans la procession à gauche de l'autel (n' 3) que dans celle qui s 'en éloigne, à droite (n' 29).
Outre la question du sexe des animaux, leur nombre a posé problème aux chercheurs, comme l'a remarqué par exemple A. Audin : « Le premier point est que le relief semble fi gurer un dou ble suovétaurile auquel toutefois il manquerai t un bélier, encore qu'on puisse admettre que, après son sacrifice, la dépouille a dispa ru sur la droite» 17. En fait, s' il s'était agi d 'un double suovétaurile, l'ord re des vict imes aurait été surprenant; on aurait dû avoir de chaque côté un taureau, un b élier et un verrat , dans cet ordre là ou dans l'ordre inverse. Sur les reliefs romains, quelle que soit la disposition crois
sa nte ou décroissante des victimes, l'ovin est l'unique animal à ne pas bouger d e place et donc à occuper la seconde position dans le sacrifice, ce qui est en fa it le cas ici. Ma is la répétition du tau reau est étrange: s i le bélier m anque à droite, il est logique que le taureau ne soit pas à droite; mais le taureau étant répété à gauche, si J'abattage des victimes s'est fait en commen çant par le p orcin, alors le bélier devrait être auss i répété dans la pompa de gauche, Il est néanmoins vrai que les sacrifices de suovétauriles sur les frises de l'arc de Cottius à Suse 18 présentaient des anomalies assez similaires
15 l i exisle 13 passages dans la littéra ture latine mentionnanl les suouelaurilia et les solitaurilia. Si j'intègre ici les soli/aurifia, c'es t en raison du rapprochement des deux te rmes qui semble aboutir à une confusion de ceux-ci et à une identité de sens ; néanmoins il Fa ut noter que ces deux molS n'insiste nt pas sur la même particula l·ilé du rite, l'un mettant en avant le nombre et le type d'animaux requis, l'a utre l'intégralité du sexe d'un animal , celu i du chef des victimes , q ui esl donc pris comme modèle de désig nation : voir G. Dumézil. "Suouera/.,triUa ", in : Tarpeia. Essa is de philoLogie com.parative ÎI1do-eu ropéel'lne, Paris, 1947, p. 11 7! 58 ; U. W. Scho!z, St/oui/aurifia et Soliraurilia, Phîlologus, 117, 1973, p. 3-28. Les références sont Cato, de agr. 141 ; Varro, de r.r. Il , 1,10; Uv., L 44 , 1-2; Liv., VII I, 10, 13-14; Tac., Ann. VI , 37; Tac., Hür IV, 53 ; Quint., l nsl. Or. l, 67 ; Charis.,Art. Gra m. l , 108, 5-8; Val.Max., IX, 10; Fest. , L 152- 154; Fes t. , L 204; Fest., L 372-374 ; Pa ul. , L 373. Les SOUI"ces épigraphiques li vrent aussi des témoignages sur les suovétau l·iles : cf. les occurrences dans les inscriptions des frè res atvales des années 183 (CIL Vl, 2099, l,II). 2 18 (2 104 reclo), 224 (2 107), 237 (37 164. II), Alex. b (21 10). 240 (NSA, 19 14,466) ; voir J. Sche id , Commentarii (raman arvalium qui sUpe'"SLm t. Les copies épig,-apJJiques des protocoles annuels d.e la confrérie mvale (21 av.-304 ap. J.-C) , Rome, J 998.
16 Dans l'ordre chronologiq ue, la base de Cn. Domitius Ahenobarbus, Paris, Musée du Louvre, MA 975 ; la base honorifique à M. Nonius, fserni a, Antiquario Comunale; les fri ses nord et sud de J'arc de Suse: la frise fragmen taire de Casa; la bise fragmentaire de Paris, Musée du Louvre, MA 1096 ; les scènes 8, 53 et 103 de la colo nne Trajane, Rome ; les Al1agLyplw Traiaui ou Hadrial1i, forum de Rome ; un relie f privé, probablement dans une colleclion particulière; les scènes 6 et 30 de la colonne de Marc-Aurèle, Ro me; le relief de Marc-Aurèle, Arc de Cons tantin, Rome; la base de colonne des Decenl1alia. foru m de Rome ; il faut ajouler à ce corpus la borne de Bridgeness consel\1ée au Musée natio nal d'antiquités à Edînburgh. Voir V. Huel, Les images de suovélat.mïe, à paraitre.
17 Audin 1986.
18 Scott Ryberg 1955, p. 104-J06, pl. 34, fig. 52 a-d; J. Prieur, Les Arcs d'Aoste, Suse et Aix-Les-Bains, ANRW, II, 12, 1 (1982), p. 442-475; V. Huet , TIlesCRA 1 (2004), s.v. « Les sacri fices dans le mo nde romain li, nO 80, p . 207 ; S. Barpi, Il fregio dell'a rco di Augusto a S usa : in terpretazio ni s torico-arListiche, ROJl1anità val· susil1a, 2004 , p . 139-J60.
404
Le relief dit des suovétauriles de Beaujeu: une image sacrificielle hors de l'Italie
Fig. 3 - Relief de Beaujeu, partie centrale de la procession.
en regard du nombre et de la disposition des victin1es : sur la frise sud, apparaissaient un taureau suivi d'un verrat à gauche de l'autel, et à sa droite un taureau et un bélier, alors que la frise nord mettait en scène uniquement trois animaux, d'un côté le taureau i de rautre un verrat suivi dlun bélier. Cependant, l'arc de Suse ne pose pas de problèmes quant à l'identification du rituel présenté, puisque les victin1es sont toutes mâles. En fait, si l'on s'intéresse à l'historiographie des reliefs sacrificiels romains, on s'aperçoit que dès qu'étaient repérés des animaux appartenant aux trois espèces (bovins, ovins, porcins) dans le même champ imagé, on pensait automatiquement à un suovétaurile. Or il existe des reliefs comprenant plusieurs victimes mâles et femelles, comme la petite frise couronnant l'autel de la Paix à Rome qui exhibe un ovin, un jeune taureau, une génisse 19.
Le dernier argument pour déconstruire l'hypothèse d'un suovétaurile sur le relief dit de Beaujeu est que le sacrifice de suovétaurile était offert uniquement à une seule divinité, à savoir Mars. En effet, bien que le nom de Mars n'apparaisse de fait que deux fois dans les textes, il est indirectement mentionné par les lieux mêmes où le sacrifice prend place. Et à en croire Festus, le rituel des solitau,-ilia correspond au sacrifice majeur (spolia opima) destiné à Mars. De plus, les autres divinités
évoquées dans les textes ne le sont jamais en tant que bénéficiaires du suovétaurile. Sur les reliefs romains montrant des suovétauriles, Mars figure uniquement sur les bases de Cn. Domitius Ahenobarbus et des Decennalia. D'autres divinités sont exceptionnellement représentées, mais elles sont soit en marge, comme les dioscures sur l'arc de Cottius à Suse, soit dans un autre registre comme sur le relief d'Isernia. Pour ce dernier, John Scheid a démontré que l'invocation au syncrétisme ne peut fonctionner; Mars, le destinataire du sacrifice, n'est simplement pas représenté 20 Sur notre relief,
J9 Dans l'abondante bibliographie, voir entre autres Scott Rybel'g 1955, p. 42, pl. XI, fig. 22b ; G. M. Koeppel, Die historischen Reliefs der romischen Kaiserzeit. V. Ara Pads Augustae Teil l, BOl1l1erJahrbücher, 187, 1987, p. 137-141, n° 7, fig. 27-31. P. Veyne, dans l'article cité, comparail avec justesse le relief de Beaujeu avec la oise de l'Ara Pacis, mais il y voyait malencontreusement la représentaLion d'un suovétaurile.
20 J. Scheid, Altalus Noni M(arci) s(eruus). Un Trévire b Aesernia ?, Mèlis, 9-10, 1994-95, p. 245-256. L'état actuel des connaissances en religions romaines permet de démonter les théories syncrétiques proposées par M. J. VerT.naseren dans son article The Suouetaurilia in Roman Art, Bulletin van de Vereeniging lot Bevordering de kennis van de antieke Beschaving, 32,1957, p. 1-12.
405
Le relief dit des SUovél3urîles de Beaujeu: une image sacrificielle hors de l'Italie
de suovétaurileso La dédicace de l'autel à Cérès aux confins de la colonie reposait d'une part sur la provenance du relief de Beaujeu, d'autre part sur les rapports qui, à l'époque, étaient établis entre les suouetaurilia, les anzbaruaiia, et Je sacrifjce offert par les frères Arvales à dea Dia en maL Amable Audin a montré qu'il était très difficile d'affirmer que le relief venait de BeaujeLl : il a tout à fait pu être transplanté de Lyon à l'époque moderne 24 .
John Scheid a démontré qu'il ne fallait pas assimiler les ambarualia avec le sacrifice à dea Dia et qu'il fallait donc clore la controverse. Le rite représenté sur le relief de Beaujeu ne peut donc en aucun cas être celui des frères arvales, contrairement à ce qu'avait affirmé L Scott Ryberg 25 Et d'ailleurs, j'ajouterai que rien ne permet d'affirmer que la divinité assise est Cérès, puisque son identification repose sur son assin1ilation avec les ambarualia et sa possibililé "syncrétique" de récupérer un sacrifice de suovétaurile : bien sûr les arbres présents (n° 1,4 et 11) signalent que nous SOTnmes dans un espace extérieur, peut-être dans un bois sacré, ce qui rend quand même l'interprétation de y Veyne de la représentation de la dédicace d'une ara (illalis extrêmement séduisante 26 , beaucoup plus séduisante que celle de Jean-Jacques HatL Ce dernier part de l'optique inverse de y Veyne même s'il reconnaît une cenaine acculturation rOTnaine, il cherche les traces d'un rite plus ancien qu'il décèle dans la présence de trois divinités associées, dans la forme de l'ornement posé entre les cornes du taureau (une pelte), dans l'offrande des taureaux à des divinités féminines. Ainsi rejette-t-îll'inlerprétation des deux fleuves pour y substituer un groupe qu'il interprète comme celui d'une triade de déesses-mères, présidée par une déesse n1ajeure des celtes: Rigani-Cantismerta-Rosmertao Toutefois, il reconnaît qu'il s'agit du rituel romain de s1.1ovétauriles consacré à Cérès! Sa conclusion est que « le motif central doit être lu comme une triade de déesses hiérarchisées» prouvant que «( derrière l'îmage d'une cérémonie en apparence purement romaine, se manifeste un culte beaucoup plus ancien de caraclère celtique: sacrifice de taureaux à la déesse reine des Celtes accompagnée de ses acolytes. Cette déesse reine, à Bordeaux, à Saintes, à Lyon, devait être ron1anisée et prendre l'aspect de la Tutelleo Il devait reprendre son importance au HIe siècle, à un moment où reparaissent en pleine lumière et officiellement les traditions indigènes. Et la déesse assise, en haut-relief) qui figure au
centre du suovéraurile et en l'honneur de laquelle sont accomplis les sacrifices, n'est autre que la réapparition tardive de la déesse reine celtique, à laquelle sont offerts, suivant une tradition séculaire, des taureaux au cours de certaines cérémonies annuelles )} 27. Je ne délTIOnlerai pas ici en détai! la théorie de Jo-Jo HatL Je préfère m'intéresser à la question du y/tus gallo-romain. Si l'on replace le relief dit de Beaujeu au sein du corpus des reliefs sacrificiels provenant des Gaules ron1aines 28 , on s'aperçoit qu'il témoigne à ]a fois bien d'un rite romain, et de certaines tendances in1agées "gallo-romaines"o En effet, bien que la représentation des sacrifices "sanglams" soit plutôt rare, elle est plus fréquente dans une zone comprenant Dijon, Bordeaux, Narbonne, Lyon et Avignon. Néann10îns, c'est sur un autel en calcaire consacré aux IVlatronae Aufàniae, actuellement conservé aul\1usée de Bonn, que l'on retrouve le port d'un cochon sur le dos d'un assistant en tunîque ; cependant la manière de transporter l'animal est différente 29 D'autre part, les divinités, rareInent visibles sur les reliefs provenant d'Italie, semblent presque systématiquement participer au sacrifice sur les reliefs gallo-romains, même si elles ne sont pas toujours insérées dans le même registre.
Donc, à la question du ritus romanu,)' ou du ritus "gallicus" se substituent la question de la construction de l'image et son pouvoir de perméabilité et de communicabilité d'un "autre" et d'un "semblable", d'une "altérité incluse"o Si je me place du côté de Rome, l'autre est révélé par la présence des divinités el par la truie transportée; si je me situe dans
24 Audjn 1986,
25 J, Scheid, Romulus et ses (l'ère';, Le collège des fi-èrô' (liliale,)" modèle du cutte public dans /a Rome des empèreurs, Rome-Paris, 1992, p. 442-45l.
2~ Voir aussi J. Scheid, op. ci!., no le n, p. 45l.
2ï J.-J. Hau., op. cif.. p. 267.
28 Voir le corpus que j'ai cons!"ltué il panir d' E. Espémndieu el de R. Lant.ier; Recueil généra! des !Jas-relie/s, statues et bustes de la G(!I,le romaine, I-XVl, 1907-1981, el Je tableau comparatif avec les reliefs saclificiels provenant de Rome el d'ltalie : V. Huel, Les images de sacr"ifice en Gaule romiJine, in : S. Lf'pelz, 'iN. Van Andringa (éd.), Archéologie du sacrij!ce anima! en Gaule romaine, Rituels et pratiques alimentaires, Palis, 2008, p. 43-74.
2° Scott Ryberg 1955, p. 171-172, pl. 62, fig. 102 a; T. Derks, Gods, Temples and Ritua! Practiees. The Ti"ansformatiol1 of" reIf.· giou.s Ideas and "lia/fies in Roman Gau/. Amsterdam, 1998, p, 221224, fig. 5.1.
407
Valérie Huet
J'espace géographique des trois Gaules , ces éléments "autres" constituent la marque identita ire des Gaules romaines . Pour autant, cette constatation n'implique pas de recherche r l'origine de ces éléments. Car l'image est opératoire justement dans cet empire romain et il n'y a pas lieu, contrairement à ce que font souvent les chercheurs/specta teurs, de distinguer éléments "romains" des "gallo-romains", les deux étant probablement indissociables à Lugdunum, colonie romaine, au début du pl' s. de notre ère.
En guise de conclusion, je voudrais citer Paul Veyne dans un autre article: " Linterprète qui surinterprète croit voir partout des intensités , alors que celles-ci sont sporadiques, ou trompeuses ,,30.
30 P. Veyne, t:interpréla tion et l'interprète . À propos des choses de la religion . Enquête, 3, 1996. p. 26 1.
Abréviations bibliographiques
Audin 1986 : A. Audin, Problèm es d'Archéologie lyon Religion in Roman A,t, Rome, 1955 (MAAR 22 ). naise. IVa. À propos des suouetaurilia de Beaujeu , Veyne 1959 : P. Veyne, Le monument des suové ta uRAE, 37, 1986, p. 262. riles de Beaujeu (Rhône) , Gallia, I, 1959, p. 79
Scott Ryberg 1955 : 1. Scott Ryberg, Rites of rhe Stare 100.
408















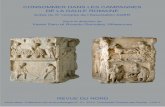


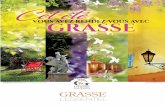












![Vbi ecclesia? Basiliques chrétiennes et violence religieuse dans l'Afrique romaine tardive (In: FREU, C.; JANIARD, S. [éds.], Libera Curiositas. Mélanges en l'honneur de Jean-Michel](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63178df62b00f6ff4406a021/vbi-ecclesia-basiliques-chretiennes-et-violence-religieuse-dans-lafrique-romaine.jpg)


