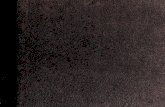Le programme iconographique de la basilique Saint-Paul-hors-les-murs à Rome : état de la question...
Transcript of Le programme iconographique de la basilique Saint-Paul-hors-les-murs à Rome : état de la question...
1
REMERCIEMENTS
Je souhaite, tout d’abord, exprimer toute ma gratitude à mon professeur Jean-Pierre
Caillet, pour la pertinence de ses conseils, pour sa grande disponibilité, et pour m’avoir
guidé dans le choix de ce sujet.
Je tiens à exprimer ma gratitude au professeur Herbert Kessler, véritable mine
d’informations sur Saint-Paul comme sur tant d’autres sujets, qui m’a encouragé et
prodigué des conseils avisés sur les programmes de la basilique.
Mes plus chaleureux remerciements vont au professeur Alessandro Tomei qui m’a
apporté son aide au cours d’inépuisables discussions sur Pietro Cavallini, et qui dans de
nombreux cas m’a indiqué les ouvrages de références sur l’artiste romain.
Je tiens également à remercier le docteur William Tronzo qui a accepté d’affronter
des difficultés sans nombre pour me procurer des articles dont j’avais besoin.
Mes pensées vont à Patrice Lerambert qui plus d’une fois m’a ouvert les portes de
son bureau pour me permettre d’effectuer mes recherches, non sans oublier de m’apporter
une aide matérielle pour que je puisse terminer ce travail.
Enfin, je voudrais dire ma reconnaissance aux membres de ma famille dont
l’affection et les encouragements ont permis à ce travail de se réaliser, et qui ont bien
voulu relire soigneusement les différentes parties de ce mémoire.
2
INTRODUCTION
« The search for the original iconography of the nave frescoes of San Paolo fuori
le mura remains one of the most vexing problems in art-historical research1 ». C’est par
cette phrase qu’en 1985 Luba Eleen introduisait son article fondamental sur les peintures
de la Vie de saint Paul ornant la nef de l’une des plus anciennes basiliques chrétiennes.
Il est vrai que les questions que soulève le décor de la basilique Saint-Paul-hors-
les-murs sont d’une importance capitale. De par son ancienneté, elle faisait partie avec
Saint-Pierre des monuments les plus importants de Rome et devait constituer par son
programme iconographique un véritable livre ouvert sur l’évolution des idées et des
manières de penser dans la ville éternelle. Hélas, la basilique devait brûler en 1823,
emportant dans les flammes les secrets de son décor.
Heureusement, des sources précieuses nous sont parvenues afin de reconstituer le
monument. Ce sont tout d’abord les données textuelles. Mais surtout, des dessins et des
gravures réalisés avant et après le sinistre permettent de nous donner une idée à peu près
exacte de l’arrangement et des programmes iconographiques qui se déployaient dans et en
dehors de la basilique.
Depuis la première étude réalisée sur les fragments de peintures au lendemain du
sinistre par G.B de Rossi2 jusqu’aux conclusions les plus récentes d’Anne-Orange
Poilpré3, le programme de Saint-Paul n’a cessé d’intéresser les historiens. La
reconstitution du programme et son attribution ont fait l’objet des principales recherches.
C’est en 1815, dans sa monographie consacrée à la basilique, que Nicolai
reproduit le cycle hagiographique4. Son étude, largement consacrée à l’aspect structurel du
bâtiment, avait quand même précisé que : « In tutta la extensione del muro meridionale
veggonsi pitture rappresentati fatti dell’antico testamento ; nel muro poi opposto, (…)
sono dipinti fatti del testamento nuovo (…)5 ». C’est pourtant à l’historiographie française
que l’on doit les premières avancées significatives sur la reconstitution du décor. En 1823,
1 ELEEN, 1985, p 251.
2 Résumé par KESSLER, 1994, p 397.
3 Voir POILPRE, 2003, pp 127-136 et pp 139-142.
4 Sur la planche intitulée : « Spaccato della basilica ostiense sulla linea A.A ».
5 NICOLAI, 1815, p 29.
3
est publié l’ouvrage de Jean-Baptist Seroux d’Agincourt6 qui fournit quelques
reproductions de scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament7. A la fin du XIXème
siècle, Eugène Müntz8 édite un article primordial sur plusieurs points. Tout d’abord, il met
enfin à la disposition des érudits les copies réalisées par le cardinal Barberini en 16349 et
qui, à cette période, étaient encore en la possession de cette famille10
. Ces relevés, qu’il
avait découverts en 187511
, lui avaient permis de reconnaître dans leur élaboration la main
de trois artistes. Il affirme surtout qu’à cause du mauvais état de conservation des
peintures au moment des relevés, les croquis devaient être très souvent infidèles. De plus,
par des descriptions précises, aussi bien iconographiques qu’épigraphiques, il donne en
détail le sujet de toutes les scènes de l’Ancien Testament et de l’arc triomphal ainsi que le
nom de quelques saints et prophètes qui se trouvaient dans la nef. Cependant, s’il s’essaie
à quelques comparaisons (comme par exemple lorsqu’il voit dans les vingt-et-une scènes
de l’Histoire des saints un rapport avec celles de Sant’Apollinare Nuovo à Ravenne qui
date du VIème siècle), ses descriptions restent bien trop vagues pour être tout à fait
convaincantes12
. C’est à la fin de la première guerre mondiale que la recherche allemande
va alors entreprendre une étude de fond de toutes les sources documentaires. En 1917,
Josef Wilpert est le premier à répertorier les différentes inscriptions présentes sur les
dessins de l’arc triomphal. De plus, il se livre à une description des différents portraits des
papes, et cela aussi bien pour les fragments sauvés après l’incendie qu’aux travers des
croquis réalisés au XVIIme siècle et conservés dans le Codex Barberini 440713
. Enfin, il
revient sur les scènes de l’Ancien Testament qu’il compare avec un ivoire de Salerne, dans
lequel il retrouve une parenté thématique14
. Son étude a largement été remise en cause par
une grande partie de l’historiographie, mais elle reste fondamentale dans le long processus
d’identification des figures votives que l’on pouvait apercevoir sur quelques peintures de
6 Alors qu’il venait d’expédier le manuscrit de son ouvrage à Paris, la Révolution arrête l’impression de son
étude. Il ne paraîtra donc qu’en 1823. Le principal intérêt de cette recherche reste une abondante illustration
gravée. Voir BAZIN Germain., Histoire de l’histoire de l’art de Vasari à nos jours, Paris, 1996, pp 87-88. 7 SEROUX d’AGINCOURT, 1823, Tome V, planche XCVI.
8 Sur la carrière d’Eugène Muntz, voir utilement BAZIN Germain., Histoire de l’histoire de l’art de Vasari à
nos jours, Paris, 1996, pp 145-146. 9 Ces copies font partie d’une série d’études documentaires sur Saint-Paul-hors-les-murs, des vues des
mosaïques de Sainte-Marie-Majeure et de Sainte-Marie-du-Transtévère, ainsi que des croquis des fresques
de San Urbano all’Caffarella et de Saint-Laurent-hors-les-murs. 10
La série rentrera dans la collection de la Bibliothèque Vaticane en 1902. 11
MUNTZ, 1895, p 112. 12
MUNTZ, 1898, p 11. 13
WILPERT, 1917, pp 560-579. 14
Ibid, 1917, p 622-623.
4
Saint-Paul. L’année suivante est publié l’ouvrage fondamental de Garber. Cette étude que
nous n’avons pas réussi à consulter nous est quand même restituée dans ses grandes lignes
par les commentaires qu’elle a suscités chez les historiens de l’art postérieurs15
. Il propose
qu’au moins quatre artistes aient participé à l’élaboration des dessins, et donne brièvement
leurs caractéristiques spécifiques16
. Enfin, l’auteur semble pousser à l’extrême l’influence
de Saint-Paul-hors-les-murs et de Saint-Pierre comme sources de toute l’iconographie
italienne17
. En 1961, Stephan Waetzoldt publie une première somme sur le délicat
problème de l’iconographie et de la signification de l’arc triomphal, suivie trois ans plus
tard par un véritable bilan des recherches sur le programme de la basilique. Son ouvrage
se présente comme un catalogue avec de courtes notices analytiques terminées par une
présentation bibliographique des ouvrages importants sur chaque composante du cycle. Il
s’est également attaché de façon plus précise à l’identification de chaque scène en
fonction des textes bibliques. Mais surtout, il présente pour la première fois, rassemblée
dans un même ouvrage, des reproductions en noir et blanc de l’intégralité du programme.
Cet « avantage » se retourne d’ailleurs contre lui, étant donné que Waetzoldt se limite aux
relevés du XVIIème siècle. Quelques années plus tard, Gardner présente et étudie avec
attention un autre dessin du XVIIème siècle qui livre l’iconographie de la façade de Saint-
Paul. Ses conclusions seront reprises en 1979 par Paul Hetherington18
. Quant à ce dernier,
sa reconstitution des cycles présents sur les murs latéraux de la nef et au revers de façade
de Saint-Paul permet d’envisager avec plus de clarté la disposition de ces programmes
dans l’édifice. Enfin, il reprend une par une chaque partie des cycles de la basilique, non
sans proposer pour certaines d’entres elles de nouvelles datations. D’une façon plus
ponctuelle, Luba Eleen concentre son travail sur le cycle néotestamentaire. Après un
rapide bilan des connaissances sur cette partie du cycle, elle s’attache à présenter
quelques scènes qui comportent, selon elle, des témoignages d’une iconographie
proprement paléochrétienne ; cela en ouvrant de nouveaux axes de recherches sur
certaines anciennes coutumes juives illustrées sur quelques folios du Codex Barberini.
Pour elle, il ne fait pas de doute que la confrontation des peintures de Saint-Paul avec des
textes comme la Misnah permettra aux futures recherches de déceler de nouvelles traces
15
L’ouvrage est conservé dans la Bibliothèque Hertzienne à Rome qui, pour des raisons de réfection des
bâtiments, n’effectue plus de prêt entre bibliothèque. 16
GARBER, 1918, pp 18-19. Cité par HETHERINGTON, 1979, p 81. 17
Voir sur ces propos GARRISON, 1993, p 205. 18
Nous renvoyons au résumé de l’ouvrage par GARDNER, Julian., « Pietro Cavallini », dans Burlington
Magazine, vol 72, n°925, Londres, 1980, pp 255-258.
5
de l’iconographie tardo-antique19
. En 1985, H. Kessler continue de suivre les orientations
d’une bonne partie de l’historiographie et, de nouveau, s’intéresse au programme primitif.
Il tente d’élucider le délicat problème de la signification du cycle au travers de
descriptions iconographiques précises20
. Cependant, son analyse se fonde sur des scènes
dont il est certain qu’elles avaient perdu leur composition d’origine, ce qui tend à fausser
la plupart de ses conclusions. Dans un article qui a fait date, Ulrike Koenen revient sur le
folio 41 du Codex Barberini. L’observation minutieuse du Rêve de Joseph lui permet de
remarquer quelques annotations jusqu’alors non prises en compte. En effet, Koenen
indique : « Le T se distingue et doit vouloir dire Tinto donc bleu (…), on remarque aussi
trois V (…) pour vert ce qui devait indiquer le paysage (…), enfin à droite se dégage ce
qui devait être un vase. Ce motif permet d’avancer l’idée que les copistes percevaient les
épis liés vaguement à une gerbe, et ne savaient pas les ranger dans la composition21
». Par
la suite, produisant un bilan des représentations du Rêve de Joseph dans l’Antiquité
tardive, elle reconstitue la peinture qui devait être en place à Saint-Paul, bien différente du
croquis du XVIIème siècle. Enfin, dans une thèse soutenue en 2003, Anne-Orange Poilpré
présente avec pertinence une classification chronologique de la Maiestas Domini. Ce
thème, présent sur l’arc de Saint-Paul, permet à l’auteur de soulever de nouvelles
conclusions quant à sa composition et à sa signification22
. Pourtant, ses hypothèses
négligent plusieurs conclusions de toute première importance présentes dans bon nombre
d’études antérieures. Ce qui, sans remettre en cause la pertinence de son propos, limite la
portée de son interprétation.
L’historiographie a également soulevé le délicat problème de l’attribution de ces
peintures et mosaïques. En étudiant le cycle de Saint-Paul, Seroux d’Agincourt avait
proposé de voir : « (…) dans les sujets des martyres, et en général dans le mouvement et
l’expression des figures, ainsi que dans le jet moins noble des draperies, que l’on peut (…)
observer (…) l’ancien style de l’école grecque, sous le pinceau des maîtres grecs établis
depuis long temps en Italie, ou des élèves italiens travaillant avec eux23
». En 1918,
Garber par son étude des croquis, a remarqué que dans une dizaine de scènes
transparaissait une iconographie de l’Antiquité tardive. Pourtant, il a trop tendance à
19
ELEEN, 1985, p 257. 20
KESSLER, 1985, p 372. 21
KOENEN, 1992, p 188. 22
POILPRE, 2003, pp 141-142. 23
SEROUX d’AGINCOURT, 1823, Tome II, p 117.
6
oublier que chaque scène pose des problèmes différents : à savoir, si nous sommes bien en
présence d’un épisode dont l’iconographie est vraiment paléochrétienne, ou face à une
restauration réalisée à une date postérieure ne reproduisant qu’approximativement le
schéma tardo-antique. En 1934, Léon de Bruyne publie un bilan des connaissances sur la
galerie des portraits des papes tout en formulant de nouvelles propositions sur le travail de
Cavallini pour la seconde galerie. Ce problème de l’intervention de l’artiste médiéval sur
les peintures de la basilique va connaître une avancée tout à fait remarquable avec l’article
de John White paru en 1956. Il a d’abord le mérite de proposer des dates précises quant à
l’intervention de Cavallini sur les peintures de l’Ancien Testament et du Nouveau
Testament. Puis, dans un second temps, sa recherche se concentre sur l’étude formelle des
dessins ce qui lui permet de tirer certaines conclusions sur l’évolution du style de l’artiste.
En revanche, il ne fait pas de doute pour Gardner que ce n’est pas Cavallini qui est
intervenu sur le cycle de la façade. Dans sa monographie sur l’artiste, Hetherington
présente l’intégralité des sources connues de l’artiste, en insistant sur l’abside de Sainte-
Marie-du-Transtévère, dont il pense que c’est l’œuvre la plus autographe. L’auteur ne
tente cependant pas d’approfondir certaines problématiques soulevées par Gardner et
White. Pour lui, les peintures et mosaïques qui décoraient Saint-Paul sont toutes de la
main de Cavallini24
. Avec Serena Romano, l’historiographie italienne revient sur les
problèmes d’attribution de quelques parties du programme réalisé au XIV siècle. Et, dans
un nouveau panorama de l’œuvre de Cavallini, Alessandro Tomei va dans le sens de
l’intervention d’autres artistes que Cavallini sur le programme de Saint-Paul.
Face à cette bibliographie assez pléthorique et aux orientations parfois divergentes,
il apparaît utile de produire un bilan objectif. Nous focaliserons particulièrement
l’attention sur le cycle primitif qui, à quelques exceptions près, ne nous est connu qu’au
travers des études sur Cavallini.
Du fait de la complexité du problème, aucun aspect ne saurait être négligé, à
commencer par ce qui tient à l’historique du monument et à son évolution architecturale.
Tout d’abord, une mise au point sur les commanditaires et le contexte de réalisation
fournira des points d’ancrage incontournables pour la compréhension de l’élaboration du
décor. Nous nous risquerons alors à dresser un nouvel état de la question critique sur le
programme de Saint-Paul. Dans ce sens, le déroulement chronologique permettra de
24
HETHERINGTON, 1979, pp 112-113.
7
souligner au mieux les multiples chantiers qui se sont succédés dans la basilique. Enfin,
nous tenterons d’explorer de nouveaux axes de recherches sur le programme primitif. Pour
ce faire, nous proposons d’aborder encore une fois le délicat problème de restitution de
quelques points particuliers du cycle. Mais surtout, nous reviendrons sur les différents
critères de datation et de signification du programme, qui occupent encore aujourd’hui une
bonne part des publications.
9
Chapitre Premier
Aux Origines de Saint-Paul-hors-les-murs
1) Dates et commanditaires
a) Sur les problèmes du premier édifice
C’est en périphérie de Rome, tout près des murs de l’ancienne cité, dans une plaine
située entre les rives du Tibre et la voie d’Ostie, qu’avait été construite à la place d’un
premier édicule25
une église Saint-Paul dans laquelle étaient conservés les restes de
l’apôtre26
. Les fouilles archéologiques ont dégagé un mur absidial dont la cavité devait
s’orienter vers l’est. Etant donné le diamètre de cette abside, évalué à neuf ou dix mètres,
il devait s’agir d’un édifice de moyenne importance. Malgré certaines tentatives de
reconstitution27
, le plan et l’extension du bâtiment en direction de la voie d’Ostie restent
encore aujourd’hui très mal connus28
.
Les circonstances de la fondation de cette église sont également peu claires. A en
croire la biographie du pape Sylvestre contenue dans le Liber Pontificalis, c’est à
Constantin que l’on doit la construction de l’édifice :
« Eodem tempore fecit Augustus Constantinus basilicam Sancto Paulo apostolo ex
suggestione Silvestri episcopi29
».
C’est toujours l’empereur qui offre le cercueil de bronze dans lequel ont été déposé
les restes du saint mais également les nombreuses donations offertes à l’église30
. En plus
de cela, le compilateur du Liber fait mention d’un patrimoine en argent et en objets
précieux à peu près égal à celui offert par Constantin à Saint-Pierre31
. Cependant, face aux
grandes imprécisions que l’on relève ici et là, on peut vraisemblablement être amené à
penser que nous sommes face à une manipulation. Pour Krautheimer, il paraît clair que les
archives de l’Eglise, dans lesquelles puisa au VIème siècle le compilateur du Liber, ne
25
Sa présence nous est confirmée par un certain Gaius qui avait sans doute visité les tombes des apôtres
Pierre et Paul pendant le IIème siècle. Voir DELEHAYE, 1933, p 203. 26
Sur le culte des martyrs, voir utilement MAROU, 1985, pp 101-105. 27
Dans son article, GHETTI propose une restitution « idéale » du mausolée de l’apôtre. Voir GHETTI,
1969, p 24 et 26. 28
Pour l’étude archéologique de ce site, voir KRAUTHEIMER, 1977, p 117-118 et THUMMEL, 1999, pp
98-121. 29
KRAUTHEIMER, 1977, p 97. 30
VOGEL, Liber, 1981, tome I, p 178. 31
KRAUTHEIMER, 1995, p 13-14.
10
conservaient aucun document concernant aussi bien la fondation que la construction de
l’édifice, peu avant 400. Pour pallier les manques de documentation, celui-ci aurait donc
fait état de dons fantaisistes, tout au moins égaux à ceux de la basilique Saint-Pierre.
L’étude du texte nous laisse cependant penser qu’à l’origine l’édifice a bien été
fondé par Constantin qui fit don alors d’une propriété près de Tarse. Pourtant, selon
Krautheimer, il est tout à fait probable que l’église n’a pas été réalisée par l’empereur
après les conquêtes d’Orient (327-337) mais plutôt par ses fils, c’est-à-dire Constantin II,
Constant Ier et Constance II, dans les années 337-34032
. Quoi qu’il en soit, ce premier
bâtiment n’avait rien à voir avec la basilique construite en l’honneur de Pierre richement
dotée par Constantin et qui occupait une vaste terrasse artificielle résultant du comblement
d’un cimetière païen et du premier lieu du culte chrétien.
b) L’intervention de Valentinien II, Théodose et Arcadius
Pour sans doute rivaliser avec la basilique vaticane, c’est au préfet Sallustius
Aventius qu’est envoyée la lettre des Augustes Valentinien II33
(375-392), Théodose (379-
395) et Arcadius (383-408) qui demandent, au vu du nombre des fidèles, de remplacer
l’église originelle par un édifice plus vaste, plus élevé et plus magnifique:
« Valentinianus, Theodosius et Arcadius Augusti Salustio praefecto urbis.
Desiderantibus nobis contemplatione uenerationis antiquitus iam sacratae basilicam
Pauli apostoli pro sanctimonio religionis ornare, pro quantitate conuentus amplificare,
pro studio devotionis attollere34
»
Il semble donc que la fondation de la basilique soit à son origine une fondation
impériale35
, véritable acte d’évergétisme privé acquis à l’Eglise36
et dont les empereurs
semblent vouloir aviser le clergé et la population chrétienne :
32 KRAUTHEIMER, 1995, p 14. 33 Selon André Chastagnol c’est à Valentinien II que l’on doit surtout cette réalisation. Etant à l’origine de sa
construction et malgré l’intermède de l’usurpateur Maxime, elle fut terminée à peu près sous Valentinien II qui
gouvernait de nouveau l’Italie après la victoire de Théodose sur Maxime comme le prouve une brique trouvée à Saint
Paul qui portait l’estampille : D.N FL. VALENTINIANS AVG. CHASTAGNOL, 1966, p 432. Malgré l’initiative de
Valentinien, l’honneur d’avoir élevé la basilique fut revendiqué sans partage par la famille théodosienne. 34 CHASTAGNOL, 1966, p 436. 35 Voila pourquoi, comme le signale KRAUTHEIMER il n’y a aucune explication pour ce qui concerne la fondation de
la basilique dans le Liber, et qu’on en trouve trace qu’au moment de la restauration sous Léon le Grand, quand la
basilique fut placée sous l’autorité de l’évêque de Rome. Voir KRAUTHEIMER, 1995, p 13. 36Voir sur ce point précis, GUYON, Jean., « La Marque de la Christianisation dans la topographie urbaine de Rome »
dans La fin de la cité antique et le début de la cité médiévale de la fin du IIIème siècle à l’avènement de Charlemagne :
Actes du colloque tenu à l’Université de Paris X Nanterre les 1, 2 et 3 avril 1993, Paris, 1996, p 222.
11
« (...) uenerabili sacerdote intimatisque omnibus et magnificentissimo ordini et
Christiano populo(...)37
»
Enfin, ils demandent au préfet d’établir des négociations avec les autorités civiles, afin
de régler les problèmes de situation du site. Mais surtout, ils demandent qu’un plan et un
devis soient dressés pour être portés à leur connaissance :
« Iam illud ipsa res exigit, ut et synopis operis construendi fideli tendatur examine
sumptuumque omnium iuxta praetia rerum, quae in sacratissima urbe, preataxatio
plenius ordinetur atque ad nostram clementiam debita maturitate referatur (…) 38
»
Les mechanici en furent d’abord Cyriade et Auxientus39
. L’entreprise, réalisée à
grand frais, posa des problèmes financiers et se termina par un procès, et ce fut finalement
le notaire Aphrodisius qui finit par prendre la direction du chantier40
. L’aboutissement à
un procès, sans doute précédé par une enquête peut évidemment surprendre. Cependant, il
convient de signaler que ce chantier fut peut-être supporté grâce aux caisses spéciales,
que sont l’arca vinaria ou l’arca frumentaria41
.
Il est vrai qu’auparavant, quand il s’agissait d’élever un édifice destiné au culte
chrétien, l’évêque et/ou les prêtres ordonnaient les travaux sans le recours de l’Etat, en
faisant appel aux ressources de la communauté chrétienne, ou bien en utilisant des fonds
accordés par de généreux donateurs. Cependant, depuis Constantin, l’évêque pouvait, pour
la construction d’édifices onéreux, puiser dans les fonds publics ; dans ce cas, il est normal
qu’un contrôle de l’Etat intervint. Enfin, avec le règne de Gratien (375-383), la
construction (ou bien la réparation) était effectuée par les services officiels des travaux
publics, sous la direction du préfet de la ville42
.
Une autre difficulté, sur laquelle il convient de se pencher maintenant, et largement
traité par l’historiographie, concerne les différents problèmes liés à la chronologie de
réalisation de l’édifice. L’un des plus sérieux consiste à cerner avec plus ou moins
37
CHASTAGNOL, 1966, p 436. 38
CHASTAGNOL, 1966, p 436. 39
On avait d’abord pensé que l’architecte qui avait travaillé à Saint-Paul fut Auxientus et non pas Cyriadès,
comme il a été affirmé auparavant. Voir MARTINEZ-FAZIO, 1972, p 318 et suiv. 40
KRAUTHEIMER, 1995, p 11. 41
CHASTAGNOL, 1966, p 427. 42
Ibid, 1966, p 435.
12
d’exactitude la date du début du chantier43
. L’étude d’André Chastagnol reste sur ce point
d’une importance capitale. S’appuyant sur une inscription, retrouvée mutilée, d’une
colonne de marbre en cipolin (encore aujourd’hui dans le bas-côté nord de la basilique, la
première colonne en partant de l’autel), il propose de situer les travaux entre 383 et la
dédicace du 18 novembre 39144
. Affinant cette étude, Richard Krautheimer s’oriente
plutôt vers une décision qui oscillerait entre 382 et le printemps 383, tout en admettant que
le début du chantier intervint sous le mandat du praefectus Sallustius Aventius au
printemps 38445
. Nous savons que les travaux furent terminés sous le mandat d’Honorius
(après 395) comme nous l’indique une inscription de l’arcus maior46
:
“THEODOSIUS CAEPIT. PER FECIT HONORIUS AULAM DOCTORIS MUNDI
CORPORE PAULI”
et que Prudentius la vit vers 402-403 :
« (…)Regia pompa loci est, princeps bonus has sacravit arces lusitque magnis
ambitum talentis (…) Subdidit et Parias fulius laquecuibus columnas distinguit
illic quas quaterras ordo47
»
C’est donc un chantier d’une vingtaine d’années qu’il fallut pour la construction de
l’édifice. Le personnel attaché à la basilique devait être placé sous l’autorité directe des
empereurs, comme en témoigne l’inscription retrouvée sur une plaque de bronze utilisée
pour identifier un chien de berger ou un esclave :
« AD BASILICA APOSTOLI PAVLI ET DDD NNN FILICISSIMI PECOR48
»
2) Contexte de construction
a) Primauté de Pierre
Les fidèles qui, au cours des quarante dernières années du IIIème siècle, visitaient la
memoria apostolorum ad catacumbas sous l’église Saint-Sébastien, invoquaient dans leurs
43
Pour un bilan exhaustif des nombreuses études à ce sujet : Voir MARTINEZ-FAZIO, 1972, pp 103-105. 44
CHASTAGNOL, 1966, pp 428-432. 45
Cette date a été largement débattue par les spécialistes. Voir la planche récapitulative dans MARTINEZ-
FAZIO, 1972, pp 120-121. 46
Ce n’est que dans les années 820-830 que l’arc qui séparait la nef du transept, qu’on désignait comme
l’arcus maior, devint « arc triomphal ». Voir KRAUTHEIMER, 1999, p 304. 47
PRUDENTIUS, 1951, verset 45-54. 48
VOGEL, Liber, 1981, p 195, note 71.
13
graffiti aussi bien l’apôtre Pierre que Paul, donnant la préséance tantôt à l’un tantôt à
l’autre, ce qui montre bien à quel point les deux apôtres jouissaient de la même
considération49
. C’est dans ce sens que l’Eglise romaine consacra conjointement la
mémoire des deux saints, lors de la fête du 29 juin, peut-être instituée en 258 et confirmée
en 336.
Pourtant, à côté de cette égalité de traitement, une autre conception se faisait jour :
celle du primatus Petri. Cette idée, fondée sur le passage de Matthieu : « Tu es Pierre, et
sur cette pierre je bâtirai mon Eglise » (Mat 16 : 18), permit de réclamer la première place
dans l’Eglise universelle pour l’évêque de Rome, en tant que successeur de l’apôtre Pierre,
désigné par le Christ lui-même. Cette affirmation devint une arme efficace des évêques de
la ville pour consolider tout d’abord leur place prééminente en Occident, puis pour pallier
les manques du soutien impérial quand le souverain vint à quitter Rome, et à contrer les
revendications des patriarches orientaux.
b) Remise à l’honneur de l’apôtre des Gentils
Ce n’est qu’à la fin du IVème siècle que Paul retrouve une place particulière dans
la vie des fidèles. On remarque alors que les deux apôtres se présentent sur un pied
d’égalité, comme le soulignent les thèmes de la traditio legis, où Pierre reçoit la loi tandis
que Paul figure comme celui qui se chargera de la prédication. Parallèlement, vers 360, fut
élaboré à Rome le thème de la concordia apostolorum50
qui attribuait le même rang aux
deux apôtres. A une époque de transition si particulière, ce thème de la concordia
garantissait d’une certaine manière la renaissance de Rome. A l’antique cité se substituait
la nouvelle Rome chrétienne, unie par une même foi religieuse, et où Pierre et Paul
venaient se substituer à Romulus et Remus51
.
Loin d’être un phénomène purement populaire, on remarque que Paul prend une
dimension considérable chez les érudits de l’époque. Pour Amboise, Paul est le sapiens
architectus. Le Christ, qui avait remis les clés du royaume céleste à Pierre, aurait confié à
Paul les clés de la connaissance :
49
Voir à ce sujet, DE SPIRITO, 2000, pp 37-40. 50
KRAUTHEIMER, 1995, p 16. Voir utilement l’étude majeure de HUSKINSON, J-M., Concordia
Apostolorum: Christian propaganda at Rome in the fourth and fifth centuries: a study in early Christian
iconography and iconologie, Oxford, 1982. 51
KRAUTHEIMER, 1999, p 109.
14
« Clavem a Christo scientiae et Paulus acceptit. Ambo igitur claves a Domino
perceperunt, scientiae iste, ille potentiae52
»
Une prière pour la fête du 29 juin, contenue dans le Sacramentarium Veronense,
marque le lien entre les deux apôtres :
« Hic princeps fidei confitendae (…), ille intelligendae (…) adsortor ; hic Christum
filium dei vivi pronuntiavit (…), ille hunc eundem verbum sapientiam dei (…)
adstruxit ; hic (…) instituens ecclesiam primitivam, ille magister et doctor gentium
vocandarum53
»
La parité entre Pierre et Paul était donc un principe de base, même si la primauté
de Pierre ne fut jamais remise en doute. A la fin du IVème siècle, Paul qui possédait les
clés de la connaissance car il avait percé la signification du Logos, était devenu l’égal de
Pierre, le cofondateur de l’Eglise universelle.
Il fallait donc sans plus attendre construire un édifice en l’honneur de l’apôtre des
Gentils, tout aussi somptueux que la basilique vaticane, et qui devait évoquer aussi bien
son martyre que la double apostolicité de Rome. Il devait être un ultime appel aux païens
pour l’entrée dans une Eglise fondée par Pierre mais aussi par Paul.
Pour ce faire, le pape Damase54
qui sans aucun doute eut le premier l’idée de
construire cette basilique, eut recours aux empereurs55
; cela pour soutenir dans un premier
temps les efforts de financement d’un tel projet mais aussi pour jouer subtilement d’un
moyen de pression efficace envers les derniers groupes païens enracinés au Sénat et dans
les grandes familles romaines. Et en cela, Paul, « philosophe » et dépositaire de la clavis
scientae, devenait pour le pouvoir une personnalité capable de rallier à la foi chrétienne
ces derniers foyers de « résistants » sans que ceux-ci ne perdent de leur dignité
intellectuelle56
.
52
MIGNE, 1844-1890, Supplément III, col 355. 53
Cité dans KRAUTHEIMER, 1995, p 17. Voir aussi PIETRI, 1969, p 199. 54
Son tombeau qu’il réalisa sur la via Tiburtina, véritable témoignage du culte pour saint Laurent marqua
pour Rome un fait nouveau, et capital dans l’histoire de l’Eglise de Rome. Le culte des martyrs localisé
jusque-là sur leur tombe et hors les murs pénétrait au cœur de la ville. Voir sur ce point, KOCI-
MONTANARI, Silvia., Le chiese Papalia a Roma. Sulle trace dei sepolcri dei Papi, Cité du Vatican, 2002,
pp 273-285. 55
Dans sa lutte contre le paganisme Damase est resté très prudent dans sa politique avec le parti de
l’aristocratie sénatoriale. Il avait semble t-il encore besoin de l’appui impérial. Voir PIETRI, 1976, p 427-
431. 56
KRAUTHEIMER, 1995, p 20.
15
Enfin, par la présence des deux basiliques, Rome pouvait de nouveau prétendre à
être le symbole même du catholicisme (dans son sens littéral d’universalisme), en
devenant l’entité qui prépare la cité terrestre à réaliser la ville céleste. La ville qui avait été
rachetée à la vraie foi par le sang des martyrs, et en particulier par celui de Pierre et Paul,
devenait le siège spirituel de la foi dans le Christ.
16
Chapitre second
Genèse structurelle du monument
1) L’édifice paléochrétien
a) Plan
« Le souci de cohérence et de la beauté de chaque détail, le luxe du décor,
l’équilibre des proportions qu’on observe à Saint-Paul-hors-les-murs, (…), dénotent un
renouveau du goût classique dans l’architecture ecclésiastique (…)57
». Il est vrai que
celle-ci devait en quelque sorte rivaliser avec la basilique dédiée à saint Pierre, et aussi
sans aucun doute la dépasser dans beaucoup de domaines. Malgré l’incendie de 1823, et la
reconstruction qui l’a suivi, des plans réalisés au XVIème siècle et des vues intérieures et
extérieures permettent de rendre avec assez d’exactitude ce que devait être la basilique de
la voie d’Ostie.
Il fallait d’abord éviter à la basilique d’empiéter sur l’ancienne voie d’Ostie.
L’architecte prit alors la décision de tourner l’édifice à 180°, ce qui plaçait l’entrée à
l’ouest, et permettait de construire la bâtiment sur la Via Soppressa da Valentiniano, tout
en sauvegardant l’ancienne route romaine (ill.1).
Précédée d’un immense atrium rectangulaire à quadruple portique qui s’ouvrait par
cinq portes sur la basilique, l’édifice se développait sur un plan en forme de T avec une
abside unique58
comme les grandes basiliques antiques. Elle était subdivisée en cinq nefs,
une nef centrale et quatre bas-côtés, et était exceptionnellement dotée comme Saint-Pierre,
d’un transept allongé de la même largeur que la nef principale59
qui venait s’interposer
entre les nefs et l’abside60
, le tout orienté d’Est en Ouest (ill.2). De proportions
gigantesques, elle avait une longueur totale de 128,38 mètres pour une largueur (les cinq
nefs) de 65, 27 mètres. La nef principale, plus large que les collatéraux, était délimitée par
une « forêt » de 40 colonnes.
57
KRAUTHEIMER, 1999, p 113-114. 58
KRAUTHEIMER, 1977, p 29. Ce système cessera d’être exploité à Rome aux environs de 400. 59
BUNSEN, 1872, p 15. 60
Trois basiliques chrétiennes étaient chalcidiques, St-Pierre, St-Paul et le Latran. Cette nef transversale
jetée en travers avait la même hauteur de comble que la nef longitudinale. Avec la disparition des materiaux
de luxe, on remployait énormément. Pendant longtemps dans les pays où les civilisations grecque et romaine
avaient prodigué les édifices on parvint par des démolitions et des arrachements à se procurer des colonnes
dont on égalisait les tailles par des chapiteaux plus ou moins élevés.
17
b) Elévation
Le vaisseau principal présentait de hautes arcades, dont chaque pilier cannelé était
pourvu de chapiteaux composites61
. Ces arcades, décorées selon Prudentius par des
mosaïques de tesselles en pâte de verre62
, soutenaient des murs latéraux qui s’élevaient
sans aucune rupture ni articulation et se terminaient par une claire-voie où quarante deux
fenêtres hautes répondaient à un souci d’éclairage optimal. Cet ajournement était sans
doute permis grâce à l’utilisation d’un système de couvrement léger, ici une charpente à
entraits (ill.3).
Chaque double bas-côté était couvert par un appentis à un seul rampant. Sur chaque
flanc par conséquent, un seul comble partait du mur de la nef et se prolongeait jusqu’au
mur extérieur. Mais comme, en pareil cas, la colonnade intermédiaire devait être relevée
bien au-delà du nécessaire pour aller à la rencontre du comble et offrir son soutien aux
fermes du premiers appentis, on épargna les matériaux en établissant une sorte d’attique
pourvu d’une série de percement semblables à des baies. Enfin, les murs gouttereaux
étaient percés de fenêtres qui correspondaient à chaque entrecolonnement63
.
A l’est chaque bas-côté était terminé par une arcade soutenue par des puissants arcs
de décharge, tandis que la nef était pourvue d’un immense arcus maior qui était soutenu
par des colonnes de granit à chapiteaux ioniques. C’est par ces passages que l’on pouvait
avoir accès au transept (ill.4). Nous savons qu’à l’inverse du transept bas de Saint-Pierre,
celui de Saint-Paul avait été construit à la même hauteur que la nef. Pourtant, le manque
de documentation sur cette partie de l’édifice rend difficile toute interprétation de son
articulation interne. Malgré tout, grâce à un croquis de Ciampani (ill.5) et à certaines
gravures de Nicolai (ill.4), nous pouvons remarquer que les murs étaient percés à divers
endroits de nombreuses ouvertures. Par exemple, sur la gravure de Nicolai, sont
représentés, sur l’un des murs latéraux du transept, des fenêtres obstruées qui sont
surmontées d’arcs de décharges à double extrados que l’on peut sans doute faire remonter
61
DEICHMANN, TSCHIRA, 1969, p 95. Voir également l’étude de BRANDENBURG, Hugo.,
« Beobachtungen zur architektonischen Ausstattung der Basilika von S. Paolo fuori le mura in Rom » dans
Jahrbuch für Antike und Christentum, vol 33, Münster, 2002, pp 83-107. 62
PRUDENTIUS, 1951, chap XII, 45-54. 63
KRAUTHEIMER, 1977, p 107.
18
à une date haute64
. En ce qui concerne les murs pignons, le relevé de Ciampani et certaines
gravures laissent apercevoir de larges baies surmontées d’ouvertures circulaires, que
Nicolaï a reproduites en 1815. La confrontation avec les restitutions de l’ancienne
basilique Saint-Pierre (Fig.1), permet d’affirmer que, dans ce secteur également,
l’architecte de Saint-Paul, avait multiplié, comme dans la nef, des fenêtres hautes pour
assurer le meilleur éclairage possible65
. Il est vrai que se trouvait, dans cet espace, la
memoria apostolique, située juste devant l’abside voûtée en cul-de-four. On peut imaginer
qu’à cette période, la tombe de saint Paul était surmontée d’un ciborium66
protégé par des
chancels comme à Saint-Pierre ; on a d’ailleurs retrouvé une dalle de marbre provenant
peut-être du premier templum et qui portait l’inscription :
« PAOLO APOSTOLO MART(yri)67
»
2) Restauration et restructuration
a) Les interventions pendant le Moyen Age
Il est bien difficile de dresser un état certain des différentes reconstructions ou
embellissements qui ont émaillé l’histoire de la basilique pendant le Moyen Age. Le
croisement des données archéologiques et des renseignements fournis par le Liber, permet
de dégager quelques renseignements sur les changements entrepris68
.
C’est à la suite d’un orage ou d’un tremblement de terre qu’intervinrent, quelques
années après sa construction, les premiers travaux de consolidation. Il semble que Léon le
Grand, à la suite de l’affaissement du sol et de l’effondrement de la toiture, ait été alors
obligé de se lancer dans une vaste campagne de restauration :
«Hic renovavit basilicam beati Petri apostoli et beati Pauli post ignem divinum
renovavit69»
64
On retrouve le même schéma pour l’église Sainte-Praxède, dont on pense qu’il s’est inspiré de Saint-Paul.
Voir KRAUTHEIMER, 1999, p 325. 65
KRAUTHEIMER, 1977, pp 107-108. 66
Sur le mobilier liturgique paléochrétien, nous renvoyons à METZGER, Catherine., « Le mobilier
liturgique », dans Naissance des Arts chrétiens. Atlas des Monuments paléochrétiens de France, Paris, 1991,
pp 262-267. 67
Voir GHETTI, 1969, p 28-30. 68
Sur la somme de ces interventions nous renvoyons des à présent à TOMEI, 1988, pp 55-65. 69
VOGEL, Liber, Tome I, 1981, p 239.
19
Le soin de l’organisation et de la réalisation du chantier ont incombé à deux clercs
majeurs, un prêtre et un diacre :
« Laus ista Felix respicit te presbyter nec te leuites Adeodate praeterit, quorum
fidelis atque peruigil labor decus omne tectis ut rediret institit 70
».
L’intervention ne s’est pas seulement limitée à la réfection de la toiture71
puisqu’il
semble que sur les quarante colonnes de la nef, seize ont été restaurées en marbre blanc72
.
Quoi qu’il en soit, la « somme » des travaux réalisés par le pape était résumée sur une
plaque de marbre, placée à l’envers de la façade au-dessus de la porte d’entrée :
« NAM POTIORA NITENT REPARATA CULMINA TEMPLI
ET SUMPSIT VIRES FIRMIOR AULA NOVAS
DUM XPI ANTITES CUNCTIS LEO PARTIBUS AEDES
CONSULIT ET CELERI TECTA REFORMAT OPE73
»
Après 422, le pape Célestin donne à l’édifice un système d’éclairage avec des
canthara cereostata. Sixte III la pourvoit de matériel liturgique, et le Pape Simplicius
permet que le baptême soit administré à Saint-Paul par le clergé de la Région I74
. C’est
avec le pontificat de Grégoire le Grand (590-640) qu’interviennent des modifications
d’importance. Tout d’abord, le pape permet que la messe soit célébrée autour du corps du
saint :
« Hic fecit ut super corpus beati Petri missas celebrarentur ; item et in ecclesiam
beati Pauli apostoli eadem fecit75 »
Il fit alors de creuser la tombe de saint Paul, afin de créer une crypte comme à
Saint-Pierre (Fig.2), avec l’intention « d’améliorer le site » pour canaliser le flux des
fidèles, comme en témoigne la lettre adressée à l’impératrice Constantina :
70
Voir CAILLET, Jean-Pierre., L’évergétisme monumental chrétien en Italie et à ses marges, Rome, 1993,
p 419. 71
VOGEL, Liber, Tome I, 1981, p 240, note 7. 72
KRAUTHEIMER, 1977, p 156. Cela est confirmé par la présence d’agrafes en métal pour consolider les
colonnes. Voir DEICHMAN, TCHIRA, 1969, p 106. 73
KRAUTHEIMER, 1977, p 99. 74
VOGEL, Liber, tome I, p 249. 75
VOGEL, Liber, Tome I, 1981, p 312.
20
« Sed et ego aliquid…ad sacratissimun corpus sancti Pauli apostoli meliorare
volui, et quia necesse erat, ut iuxta sepulcrum eiusmodi effodiri altius debuisset76 »
Avec Léon III, les travaux furent particulièrement axés sur la charpente du transept
et des collatéraux, sans que l’on sache cependant la teneur exacte de ces restaurations.
Vers 1070, l’abbé Hildebrand fit nettoyer la basilique qui était devenue un abri pour les
animaux77
. Nous savons que, pendant cette période, plusieurs réparations furent réalisées
sur les murs de l’église, et que fut construit le campanile, comme le prouvent des pièces
retrouvées dans plusieurs fondations78
. Les destructions, à la suite d’un orage qui avait
enflammé les poutres du transept79
, obligèrent le pape Innocent II (1130-1143) à
construire un mur d’appui supporté par des colonnes en marbre80
tout le long du transept
pour supporter le toit (ill.6) :
« In ecclesia quoque beati Pauli tectum qui ruinam minabatur, constructo super
columnis marmoreis muro, firmissime roboravit, et partem tecti eiusdem ecclesie
longissimis trabibus resarcivit81 »
Enfin, un tremblement de terre en 1349 causa la chute du campanile et
endommagea fortement l’atrium :
« (...) tremuoti (…) a Roma feciono cadere il campanile della chiesa di San Paolo,
con parte delle loggi in quella chiesa (…)82
»
Face à ce sinistre, l’ensemble fut restauré par Clément VI. Ces premières
campagnes de restauration, quoique documentées incomplètement, permettent de dégager
les grandes lignes des nouvelles dispositions liturgiques et structurelles de l’édifice. Pour
dresser un panorama complet, il convient cependant de considérer plus avant les
bouleversements survenus.
76
MIGNE, 1844-1890, PL LXXVII, col 1318. 77
MIGNE, 1844-1890, PL CXLVIII, col 43. C’est l’abbé qui, pendant son ambassade à Constantinople avec
l’aide de la famille Pantaléon, commanda des portes en bronze pour la basilique. Elles étaient divisées en
cinquante-quatre panneaux représentant des prophètes et plusieurs sujets relatifs aux apôtres. Nous
renvoyons à la monographie de JOSI, 1967, à l’ouvrage de MATTHIAE, 1971, pp 132-143 et à l’article de
RAVERA, Gabriella., « La porta bizantina della Basilica di San Paolo », dans Lazio ieri e oggi, n°36, Rome,
2002, pp 104-105. 78
« Nel 1628 a di 15 Decembre furon trvate nelle muraglie di tal chiesa dieci monete sottili …con lettere
impressevi : et una vi less cosi O(TT)O, cioè Otto che mostra Ottone Imp… ». 79 Voir VOGEL, Liber, Tome II, 1981, p 384. 80
En voir la description dans KRAUTHEIMER, 1977, p 110. 81 VOGEL, LIber, Tome II, 1981, p 384. 82
KRAUTHEIMER, 1977, p 101.
21
b) Les bouleversements de l’époque moderne
Pendant un long moment, la basilique avait été laissée à l’abandon, abritant les
pèlerins de passage, et les bergers pendant la nuit. C’est le cardinal de Sienne, le futur
Eugène IV, qui fit non seulement nettoyer la basilique, mais également entreprendre une
réforme profonde du monastère83
. Aux alentours de 1585-1590, Sixte V décida de
remanier le chancel autour du grand autel, et ferma la crypte en-dessous de l’abside,
vestige de l’époque carolingienne ; enfin il demanda un coffrage pour le plafond du
transept84
.
Avec le XVIIème siècle s’ouvre une ère qui va entraîner de nombreux
bouleversements dans la basilique paléochrétienne. Carlo Maderno est appelé pour la
construction de la chapelle du SS. Sacramento, décorée par la suite par Giovanni
Lanfranco, avec des scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament, en accord avec le
vocable de la chapelle85
.
Une première intervention d’Alessandro Specchi sur la façade avait
malheureusement abouti à un écroulement, et avait entraîné la décision de démolir
l’atrium86
. En 1725, on fit appel aux architectes Canevari et Aurelio Saffi pour la
démolition du narthex, afin de le remplacer par un portique occupant tout le devant de la
basilique. Celui-ci était composé de sept arcs articulés par des piliers et des colonnes,
parfois seuls ou allant par paires. La façade fut elle aussi restructurée, avec deux niveaux
de trois fenêtres, dont celles du dessous furent décorées de motifs en stuc (ill.7 et ill.8). Ce
chantier correspondit au dernier grand changement entrepris sur la basilique, puisque
celle-ci brûla dans la nuit du 15 au 16 juillet 1823 ; ce qui inspira ces mots à Stendahl :
« Je visitai Saint-Paul le lendemain de l’incendie. J’y trouvai une beauté sévère et une
empreinte de malheur telle que dans les beaux-arts la seule musique de Mozart peut en
donner l’idée. Tout retraçait l’horreur et le désordre de ce malheureux événement ;
l’église était encombrée de poutres noires fumantes et à demi brûlées ; de grands
83
Voir TRONZO, 2001, p 473. 84
NICOLAI, 1815, p 21. 85
Voir sur ce point TOMEI, 1988, p 56 et l’article de SFERRAZA, Agnese., « Il ciclo di dipinti di Giovanni
Lanfranco per la cappella del Sacramento in San Paolo fuori le mura », dans Paragone, n°53, Rome, 2002,
pp 49-58. 86
NICOLAI, 1815, p 21.
22
fragments de colonnes fendues de haut en bas menaçaient de tomber au moindre
ébranlement. Les Romains qui remplissaient l’église étaient consternés87
».
Si l’incendie de 1823 et la discutable reconstruction88
qui s’en suivit ont largement
mis à mal l’édifice paléochrétien, nous savons que sont conservés au sein même de
l’église de nombreux témoignages architecturaux de la structure primitive. Par contre, le
programme iconographique qui se déployait dans et hors du bâtiment a été en grande
partie perdu, et ce, malgré le sauvetage de quelques fragments mutilés. Toutefois, les
dessins, gravures et peintures réalisés au cours des siècles transmettent un aperçu à peu
près général du décor de la basilique. Bien évidemment, l’historiographie s’est largement
penchée sur ces documents afin de reconstituer et de comprendre la teneur du programme
de Saint-Paul. Une fois de plus, c’est sur le décor originel que notre connaissance semble
la plus limitée, avec de nombreuses interrogations qui ont depuis longtemps fais couler
beaucoup d’encre. Malgré tout, certaines composantes majeures sont maintenant
parfaitement assimilées et peuvent sans trop de risques être présentées.
87
STENDHAL, Promenades dans Rome, Grenoble, 1995, p 288. 88
Voir PALLATINO, 1995, pp 30-59 et CERIONI, 1988, pp 67-84.
24
Chapitre Premier
Sources et organisation du programme originel
1) Le décor de la nef
a) Les portraits des papes
Au-dessus des grandes arcades et de l’entablement, se développaient des théories
entières de papes en imagines clipeatae. Les portraits étaient groupés deux à deux, chaque
paire correspondant à l’un des entrecolonnements de la nef (ill.9). Entre les médaillons,
des inscriptions indiquaient les noms des papes et les durées de leur pontificat exprimées
en année, mois, jours89
.
La série commençait sur le mur méridional, d’Est en Ouest ; puis elle passait sur le
mur septentrional pour avancer de l’entrée à l’arcus maior. Ce dernier s’étant écroulé lors
de l’incendie de la basilique, c’est par l’étude du mur sud resté en élévation que l’on
suivait la chronologie de la théorie qui partait de Pierre et qui se terminait par Innocent Ier
(402-417)90
. On peut vraisemblablement penser qu’à l’origine, quarante-deux portraits de
papes étaient peints sur les parois de la nef.
La forme de représentation était celle de l’imago clipeata ; celle-ci prenait donc la
forme d’un bouclier. Les antécédents dans l’art grec classique et l’art romain en étaient
bien connus. On recourait en effet à l’imago clipeata pour représenter les tenants de titres
particuliers91
. Dans l’imagerie chrétienne, son usage fut d’abord funéraire. Les
sarcophages romains en offraient de nombreux exemples, comme le sarcophage dit
« dogmatique » provenant de Saint-Paul-hors-les-murs, qui date des environs de 320, où
au centre du registre supérieur de la cuve, étaient représentés dans un cercle les bustes des
défunts92
. Puis, reprenant un caractère plus officiel, l’imago servit à la représentation des
empereurs ou des consuls et fut par la suite étendue aux évêques (auxquels les empereurs
89
Ces inscriptions sont aujourd’hui perdues ; les ouvriers les ayants détruites pendant le décrochement des
portraits après l’incendie. Voir ANDALORO, 2000, p 41-42. 90
Ils sont conservés dans les corridors du monastère de Saint-Paul, au bout du musée épigraphique de la
basilique. 91
Voir GRABAR, 1979, p 43. 92
Voir CAILLET, 1990, p 14.
25
chrétiens avaient accordé le droit au portrait, à partir de l’instant où ils furent assimilés
aux hauts fonctionnaires de l’Empire)93
.
A Saint-Paul, chaque imago est constituée de trois cercles concentriques, dont
l’interne est souvent vert, celui du milieu rouge et l’externe jaune ; le fond devait être
d’une couleur bleu gris. Les médaillons ont un diamètre qui peut varier de 1,20 à 1, 62
mètres94
. Les personnages portent en général une tunique blanche, ou alors le pallium, les
cheveux et la barbe diversement répartis, et on aperçoit chez la plupart la présence d’une
tonsure.
Pour le pape Sylvestre (ill.10), on remarque que celui est représenté en buste, sans
les bras et les mains95
, très légèrement de trois quart, le regard tourné vers l’extérieur. Il
porte la barbe, et une tonsure. Pour le pape Calixte Ier (ill.11), la position est différente, le
buste est positionné de trois quart vers la droite, alors que sa tête et son regard sont
largement tournés vers l’extérieur du cadre. Enfin, la présentation du pape Léon Ier (ill.12)
est de face, le visage et le regard orienté vers le spectateur.
La composition de ces portraits n’est pas non plus homogène, étant donné que les
artistes semblent s’être employés à jouer avec un cadrage plus ou moins serré. Le centre
de l’imago cliptea est souvent occupé par le menton de la figure ; on ne voit donc que la
poitrine et toute la hauteur du visage. Pour certains portraits cependant, comme celui du
pape Sylvestre, le haut du crâne touche le bord du cercle dans la partie sommitale, alors
qu’à l’inverse d’autres doivent, comme Calixte Ier, se distinguer par une distance entre le
haut de la tête et le bord du cercle.
Quoi qu’il en soit, on remarque qu’aucun médaillon n’est ovale ; ils sont tous ronds
ce qui a sans doute limité l’espace pour représenter le reste du buste. De plus, la réduction
de l’espace dédié au fond a poussé les artistes à faire passer le cercle interne au niveau de
la poitrine, ce qui donne l’impression de voir le personnage au travers d’une ouverture,
comme une fenêtre96
.
Ces portraits ont bien évidemment un sens précis. La présentation des papes dans
des médaillons doit pour le concepteur du programme être un moyen de rendre hommage
93
GRABAR, 1979, p 71. 94
BRUYNE, 1934, p 67. 95
Ces portraits reprennent le type de buste plus ancien. Voir BRUYNE, 1934, p 68. 96
BRUYNE, 1934, p 72.
26
à la mémoire des personnages représentés, tout en légitimant son autorité en se faisant
valoir comme le successeur de cette prestigieuse lignée97
.
b) Thèmes et emplacement du cycle biblique
Sur les murs latéraux, juste au-dessus de la série papale, se déployait, sur 1300m2
de surface, un vaste cycle narratif de quatre-vingt quatre scènes. Sur le mur septentrional,
on trouvait quarante-deux tableaux tirés du Nouveau Testament et, sur le mur sud,
quarante-deux scènes de l’Ancien Testament. Le programme était réparti sur chaque mur
en deux registres composés chacun de vingt-et-une scènes (ill.13). Il est également établi
que les scènes se présentaient dans un format carré98
(ill.14) et étaient séparées les unes
des autres par des colonnettes tridimensionnelles en stuc99
(ill.15).
Les thèmes iconographiques et l’arrangement du programme nous sont également
bien connus : le cycle vétérotestamentaire, qui commentait des scènes tirées de la Genèse
et de l’Exode, débutait au registre supérieur à côté de l’arcus maior en suivant une
progression de gauche à droite jusqu’à l’entrée. Puis, après un parcours aveugle du
spectateur, il reprenait au registre inférieur toujours en suivant un sens de lecture d’Est en
Ouest100
.
En ce qui concerne le mur méridional, les scènes suivaient essentiellement le livre
des Actes des Apôtres et tout particulièrement celles dédiées à la vie de saint Paul, dont la
basilique était placée sous le vocable. Si le programme débutait comme pour le cycle de
l’Ancien Testament au registre supérieur à côté de l’arc, on pourrait raisonnablement
penser qu’il suivait cette fois un sens narratif allant de droite à gauche, même si, au
passage, on observait certaines anomalies101
. Après un retour du spectateur jusqu’à l’autel,
le registre inférieur reprenait le même arrangement.
97
PICARD, 1988, pp 507-509. 98
Voir WAETZOLDT, 1964, Abb 363a. 99
Nous savons, grâce à Nicolai, que ces colonnettes n’étaient pas fictives : « (…) due muri è decorato di due
ordini di pitture a fresco, divise da sottili colonne spirali ». Voir NICOLAI, 1815, p 32.
100 Pour les séquences narratives en général : Voir ARONBERG, G., The place of narrative : mural
décoration in Italian churches, 1431-1600, Chigago-Londres, 1990, p 24. 101
ELEEN a remarqué que sur les quarante deux scènes, dix-sept suivaient un sens de lecture droite-gauche,
treize étaient centralisées et douze allaient de gauche à droite. Voir ELEEN, 1985, p 254.
27
Depuis longtemps, les spécialistes se sont largement penchés sur les folios du
Codex Barberini 4406 et sur les gravures de Seroux d’Agincourt afin d’identifier chaque
scène et ainsi appréhender les sources du décor originel, mais aussi pour tenter de
reconnaître et de souligner les formules iconographiques de caractères véritablement
tardo-antique. Nous dresserons ici un bilan exhaustif des connaissances, tout en
reprécisant à certains moments les sources textuelles de telle ou telle scène.
En ce qui concerne le programme de l’Ancien Testament, celui-ci débute avec La
Création de l’Univers (Gen 1 : 1-2) (ill.16), scène singulière étant donné qu’elle présente
un contraste évident avec les autres peintures, car elle est d’organisation symétrique et de
caractère symbolique au lieu d’être narrative et de suivre un sens de lecture de gauche à
droite. On y remarque des signes de la séparation de la lumière et de l’obscurité
personnifiées par la présence du Soleil et de la Lune ; cela alors que Dieu projette de créer
l’homme et la femme dans une humanité idéale ; enfin, sur un monticule, est figuré un
agneau, avec en-dessous la colombe du Saint Esprit. Il n’y a par ailleurs là aucune trace
des autres Créations de Dieu, que ce soit la Création des Animaux, ou même des végétaux.
Le cycle continue, en suivant le récit biblique par la Création d’Adam (Gen 2 : 7)
(ill.17) et La Création d’Eve (Gen 2 : 21-22) (ill.18), suivies immédiatement par le Pêché
originel (Gen 3 : 6) (ill.19) et par la scène où Dieu prend conscience du péché de l’homme
(Gen 3 : 8-10) (ill.20). Dans le tableau suivant, Adam semble dénoncer la culpabilité
d’Eve, qui a trop écouté les conseils du serpent mis à l’index par Dieu (Gen 3 : 11-13)
(ill.21) ce qui a engendré immédiatement après l’Expulsion du Paradis (Gen 3 : 24)
(ill.22) et la Condamnation au travail (Gen 3 : 17) (ill.23) où Adam en train de cultiver la
terre, est accompagné d’Eve qui tient sur ses genoux un enfant nu que l’on peut identifier,
suivant les textes bibliques, comme étant Caïn (Gen 4 : 1).
L’histoire se poursuit avec l’Offrande d’Abel et Caïn (Gen 4 : 3-4) (ill.24), où de
part et d’autre d’un autel couvert de marbres, les frères offrent à Dieu des cadeaux pour lui
plaire. La peinture suivante commente tout d’abord le meurtre d’Abel par Caïn (Gen 4 : 8)
(ill.25) puis toujours dans le même tableau La condamnation de ce crime par Dieu (Gen
4 :10-15). Toujours en suivant chronologiquement le texte de la Genèse, intervient alors
l’histoire de Noé, concentré en seulement trois scènes. La première voit Noé avertit par
Dieu du déluge (Gen 6 : 13) (ill.26), la seconde met en scène la Construction de l’arche
(Gen 6 : 22) (ill.27) et la dernière passe sans intermédiaire à la fin du déluge et à la sortie
28
de la famille du patriarche (Gen 8 : 11) (ill.28). Par la suite, le cycle s’ouvre sur les
péripéties d’Abraham. Le premier tableau présente Le patriarche et les trois anges au
chêne de Menbré (Gen 18 : 2-5) (ill.29), les trois scènes suivantes disparues102
sont suivis
par le Départ d’Isaac et Abraham pour le sacrifice (Gen 22 : 3) (ill.30) et terminé par le
Sacrifice d’Isaac (Gen 22 : 10-13) (ill.31) où en haut d’une montagne on retrouve le
patriarche qui tient dans sa main droite la tête d’Isaac et dans la gauche une épée. Le geste
est élancé est particulièrement marqué par l’envol du manteau. Isaac est placé sur un autel
parallélépipédique bas, de base carrée et à encadrement marbré sur les faces et recouvert
de rondins de bois. Isaac représenté à genoux est nu, la tête baissée et les mains attachées
dans le dos ; un bandeau semble retenir ses cheveux103
.
Enfin, le registre se termine par deux tableaux représentant l’Histoire de Jacob. La
première scène que l’on présente comme Isaac bénissant Jacob104
(Gen 28 : 1) (ill.32),
figure le vieux patriarche assis dans un lit confortable les yeux fermés pour bien marquer
qu’il a pratiquement perdu la vue. Il réalise le geste de bénédiction de la main droite. A
droite du tableau, on remarque que Jacob soutenu par Rébecca présente à son père ses
mains recouvertes de poils de chevreau pour mieux le tromper sur son identité (Gen 27 :
21). Enfin, le registre se termine par le Songe de Jacob et la Bénédiction de la pierre de
Béthel (Gen 28 : 10-19) (ill.33).
Le registre inférieur débute à côté de l’arcus maior par le Rêve de Joseph105
(Fig.3). Dans la partie inférieure gauche du tableau se démarque Joseph endormi, couché
devant une architecture. A droite se trouvent représenté plusieurs gerbes, souvenirs du
premier songe du patriarche (Gen 37 : 5-6). Dans la partie supérieure dans un segment
semi-circulaire, sont présentées onze étoiles et des représentations du Soleil et de la Lune,
apparus cette fois pendant le second rêve du patriarche (Gen 37 : 9).
Le cycle continue avec des scènes où l’on voit successivement Joseph en train
d’interpréter ses visions (Gen 37 : 10) (ill.35), la peinture suivante montre Le patriarche
rejoignant ses frères à Dotân (Gen 37 : 15-17) (ill.36). Enfin, après la scène où Joseph est
jeté dans le puits (Gen 37 : 24) (ill.37), puis Joseph vendu par ses frères aux Madianites
102
HETHERINGTON identifie ces scènes disparues, sans malheureusement indiquer ses sources. Voir
HETHERINGTON, 1979, p 100. 103
MOUNIER, 2000, p 17. 104
WAETZOLDT, 1969, p 58 et HETHERINGTON, 1979, p 100. 105
Pour cette image voir KOENEN, 1992, p 185-194 et particulièrement la reconstitution qu’elle propose p
193 repris dans KOENEN, 1995, fig 27.
29
(Gen 37 : 28) (ill.38), le cycle se termine par Le songe de Pharaon (Gen 41 : 1-4) (ill.41)
et Pharaon qui faisant appel à Joseph pour l’aider à interpréter son rêve (Gen 41 : 14-36)
(ill.42).
Après l’histoire de Joseph commence le récit tiré de l’Exode. La première scène
représente Moïse devant le buisson ardent (Ex 3 : 2) (ill.43), ou bien la Rencontre de
Moïse et d’Aaron (Ex 4 : 27) (ill.45). Puis, le cycle se termine par les plaies infligées par
Dieu pour convaincre Pharaon de libérer le peuple d’Israël. Par exemple, dans la scène où
Moïse change l’eau en sang (Ex 7 : 20) (ill.48), se détache à gauche de l’image derrière un
massif rocheux le buste d’Araon, alors que Moïse trempe le bâton de Dieu dans une
représentation du Nil. A gauche, assis dans un trône à fond semi-circulaire, Pharaon
assiste à la puissance divine et esquisse un geste de la main droite. Dans le tableau
représentant la Mise à Mort des Premiers nés (Ex 12 : 33) (ill.53), on remarque au second
plan, les bustes d’Araon et de Moïse, alors qu’au premier plan, se trouvent à gauche deux
anges dont les mains levées lancent des flèches en direction des personnages couchés au
milieu de l’image. A droite, Pharaon assis sur un trône avec dans sa main droite un
sceptre, assiste là aussi à la mort des Egyptiens.
Sur le mur nord, le programme néotestamentaire débute par quelques
représentations de la vie de saint Etienne. Le cycle s’ouvre avec Le choix des sept diacres
(Actes 6 : 1-6) (ill.54) et continue par la scène où l’on voit Le saint avec le haut Conseil
(Actes 6 : 12-15) (ill.55) ; ce premier récit se termine par la Lapidation du saint (Actes 7 :
58-60) (ill.56) dans lequel on peut remarquer qu’un groupe de personnages lancent des
pierres sur le saint agenouillés déjà en conversation avec Dieu représenté dans le segment
en haut à gauche.
Ensuite, vient le récit dédié à saint Paul. Si la première met en avant encore le Saül
persécuteur des chrétiens (Actes 8 : 3) (ill.57), son histoire prend une orientation décisive
avec la scène bien connue de la Révélation de Saül (Actes 9 : 10) (ill.58). On remarque le
général romain au centre de l’image, agenouillé et les yeux fermés, les mains sont tendues
vers le ciel, alors qu’à gauche deux personnages semblent se diriger vers celui qui a perdu
la vue à cause de sa vision. Les scènes suivantes montrent ce qui doit être Ananie faisant
recouvrer la vue à Saül106
(Actes 9 : 10) (ill.59) et Le baptême du saint (Actes 9 : 18)
(ill.60). Malgré le mauvais état de conservation au moment des copies, on remarque que le
106
Voir sur ce point BUCHTAL, 1966, p 46.
30
sacrement a lieu dans un environnement naturel, ce qui témoigne d’une iconographie issue
de l’Antiquité tardive. En effet, ce n’est qu’au XIIIème siècle qu’on représente le saint
installé dans un baptistère comme en témoigne le folio 92 du Cod. Vat.lat 39107
(Fig.4).
Par la suite est peut-être illustrée la Prédication de Paul à la Synagogue (Actes 9 : 20)
(ill.61) et le moment beaucoup moins obscur où Paul s’échappe de la ville de Damas108
(Actes 9 : 25) (ill.62) reconnaissable à la position du saint étendu dans un panier et
descendu hors des murs de la ville. Dans la scène suivante, un personnage, allongé au
milieu du tableau à côté d’un personnage assis devant une architecture, représente le
Songe de Paul à Troas109
(Actes 16 : 9) (ill.63), suivi Du voyage vers la Macédoine, si on
s’en réfère au livres des Actes (Actes 16 : 11-12) (ill.64). S’ensuit la scène de La guérison
d’Eutyque (Actes 20 : 10-12) (ill.65) dans laquelle, après la chute de l’enfant du troisième
étage de sa maison, Paul à gauche ramasse le garçon et le présente ressuscité aux membres
de sa famille. Le tableau suivant nous montre une scène dans laquelle Paul est battu par
deux personnages. L’identification pose un véritable problème car elle est pour les
spécialistes le moment où Le saint est frappé à Philippes110
(Actes 16 : 22) (ill.66)
marquant ici un retour en arrière dans la chronologie des textes bibliques. Le récit reprend
ensuite un cours normal avec La rencontre de Paul et d’Agabus (Actes 21 : 10-14) (ill.67),
immédiatement suivi par une scène où l’on peut apercevoir Paul qui prophétise à
Jérusalem (Actes 21 : 17) (ill.68).
Toujours en essayant de suivre l’ordre chronologique des textes, le tableau suivant
doit représenter Paul frappé à Jérusalem111
(Actes 22 : 25) (ill.69). Il est vrai que le
peuple s’est soulevé contre les prédications du saint et que le tribun a fait introduire Paul
dans la forteresse, ici peut-être matérialisée par l’architecture au second plan de l’image,
afin de le questionner par le fouet. A gauche, le tribun, semble esquisser un geste de la
main droite comme pour mettre fin à la punition, suivant là aussi les textes puisque le
dignitaire fait arrêter les fouets pour demander à Paul si il est citoyen romain.
Le récit continue par la pérégrination de Paul vers Césarée (Actes 23 : 31-33)
(ill.71) et par la Traversée de la mer vers Sidon (Actes 27 : 2-3) (ill.72). Le registre
107
Voir ELEEN, 1985, p 259. 108
Ce thème est répertorié dans l’article de DINKLER VON SCHUBERT, 1967, pp 79-92. 109
WAETZOLDT, 1964, p 60. 110
Voir tout particulièrement ELEEN, 1985, p 256. 111
WAETZOLDT, 1964, p 60.
31
supérieur se termine par la Guérison de Publius (Actes 28 : 8) (ill.73) et par la Prédication
à Rome112
(Actes 28 : 23) (ill.74).
Le registre inférieur débute avec la scène énigmatique de La Division des juifs à
Iconium113
(Actes 14 -4) (ill.75) puis continue avec la Lapidation de Paul à Lystra (Actes
14 : 19) (ill.76) ou bien l’aveuglement d’Elymas (Actes 13 : 9 – 11) (ill.81) marquant ici
de nouveau un retour en arrière par rapport à la chronologie du livre des Actes. Quelques
scènes plus loin, le tableau renvoie sans doute au Baptême du gardien de la prison et de sa
famille (Actes 16 : 33) (ill.86) où, au centre de la composition, un personnage nu reçoit le
sacrement par Paul debout sur un monticule circulaire et qui, malgré les détérioration de la
peinture, doit tendre son bras vers la tête du personnage. A gauche, Barnabé assiste à la
scène alors qu’à droite une matrone symbolise sans doute la femme du geôlier. Les
dernières images nous dévoilent des scènes avec Paul devant un autel dédié à un Dieu
inconnu à Athènes (Actes 17 : 22-23) (ill.87), ou bien encore une peinture qui montre Dieu
apparaissant en rêve à Paul (Actes 23 : 11) (ill.90). Le programme se conclut par une
scène dans un mauvais état de conservation et admis par les différents chercheurs comme
étant La rencontre de Pierre et Paul à Rome114
(ill.95).
c) Les portraits des saints et prophètes
Au-dessus des scènes bibliques se trouvaient quarante-quatre figures en pied (dont
une a disparu au XVIIème siècle), peintes entre les embrasures des fenêtres hautes. La
distribution des personnages nous est bien connue grâce à certaines annotations des
copistes aux moments des relevés : au folio 1 est noté : « Figure 22 nella parte fra la
finestre a mano diritta nel entrare in chiesa115
», au folio 2v : « manca un propheta », au
folio 22 : « facciata ne… il crocifisso figura 1 » et au folio 61 : « Figure 22 poste fra la
finestre a mano manca nell entrare116
».
La difficulté devient plus aiguë pour ce qui concerne la datation de ces peintures :
doit-on les intégrer dans le groupe programmatique de l’Ancien et du Nouveau Testament,
112
Voir sur ce point l’identification de WAETZOLDT, 1964, p 60, sur laquelle n’est pas d’accord
HETHERINGTON, 1979, p 100. 113
C’est la proposition de WAETZOLDT, 1964, p 60 et HETHERINGTON, 1979, p 100. 114
WAETZOLDT, 1964, p 61 et HETHERINGTON, 1979, p 100. 115
WAETZOLDT, 1964, p 61. 116
Ibid, 1964, p 61.
32
ou bien les considérer comme quelque chose d’isolé, peint à une date ultérieure ? Deux
pistes ont permis de balayer certaines incertitudes. La première nous est une fois de plus
donnée par les copistes du XVIIème siècle. On peut vraisemblablement admettre que lors
de l’élaboration des relevés, si des différences stylistiques avaient été remarquées sur
certaines, ou même sur l’intégralité des figures, cela aurait été dûment noté par les artistes.
La deuxième nous est fournie par l’apparence originale des figures de Saint-Paul dont
nous savons qu’elles sont similaires à celles qui se trouvent dans la nef de S. Apollinare-
Nuovo à Ravenne117
. Dans le vaisseau médian, au-dessus d’un double cortège qui à
gauche illustre la théorie des Vierges se dirigeant vers la Madone et à droite des martyrs
marchant vers le Christ, sont représentés des saints, apôtres et prophètes qui tiennent des
codices ou des volumina. L’ensemble a été peint au VIème siècle. Le recoupement de ces
réflexions conforte notre hypothèse selon laquelle les figures de Saint-Paul furent peintes
au même moment que les scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament.
L’observation des figures nous apprend que sur l’ensemble des personnages
quarante-trois sont nimbés sur le mur méridional (ill.96 et ill.97), sept tiennent un
parchemin ou un livre (ill.98), alors que deux autres portent distinctement des robes. Sur le
mur septentrional, on discerne que l’un écrit sur un livre comme un évangéliste (ill.99) et
deux autres portent des robes ecclésiales. Face à ces constatations, on ne peut que tendre
vers l’idée que nous sommes en face de chefs de l’Ancien Testament, de saints et
d’apôtres.
Pour en être certain, il convient bien évidemment de se tourner vers le délicat
problème de l’identification des personnages. Le sujet est pour le moins complexe, étant
donné que le corpus a tendance à se réduire car sur les quarante-trois figures, quatorze
comprennent d’importantes lacunes, rendant une partie du programme inexploitable. Les
seules informations disponibles sont les quelques noms donnés par les copistes et par des
personnes qui se sont servis postérieurement des relevés118
. Elles ont bien évidemment été
largement reprises à leurs comptes par une bonne partie de l’historiographie qui a reconnu
sur certains folios Eléazar, Hosea, Nathan, Joël, Aaron et David119
(ill.100). Pourtant, ces
117
Erigée sur l’ordre de Théodoric, elle fut construite sur l’emplacement de l’ancienne chapelle Palatine.
C’est seulement au IXe siècle qu’elle prit son nom actuel, lorsque les reliques de saint Apollinaire, fondateur
de l’église de Ravenne, furent transférées de la basilique de Classis dans la basilique actuelle.
HETHERINGTON, 1979, pp 48-49. 118
Au folio 1 est inscrit le nom du prophète Eleazar. Voir WAETZOLDT, 1964, p 61. 119
MATTHIAE 1965, p 58, HETHERINGTON, 1979, p 96.
33
dernières propositions se doivent d’être appréhendées avec une certaine prudence. En
effet, il n’est absolument pas certain que les sources sur lesquelles se basent ces
identifications soient tenues comme assurées. A cela, ajoutons que la physionomie et les
attributs de l’ensemble des figures de la nef n’offrent pas de témoignages suffisamment
significatifs pour permettre des confrontations avec d’autres représentations de saints et
prophètes120
, ou bien de retrouver leurs traces par une étude des textes bibliques. Il
convient donc peut-être d’abandonner les propositions d’identifications formulées plus
haut, en conservant cependant l’hypothèse selon laquelle nous serions en face de
prophètes, de saints et d’apôtres.
2) L’arcus maior et l’abside
a) Le débat sur le programme de l’arc
Le programme qui se développait sur l’arc qui séparait la nef du transept nous est
transmis par une gravure de Ciampini121
(ill.101), au folio 139 et 140 du Codex
Barberini122
(ill.102), et par un relevé du Christ dans son médaillon conservé au folio 29 v
du Barb. Lat. 2161 (ill.103). Ces relevés parfois différents ont été largement étudiés et
interprétés.
Pour certains la gravure de Ciampani doit être à considérer comme celle qui se
rapproche le plus de la composition d’origine123
. Yves Christe se tient dans une position
beaucoup plus neutre, puisqu’il remarque des différences entre les deux schémas, mais se
garde de trancher de façon précise. Enfin, Anne-Orange Poilpré s’est davantage axée sur
l’interprétation des folios du Cod.Barb.lat. 4406 comme relevant de la composition
originelle124
.
Une première confrontation entre le schéma de Ciampani et le folio 29 v du Barb.
Lat. 2161 permet de penser que se trouve, au centre du sommet de l’arc, un Christ en
buste, représenté de face, le visage barbu et la tête pourvue d’un nimbe dardant des
120
Citons l’exemple de Saint-Apolinaire ou bien les représentations de saints sur la coupole de la chapelle
Saint-Victor-in-ciel-d’Oro qui fait partie de l’église Saint-Ambroise. 121
Dans Ciampinis Vetera Monimenta, I, Rome, 1690, tab 68. L’artiste se serait inspiré d’un dessin de la
Royal Library du château de Windsor (n°9056, WAETZOLDT, 1964, tab 836), lui-même une copie du
Cod.Bar.lat.4406. Voir WAETZOLDT, 1964, p 64 et CHRISTE, 1996, p 72. 122
Avec en bas cette inscription : « pitture dell’arco grande di mosaico in faccia alla porta ». 123
Voir MUNTZ, 1898, p 14, WAETZOLDT, 1961, p 21 et KESSLER, 1994, p 123. 124
POILPRE, 2003, pp 128-129.
34
rayons125
. Il tient peut-être, selon le copiste du folio 29 v, une croix à longue hampe, dont-
on aperçoit quelques fragments sur la gravure de Ciampani et au folio 140.
Un petit peu au-dessus du médaillon, et à gauche du Christ, sont présentés les
quatre Vivants, dont deux seulement sont encore visibles sur l’œuvre de Ciampani et sur le
folio 140 de la Bibliothèque Vaticane. Représentés à mi-corps en position centripète, et
émergeant de petits nuages, le lion et l’aigle, sont tous les deux pourvus d’un nimbe et de
deux ailes sur les relevés. Cependant, le lion est placé au-dessus de l’ange sur la gravure
de Ciampani, alors qu’il est installé plus à gauche sur le croquis du XVIIème siècle126
. A
ces premières différences, on remarque que les deux Vivants tiennent un livre sur le folio
140 qui ont disparu sur la gravure. Yves Christe, n’est pas certain que les codices soient
presentés sur le programme primitif127
. Alors que pour Anne-Orange Poilpré, cette version
de la Maiestas Domini en ligne avec des Vivants qui tiennent chacun un codex est inédite
pour cette période tardo-antique128
.
Précédée de deux anges qui s’inclinent devant la gloire de Dieu, une double théorie
de Vieillards en deux files étagées s’avance cérémonieusement vers le centre de l’arc.
Douze sont esquissés sur le folio 140 et dix au folio 139 du Codex Barberini alors que la
gravure de Ciampani dévoile à la gauche du Christ dix vieillards et à sa droite onze. Ils
tiennent tous une couronne disposée verticalement. Elles sont constituées d’une série
d’anneaux dans la gravure, alors que dans les dessins, elles se composent d’un simple
cercle.
Les relevés s’accordent pour retranscrire les vieillards de droite couverts d’un voile
tandis que ceux de gauche ont la tête nue129
. Au registre inférieur, est figuré Pierre précédé
de cette inscription :
« Ianitor hic caeli est fgidei petra culmen honoris
Sedis apostolicae rector et omne devcus. »
Et à gauche Paul avec cette mention :
« Persequiturdum vasa Dei fit Paulus et ipse
Vas fidei electum Gentibus et populis 130
»
125
Voir sur ce point les discussions de WARLAND, 1986, pp 41-43 et GRABAR, 1982, pp 5-24. 126
Voir MUNTZ, 1898, p14. 127
CHRISTE, 1996, p 72. 128
Voir POILPRE, 2003, p 129. 129
WAETZOLDT, 1961, p 22, CHRISTE, 1996, p 73. 130
IHM, 1960, p 136.
35
Les saints, qui n’ont pas la même physionomie sur la gravure et les dessins, lèvent
la main droite en direction du Sauveur. La présence des deux saints fondateurs de la Rome
chrétienne correspond selon Anne-Orange Poilpré à la première « occurrence de cette
disposition en ligne à l’arc de triomphe131
».
Bien que très proches sur certains points, on remarque que les deux compositions
comportent beaucoup de différences sur certains détails précis du programme. Ces
dissemblances sont pour le moins surprenantes étant donné que la gravure de Ciampani
s’inscrit comme étant une filiation des deux folios du Codex Barberini132
. Quoi qu’il en
soit, face aux arguments des uns et des autres, il est bien difficile de trancher avec
certitude sur l’un ou l’autre des schémas et de dégager une position certaine sur le cycle
iconographique qui ornait l’arc.
Afin d’y voir plus clair, on peut éventuellement s’aider de cycles paléochrétiens où
l’on retrouve la représentation du Tétramorphe. Le plus ancien exemple se trouve
aujourd’hui présenté sur le cul-de-four de l’abside de Sainte-Pudentienne133
. Il est
aujourd’hui attesté que le début des travaux remonte au pontificat de Sirice vers 387-398
pour s’achever sous Innocent Ier (401-417) (Fig.37). Au registre inférieur, le Christ siège
sur un trône surélevé avec à ses pieds une colombe et un agneau placé sur un monticule
d’où s’échappent les quatre fleuves du paradis. A sa gauche et à sa droite sont illustrés les
apôtres, auxquels se joint la personnification des juifs et des gentils couronnant Pierre et
Paul. Les personnages se tiennent devant un mur percé d’ouvertures que l’on peut
appréhender comme la représentation d’une ville. Dans l’axe de l’abside est figurée une
grande croix gemmée avec de part et d’autre, dans un ciel rempli de nuées, la figuration du
Tétramorphe. Comme sur la gravure de Ciampani, les Vivants ne tiennent ni rouleau ni
codex. On retrouve le même genre de représentation à la porte de Sainte-Sabine (Fig.38)
réalisée sous le pontificat de Célestin (422-432) 134
et au revers de façade de Sainte-Marie-
Majeure (422-432) 135
. Pourtant, on remarque la présence des livres sur la façade de Saint-
131
POILPRE, 2003, p 128. 132
CHRISTE renvoie à WAETZOLDT, 1969, p 64, n°836, qui malheureusement ne reproduit pas le dessin
de Windsor, ce qui ne permet pas de certifier si le dessin de la Royal Library est bien une copie du Codex
Barberini. 133
Voir POILPRE, 2003, pp 85-110. 134
POILPRE, 2003, pp 110-114. 135
SAXER, 2001, pp 56-59.
36
Pierre dont-il semble certain, malgré les nombreuses restaurations au Moyen Age, qu’elle
avait gardé son décor réalisé par Léon le Grand au milieu du Vème siècle136
.
On le voit, le renvoi à des cycles iconographiques contemporains n’offre pas plus
de solutions que la confrontation des différents schémas de l’arc. C’est donc par d’autres
voies, et particulièrement par l’étude des critères de datation et aussi de restauration que
nous étudierons plus tard, que s’ébauche peut-être la solution. Sans anticiper sur cela, il
semble bien que le décor de l’arc de Saint-Paul s’inscrive dans un groupe programmatique
homogène. La gravure de Ciampani pourrait alors transcrire le programme primitif de
Saint-Paul alors que les dessins du Codex Barberini représenteraient le décor mis en place
par Galla Placidia sœur des empereurs Arcadius et Honorius sous Léon le Grand comme
nous l’apprend l’inscription 137
:
« Placidia pia mens operis decus hoc favebat svadet pontificis studio splendere Leonis ».
b) Hypothèse sur le cycle de l’abside
On demeure mal informé pour ce qui concerne le cycle iconographique qui ornait
le cul-de-four de l’abside de la basilique. Pourtant, il semble que la décoration en ait été
élaborée sous le pape Symnaque (498-514)138
. Les chercheurs s’accordent à penser,
malgré l’absence de toute source iconographique de cette période, que le cycle qui s’y
déployait doit plus ou moins s’approcher de celui de la basilique Saint-Pierre. Ce décor,
aujourd’hui perdu, nous est transcrit par un dessin du XVIème siècle sur lequel est
présenté le programme mis en place à l’époque d’Innocent III (1198-1216), dont certaines
composantes sont restées paléochrétiennes139
(Fig.5). On peut y observer une des
premières représentations de la Traditio Legis140
. Le Christ debout et non pas trônant,
entre les princes des Apôtres, remet la loi à Pierre à droite tandis que Paul à gauche assiste
à la scène en simple spectateur. Ils sont encadrés par deux palmiers, au-dessus d’un
136
RICHE, 2001, p 241 et POILPRE, 2003, p 137. 137
Nous renvoyons ici au travail de Jean-Pierre CAILLET sur la basilique Nord du groupe épiscopal de
Salone. Il remarque dans l’abside une inscription qui évoque ceux de l’arc de Saint-Paul-hors-les-murs. Voir
CAILLET, Jean-Pierre., L’évergétisme monumental chrétien en Italie et à ses marges, Rome, 1993, p 384. 138
TOMEI, 1988, p 57. 139
Une reproduction de l’abside réalisée par Giacomo Grimaldi est conservée à la Bibliothèque Vaticane,
Arch.S.Pietro, Album, folio 50. Voir WAETZOLDT, 1964, Fig 490, Kat 943. 140
KRAUTHEIMER, 1995, p 16. Voir également ANDALORO, SERENA, 2000, p 38.
37
paysage « nilotique », au milieu duquel jaillit une rivière. Enfin, à la naissance de la voûte,
court une frise de douze agneaux sortant de Jérusalem et de Bethléem141
.
Cette première incursion dans le cycle iconographique de la basilique Saint-Paul
nous rappelle les nombreuses zones d’ombres qui grèvent encore aujourd’hui la
connaissance de quelques parties du cycle. Du fait de la complexité de ces problèmes,
aucun aspect ne saurait être négligé, au premier rang duquel les travaux qui vont se porter
sur l’édifice. Ces campagnes de restauration, bien loin de ne s’arrêter qu’à l’aspect
structurel du bâtiment, concerneront en même temps ou de façon propre l’ensemble du
décor. Bien évidemment, il convient de ne pas écarter les compositions nouvelles,
rajoutées au fil du temps, et qui s’imposeront comme complément aux peintures et
mosaïques de l’Antiquité tardive.
141
Sur l’évolution du thème de la Traditio-Legis, voir DAVIES-MAYER, Cäcilia., « Das Traditio-Legis
Bild und seine Nachfolioge », dans Müncher Jahrbuch, n°12, Munich, 1961, pp 7-45. Pour une description
précise de l’ancienne iconographie qui se développait dans l’abside, voir ANDALORO, ROMANO, 2000, p
38.
38
Chapitre second
Les restaurations et contributions du Moyen Age
1) Le Haut Moyen Age
a) Les peintures du revers de la façade
Les copies du XVIIème siècle, les relevés réalisés par Seroux d’Agincourt à la fin
du XVIIIème siècle et la reconstitution proposée par Hetherington (Fig.6) permettent
aujourd’hui de mieux connaître la teneur du programme qui se dévoilait sur le revers du
mur ouest de la basilique de la voie d’Ostie. Huit compartiments y étaient groupés, divisés
en deux rangées de quatre images juste en-dessous des six fenêtres de la façade et qui
étaient séparés par des inscriptions que les copistes du XVIIème siècle avaient ignorées et
que d’Agincourt n’avait pas pu retranscrire.
Dans le registre supérieur, les peintures représentent les quatre évangélistes et
leurs symboles. Les deux portraits intérieurs sont séparés par un monogramme. De gauche
à droite se distinguent Luc, Matthieu, Jean, et Marc. Chaque panneau est divisé en deux, la
partie supérieure étant légèrement plus petite que la partie inférieure. Dans la partie
sommitale, on retrouve l’animal qui représente chaque évangéliste. En ce qui concerne
Luc, le taureau est présenté de profil et coupé à mi corps, la tête nimbée, avec une aile sur
son flanc droit et retenant sous sa patte droite un codex (ill.104). Pour Matthieu, l’ange est
de face, la tête nimbée avec des ailes déployées et avec un objet difficilement identifiable
dans sa main droite (ill.105). Après le monogramme, se détache Jean dont l’aigle est
comme pour Luc de profil, la tête nimbée et orientée vers le haut, avec les ailes bien
représentées (ill.106). Enfin, le lion de Marc suit à peu près la même composition sauf que
la tête est tournée dans la direction du spectateur (ill.107).
Dans la partie inférieure est figuré chaque évangéliste, vêtu d’une tunique à
manches longues avec un manteau jeté au-dessus de l’épaule. Ils sont assis à côté de leur
pupitre dont certains ont des formes trapézoïdales et des pieds crénelés, alors que celui de
Mathieu est rectangulaire. Ce dernier a son regard dirigé vers le livre posé sur ses genoux
sur lequel il semble ajouter des annotations. Dans la peinture suivante, Luc, assis et
représenté de profil, tient dans sa main droite une plume et dans sa gauche un rouleau.
39
L’attitude de Matthieu et de Luc renvoie à l’image d’un évangéliste écrivant ou bien
réfléchissant devant la première page de son Evangile.
Dans la partie droite, l’attitude des deux autres évangélistes est beaucoup plus
difficile à appréhender au vu du mauvais état de conservation au moment de la réalisation
des copies. On remarque néanmoins qu’il est placé à droite du lutrin et non pas à gauche
comme sur les peintures précédentes. Sur l’image de Jean, la perte couvre en grande partie
les bras de l’évangéliste. Les copies permettent quand même d’apercevoir dans sa main
gauche un objet : peut-être un encrier dans lequel il peut tremper sa plume ? Comme pour
Matthieu et Luc, la tête du personnage est pourvue d’un nimbe. Sa position dénote une
attitude méditative qui doit se rapprocher de celle de Luc. La dégradation de la peinture
sur le tableau de Marc ne permet pas de définir son comportement étant donné que le
visage et les bras du personnage ont malheureusement disparu au XVIIème siècle.
Dans le registre inférieur, les quatre compartiments montrent des scènes de la
Passion. Dans la première, subdivisée en deux images égales, se démarque en haut le
Christ en conversation avec un ange. Le Seigneur est représenté barbu, la tête nimbée,
assis sur un rocher et légèrement penché en avant. Il semble tendre les mains vers un ange
aux traits juvéniles qui, debout, posé sur un monticule, les jambes croisées, tient dans sa
main droite un bâton et semble écouter les paroles du Christ. En-dessous est illustré ce que
Hetherington a reconnu comme L’agonie dans le jardin142
(ill.108). Pour être plus précis,
on remarque que le Christ esquisse un geste envers le personnage presque assis alors que
les deux autres individus sont encore profondément endormis.
Les scènes suivantes montrent dans un premier temps Le portement de Croix
(ill.109) où le Christ, qui occupe le centre de la composition est représenté la tête pourvue
d’un nimbe gemmé, le corps penché en avant, avec la croix sur son épaule gauche. Au
second plan est figurée une foule de personnages en armes dont les lances, selon la
transcription du copiste, sortent du cadre de la peinture. En-dessous se trouvent deux
portraits et une inscription en bas à gauche :
« BDT
HIVIII
NEOPP »
142
HETHERINGTON, 1979, p 97.
40
Ce qui a permis d’identifier le personnage coiffé de la tiare comme étant soit Boniface
VIII soit Jean XXII143
.
La troisième image semble beaucoup plus complexe étant donné qu’elle nous
montre ce qui peut être une combinaison singulière entre la Descente de Croix et la
Crucifixion144
(ill.110). Malgré les nombreuses restaurations qu’ont sans doute subi les
peintures avant le XVIIème et XVIIIème siècle, on peut vraisemblablement penser que les
copistes ont tenté de retranscrire avec précision l’iconographie de cette image. On y
découvre en-dessous de la personnification du Soleil et de la Lune une immense croix,
surmontée d’un large titulus, qui est plantée dans le sol. Le Christ y est représenté la tête,
pourvue d’un nimbe crucifère, retombant sur son épaule droite. Le visage est barbu, le
corps est rigide et amaigri puisque le torse laisse largement apercevoir les côtes. Son bras
gauche est tendu, la paume de la main ouverte laissant d’ailleurs apercevoir le clou qui le
maintient à la croix. Le bras droit quant à lui, semble tomber sans vie sur le dos du
personnage qui le tient par la hanche. Enfin, les jambes, l’une à côté de l’autre, ont les
pieds cloués et posés sur un bout de bois carré.
De part et d’autre de la croix, se tiennent la Vierge et saint Jean l’Evangéliste.
Marie est représentée de face et habillée d’une robe, d’un voile et pourvue d’un large
nimbe. Saint Jean tient dans sa main gauche un livre et sa tête nimbée repose sur sa main
droite. Le personnage situé au centre de la composition entretient ici une position bien
particulière puisqu’il tient le Christ par la hanche, représenté comme en lévitation. On
remarque néanmoins que son pied droit est posé sur un petit monticule. Enfin, tout de suite
à la droite de saint Jean, un petit personnage est tout aussi difficilement identifiable : il est
représenté debout et les jambes à demi fléchies ; seul son bras droit est parfaitement
perceptible. Il semble tenir dans sa main un outil avec lequel il travaille. Est-il en train de
planter les clous dans les pieds du Christ ou bien de les enlever avec une pince ?
La dernière image présente une iconographie originale. Un ange est assis sur un
coffre dont la construction oblique nous laisse largement apercevoir le fond de ce qui doit
être le tombeau (ill.111). L’ange les jambes croisées et les ailes déployées semble songer à
la destinée du Christ. Sur ses genoux est figuré le Seigneur, allongé, les jambes fléchies et
le bras droit tombant sur le coffre. Sur la gauche de l’image, une femme, représentée à
143
Voir HETHERINGTON, 1979, p 97 qui propose une restauration au XIVème et XVème siècle.
TRONZO date l’intervention début XVème siècle. Voir TRONZO, 2001, pp 467 et 473. 144
HETHERINGTON, 1979, p 98, TRONZO, 2001, pp 469 et 471.
41
plus petite échelle, le corps couvert d’une longue robe et les mains jointes dans l’attitude
de la prière, assiste discrètement à la scène. Sommes-nous en face d’une image
correspondant à une représentation singulière de la Pietà ? A la représentation habituelle
de la Vierge Marie pleurant son fils, est substitué ici un ange à l’aspect bien particulier145
.
Le monogramme situé entre Matthieu et Jean, que seul d’Agincourt a tenté de
reproduire, a été diversement interprété. On y remarque dans un médaillon circulaire une
inscription qui de gauche à droite transcrit: S. R. G. I. (Fig.6). Si Léon de Bryune opte
pour Grégoire VII (1073-1085) 146
, il semble néanmoins que l’on se penche dorénavant sur
la retranscription SERGIo que l’on identifie aujourd’hui comme SERGE IV (1009-
1012)147
.
On le voit, le programme iconographique qui est situé sur le revers de la façade
comporte de nombreuses incertitudes quant à l’identification des scènes et à sa datation,
étant donné qu’il semble avoir été restauré sous Jean XXII, et, qu’à la proposition de
Serge IV, peut d’une manière tout aussi probante être substituée celle de Serge III (904-
911).
Dans la peinture identifiée par Hetherington comme étant l’Agonie au Jardin, il est
possible de situer la scène dans le domaine de Gethsémani. Les textes Bibliques qui ne
s’accordent pas sur certains points, précisent que le Christ s’y retira avec Pierre et les deux
fils de Zébédée (Mat 26 : 37) ou bien avec Pierre, Jacques et Jean (Mar 14 : 33). Dans ce
lieu, le Christ commença à ressentir de la tristesse et de l’angoisse et finit par quitter ses
compagnons pour prier son père. Revenant vers ses disciples, il les trouva endormis et
réveilla Pierre pour lui signifier qu’ils devaient tous veiller et prier pour éviter la tentation
(Mat 26 : 38-40, Mar 14 : 35-38). On le voit, le texte explicite l’action du Seigneur pour
sortir Pierre du sommeil où il était plongé. C’est, semble-t-il, cette scène que le concepteur
du programme a voulu nous expliciter ici. Les deux personnages endormis pourraient être
les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, et le personnage dont le Christ tient l’épaule
serait alors Pierre qu’il vient de réveiller. C’est donc un instant bien précis qui peut être
représenté ici ; l’identification de Hetherington étant bien trop générique.
145
BELTING, 1998, p 122. 146
BRYUNE, 1934, p 139. 147
HETHERINGTON, 1979, p 98 et TRONZO, 2001, p 468.
42
Dans le même sens, il convient maintenant de se pencher sur la peinture
représentant sur la même image la Crucifixion et la Déposition de Croix. Il est vrai que
l’on y retrouve certaines composantes iconographiques alliant ces deux moments précis de
la Passion du Christ. Au-dessus de la Croix est bien représentée la personnification du
Soleil et de la Lune que l’on retrouve par ailleurs sur la Crucifixion des Evangiles dit de
François II (seconde moitié du IX siècle)148
(Fig.7). En revanche, la représentation de la
croix et la position du Christ dont le corps est couvert par un perizonium n’évoquent en
rien la peinture de Saint-Paul.
C’est par la confrontation avec un triptyque de la Bibliothèque Nationale de
France (seconde moitié du Xème siècle) (Fig.8), que l’on peut trouver sur ce point
quelques analogies avec le folio 136 du Codex Barberini. La Crucifixion qui occupe le
centre de la composition est surmontée, comme dans les Evangiles de François II, à
gauche de la personnification du Soleil et à droite de celle de la Lune. La croix est pourvue
du même titulus que celle de Saint-Paul et le Christ présente la même physionomie. Les
muscles sont bien dessinés, les bras sont tendus et la paume est ouverte pour bien laisser
apparaître le clou au milieu de la main. Sur ses hanches, est bien figuré un pagne court qui
retombe jusqu’aux genoux et qui laisse apparaître des jambes figurées l’une à côté de
l’autre. De chaque côté, on retrouve bien la Vierge à gauche et saint Jean à droite qui,
malgré une attitude différente de la peinture de Saint-Paul, témoignent d’un répertoire
traditionnel d’illustration de la Crucifixion.
Cependant, le folio.136 laisse clairement apparaître un personnage qui retient le
Christ par la hanche et un autre à côté de Jean qui semble travailler. Ceux-ci se retrouvent
sur un autre ivoire conservé au Dumbarton Oaks de Washington représentant cette fois
une Descente de Croix (Fig.9). On retrouve, là aussi, de part et d’autre de la croix, la
Vierge à gauche qui baise la main du Christ et saint Jean à droite qui tient dans sa main
droite un livre. Au centre de l’ivoire, un personnage à plus grande échelle, identifié
comme Joseph d’Arimathie (Mat 27 : 59), retient lui aussi le Christ par la taille. Enfin, à
droite on retrouve un individu en train de retirer les clous des pieds du Christ à l’aide
d’outils. Il reprend le même mouvement que celui du folio 136. Ces dernières
observations, ajoutées aux premières, ont tendance à conforter la proposition d’
Hetherington. Néanmoins, on peut également formuler l’hypothèse que, dans un premier
148
Paris, B.N.F, ms.Lat.257, folio 12v°.
43
temps, a été peinte une Crucifixion qui plus tard fut transformée en Descente de Croix.
L’artiste se serait alors gardé de toucher à la composition d’ensemble et aurait juste
introduit quelques légères transformations. Le personnage qui tient le Christ par la hanche
et celui qui semble lui retirer les clous des pieds sont figurés à plus petite échelle que le
Christ, la Vierge et Jean et apparaissent avoir été introduits dans les derniers espaces
disponibles au moment de la mutation de cette scène.
Pour terminer, il convient de se pencher une nouvelle fois sur la scène que Belting
a considérée comme une Pietà. Il est vrai qu’ici on retrouve une figure qui en soutient une
autre. Ce type de représentation assez rare se retrouve néanmoins sous une autre forme sur
le Reliquaire de Montalto (vers 1400) conservé au Museo Sistino Vescovile (Fig.10). Le
panneau rectangulaire central montre là aussi l’Homme de douleur soutenu par un ange
(Engelspietà)149
. Si le Christ est bien représenté en figure entière, il est cette fois de face et
pas de profil comme sur la peinture de Saint-Paul. Mais surtout, la scène est figurée devant
une Croix ornée de perles et de pierres précieuses et entourée d’anges, alors que sur la
peinture se retrouvent distinctement le tombeau et une femme en prière au second plan.
Le problème est qu’aucune source textuelle ne parle du cadavre du Christ et de l’ange.
C’est dans une autre scène que l’on figure un ange assis sur un tombeau et accompagné,
comme à Saint-Paul, d’une ou de plusieurs femmes. Ce thème se retrouve souvent dans
l’art médiéval sous le dénomination de la Visite des saintes femmes au tombeau (Mat 28 :
1-8 ; Mar 16 : 1-7 ; Luc : 24 : 1-8). On représente généralement l’ange assis sur le
tombeau vide, accompagné des saintes femmes qui viennent faire révérence au Seigneur.
Que vient alors faire le Christ dans les bras de l’ange ? Fait-il partie du programme
originel ?
Si, comme nous venons de le voir, l’identification des scènes reste largement
sujette à caution, il en est de même pour ce qui concerne la datation de ce programme.
149
Cette représentation du Christ de douleur sortant du tombeau, dénommé « Pitié Nostre Seigneur » dans
les textes de Charles V et Charles VI n’est pas une simple expression en France du courant de la Devotio
moderna. Ce thème semble t-il était déjà courant sous Charles V et peut-être sous Jean le Bon. Il est en tout
cas établi que Charles VI avait une dévotion personnelle à la Croix. Il n’est pas impossible que sous l’action
de personnalités liées à la cour comme Jean Gerson, les souffrances du roi malade et la « grande pitié du
royaume » aient contribué à la diffusion de la dévotion du Christ souffrant. Voir TABURET-DELAHAYE,
Elisabeth., Paris 1400. Les arts sous Charles VI, catalogue de l’exposition, Paris, Louvre, 22 Mars 2004-12
Juillet 2004, Paris, 2004, p 179-180. Sur ce thème voir également SCHILLER, 1968, p 229.
44
D’après les dernières conclusions, il aurait été peint aux alentours du IXème ou du Xème
siècle et aurait subi une restauration sous le pontificat de Jean XXII150
.
Pour revenir sur ce propos, on remarque que les peintures des évangélistes se
situent à certains égards dans la même mouvance que certains manuscrits carolingiens.
Les vêtements que portent les figures de Saint-Paul et qui rappellent le costume romain, se
retrouvent dans de nombreuses représentations des évangélistes. Par exemple au folio 15
v° du ms.lat.17968 de la BNF (Fig.11), on retrouve saint Matthieu avec la même tunique
qui lui arrive au bord du poignet, le corps couvert par un manteau jeté sur l’épaule. De
plus, sur le frontispice, des Evangiles d’Aix-la-Chapelle151
(début du IXème siècle)
(Fig.12), attribués à une école de la Cour d’influence byzantine, on découvre d’autres
analogies avec les copies des tableaux de Saint-Paul. Le lutrin est posé à côté des
évangélistes occupés à la rédaction des livres. Au-dessus d’eux est figuré leur attribut qui
reprend, là aussi, le même schéma qu’à Saint-Paul. Le taureau de Luc est représenté de
profil, pourvu de deux ailes, la tête nimbée avec sa patte avant droite posée sur un rouleau
qu’il semble conserver près de lui.
On peut également ajouter que le traitement de l’espace admet quelques parallèles.
Aussi bien sur le manuscrit d’Aix que sur les peintures de Saint-Paul, les évangélistes sont
présentés sur un fond aéré et non plus surchargé d’architectures comme sur la
représentation de Matthieu dans les Evangiles dits d’Ada152
(vers 800), où le siège du
personnage occupe l’intégralité de l’espace (Fig.13).
Cependant, d’autres correspondances peuvent s’entrapercevoir avec la
représentation des évangélistes sur un Tétraévangile dit Manuscrit Coislin 195 (Xème
siècle) conservé à la Bibliothèque Nationale de France (Fig.14).
Les évangélistes sont là aussi assis, écrivant la première page de leur Evangile, et
même pour certains, comme Luc, dans une attitude de méditation comme on peut le
supposer pour la représentation de Jean au folio 132.
Au folio 386 v° du BNF.ms.lat. 1 dite Première Bible de Charles le Chauve (vers
846) (Fig.15), sur le registre inférieur au bas de la page, est illustrée la scène bien connue
de Saint Paul enseignant. De chaque côté du saint, sont représentés des soldats qui portent
150
WAETZOLDT, 1964, p 55, HETHERINGTON, 1979, p 98, TRONZO, 2001, p 471. 151
Aix-la-Chapelle, Trésor de la cathédrale, sans n°, folio 14 v°. 152
Trèves, Stadtbibliothek, Cod. 22, folio 15 v°.
45
tous, une tunique courte, une chlamyde sur les épaules et des bottes qui montent jusqu’à
mi-mollet. Certaines de ces caractéristiques se retrouvent sur le soldat devant le Christ
dans la scène du Portement de Croix (ill.110). Outre cela, le Christ porte à peu près les
mêmes vêtements que les évangélistes du registre supérieur et du folio 15 v° de la BNF, ce
qui tend à suggérer une souche iconographique carolingienne.
Au registre inférieure, nous avons précédemment soulevé bon nombre de
correspondances entre la supposée Descente de Croix et le triptyque de la Bibliothèque
Nationale de France, produit à Constantinople dans la seconde moitié du Xème siècle.
D’autres sont à percevoir, comme par exemple, dans la figuration de la Vierge à droite du
Seigneur. Elle a les bras tendus et les mains couvertes par un voile. A gauche du Christ est
figuré saint Jean avec la main droite sur le visage et la gauche occupée par un livre, que
l’on perçoit sur la peinture de L’abbé Epifanio au pied du Christ en croix dans l’église San
Vincenzo al Volturno (IXème siècle) (Fig.16).
Cette position de saint Jean au folio 136 se retrouve sur le revers d’une plaque
d’ivoire du Musée de l’Ermitage, attribuée à un atelier de Constantinople aux environs du
Xème ou du XIème siècle (Fig.17). L’œuvre qui présente sur sa face des scènes tirées de
la vie de la Vierge, commente au revers des images inspirées de la vie du Christ dont l’une
au registre médian présente la Crucifixion. A la gauche du Christ en croix est représenté
saint Jean qui, comme sur les peintures de Saint-Paul et de San Vincenzo, tient un livre
dans sa main gauche et semble se tenir la tête avec la main droite ; attitude plus
douloureuse que l’on peut voir illustrée sur la Croix dite aux émaux (fin du Xème siècle)
conservée à Essen (Fig.18).
En conclusion, plusieurs hypothèses peuvent être formulées. Il est envisageable
qu’un premier programme ait été peint au IXème siècle comme nous l’a révélé la
confrontation des évangélistes avec des manuscrits carolingiens. De plus, l’attitude des
personnages sur la Crucifixion de San Vincenzo et certaines dispositions iconographiques
témoignent encore d’une influence antique dont nous savons qu’elle était très vivace à
cette période153
. En admettant que ce cycle ait existé, on ne peut que souligner le caractère
exceptionnel de celui-ci. Face à nos connaissances actuelles sur la peinture monumentale
de cette période, on s’attend plutôt à retrouver à la place des Evangélistes et de la Passion
153
Sur l’influence des modèles paléochrétiens sur la peinture carolingienne, voir KOEHLER, Wilhelm., Die
karolingische Miniaturen, tome I, Die Schule von Tours, Berlin, 1933, réed 1963, p 245.
46
du Christ, une représentation du Jugement Dernier. Ce thème est en effet, plus en accord
avec la composante spatiale de l’édifice et surtout il se situe dans le prolongement des
usages carolingiens qui tendent à représenter, dans ce secteur, une iconographie préparant
l’avènement final du royaume divin. Ce serait alors dans un souci d’association des
images avec les différents pôles cultuels de cette partie de l’édifice qu’aurait été élaboré ce
programme.
On peut également formuler l’idée que certains compartiments auraient été
repeints aux alentours de l’an mil comme en témoignerait le monogramme relevé par
d’Agincourt et que Hetherington transcrit comme étant Serge IV, et certaines analogies
entraperçues entre le folio 136 et les ivoires de Paris et de l’Ermitage. Dans un contexte
marqué par une fascination pour Byzance, il est envisageable que le souverain pontife se
soit alors attaché les services d’artistes byzantins itinérants, ou alors d’artistes italiens
s’inspirant de modèles orientaux. Quoi qu’il en soit, la campagne n’avait pas dû toucher
au programme originel étant donné qu’aux regards des quelques témoignages
iconographiques relevés entre les ivoires et le folio 136, on peut penser que la troisième
peinture du registre inférieur pouvait encore présenter, après leurs interventions, une
Crucifixion. C’est alors sous le pontificat de Jean XXII (1245-1334), qu’aurait été
entreprise une restauration complète du programme. Pour ce faire, les artistes se seraient
basés sur des schémas iconographiques et des procédés formels qu’avait développés l’art
byzantin à partir du Xème siècle.
Dans un premier temps, les artistes auraient simplement repris les quatre
compartiments du registre supérieur en suivant les dessins originels. Puis dans un second
temps, ils seraient plus longuement intervenus sur les deux premiers compartiments du
registre inférieur en reprenant le même thème tout en modernisant l’iconographie. Enfin,
la Crucifixion et la Visite des saintes femmes au tombeau dont on peut vraisemblablement
imaginer la présence depuis l’époque carolingienne, auraient été transformées en Descente
de Croix et en Engelspietà154
afin d’insister sur le sacrifice du Sauveur et les moments qui
précèdent sa résurrection. Pour ce faire, il est alors probable que le concepteur du
154
Selon TABURET-DELAHAYE, ce thème relève d’une iconographie caractéristique de l’art français et
peut-être élaboré pour l’auteur sous Jean le Bon (1350-1364) ou Charles V (1364-1380). Voir TABURET-
DELAHAYE, Elisabeth., Paris 1400. Les arts sous Charles VI, catalogue de l’exposition, Paris, Louvre, 22
Mars 2004-12 Juillet 2004, Paris, 2004, p 180. Il convient de signaler que cette formule existait sans doute
depuis quelques années dans la basilique de Saint-Paul.
47
programme se soit basé sur certaines spéculations savantes des docteurs de l’époque ou
qu’il ait été tenté de répondre une fois de plus à des besoins cultuels155
.
b) La possible restauration de l’arcus maior
Afin de ne négliger aucune piste, il est important de se pencher sur un point
essentiel et pourtant mal exploré : celui de la réfection de l’arcus maior qu’aurait réalisé
Léon III pendant une énorme campagne de travaux à l’intérieur de la basilique. Cette
proposition a été formulée dans un premier temps par Eugène Muntz156
mais elle n’a pas
soulevé de commentaire et est restée en quelque sorte en suspens. Elle a pourtant son
importance car elle permet d’expliquer les différences entre la gravure de Ciampani et les
dessins du Codex Barberini.
Nous savons grâce au Liber que Léon III, aux alentours de 801157
, est largement
intervenu dans la basilique de la voie d’Ostie. Celle-ci, en partie détruite par un
tremblement de terre, a alors subi une énorme réfection. Il est possible, en suivant la
proposition de Müntz, qu’une restauration soit intervenue sur l’arcus maior de la basilique
même si aucune documentation ne vient entériner cette proposition.
Pour tenter d’y voir plus clair, il convient de se tourner vers un autre grand chantier
de Léon III, celui de l’arc absidal du second Triclinium appelé « Salle des conciles du
Latran ». Il a été construit dans un contexte particulier qui traduit les inquiétudes de
l’Eglise en matière dogmatique et christologique. Hans Belting a dans un premier temps
émis l’hypothèse que le programme de l’arcus maior de Saint-Paul aurait servi de modèle
aux mosaïstes de Léon III158
. Dans ce sens, Anne-Orange Poilpré remarque que la
présentation d’une Maiestas Domini en ligne ainsi que la disposition des Vieillards qui
tiennent une couronne verticale rappellent en effet la Maiestas Domini et la disposition des
Anciens de Saint-Paul-hors-les-murs. Elle conclut son commentaire en insistant sur le fait
que Léon III aurait voulu au Latran souligner la continuité de son église avec celle des
papes de l’époque paléochrétienne159
.
155
BELTING, 1998, pp 122-123. 156
MUNTZ, 1898, p 14. 157
VOGEL, Liber, 1981, Tome II, p 2 et 8. 158
BELTING, 1976, p 172-173. 159
POILPRE, 2003, p 292.
48
Un dessin de l’arc réalisé par Ugonio160
nous est conservé à la Bibliothèque
Vaticane dans le Cod.lat. 2160 au folio 157161
(Fig.19). On y aperçoit il est vrai au registre
supérieur le Christ en médaillon, avec de part et d’autres, les Vivants dont le taureau,
l’ange et le lion qui tiennent un livre alors que l’aigle n’en est pas pourvu. Dans le registre
inférieur, de chaque côté du cul de four de l’abside, se déploient les Vieillards présentant
une couronne. Au registre inférieur, Ugonio inclut dans son dessin deux autres assemblées
représentées à une échelle plus petite, faisant le geste de l’acclamation, qu’il nomme
« poveri ». Face à ces premières observations on ne peut que suivre l’idée générale d’une
dépendance du programme du Latran à l’égard de celui de Saint-Paul.
Malgré tout, s’il est en effet possible d’apercevoir des parallèles dans la
composition d’ensemble, le problème se pose d’une tout autre manière lorsqu’on observe
plus en détails les folios du Codex Barberini et le dessin d’Ugonio. A l’attitude
cérémonieuse de l’assemblée de Saint-Paul, répond au Latran une allure beaucoup plus
rigide. Les anciens ont le corps droit et les bras tendus pour présenter une couronne, alors
qu’à Saint-Paul ils sont légèrement penchés en avant et les bras sont à demi fléchis. Si la
disposition reprend le même schéma qu’à Saint-Paul, l’attitude est bien différente. De
plus, la distinction que nous avions remarquée plus haut entre les Vieillards voilés au-
dessus de Pierre et les Vieillards tête nue au-dessus de Paul ne se retrouve pas sur le dessin
d’Ugonio162
.
Déjà s’esquisse ici une légère variante entre la supposée dépendance du cycle du
Latran et le programme de la basilique, étant donné que les artistes de Léon semblent
suivre un schéma beaucoup plus proche de la création contemporaine, puisque l’on
retrouve la même formule iconographique pour les Vieillards de l’arc de l’église Sainte-
Praxède de Rome dont la décoration date des années 817-824 (Fig.20). Cette remarque a
son importance étant donné qu’elle nous renvoie immédiatement à la représentation du
Tétramorphe figuré dans la partie sommitale de l’arc. Yves Christe admet la présence d’un
livre près des Vivants au Latran, suivi par Anne-Orange Poilpré qui ajoute que comme
dans la basilique Saint-Paul, les Vivants du Latran apparaissent à mi-corps et tiennent un
codex163
. Ce qui n’est pas tout fait le cas, puisque comme nous l’avons observé, l’aigle de
160
Qui est plutôt un croquis permettant de proposer une reconstitution. Voir POILPRE, 2003, p 291. 161
CHRISTE, 1996, p 73. 162
Ibid, 1996, p 73. 163
POILPRE, 2003, p 291.
49
Jean n’en est pas pourvu au Latran alors qu’il est bien représenté sur le folio 140 du Codex
Barberini. En acceptant sur ce point qu’Ugonio transcrive mal cette partie de l’édifice, il
convient de garder une certaine distance face à la théorie selon laquelle le programme du
Latran se serait largement inspiré de celui de Saint-Paul. S’il est clair que les artistes
carolingiens ont repris certaines composantes générales qu’ils savaient issues de
l’Antiquité tardive, on peut néanmoins penser qu’ils ont puisé pour certains détails
iconographiques dans un répertoire beaucoup moins ancien, dont ils ne font que reprendre
la formule. Cette dernière objection soulève immédiatement la question de l’arcus maior :
Léon III a-t-il suivi à la lettre le programme paléochrétien ?
Grâce à une lettre du pape Adrien Ier (772-795) écrite à Charlemagne en 791, nous
savons que la mosaïque est sans doute encore en bon état de conservation et a gardé sa
composition d’origine :
« …sanctus Leo papa…in basilica beati Pauli apostoli, arcum ibidem maiorem
faciens, et musivo depingens salvatorem dominum nostrum Iesum Christum seu
viginti quatuor seniores nomini suo versibus decoravit 164 »
Nous avons relevé plus haut les différences entres les dessins de Ciampani et les
folio 139 et folio 140 du Codex Barberini, et relevé certaines différences entre ces derniers
et le folio 157 du Cod. Lat. 2160. Nous rappelons qu’Yves Christe n’est pas certain de la
présence des codices sur l’arc de Saint-Paul. En admettant que la gravure suive le
programme originel, il est alors possible que les croquis du Codex Barberini transcrivent
un cycle qui avait subi une réfection. Ce qui nous ramène à l’hypothèse de Müntz et à la
supposée restauration de l’arc sous Léon III.
Le sinistre qui a alors endommagé la basilique doit avoir été d’une grande ampleur
étant donné que le pape décide de faire réparer la charpente, le transept et les
collatéraux165
. On peut raisonnablement penser que son intervention ne s’est pas limitée à
la structure du bâtiment mais aussi à certains endroits du programme iconographique dont
l’arc en liaison avec le transept a dû lui aussi être abîmé. Bien évidemment, nous ne
savons rien à ce propos, mais on peut néanmoins émettre l’hypothèse que les autorités
ecclésiales auraient décidé de garder le schéma général de la composition en préservant la
Maiestas Domini accompagnée d’un cortège d’Anciens. Iconographiquement parlant,
164
BRUYNE, 1934, p 88 et CLAUSE, 1893, p 306. 165
Voir VOGEL, Liber, 1981, Tome II, pp 9, 10 et 13.
50
certains détails semblent plus révélateurs d’une éventuelle restauration. Les couronnes que
tiennent les Vieillards dans les relevés du Codex Barberini sont certes circulaires mais on
observe que le copiste a reconnu sur certaines d’entre elles la présence de pierres
précieuses. Ces éléments se retrouvent non seulement sur le relevé d’Ugonio mais
également sur la coupole de la chapelle Palatine d’Aix-la-Chapelle166
. Dans cette dernière,
un Christ occupe le centre de la composition. Assis sur son trône, il a les épaules couvertes
par un long manteau, et éleve sa main droite dans un geste de bénédiction. Derrière son
trône, apparaît le globe du monde rendu par cinq zones circulaires. A ses pieds, répartis
sur tout le pourtour de la coupole, les vingt-quatre Vieillards figurés à l’échelle humaine
se dressent de leur trône pour tendre au Christ leur couronne enrichie de gemmes (Fig.41).
Le problème reste cependant entier en ce qui concerne la présence de codex à côté
des évangélistes. On ne peut bien sûr admettre une simple intervention ponctuelle sur le
programme de l’arc. Si, toujours en suivant le fil conducteur de notre analyse, les relevés
du copiste présentent bien une iconographie légèrement transformée sous Léon III et si on
considère que le programme de l’arc absidial du Latran s’inscrit bien dans une relation
complexe alliant composition paléochrétienne et iconographie contemporaine, on peut
alors être amené à penser que les codices furent introduits sur l’arcus maior de Saint-Paul
à l’époque carolingienne ; peut-être après la catastrophe de 801 ?
2) Les interventions du XIIIème siècle
a) Réfection du programme de l’abside
Largement endommagée par l’incendie de 1823, l’iconographie qui se déploie
encore aujourd’hui sur le cul-de-four de l’abside de la basilique Saint-Paul-hors-les-murs,
est le résultat d’une restauration entreprise en 1836 qui a voulu reprendre les grandes
lignes iconographiques d’un décor précédent, lui-même restauré une première fois sous le
pontificat de Benoît XIV (1740-1758)167
.
La mosaïque d’origine fut sans doute élaborée et commencée sous le pontificat
d’Innocent III168
mais elle date pour l’essentiel d’Honorius III, même si elle fut sans doute
166
L’ancienne mosaïque ne nous est connue que par un dessin de Ciampani, puisque celle-ci a subi une
restauration de 1870 à 1873 par l’entreprise Salviati de Venise. 167
TOMEI, 1988, p 57. 168
Son initiative est documentée par les Gesta Innocentii (col CCVI), qui mentionnent un don de 117 onces
d’or pour la basilique de Saint-Paul. Voir KRAUTHEIMER, 1999, pp 544 et 600.
51
achevée après sa mort169
. Par une lettre écrite le 23 janvier 1218, nous savons que le pape
Honorius III remercie le doge de Venise Pietro Ziani de lui avoir envoyé un mosaïste et lui
demande l’aide de deux autres artistes pour réaliser le décor de l’abside de Saint-Paul :
« Tue nobilitatis litteras benigne recepimus (…). Ad hec nobilitati tue gratias
referentes de magistro, quem nobis misisti pro mosaico opere in beati Pauli
ecclesie faciendo. Rogamus devotionem tuam quia cum ipsum tante sit
magnitudinis quod per illum non posit extra longi temporis spatium consumari,
duos alios in iamdicti operas arte peritos nobis destinare procures, ut et nos
liberalitati tue grates reddere teneamur et tu per hoc specialiter desiderandum
ipsius gloriosissmi apostoli patrocianium assquaris (…)170 “
L’œuvre fut sans doute terminée par des Vénitiens peut-être formés par les ateliers
byzantins qui avaient travaillé à Saint-Marc de Venise171
. Elle présente au centre de la
composition un Christ Pantocrator avec un livre ouvert dans sa main gauche et qui
esquisse avec sa main droite un geste de bénédiction (ill.112). De part et d’autre du Christ,
sont figurés quatre personnages debout avec, dans une main, un parchemin ouvert alors
que l’autre désigne le Sauveur. Les inscriptions à côté des protagonistes ont permis
d’identifier, à la gauche du Christ, saint Pierre et saint André et à sa droite saint Paul et
l’évangéliste Luc. Posés sur une zone de terre fleurie peuplée de nombreux animaux, les
personnages sont encadrés par deux énormes palmiers (ill.113).
Dans le registre inférieur, on pouvait découvrir certains compagnons de Paul dont
les figures sont accompagnées d’une légende. A gauche Jacques, Thomas, Simon et sans
doute l’évangéliste Marc, et à droite, l’évangéliste Jean, Jacques le Mineur ou bien
Barnabé (ill.114). Au centre, entre les archanges Michel et Gabriel, se trouve représenté
l’Hétimasie, le trône couvert de pierres précieuses sur lequel est posé le livre des Ecritures
symbolise l’attente du Jugement Dernier et donc le retour du Christ sur la Terre à la fin
des temps. Le trône est surmonté d’une immense Croix latine ornée de pierres précieuses,
dont les bras s’évasent légèrement vers leur extrémité. Sur sa face, l’intersection des bras
est occupée par un médaillon où est représenté un Christ trônant. A côté, la lance, la
couronne d’épines, l’éponge et le calice dans lequel semblent posés les clous rappellent la
169
L’étude de l’abside a été reprise par TOMEI, 1988, pp 153-156. Avec un renvoi à la bibliographie
concernant ce sujet. 170
TOMEI, 1988, p 153-154. 171
LADNER, 1981, p 80.
52
Passion (ill.115). En contrebas apparaissent, à plus petite échelle, cinq personnages
debout tenant dans leur main gauche un rouleau fermé et dans la droite un rameau
d’olivier, ce qui permet d’affirmer que ce sont sans aucun doute des martyrs, dont les
restes ont du être conservés dans la basilique (ill.117). Martyrisés au nom du Christ, les
cinq saints attendent le prix de leurs combats et la promesse des Ecritures que représente
le Livre installé sur le trône.
Les inscriptions qui complètent le programme iconographique ont permis de
reconnaître le pape Honorius III vêtu d’une tunique blanche et prosterné à côté du pied
droit du Christ (ill.116). Quant aux personnages en-dessous de l’Hétimasie, à gauche, se
démarque le sacristain Adinolfo, et à droite l’abbé Giovanni Caetani (ill.117) qui
achevèrent la mosaïque après la mort d’Honorius en 1227, comme nous le commente cette
inscription située en-dessous du trône :
« Totius orbis honor quod Honorius artis honore/Papa prius fecit fulget fulgente
decore/Abbas post papam, quem Christus, ad alta vocavit,/Omne Ioannes opus
mira beata soavi172
»
Pour terminer, signalons que la restauration initiée par Innocent III à l’abside de
Saint-Pierre (Fig.5) prouvait que le pontife glorifiait sa propre personne et également toute
les institutions qu’il représentait. En effet, on remarque que le pape occupe une place tout
à fait particulière, proche de l’Agneau juché sur un monticule, donc du monde de
l’Incarnation et du sacrifice de l’Agneau de Dieu. Il semble tenir dans ses mains un
étendard où l’on peut lire Ecclesia Romana. Ici, Innocent III ne figure pas en tant que
simple donateur, il est au même titre que l’Eglise de Rome représenté sur la mosaïque de
l’autre côté de l’Agneau, le successeur des apôtres figurés au registre supérieur.
A l’inverse, à Saint-Paul, cette dimension politique semble avoir disparu ;
Honorius III est représenté à une échelle réduite, hors de la sphère céleste et aux pieds du
Christ, preuve sans doute qu’il se situe à ce moment comme un simple mortel et en simple
donateur173
.
Si Honorius III fait encore appel à des artistes byzantins pour effectuer le décor de
l’abside, c’est à un artiste romain, peintre et mosaïste que va être confiée plus tard la
restauration d’une grande partie du programme. Bien évidemment, nous savons qu’à cette
172
NICOLAI, 1815, p 28, planche VIII et PACE, 1991, pp 182-183. 173
LADNER, 1984, p 80.
53
période travaillent à Rome de nombreuses personnalités. Torriti exécuta entre 1290 et
1295 la voûte de l’abside de Sainte-Marie-Majeure alors que Filippo Rusuti, pratiquement
au même moment, entre 1292 et 1297, s’occupa des mosaïques de la partie supérieure de
la façade174
.
Cependant, c’est sur un autre artiste qu’il faut porter son attention ; un maître à qui
l’on devait les mosaïques de la vie de la Vierge dans l’abside de Sainte-Marie-du-
Transtévère, à savoir Pietro Cavallini. Retracer la carrière et l’évolution du style de
l’artiste a été un des éléments moteurs d’une grande partie de l’historiographie. Pour ce
faire, il a fallu se pencher sur l’un de ses plus grands chantiers, celui de Saint-Paul-hors-
les-murs.
b) La restauration des peintures de la nef
Son intervention sur les peintures et les mosaïques de la basilique nous est certifiée
par un passage de Ghiberti tiré de ses Commentarii qui indique:
« in santo Pagolo era di musaico la faccia dinanzi ; dentro nella chiesa tutte le
pariete delle nave de meço erano dipinte storie del testamento vecchio. Era dipinto
el capitolo tutto di sua mano egregiamente fatte175 »
Après avoir trouvé confirmation de son passage sur le chantier de Saint-Paul, il
convient d’essayer de déterminer à quel moment le maître est intervenu. Pour essayer de
résoudre cet épineux problème, les historiens se sont alors penchés sur les inscriptions
perceptibles sur différents folios du Codex Barberini. Cette étude épigraphique a permis
d’identifier les personnages votifs que l’on retrouve sur certaines compositions et de
proposer une chronologie relative des travaux sur le programme de la basilique.
Au folio 111, a été retrouvée l’inscription « VRSUS SACER ET MONACHUS »
avec sur la marge blanche de la feuille cette annotation : « PLETA EST PARS
ECCLESIE » (ill.78). Sur le folio 112 a été découverte cette légende : « RIBVS DOM
IHOIS SEXTVS ABBAS » avec une indication supplémentaire rajoutée par le copiste :
« riverdersi meglio : ma è monaco in ginocchioni » (ill. 79).
174
Sur l’intervention des deux artistes à Sainte-Marie-Majeure, voir utilement SAXER, 2001, pp 191-192. 175
Voir SCHLOSSER, 1912, p 39, PARRONCHI, 1994, p 15, WHITE, 1984, p 84.
54
Sur le folio 121, en bas de l’image, entre l’escalier et le personnage agenouillé a
été portée cette mention : « IHS LEVITA » (ill.88). Enfin, au folio 137 est indiqué
« ABBAS BARTHOLOMEVS176
» (ill.118).
Il est aujourd’hui certain que le personnage aux pieds de Paul au folio 110 est
l’abbé Jean VI, qui a été élu abbé en 1278 et qui décéda l’année d’après177
.
La formulation retrouvée au folio 111 a été décrypté en « (com) PLETA EST (haec)
PARS ECCLESI(a)E ». En tenant compte de la séquence narrative qui court dans cette
partie de l’édifice, il est clair que le folio 112 précède le folio 111, ce qui a permis de
proposer cette lecture :
“(In tempo)RIBVS DOM(ini) IOH(ann)IS SEXTVS ABBAS (com)PLETA EST(haec) PARS
ECCLESI(a)E”
Grâce à l’autre partie de l’inscription retrouvée au folio 111, transcrite en « VRSVS
SACER (dos) ET MONACHVS », on a proposé de dater l’intervention de l’artiste sous le
pontificat de Nicolas III (1277-1280) et cela malgré les quelques interrogations en suspens
pour ce qui concerne le MONACHVS.
Le problème est plus aigu pour le folio 121. On y retrouve « I (O) H (ANNES)
LEVITA178
». Certains ont proposé de reconnaître le pape Nicolas III au temps où il a été
cardinal de S. Nicola-in-Cancere. On se place donc ici avant l’accession de Nicolas III au
trône pontifical. D’autres voient plutôt « HAS (…) fecit PORTAS LEVITA Iohannes ». Ce
qui identifie ici Giovanni Gaetano Orsini avant son pontificat et explique qu’il est sur la
peinture en habit de moine. Enfin, certains supposent que le copiste, au moment du relevé,
a opéré une erreur et que nous sommes ici en face de Jean VI179
.
L’inscription du folio 137 a autorisé l’identification de l’abbé Barthélemy, abbé de
la basilique de 1282 à 1297, qui a entrepris de nombreuses restaurations dans la basilique
et commandé en 1285 un nouveau ciborium à Arnolfo di Cambio pour abriter l’autel de la
Confession180
où l’on a porté cette inscription :
176
Voir HETHERINGTON, 1979, p 86, TOMEI se trompe puisqu’il indique le folio 135, TOMEI, 2000, p
136. 177
WHITE, 1984, p 86, HETHERINGTON, 1979, p 86, TOMEI, 2000, p 136. 178
WILPERT, 1917, p 622 et WAETZOLDT, 1964, p 60. 179
Voir sur ce point TOMEI, 2000, p 137. 180
Pour une description précise voir MOSKOWITZ, 1998, pp 88-103. Pour l’intervention d’Anorlfo di
Cambio à Saint-Paul-hors-les-murs et sur sa carrière romaine, voir GARDNER, Julian., The Tomb and the
Tiara, Oxford, 1992, p 43 et 50 et spécialement pp 95-109.
55
« ANNO MILLENO CENTUM BIS ET OCTAVEGO/QVINTO…/ HOC FECIT
ARNULPHUS CUM SUO SOCIO PETRO181
»
Pour conclure, la confrontation de ces différentes données nous apprend que la
campagne de restauration des peintures de la nef, et tout particulièrement celles du cycle
du Nouveau Testament, a été entreprise pendant la brève carrière de Jean VI et sous le
pontificat de Nicolas III avec peut-être le concours d’un autre membre de la famille Orsini
comme en témoigne l’inscription « VRSVS SACER(dos) et MONACHV(s) ». Pour
Gardner, il ne fait aucun doute que le pape Nicolas III a largement participé au
financement des travaux182
. Il est vrai que la réfection des basiliques paléochrétiennes est
au centre de sa politique, comme en témoigne la mention de Ptolémée de Lucques qui
décrit les charges du pape dans ses nombreuses campagnes :
« Hic ecclesiam beati Petri quasi totam renovavit et numerun summorun
pontificium fecit describi secundum imagines in ecclesia Beati Petri in loco
eminenti et Beati Pauli ac Sancti Ioannis in laterano183 »
Après cette première campagne, il semble qu’une seconde fut entreprise sous
l’abbé Barthélemy, qui s’est lui aussi investi dans un programme de rénovation de la
basilique. C’est donc en deux temps que se sont réalisés les travaux de restauration sur les
murs latéraux de la nef de Saint-Paul : une première phase, dont le projet remonte à 1270
mais qui commença en 1277 pour se poursuivre jusqu’en 1279, date de la mort de Jean VI,
et qui fut peut-être terminée par un de ses successeurs ; puis une seconde phase, dont la
fourchette peut se situer entre le début de l’abbatiat de Barthélemy en 1282 et la date de
dédicace du ciborium d’Arnolfo di Cambio en 1285184
.
Après avoir levé le voile sur la chronologie et les protagonistes des restaurations du
programme de la basilique, les chercheurs ont essayé de comprendre à quel moment
Cavallini est intervenu sur le cycle vétéro- et néotestamentaire, non sans rechercher les
scènes qu’il ne fit que restaurer, ou bien celles que l’artiste remplaça par des compositions
de son crû. L’étude des copies du XVIIème siècle a permis de suivre l’évolution de
l’artiste aussi bien dans sa manière de traiter la disposition des personnages que dans les
progrès qu’il a réalisé quant aux styles architecturaux.
181
KRAUTHEIMER, 1977, p 100. 182
GARDNER, 1971, p 246. 183
Ibid, 1971, p 240. 184
BEAUSCEANUS, 1925, p 263, HETHERINGTON, 1979, p 94, WHITE, 1984, p 85.
56
White a remarqué que dans certaines aquarelles du Nouveau Testament, certains
personnages sont confinés dans un espace peu profond ne permettant qu’une perspective
tridimensionnelle limitée. Au folio 103 par exemple (ill.70) : à droite, trois personnages
forment le premier groupe et les deux autres à gauche sont seulement séparés par le
changement de plan. Au contraire, dans la scène où Paul est mordu par un serpent (ill.94),
le saint est représenté devant trois personnages assis sur une pierre et rangés en diagonale,
ce qui engendre un effet de profondeur. Cela s’avère plus ambitieux au folio 99 puisque la
façon dont le saint semble prosterné ne suit pas exactement le plan (ill. 66). A cela, les
deux figures à la gauche de Paul sont comme au folio 127 rangées en diagonale marquant
également un effet de profondeur (ill.94). Le second plan est cette fois, enfin, déterminé,
puisque deux personnages sont placés à droite du bâtiment. La scène la plus réussie est,
selon White, l’image qui commente la Prédication de saint Paul à Jérusalem (ill.68). Une
bonne vingtaine de personnages déterminent une sorte d’élan demi-circulaire dans
l’espace et entourent le saint qui occupe le centre de la composition. La disposition des
figures est accompagnée par d’importantes variations dans la profondeur et la relation
entre les figures et l’architecture est plus claire. Toutefois, sur le mur opposé, dans La
Plaie des Serpents (ill.46), les personnages sont en liaison avec l’architecture. L’artiste
semble vouloir attirer l’attention sur le premier plan où sont représentés les serpents.
En plus du traitement des figures dans l’espace, intervient également une évolution
dans le traitement des styles architecturaux. Si certains bâtiments se sont largement basés
sur ceux de l’Antiquité, comme en témoigne la scène de Joseph en Prison (ill.40), ou celle
du folio 112 (ill.79) que White rapproche de certaines mosaïques de Pompeï185
, dans
d’autres cas, Cavallini utilise des constructions frontales simples où il ne montre qu’un
seul côté sans aucune déformation comme au folio 112, ou complexe comme dans la
peinture de saint Paul en prison (ill.85). Dans d’autres scènes, il utilise des constructions
frontales en raccourci, isolées comme au folio 42 (ill.35) ou bien couplées dans La Plaie
des sauterelles, mais dont on a du mal à comprendre les articulations (ill.52). Si sa
maîtrise commence à s’affirmer dans l’image de La Révélation de Saül186
(ill.58), c’est
tout particulièrement dans les scènes de l’Ancien Testament que les progrès sont les plus
nets comme en témoigne le trône de Pharaon au folio 54 (ill.47).
185
WHITE, 1984, p 87. 186
WHITE, 1992, p 42.
57
La scène la plus étonnante est celle qui représente Joseph et la femme de Putiphar
(ill.39). L’échelle qui est différente des autres peintures de l’Ancien Testament et que l’on
avait déjà aperçu au folio 91 (ill.58), est ici une construction oblique extrême. Un
bâtiment isolé dont on ne peut voir que l’intérieur occupe une grande partie de l’espace.
On le voit, Cavallini s’intéresse cette fois aussi bien à des vues extérieures qu’à des scènes
se déroulant dans un espace clos187
.
L’examen des copies de la Vie de saint Paul et des scènes de l’Ancien Testament
nous amène à plusieurs axes de réflexions. Tout d’abord, on peut supposer que Cavallini a
sans doute travaillé lors de la première campagne sur le mur gauche de la basilique, ce qui
induit que c’est dans un second temps que le cycle de l’Ancien Testament a été effectué188
.
De plus, il apparaît clairement, face aux changements stylistiques et quelquefois
iconographiques, que Cavallini fut sans doute influencé par des fragments du programme
paléochrétien189
. On peut même dans certains cas affirmer que l’artiste s’est arrangé pour
ne pas trop bouleverser le schéma déjà existant, comme nous le prouve la disposition des
personnages votifs sur quelques scènes du Nouveau Testament. Les spécialistes ont depuis
longtemps soulevé le caractère fondamental de la rencontre de l’artiste romain avec le
cycle tardo-antique de Saint-Paul-hors-les-murs190
. Il est vrai que dans la scène de la
Nativité à Sainte-Marie-du-Transtévère, on retrouve dans le personnage qui joue de la
flûte un emprunt direct à des scènes pastorales issues de l’Antiquité tardive191
. Pourtant, ce
type de motifs était rentré depuis longtemps dans le répertoire byzantin, qui avait connu un
regain d’intérêt à la fin du XIIIème siècle. Il n’a alors fallu qu’un pas pour proposer que
Cavallini s’est plutôt fondé sur des carnets de modèles orientaux192
.
Cette hypothèse renvoie immédiatement aux scènes du Nouveau Testament dont
certaines laissent apercevoir une iconographie de souche grecque. Afin de déterminer la
source sur laquelle auraient travaillé plusieurs artistes de la fin du XIIIème siècle, les
187
WHITE, 1992, p 43. 188
Ibid, 1992, p 40. 189
WHITE, 1984, p 89. 190
Voir notamment les travaux d’Ulrike Koenen sur la Croix de Constantin. Elle propose une restitution de la
disposition originelle des différentes scènes qui ornaient la Croix. Mais surtout elle suppose que cette
iconographie est l’aboutissement de la réception d’une tradition paléochrétienne ; réception visible dans une
quinzaine d’églises de Rome et de ses environs du XIIème siècle au XIIIème siècle. Sur l’influence de Saint-
Paul sur la peinture monumentale : Voir KOENEN, 1995, pp 126-155. 191
VITALIANO, 1996, pp 123-179 et surtout pp 131-146. 192
Sur l’influence de modèles byzantins sur l’œuvre de Cavallini : Voir KESSLER, 1965, pp 112-115, et
GEAHDE, 1971, pp 359-400 et surtout p 390. Pour comprendre l’influence des manuscrits sur la peinture
monumentale de cette période. Voir WEITZMANN, 1971, pp 48-49.
58
regards se sont portés sur les trois manuscrits dans lesquels sont illustrés le Nouveau
Testament : le Vat. Lat.39, le Chigi A. IV. 74 et le Codex Giustiniani qui selon Eleen date
de 1200. Weitzmann a remarqué qu’il existe des manuscrits très illustrés fondés sur les
Actes des Apôtres193
. Eleen a largement démontré que les trois manuscrits ne dépendent
pas les uns et des autres mais qu’ils ont tous copié un quatrième manuscrit, sans doute
originaire de Vérone, et qui a été réalisé entre le début et le milieu du XIIIème siècle.
Outre cela, nous savons que le Rotulus de Verceil qui date du début du XIIIème siècle
déploie des schémas tirés des actes canoniques, exécutés en prévision de la restauration
des peintures autrefois dans la nef de San Eusebio de Verceil. Malgré quelques variations,
il est aujourd’hui admis que le Rotulus doit se situer dans le groupe de Vérone. Dans la
scène de La Révélation de Paul, Eleen a remarqué que le saint était en position de
proskynèse et a, pour corroborer cette proposition, confronté cette position avec le folio
126 v° du MS 1186 conservé au monastère Sainte-Catherine (Fig.21). Le saint entretient à
peu près la même posture que sur le ms. Vat.Lat. 39 et sur le Codex Giustiniani.
Les analogies perceptibles avec les mosaïques de la chapelle Palatine de Palerme
en Sicile194
, et en tout premier lieu avec la scène de La Révélation de Saül ont permis à
Eleen de conclure que certaines scènes du Nouveau Testament de Saint-Paul-hors-les-
murs se groupent dans une famille italo-byzantine dont les sources peuvent venir d’un
ancien manuscrit enluminé des Actes qui doit s’inscrire dans le même schéma que certains
manuscrits véronais195
.
La confrontation de l’artiste avec des courants artistiques antiques et sans doute
avec des modèles d’Italie du Nord, qu’il décide parfois d’assimiler et tantôt de rejeter, font
de Cavallini un des chefs de file de l’art romain du XIIIème siècle. Doit-on pour autant
voir une influence réciproque entre Cimabue et Cavallini ou entre Cavallini et Giotto ?
Cavallini a-t-il exercé une influence sur Torriti196
?
Au cours de ces dernières décennies, les historiens de l’art ont apporté certaines
solutions convaincantes à ces importantes questions. Il n’y a plus de doute qu’il existe des
différences stylistiques entre Torriti, Cavallini et Rusuti, mais aussi entre leurs ateliers.
193
WEITZMANN, The miniatures of the sacra Parallela, Parisinus Graecus 923, Princeton, 1979, pp 191-
193. 194
Voir sur ce point DEMUS, 1949, p 298 et les conclusions de GARRISSON, 1993, p 205. 195
ELEEN, 1982, p 32. 196
Voir les remarques pertinentes de Koenen, avec renvoi à une bibliographie sélective sur ce sujet.
KOENEN, 1995, p 151.
59
C’est sur ce point que se concentre l’historiographie actuelle. Pour ce faire, celle-ci essaye
de distinguer dans l’œuvre de Cavallini ce qui est de sa propre main de ce qui revient à ses
élèves et pourquoi pas à ses successeurs ; ces recherches tentant d’ailleurs, ces derniers
temps, de retrouver l’identité des artistes de grande qualité restés jusqu’ici anonymes.
Le Christ en buste dans la Création de l’Univers (ill.16), qui se retrouve pourvu
d’un nimbe triangulaire au folio 31 figurant L’Offrande de Caïn et Abel, traduit pour
certains la main de Cavallini197
(ill.24). White a fortuitement soulevé le problème de
l’atelier. Hetherington, pour sa part, a proposé que l’artiste romain se soit tout d’abord
formé dans l’ombre d’un artiste auquel la commission papale a commandé la réfection
d’une partie du cycle de Saint-Paul, sans pour autant abandonner l’idée de l’intervention
d’élèves sur le cycle de l’Ancien Testament198
. C’est aux historiens de l’art italiens que
l’on doit les études les plus significatives sur ce sujet, en soulevant de nouveaux axes de
réflexions sur les artistes qui ont travaillé à Saint-Paul-hors-les-murs.
c) Le problème de l’atelier
L’iconographie qui a orné la façade de la basilique est connue par un dessin du
XVIIème siècle et des gravures du XVIIIème et du XIXème siècle. L’observation générale
du dessin du XVIIème (ill.119) laisse transparaître de larges pertes qui ont disparu sur la
gravure de Nicolai (ill.120), ce qui indique une restauration entre ces périodes que l’on
peut vraisemblablement situer en 1720, au moment où a été menée une campagne de
travaux dans l’abside199
. Il reste à envisager la date d’élaboration du programme que l’on
peut deviner sur le dessin du XVIIème siècle.
C’est par l’analyse du relevé du Vat. Lat 5507 (ill.121) que notre connaissance de
la campagne de réalisation du cycle a largement évolué. Sur le dessin, on trouve un
personnage à genoux, la tête coiffée d’une tiare, pourvu d’une longue robe ecclésiale, avec
cette inscription du copiste :
« IOANNES XII PP EX opere musivo seu vermiculato, quod ipsius iussu factum
supra porticum basilicae S. PAULI quam ipse renovavit collabentum et ornavit200
».
197
HETHERINGTON, 1979, p 94. 198
Dont la restauration semble avoir commencé avec l’abbé Barthélemy en 1282. La commande du ciborium
en 1285 marque son achèvement dans la seconde partie de cette décade. 199
HETHERINGTON, 1979, p 107. 200
Vat. Lat. 55O7, p 118. WAETZOLDT,1964, p 55, Kat. 577, Abb 317.
60
Il est alors tout à fait probable que le programme a été élaboré sous le pontificat de
Jean XXII (1316-1334). Plus particulièrement, nous savons qu’après la nomination de
l’abbé Grégoire en 1322 fut entreprise une remise à neuf de la basilique. Les sources
textuelles nous apprennent que le souverain pontife avait en septembre 1323 offert mille
florins pour restaurer l’édifice :
« reparationi fabricae monasterii Sancti Pauli201 »
Outre cela, le pape demande à l’abbé Grégoire qu’une mosaïque soit placée sur la
façade :
« opus Mosaicum sit inceptum202 »
Face à cela certains chercheurs ont formulé l’hypothèse que le chantier aurait
commencé en 1325 et se serait terminé aux alentours de 1330 alors que pour d’autres, le
cycle aurait été terminé dès 1325203
. Cependant, ils ont laissé de côté quelques
informations d’importance. En 1332, Philippe de Camberhalc rapporte que la basilique
était dans un état de dégradation importante :
« …inter et extra collapsum et desolatum…et iam ruinosam204 ».
L’édifice a été sinistré par un tremblement de terre en septembre 1349 et donc de
nouveau restauré jusqu’en dans les années 1360, comme nous le prouvent les armes de
Clément VI présentes sur la façade205
(ill.120).
Le programme est divisé en deux grandes zones. Dans la partie supérieure, juste
au-dessus de la fenêtre centrale est figuré un Christ en buste dans un médaillon (ill.7).
Présenté de face, le visage barbu et pourvu d’un nimbe crucifère, il lève sa main droite, la
paume ouverte vers le spectateur, alors que la gauche tient un livre ouvert. L’imago
cliptea est soutenue par six anges tous représentés la tête nimbée et le regard dirigé vers le
Christ. De chaque côté est illustré le Tétramorphe avec le taureau et l’ange de Matthieu à
la droite du Christ, l’aigle et le lion à sa gauche ; tous pourvus de quatre ailes, d’un nimbe
et d’un codex.
201
HETHERINGTON, 1979, p 109. 202
Ibid, 1979, p 109. 203
BOTTI, MANACORDA, 1999, p 501. 204
HETHERINGTON, 1979, p 114. 205
Voir GALBREATH, 1983, pp 23 et 77.
61
Au registre inférieur se trouve à gauche saint Paul, qui semble assis sur un trône
dans le dessin du XVIIème siècle, alors qu’il est debout sur la gravure de Nicolai. La tête,
qui a disparu sur le relevé d’Edimbourg, a dû reprendre certains traits caractéristiques du
saint : mèches de cheveux sur les côtés au-dessus des oreilles, tempes dégarnies, avec un
toupet de cheveux central ramené en avant au milieu du front206
. Pourvu d’un nimbe, il
tient dans ses mains un livre et une épée. La figure suivante montre une Vierge à l’enfant
en majesté. Marie est assise sur un trône richement sculpté soutenu par deux anges. Elle
est sur le dessin d’Edimbourg présentée de face, avec le visage couvert d’un long voile et
pourvue d’une couronne. Sur ses genoux, est figuré l’enfant au nimbe crucifère.
Après la fenêtre se trouve saint Jean l’Evangéliste encadré par deux palmiers. Le
saint est là aussi représenté de face, la tête nimbée et tournée vers la droite. Il semble tenir
dans sa main gauche un objet difficilement identifiable sur le dessin du XVIIème siècle
mais que Nicolai transcrit comme étant un globe. A l’extrême droite est figuré saint Pierre
qui reprend les mêmes caractéristiques que saint Paul, sauf qu’il semble debout et tient
dans ses mains une immense clef. Toutes ces figures ont, au-dessus d’elles, des
inscriptions qui ont permis d’entériner leur identification. Pour Paul on trouve cette
mention :
« S PAVLVS VAS ELECTIONIS ET DOCTOR GENTINVM »
alors que pour la Vierge est marqué :
« REGINA COELI MARIA MATER DOMINI »
Pour saint Jean est transcrit :
« S IOHANNES BAPTISTA PRECUSOR DOMINI »
Enfin pour Pierre se trouve noté :
« S PETRUS PASTOR OVIVM ET PRINCEPS APOSTOLORUM207 »
L’ensemble du programme est décoré par des bandes ornées des tiares papales ou
bien par des têtes de chérubins et des blasons. Iconographiquement parlant, certains détails
renvoient à des formulations acquises depuis longtemps. Citons par exemple la
représentation de Paul pourvu d’une épée, qui a été introduite vers le milieu du XIIème
siècle sur un tympan du transept de la cathédrale de Maguelone en Languedoc (Fig.22),
206
ELEEN, 1985, pp 2-3. 207
Pour ces transcriptions voir HETHERINGTON, 1979, pp 112-113.
62
pour être reprise à la fin du siècle ou bien au début du XIIIème siècle sur certaines
enluminures comme au folio 1 v du ms. Lat. 12004 de la BNF208
(Fig.23). Cette mutation
de l’iconographie a un double but. Tout d’abord, renvoyer au martyre du saint qui a été
décapité et ensuite insister sur l’illustration d’un personnage qui est considéré comme
l’incarnation du militant aux qualités chevaleresques. Enfin, et malgré le mauvais état de
la mosaïque au XVIIème siècle, la position des jambes de Paul laisse à penser que le saint
était représenté assis. Afin de reconstituer sa position, on peut s’imaginer que celui-ci a du
être représenté de la même manière que sur la peinture du Jugement Dernier au revers de
façade de Sainte-Cécile peinte par Cavallini où il siège à côté de la Vierge (Fig.24).
En ce qui concerne saint Jean-Baptiste, la gravure de Nicolai laisse clairement
transparaître qu’il porte un globe crucifère alors que le dessin du XVIIème siècle nous
montre le saint pourvu de l’Agneau crucifère posé sur un disque. Cet attribut était déjà
présent depuis une longue période puisqu’on le retrouve sur la chaire de Maximien de
Ravenne qui date du VIème siècle (Fig.25). D’autres part, il est vêtu du manteau du
philosophe sur la chaire ; mode d’habillement que l’on retrouve sur la figure de la façade
de Saint-Paul.
L’aspect général du programme est là aussi pour le moins singulier, étant donné
que se trouvent combinées à la fois une Maiestas Domini en ligne et une Deesis. Pour
cette dernière, on ne peut qu’être frappé par sa figuration. Dans cette image trimorphe,
dont l’iconographie se révèle d’ascendance byzantine, on trouve généralement la mère de
Dieu et saint Jean-Baptiste en prière autour d’un Christ souvent trônant. C’est le cas sur le
Triptyque dit Triptyque Harbaville où, à l’intérieur, dans la partie centrale, est figuré le
Christ sur un trône avec à sa droite la Vierge et sa gauche saint Jean-Baptiste ; l’ensemble
étant surmonté du buste de deux archanges (Fig.26). Nous connaissons toute la portée de
ce thème par lequel on a demandé l’intercession de la Vierge et du saint pour son bien-
être sur terre et le salut des âmes209
. Pourtant, il semble bien qu’à Saint-Paul la
représentation de la Vierge donne priorité à la Mère de Dieu. Le Christ n’est pas trônant
puisque c’est le médaillon d’un vainqueur que les anges semblent monter au ciel. En fait,
seul saint Jean-Baptiste reprend une attitude conventionnelle dans la Deesis.
208
C’est aussi à cette période que sont illustrés conjointement Pierre et Paul avec leur attribut respectif.
C'est-à-dire pour Paul l’épée et pour Pierre la clef. Voir ELEEN, 1982, pp 38-39. 209
GRABAR, 1979, p 153.
63
La restauration du XVIIIème siècle et la mauvaise conservation des mosaïques au
XVIIème siècle, ont rendu presque impossible toute confrontation stylistique avec des
programmes contemporains.
C’est pourquoi la littérature a depuis longtemps accepté l’idée qu’étant donné que,
dans la seconde moitié du XIIIème siècle, Jacopo Torriti travaillait aux mosaïques de la
façade du Latran, il est alors possible que Cavallini soit intervenu sur la façade de Saint-
Paul.
Pour ce faire, certains ont vu dans le modelé des robes la même main que sur la
Vierge trônant ou sur la scène de l’Annonciation de Sainte-Marie-du-Transtévère où les
corps sont tout aussi charnus, drapés dans des étoffes pesantes et souples. Gardner a
d’abord privilégié la piste d’un artiste de Venise étant donné que l’iconographie renvoie à
des modèles courants depuis longtemps à Byzance210
pour finalement opter pour un artiste
romain arrivé à sa maturité, et que Hetherington identifie comme étant bien Cavallini211
.
Plus récemment, Serena Romano est revenue sur l’attribution de cette œuvre, pour
la donner à un certain Lello da Orvieto. Après la déposition de Boniface VIII en 1303
consécutive à sa défaite contre la France et les Colonna, il est fort possible, face à la baisse
croissante des commandes, que Cavallini se soit réfugié à la cour angevine de Naples aux
alentours de 1308. C’est lui, avec l’aide de collaborateurs, dont Lello da Orvieto, qui a
travaillé à l’église de Santa-Maria-Donnaregina212
. Nous savons que ce même Lello a
abandonné Naples en 1325 pour venir travailler à Rome, où son intervention est attestée
sur le cycle dédié à saint Benoît dans l’église Sainte-Agnès-hors-les-murs213
. Alors,
Serena Romano voit dans la Vierge à l’enfant qui ornait jadis la façade (ill.122), et
aujourd’hui placée sur l’arc absidal, et celle peinte par l’artiste à l’abbaye de Fassanova
(Fig.27), des liens stylistiques qui peuvent dénoter l’intervention de l’artiste dans le
programme de Saint-Paul214
. Enfin, pour Tomei, si l’intervention de Lello est bien
attestée, il remarque encore de nombreuses similitudes avec l’art de Cavallini ce qui, pour
210
GARDNER, 1973, p 588. 211
HETHERINGTON, 1979, pp112-113. 212
Pour l’étude du travail de Cavallini à Naples voir TOMEI, 2000, pp 121-133. 213
ROMANO, 1992, pp 170-174. 214
Ibid, 1992, p 114.
64
lui, est une preuve supplémentaire des liens importants qui ont dû exister entre l’artiste et
son atelier215
.
Ces interrogations essentielles peuvent également se transposer sur d’autres parties
du programme. Pendant la première campagne des travaux, sous le pontificat de Nicolas
III, à la première série paléochrétienne qui sans doute avait été restaurée et complété au
VIIè et au IXè siècle216
, a été ajoutée dans les écoinçons des arcades une nouvelle galerie
de portraits allant de Pierre à Boniface Ier217
. Seul quatre portraits ont survécu au sinistre
de 1823, dont un est conservé dans le musée de la basilique. Il s’agit des papes Sixte Ier
(v. 117-127), Télesphore (v. 117-137), Hygin (v. 137-140) et Anaclet (v.154-166)
(ill.123).
Il ne fait aucun doute que cette deuxième série s’inspire de la galerie
paléochrétienne située au-dessus de l’arcature puisque les portraits sont insérés dans un
médaillon d’où ne transparaît que le buste du pontife.
D’une forme plus ou moins ovale, et de dimension plus petite que les médaillons
paléochrétiens, on retrouve les papes habillés du pallium représentés de face, le visage
barbu et pourvus d’une tonsure dont la tête, à la différence de la série antique, est pourvue
d’un nimbe. Ces portraits ont bien évidemment beaucoup apporté à la connaissance du
travail de l’artiste. Quant à la mise en œuvre, il a dû entre autres tracer à la pointe dure le
dessin préparatoire de la tête puis il a repassé sur cette ligne avec une couleur rouge. Pour
le nimbe, on remarque que dans la partie basse celui-ci se fond avec l’arrière plan du
portrait alors que dans la partie haute il déborde d’un demi centimètre en avant.
Indépendamment de cela, par l’emploi des tons, on observe une bonne connaissance des
jeux d’ombres et de lumières et une volonté d’un rendu réaliste du personnage218
.
Là aussi, l’attribution de ces portraits a été largement discutée. Certains les ont
donnés sans équivoque à Cavallini tout en y incluant une influence d’Arnolfo di Cambio
qui a travaillé au même moment sur le ciborium219
. D’autres pensent être face à des
215
TOMEI, 2000, p142. 216
LADNER, 1984, p 41. 217
Nicolas III fit également peindre à Saint-Pierre, au-dessus de chaque colonne de la nef, une galerie de
portraits (des croquis en sont conservés dans le Cod.Barb.Lat. 2733) qui commençait là aussi au début de la
papauté. Il est admis que ce schéma fut reproduit au Latran mais les portraits ont du disparaître pendant
l’incendie de 1308. Enfin, on pense que Cavallini aurait peint une quatrième série pour Sainte-Cécile, sur le
modèle de Saint-Paul. Voir KRAUTHEIMER, 1999, p 590. 218
BRUYNE, 1934, pp 168-169. 219
Ibid, 1934, p 165.
65
peintures réalisées par Cimabue qui est arrivé à Rome en 1272 et qui a dû collaborer à la
galerie de portraits220
. Enfin, les dernières restaurations entreprises sur le portrait
d’Anaclet ont permis de dégager un style byzantinisant, fort loin de la manière de
Cavallini221
.
Dans sa monographie sur Cavallini, Tomei est revenu lui aussi sur les peintures
néotestamentaires. Pour lui, si Ghiberti mentionne bien l’intervention de Cavallini sur le
cycle de l’Ancien Testament, il est moins certain que le maître ait travaillé sur le mur
septentrional. Pour ce faire, il publie une lettre de l’abbé Giuseppe Giustino, conservée à
la Bibliothèque Vaticane au folio 45 r du Vat.Lat. 9672, qui nous apprend :
« In tutta la vasta estensione del muro meridionale della gran nave di mezzo, dal
principio di esso, sino alla scrostatura, che ancora si vede per apporvi un nuovo
stabilimento, veggonsi dipinti vari fatti dell’antico testamento, attribuiti al
Cavallini, il quale essendo giunto co’suoi pennelli fino a questo luogo, cesso di
vivere, e fu sepolto in questa Basilica. Le altre, caratterizzate di gusto greco
dall’intelligentissimo P. Costanzo, presentano al septentrione fatti del nuovo, e
specialmente degli apostoli 222»
Ce qui permet à Tomei de soulever de nouveaux problèmes : peut-on alors
envisager que ce soit un autre maître qui ait travaillé au cycle néotestamentaire ? Peut-on
soulever l’hypothèse que le cycle vétérotestamentaire soit alors plus classique que le
Nouveau ? Malheureusement, Tomei n’étend pas le débat à d’autres questions essentielles.
Qui est ce P. Costanzo ? Est-ce le maître qu’a reconnu Hetherington et avec lequel aurait
peut-être collaboré Cavallini ? Ou alors sommes nous en face d’un élève qui a peint sous
la direction du maître, sur le cycle du Nouveau Testament, et pourquoi pas sur la seconde
galerie des portraits des papes ?
Il ne fait aucun doute que sur ce point le débat ne fait que commencer. On ne peut
bien évidemment pas écarter l’intervention d’un élève à côté du maître. On le sait,
Cavallini était le mosaïste et le fresquiste le plus demandé à Rome dans le dernier quart du
220
KRAUTHEIMER, 1999, p 552. 221
ROMANO, 1989, pp 211-218. 222
TOMEI, 2000, p 142.
66
XIIIème siècle223
. La multiplication des commandes a sans aucun doute décidé l’artiste à
s’entourer d’un vaste atelier. Certains s’accordent à penser que Cavallini a collaboré avec
ses élèves ou assistants dans les huit effigies placées entre les fenêtres du revers de façade
de Saint-Pierre où l’on peut découvrir saints Pierre et Paul accompagnés d’apôtres et de
quatre évangélistes224
. On peut de la même manière imaginer qu’il fit de même à Saint-
Paul. Doit-on pour autant écarter l’idée selon laquelle ce serait des artistes indépendants
qui auraient travaillé dans la basilique ?
Dans les années 1290, c’est un artiste proche de Torriti, de Cavallini et de Giotto,
mais ayant sa propre personnalité, qui exécuta pour la loggia supérieure de l’abbaye des
Trois-Fontaines un programme comprenant des scènes profanes et l’histoire de
Barlaam225
. Peut-être est-ce l’un d’entre eux qui a œuvré à la façade et au revers de façade
de Saint-Paul-hors-les-murs ?
Au terme de ce parcours sur nos connaissances actuelles du programme
iconographique de Saint-Paul, il s’avère que le cycle a pour le moins été largement
transformé au fil des siècles. En dernier lieu, nous savons que les peintures de la nef
centrale ont été de nouveau restaurées sur ordre de Benoît XIV (1740-1758) sous la
direction du peintre Salvatore Monosilio226
. C’est sans doute à cette période que l’on a
orné les scènes bibliques d’un fond bleu avec une base rouge sur laquelle a été inscrit un
titre en blanc afin de les rendre visibles du sol. Cela engendrant, comme le signale
Gardner, un contraste très net entre la mosaïque de l’abside, celle de l’arc227
et le reste du
programme228
.
La présentation des interventions sur le programme de Saint-Paul s’évalue, comme
nous venons de le voir, dans le cadre d’une documentation dont l’ampleur découle des
aléas de l’histoire. C’est pourtant sur le cycle primitif qu’il convient de se reporter
223
On lui doit par exemple la nef de Saint-Chrysogone. Ghiberti mentionne son travail à Saint-Pierre. Il
participe aux travaux sur le revers de façade de Sainte-Cécile. A la demande du cardinal-diacre Pietro
Peregrosso, il exécuta le Christ flanqué de trois saints et de la Vierge Marie sur la voûte de Saint-Georges-
au-Vélabre. 224
Voir MATTHIAE, 1972, pp 121-123, HETHERINGTON, 1979, p 122, KRAUTHEIMER, 1999, p 556,
TRONZO, 2001, p 465. 225
Voir utilement la monographie de MULLAZANI, Germano., L’abbazia delle Tre Fontane, Milan, 1988,
p 264. 226
TOMEI, 1988, p 57. 227
Restaurée sous Clément XI (1730-1740). Voir sur ce point WILPERT, 1917, p 517, WARLAND, 1986, p
41, TRONZO, 2001, p 472 note 31. 228
GARDNER, 1999, pp 245-254 et particulièrement pp 251-254.
67
maintenant. Car, force est de constater que sur ce point, les résultats d’un siècle de
recherche sont encore fragilisés par de nombreuses incertitudes.
69
Chapitre Premier
Retour sur le programme paléochrétien
1) Une restitution délicate
a) Nouvelles propositions d’identification de scènes
Sur l’intégralité du programme qui orne la basilique, c’est tout particulièrement
dans les peintures à thème biblique que l’on trouve encore de nombreux points
d’interrogation quant à leur identification. Si certains ne peuvent être résolus, comme
l’image du folio 111, d’autres méritent qu’on s’y arrête. En tout premier lieu, c’est à la fin
de l’histoire de l’Exode que sont représentées deux scènes illustrant la Mise à mort des
premiers nés d’Egypte (ill.47 et 53). Dans ces deux dessins très proches on retrouve deux
anges dont les flèches frappent deux personnages allongés qui symbolisent l’ensemble des
nouveaux nés. Il ne fait plus de doute que Cavallini est intervenu sur l’image que transcrit
le folio 54 du Codex Barberini. On ne trahira sans doute pas la vérité en affirmant que
l’on ne sait toujours pas pourquoi Cavallini a effectué une réplique de l’iconographie qui
se trouve dans la dernière scène de l’Ancien Testament. Cependant, si certaines analogies
sont perceptibles entre les deux folios, on remarque également que Moïse n’entretient pas
le même comportement sur le folio 54 et sur le folio 60. Dans le premier, Moïse et Aaron
sont figurés à mi-corps, et ont le regard orienté vers le haut dignitaire, avec lequel Moïse
semble entretenir une conversation puisqu’il pointe son index dans sa direction. Au folio
60, Moïse et Aaron sont figurés au deuxième plan, là aussi à mi-corps, avec cette fois le
regard dirigé vers l’action du premier plan qui marque le dernier fléau de Dieu.
Indépendamment de cela, on remarque que Moïse tient dans sa main droite un bâton qu’il
dirige vers le ciel.
Hetherington a avancé l’idée qu’au folio 54, Cavallini a largement repris
l’iconographie primitive tout en la modernisant pour la rendre plus compréhensible à
l’assistance de son époque229
; cela étant donné que tout le monde s’accorde pour voir une
iconographie issue de l’Antiquité tardive au folio 60. Dans ce cas, la peinture pourrait
reprendre le schéma d’ensemble que l’on trouve sur la scène de La mise à mort des
premiers nés Egyptiens, c'est-à-dire : au premier plan, deux anges décochant des flèches
229
HETHERINGTON, 1979, p 92.
70
en direction des deux personnages qui occupent le centre de la composition ; et à droite,
Pharaon assis sur son trône, qui assiste impuissant à la scène. Au second plan, derrière une
montagne, à mi-corps, Moïse, au lieu d’indiquer par le geste de son bâton l’ordre du début
du fléau, signifie de sa main l’ultime avertissement. Ce sont donc deux moments bien
précis que devaient transcrire ces deux images.
La lecture du livre de l’Exode nous apprend que le patriarche s’était rendu une
dernière fois chez le Pharaon pour lui annoncer la future mise à mort des Premiers nés (Ex
11 : 1 : 9). Le geste du doigt qu’a reproduit Cavallini, et qui pouvait exister sur l’image
paléochrétienne, permet de croire que c’était bien l’Annonce de la mort des Premiers nés
qui était illustrée sur cette peinture.
Cependant, cette nouvelle identification ne résout pas un autre problème majeur.
Alors que l’intégralité du cycle de l’Ancien Testament suit chronologiquement les textes
bibliques, il est étonnant que cette scène s’insère entre Le miracle des serpents devant
Pharaon (Ex 7 : 10-12) et L’eau changée en sang (Ex 7 : 20). L’hypothèse la plus
commode est de percevoir ici une erreur du compilateur du Codex Barberini qui aurait
mal placé cette image dans le manuscrit230
. Dans ce cas, et au regard de la reconstitution
de Hetherington, on pourrait situer cette scène juste avant celle du folio 60. Pourtant, la
gravure de Seroux d’Agincourt que l’on retrouve au folio 4.r du Cod. Vat. Lat. 9843
(ill.124) indique qu’à la fin du XVIIIème siècle, se plaçait à cet endroit La plaie des
sauterelles (Ex 10 : 13-14). Il apparaît donc que le concepteur du programme primitif n’ait
pas voulu à cet emplacement suivre strictement le livre de l’Exode. Pour notre part, et en
admettant que cette scène ait existé, il ne fait pas de doute qu’elle aurait dû précéder celle
de La mise à mort des premiers nés d’Egypte. Sur ce point, il se pourrait que Cavallini ait
décidé du sujet de cette scène en restaurant cette partie du mur qui devait être en mauvais
état de conservation. Prenant alors une liberté par rapport à la suite chronologique du
texte, il aurait situé cet épisode en « introduction » à la suite de scènes de l’Exode pour le
rendre plus explicite à ses contemporains.
Au folio 43 est figurée La rencontre de Joseph et de ses frères à Dotân (Gen 37 :
17-20) (ill.36). C’est bien Joseph qui apparaît sur la gauche de l’image devant ses frères
qui, déjà en pleine discussion, complotent contre lui. Pourtant, personne ne s’est intéressé
230
White avait déjà indiqué que plusieurs dessins avaient été classés par hasard dans la série du Nouveau
Testament. Voir WHITE, 1992, p 41.
71
à la scène figurée dans le registre supérieur de l’image. On y voit à droite un homme
accroupi dirigeant sa main droite en direction de deux personnages, le regard dirigé vers
un troupeau de moutons qu’ils semblent garder. Nous savons qu’avant de retrouver ses
frères à Dotân, Joseph avait demandé son chemin à un homme (Gen 37 : 15-17). Il se
pourrait donc que l’image nous renseigne sur deux moments différents de la Genèse. En
haut de l’image était figuré Joseph demandant son chemin à un homme dans la campagne
et en bas La rencontre de Joseph et de ses frères à Dotân.
Le problème est tout aussi délicat dans les scènes néotestamentaires. De nombreux
tableaux sont encore à l’heure actuelle largement discutés. Au folio 94, on trouve une
image où l’on voit Paul prêchant dans une synagogue231
(ill.61). On y remarque, malgré
de larges pertes, le saint sans doute en discussion avec un jeune homme et esquissant un
geste de la main droite. Sur la gauche de l’image on distingue un groupe de personnages
devant des architectures qui semble attendre ou bien écouter le témoin du Christ. Ces
maigres indices rendent toute tentative d’identification extrêmement délicate. La solution
pourrait venir des travaux de Luba Eleen. Celle-ci a réussi à démontrer que la scène qui
précède le folio 94 pourrait bien figurer le Baptême de Paul (Actes 9 : 18). Malgré le
mauvais état de conservation de la peinture au moment des copies, elle remarque des
analogies entre cette image et le folio 119 illustrant Le baptême de la famille du geôlier
(Actes 16 : 33) qui se situent tous deux à l’extérieur et à proximité d’un cours d’eau,
suivant ainsi d’anciennes méthodes de représentation issues de l’Antiquité tardive232
. Si
Luba Eleen ne se trompe pas, il est fort possible d’identifier, en suivant le livre des Actes,
l’image du folio 94 comme étant La prédication de Saül à Damas (Actes 9 : 19-21). Le
saint semble se tenir devant la représentation d’une synagogue et tente de convaincre un
personnage que Jésus est bien le Fils de Dieu. A gauche, les individus représenteraient ces
nombreux curieux qui assistent stupéfaits aux prédications de Saül et dont font mention les
Actes.
D’une tout autre manière, le folio 103 du Codex Barberini illustre pour Waetzoldt
le moment où Le tribun se rend compte de la citoyenneté de Paul (Actes 22 : 22-29) alors
que Hetherington voit plutôt Le châtiment de Paul et Le capitaine libérant Paul (Actes
231
WAETZOLDT, 1964, p 60 et HETHERINGTON, 1979, p 101. 232
ELEEN, 1985, p 259.
72
22 : 28 -28 ; 23 : 23-32), enfin pour Eleen l’image montre Paul battu par les juifs233
(ill.70). Au centre de la composition, le saint est figuré couché et les bras tendu devant
lui. Derrière, deux personnages le fouettent avec des verges alors qu’à gauche un homme
et un enfant assistent calmement à la scène. Dans la scène qui précède, Paul est reçu à
Jérusalem (Actes 21 : 17) et celle qui la suit présente Le voyage pour Césarée (Actes 23 :
23-32). Il est donc fort probable que la scène du folio 103 se situe entre ces deux instants.
Les Saintes Ecritures nous rapportent que dans la ville de Jérusalem, le saint avait été
lourdement molesté par la foule avant d’être libéré par les soldats romains : « La ville
entière fut en effervescence, et le peuple accouru de toutes parts. On s’empara de Paul, on
se mit à le traîner hors du Temple (…). On cherchait à le mettre à mort, quand cet avis
parvint au tribun de la cohorte : « Tout Jérusalem est sens dessus dessous ! ». Aussitôt,
prenant avec lui des soldats et des centurions, il se précipita sur les manifestants (…) qui
cessèrent de frapper Paul » (Actes 21 : 30-32). Cependant, aucune partie de l’image ne
représente une foule en colère, ni même l’intervention de soldats. On le sait, Cavallini est
largement intervenu sur cette peinture qui devait, au moment de son intervention, être en
partie détruite. En suivant l’analyse de Luba Eleen, il est possible que la position du saint
couché pour recevoir la punition suive une iconographie de l’Antiquité tardive234
. Pour le
reste, le rapport entre texte et image reste difficilement exploitable. Eleen reste surprise
que le saint soit figuré à demi nu. Peut-être avait-on voulu, à une période ancienne,
marquer toute la violence de la foule envers Paul en le présentant les vêtements déchirés ?
Quoi qu’il en soit, l’iconographie de cette image est encore largement sujette à caution,
même si, en suivant le livre des Actes, on peut situer l’épisode d’une façon plus précise
qu’auparavant en proposant de l’identifier comme étant Paul battu par les juifs à
Jérusalem (Actes 21 : 30-32).
b) Questions sur l’iconographie de la façade
Dans les pages précédentes, nous avons relevé que l’articulation du programme de
la façade était complexe étant donné qu’elle présentait dans le registre supérieur une
Maiestas Domini et une Deesis à l’iconographie étonnante avec, de part et d’autre, la
présence de Pierre et Paul. Si l’historiographie s’est largement penchée sur le cycle du
233
ELEEN, 1985, p 256, fig 8. 234
Ibid, 1985, p 257.
73
XIVème siècle, elle est restée étrangement silencieuse au sujet du programme primitif. Le
chapitre consacré par Serena Romano et l’ouvrage de Tomeï sur Cavallini s’accordent
pour voir dans l’intervention du pape Jean XXII plus qu’une simple restauration. Cela
induit qu’il existait auparavant un programme que l’on avait peut-être suivi au XIVème
siècle. En 1635, un certain Torrigio, en analysant le programme de la façade de Saint-
Paul, voyait une fois de plus le travail de Cavallini tout en soulignant que le cycle avait été
élaboré à la fin du Vème siècle :
« Ancora fece la facciata di Mosaico della Basilica di S. Paolo, commenciata da
Innocentio III, assignativi scudi 490, e finita da Gregorio IX235
»
En admettant que le programme vienne bien du Vème siècle, peut-être élaboré sous
le pontificat de Félix III (483-492), il convient ici d’en comprendre la teneur. Pour ce
faire, il faut tout d’abord se pencher sur une autre réalisation de cette période, la façade de
Saint-Pierre.
La mosaïque réalisée sous le pontificat de Léon le Grand entre 423 et 448236
nous
est connue par de nombreux dessins. Le décor avait été de nombreuses fois restauré. Le
commentaire du pontificat de Serge Ier par le Liber Pontificalis fait remonter à la fin du
VIIème siècle la première restauration. Il ne s’agit que d’une simple hypothèse, mais il est
tout de même intéressant de remarquer que cette transformation est à peu près
contemporaine du concile de Constantinople (692) interdisant la représentation de
l’Agneau. La nouvelle iconographie serait alors un exemple remarquable de l’influence
d’un concile sur la création artistique de cette période237
. C’est à cette époque que le Christ
aurait été substitué à l’Agneau. Une autre campagne de restauration est connue sous le
pontificat d’Innocent III et une dernière sous Grégoire IX (1227-1241).
Les historiens s’accordent pour voir au folio 122 du Codex de Farfa, qui date du
XIème siècle et qui est conservé au Collège d’Eaton, la représentation la plus fidèle du
235
HETHERINGTON, 1979, p 108. Nous tenons à remercier le professeur Alessandro Tomeï de nous avoir
certifié de toute la valeur de cette source. 236
KESSLER, 1999, p 263. 237
Il faut toutefois être très prudent sur cette proposition car les exemples de non-observation d’un interdit
ne manquent pas.
74
décor du Vème siècle238
(Fig.28). Le programme nous montre l’Agneau dans un
médaillon au sommet du fronton, flanqué des bustes des Vivants : le lion ou le bœuf à
gauche, l’homme, le bœuf ou le lion et à droite l’aigle. En contrebas, sur les côtés
apparaissent des groupes supplémentaires que Kessler identifie comme des représentants
du novus populus Christianus en adoration devant le Seigneur alors que Yves Christe
s’oriente plutôt vers la figuration des vingt-quatre Vieillards de l’Apocalypse239
,
accompagnés selon Anne-Orange Poilpré de Pierre et Paul.
Pour cette dernière, la mosaïque de Saint-Pierre souligne l’importance de la
primauté du siège romain sur l’ensemble des évêchés. Il est vrai que le décor renforce
l’idée de l’importance institutionnelle de Rome par l’éminence de son fondateur, l’apôtre
le plus proche du Christ. Enfin, la présence de l’Agneau insiste sur le fait que Saint-Pierre
était la gardienne de l’orthodoxie en matière de liturgie et surtout pour l’eucharistie ;
l’expression rituelle de l’Eglise terrestre.
En ce qui concerne la façade de la basilique Saint-Paul, l’iconographie qui pouvait
se déployer à l’époque paléochrétienne est pour le moins difficile à appréhender. On peut
néanmoins supposer, en se fondant sur le programme de Saint-Pierre, que le cycle de
Saint-Paul présentait à la place du Christ en médaillon porté par six anges une figuration
de l’Agneau lui aussi inséré dans une imago cliptea. A sa droite pouvaient être illustrés,
comme sur le dessin d’Edimbourg, le bœuf et l’homme, et à sa gauche l’aigle et le lion.
Peut-être étaient-ils représentés à mi-corps, pourvus de deux ailes et d’un codex comme
sur la mosaïque de Saint-Pierre.
Au registre inférieur, la présence de certains personnages a fait l’objet de
nombreux débats. Par exemple, Hetherington propose que Paul en tant que saint patron de
l’Eglise devait être figuré à la place de saint Jean-Baptiste, à côté de Pierre240
. Mais
l’absence de toute documentation ne permet pas d’être certain de la présence de tous ces
personnages à la période tardo-antique. On peut déjà avancer l’hypothèse que n’est pas
représenté dans ce registre le cortège de Vieillards comme à Saint-Pierre, étant donné que
cette formule est déjà présente sur l’arcus maior de la basilique. En se fondant sur la
238
CHRISTE, 1996, p 75. CAILLET, Jean-Pierre., « Le décor monumental », dans RICHE (dir.)., L’Europe
de l’an mil, Paris, 2001, pp 240-241. POILPRE, 2003, p 137. 239
CHRISTE, 1996, p 75. 240
HETHERINGTON, 1979, p112.
75
proposition d’Hetherington, le cycle peut alors présenter de gauche à droite : saint Jean-
Baptiste, la Vierge Marie, saint Paul et saint Pierre.
Dans tous les cas, cette disposition des personnages, associée à la supposée
présence de l’Agneau, permet de « gommer » la présence de la Deesis au centre de la
composition. L’existence de ce thème à une date aussi haute était pour le moins
surprenante étant donné que la plus ancienne illustration connue de la Deesis se trouve sur
l’arcus maior du monastère du Mont Sinaï que l’on date généralement du VIème siècle241
.
On peut y découvrir l’Agneau dans un médaillon au sommet de l’arc, avec plus bas et à sa
droite le buste de la Vierge et à sa gauche le buste de saint Jean-Baptiste.
Cette hypothétique restitution amène à s’interroger sur le contexte d’élaboration et
sur la signification de ce décor. En 451, sur ordre du pape Léon Ier, se réunit le concile de
Chalcédoine. Celui-ci a pour but d’annuler les décisions du prétendu faux synode
d’Ephèse et de mettre un terme à la controverse eutychienne. Ce concile condamna le
monophysisme, doctrine selon laquelle Jésus-Christ n’aurait possédé qu’une seule nature
divine et n’aurait pas de nature humaine. La définition chalcédonienne, fondée sur la
formulation du pape Léon dans son Tome à Flavien et les lettres synodales de saint Cyrille
d’Alexandrie à Nestor, revint à affirmer la réalité d’ « un seul et même Christ Fils,
Seigneur, Monogène, sans confusion, sans mutation, sans division, sans répartition, la
différence de nature n’étant nullement supprimée par l’Union, mais plutôt les propriétés
de chacune étant sauvegardées et réunies en une seule personne et une seule
hypostase242
».
De fait, loin d’apporter une conclusion au problème soulevé par Eutychès, le
concile de Chalcédoine s’est trouvé ouvrir une longue crise qui remplit la fin du Vème
siècle. Il est vrai que dans le milieu oriental s’organisa rapidement une opposition anti-
chalcédonienne. Le monophysisme, sans jamais rallier l’unanimité, était tout même bien
présent en Egypte ou bien dans l’Orient Syrien. Rapidement s’est organisée une politique
d’intervention vigoureuse envers les récalcitrants. Toutefois, l’empereur Léon a cru devoir
revenir sur les décisions du concile de Chalcédoine, en consultant l’épiscopat à son sujet
(octobre 457) ; les réponses ont été en faveur de la fidélité au concile. L’empereur Zénon
241
Voir WEITZMANN, Kurt., « Introduction to the Mosaics and Monumental Paintings », dans The
Monastery of Saint Catherine at Mount Sinai. The Church and fortress of Justinian, Princeton, 1965, pp 11-
20. 242
MARROU, 1985, p 142.
76
l’Isaurien promulgua ensuite en 482 un édit d’union, Hénotikon, qui concluait par un appel
à l’unité autour du Symbole de Nicée considéré comme seule définition de la Foi.
Rapidement, l’Hénotique parut inadmissible aux chalcédoniens d’Egypte, de
Constantinople et d’Antioche. Mais surtout à Rome, le pape Félix III maintint la doctrine
de Léon Ier et condamna l’Hénotique243
. Ce serait alors dans une situation difficile
provoquant un schisme entre Rome et Constantinople qu’aurait été réalisé le décor de la
façade de Saint-Paul.
Il semble que la présence de l’Agneau accompagné des Vivants renvoie à
Apocalypse 5 : 6 dans lequel est décrit l’intronisation et l’Epiphanie glorieuse de
l’Agneau. Dans le registre inférieur, on trouve à la droite de l’Agneau saint Jean-Baptiste,
considéré par les Evangélistes comme le dernier prophète et celui qui précède et annonce
l’arrivée du Messie. A côté de lui, la représentation de la Vierge distingue celle qui sera la
mère de Jésus. Enfin, à la gauche de l’Agneau sont figurés les deux grands martyrs de
Rome, véritables modèles de vie ascétique, gardiens de l’orthodoxie, et qui ont assuré la
prédication de la parole du Christ chez les Juifs et les Gentils.
Alors que le message politique de la façade de Saint-Pierre témoignait du
militantisme de l’Eglise romaine pour la reconnaissance de sa primauté244
, sur le mur
pignon de l’autre grande basilique de Rome était donc commentée au registre supérieur la
nature Divine du Christ, et au registre inférieur se trouvaient des personnages rappelant sa
nature humaine ; les deux assemblées étant, selon les Chalcédoniens, inséparables.
2) Mode d’élaboration de l’image
a) Les scènes bibliques
Dans son ouvrage sur les Voies de la création en iconographie chrétienne, André
Grabar est revenu à plusieurs reprises sur la relation entre l’iconographie et le langage. Il a
alors démontré que l’on pouvait construire une image comme on structurait une phrase, en
utilisant et en combinant entre eux des éléments d’origines différentes. Au chapitre II de
son livre, il s’est longuement penché sur la définition des termes correspondant aux mots
et aux phrases d’une langue qui était employée dans l’art paléochrétien. Il a également
243
Sur la réception et l’opposition du concile de Chalcédoine, voir utilement GRILLMEIER, 1990. 244
POILPRE, 2003, p 141.
77
souligné que la part créative des artistes était en fait minime et qu’ils puisaient dans un
répertoire visuel déjà constitué, dont ils étaient certains qu’ils seraient reconnus par
tous245
.
C’est sur la base de ces remarques que nous tenterons de définir, au travers des
folios du Codex Barberini, les emprunts ou même les innovations des artistes de
l’Antiquité tardive qui ont travaillé à la basilique de Saint-Paul-hors-les-murs.
Nous débuterons cette démonstration par les emprunts des artistes à des éléments
courants depuis un long moment dans l’iconographie chrétienne. Dans la scène qui
représente Le péché originel (ill.19), on remarque que l’artiste a représenté Adam et Eve
juste avant qu’ils ne goûtent au fruit défendu. Et pourtant, l’homme et la femme sont
figurés de part et d’autre de l’Arbre de la Connaissance avec le serpent tentateur. Ce
schéma se retrouve au registre inférieur du sarcophage du préfet de la ville, Junius Bassus,
vers 359 et conservé dans les Grottes Vaticanes (Fig.29). Comme sur la peinture de Saint-
Paul, Adam est à gauche de l’Arbre sur lequel s’enroule le serpent et Eve à droite.
De la même manière, la peinture qui représente La rencontre d’Aaron et de Moïse
(ill.45) reprend également un schéma déjà élaboré dans la sculpture funéraire. L’artiste
place les protagonistes l’un en face de l’autre ce qui engendre une composition
pyramidale ; motif que l’on trouve dans le Baiser de Judas sur le sarcophage dit « Des
saints Simon et Jude Thaddée », daté de la fin du IVème siècle et aujourd’hui conservé à
Vérone dans l’église San Giovanni in Valle (Fig.30). Au folio 121, reconnu comme La
prédication de Paul à Jérusalem (ill.88), le saint au centre est figuré debout esquissant un
geste du bras droit. A droite et à gauche de Paul sont représentés de nombreux
personnages qui se placent avec le saint au premier plan de l’image. Cet arrangement est
assez conventionnel dans l’iconographie chrétienne puisqu’on le retrouve sur de
nombreuses scènes de la Traditio Legis. C’est en tout cas ce genre de langage qui est
exploité sur le sarcophage de Saint-Ambroise de Milan que l’on date de la fin du IVème
siècle. Au centre du registre est figuré le Christ debout sur un monticule qui remet la Loi à
Pierre. De part et d’autre de la figure centrale, les apôtres sont représentés au premier plan
les uns à côtés des autres devant des architectures (Fig.31).
A côté de ces premiers véritables poncifs, l’artiste exploite les Saintes Ecritures
pour illustrer des épisodes en rapport étroit avec le texte. Dans le tableau qui présente
Dieu en discussion avec Adam et Eve, l’image reconstituée par Ulrike Koenen nous
245
GRABAR, 1979, p 33.
78
dévoile quelques changements par rapport au folio 27 du Codex Barberini246
. L’un est de
taille, étant donné qu’Adam et Eve sont cette fois représentés derrière des frondaisons qui
ne figurent pas sur le croquis du XVIIème siècle (Fig.32). Ce détail qui peut paraître
minime est pourtant bien explicité dans la Genèse qui nous apprend :
« Ils entendirent le pas de Yahvé Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du
jour, et l’homme et la femme se cachèrent devant Yahvé Dieu parmi les arbres du
jardin. Yahvé Dieu appela l’homme : « Où es-tu ? » dit-il. « J’ai entendu ton pas
dans le jardin, répondit l’homme ; j’ai eu peur parce que je suis nu et je me suis
caché » » (Gen 3 : 8-10).
Si ces premières images témoignent d’emprunts à un mode d’élaboration plus ou
moins courant dans l’imagerie paléochrétienne, d’autres dénotent une certaine évolution
dans le langage formel.
Dans le tableau représentant Le sacrifice d’Isaac (ill.31), Abraham est figuré
l’arme au poing et engagé à frapper son fils. Celui-ci, sur un autel recouvert de bois, est
montré nu et à genoux, les mains attachées dans le dos et les cheveux retenus par un
bandeau247
. Le tout premier exemple de représentation d’Isaac à genoux sur du bois se
trouve sur une peinture du IIIème siècle dans la catacombe de Saint-Pierre-et-Saint-
Marcellin à Rome (Fig.33). Parfois, il est figuré sur un autel, un genou posé à terre et les
mains liées dans le dos comme sur un sarcophage conservé à Saint-Pierre du Vatican (fin
du IVème siècle) ou bien encore à genoux aux pieds du patriarche, les yeux couverts par
un bandage sur le sarcophage dit « de Leocadius » à Tarragone (début du Vème siècle)
(Fig.34). Face à ces observations, il semble que l’artiste de Saint-Paul ait intégré tous ces
éléments pour illustrer cet épisode. Par exemple, Mounier a reconnu la présence d’un
bandeau dans les cheveux d’Isaac, qui peut-être à l’origine devait couvrir les yeux de la
victime.
La scène du Rêve de Joseph, remise au jour par Ulrike Koenen, marque une étape
importante dans l’élaboration des peintures de Saint-Paul (Fig.3). Le rêve est ici traduit à
la droite de l’image, avec la représentation du premier et du deuxième rêve du patriarche.
Ce genre de cohabitation de plusieurs images dans le même tableau s’est déjà vu dans le
cubiculum B de la catacombe de la Via Latina à Rome qui date du IVème siècle, où est
246
KOENEN, 1995, p 109. 247
MOUNIER, 2000, p 17.
79
illustrée l’Ascension du prophète Elie avec le Bon pasteur (Fig.35). Alors que dans le
tableau de la catacombe les images sont associées du fait de leur complémentarité, la
scène de Saint-Paul commente d’une façon synthétique deux moments distincts de la
Genèse. Ces deux instants qui cohabitent dans la même peinture marquent une évolution
importante dans le langage figuratif des artistes de Saint-Paul aussi bien par rapport aux
autres peintures du programme qu’au regard du champ iconographique paléochrétien.
Il serait difficile d’allonger cette liste composée d’exemples isolés, mais qui
témoignent déjà d’une belle manière de l’assimilation et de l’évolution du langage
iconographique dans la basilique de Saint-Paul. Dans la plupart des cas, les schémas
devaient puiser dans un répertoire de formes répandues. Il est vrai que face à la complexité
du programme qui devait viser à développer de manière cohérente le message de l’Ancien
Testament et du livre des Actes, on avait peut-être eu recours alors à un système narratif
coutumier dans l’iconographie païenne, avec succession parfois très serrée d’épisodes en
rapport avec le texte. Dans La révélation de Paul, Eleen a reconnu de droite à gauche :
Saül qui reçoit la lettre du haut conseil, la révélation de saint Paul, et Paul conduit à
Damas248
; système que l’on peut retrouver dans La rencontre de Joseph et de ses frères à
Dotân où nous avons remarqué la juxtaposition de deux passages de la Genèse. Ce parti,
qui semble être ébauché à Saint-Paul, est beaucoup mieux développé dans les mosaïques
de la nef de Sainte-Marie-Majeure (432-440). L’un des tableaux y montre Abraham
recevant les trois anges, puis ordonnant à son épouse Sarah de leur apprêter le repas et
enfin servant lui-même ses hôtes attablés (Fig.36)249
.
Enfin, d’autres peintures se démarquent par des ambitions nouvelles. Plusieurs
schémas iconographiques sont rassemblés dans le Sacrifice d’Isaac et une nouvelle
syntaxe est élaborée dans le Rêve de Joseph. Pour autant, les multiples interventions sur
les peintures et la fidélité relative des croquis réalisés par les artistes du XVIIème siècle
limitent en partie notre champ d’étude. La solution ne pourra sans doute venir que par une
nouvelle étude des aquarelles du Codex Barberini. Dans cette perspective, les travaux
inaugurés par Ulrike Koenen nous semblent les plus pertinents. Ses études,
malheureusement cantonnées à quelques scènes de l’Ancien Testament, mériteraient de
248
ELEEN, 1985, fig 16. 249
Sur ce point voir utilement KINTZINGER, 1975, p 121 et SPAIN, 1979, pp 518-540. Sur les rapports
entre les mosaïques de Sainte-Marie-Majeure et la colonne Trajane : Voir BRENK, 1975, p 160 et
TRONZO, 2001, p 461.
80
s’étendre à l’ensemble du programme ; voie incontournable pour percevoir de nouvelles
traces d’une iconographie chrétienne.
b) le cycle de l’arc
Parmi ses nombreuses hypothèses, André Grabar avait soulevé l’idée que l’arcus
maior de Sainte-Marie-Majeure (Fig.39) présentait une organisation que l’on pouvait
retrouver dans les monuments impériaux250
. Sur la base d’une colonne élevée par Arcadius
en l’honneur de son père Théodose aux alentours de 400 (Fig.40), on peut distinguer de
bas en haut des thèmes bien particuliers. Dans la partie sommitale se trouve la
représentation de l’Empereur dans une attitude trônante et glorieuse, puis en-dessous est
figuré l’Hommage des peuples qu’il a sauvés, puis les campagnes militaires qu’il a menées
contre les ennemis. C’est peut-être ce même schéma qui aurait été élaboré sur l’arc de
Saint-Paul. Au sommet de l’arc était figuré un Christ en gloire accompagné des Evangiles,
dont la présence était une preuve de ce que le christianisme tenait pour sa vérité
fondatrice : l’Incarnation, la Résurrection et la présence de tout temps du Christ dans la
Création. Au registre médian était illustrée la vénération de l’Eglise universelle qu’il avait
sauvée par son sacrifice rédempteur. En bas étaient figurés les personnages qui avaient été
chargés de la prédication de la Parole du Sauveur chez les Juifs et les Gentils. Mais
surtout, ils étaient considérés comme les défenseurs de Rome et de toute la chrétienté
contre les derniers foyers païens et les déviations hérétiques251
.
250
GRABAR, 1979, pp 46-47. Pour connaître plus en détail le programme iconographique et sa
signification : Voir BRENK, 1975, pp 107-109. 251
Voir utilement MARCEL, 1972, pp 265-269.
81
Chapitre Second
Repères chronologiques et significations du programme
1) Retour sur certaines estimations
Etant donné que la basilique de Saint-Paul-hors-les-murs constitue, avec Saint-
Pierre, l’un des bâtiments majeurs de l’époque paléochrétienne, l’historiographie a depuis
longtemps tenté de déterminer avec plus ou moins d’exactitude la date de réalisation de
son décor. Dans un premier temps, Eugène Müntz, en étudiant les folios du Codex
Barberini avait déclaré que le cycle de l’Ancien Testament et quelques scènes tirées des
Actes « respiraient je ne sais quelle saveur antique »252
. A sa suite, Nibby avait proposé
de voir dans ces peintures une commande de Léon le Grand (440-461)253
. Dans son article
suivant, Müntz acceptait toujours l’idée que les dessins transmettaient une iconographie à
la « saveur » antique, tout en refusant de les dater aussi haut que les portraits des papes.
Par exemple, les scènes de la Genèse lui apparaissaient être antérieures à l’an mil254
.
Par la suite, les investigations avaient dégagé deux grands axes de recherches. La
plupart des chercheurs s’accordaient à penser que les peintures qui se déployaient sur le
mur de droite de la basilique présentaient une iconographie du Vème siècle sans doute
mise en place par Léon le Grand255
. Par contre, pour le mur de gauche, certains, en suivant
de façon surprenante une prétendue affirmation de Müntz256
, avaient vu un témoignage de
l’iconographie primitive dans les croquis du XVIIème siècle257
. D’autres, comme Josef
Garber, avaient refusé l’idée que la nef principale de la basilique de Saint-Paul ait été
décorée avec des scènes de la vie du saint titulaire étant donné que cet honneur n’avait pas
été accordé à saint Pierre dans sa basilique258
. Suivant la théorie de Garber, Erika Dinkler-
von Schubert avait même proposé qu’à l’origine, le mur ait reçu des peintures aux thèmes
christologiques, suivant dans ce cas le modèle de Saint-Pierre, remplacées ensuite par un
programme dédié à saint Paul259
. Cette hypothèse a été mise à mal par Tronzo qui avait
252
MUNTZ, 1875, p 112. 253
NIBBY, 1839-41, p 579. 254
MUNTZ, 1898, p 12. 255
GARBER, 1918, p 57, BRYUNE, 1934, p 13, DEMUS, 1949, p 258, WAETZOLDT, 1964, p 56,
HETHERINGTON, 1979, p 92, WHITE, 1992, p 50, ELEEN, 1985, p 252. 256
ELEEN, 1985, p 252. 257
WAETZOLDT, 1964, p 58, BUCHTAL, 1966, p 44, HETHERINGTON, 1979, p 92, ELEEN, 1985, p
252, WHITE, 1984, p 87. 258
GARBER, 1918, pp 27-28. 259
DINKLER-VON SCHUBERT, 1966, pp 82 et 90 note 29.
82
soulevé la possibilité d’un cycle présentant la vie de saint Pierre dans la basilique Vaticane
peint sous le pontificat de Léon le Grand, et ainsi par analogie supposé la présence des
peintures pauliniennes à Saint-Paul260
. Dans un autre registre, Belting avait proposé qu’un
premier programme ait été complètement réalisé en stuc, et transposé en peinture au
milieu du Vème siècle261
. Cette argumentation a été largement contredite par Herbert
Kessler. Pour lui, non seulement le cycle primitif était bien réalisé en peinture mais, en
plus, il se proposait de revenir une nouvelle fois sur sa datation. Pour ce faire, il rappelait
que Prudentius dans le Peristephanon avait écrit :
« Regia pompa loci est, princeps bonus has sacravit arces lusitque magnis
ambitum talentis262
»
Il se pourrait donc que celui-ci parle de la décoration qui pouvait orner les murs du
vaisseau médian de Saint-Paul263
. A cela, il ajoutait que saint Augustin, dans l’un de ses
sermons, faisait mention de scènes où l’on pouvait voir La lapidation de saint Etienne et
des scènes tirées des Actes des Apôtres où Paul était mis à l’honneur :
« Dulcissima pictura est haec ubi videtis sanctum Stephanum lapidari, videtis
Saulum lapidantium vestimenta servantem. Iste est Paulus apostolus… Bene
auditis vocem : Quid me persequeris ? Stratus es, erectus es : Prostatus
persecutor, erectus praedicator264 »
La confrontation de ces sources textuelles, dont on pouvait raisonnablement
admettre qu’elles étaient plus ou moins contemporaines, avait permis à Kessler de tendre
vers un programme élaboré aux environs de 400265
.
Le constat est tout aussi délicat en ce qui concerne la mosaïque de l’arcus maior.
Depuis de nombreuses années, les inscriptions qui se lisaient sur l’arc avaient donné lieu à
de nombreuses controverses. Ainsi celles qui se rapportaient à Théodose et Honorius ne se
trouvaient pas primitivement au sommet de l’arc, mais occupaient primitivement un
260
TRONZO, 1985, pp 97-98. 261
BELTING, 1977, p 155. 262
PRUDENTIUS, 1951, chap XII, 46. 263
Il remarque que Prudentius utilise le mot « ludere » pour signifier la peinture illusionniste ; verbe
qu’utilise Polin de Nole pour décrire les décors qu’il mettait en place dans les églises : « propterea uisium
nobis opus utile totis Felicis dominus pictura ludere sancta » (Carmen, 27, 581-582). Voir KESSLER, 1989,
p 122. 264
KESSLER, 1989, p 122 qui cite le sermon 314 alors qu’il s’agit du 315. Voir MIGNE, 1844-1890, PL 38,
col 1431. 265
KESSLER, 1999, p 532.
83
diptyque qui ornait l’abside266
. Pour certains, il était fort possible que Placidia ou bien
Léon le Grand ait, lors de la restauration, reproduit ou même introduit cette inscription au
sommet de l’arc267
. Pourtant, Uggeri avait déjà opté pour un décor réalisé sous Léon le
Grand, et daté celui-ci vers 450268
. Waetzoldt s’était plutôt dirigé vers une fourchette se
situant entre 440-450269
. Quoi qu’il en soit, il semblait établi que le décor fut mis en place
par Galla Placidia et le pape Léon270
, d’où le titulus :
« PLACIDIAE PIAMENS OPERIS DECUS HOMNE PATERNI GAUDET
PONTIFICIS STUDIO SPLENDERE LEONIS271
»
Cette tendance devait être remise en cause par Kessler dont les conclusions
s’orientent plutôt vers une œuvre réalisée sous Théodose (379-395) et Honorius (395-
423)272
.
Quel regard porter sur ces diverses propositions ? Il est possible qu’un premier
décor peint aux environs de 400 ait orné les murs latéraux du vaisseau médian, dont le
programme était sans doute fondé sur les livres des deux Testaments. Les épisodes de
l’Ancien Testament et ceux des Actes des Apôtres devaient former un ensemble
soigneusement distingué du point de vue topographique. Il devait s’organiser selon une
composition binaire, dont chaque cycle devait se conformer au texte narratif des Ecritures
suivant un sens de lecture allant de l’arcus maior à l’entrée. C’est peut-être à cette période
qu’avaient été élaborées des scènes comme Le Rêve de Joseph, Le pêché originel, ou bien
La rencontre de Pierre et Paul à Rome.
Ce ne serait alors que sous Léon le Grand que les cycles auraient été restaurés et
complétés par la galerie des papes. Sur ce point, bien des zones d’ombre subsistent.
Néanmoins, il y a de grandes chances pour que le personnage en charge du chantier ait
décidé de garder le même arrangement que ses prédécesseurs273
; organisation que l’on
266
KRAUTHEIMER, 1977, p 98. 267
MUNTZ, 1898, p 14. 268
UGGERI, 1827, p 114. CLAUSE penche vers la date de 441. Voir CLAUSE, 1893, p 306. 269
WAETZOLDT, 1961, p 20 et WAETZOLDT, 1964, p 56. 270
MATTHAIE, 1965, pp 55 et 59, BISCONTI, 1995, p 85, CHRISTE, 1996, p 7, ANDALORO,
ROMANO, 2000, p 39, TRONZO, 2001, p 481, POILPRE, 2003, p 127. 271
KRAUTHEIMER, 1977, p 99. 272
Nous renvoyons à la nouvelle contribution de Herbert Kessler dont l’article est toujours en cours
d’élaboration. Nous tenons tout particulièrement à remercier le professeur Kessler d’avoir bien voulu nous
livrer quelques conclusions de son futur article. 273
Nous ne nous accordons pas avec les conclusions de Herbert Kessler qui avait proposé qu’à cette période
avait été élaboré un arrangement complexe, permettant de suivre l’histoire sainte sans aller retour afin de
transcrire une histoire vraie et non plus typologique. KESSLER, 1994, p 373. Il est vrai que dans le cycle du
Nouveau Testament, on remarque des scènes placées aux hasards et qui ne suivent pas l’ordre chronologique
84
pouvait retrouver d’une certaine manière à Sainte-Marie-Majeure ou bien à Saint-
Apollinaire-le-Neuf à Ravenne274
. C’est plutôt sur la piste d’une modernisation
iconographique des images qu’il faudrait se tourner. Nous avions remarqué que, dans
certaines images, les artistes avaient puisé dans le large répertoire paléochrétien.
L’exemple du Sacrifice d’Isaac est à cet égard tout à fait remarquable. Dans d’autres, le
système narratif s’était pour le moins complexifié. Dans l’épisode de Meurtre d’Abel,
l’image développe à gauche le moment où Caïn va frapper son frère ; à droite est
représenté le jugement de Dieu après le délit de Caïn. Dans d’autres, comme La rencontre
de Joseph et des frères à Dotân, la scène semble cette fois coupée dans sa hauteur. Au
sommet, Joseph demande son chemin à des bergers et, en bas, il retrouve ses frères.
Enfin, quelques peintures ne présentaient qu’un seul sujet, comme par exemple La
lapidation de saint Etienne ou l’Assemblée à Jérusalem. S’agit-il d’hésitations de
l’imagier dans sa recherche d’un nouveau vocabulaire iconographique ? Sans doute
s’exprime ici une même volonté de cohérence que sur les scènes de Sainte-Marie-
Majeure ; traduction d’épisodes que les artistes de Saint-Paul essayent pourtant de
dépasser en ambition.
De la même manière, un retour s’impose sur le programme de l’arc. Dans les
pages précédentes, nous avons souligné les problèmes soulevés par la gravure de
Ciampani et les folios 139 et 140 du Codex Barberini, dont il est bien difficile de
reconnaître avec certitude celui qui représente le programme mis en place par Léon le
Grand. C’est sur une autre base de travail qu’il convient de se pencher maintenant. Sans
rien affirmer, on peut néanmoins supposer que le programme primitif mis en place aux
alentours de 400 doit dans ses grandes lignes être reproduit sur le croquis de Ciampani
(ill.101). Nous avons remarqué que les Vivants sur la gravure ne sont pas pourvus de
codex. Ce schéma s’est retrouvé dans des compositions contemporaines de Saint-Paul ;
citons par exemple la représentation du Tétramorphe dans l’abside de Sainte-Pudentienne
(Fig.37) et sur la porte de Sainte-Sabine (Fig.38).
En suivant la théorie d’Anne-Orange Poilpré, il se peut que les folios 139 et 140 du
Codex de la Bibliothèque Vaticane traduisent bien une iconographie du Vème siècle
(ill.102) ; époque à laquelle on ajoute le diptyque sur le sommet de l’arc et on transforme
légèrement l’iconographie, comme en témoigne l’ajout des livres aux Vivants. C’est ce
des textes. Il semblerait bien que ce désordre soit le fait de Cavallini et de son atelier. Voir WAETZOLDT,
1964, p 59 et ELEEN, 1985, p 253. 274
ELEEN, 1985, pp 254-255.
85
schéma, que l’on retrouve sur la façade de Saint-Pierre et peut-être plus tard sur celle de
Saint-Paul.
2) Message du décor
Quel peut-être le message du programme primitif de Saint-Paul ? En nous aidant
du relevé de Ciampani, il apparaît que le décor originel de l’arcus maior présente une
Maiestas Domini en ligne, avec sans doute le cortège des vingt-quatre Vieillards divisés
en deux groupes, portant des couronnes. Au registre inférieur, aux retombées de l’arc,
Pierre et Paul lèvent la main dans un geste d’acclamation en direction du Sauveur.
Au sommet de l’arc, autour du médaillon du Christ, se déploie le Tétramorphe. Les
créatures ne tiennent ni rouleau ni codex. Il semble que ce genre de représentation
corresponde à une interprétation littéraire des Vivants comme personnification des textes
des Evangiles plutôt que les Evangélistes eux-mêmes. Ambroise a discuté du
rapprochement des animaux avec le contenu de chacun des récits ainsi que l’unité qu’ils
partagent avec le Christ :
« Beaucoup cependant pensent que c’est Notre Seigneur qui, dans les quatre
évangiles, est figuré par les symboles des quatre animaux. C’est Lui l’homme, Lui
le lion, Lui le taureau, Lui l’aigle ; l’homme puisqu’il né de Marie ; le lion, parce
qu’Il est fort, le taureau, parce qu’Il est résurrection. Or, les traits des animaux
sont dessinés dans chaque livre de telle sorte que le contenu de chacun s’accorde
avec leur caractère merveilleux. Sans doute, tout cela se rencontre dans tous ces
livres ; et pourtant dans chacun d’eux il y a comme une plénitude de telle ou telle
caractéristique. L’un a raconté plus au long l’origine humaine et formé la moralité
de l’homme par des préceptes plus abondants ; un autre commence par exprimer
la puissance divine de ce Roi fils de Roi, force de force, vérité de vérité, dont les
ressources vitales ont défié la mort ; le troisième prélude par un sacrifice
sacerdotal et s’étend plus abondamment sur l’immolation même du taureau ; le
quatrième a détaillé plus que les autres les prodigues de la résurrection divine.
« Tous ne sont qu’un, et Il est unique en tous, comme on vient de le lire ; Il ne
varie pas l’un de l’un à l’autre, mais Il est vrai chez tous » »275
.
275
AMBROISE DE MILAN., Traité sur l’évangile de saint Luc, Prologue 8. Voir POILPRE, 2003, pp 99-
100.
86
Il se peut que l’iconographie de l’arc de Saint-Paul rende avec fidélité cette
complémentarité des Evangiles. A Saint-Paul, cette vérité se concentre de manière
immédiate autour de la figure du Christ pourvu d’un nimbe radié et d’une croix à longue
hampe sur l’épaule gauche. Selon Yves Christe, il ne fait pas de doute que ce genre de
représentation renvoie au Christ ressuscité dont le visage resplendit comme le Soleil276
et
que l’on retrouve dans les visions de Jean :
« Sa tête, avec ses cheveux blancs, est comme de la laine blanche, comme de la
neige, ses yeux comme yeux comme une flamme ardente (…) et son visage, c’est
comme le soleil qui brille dans tout son éclat ». (Ap 1 : 12-20)
A cette première représentation du Christ et des Vivants est ajoutée la présence des
Anciens issus du chapitre quatre de l’Apocalypse :
« Et chaque fois que les Vivants offrent gloire, honneur et action de grâces à celui
qui siège sur le trône et qui vit dans les siècles et les siècles, les vingt-quatre
Vieillards se prosternent devant Celui qui siège sur le trône pour adorer celui qui
vit dans les siècles des siècles ; ils lancent leurs couronnes devant le trône en
disant : « Tu es digne, ô notre Seigneur et Dieu (…) » ». (Ap 4 : 9-11)
Les Anciens sont présentés au-dessus de Pierre avec la tête voilée alors qu’ils ont
la tête nue au-dessus de Paul. Cette figuration renvoie à la représentation de l’Ancien et
du Nouveau Testament dans la personnification des douze apôtres et prophètes et
patriarches277
. Ce procédé singulier se trouve également sous une forme littéraire dans le
commentaire de l’Apocalypse de Victorin de Petau278
:
« Les vingt-quatre vieillards assis avec leurs vingt-quatre trônes sont les livres des
Prophètes et de la Loi, qui rapportent les témoignages sur le jugement. D’autres
part, il y a vingt-quatre pères : douze apôtres et douze patriarches 279
».
276
WAETZOLDT, 1961, p 23 et CHRISTE, 1996, p 73. 277
WAETZOLDT, 1961, p 22, CHRISTE, 1996, p 73. 278
Ce texte écrit vers 300 en Pannonie, dans le contexte des persécutions de Dioclétien, a ensuite été corrigé
par saint Jérôme en 398, après la paix de l’Eglise. Comme tous les commentateurs paléochrétiens et
médiévaux de l’Apocalypse interprètent le texte de Jean comme une succession de récapitulation de
l’histoire sacrée, depuis le temps des patriarches jusqu’au temps futur de l’Eglise et à la Parousie, la
correction de Jérôme est emprunte d’une autre influence, celle de Ticonius, donastique d’Afrique du Nord à
la fin du IVème siècle. Son œuvre rédigée vers 385, est perdue mais son influence permanente pour grand
nombre d’auteurs jusqu’à l’époque romane permet d’en connaître les principales orientations. Voir
CHRISTE, 1996, pp 21-22. 279
VICTORIN DE POETOVIO, Sur l’Apocalypse, traduction française par DULAEY, Paris, 1997, IV, 10.
Voir POILPRE, 2003, p 119. Voir également KESSLER, 1994, p 371 qui avait déjà remarqué cette
correspondance.
87
C’est donc une image allégorique de l’Ecclesia ex Judaeis et de l’Ecclesia ex
Gentibus figurées au-dessus de leur apôtre respectif qui offre au Christ l’aurum oblicatum
réservé au perpétuel vainqueur280
. Debout, les mains sous le pallium ils s’avancent avec
révérence de chaque côté de l’arc tendant au Seigneur une couronne d’or.
Ainsi, il se peut que le décor de l’arc inaugure les tempora novissima, le Règne
définitif du Christ et de l’Eglise. L’illustration du Tétramorphe renvoie ici aux textes
comme fondations de l’Eglise qui exprime un point dogmatique central : l’humanité, la
royauté, le sacrifice et la résurrection du Christ, figurés dans le médaillon central. Cette
réunion des Evangiles et d’un Christ, vainqueur recevant l’hommage du cortège des
Anciens est une sorte de récapitulation des fondements sacrés et prophétiques de l’Eglise,
de son existence éternelle à travers tous les temps de l’histoire vétéro- et néotestamentaire.
Elle exprime également, comme le relève Kessler, une expression symbolique de la
proclamation de l’Eglise universelle281
. Enfin, au registre inférieur, se trouvent représentés
Paul qui a conduit les Gentils à l’Eglise chrétienne et Pierre qui s’est chargé de donner la
bonne parole au peuple juif. C’est par leur action conjointe que l’Eglise s’est unifiée et
marquait dorénavant sa présence dans les temps actuels et futurs.
Ces dernières hypothèses renvoient immédiatement à l’œuvre de Galla Placidia et
de Léon le Grand. Anne-Orange Poilpré a récemment proposé que le décor ait été
constitué de plusieurs formulations iconographiques inédites. La première, et la plus
importante, est l’introduction de codices à côté du Tétramorphe. Selon elle, il est possible
que la signification des personnages se modifie pour évoluer du texte évangélique vers
l’auteur. Pour autant, elle écarte l’idée d’une rupture entre le « type de Vivant-Evangile et
un autre, celui du Vivant-évangéliste282
». L’iconographie de l’arc de Saint-Paul marque
donc la volonté d’une synthèse entre le contenu des livres et les auteurs. Ainsi, en ce
milieu du Vème siècle, le sens du Tétramorphe connaît une nouvelle évolution par
laquelle le texte et l’auteur fusionnent. La question reste plus problématique en ce qui
concerne la présence du cortège d’Anciens en-dessous de la Maiestas Domini. Pour
Anne-Orange Poilpré, il s’agit là aussi d’un schéma nouveau dans l’art paléochrétien. Au
stade actuel de nos connaissances, il est probable que ce système ait été mis au point à une
280
Christe propose que cette attitude se rapproche de la figuration des sénateurs qui, sur la colonne
d’Arcadius au troisième registre, viennent rendre hommage aux deux empereurs victorieux. Voir CHRISTE,
1996, p 73. 281
KESSLER, 1994, p 371. 282
POILPRE, 2003, p 130.
88
époque antérieure à celle de Léon le Grand et qu’ici, les artistes n’aient voulu en fait qu’en
moderniser l’iconographie. C’est peut-être le contexte politique de l’époque qui a modifié
ici le sens de ces personnages. Effectivement, et en suivant la thèse formulée par Anne-
Orange Poilpré, il semble que le programme ait été réalisé à la suite des tensions soulevées
par le concile de Chalcédoine. Selon elle, ce décor marque la volonté de l’épiscopat
romain de voir reconnaître sa primauté. Pour ce faire, elle en date l’élaboration après
457283
. Cette hypothèse, quoique séduisante, doit être néanmoins nuancée. En effet, la
plupart des spécialistes qui ont travaillé sur l’arc de Saint-Paul et qui y voient une œuvre
du pape Léon, le datent entre 440-450. Et n’oublions pas, en suivant le témoignage du
Liber, que l’intervention fait suite à un sinistre en 441. A notre avis, si le programme de
Saint-Pierre tend à véhiculer un message politique de Léon, il convient peut-être de garder
une certaine distance quant au message appréhendé par Galla Placidia et Léon Ier sur un
décor antérieur de quelques années à cette crise institutionnelle et politique.
Malgré les nombreuses incertitudes sur le programme de l’arc, il ne fait pas de
doute que celui-ci tient une place prépondérante au regard de la structure du bâtiment en
tant que véritable passage entre le quadratum populi et l’espace réservé à l’eucharistie284
.
Au-delà de ce point de jonction capital, il semble que l’arc entretienne un rapport tout
particulier avec l’ensemble du programme. En effet, il doit en être la clef ; véritable point
focal de tout l’édifice servant de prologue aux histoires du vaisseau médian285
.
Sur ce point seul Herbert Kessler s’est risqué à vraiment interpréter le message de
cycle. Pour lui, les peintures expriment l’Alliance de Dieu avec le peuple élu. Le cycle
commence par des épisodes qui commentent le contrat entre Dieu et Israël ; thème qui
s’achève avec le tableau du Songe de Jacob (ill.33). A droite de l’image, on remarque un
personnage en train de répandre de l’huile sur la pierre qui lui a servi de chevet. Cette
onction par Jacob de la pierre de Béthel marque une étape nouvelle dans le destin d’Israël
étant donné que Dieu lui concède un territoire propre286
. Au registre inférieur est illustré le
thème de la rencontre des Juifs et des Gentils figuré par l’histoire de Joseph qui se termine
en Egypte et par des scènes représentant l’histoire de Moïse. Celle-ci commence avec
Moïse et le buisson ardent, le Miracle du serpent et La rencontre de Moïse et Aaron. Pour
Kessler, ces épisodes marquent le renouveau de la Loi d’Abraham, où Moïse a le pouvoir
283
POILPRE, 2003, pp 140-142. 284
Ibid, 2003, p 136. 285
KESSLER, 1985, p 371 et TRONZO, 2001, p 480. 286
KESSLER, 1985, p 372.
89
de réaliser des miracles et reçoit l’autorité de Dieu pour libérer son peuple287
. Cette
confrontation se retrouve sur le mur opposé, étant donné que le programme déploie là des
épisodes de la Vie de saint Etienne. L’auteur indique que des peintures comme
L’Institution des sept (Actes 6 : 1-5) et Saint Etienne chez le haut conseil (Actes 6 : 12-15)
marquent la volonté du concepteur du programme de Saint-Paul d’établir une continuité
entre le cycle vétérotestamentaire et le programme néotestamentaire. C’est à partir de
l’image qui représente La lapidation de saint Etienne (Actes 7 : 58-60) que débute le
schisme entre les Juifs et les Gentils. Cette séparation se retrouve ensuite dans des scènes
comme Paul et Barnabé prêchant à Iconium (Actes 14 : 4) et se termine par la scène de
La lapidation de Paul à Lystra (Actes 14 : 19).
Dans le tableau suivant, où figure l’Assemblée des Apôtres à Jérusalem (Actes 15 :
6), débute l’évangélisation des Gentils. Par la suite, les scènes suivent le ministère de Paul
à Antioche (ou bien à Athènes) et s’achèvent sur la rencontre de Pierre à Rome. H. Kessler
a tenté de prouver que la superposition sur deux registres permettait d’établir des liens
typologiques entre les scènes. Par exemple, alors qu’au registre supérieur du mur
septentrional se déploient Le pêché originel (Gen 3 : 6-7) et Adam et Eve chassés du
Paradis (Gen 3 : 24), juste en-dessous, on trouve Joseph faussement accusé par ses frères
et même mis en prison288
. De même, au folio 41, le personnage le doigt tendu vers le ciel
représenté derrière le patriarche endormi est une préfiguration de l’Adoration des
vieillards de l’arc289
. Enfin, en suivant le livre de l’Exode, Kessler remarque que le texte
parle de dix plaies alors que l’Apocalypse n’en exprime que sept. Pour lui l’artiste de
Saint-Paul a choisi le nombre des plaies en fonction de l’Apocalypse290
.
Certaines des conclusions proposées par Herbert Kessler ont été réfutées. Dans son
étude sur le Rêve de Joseph, Ulrike Koenen a démontré que le personnage derrière le
patriarche au folio 41 (ill.34) n’existait pas à la période paléochrétienne291
. Cette remarque
a son importance, étant donné que Kessler raisonne sur la base des dessins du Codex
Barberini qui transcrivent des images largement transformées et dont il n’est pas certain
287
KESSLER, 1985, p 372. 288
Ibid, 1985, p 373. 289
Ibid,1985, p 375. 290
Ibid, 1985, p 376. 291
KOENEN, 1992, pp 182-194.
90
que le dernier état reprenne véritablement ce qui pouvait se voir sur les murs292
. A ces
premières objections, ajoutons que la typologie observée par Kessler entre l’histoire de la
Création et l’histoire de Joseph n’est pas évidente. Pour nous, le programme constitue une
grande phrase dont l’introduction est l’arcus maior. Sur les deux registres du mur nord
nous est exposé linéairement le livre de l’Ancien Testament. Le cycle reprend alors sur le
mur opposé, avec ces « scènes-tampons » qu’a justement remarquées Kessler, pour
continuer peut-être en suivant chronologiquement le texte des Actes, aux registres
supérieur et inférieur jusqu’à l’entrée.
Néanmoins, il ne fait pas de doute que certaines images du cycle renvoient par
écho à des peintures « jumelles » sur le mur opposé. Par exemple, sur le mur septentrional
est représenté La rencontre de Moïse et Aaron, alors que l’image qui commente La
rencontre de Pierre et Paul se trouve sur la partie méridionale. Pour Kessler, le folio 51
souligne avec force la rencontre entre les Juifs et les Gentils et marque la complicité des
deux protagonistes pour libérer le peuple d’Israël. C’est le même schéma qui est employé
au folio 128 où l’apôtre des Juifs et des Gentils rassemble ses forces pour établir
l’unification de l’Eglise293
.
Ces dernières observations nous amènent tout naturellement à reconsidérer le
message qui se déploie dans la nef. Sur ce point, le découpage réalisé par Kessler est
semble t-il tout à fait pertinent. L’arc supporte l’idée de l’installation et de l’unification de
l’Eglise sous un Christ-roi. C’est l’histoire de cette unification qui est racontée sur les
murs. Pour autant, nous avons remarqué qu’au folio 121 l’imagier de la basilique a repris,
pour représenter saint Paul, la même figuration employée par les sculpteurs paléochrétiens
pour représenter le Christ enseignant entouré de ses apôtres. Ce genre de détail se retrouve
dans la scène où Paul ressuscite Eutychus (Actes 20 : 10-12) (ill.65) ou encore dans
l’image qui commente La Guérison du paralysé à Lystra (Actes 14 : 8-10) (ill.82). Il
292
Nous avions déjà remarqué dans nos pages précédentes que Kessler pensait que les artistes de Saint-Paul
n’avaient pas suivi l’ordre chronologique du texte dans certaine partie du programme et particulièrement
dans les scènes du Nouveau Testament pour éviter au spectateur de réaliser un aller retour. On se demande
alors pourquoi ce n’est pas le même système qui a été choisi sur les peintures vétérotestamentaire ? Et
pourquoi se système ne s’est pas répercuté sur d’autres cycles plus tardifs ? Il semble en tous cas certain que
la conception linéaire prévalait à cette période. Voir BASCHET, Jérôme., « Logique narrative, nœuds
thématiques et localisation des peintures murales. Remarques sur un livre récent et sur un cas célèbre de
boustrophédon » dans L’emplacement et la fonction des images dans la peinture murale du Moyen
Age :Actes du 5ème
séminaire International d’Art Mural, Saint-Savin, 16-18 Septembre 1992, cahier n°2,
Saint-Savin, 1992 pp 103-195 et spécialement p 104. 293
KESSLER, 1999, p 536.
91
semble ici que Paul manifeste des capacités à l’égal de celle du Christ294
. En considérant
le contexte de production du programme que l’on peut dater de la fin du IVème siècle, il
se peut qu’à la signification découverte par Kessler s’en ajoute une autre, plus implicite.
Dans l’édifice construit pour rallier à la foi chrétienne les derniers foyers païens, le
programme peut exprimer ce passage de saint Paul dans sa Première Epître aux
Corinthiens :
« Montrez-vous mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ »
(Cor 11 : 1).
De la même manière, les scènes vétérotestamentaire mettent en valeur la foi
exemplaire des patriarches ; vertu également explicitée par saint Paul dans son Epître aux
Hébreux :
« Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de
Caïn ; aussi fut-il reconnu comme juste, Dieu ayant rendu témoignage à ses dons,
et par elle aussi, bien que mort, il en parle encore. (…). Par la foi, Noé divinement
avertit de ce qui n’était pas encore visible, saisi d’une crainte religieuse,
construisit une arche pour sauver sa famille. Par la foi, il condamna le monde et il
devint l’héritier de la justice qui s’obtient par la foi. (…) Par la foi, Abraham mis
à l’épreuve a offert Isaac, et c’est son fils unique qu’il offrait en sacrifice, lui qui
était le dépositaire des promesses, lui à qui il avait dit : « C’est par Isaac que tu
auras une postérité ». Dieu, pensait-il, est capable même de ressusciter les
morts ; c’est pour cela qu’il recouvrera son fils, et ce fut un signe. (…) Par la foi,
Isaac donna à Jacob et à Esaü des bénédictions assurant l’avenir. (…) Par la foi,
il (Moïse) célébra la Pâques et fit l’aspersion du sang, afin que l’Exterminateur ne
touchât point leurs premiers-nés» (Héb : 11 : 1-28).
Comme nous l’avons vu, la mosaïque de l’arc renferme l’espoir eschatologique qui
va installer le Christ roi et prêtre ; décor qui évoque déjà le triomphe de la Foi nouvelle
dans la plus vieille capitale du monde. Sur les murs latéraux, le décor commente l’histoire
de l’unification de l’Eglise tout en célébrant le saint auquel est dédié la basilique.
A la gauche du Christ est illustré le début de l’histoire des peuples. Après avoir
opposé aux bontés du Dieu créateur les infidélités de l’Homme pécheur, le récit
294
On retrouve la même signification pour Pierre dans la sculpture funéraire. Voir CAILLET, 1990, pp 66-
67.
92
développe, au travers de l’histoire des Patriarches l’évolution des relations entre Dieu et
son peuple. C’est pendant cette pérégrination qu’ont été jetées les bases des principales
vertus de la foi chrétienne, dont Dieu a reconnu la valeur.
A la droite du Christ se trouve évoqué le difficile chemin de l’unification de
l’Eglise. Mais surtout, ce cycle figure l’histoire d’un homme d’abord dans l’erreur et qui
par la suite a connu la révélation du Christ. Son itinéraire l’a conduit à réunir toute les
Nations sous la bannière du Seigneur. Pour mener à bien cette mission, il a traversé de la
même manière que Jésus de nombreuses épreuves pour prodiguer la bonne parole. Ce
destin parallèle est particulièrement valorisé par les pouvoirs dont use le saint pour asseoir
son autorité et marquer la véracité de ces propos. Enfin, ce programme se conclut d’une
façon magistrale par une image qui résume la teneur de l’intégralité du programme. En
effet, la scène qui figure la Rencontre de Pierre et Paul marque selon Bisconti un retour
du thème de la Concordia Apostolorum ; instrument de la renovatio Imperii, qui constitue
un véritable témoignage de l’entourage impérial pour encourager les derniers foyers
païens à se convertir au christianisme295
.
295
BISCONTI, 1995, p 88.
93
CONCLUSION
Au terme de ce périlleux parcours, on peut sans risque avancer l’idée que les
documents aujourd’hui en notre possession nous donnent un ensemble assez représentatif
du programme qui a pu exister dans la basilique Saint-Paul-hors-les-murs. Mais les
questions sur celui-ci restent nombreuses. Il est aujourd’hui certain qu’avait été mis en
place pendant l’Antiquité tardive un décor de peintures et de mosaïques qui ornaient les
composantes spatiales majeures de l’édifice. En ce qui concerne les peintures qui se
trouvaient sur les murs latéraux de la nef, la littérature s’accorde à penser que les cycles
avaient été élaborés aux alentours de 400, sous le règne d’Honorius. Il est également établi
que ces programmes prenaient leurs sources dans les livres de l’Ancien Testament et des
Actes des Apôtres. Ces cycles narratifs étaient composés, sur chacun des murs, de deux
registres juxtaposés, suivant un sens de lecture qui partait de l’arcus maior jusqu’à
l’entrée, de gauche à droite pour les scènes vétérotestamentaire et de droite à gauche pour
les tableaux tirés du livre du Nouveau Testament. Enfin, les tableaux devaient adopter un
format carré et étaient séparés les uns des autres par des colonnettes tridimensionnelles en
stuc.
A la suite de l’incendie, les épisodes ont été restaurés sous le pontificat de Léon
Ier. Le pape, sans aucun doute, apporta une contribution nouvelle en ajoutant au-dessous
des scènes bibliques et au-dessus de la corniche une galerie de portraits de ses
prédécesseurs. Cette série, qui suivait un sens chronologique, commençait avec Pierre et
courait jusqu’à Boniface Ier. Chaque portrait présentait dans un médaillon circulaire un
portrait d’un personnage en buste. A la fin du Vème siècle, il est fort possible que l’abside
ait été décorée avec le thème de la Traditio Legis suivant sur ce point l’iconographie qui
se déployait dans l’abside de Saint-Pierre.
Par la suite, pendant le haut Moyen Age, le programme fut complété par
l’adjonction au revers de façade de peintures représentant les Evangélistes et des épisodes
de la Passion du Christ. Puis au XIIIème siècle, sous le pontificat d’Innocent III et
Honorius III, fut réalisé un nouveau décor sur le cul-de-four de l’abside. Aux alentours de
1277 jusqu’à 1279 fut entreprise sous l’abbatiat de Jean VI et avec l’aide de Nicolas III,
une première campagne de restauration sur les scènes néotestamentaires. C’est pendant
cette même période que fut peinte la seconde galerie de portraits de papes sur les
écoinçons des colonnes. Puis de 1282 à 1285, Cavallini intervint sur les tableaux du cycle
94
de l’Ancien Testament pendant qu’Arnolfo di Cambio travaillait au ciborium. Enfin, c’est
sous le pontificat de Jean XXII que fut ouvert un nouveau chantier sur la façade et son
revers. Il ne fait pas de doute que le programme présentait sur la façade au registre
supérieur une Maiestas Domini et au registre inférieur de gauche à droite la représentation
de saint Paul, de la Vierge, de saint Jean-Baptiste et de saint Pierre. Le problème est plus
aigu pour le revers de façade. Nous ne sommes absolument pas certain que le personnage
en charge du chantier avait demandé à l’artiste de reprendre l’intégralité du cycle, s’il
n’est intervenu que ponctuellement sur certains épisodes du programme.
Ce genre de débat se retrouve tout particulièrement pour la mosaïque de l’arcus
maior. Pour certains, cette œuvre aurait été réalisée par Léon le Grand, peut-être à cause
du sinistre de 441, ou bien après le concile de Chalcédoine (451) qui avait engendré une
grave crise institutionnelle. Pour d’autres, il ne fait pas de doute que le programme fut mis
en place à la même période que les cycles bibliques, c'est-à-dire sous le règne de Théodose
et terminé par Honorius. Ce problème, d’une importance capitale, engendre plusieurs sens
de lecture en fonction de son contexte de création. Marque t-il l’intronisation de l’Eglise
universelle pour tous les temps ? Ou alors est-il une expression de l’Eglise romaine
militante en quête de la reconnaissance de sa primauté ? Pour notre part, nous retiendrons
seulement qu’il serait pour le moins étonnant que ce point focal de l’édifice n’ait pas été
décoré à la même période que les murs latéraux du vaisseau médian.
Autre source de discussions, et qui occupe encore aujourd’hui une partie de
l’historiographie italienne, l’intervention de Pietro Cavallini sur le programme
néotestamentaire, la deuxième série de portraits pontificaux et sur la façade. Nous l’avons
vu, il est tout à fait possible que l’artiste se soit entouré d’un atelier, ou bien ait travaillé
sous la direction d’un autre artiste sur le mur septentrional. Ce serait ce même atelier, ou
sous la direction du même maître, qu’aurait été réalisé le portrait d’Anaclet et également le
reste de la seconde galerie des portraits des pontifes. Le problème se pose aussi pour la
mosaïque de la façade. Si l’intervention de Lello da Orvieto est envisagée, il convient de
ne pas écarter l’idée que celui-ci ait peut-être travaillé sur des cartons de Cavallini, ou
alors ce serait un artiste indépendant, travaillant suivant les mêmes schémas que le
désormais grand artiste romain qui est venu se joindre à l’énorme chantier de la basilique
de la voie d’Ostie.
Pour le reste, les hypothèses que nous avons soulevées en ce qui concerne le
programme primitif de la façade sont bien évidemment à prendre avec précaution. Elles
95
constituent une première étude qui, nous l’espérons, en appellera d’autres. C’est d’ailleurs
sur ce point et sans doute sur beaucoup d’autres que se situent les limites de la présente
étude. La solution ne peut venir que d’une nouvelle étude des aquarelles, des dessins et
des gravures qui commentent toutes les parties du programme iconographique et par un
décryptage complet des textes patristiques et exégétiques de l’époque. Mais surtout, il
faudrait confronter davantage encore cet immense programme avec d’autres productions
de l’Antiquité tardive. C’est donc une étude d’une autre envergure qu’il faudrait réaliser
pour appréhender et comprendre la signification du programme iconographique tardo-
antique de la basilique Saint-Paul-hors-les-murs.
96
BIBLIOGRAPHIE
A) SOURCES
▪ SOURCES TEXTUELLES :
- ADRIEN Ier., « Lettre à Charlemagne, en 791 », dans CLAUSE, Gustave., Les
Monuments du christianisme au Moyen Age, Basiliques et mosaïques chrétiennes, tome II,
Paris, 1893, p 306.
- AMBROISE DE MILAN., Traité sur l’évangile de saint Luc, ed. et trad. GALLETIER,
Edouard, 2vol., Paris, 1971.
- La Bible, traduction française sous la direction de l’Ecole Française de Jérusalem, Paris,
1998.
- BOVON, François., GEOLTRAIN, Pierre (ed.)., Écrits apocryphes chrétiens, Paris, 1997.
- GIUSTINO, Giuseppe., « Lettre à un anonyme, s.d. » (Vatican, Bibliothèque, Vat. Lat.
9672, folio 45 r), dans TOMEI, Alessandro., Pietro Cavallini, Milan, 2000, p 141.
- PAULIN DE NOLE., « Poème XXVII », dans QUASTEN Johannes, BUGHARDT,
Walter, LAWLER Thomas, (ed.)., The Poems of ST. Paulinus of Nola, traduction anglaise
par WALSH,P, New-York, 1975, pp 270-294.
- PRUDENTIUS, Aurelius., Dittochaeon, Paris, 1951.
- PRUDENTIUS, Aurelius., Peristephanon Liber, Paris, 1951.
- SAINT AUGUSTIN., « Sermo CCCXV. In solemnitate Stephani martyris », dans
MIGNE, Jacques-Paul., Patrologia Cursus Completus, Series Latina, vol 38, Paris, 1844-
1890, col 1434.
- VALENTINIEN II, THẺODOSE, ARCADIUS., « Lettre à Sallustius, après août 383 »,
dans CHASTAGNOL, André., « Sur quelques documents relatifs à la Basilique de Saint
Paul hors les murs », dans Mélanges d’Archéologie et d’histoire offerts à André Piganiol,
vol I, Paris, 1966, pp 434-435.
- VICTORIN DE POETOVIO., Sur l’Apocalypse, traduction française par DULAEY, Paris,
1997.
- VOGEL, Cyrille (ed.)., Le Liber Pontificalis, 3 vol, Paris, 1981.
97
▪SOURCES ICONOGRAPHIQUES :
▪ Pour la façade :
- Anonyme, Façade de Saint-Paul-hors-les-murs, XVII
ème siècle, National Gallery of
Scotland, Edinburgh ; n°1057, dans HETHERINGTON, Paul., Pietro Cavallini, Londres,
1979, fig 137.
- NICOLAI, « Prospetto della basilica di San Paolo sulla via Ostiense », 1815, gravure,
dans PIETRANGELI, Carlo (dir.)., San Paolo fuori le mura, Florence, 1988, p 69.
- PIRANESI, Giambattista, Veduta della Basilica di S. Paolo fuor delle mura, vers 1750,
eau-forte, Rome, Gabinetto Communale delle Stampe ; M.R. 37813, dans
HETHERINGTON, Paul., Pietro Cavallini, Londres, 1979, fig 136.
▪ Pour la nef :
- ACQUARONI, Vue intérieure de la nef en ruine, juillet 1823, aquarelle, Thorvaldsens
Museum, Copenhague, Reproduction en noir et blanc, dans PIETRANGELI, Carlo (dir.).,
San Paolo fuori le mura, Florence, 1988, p 140.
- Anonymes, Relevé des Portraits des Papes, 1634/35, (Vatican, Bibliothèque, Barb. Lat.
4407, folio 1 à folio 119), Reproduction en noir et blanc, dans WAETZOLDT, Stephan.,
Die Kopien des 17. Jahrhunderts nach Mosaïken und Wandmalereien in Rom, Munich-
Vienne, 1964, pp 61-64.
- Anonymes, Relevé des scènes de l’Ancien Testament, 1634/35, (Vatican, Bibliothèque,
Barb. Lat. 4406, folio 23 à folio 60), Reproduction en noir et blanc, dans WAETZOLDT,
Stephan., Die Kopien des 17. Jahrhunderts nach Mosaïken und Wandmalereien in Rom,
Munich-Vienne, 1964, pp 56-58, fig 328-365.
- Anonymes, Relevé des scènes de la vie de saint Paul, 1634/35, (Vatican, Bibliothèque,
Barb. Lat. 4406, folio 87 à 128), Reproduction en noir et blanc, dans WAETZOLDT,
Stephan., Die Kopien des 17. Jahrhunderts nach Mosaïken und Wandmalereien in Rom,
Munich-Vienne, 1964, pp 58-61, fig 366-406.
- Anonymes, Relevé des scènes de la vie de saint Paul, 1634/35, (Vatican, Bibliothèque,
Barb, Lat. 4406, folio 109, 110 et 119), Reproduction en couleurs, dans TOMEI,
Alessandro., Pietro Cavallini, Milan, 2000, p 136-137, figs 117, 118 et 119.
- Anonymes, Relevé des scènes de l’Ancien Testament, 1634/35, (Vatican, Bibliothèque,
Barb. Lat. 4406, folio 36, 56 et 62), Reproduction en couleurs, dans TOMEI, Alessandro,
Pietro Cavallini, Milan, 2000, p 138 et 139, fig 120,121 et 123.
- Anonymes, Relevé des saints et prophètes, 1634/35, (Vatican, Bibliothèque, Barb. Lat.
4406, folio 1 à 82), dans WAETZOLDT, Stephan., Die Kopien des 17. Jahrhunderts nach
Mosaïken und Wandmalereien in Rom,Munich-Vienne, 1964, p 61, fig 409-450.
- GUTENSOHN, Vûe interieure de la basilique de ST Paul hors les murs, 1822, gravure,
dans BUNSEN, Christian., Die Basiliken des christlichen Roms aufgenommen von den
architecten Gutensohn und Knapp, München, s.d, traduction française, Les basiliques
98
chrétiennes de Rome relevées et dessinées par Gütensohn et Knapp, Paris, 1872, p 30, pl.
V.
- HETHERINGTON, Paul., Reconstitution des fresques du mur Sud de Saint-Paul-hors-les-
murs, dans HETHERINGTON, Paul., Pietro Cavallini, Londres, 1979, fig 124.
- HETHERINGTON, Paul., Reconstitution des fresques du mur Nord de Saint-Paul-hors-
les-murs, dans HETHERINGTON, Paul., Pietro Cavallini, Londres, 1979, fig 125.
- PANNINI, Gian Paolo., Interno di S.Paolo fuori le mura, huile sur toile, 1741, Gallerie
Leonard Koetser, Londres, Reproduction en noir et blanc, dans ARISI, Ferdinando., Gian
Paolo Panini e i fasti della Roma dell’700, Rome, 1986, p 386, fig 310.
- PANNINI, Gian Paolo., Interno di S.Paolo fuori le mura, Huile sur toile, 1743, collection
particulière, en dépôt au National Museum of Wales, Reproduction en noir et blanc, dans
GARDNER, Julian., “Gian Paolo Panini, San Paolo fuori le Mura: Some notes on colours
and setting”, dans Mosaics of Friendship: studies in art and history for Eve Bonsook,
Florence, 1999, p 246, fig 1.
- PIRANESI, Giambattista, Spaccato interno della basilica di San Paolo fuori le mura,
1748-49, eau-forte, Rome, Gabinetto Communale delle Stampe ; M.R. 37812, dans
KRAUTHEIMER, Richard, FRAZER, Alfred, SPENCER, Corbett., Corpus Basilicarum
Christianarum Romae. The Early Christian Basilicas of Rome (IV-IX Cent.), vol 5,
Vatican, 1937-1971, réed 1977, p 109, fig 91.
- ROSSINI, « Vue depuis le transept de la nef en ruine », 1823, gravure, dans
PIETRANGELI, Carlo (dir.)., San Paolo fuori le mura, Florence, 1988, p 73.
- ROSSINI, « Vue depuis l’Est le long de la nef en ruine », 1823, gravure, dans
PIETRANGELI, Carlo (dir.)., San Paolo fuori le mura, Florence, 1988, p 73.
- SEROUX D’AGINCOURT, Copie des scènes du Nouveau testament, entre 1780 et 1790,
(Vatican, Bibliothèque, Barb. Lat. 9843, folio 4 r), dans WAETZOLDT, Stephan., Die
Kopien des 17. Jahrhunderts nach Mosaïken und Wandmalereien in Rom, Munich-
Vienne, 1964, fig 408.
- SEROUX D’AGINCOURT, Scènes de l’Ancien Testament, entre 1780 et 1790, (Vatican,
Bibliothèque, Barb. Lat. 9843, folio 4 r), dans WAETZOLDT, Stephan., Die Kopien des
17. Jahrhunderts nach Mosaïken und Wandmalereien in Rom,Munich-Vienne, 1964, fig
408.
▪ Scènes du revers de la façade :
- Anonymes, Relevé des figures des évangélistes, 1634/35, (Vatican, Bibliothèque, Barb.
Lat. 4406, folio 129 r, folio 131 et 132 r, folio 134 r), Reproduction en noir et blanc, dans
HETHERINGTON, Paul., Pietro Cavallini, Londres, 1979, fig 128,130, 132 et 134.
- Anonymes, Relevé des scènes de la Passion, 1634/35, (Vatican, Bibliothèque, Barb. Lat.
4406, folio 130 r, folio 133 r, folio 135 r, folio 136 r), Reproduction en noir et blanc, dans
HETHERINGTON, Paul, Pietro Cavallini, Londres, 1979, fig 130, 131 ,133 et 135.
99
- HETHERINGTON, Paul., Reconstitution de l’envers de la façade de Saint-Paul-hors-les-
murs, à l’aide des dessins du XVIIème
siècle et des gravures de Seroux d’Agincourt, dans
HETHERINGTON, Paul., Pietro Cavallini, Londres, 1979, fig 126.
- SEROUX D’AGINCOURT, Copie des scènes de la Passion, entre 1780 et 1790, (Vatican,
Bibliothèque, Barb. Lat. 9843, folio 5 r), dans HETHERINGTON, Paul., Pietro Cavallini,
Londres, 1979, fig 126.
▪ L’arcus maior :
- Anonymes, Vue d’ensemble de l’arc triomphal, 1634/35, (Vatican, Bibliothèque, Barb.
Lat. 4406, folio 130 et 140), Reproduction en noir et blanc, dans WAETZOLDT, Stephan.,
Die Kopien des 17. Jahrhunderts nach Mosaïken und Wandmalereien in Rom, Munich-
Vienne, 1964, p 64, fig 453.
- Anonymes, La prédication de Paul, 1634/35, (Vatican, Bibliothèque, Barb. Lat. 4406,
folio 137 et folio 138), dans WAETZOLDT, Stephan., Die Kopien des 17. Jahrhunderts
nach Mosaïken und Wandmalereien in Rom,Munich-Vienne, 1964, fig 454
- CIAMPINI, Gravure de l’arc triomphal, 1690, dans WAETZOLDT, Stephan.,“ Zur
ikonographie des Triumphbogenmosaiks von ST. Paul in Rom“, dans Miscellanea
Bibliothecae hertzianae, zu Ehren von Leo Bruhns, Franz Graf Wolff Metternich, Ludwig
Schudt, Munich, 1961, p 21, fig 9.
- NICOLAI, « Spaccato della Basilica Ostiense sulla linea B », 1815, gravure, dans
PIETRANGELI, Carlo (dir.)., San Paolo fuori le mura, Florence, 1988, p 63.
▪ Abside
- Anonyme, Vues de l’abside, dans PIETRANGELI, Carlo (dir.)., San Paolo fuori le mura,
Florence, 1988, p 172.
B) INSTRUMENTS DE TRAVAIL
Architecture:
- MICHEL, Henry-Claude, STEFANON Laurence, ZABALLOS, Yannick., Principes et
éléments de l’Architecture religieuse médiévale, Graulhet, 1997.
Dictionnaires et encyclopédies :
- CABROL, Fernand., LECLERCQ, Henri (dir.)., Dictionnaire d’Archéologie chrétienne et
de liturgie, 15 vol ,Paris, 1922-1925.
- ROMANINI, Maria (dir.)., Enciclopedia dell’Arte Medievale, 12 vol, Turin, 1953.
- THIEME, Ulrich, BECKER Felix., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der
Antike bis zur Gegenwart, 18 vol, Berlin, 1999.
- TURNER, Jane (ed.)., The Dictionary of Art, 34 vol, New-York, 1996.
100
- VACANT, A, MANGENOT, E., AMAN, E., Dictionnaire de Théologie Catholique, 15
vol, Paris, 1923.
Répertoire de sources historiques:
- CHEVALIER, Ulysse., Répertoire des sources historiques du Moyen Age, Paris, 1905.
Répertoire de sources iconographiques :
- KIRSCHBAU, E., Lexikon der christlichen ikonographie, 8 vol, Rome-Fribourg-Bâle-
Vienne, 1968-1976, réed 1990.
C) Etudes
ANDALORO, ROMANO, 2000
=ANDALORO, Maria, ROMANO, Serena., Arte e Iconographia a Roma da Costantino a Cola di
Renzio, Milan, 2000.
BECKWITH, 1970
=BECKWITH, John., Early christian and byzantine art, Londres, 1970.
BELTING, 1976
=BELTING, Hans., “ I mosaici dell’aula leonina comme testimonianza della prima “renovation”
nell’arte medioevale di Roma” dans Roma e l’étà carolingia. Atti delle Giornate di studio, 3-8
maggio 1976, Rome, 1976, pp 93-121.
BELTING,1998
=BELTING, Hans., Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst,
Munich, 1990, traduction française par MULLER, Franck., Image et culte. Une histoire de l’art
avant l’époque de l’art, Paris, 1998.
BELTING, 1998
=BELTING, Hans., Das Bild und sein Publikum im Mittelalter: Form und Funktion früher
Bildtafeln der Passion, Berlin, 1981, traduction française par FORTUNATO, Israel., L’image et
son public au Moyen Âge, Paris, 1998.
BISCONTI, 1995
=BISCONTI, Fabrizio., « L’Abbracio tra Pietro e Paolo ed un affresco inedito del Cimitero
Romano dell’ex Vigna Chiaraviglio » dans XLII Corso di Cultura sull’arte Ravennate e
Bizantina. Seminario internazionale sul tema : « Ricerche di Archeologia Cristiana e bizantina »,
Ravenne, 14-19 Mars 1995, Ravenne, 1995, pp 71-93.
BISCONTI, 1998 =BISCONTI, Fabrizio., « La pittura paleocristiana » dans Catalogue de l’exposition: Romana
Pittura. La Pittura romana dalle origini all’eta bizantina, Rimini, Palazzo dell’Arengo e del
Podestà, 28 mars-30 août 1998, Rimini, 1998, pp 217-219.
BRADSHAW, 1995
=BRADSHAW, Paul., La liturgie chrétienne en ses origines, Paris, 1995.
BRENK, 1975
101
=BRENK, Beat., Die früchristlichen Mosaiken in S. Maria Maggiore zu Rom, Wiesbaden, 1975.
BRUYNE, 1934
=BRUYNE (de), Luciano., L’Antica serie di ritratti papali della Basilica di S.Paolo fuori le mura,
Rome, 1934.
BOTTI, MANACORDA, 1999
=BOTTI, Stefania, MANACORDA, Simona., « Precisazioni sulla statua lignea di S.Paolo nella
Basilica ostiense di Rome », dans Arte d’Occidente : studi in onore di Angiola Maria Romanini,
vol I, Rome, 1999, pp 497-511.
BUCHTAL, 1966
=BUCHTAL, Hugo., « Some representation from the life of St Paul in Byzantine and Carolingian
art”, dans Tortulae : Studien zu altchristlichen und byzantinischen Monumenten, n°30, Freiburg-
im-Breisgau, 1966, pp 43-49.
BUNSEN, KNAPP, 1872
=BUNSEN, Christian, KNAPP, Johann., Die Basiliken des christlichen Roms aufgenommen von
den architecten Gutensohn und Knapp, Munich, s.d, traduction française, Les basiliques
chrétiennes de Rome relevées et dessinées par Gütensohn et Knapp, Paris, 1872.
BUSUAECEANU, 1925
=BUSUAECEANU, Al., “Pietro Cavallini et la pittura romana del duecento e del trecento”, dans
Ephemeris Dacoromana, n°3, Rome, 1925, pp 259-406.
CAILLET, 1990
=CAILLET, Jean-Pierre., La Vie d’éternité. La sculpture funéraire dans l’antiquité chrétienne,
Paris, 1990.
CECCHELLI, 1988
=CECCHELLI, Margherita., « Il complesso monumentale della basilica dal IV al VII secolo »,
dans PIETRANGELI, Carlo (dir.)., San Paolo fuori le mura, Florence, 1988, pp 37-51.
CERIONI, 1988
=CERIONI, Anna Maria., « L’incendio del 1823. Problemi e polemiche per la ricostruzione e sua
realizzazione », dans PIETRANGELI, Carlo (dir.)., San Paolo fuori le mura, Florence, 1988, pp
67-84.
CHASTAGNOL, 1966
=CHASTAGNOL, André., « Sur quelques documents relatifs à la Basilique de Saint Paul hors les
murs », dans Mélanges d’Archéologie et d’histoire offerts à André Piganiol, vol I, Paris, 1966, pp
421-435.
CHAVASSE, Liturgie, 1993
=CHAVASSE, Antoine., La liturgie de la ville de Rome du Vème siècle au VIIIème siècle, Rome,
1993.
CHRISTE, 1979
=CHRISTE, Yves., « Traditions littéraires et iconographiques dans l’interprétation des images
apocalyptiques », dans L’Apocalypse de Jean. Traditions exégétiques et iconographiques III-
XIIIème siècle. Actes du Colloque de la Fondation Hardt, Genève, 29 février- 3 mars 1976,
Genève, 1979, pp 109-135.
102
CHRISTE, 1996
=CHRISTE, Yves., L’Apocalypse de Jean, Paris, 1996.
CHUVIN, 1991
=CHUVIN, Pierre., Chronique des derniers païens, Paris, 1991.
CLAUSE, 1893
=CLAUSE, Gustave., Les Monuments du christianisme au Moyen Age, Basiliques et mosaïques
chrétiennes, tome II, Paris, 1893.
CRIPPA, 1998
=CRIPPA, Maria Antonia., « La première architecture chrétienne IV-Vème siècle », dans L’art
Paléochrétiens. Des origines à Byzance, Paris, 1998, pp 183-217.
DEICHMANN, TSCHIRA, 1939
=DEICHMANN, Friedrich, TSCHIRA, Arnold.,“Die frühchristlichen Basen und Kapitelle von S.
Paolo fuori le mura“, dans Mitteilungen des deutschen archäologischen Institut, n°54, München,
1939, pp 99-111.
DEICHMANN, 1967
=DEICHMANN, Freidrich, BOVINI, Giuseppe, BRANDENBURG, Hugo., Repertorium der
Christlich-Antiken sarkophage. Rom und Ostia, Tome I et II, Wiesbaden, 1967.
DELEHAYE, 1927
=DELEHAYE, Hippolyte., Sanctus : essai sur le culte des saints dans l’antiquité, Bruxelles,
1927.
DELEHAYE, 1933
=DELEHAYE, Hippolyte., Les origines du culte des martyrs, 2ème
édition, Bruxelles, 1933.
DEMUS, 1949
=DEMUS, Otto., The mosaic of Norman Silicy, Londres, 1949.
DE SPIRITO, 2000
=DE SPIRITO, Giuseppe., « Chrétiens de Rome : Pierre et Paul et les martyrs romains au cœur de
la naissance de l’Eglise universelle », dans Dossiers d’Archéologie, n°255, juill-août 2000, Dijon,
2000, pp 36-46.
DINKLER VON SCHUBERT, 1967
=DINKLER VON SCHUBERT, Erika., “Per MURUM DIMISERUNT EUM“, Zur ikonographie
von Acta IX, 25 UND 2. Cor XI, 33, dans Studien zur Buchmalerei und Goldschmiedekunst des
Mittelalters. Festschrift fürKarl Herman Usener zum 60 geburstag am 19. August 1965, Marburg
an der Lahn, 1967, pp 79-92.
DUGAN, 1989
=DUGAN, Lawrence., « Was Art really the “Book of the Illiterate?” dans Word and Image, n°5,
Juillet-Septembre 1989, Londres, 1989, pp 227-251.
ELEEN, 1977
=ELEEN, Luba., “Acts illustration in Italy and Byzantium”, dans Dumborton Oaks Papers, n°31,
New-York, 1977, pp 254-278.
ELEEN, 1982
103
=ELEEN, Luba, The Illustration of the Pauline Epistles in French and English Bibles of the
Twelfth and Thirteenth Centuries, Oxford, 1982.
ELEEN, 1985
=ELEEN, Luba., “The frescoes from the life of St Paul in San Paolo fuori le mura in Rome: Early
Christian or Medieval ?” dans Revue d’art canadienne, vol 12, Toronto, 1985, pp 251-259.
FISCHER, 1969
=FISCHER. M, « Classicism and Historicism in nineteenth century Roman architecture. The
rebuilding of San Paolo fuori le mura », dans Acte du XXII congrés Internationnal d’histoire de
l’art, vol II, Budapest, 1969, pp 124-143.
GAEHDE, 1971
=GAEHDE, Joachim.,“ The Turonian Sources of the Bible of San Paolo fuori le Mura“, dans
Frühmittelalterliche Studien, n°5, Berlin-New-York, 1971, pp 359-400.
GARBER,1918
=GARBER, Joseph., Wirkungen des frühchristlichen Gemäldezyklen der alten Peters und Pauls
basiliken in Rom, Berlin, 1918*.
GARDNER, 1971
=GARDNER, Julian.,“ S.Paolo fuori le mura, Nicholas III and Pietro Cavallini“, dans Zeitschrift
für Kunstgeschichte, n°34, Munich-Berlin, 1971, pp 240-259.
GARDNER, 1973
=GARDNER, Julian., « Copies of Roman Mosaics in Edinburgh », dans The Burlington
Magazine, vol 115, Bedford, septembre 1973, pp 583-591.
GARDNER, 1980
=GARDNER, Julian., “Pietro Cavallini“, dans Burlington Magazine, n°925, avril 1980, Bedford,
pp 255-258.
GARDNER, 1999
=GARDNER, Julian., “Gian Paolo Panini, San Paolo fuori le Mura: Some notes on colours and
setting”, dans Mosaics of Friendship: studies in art and history for Eve Bonsook, Florence, 1999,
pp 245-254.
GARRISON, Studies, 1993
=GARRISON, E.B, Studies in the History of Medieval Italian Painting, vol 4, Londres, 1993.
GHETTI, 1969
=GHETTI- APOLLONJ, B.M., « Le basiliche cimiteriali degli apostoli Pietro e Paolo a Roma »,
dans Saecularia Petri et Pauli. Conferenze per il centanario del martirio degli apostoli Pietro e
Paolo tenute nel Pontifico Istituto di Archeologia Cristiana, Vatican, 24 janvier -20 mars 1968,
Vatican, 1969, pp 7-35.
GRABAR, 1946
=GRABAR, André., Martyrium.Recherches sur le culte des reliques et l’art Chrétien antique, vol
2 et 3, Paris, 1946.
GRABAR, 1979
=GRABAR, André., Les voies de créations en iconographie chrétienne, Paris, 1979.
104
GRABAR, 1982
=GRABAR, André.,“L’Iconographie du ciel dans l’art chrétien de l’antiquité et du haut Moyen
Age“, dans Cahiers Archéologiques, n°XXX, Paris, 1982, pp 5-24.
GRILLMEIER, 1990
=GRILLMEIER, Alois., Jesus der Christus im Glauben der Kirchen, Tome II, Freibourg-im-
Brisgau, 1979, traduction française DOMINIQUE, Pascale., Le Christ dans la tradition
chrétienne, Tome II, Paris, 1990.
GUJ, 2002
=GUJ, Melania., « La concordia Apostolorum nell’Antica decorazione di San Paolo fuori le
mura », dans Ecclesiae urbis : atti del congresso internazionale di Studi sulle chiese di Roma (IV-
X secolo), Rome, 4-10 Septembre 2000, Vatican, 2002, pp 1873-1892.
HEITZ, 1980
HEITZ, Carol., L’architecture religieuse carolingienne : les formes et leurs fonctions, Paris, 1980.
HETHERINGTON, 1979
=HETHERINGTON, Paul., Pietro Cavallini : A study in the art of late medieval, Londres, 1979.
HJORT, 1970
= HJORT, Oystein., « Da San Paolo fuori le mura braendte », dans Meddelser fra Thorvaldsens
Museum, n°3, Copenhage, 1970, pp 67-87.
IHM, 1960
=IHM, Christa., Die programme der christlichen apsismalerei vom Vierten jahrhunderts
bis zur Mitte des Achten jahrhunderts, Wiesbaden, 1960.
JULLIAN, 1833
=JULLIAN, René., Le candélabre Pascal de Saint-Paul-hors-les-murs, Nogent ( ?), 1833.
JULLIAN, 1959
=JULLIAN, René., « Arnolfo di Cambio et Pietro Cavallini » dans Gazette des Beaux-Arts, Mai-
Juin,1959, pp 357- 371.
JOSI, 1967
=JOSI, Enrico., La Porta Bizantina di San Paolo, Rome, 1967.
KESSLER, 1965
=KESSLER, Herbert., The Illustrated Bibles from Tours, Princeton, 1965.
KESSLER, 1989
=KESSLER, Herbert., “ Caput et speculum omnium ecclesiarum » : Old ST. Peter’s and church
decoration in medieval latium “ dans Italian Church Decoration of the Middle Ages and Early
Renaissance. Functions, Forms and Regional Traditions, vol I, Bologne, 1989, pp 119-146.
KESSLER, 1994
=KESSLER, Herbert., “Pictures as scripture in Fifth-century churches”, dans Studia Artium
Orientalis et Occidentalis, n°2, 1985, pp 17-31; repris dans Studies in Pictorial Narrative,
Londres, 1994, pp 357-379.
105
KESSLER, 1999
=KESSLER, Herbert., “La decorazione della basilica medievale di San Pietro”, dans Romei
&Giubilei. Il pellegrinaggio medievale a San Pietro (350-1350), catalogue de l’exposition du
Palazzo Venezia, Rome, 29 octobre 1999-26 février 2000, Rome, 1999, pp 263-270.
KESSLER, 1999
=KESSLER, Herbert.,“The Meeting of Peter and Paul in Rome : An emblematic narrative of
spiritual brotherhood“, dans Dumbarton Oaks Papers, n°41, 1987, pp 265-75; repris dans Studies
in Pictorial Narrative, Londres, 1994, pp 529-548.
KOENEN, 1992
=KOENEN, Ulrike., “Das Bild der Traume Josephs von St. Paul von den Mauer in Rom“, dans
Jahrbuch für Antike und Christentum, vol 35, Münster, 1992, pp 185-194.
KINTZINGER, 1975
=KINTZINGER, E.,“ The Role of Miniature Painting in Mural Decoration“, dans The Place of
Book Illumination in Byzantine Art, Princeton, 1975, pp 99-142.
KOENEN,1995
=KOENEN, Ulrike., Das « Konstantinskreuz » im Lateran und die Rezeption früchristlicher
Genesiszyklen im 12. und 13. Jahrhundert, Wörms, 1995.
KRAMER, 1997
=KRAMER, J., « Spätantike korinthische Saülenkapitelle in Rom bei S. Paolo fuori le mura, S.
Maria in Dominica und andere », dans Spätantike Frühes Christentum Byzantium. Studien und
Perspektiven, n°3 , Rome, 1997, pp 55-64.
KRAUTHEIMER, 1977
=KRAUTHEIMER, Richard, FRAZER, Alfred, SPENCER, Corbett., Corpus Basilicarum
Christianarum Romae. The Early Christian Basilicas of Rome (IV-IX Cent.), vol 5, Vatican, 1937-
1971, réed 1977.
KRAUTHEIMER, 1989
=KRAUTHEIMER, Richard, Early Christian and Byzantine architecture, Londres, 1965-1986,
réed 1989.
KRAUTHEIMER, 1995
=KRAUTHEIMER, Richard, « Interno alla fondazione di San Paolo fuori le mura » dans Atti della
Pontifica Accademia Romana di Archeologia, n°53/54, Rome, 1980-1982, pp 207-220, traduction
française par GUGLIELMI-PERETTI, Martine., « La fondation de Saint-Paul-hors-les-murs »,
dans Idéologie de l’art antique du IV au XVème siècle, Paris, 1995, pp 11-24.
KRAUTHEIMER, 1999 =KRAUTHEIMER, Richard., Rome, Profile of a city 312-1308, Princeton, 1980, traduction
française par MONFRIN, Françoise., Rome, Portrait d’une ville 312-1308, Paris, 1999.
LADNER, 1984
=LADNER, Gherardo., Die Papstbildnisse des Altertums und des Mittelalters, Cité du Vatican,
1941-1984.
MARTINEZ- FAZIO, 1972
=MARTINEZ-FAZIO, L-M., La segunda basilica de San Pablo Extramuros, Rome, 1972.
106
MATTHIAE, 1962
= MATTHIAE, Guglielmo, Le chiese di Roma dal IV al X secolo, Rome, 1962.
MATTHIAE, 1965
=MATTHIAE, Guglielmo., Pittura romana del medoievo, vol I (Secoli IV-X), Rome, 1965.
MATTHIAE, 1971
=MATTHIAE, Guglielmo., Le Porte bronzee bizantine in Italia, Rome, 1971.
MATTHIAE, 1972
=MATTHIAE, Guglielmo., Pietro Cavallini, Rome, 1972.
MATTHIAE, 1988
=MATTHIAE, Guglielmo., Mosaici medioevali delle chiese di Roma, vol 1 et 2, Rome, 1988.
MAYEUR, PIETRI, 1995
=MAYEUR, Jean-Marie, PIETRI, Lucie, PIETRI, Charles., Naissance d’une chrétienté (250-430),
Paris, 1995.
MOSKOWITZ, 1998
MOSKOWITZ, Anita.,“Anolfo, Non-Arnolfo: New (and some old) Observations on the Ciborium
in San Paolo fuori le mura“, dans GESTA, n°37, New-York, 1998, pp 88-103.
MOUNIER, 2000
=MOUNIER, M., Le sacrifice d’Isaac. Son évolution du IIIème au XIIème siècle,
Mémoire de DEA-Paris X Nanterre, Paris, 2000.
MUNTZ, 1895
=MUNTZ, Eugène., « Les peintures murales de l’ancienne basilique de Saint-Paul-hors-les-
murs », dans Nuovo Bullettino di Archeologia Cristiana, Anno Primo, Rome, 1895, pp 112-113. MUNTZ, 1898
=MUNTZ, Eugène., « L’ancienne basilique de Saint-Paul-hors-les-murs », dans Revue de l’art
chrétiens, n°41, Paris, 1898, pp 1-19.
NIBBY, 1839-41
=NIBBY, Antonio., Roma nell’anno MDCCCXXXVIII, Partie Moderna I, Rome, 1839-41.
NICOLAI, 1815 =NICOLAI, N-M., Della Basilica di S. Paolo, Rome, 1815.
NICOLAI, 2000
=NICOLAI, V., BISCONTI, F., MAZZOLINI, D., Les catacombes chrétiennes de Rome. Origine,
développement, décor, inscriptions, Turnhout, 2000.
PACE, 1991
=PACE, Valentino., « Committenza benedettina a Roma : Il caso di San Paolo fuori le mura nel
XIII secolo », dans Zeitschrift für Kunstgeschichte, n°54, Munich, 1991, pp 181-189.
PALLARD, 1884
107
=PALLARD, Louis, Portraits officiels des souverains Pontifes, depuis St Pierre jusqu’à Léon
XIII. Reproduction par la chromolithographie, des médaillons en mosaïques de Saint-Paul-hors-
les-murs à Rome, Paris, 1884.
PALLOTINO, 1995
=PALLOTINO, Elisabetta., « La Nuova architettura paleocristiana nella ricostruzione della
Basilica di S Paolo fuori le Mura 1823-1847 », dans Ricerche di storia dell’arte, n°56, Rome,
1995, pp 30-59.
PALLOTINO, 1997
=PALLOTINO, Elisabetta., L’ultimo projetto di Valadier per San Paolo fuori le Mura, Rome,
1997.
PICARD, 1988
=PICARD, Jean-Charles., Le souvenir des évêques : sépultures, listes épiscopales et culte des
évêques en Italie du Nord, des origines au Xème siècle, Rome, 1988.
PIETRI, 1976
=PIETRI, Charles., « L’église romaine et la conquête de la cité », dans Roma Christiana.
Recherches sur l’Eglise de Rome, son organisation, sa politique, son idéologie de Miltiade à Sixte
III (311-440), vol I, Rome, 1976, pp 406-460.
PIETRI, 1976
=PIETRI, Charles., « Les constructions suburbaines », dans Roma Christiana. Recherches sur
l’Eglise de Rome, son organisation, sa politique, son idéologie de Miltiade à Sixte III (311-440),
vol 1, Rome, 1976, pp 514-519.
POILPRE, 2003
=POILPRE, Anne-Orange., Maiestas Domini. L’image du Christ en Majesté en Occident. Des
origines à la fin de l’époque Carolingienne, Thèse- Paris X Nanterre, Paris, 2003.
RICHE, 2001
=RICHE, Pierre (dir.)., L’Europe de l’an mil, Paris, 2001.
ROMANO, 1989
=ROMANO, Serena., « Un clipeo con busto papale di San Paolo fuori le Mura », dans Fragmenta
picta. Affreschie e mosaici staccati del medioevo Romano. Catalogue de l’exposition, Rome,
Château Saint-Ange, 15 Décembre 1989- 18 Février 1990, Rome, 1989, pp 211-218.
ROMANO, 1992
=ROMANO, Serena., « Fra Roma e Napoli », dans Eclissi di Roma. Pittura a Roma e nel Lazio da
Bonifacio VIII a Martino V (1295-1431), Rome, 1992, pp 103-196.
SANSAINI, 1933
=SANSAINI, P., La basilica di S. Paolo sulla via Ostiense, Rome, 1933.
SAXER, Culte, 1969
=SAXER, Victor., « Le culte des apôtres Pierre et Paul dans les plus vieux formulaires romains de
la messe du 29 juin. Recherches sur la thématique des sections XV-XVI du sacramentaire
Léonien », dans Saecularia Petri et Pauli. Conferenze per il centanario del martirio degli apostoli
Pietro e Paolo tenute nel Pontifico Istituto di Archeologia Cristiana, Vatican, 24 janvier -20 mars
1968, Vatican, 1969, pp 199-204.
108
SAXER, 1984
=SAXER, Victor., « Le pèlerinage aux apôtres Pierre et Paul », dans Dictionnaire de spiritualité,
Tome XII, Paris, 1984, pp 910-918.
SAXER, 2001
=SAXER, Victor., St Marie Majeure; une basilique de Rome dans l’histoire de la ville et de son
Eglise, Vème-XIIIème siècle, Rome, 2001.
SCHILLER 1968
=SCHILLER, Gertrud., Ikonographie der christlichen Kunst. Die Passion Jesu Christi, Tome II,
Gütersloh, 1968.
SCHILLER, 1991
=SCHILLER, Gertrud., Ikonographie der christlichen Kunst. Die Apokalypse des Johannes, Tome
V, Gütersloh, 1991.
SCHMITT, 2002
=SCHMITT, Jean-Claude., Le corps des images. Essais sur la culture visuelle au Moyen Âge,
Paris, 2002.
SCHUSTER, 1934
=SCHUSTER, Ildefonso., La Basilica e il Monastero di S. Paolo fuori le Mura, Turin, 1934.
SEROUX d’AGINCOURT, 1823
=SEROUX d’AGINCOURT, Jean-Baptist., Histoire de l’art par les monumens : depuis sa
decadence au IV siècle jusqu’à son renouvellement au XVIème siècle, Paris, 1823.
SEVERINI, 2000
=SEVERINI, Francesca., « Ad limina Apostolorum. Les Pèlerins à Rome dans les premiers siècles
de la chrétienté », dans Dossiers d’Archéologie, n°255, juill-août 2000, Dijon, 2000, pp 132-141.
SIMON, 1972
= SIMON, Marcel., La civilisation de l’antiquité et le christianisme, Paris, 1972.
SOPER, 1938
=SOPER, Alexander., “The Italo-gallic school of Early christian art”, dans Art bulletin, n°XX,
Chicago, 1938, pp 145-192.
SPAIN, 1979
=SPAIN, Suzanne., “The Promised Blessing”: The Iconography of the Mosaics of S. Maria
Maggiore”, dans Art Bulletin, n°LXI, Chicago, 1979, pp 518-540.
SPEYART VAN WOERDEN, 1961
SPEYART VAN WOERDEN, « The iconography of the sacrifice of Abraham », dans Vigiliae
Christianae, vol 15, Amsterdam, 1961, pp 214-255.
SPIESER, 1998
=SPIESER, J-M., “The Representation of Christ in the Apses of Early Christian Churches“, dans
GESTA, n°37, New-York, 1998, pp 63-73.
TESTINI, 1969
=TESTINI, P.,”L’iconographia degli apostolic Pietro e Paolo nelle cosiddette “arti minori”, dans
Saecularia Petri et Pauli. Conferenze per il centanario del martirio degli apostoli Pietro e paolo
109
tenute nel Pontifico Istituto di Archeologia Cristiana, Vatican, 24 janvier -20 mars 1968, Vatican,
1969, pp 241-288.
THUMMEL, 1999
=THUMMEL, Hans., Die Memorien für Petrus and Paulus in Rom :Die Archäologischen
Denkmäler und die litararische tradition, Berlin, 1999.
TOMEI, 1988
=TOMEI, Alessandro., « Vicende della Basilica sino al 1823 », dans PIETRANGELI, Carlo
(dir.)., San Paolo fuori le mura, Florence, 1988, pp 55-65.
TOMEI, 2000
TOMEI, Alessandro., Pietro Cavallini, Milan, 2000.
TRONZO, 1985
=TRONZO, William., « The Prestige of Saint Peter’s: Observations on the Function of
Monumental Narrative Cycles in Italy », dans Pictorial Narrative in Antiquity and the Middle
Ages, vol 16, Washington, 1985, pp 93-115.
TRONZO, 1986
=TRONZO, William., The Via Latina Catacomb. Imitation and Discontinuity in Fourth-Century
Roman Painting, Londres, 1986.
TRONZO, 2001
=TRONZO, William., “The Shape of Narrative. A problem in the Mural Decoration of Early
Medieval Rome”, dans Roma nell’alto Medieovo : Settimane di Studio del Centro italiano di studi
sull’alto Medieovo, Rome, 27 avril-1er Mai 2000, n°XLVIII, tome I, Rome, 2001, pp 457-492.
UGGERI, 1827
=UGGERI, Angelo., “Dell Arco trionfale detto di Placidia“, dans Memorie romane di Antichità e
di Belle Artè, Tome IV, Florence, 1827, pp 113-124.
VICAIRE, 1963
=VICAIRE, Marie-Humbert., L’Imitation des apôtres, moines, chanoines, mendiants (IV-XIIème
siècle), Paris, 1963.
VITALIANO, 1996
=VITALIANO, Tiberia., I mosaici de XII secolo e di Pietro Cavallini in Santa Maria in
Trastevere. Restauri e nuove ipotesi, Pérouse, 1996. WAETZOLDT, 1961
=WAETZOLDT, Stephan.,“ Zur ikonographie des Triumphbogenmosaiks von ST. Paul in Rom“,
dans Miscellanea Bibliothecae hertzianae, zu Ehren von Leo Bruhns, Franz Graf Wolff
Metternich, Ludwig Schudt , Munich, 1961, pp 19-29.
WAETZOLDT, 1964
=WAETZOLDT, Stephan., Die Kopien des 17. Jahrhunderts nach Mosaïken und Wandmalereien
in Rom, Vienne-Munich, 1964.
WARLAND, 1986
=WARLAND, Rainer., Das Brustbild Christi. Studien zur spätantiken und frübyzantinischen
Bildesgeschichte, Rome, 1986.
110
WEITZMANN, 1977
=WEITZMANN, Kurt., Manuscrits gréco-romains et paléochrétiens, Paris, 1977.
WEITZMANN, 1977
=WEITZMANN, Kurt., Late Antique early Christian painting, New-York, 1977.
WEITZMANN, 1990
=WEITZMANN, Kurt, KESSLER, Herbert., The Frescoes of the Dura Synagogue and Christian
Art, Washington, 1990.
WEIS, 1966
=WEIS, Adolf., “Der römische Schöpfungzykus des 5.jahrhunderts im Triclinium Neons zu
Ravenna“, dans Tortulae : Studien zu atlchristlichen und byzantinischen Monumenten, n°30,
Freiburg-im-Breisgau, 1966, pp 300-317.
WHITE, 1984
=WHITE, John.,”Cavallini and the lost frescoes in S. Paolo”, dans The Journal of the Warburg
and Courtauld Institutes, n°19, Londres, 1956, pp 84-95; repris dans Studies in Late Medieval
Italian Art, Londres, 1984, pp 84-95.
WHITE, 1992
=WHITE, John., The Birth and Rebirth of pictorial space, Londres, 1957, traduction française s.n,
Naissance et renaissance de l’espace pictural, Paris, 1992.
WILPERT, 1917
=WILPERT, Josef., Die römischen mosaiken und marelein der kirchlichen bauten vom IV bis XIII
jahrhunderts, vol 2, Freiburg-im-Breigau, 1917.
WOLLENSEN,1983
=WOLLENSEN, J., Penduttae ritrovati una inconsiderazione della pitturra romana nell’ambiante
del papato di Niccolo III, Rome, 1983.
111
TABLES DES MATIERES
Remerciements…………………………………………………………………………....1
Introduction……………………………………………………………………………….2
PREMIERE PARTIE : RAPPEL DES DONNEES HISTORIQUES ET ARCHITECTURALES
Chapitre premier : Aux origines de Saint-Paul-hors-les-murs.....................................9
1) Dates et commanditaires………………………………………………………..9
a) Sur le problème du premier édifice…………………………………......9
b) L’intervention de Valentinien II, Théodose et Arcadius……………...10
2) Contexte de Construction……………………………………………………..12
a) Primauté de Pierre……………………………………………………..12
b) Remise à l’honneur de l’apôtre des Gentils…………………………...13
Chapitre second : Genèse structurelle du monument……………………………......16
1) L’Edifice paléochrétiens……………………………………………………....16
a) Plan…………………………………………………………………….16
b)Elévation…………………………………………………………….....17
2) Restauration et restructuration..........................................................................18
a) Les interventions pendant le Moyen Age..............................................18
b) Les bouleversements à l’époque moderne.............................................21
DEUXIEME PARTIE : LE PROGRAMME ICONOGRAPHIQUE : ETAT DE LA QUESTION
Chapitre premier : Sources et organisations du décor originel.................................23
1) Le décor de la nef..............................................................................................23
a) Les portraits des papes..........................................................................23
b) Thèmes et emplacement du cycle biblique............................................26
c) Les saints et les prophètes.....................................................................31
112
2) L’arcus maior et l’abside..................................................................................33
a) Le débat sur le programme de l’arc.......................................................33
b) Hypothèse sur le cycle de l’abside.........................................................36
Chapitre second : Les restaurations et contributions du Moyen Age.........................37
1) Le Haut Moyen Age..........................................................................................38
a) Les peintures du revers de façade..........................................................38
b) La possible restauration de l’arcus maior.............................................47
2) Les interventions du XIIIème siècle..................................................................50
a) Réfection du programme de l’abside.....................................................50
b) La restauration des peintures de la nef..................................................53
c) Le Problème de l’atelier........................................................................59
TROISIEME PARTIE : NOUVELLES HYPOTHESES DE TRAVAIL
Chapitre premier : Retour sur le programme paléochrétien.....................................68
1) Une restitution délicate..................................................................................... 68
a) Nouvelles propositions d’identification de scènes.................................68
b) Questions sur l’iconographie de la façade.............................................71
2) Mode d’élaboration de l’image..........................................................................75
a) Les scènes bibliques...............................................................................75
b) Le cycle de l’arc.....................................................................................79
Chapitre second : Repère chronologique et signification du programme..................80
1) Retour sur certaines estimations........................................................................80
2) Message du décor..............................................................................................84
Conclusion.........................................................................................................................92
Bibliographie......................................................................................................................95