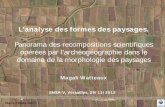Derrière les murs, l'écho de Tahrir. Le rapport au politique des habitants des quartiers fermés...
Transcript of Derrière les murs, l'écho de Tahrir. Le rapport au politique des habitants des quartiers fermés...
UNIVERSITE PARIS DIDEROT
MASTER 2 GEOPRISME Spécialité Recherche – Parcours Sciences des Territoires
DERRIERE LES MURS, L’ECHO DE TAHRIR LE RAPPORT AU POLITIQUE DES HABITANTS DES QUARTIERS FERMES
DU GRAND CAIRE
Mémoire de Master 2 réalisé par Elise Braud Sous la direction de :
• Renaud Le Goix (maître de conférence, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR Géographie-cités)
• Bénédicte Florin (maître de conférence, université de Tours, UMR CITERES)
JUIN 2014
- 2 -
REMERCIEMENTS Je tiens à remercier ici toutes les personnes qui m’ont guidée, conseillée et soutenue dans la
réalisation de ce mémoire de recherche et lors de mon terrain au Caire.
Mes remerciements vont tout d’abord à mes directeurs de recherche Renaud Le Goix et
Bénédicte Florin pour leur aide et leurs conseils avisés tout au long de ce travail.
Un grand merci également à tous ceux qui ont rendu ce terrain possible et passionnant en me
conseillant et en acceptant de me donner un peu (et parfois beaucoup) de leur temps.
Photographies de couverture : à gauche, un groupement d’immeubles à Rehab ; à droite, le golf de Mirage City. Clichés : E. Braud, 2014.
- 3 -
SOMMAIRE REMERCIEMENTS ....................................................................................................................... 2
SOMMAIRE ................................................................................................................................. 3
INTRODUCTION .......................................................................................................................... 4
PREMIERE PARTIE : Privatisation résidentielle et rapport au politique : les éléments du débat dans le contexte égyptien ............................................................................................... 8
1. Mutations urbaines et transition politique : quelques éléments de contexte ................................ 8 2. Privatisation résidentielle et rapport au politique ....................................................................... 13 3. L’enquête de terrain : une méthodologie faite de « bricolages et d’arrangements » .................. 17
DEUXIEME PARTIE : Le rapport ordinaire au politique des habitants des compounds cairotes, quel effet de lieu ? .................................................................................................... 20
1. A la recherche des « répertoires invisibles » du politique .......................................................... 20 2. L’écho de Tahrir : un intérêt général pour la politique égyptienne, une mobilisation de l’apathie à la prise de parole .............................................................................................................................. 22 3. Echapper à la ville : une stratégie d’exit au service de la distinction sociale ............................. 25 4. L’effet de lieu sur le rapport ordinaire au politique et les répertoires de mobilisation .............. 32
TROISIEME PARTIE : La place et la nature des compounds dans le paysage politique égyptien : pratiques et représentations des habitants ......................................................... 38
1. Le compound, un lieu apolitique dans la conception et les représentations ............................... 39 2. Des pratiques politiques locales aux mobilisations nationales : le compound comme un lieu d’expression politique ........................................................................................................................ 44 3. Les compounds dans la configuration politique égyptienne : lieux satellites ou complémentaires de la contestation postrévolutionnaire ? ................................................................. 50
CONCLUSION ............................................................................................................................ 57
ANNEXES .................................................................................................................................. 59
BIBLIOGRAPHIE ....................................................................................................................... 65
TABLE DES FIGURES ................................................................................................................. 71
TABLE DES MATIERES .............................................................................................................. 72
- 4 -
INTRODUCTION
« Pour l’instant, je me contenterai d’être l’interprète de la rue al-Radwân et de rapporter ses histoires. (…) Finalement, ce qu’il faut retenir, c’est ce que l’on entend, non ce qui a eu lieu. Car il arrive souvent que le mensonge soit plus vrai que la réalité. Alors, écoute la rue al-Radwân et ne sois pas de ceux qui doutent.1 »
Ecouter la ville et ses habitants pour mieux la comprendre, à travers ses contradictions
réelles et imaginaires : tel est le conseil de Naguib Mahfouz. Observateur avisé et véritable
amoureux de la ville du Caire, l’écrivain décrivait avec nostalgie et réalisme, à la fin des
années 1980, les transformations de son quartier d’origine. Or, parmi les mutations urbaines
qui ont radicalement transformé le paysage de la métropole cairote ces dernières décennies,
des quartiers d’un nouveau genre se sont développés sur ses marges désertiques : les
compounds. Ces derniers peuvent être comparés aux gated communities américaines ou aux
condominios fechados latino-américains, ensembles résidentiels gérés en copropriété et
clôturés, même si l’appellation de « compound » est spécifique aux pays du Moyen-Orient
(Glasze, 2000). Quartiers fermés et privés, les compounds connaissent d’une part un grand
succès auprès des ménages égyptiens des classes moyennes et supérieures tout en étant
d’autre part largement critiqués comme les symboles d’une ségrégation socio-spatiale
croissante.
Si les publicités séduisantes pour ces nouveaux quartiers bordent les principaux axes
routiers de la ville et que les enseignes clignotantes de leurs promoteurs illuminent les bords
du Nil nuit et jour, l’omniprésence des compounds dans le paysage urbain contraste toutefois
nettement avec leur absence dans l’analyse médiatique et académique de la transition
politique égyptienne. Souvent ignorées au profit des épicentres du soulèvement populaire
contre le régime autoritaire de Hosni Moubarak en janvier 2011, dont la place Tahrir est
devenue le lieu symbolique, qu’en est-il des périphéries dans la configuration politique
postrévolutionnaire ? En particulier, si les compounds sont considérés par certains comme des
« paradis infernaux » (Davis, Monk, 2007) qui permettent à une élite de fuir la ville et de jouir
d’une « démocratie privée » (Denis, Séjourné, 2003), les pratiques politiques et les
représentations de leurs habitants n’ont jamais fait l’objet d’une étude approfondie. On peut se
demander notamment si la marginalité spatiale associée à la privatisation résidentielle se
traduit mécaniquement par une marginalité politique pour les habitants des quartiers fermés.
1 Mahfouz N. (1988, éd. française 1998). Matin de roses, Paris : Actes sud, p.33.
- 5 -
Si la distance matérielle et symbolique mérite d’être étudiée sur le rapport des habitants au
politique, qu’en est-il par ailleurs de la fermeture et de la gestion privée ? En quoi les
caractéristiques fonctionnelles du quartier influencent-elles les modalités de la participation
politique, notamment dans le contexte de transition post-2011?
En choisissant d’étudier, par une enquête de terrain au Caire, le rapport au politique des
habitants des compounds à travers leurs pratiques et leurs représentations, il s’agit de remettre
ces espaces périurbains résidentiels, fermés et privés au centre d’une analyse de géographie
politique. Si celle-ci permet d’étudier sous un angle nouveau les caractéristiques socio-
politiques de la transition postrévolutionnaire en Egypte, elle s’inscrit également dans un
débat théorique sur le rapport entre la privatisation résidentielle périurbaine et la participation
politique locale (Mitchell, 1995 ; Kirby, 2008 ; Walk, 2004 ; 2005 ; 2006).
L’approche retenue peut être qualifiée de « géographie politique “par le bas” » dans la
mesure où nous2 avons privilégié les formes banales et ordinaires des trois pôles du triptyque
autour duquel s’articule notre réflexion : le politique, les acteurs et le lieu (Fig. 1).
Au-delà du seul rapport finalisé au politique, qui se traduit par des actes visibles et
mesurables tels que le vote ou des manifestations, c’est le « rapport ordinaire au politique »
qu’il s’agit de saisir sur le terrain sous différentes formes, à la fois banales (intérêt général
2 Afin de retranscrire le caractère subjectif de ce travail de recherche, on a choisi d’utiliser alternativement les pronoms personnels « nous » et « je » en donnant un usage différent à chacun. On a privilégié la forme « je » pour évoquer l’expérience de terrain elle-même en conservant la forme « nous » pour une analyse critique personnelle de cette expérience.
LIEU Compound
ACTEURS Habitants
(2) (1)
POLITIQUE Rapport ordinaire
(3) (4)
(5)
Fig. 1: Une approche de géographie politique « par le bas » à l’articulation de trois pôles. Lecture : Etude de l’effet de lieu (1) sur le rapport ordinaire au politique des habitants des compounds (2). Etude de l’effet des représentations et des pratiques des habitants (3) sur la place et la nature des compounds dans la configuration politique égyptienne (4). La relation (5) est décomposée en (1) et (3).
- 6 -
pour des questions de nature politique, goût et pratique de la discussion politique etc.) et
parfois plus proches du politique finalisé (manifestations, pétitions etc.). L’ordinaire du
politique représente « l’ensemble de ce qui est contigu au « politique en finalité » » et
correspond à ce que recouvre l’expression anglophone « everyday politics » (Lefébure, 2009,
p. 376). S’agissant des acteurs, nous avons centré notre enquête de terrain sur les habitants
eux-mêmes, trop souvent négligés dans les études sur les compounds et les quartiers
résidentiels fermés en général. Comme le suggère Guénola Capron (2006), il est nécessaire
« d’entrer dans l’enclave afin de mieux la comprendre » (p. 13) et de « regard[er] et écout[er]
les habitants avant de les juger » (p. 18). Enfin, le choix de concentrer notre étude de cas sur
la ville fermée de Rehab, au Nouveau Caire, permet de donner à voir un compound de classes
moyennes beaucoup moins exclusif que d’autres quartiers, célèbres pour leur fermeture et la
verdure de leur golf tels que Katameya Heights ou Mirage (cf. Fig. 2 et 3). Rehab est
également un compound de très grande taille, prévu pour accueillir 200 000 habitants sur
10 km2 une fois terminé, et constitue d’ailleurs à ce titre plus une ville qu’un simple quartier3.
Avant d’exposer les réflexions tirées de notre expérience de terrain, il est nécessaire de
revenir, dans une première partie, sur le contexte urbain et politique national du sujet de
recherche mais également sur les enjeux théoriques et méthodologiques de notre enquête.
L’apport de celle-ci peut ensuite être décomposé en deux axes, correspondant aux relations
symétriques synthétisées dans la figure 1. Dans une deuxième partie, on esquissera plusieurs
trajectoires de rapport ordinaire au politique des habitants (2) à partir des entretiens réalisés et
on soulignera l’importance de la gestion privée du compound (1) susceptible d’expliquer une
désaffection relative pour les enjeux politiques métropolitains ainsi qu’un engagement
politique parfois tardif. Afin d’évaluer la place matérielle et symbolique des compounds dans
la configuration spatio-politique postrévolutionnaire (4), on s’attachera dans une troisième
partie à requalifier leur statut de lieu apolitiques et satellites. Les représentations et les
pratiques des habitants (3) ainsi que la mise en perspective, sur le temps long, de la place
respective des espaces privés et publics dans la ville cairote permettent de mettre en évidence
l’émergence, dans ces quartiers, d’une modalité d’expression politique complémentaire et
potentiellement alternative en contexte autoritaire.
3 Pour plus de détails sur Rehab, voir la page officielle dirigée depuis le site du promoteur Talaat Mustafa Group (http://www.alrehabcity.com/rehab2011/) ainsi que les travaux de Anne Bouhali (2009) et Safaa Marafi (2011).
- 8 -
PREMIERE PARTIE
Privatisation résidentielle et rapport au politique : les éléments du débat dans le contexte égyptien
1. Mutations urbaines et transition politique : quelques éléments de
contexte
1.1 L’extension périurbaine d’une ville « hors de contrôle »
Dans le réseau de villes égyptien et moyen-oriental, le poids démographique, économique
et politique de la métropole cairote lui confère une position de premier-plan. Comme pour
d’autres capitales macrocéphales de pays en développement (Dureau et al., 2000), la
croissance démographique du Caire génère des enjeux considérables en termes
d’aménagement, de logement et de gouvernance. L’urbanisation croissante des périphéries
métropolitaines, rurales ou désertiques, représente une caractéristique majeure des mutations
de la métropole et contribue à faire de la ville un « nœud de contradictions » (Sims, 2012). En
effet, cette extension urbaine sur les marges orientales et occidentales4 est marquée par de très
forts contrastes et de grandes inégalités, entre extensions planifiées et extensions informelles
d’une part et entre ces extensions et le centre-ville d’autre part. Comme le résume David
Sims, l’extrême richesse côtoie quotidiennement l’extrême pauvreté dans les rues du Caire :
« There are huge SUVs and donkey carts, palaces and hovels, beggars and pampered youth5 »
(Sims, 2012, p. 3). Le même auteur remet toutefois en cause la lecture très négative de la ville
du Caire généralement faite par les observateurs étrangers, celle d’une ville « hors de
contrôle » :
« Is modern Cairo out of control ? The words chaotic, overcrowded, cacophonous, disorganized, confusing, polluted, dirty, teeming, sprawling and so on, are quick to be used by foreign observers as well as Egyptians themselves.6 » (id.)
Malgré tous ces qualificatifs négatifs, David Sims montre à quel point Le Caire a développé
sa propre logique de développement, largement tirée par la flexibilité et les ressources de
4 Notre enquête de terrain porte principalement sur les développements périphériques vers l’est et le Nouveau Caire. Il est bon de noter cependant que de telles extensions s’observent de la même manière vers l’ouest et la ville nouvelle de Six-octobre. 5 « Il y a d’énormes 4x4 et des charrettes tirées par des ânes, des palais et des taudis, des mendiants et une jeunesse dorée. » (Traduction par nos soins). 6 « Est-ce que Le Caire moderne est hors de contrôle ? Les observateurs étrangers aussi bien que les Egyptiens eux-mêmes sont prompts à utiliser les mots « chaotique », « surpeuplé », « cacophonique », « désorganisé », « perturbant », « pollué », « sale », « grouillant », « tentaculaire » etc. » (Traduction par nos soins).
- 9 -
l’informalité. Il appelle ainsi à adopter une perspective pluridisciplinaire, à privilégier une
étude sur le temps long afin de réellement comprendre les mutations en cours et à « s’assurer
doublement » de « prendre les gens en compte ». Il convient donc de replacer notre objet
d’étude dans son contexte : les quartiers fermés étudiés au Nouveau Caire, à commencer par
la ville fermée de Rehab, ne représentent en nombre d’habitants qu’une infime partie de la
population totale du Grand Caire et s’inscrivent dans un contexte de développement
métropolitain largement dominé par la production informelle.
Le développement des compounds en périphérie s’inscrit également dans un contexte de
saturation du marché du logement. Habiter dans le centre du Caire représente un défi majeur
pour nombre de Cairotes, jeunes mariés ou familles à faibles revenus, et les pousse à chercher
un logement de plus en plus loin du centre-ville. Si le gouvernement égyptien a entrepris dès
les années 1970 de développer des villes nouvelles en périphérie afin de décongestionner le
centre et d’offrir un parc de logements pour les ménages les plus modestes, une grande partie
de ce développement péri-urbain relève aujourd’hui de l’informel. Sur les 17 millions
d’habitants vivant dans les limites du Grand Caire en 2009, environ 63%, soit 11 millions,
résident dans des zones informelles, aussi appelées ashwaiyat, qui se sont développées
illégalement depuis les années 1960. Au contraire, les périphéries planifiées, c’est-à-dire les
villes nouvelles et les new settlements7, ne regroupent pour le moment qu’un faible nombre
d’habitants, évalués à un peu plus de 600 000 en 2006 (Sims, 2012). Malgré cette
disproportion en termes démographiques, les quartiers fermés qui fleurissent dans les
périphéries désertiques de Six-Octobre (à l’ouest) ou du Nouveau Caire (à l’est) bénéficient
d’une large visibilité notamment grâce aux campagnes publicitaires de leurs promoteurs
privés. Les compounds sont également omniprésents dans le discours politique d’avant 2011
et présentés comme des succès par un régime qui a petit à petit renoncé à l’ambition sociale
qu’il accordait aux villes nouvelles pour déléguer au secteur privé son rôle de constructeur de
logements dans les périphéries planifiées.
Ce changement de discours et d’orientation politique est intervenu au tournant des années
1990 dans un contexte de libéralisation économique. Le « retrait de l’Etat bâtisseur »
(Jossifort, 1995) et l’abandon des programmes de logement social dans les villes nouvelles
(Florin, 2011) s’expliquent notamment par l’échec de ces projets dont le coût relativement
7 Le premier schéma directeur de 1970 prévoit la création de plusieurs villes nouvelles en Egypte, dont six autour du Caire afin de décongestionner la capitale égyptienne. La construction de la première ville nouvelle, Dix-de-Ramadan (située à plus de 50 km à l’est du Caire), commence en 1977. Le schéma directeur de 1983 prévoit ensuite la construction de dix new settlements (tagammu), plus proches de la ville, comme dans la zone actuelle du Nouveau Caire (Jossifort, 1995).
- 10 -
élevé et le manque d’accessibilité en plein désert ont contribué à en faire des « villes
fantômes ». Si certains programmes publics de logement sont toujours en cours dans les villes
nouvelles, la plupart des projets construits depuis les années 1990 ont été initiés par des
sociétés privées qui ont pour certaines profité de contrats avantageux pour l’acquisition de
terrains à très bas prix grâce à des relations étroites avec le régime au pouvoir.
Les compounds qui se développent alors dans les périphéries désertiques contribuent à
durablement changer « l’image, la nature et le statut des villes nouvelles » (Florin, 2005,
p. 103) par l’introduction de nouvelles formes urbaines. Contrairement à la densité et la
mixité fonctionnelle que les schémas directeurs des années 1970 envisageaient pour les villes
nouvelles, celles-ci sont marquées aujourd’hui par une forme d’urbanisation « étale et
éclatée » caractéristique des compounds peu denses et fermés.
1.2 Une gouvernance locale déficiente
La croissance urbaine qui repousse continuellement les marges de l’agglomération cairote
pose la question cruciale de la gouvernance8 d’une ville tentaculaire et considérée, à bien des
égards, comme « hors de contrôle ». Si la ville fonctionne « malgré tout », comme le
remarque David Sims, force est de constater le dysfonctionnement des institutions publiques
chargées d’encadrer et de réguler le développement urbain.
Il existe différents échelons de mahaliyyat, les « unités administratives juridiquement
autonomes », depuis la maille la plus large du gouvernorat (muhafaza) jusqu’au quartier
(hay). A chaque niveau correspondait, avant la révolution de 2011, deux conseils responsables
de la prise de décision et l’implantation des politiques locales : le conseil des fonctionnaires
locaux (nommés par le gouvernement) et le conseil populaire local (élu par les citoyens).
Dans les faits, il s’agissait essentiellement d’une « décentralisation informelle et sans
politique » (Ben Néfissa, 2011) puisque le conseil populaire n’avait aucun réel pouvoir sur les
fonctionnaires locaux et ceux-ci recevaient leurs instructions de la part du gouvernement
central. Par ailleurs, les responsabilités de ces unités locales manquaient d’une claire
délimitation par rapport au pouvoir central ce qui alimentait à la fois l’inefficacité et la
corruption dont souffraient en premier lieu les citoyens les plus défavorisés qui n’avaient
d’autre recours que ces administrations locales déficientes en cas de problème.
8 On entend ici le terme de gouvernance au sens de combinaison d’acteurs différents qui contribuent à la gestion et l’organisation de la ville soit « par le haut », comme l’Etat et les institutions publiques qui en dépendent, ou « par le bas » comme les acteurs privés, les groupes d’action citoyenne ou les ONG (par exemple Tadamun).
- 11 -
Ces conseils locaux ont été dissolus après 2011, la majorité des membres élus appartenant
alors au Parti National Démocratique, parti de la majorité qui soutenait Hosni Moubarak.
Cependant, les dysfonctionnements qui les caractérisaient n’ont pas disparu et continuent de
grever la vie politique locale. La trop grande centralisation administrative, le manque de
coordination entre les différentes agences gouvernementales responsables de l’application des
politiques urbaines, les compétences lacunaires des fonctionnaires travaillant dans ces
agences ainsi que l’attitude réfractaire des acteurs privés représentent autant de handicaps à
une action publique efficace (Nada, 2014). Ces problèmes persistants conduisent ainsi
certains groupes de citoyens à mettre en place leurs propres stratégies de développement
local, une « do-it-yourself governance » pour reprendre l’expression de Kareem Ibrahim et
Diane Singerman (2014) de l’ONG Tadamun, tout en continuant d’exiger par des actions de
protestation collective plus de prise de responsabilité de la part du gouvernement.
De manière générale, tout se passe comme si la vie politique locale était inexistante en
Egypte et s’apparentait à une simple gestion administrative déficiente. Selon Sarah Ben
Néfissa, au-delà des problèmes de fonctionnement, il existerait une réelle incompatibilité
entre la politique et l’échelon local dans le système de gouvernance égyptien :
« Dans le vocabulaire politique égyptien, « politique » et « local » sont des termes antinomiques. La politique est une activité « nationale » et « centrale », et même si tous les citoyens de ce pays vivent indéniablement dans le « local », ce dernier se gère de façon administrative et non politique. » (Ben Néfissa, 2011, p. 344)
Cette distinction entre politique nationale et administration locale semble essentielle pour
saisir le rapport des habitants rencontrés au politique ainsi que leurs représentations sur la
gestion de la ville du Caire en général. Dans ce contexte de corruption et de
dysfonctionnement des institutions publique locales, le fait d’habiter dans un compound, où la
gestion privée permet d’échapper à ces contraintes, méritera d’être examiné.
1.3 Ville et révolution : des lieux-symboles du centre aux marges périurbaines
La révolution qui a éclaté le 25 janvier 2011 place Tahrir (lit. « place de la libération »),
dans la vague de soulèvements des printemps arabes, peut être lue comme « un fait urbain
total ayant eu pour théâtre les villes » (Stadnicki, 2012). Les rues des grandes villes
égyptiennes d’Alexandrie, Suez, Port-Saïd et bien sûr du Caire ont en effet constitué le cadre
des manifestations et des affrontements parfois violents du début de la révolution en 2011
jusqu’à la destitution de Moubarak le 11 février. Elles se sont soulevées à nouveau fin 2011 et
en 2012, contre le Conseil supérieur des forces armées, puis contre le régime des Frères
- 12 -
musulmans dirigé par Mohammed Morsi à partir du 30 juin 2012. Le 30 juin 2013, un an
après l’investiture du premier président égyptien élu, un nouveau mouvement populaire
unitaire lancé par le groupe Tamarod (lit. Rébellion), a réuni plus de dix millions de
manifestants dans toute l’Egypte et obtenu, avec l’aide de l’armée, la destitution du président
Morsi. A chacune de ces étapes, qui ont ponctué la transition politique depuis janvier 20119,
les manifestations ont durablement marqué physiquement et symboliquement les villes
égyptiennes. Au Caire, si Tahrir incarne toujours l’ambition révolution populaire initiale,
d’autres lieux de rassemblement ont acquis une connotation symbolique (cf. Fig. 2). Ainsi, la
place Ittihadeya, devant le palais présidentiel à Héliopolis, constitue le lieu de référence des
manifestations anti-Frères musulmans, notamment celles du 30 juin 2013. Quant à la place
Rabia al-Adawiyya, à Nasr City, elle est devenue le bastion de la résistance des partisans des
Frères musulmans face au régime autoritaire dirigé par l’armée qui a remplacé le
gouvernement Morsi début juillet 201310.
Plus qu’un cadre des luttes politiques qui ont secoué l’Egypte depuis le déclenchement de
la révolution, les villes égyptiennes, et Le Caire en particulier, ont représenté un enjeu de
l’agenda révolutionnaire. Ce sont des slogans appelant à plus de justice sociale et à de
meilleures conditions de vie qui ont rassemblé des populations urbaines de tout niveau social
aux premiers temps de la révolution. Critique ouverte de la politique urbaine néolibérale
menée par le régime de Moubarak, ces manifestations se sont également accompagnées d’une
réappropriation des lieux publics contrôlés par un Etat autoritaire (Stadnicki, 2012). La ville
égyptienne, et plus particulièrement les rues et places symboliques du centre-ville cairote, a
donc constitué à la fois le théâtre, l’enjeu et le moyen du soulèvement révolutionnaire et de la
transition politique.
Cependant, la place des périphéries formelles et informelles dans les soulèvements
urbains de la transition politique reste méconnue. Que s’est-il passé dans ces marges urbaines
lointaines ? Dans le cas particulier les quartiers fermés, les compounds, situés dans les villes
nouvelles périphériques, comment la révolution a-t-elle été perçue et vécue par les habitants ?
A ces questions qui commencent à retenir l’attention11 et auxquelles on a cherché des
9 Cf. annexe 3 pour une chronologie détaillée de la transition politique depuis 2011. 10 Le 14 août 2013, un sit-in de partisans du régime déchu des Frères musulmans est violemment dispersé par l’armée. Amnesty International évalue le nombre de victimes à plus de 800 (http://www.amnesty.ch/fr/pays/moyen-orient-afrique-du-nord/egypte/docs/2013/les-autorites-egyptiennes-doivent-intervenir). 11 Voir notamment Urban Research (30/11/2013).
- 13 -
réponses sur le terrain, beaucoup sont tentés de répondre que les marges urbaines, a fortiori
aisées, restent largement imperméables à l’agenda révolutionnaire populaire :
« The chants for bread and freedom which rang around Tahrir Square will never be heard in the exclusive shopping mall, luxury apartments and golf course of Uptown Cairo and Emaar Square12 » (Elshahed, 7/04/2014)
L’étude du rapport au politique des habitants des compounds s’inscrit à la fois dans ce
contexte égyptien postrévolutionnaire et, sur le plan théorique, dans un débat académique sur
le rapport entre privatisation résidentielle et participation politique.
2. Privatisation résidentielle et rapport au politique
2.1 La gated community : marqueur urbain d’un apolitisme néolibéral ?
Le développement puis l’exportation à partir des années 1980-1990 d’un modèle nouveau
de privatisation résidentielle, celui de la gated community américaine, a suscité l’émergence
d’un vif débat académique en géographie sur le rapport entre privatisation résidentielle et
rapport au politique. Ce débat s’articule autour d’une double opposition entre espace public et
espace privé d’une part et entre démocratie et apolitisme d’autre part (Kirby, 2008). La gated
community représente une forme particulièrement extrême de la privatisation et de la
segmentation résidentielle et cristallise à ce titre beaucoup de critiques adressées plus
généralement à l’influence croissante des acteurs privés dans la gouvernance urbaine.
Celle-ci relèverait pour certains auteurs (Davis, 1999 ; Davis, Monk, 2007) d’un
urbanisme néolibéral qui serait caractéristique des économies occidentales et se traduirait par
un retrait de l’Etat dans la fabrique de la ville parallèlement à un recours de plus en plus
fréquent à des acteurs privés, parfois dans le cadre de partenariat de type public-privé, pour
s’y substituer. Conséquence d’une reconfiguration du champ de la construction et de
l’aménagement urbain en faveur des promoteurs et constructeurs privés, des espaces urbains
auparavant publics tant dans leur gestion que dans leur accès sont désormais produits et gérés
de manière privée (Le Goix, Loudier-Malgouyres, 2004). Vivement critiquée, la privatisation
urbaine serait synonyme selon certains auteurs d’un accroissement des inégalités socio-
spatiales tandis que le passage d’une gouvernance publique à une gouvernance privée se
12 « Les slogans qui ont résonné place Tahrir pour demander du pain et la liberté ne seront jamais entendus dans le centre-commercial exclusif, les appartements luxueux et le golf de Uptown Cairo et Emaar Square [deux projets immobiliers en cours de réalisation à l’est du Caire par la société émiratie Emaar] ». (Traduction et précision par nos soins).
- 14 -
traduirait par une privation d’un « droit à la ville » égal pour tous et par une perte des valeurs
démocratiques (Mitchell, 1995).
En s’appuyant sur des enquêtes de terrain dans des quartiers résidentiels fermés et en
adoptant une perspective historique qui permet de nuancer la privatisation résidentielle sur le
temps long, d’autres auteurs montrent, dans des contextes nationaux américains et européens,
que le statut de propriété privée ne détermine pas pour autant une tendance apolitique des
habitants (Kirby, 2008 ; Glasze, 2005) et que le quartier résidentiel privé ne constitue qu’une
forme nouvelle d’une privatisation résidentielle déjà ancienne (Callen, Le Goix, 2007).
Dans le cas des quartiers résidentiels fermés situés en périphérie urbaine, comme c’est le cas
pour la plupart d’entre eux, s’ajoute à l’influence éventuelle de la privatisation urbaine celle
de la distance au centre-ville sur le rapport au politique des habitants. Des études menées sur
le cas canadien montrent ainsi la tendance à un vote plus conservateur dans les banlieues
résidentielles que dans le centre-ville et expliquent cette différence, au-delà de l’importance
de plusieurs facteurs socio-économiques, par les enjeux liés à la localisation périphérique
susceptibles de favoriser un soutien politique conservateur (Walk, 2004 ; 2005 ; 2006).
La littérature académique sur les compounds cairotes s’inscrit dans ce débat théorique global
et traduit l’importation, pour comprendre les mutations urbaines dans le contexte égyptien,
d’une grille de lecture importée du contexte européen et nord-américain.
2.2 Les compounds cairotes : des enclaves apolitiques ?
Comme leurs équivalents américains ou européens, les compounds égyptiens, et
notamment les plus haut de gamme et exclusifs d’entre eux, ont fait l’objet de critiques
récurrentes. Enclaves ou forteresses dont les habitants feraient explicitement le choix égoïste
d’entériner la ségrégation socio-spatiale de la métropole cairote, les compounds sont souvent
critiqués pour leur caractère exclusif et la rupture matérielle et politique qu’ils introduiraient
avec le reste de la ville.
Compounds, vie privée et désaffiliation politique : une critique récurrente
Habiter dans un compound est perçu par certains auteurs comme le signe d’une
« désaffiliation et d’un désintérêt vis-à-vis de la vie urbaine », de la part des habitants, au
profit d’une « vie privée » qui offre davantage de liberté qu’ailleurs dans un contexte
politique autoritaire (Denis, 2006). Cette « auto-organisation exclusive » s’accompagnerait,
en parallèle d’un rejet de la société urbaine cairote, d’une affiliation identitaire à un univers de
référence commun à une « élite transnationale ». Ce « rêve global » (De Konig, 2009), qui se
- 15 -
mêle au discours exclusif de promotion d’un mode de vie réservé à des catégories sociales
supérieures, s’accompagnerait d’une absence de prise en compte des questions d’équité
sociale dans le projet d’un « Caire global ».
« The celebration of these specific amenities [compounds, malls etc.] highlights the intimate connection between this quest for the global and Cairo’s upper and upper-middle class. It also illustrates the irrelevance of the majority of the city’s spaces and inhabitants to a globally appropriate Cairo and displays a worrying absence of concern for questions of social equity, even survival.13 » (De Konig, 2006, p.48-49)
Dès lors, l’isolement matériel et symbolique des habitants de ces compounds exclusifs se
traduirait également par un désinvestissement et un désintérêt politiques. En contribuant à
l’émergence d’une ville duale, fragmentée et marquée par de fortes inégalités socio-spatiales,
les compounds seraient alors « le symptôme d’une mise à l’écart d’une autre nature,
proprement politique » (Florin, 2011, p. 142). Le désintérêt supposé pour la vie politique des
habitants des quartiers riches en général, et de ces compounds en particulier, seraient une
conséquence de leur situation privilégiée dans les réseaux clientélistes tissés entre les hommes
d’affaires responsables des développements résidentiels privés et les élites politiques. Sarah
Ben Néfissa rapporte ainsi les propos d’un élu local de l’ancien parti du président Moubarak :
« « Dans les quartiers riches, personne ne s’intéresse au politique », dit par exemple un élu local PND du gouvernorat de Guiza. Et en effet, les « riches » n’ont pas besoin de « ce type de politique », de ménager leur proximité avec l’administration, leur accès aux ressources étatiques pour en « manger » leur part. Les catégories aisées de la population utilisent les services éducatifs et sanitaires du secteur privé, et les services de base – eau, gaz, électricité – leur parviennent « naturellement », ajoute l’élu déjà cité. » (Ben Nefissa, 2007)
Ainsi, les compounds, entendus comme des enclaves résidentielles réservées à des
catégories sociales supérieures qui adhèrent à un « rêve global » et recherchent la
déconnection avec le reste de la ville, sont soit perçus comme le lieu d’une « démocratie
privée » (Denis, 2006), soit comme des lieux apolitiques, dans tous les cas à l’écart de la
politique « hors les murs ». C’est précisément cette représentation largement partagée que
nous avons cherché à tester lors de notre enquête de terrain.
Les limites de la critique : quand les compounds se font complexes
Avant de revenir plus en détails sur les résultats de cette recherche, il est nécessaire
d’apporter quelques nuances concernant le postulat de départ qui sous-tend la critique exposée
13 « La mise en avant enthousiaste de ces aménités spécifiques [compounds, centres commerciaux etc.] souligne l’étroitesse du lien entre cette quête de globalité et les classes supérieures et moyennes-supérieures du Caire. Ceci illustre également l’absence de pertinence de la majorité des espaces et des habitants dans une appropriation globale du Caire tout en révélant un manque de prise en compte inquiétant des questions d’équité sociale, voire de survie. » (Traduction par nos soins).
- 16 -
précédemment. Tout d’abord, contrairement à ce que peut laisser penser la critique de ces
compounds exclusifs, ceux-ci sont loin de représenter la norme dans le paysage périurbain
cairote actuel. Les compounds ne sont pas tous des enclaves rigoureusement fermées et
exclusivement réservées à une élite. Cette description correspond à des cas extrêmes et rares,
celui de quelques quartiers luxueux qui ne représentent qu’une infime partie, tant en
superficie qu’en nombre d’habitants, du total des compounds qui se développent dans les
villes nouvelles. En parallèle de cette offre haut de gamme, d’autres quartiers résidentiels
privés et fermés visent une clientèle de classes moyennes et se caractérisent par une fermeture
beaucoup moins exclusive14.
Par ailleurs, le défaut principal de ces différentes études réside dans l’absence d’une
enquête de terrain auprès des habitants. Comme le souligne Bénédicte Florin (2012), peu de
chercheurs ont osé franchir les portails bien gardés de ces quartiers pour aller à la rencontre
des habitants (Bouhali, 2009). Les arguments avancés sur le rapport supposé distant au
politique des habitants de ces quartiers reposent ainsi souvent sur des spéculations élaborées à
partir du discours promotionnel et officiel des promoteurs privés, qui se donne à voir
notamment dans les brochures publicitaires pour ces quartiers ou lors d’entretiens avec des
responsables de ces entreprises (Curtelin, Frais, 2010). Il semble a priori bien hasardeux de
déduire de ces discours promotionnels la stratégie résidentielle des habitants qui vivent dans
ces quartiers sans prendre la peine de confronter ces représentations sur papier glacé à leur
vécu quotidien.
C’est pour remettre en question cette représentation largement partagée dans la littérature
grise et académique sur les compounds comme des enclaves apolitiques que nous avons choisi
d’étudier plus particulièrement un quartier de classes moyennes, Rehab, et d’aller directement
à la rencontre des habitants pour comprendre leur trajectoire résidentielle et leurs
représentations à la fois politiques et urbaines. Afin d’étudier les interrelations entre les trois
pôles du triptyque qui résume notre approche de géographie politique « par le bas »15, il a tout
d’abord fallu réfléchir à une méthodologie adaptée au recueil de données principalement
qualitatives.
14 Cf. Fig. 2 pour un aperçu des différents types de quartiers résidentiels observés au Nouveau Caire. 15 Les relations entre les différents pôles de ce triptyque sont résumées par le schéma présenté en introduction, cf. Fig. 1.
- 17 -
3. L’enquête de terrain : une méthodologie faite de « bricolages et d’arrangements »16
3.1 Le choix d’une approche qualitative
En amont du séjour de terrain au Caire réalisé au mois d’avril, j’ai élaboré une
méthodologie d’enquête qualitative. Le choix d’une approche qualitative s’est imposé de lui-
même, étant donné l’absence d’accès aux données quantitatives sur les comportements
politiques (par exemple la participation et les résultats de vote) à l’échelon local. Si ces
données existent, elles ne sont communiquées qu’avec extrême prudence par les autorités
égyptiennes et il m’aurait été difficile d’y accéder lors de mon court séjour au Caire. De plus,
l’étude du « rapport ordinaire au politique » des habitants des compounds suppose de
travailler sur le discours de ces acteurs pour saisir leurs représentations et mieux comprendre
leurs pratiques politiques, ce qui exige de recourir à des méthodes qualitatives telles que
l’entretien semi-directif ou l’observation.
Afin de bénéficier d’une perspective la plus large possible sur les quartiers étudiés, la
compilation et la comparaison des résultats obtenus par plusieurs méthodes d’enquête,
présentant chacune des avantages différents et complémentaires (Olivier de Sardan, 1995),
m’a semblé nécessaire. J’ai recueilli dans un journal de terrain à la fois les observations
quotidiennes en rapport avec mon sujet et les pistes de réflexion suscitées par l’avancée de
mon enquête (Beaud, Weber, 2010). En plus de l’imprégnation de l’actualité politique
égyptienne facilitée par un mois de séjour au Caire, j’ai passé trois journées entières au
Nouveau Caire pour une observation plus spécifique des compounds. Lors d’une première
visite, j’ai exploré successivement lors d’un circuit en voiture les différentes zones en
construction du Nouveau Caire ainsi que plusieurs compounds haut de gamme : Mirage City,
Cairo Festival City, Katameya Heights, Katameya Residence et Swan Lake (cf. Fig. 2).
Ensuite, je suis allée à deux reprises en bus jusqu’à Rehab, où j’avais rendez-vous pour des
entretiens, afin de réaliser un relevé de terrain et de prendre des photographies. Ces visites ont
permis à la fois de retranscrire les observations en données et à m’imprégner de l’ambiance de
ces quartiers.
Avant de réaliser les premiers entretiens avec des habitants du Nouveau Caire, j’ai
réfléchi, plutôt qu’à un questionnaire précis, à un canevas de questions et de thèmes
pertinents, susceptible d’être affiné au fur et à mesure. Il s’agissait d’avoir à l’esprit lors de
l’entretien les « questions qu’on se pose » plutôt qu’un guide d’entretien des « questions 16 En référence à l’article de S. Guyot (2009).
- 18 -
qu’on pose » (Olivier de Sardan, 1995). Cette approche plus souple avait pour objectif de
mettre en confiance les enquêtés en donnant à l’entretien la tonalité d’une discussion plus que
d’un questionnaire.
3.2 L’expérience de terrain : s’adapter aux aléas et faire feu de tout bois
Si j’envisageais à l’origine de mener une approche comparative entre plusieurs
compounds du Nouveau Caire, l’insertion dans les réseaux locaux francophones et
francophiles ont largement contribué à concentrer mon enquête sur la ville de Rehab. A
quelques exceptions près, la plupart de mes interlocuteurs, contactés soit par le biais des
étudiants de l’Université Française d’Egypte (UFE) située à Shorouk (ville nouvelle à l’est du
Caire), soit par l’intermédiaire du réseau de l’Institut Français d’Egypte (IFE), se trouvaient
tous habiter à Rehab17. Cette coïncidence, a priori réductrice, m’a toutefois permis de
rencontrer des profils assez divers tant sociologiquement (hommes/femmes,
chrétiens/musulmans, étudiants/actifs) qu’économiquement (propriétaires/locataires). Autre
avantage apporté par ce réseau, j’ai pu réaliser la quasi-totalité des entretiens en français (à
l’exception de trois en anglais). Cependant, ces neuf entretiens à Rehab ne permettent
évidemment pas de généraliser les propos obtenus et on s’attachera dans le rendu des résultats
à mettre en évidence, plus qu’une tendance générale, des profils particuliers correspondant
aux habitants rencontrés. En guise de « contrôle », des entretiens avec des habitants d’autres
quartiers fermés (Mirage, Madinaty) ou non (Maadi) ainsi qu’avec des experts ont permis de
mettre en perspective certaines observations relevées à Rehab.
Pour compléter ces entretiens et les observations de terrain, j’ai également exploré la piste
des médias sociaux sur Internet. Au fil de recherches menées dans plusieurs directions, j’ai
trouvé sur Youtube des vidéos de manifestations qui se sont déroulées à Rehab et des pages
Facebook créées par des résidents de différents compounds dont le contenu est révélateur de
l’utilisation qui est en faite en tant que plateformes de discussion18.
Enfin, il a fallu s’adapter sur le terrain aux contraintes rencontrées. La première
contrainte, matérielle, à prendre en compte a été la distance de ces quartiers au centre du
Caire, où je résidais. La connaissance du mode de fonctionnement des transports (bus et taxi)
ainsi que la maîtrise du vocabulaire de base en égyptien ont toutefois grandement facilité mes
déplacements. Cette contrainte m’a cependant obligée à organiser et réfléchir précisément en
amont à l’objectif de chaque journée de visite au Nouveau Caire. 17 Pour un bilan plus détaillé des différents entretiens réalisés, cf. annexe 1. 18 Cf. annexe 1 pour plus de détails.
- 19 -
Au cours des entretiens, il a également fallu dépasser la contrainte psychologique
rencontrée chez certains habitants lorsqu’il s’agissait de parler de politique, sujet qui reste
sensible aujourd’hui en Egypte. Une première expérience ratée m’a conduit à adapter le
canevas de départ en fonction de l’ouverture des enquêtés aux sujets de nature politique. De
manière générale, j’ai opté pour une stratégie de « contournement » qui consistait à mettre les
enquêtés en confiance en commençant par des questions plus « neutres » sur la manière dont
ils se sentaient dans leur quartier et leurs raisons d’y habiter avant d’orienter la discussion sur
l’actualité politique et leur rapport au politique.
Enfin, le statut d’étrangère et de chercheuse dont je bénéficiais sur le terrain a dû être
exploité astucieusement. Si celui-ci a représenté un biais en me dirigeant presque
exclusivement vers des interlocuteurs égyptiens francophones, donc dépositaires d’un certain
capital culturel qui n’est pas partagé par tous les habitants de Rehab, il a également constitué
un atout pour aborder les pratiques et les représentations politiques des habitants. Il m’a
semblé que la curiosité, associée à une certaine naïveté volontairement surjouée, était
globalement bien acceptée et excusée par mon statut d’étrangère. Malgré parfois une
divergence d’opinion avec mes interlocuteurs, j’ai veillé pendant les entretiens à garder une
position de neutralité bienveillante qui encourageait les confidences et, après l’entretien, à
prendre le temps de comprendre sans juger hâtivement les propos tenus par les habitants
rencontrés.
* * *
Après cette présentation du contexte pratique et théorique qui pose le cadre de ce travail
de recherche, le compte-rendu des résultats de l’enquête de terrain peut se décliner à deux
niveaux. On s’attachera tout d’abord à esquisser plusieurs trajectoires du rapport ordinaire au
politique des habitants des compounds et à proposer des pistes pour comprendre l’effet de la
gestion privée sur celui-ci (deuxième partie). Il s’agira ensuite de réfléchir à la place occupée
par les compounds cairotes dans la configuration spatio-politique actuelle (troisième partie).
- 20 -
DEUXIEME PARTIE
Le rapport ordinaire au politique des habitants des compounds cairotes, quel effet de lieu ?
Fig. 4 : Etude de l’effet de lieu du compound (1) sur le rapport ordinaire au politique des habitants (2).
Un premier objectif de notre travail de terrain était de chercher à comprendre quel rapport
ordinaire les habitants des compounds étudiés au Nouveau Caire, notamment ceux de la ville
fermée de Rehab, entretiennent vis-à-vis du politique. Afin de mettre en évidence les
spécificités du rapport au politique et des éventuelles modalités de la mobilisation de ces
habitants, on propose de partir des modèles descriptifs classiques de sociologie politique et
d’y introduire un jeu d’échelles spatiales et temporelles. En décomposant ainsi le rapport
ordinaire au politique des habitants rencontrés, certaines tendances se dessinent en contraste
avec celui observé auprès d’habitants d’autres quartiers du Caire. Comment dès lors expliquer
un désintérêt manifeste pour l’échelon politique méso – correspondant à la gouvernance
urbaine de l’agglomération cairote – ainsi qu’un certain décalage temporel dans la
mobilisation ? On propose d’examiner l’effet de lieu, généré par la nature privée de la gestion
du quartier, comme une cause parmi d’autres d’un rapport au politique guidé par une certaine
rationalité en finalité.
1. A la recherche des « répertoires invisibles » du politique
Dans les entretiens conduits avec des habitants, nos questions visent à recueillir des
pratiques et des représentations permettant de cerner leur rapport ordinaire au politique19
19 Cf. Introduction, p. 6.
LIEU Compound
ACTEURS Habitants
POLITIQUE Rapport ordinaire
(2) (1)
- 21 -
(abrégé par la suite en ROP). En les interrogeant sur l’intérêt qu’ils portent à la politique
nationale ou à la manière dont la ville du Caire et leur propre quartier sont gérés, ainsi que sur
leurs actions pour améliorer les problèmes soulevés, on parvient à saisir différents types de
ROP en fonction du « degré de distance au politique formalisé et finalisé » (Lefébure, 2009,
p. 380). Le « ROP avec débouché spécifique prolongé », tel celui du militant, se distingue
ainsi du « ROP avec débouché spécifique ponctuel », caractéristique du manifestant descendu
par exemple quelques fois dans la rue. Enfin, le « ROP sans débouché spécifique » se
déclinent par exemple à travers les discussions et les échanges quotidiens à propos de la
politique.
Cette première typologie des ROP peut être complétée par le modèle classique des
répertoires de mobilisation développé par Albert Hirschman (1970) et repris par Olivier
Fillieule et Mounia Bennani-Chraïbi (2003) pour étudier les modalités de résistance dans les
pays arabes autoritaires avant 2011. Quand le ROP se caractérise par une insatisfaction à
l’égard du politique et se traduit par la participation à une action collective, cette mobilisation
peut relever de plusieurs « répertoires », entendus comme différentes manières de mobiliser
ses ressources personnelles (temps, relations sociales, argent…) dans un certain contexte
social et politique. Selon le modèle de Hirschman, un individu rationnel confronté à une
insatisfaction peut réagir de trois manières différentes : accepter la situation sans s’opposer
(loyalty), exprimer son opposition (voice) ou sortir du système pour échapper au problème
sans chercher à le résoudre (exit). A ces trois modalités, il est possible d’ajouter l’« apathie »
qui correspond à l’attitude passive adoptée par un individu qui reste dans le système malgré
son désaccord sans pour autant être loyal (Bajoit, 1988). Ce modèle, qui suppose que chaque
individu agit de manière rationnelle et choisit une modalité d’expression de son insatisfaction
en fonction de l’estimation qu’il fait des gains et pertes associés, permet de distinguer
certaines modalités de la mobilisation parmi les habitants des quartiers fermés du Caire.
Cependant, Erik Neveu (2009) incite à prêter attention aux « répertoires [d’action]
invisibles » qui peuvent exister, notamment dans un contexte autoritaire comme en Egypte,
dans « les interstices entre prise de parole et défection, prise de parole et loyauté » (p. 506).
C’est précisément avec pour objectif de saisir ces « répertoires invisibles » qu’on se propose
d’introduire dans l’analyse des pratiques et représentations récoltées lors des entretiens avec
les habitants une double échelle spatiale et temporelle qui permet d’apporter plus de nuances
dans les modalités des ROP et des mobilisations.
- 22 -
Afin de mettre en évidence les caractéristiques du rapport au politique des habitants des
compounds, on a distingué, dans les questions posées pendant les entretiens, trois niveaux de
politique en fonction de l’objet et l’échelle des préoccupations (cf. annexe 2) :
- la politique nationale : questions sur l’intérêt pour le débat politique égyptien, sur la
participation aux élections présidentielles de juin 2014 ;
- la politique à l’échelle de la ville du Caire : questions sur les problèmes qui semblent
les plus importants à régler dans la gestion de la ville ;
- la politique locale : questions sur la gestion du quartier et l’éventuelle participation des
habitants à une association de copropriétaires ;
Puisque la spécificité de la vie politique locale sera étudiée plus particulièrement dans la
troisième partie, sur la nature des compounds comme lieux du politique, on abordera ici le
rapport au politique à l’échelle nationale et à celle de la métropole cairote avant d’étudier
l’effet de lieu du quartier fermé et privé sur ce rapport particulier au politique.
2. L’écho de Tahrir : un intérêt général pour la politique égyptienne, une mobilisation de l’apathie à la prise de parole
2.1 Le rapport à la politique nationale derrière les murs : un intérêt manifeste et partagé
La bonne volonté de toutes les personnes interrogées (à l’exception d’une seule) à
discuter de politique est révélatrice de l’intérêt porté par les habitants des compounds, comme
par les autres Egyptiens, à la transition politique actuelle dans le pays. Les réactions sont
unanimes à la question « vous intéressez-vous à la politique ? ». Pour Ahmed, dentiste qui vit
et travaille à Rehab, la réponse ne fait aucun doute : « of course, it’s Egypt here too! ». Pour
Abdullahi, étudiant à l’Université Française d’Egypte qui habite aussi à Rehab mais qui est de
nationalité suisso-somalienne, c’est également une évidence même si lui, personnellement, ne
s’y intéresse pas :
-‐ Dans ton quartier, les gens sont intéressés par la politique ? Ils en parlent ? -‐ Bien sûr, il n’y a personne qui ne parle pas de politique, personne. Tous les jeunes
d’aujourd’hui regardent Bassem Youssef20 par exemple. Le lendemain, ils en parlent. Souvent ça s’arrête là mais il y a aussi des jeunes expérimentés, dans ma classe en tout cas il y en a.
-‐ Qui connaissent beaucoup la politique ?
20 L’évocation de Bassem Youssef, célèbre présentateur et humoriste égyptien dont l’émission satirique « El Barnameg » (lit. « Le programme ») est suivie par de nombreux Egyptiens le vendredi soir, est révélatrice de la diffusion, par la télévision, des débats politiques nationaux « derrière les murs » des quartiers fermés.
- 23 -
-‐ Qui connaissent beaucoup, qui parlent beaucoup, qui sont contre [untel] ou qui sont pour…
-‐ Et toi ça t’intéresse ou pas ? -‐ Bien sûr que non, j’aime pas ça… En fait c’est pas mon pays donc ils peuvent faire ce
qu’ils veulent.21
Si l’actualité politique, et notamment la perspective des élections présidentielles au
moment de notre terrain, constitue le sujet de discussion numéro un dans les compounds
comme ailleurs au Caire, cet intérêt pour la politique nationale se traduit-il par un répertoire
de mobilisation particulier ? Si l’intérêt pour la politique nationale semble partagé par le plus
grand nombre, le passage à la mobilisation lors d’actions collectives reste plus marginal et ne
saurait être généralisé. Cependant, parmi les habitants rencontrés, plusieurs ont opté pour la
« prise de parole » (ou voice selon la typologie de Hirschman) en participant aux
manifestations de 2011 sur Tahrir ou à celles contre le gouvernement Morsi en juin 2013.
Randa, qui habite à Mirage City, un compound résidentiel du Nouveau Caire, explique ainsi
qu’elle est allée manifester avec son mari en juin dernier comme d’autres résidents de
quartiers fermés :
Même des gens qui habitaient dans des compounds, oui, vraiment des gens comme nous, sont allés protester, pas uniquement les gens qui souffraient parce qu’ils ne travaillent pas ou qu’ils ne trouvaient pas à manger. Ce sont des gens qui avaient vraiment peur des intégristes, qui se
sentaient menacés.22
Ahmed a aussi participé à des manifestations en janvier 2011 sur Tahrir car, avec ses
amis, ils « voulaient voir ce qui se passait ». Au contraire, selon Sally, qui habite à Banafseg
dans un immeuble sécurisé face à Rehab, beaucoup ont préféré rester chez eux en 2011 : « on
ne se sentait pas impliqués, on a seulement regardé ce qui se passait à la télévision23 ». Le
répertoire d’action collective des habitants des compounds semble donc avoir oscillé entre la
prise de parole et la loyauté, voire l’apathie. Cependant, en quoi ces répertoires de
mobilisation rejoignent-ils des tendances plus générales parmi la population égyptienne ?
2.2 Le réveil du Hizb al-Kanaba en 2013 : une mobilisation massive, deux ans après 2011
L’introduction d’une échelle temporelle dans l’analyse du répertoire de mobilisation des
habitants rencontrés permet de mettre au jour des nuances entre différentes trajectoires de
politisation. En comparant la nature de la mobilisation lors des manifestations de 2011 et
21 Entretien avec Abdullahi, réalisé le 6 avril 2014. 22 Entretien avec Randa, réalisé le 6 avril 2014. 23 Entretien avec Sally, réalisé le 29 avril 2014.
- 24 -
celles de 2013, deux parcours particuliers de ROP avec débouché spécifique ponctuel peuvent
être mis en évidence. Certains habitants, comme Ahmed ou Randa, ont participé aux
manifestations en 2011 contre le régime de Moubarak et en 2013 contre le gouvernement
Morsi choisissant une stratégie de prise de parole dans les deux cas. Les autres habitants
rencontrés n’ont pas agi de la même manière en 2011 et en 2013, passant d’un répertoire de
mobilisation à un autre en fonction de la configuration politique nationale. Sally et Manel,
toutes deux mères de famille, ont par exemple assisté aux événements de 2011 à distance,
optant pour une stratégie de loyauté ou d’apathie vis-à-vis de l’ancien régime de Moubarak,
mais elles ont activement participé aux manifestations contre le gouvernement dirigé par les
Frères musulmans en juin 2013.
L’évolution de ce répertoire de mobilisation, de l’apathie à la prise de parole, correspond
à celui d’une catégorie socio-politique à la fois vaste et vague que les médias égyptiens et
certains analystes ont décrit comme le « Hizb al-Kanaba », ou « Parti du Canapé », pour
désigner la majorité silencieuse qui a suivi voire encouragé la révolution de 2011 devant la
télévision mais qui est descendue dans la rue en juin 2013 en suivant l’appel du mouvement
Tamarod pour la destitution du gouvernement Morsi24. Catégorie socialement et politiquement
très hétérogène, ce Hizb al-Kanaba représenterait une grande partie de la population
égyptienne dont le répertoire de mobilisation, invisible selon les critères classiques, évolue en
fonction de la configuration politique à un moment donné. Malgré l’hétérogénéité interne de
ce groupe, les membres du Hizb al-Kanaba partageraient, selon Waël Nawara (Al-Monitor,
09/2013), le même souci d’un retour à la stabilité et une grande hostilité aux Frères
musulmans. Ces deux caractéristiques peuvent notamment expliquer leur soutien aux
manifestations du 30 juin organisées par le mouvement Tamarod puis, pour certains, la
confiance placée en la personne du maréchal Abdel Fatah al-Sissi, ex-ministre de la Défense
et nouveau Président de la République.
Au cours de notre enquête, nous avons retrouvé dans les discussions avec des habitants de
Rehab ce désir d’un retour à la stabilité, associé à une critique parfois féroce des Frères
musulmans voire un soutien explicite au maréchal Sissi, suggérant ce rapprochement entre
certains et cette vaste catégorie du Hizb al-Kanaba. Selon Nick Simcik-Arese, doctorant à
24 Pour plus de détails sur le Hizb al-Kanaba, voir notamment Al-Ahram (24/12/2011), Egypt Independent (01/07/2013) et Al-Monitor (09/2013).
- 25 -
Oxford qui a vécu et travaillé un an après la révolution à Haram City25, les nouveaux habitants
de ce quartier, qui appartiennent à des catégories sociales moyennes à populaires,
partageraient également ces caractéristiques du Hizb al-Kanaba. Celui-ci ne constitue
cependant pas l’apanage des classes moyennes qui habitent en périphérie comme l’illustre le
cas de Hala. La jeune femme, qui habite à Maadi, un quartier aisé du sud du Caire, et travaille
comme rédactrice dans un magazine, revendique son appartenance à cette catégorie du Hizb
al-Kanaba, son opposition aux Frères musulmans ainsi que son soutien inconditionné à Sissi
dont elle estime qu’il est le seul à pouvoir garantir la stabilité de l’Egypte26. Ainsi, le
changement de répertoire de mobilisation entre 2011 et 2013 pour certains habitants de
Rehab, de l’apathie à la prise de parole, peut être lu comme un engagement à retardement
dont les compounds n’ont pas le monopole. Si l’on choisit d’interpréter Tamarod comme un
écho de Tahrir, celui-ci a visiblement été largement entendu par le Hizb al-Kanaba de
Rehab… et ailleurs.
3. Echapper à la ville : une stratégie d’exit au service de la distinction sociale
3.1 Fuir Oum el-Dounia, son trafic, sa pollution… et ses habitants : un rapport distant aux enjeux politiques du développement métropolitain
Contrairement à l’actualité politique nationale, les enjeux liés au développement et à la
gouvernance de l’aire métropolitaine du Grand Caire suscitent un intérêt très sélectif, voire
une nette indifférence, de la part des habitants rencontrés. Parmi les problèmes associés à la
ville du Caire, le trafic routier et la pollution (aérienne et sonore) sont toujours identifiés
comme les plus importants et constituent une justification systématique du choix d’habiter en
périphérie. La congestion endémique que subissent tous les Cairotes qui se déplacent en
voiture ainsi que les taux élevés de pollution qui l’accompagnent représentent d’ailleurs un
argument marketing majeur de la part des promoteurs des compounds (Bouhali, 2009 ; Florin,
2012). Le groupe immobilier SODIC promet ainsi aux futurs résidents du compound haut de
gamme Allegria (situé à Sheikh Zayed City, à l’est du Caire), une « touche de sérénité »27 :
25 Haram City est un projet résidentiel intégré, construit par le groupe égyptien Orascom au sud de la ville nouvelle de Six-Octobre dans l’objectif de proposer des logements à bas prix à des catégories sociales disposant de revenus modestes. Entretien avec Nick Simcik-Arese, réalisé le 18 avril 2014. 26 Entretien avec Hala, réalisé le 25 avril 2014. 27 Texte de la brochure : « Tournez le dos au spectacle et aux bruits stressants devenus caractéristiques des quartiers congestionnés du Caire. Evadez-vous des clameurs des voitures, des embouteillages, de la pollution étouffante et des rues encombrées et entrez dans un sanctuaire conçu pour vous
- 26 -
Si les habitants semblent sensibles à ce discours publicitaire promettant une vie plus
verte, plus saine et plus tranquille loin de la ville-mère devenue si étouffante, celle-ci n’est
jamais loin. La plupart des habitants rencontrés, à l’exception de Manel, femme au foyer, et
Ahmed, qui habite et travaille à Rehab, se rendent quotidiennement au Caire pour travailler,
au prix de longs trajets en voiture de plusieurs heures – contribuant ainsi, d’ailleurs, à
l’engorgement routier sur les nouveaux axes périphériques tels que la Ring Road ou la route
de Suez.
La distance physique entre ces quartiers et la ville-centre ne suffit donc pas à faire des
compounds des enclos isolés au milieu du désert : les complémentarités et interdépendances
fonctionnelles que révèlent ces mobilités quotidiennes entre lieu de vie et lieu de travail
contribuent à abolir partiellement cette distance géographique. Cependant, le désir d’une prise
de distance avec la ville, que révèle de façon symptomatique le choix d’habiter dans un
compound si éloigné dans le désert, se manifeste très clairement dans les représentations des
habitants28.
Ces représentations de la ville du Caire (et de ses habitants) sont à prendre en compte non
comme de « simples perception-interprétations de l’environnement physique et social » mais,
selon une approche subjective, comme « productrices de la réalité » (Danic, 2006). Si leurs
pratiques quotidiennes les obligent à se confronter quotidiennement avec une ville dont ils
sont dépendants tout en souhaitant la fuir, leurs représentations mentales, qui transparaissent
dans leurs discours, traduisent un rejet mental de certaines catégories sociales associées, dans
débarrasser du stress quotidien. Voyagez à l’intérieur d’un lieu enchanté et revigorant, où l’air est sain, le rythme de vie serein et la qualité de vie celle d’un rêve. Découvrez un lieu à la porte du Caire, entouré d’une multitude de services, que l’on croirait pourtant à des millions de kilomètres » (SODIC, 2011).Traduction par nos soins. 28 Les modalités de cette stratégie d’exit, notamment fiscale, sont également mises en évidence dans le contexte européen par Zoltan Cséfalvay et Chris Webster (2012) en recourant au cadre théorique de Hirschman ainsi qu’aux théories de l’école du public choice (Buchanan, Tiebout etc.).
Fig. 5 : « Une touche de sérénité » à Allegria. Source : SODIC. (2011). Brochure Allegria.
- 27 -
leur imaginaire, à la ville-mère. Les contraintes matérielles inhérentes à la ville du Caire
glissent ainsi rapidement, dans le discours de certains habitants rencontrés, à une critique
explicite de catégories sociales populaires dont le comportement est jugé oppressant,
dérangeant voire déviant et justifie de prendre ses distances dans l’objectif de préserver un
certain mode de vie. Wadia, qui a déménagé d’un quartier central du Caire, assez populaire, à
Rehab au début des années 2000 apprécie ainsi la plus grande tolérance vestimentaire dans
son nouveau quartier :
-‐ A la piscine du club [de Rehab], c’est un avantage parce que, comme dans les autres clubs au Caire (tels que Aïn Chams ou al-Ahly), il y a des jours pour les femmes et des jours pour les hommes mais ici c’est possible de descendre à la piscine même si ce n’est pas un jour pour les femmes. Moi je peux descendre n’importe quel jour avec ma famille, il n’y a pas de problème, je ne suis pas mal vue par les gens, au contraire.
-‐ Les gens ici sont plus ouverts d’après vous ? -‐ Oui, quand on est allés habiter à Rehab on s’est aperçu que les gens se sont vite habitués à
cette façon de vivre. Par exemple, en été, tu peux voir des hommes en T-shirt et short dans la rue, ce qui ne se passe pas ailleurs, ou les femmes en T-shirt sans manches. Ils se sont habitués à voir ça, c’est devenu une chose normale, ce n’est pas critiqué. Et même les vendeurs dans les magasins se sont habitués à voir cette façon de s’habiller, de se comporter.
-‐ Et ce n’est pas mal perçu par les femmes qui s’habillent de façon plus rigoureuse ? -‐ Non, je pense que c’est la liberté, tout le monde vit sa vie comme il veut, sans être mal vu
par les gens29.
Dans un contexte social de regain du traditionalisme religieux depuis les années 198030,
les compounds apparaissent aux yeux d’une frange libérale et/ou chrétienne de la population
comme un espace de liberté et un moyen d’échapper à une pression sociale devenue parfois
très pesante dans l’espace public, et particulièrement pour les femmes. La coprésence, dans
les espaces ouverts de Rehab, à la fois de femmes intégralement voilées et de femmes
habillées à l’occidentale, sans voile, semble globalement bien tolérée par tous. En accord avec
cette représentation du compound comme d’un lieu de « liberté », on retrouve dans l’offre
commerciale de Rehab des boutiques de vêtements et des services destinées à une clientèle
musulmane rigoriste (Fig. 6 et 7), tandis que les terrasses des restaurants et coffee shops du
food court sont largement fréquentées par des femmes, non voilées pour la plupart,
contrairement à la clientèle traditionnellement très masculine des cafés baladi (lit.
« populaires ») du centre-ville.
29 Entretien avec Wadia, réalisé le 22 avril 2014. 30 Alaa al-Aswany, écrivain et essayiste égyptien, développe largement l’origine et les conséquences de l’importation en Egypte dans les années 1980 d’un rigorisme wahhabite originaire d’Arabie Saoudite dans ses Chroniques de la révolution égyptienne (2011, Actes sud).
- 28 -
En opposition à cette évaluation positive du quartier et de ses habitants, présentés comme
tolérants et familiers de pratiques sociales moins rigoristes, le discours tenu à l’égard des
« autres », qui n’habitent pas dans le compound et qui n’appartiennent pas à ce milieu social
est caractérisé par des jugements souvent négatifs et parfois teintés d’une certaine
méconnaissance qui transparaît sous un mépris explicite. Habiter dans un compound relève
d’une stratégie de distanciation tout autant que de distinction sociale (Bourdieu, 1979) qui, si
elle n’est jamais avouée immédiatement par nos interlocuteurs, se devine dans les propos
tenus sur les nouveaux arrivants dans le quartier ou les « voisins » de quartiers populaires
proches, deux catégories sociales considérées comme une menace à la préservation de la
qualité du quartier et, par là même, du niveau de vie de ses habitants. Pour Wadia, qui est
propriétaire de son appartement et fait partie de la première vague d’habitants de Rehab,
l’arrivée récente de locataires dans son quartier, où tous les résidents étaient à l’origine
propriétaires, représente une certaine menace tant pour la préservation du cadre de vie que de
la « culture » plus ouverte qu’elle était venue chercher à Rehab.
-‐ [A l’origine] c’est aussi une certaine classe sociale qui a commencé à habiter [à Rehab], la façon de penser était différente, la culture était un peu différente, tu ne peux pas trouver la classe sociale très populaire là-bas. C’est tout à fait récent maintenant [de trouver des gens appartenant à des catégories sociales plus populaires] parce que les propriétaires des appartements qui n’y habitent pas commencent à les louer. C’est ainsi que nous, les premiers habitants, les propriétaires des appartements, on souffre actuellement, d’une
Fig. 6 : Boutique, dans le mall 2 de Rehab. On peut y acheter des abayas, vêtement traditionnel de couleur noire porté par les femmes pratiquant un islam rigoriste. Cliché : E. Braud, 2014.
Fig. 7 : Coiffeur féminin, dans le mall 1 de Rehab. La vitrine est opaque pour permettre aux femmes voilées de se faire coiffer à l’abri des regards. Cliché : E. Braud, 2014.
- 29 -
certaine façon, des gens qui viennent habiter à Rehab et qui sont locataires. Ce sont des gens qui ont de l’argent mais qui n’ont pas vraiment la même culture. Quand ces gens ont commencé à « envahir », si on ose dire, Rehab, c’est une nouvelle catégorie de gens qui est venue. Maintenant, si tu viens à Rehab, tu vas trouver beaucoup de Syriens qui ont envahi le marché, qui ont envahi les magasins et qui ont monté leur propre business. Ils ont investi l’argent qu’ils avaient à Rehab pour ouvrir des cafés, des restaurants, des pâtisseries. (…)
-‐ Qu’est-ce que ça change dans l’ambiance de Rehab le fait qu’il y ait plus de Syriens ?
-‐ Le fait que les habitants ne soient pas propriétaires de leur appartement fait qu’ils n’ont pas vraiment peur d’abimer le jardin par exemple parce que ce n’est pas à eux. Moi, je me sens plus responsable car je sens que d’une certaine façon c’est à moi, je paye la maintenance du jardin, de l’immeuble. Je n’aime pas voir un petit garçon qui monte sur une branche d’arbre et qui la casse car nous, en tant que propriétaires, nous payons pour tout ça, ce n’est pas offert.
Les locataires qui commencent à « envahir » le quartier importent avec eux un mode de
vie, une « culture » différente de celle des propriétaires installés depuis longtemps qui
introduit un clivage interne au quartier (ou à la ville dans le cas de Rehab) dans les
comportements et les pratiques quotidiennes. L’exemple des immigrés syriens, souvent cité
par les habitants rencontrés, est révélateur de l’association d’idées qui contribue à former une
catégorie à la fois vaste et vague regroupant les « autres ». Aux yeux des propriétaires, les
locataires et les étrangers ont pour point commun de disposer d’un capital économique
suffisant pour accéder au quartier mais leur moindre capital culturel les distingue des premiers
arrivants. L’impression pour les premiers habitants propriétaires d’être rattrapés par une
catégorie sociale qu’ils cherchaient précisément à mettre à distance en venant s’installer dans
le compound révèle le souci permanent de préserver une forme de distinction sociale fondée à
la fois sur des critères économiques et culturels.
3.2 La méconnaissance au service d’une mise à distance mentale des habitants des quartiers informels
Parmi les « autres » indésirables, qui ne disposent ni du capital économique ni du capital
culturel des classes moyennes-supérieures installées dans les compounds, les habitants des
quartiers populaires proches du Nouveau Caire figurent en tête des catégories sociales dont
certains habitants craignent la proximité et envers lesquelles ils sont soucieux de maintenir
une forme de containment social. Si le désert est perçu comme une zone-tampon entre les
compounds et les quartiers populaires du centre, ce sont les quartiers informels qui s’étendent
sur les marges désertiques, à proximité de ces quartiers fermés, qui représentent une nouvelle
« menace ». Dans le discours de nos interlocuteurs, les habitants du quartier Arbaa wu nos
- 30 -
aussi appelé Izbet al-Hagana31, situé à l’ouest de la Ring Road qui dessert les compounds du
Nouveau Caire (cf. Fig. 2), sont systématiquement décrits comme des baltagueya32 et des
voleurs. La première fois que le nom de ce quartier, que je ne connaissais pas encore, a été
évoqué lors d’un entretien, mon interlocuteur a aussitôt ajouté « qu’il valait mieux ne pas y
aller »33.
La vision étroite et négative d’un quartier géographiquement très proche mais perçu
uniquement par les faits divers et la vision biaisée présentée dans la presse34 révèle une
méconnaissance très nette voie une indifférence manifeste aux enjeux économiques et sociaux
liés au développement de l’habitat informel dans la périphérie du Caire. Cette
méconnaissance, qui est d’ailleurs commune à beaucoup de Cairotes hors des compounds,
sert la formation de représentations mentales en conformité avec la peur fantasmée de ces
quartiers pauvres et de leurs habitants, une « culture de la peur » nourrie par les discours
politiques au service de la promotion des compounds (Marafi, 2011). Une habitante de Rehab
m’a ainsi parlé de Arbaa wu nos en me disant que le quartier s’appelait officiellement « Izbet
al-Hagama », le « quartier des voleurs ». La transformation inconsciente de « hagana »
(gardiens), terme que cette personne ne connaissait pas, en « hagama » (voleurs) révèle la
faculté à renommer et réinventer la réalité pour l’adapter à la représentation négative d’une
certaine catégorie sociale.
Ces représentations mentales, loin de correspondre à une réalité objective, largement
méconnue, contribuent cependant en retour à agir sur cette réalité. En conséquence de ces
représentations caractérisées par une peur et un rejet des habitants originaires des quartiers
informels voisins, certains habitants de Rehab partagent une même préoccupation pour la
sécurité, dont l’objectif est notamment d’empêcher ces « autres » indésirables de rentrer.
31 « Arbaa wu nos » signifie littéralement « quatre et demi » pour désigner la distance en kilomètres du quartier au centre d’Héliopolis, quartier riche de l’est du Caire. L’autre nom, plus ancien et moins usité du quartier est « Izbet al-Hagana », littéralement « quartier des gardiens », car les premiers occupants avaient pour responsabilité de garder ces terres appartenant à l’armée. 32 Le terme arabe « baltagueya » désigne originellement les hommes forts utilisés par le régime pour attaquer et intimider les opposants. Dans le contexte égyptien postrévolutionnaire, il a pris le sens de « bandits » ou « voyous » avec une connotation particulière pour désigner les jeunes issus de quartiers populaires accusés de provoquer la peur et d’user de violence notamment lors des manifestations. 33 A l’occasion d’une journée de terrain dans ce quartier, j’ai pu découvrir, notamment en discutant avec des habitants, les difficultés d’équipement et d’aménagement liées à la nature informelle du quartier (Le Houérou, 2007). Cette visite a permis une mise en perspective intéressante avec les représentations partiales de Arbaa wu nos partagées par les habitants de Rehab. 34 Voir par exemple Darwich (4/06/2008). En comparaison, l’article de Galila El-Kadi (1994) et l’introduction de Singerman et al. (2011) apportent un regard académique enrichissant sur ces quartiers informels et leur présentation dans le discours officiel et les médias.
- 31 -
-‐ I wish gates to be closed, if someone wants to enter he must live here or know someone who lives here. On Thursday, a lot of people come and they are not good people, they come from Arbaa wu nos, you know?
-‐ No, I don’t know, I’ve never been there… -‐ You better not! -‐ They come here to see girls, make troubles and I want these Egyptians not to come.
[Je remarque que je suis rentrée très facilement en bus à Rehab]: “it’s normal, you’re not Egyptian, you are not a problem”
-‐ So you feel like there are a lot of troubles in the streets, a lot of problems? -‐ No, very little compared to outside, in Cairo. I’m happy here35.
Le discours très dur à l’égard des résidents de Arbaa wu nos qui causeraient des
problèmes en venant à Rehab le jeudi soir pour faire la fête semble en partie décrédibilisé par
l’aveu d’une absence de réels problèmes dans le quartier. Ce contraste suggère que ces
« autres », qui ne sont « pas des gens bien », doivent être mis à distance non parce qu’ils
perturbent effectivement la quiétude du quartier mais parce qu’ils nuisent à l’image et l’entre-
soi cher aux habitants36.
3.3 Une autre voie possible : une perception différente de la ville par des habitants hors les murs
Cette mise à distance mentale de la ville ingérable et de ses autres indésirables correspond
à une stratégie d’exit, selon le schéma de Hirschman, bien différente de celle adoptée par des
résidents d’autres quartiers au Caire. Dans l’enquête « Resident Perspective » publiée par le
blog Cairobserver, je me suis intéressée aux réponses données par des habitants de différents
quartiers du Caire à la question concernant leur connaissance de la façon dont la ville du Caire
est gérée et leur opinion quant à une éventuelle participation des citoyens au processus de
décision37. Plus de la moitié des enquêtés disent ne pas connaître du tout ou très mal le mode
de gouvernance de la métropole mais tous expriment un avis négatif sur son fonctionnement
actuel dont ils éprouvent l’inefficacité au quotidien. Les conseils locaux, les mahaleyyat qui
ont d’ailleurs été supprimés depuis 2011, sont décrits comme « inutiles » et « grevés par la
corruption ». Ce constat s’accompagne d’un désir de participation accrue des habitants au
processus de décision dont ils se sentent exclus, sans réelle possibilité d’expression. Même si
35 Entretien avec Ahmed, réalisé le 12 avril 2014. 36 Contrairement à d’autres pays où la peur associée à la criminalité est souvent citée comme un facteur déterminant pour habiter dans une gated community (Low, 2011 ; Capron, 2006), il est intéressant de noter que cet argument n’a jamais été évoqué lors des entretiens, peut-être en raison du très faible taux de criminalité au Caire qui le rend peu crédible. 37 « Do you understand how the city is governed/managed? Do you think your community/district would be better or worst if residents from the community/district were involved in local government (mahaliyyat) ? ». Cairobserver, « Resident Perspective ». [en ligne] URL : http://cairobserver.com/tagged/resident_perspective#.U4iKeV47vN0
- 32 -
certaines critiques à l’égard du fonctionnement général de la ville (trafic, pollution…)
rappellent celles exprimées par les habitants rencontrés à Rehab, une différence remarquable
interpelle : l’évocation de problèmes d’injustice spatiale et des inégalités sociales, qu’aucun
de nos interlocuteurs n’a exprimée, se retrouve à plusieurs reprises dans les questionnaires
publiés sur Cairobserver. Certains Cairotes, qui n’habitent pas dans les compounds, ont
d’ailleurs tendance à émettre de très vives critiques à leur égard et à les considérer comme un
symbole de l’injustice socio-spatiale qui caractérise la ville du Caire. En comparaison,
l’absence de réflexion sur la place matérielle et symbolique de leur propre quartier dans le
cadre d’un développement métropolitain caractérisé par des inégalités socio-spatiales criantes
(Denis, 1995 ; Sims, 2012) est révélatrice à la fois de cette méconnaissance et d’une certaine
indifférence pour les enjeux politiques métropolitains. Si la perception aigüe des inégalités
socio-spatiales partagée par certains Cairotes les pousse à opter pour une stratégie de prise de
parole et, par exemple, à apporter un soutien à l’agenda social des manifestations de 2011 ou
à des initiatives locales de développement telles celles lancées par l’ONG Tadamun (Barthel,
Monqid, 2011), l’indifférence et/ou la méconnaissance de ces inégalités par certains habitants
des compounds se traduisent par une stratégie de mise à distance et d’exit.
4. L’effet de lieu sur le rapport ordinaire au politique et les répertoires de mobilisation
Afin d’expliquer les spécificités du ROP des habitants rencontrés, marqué à la fois par un
engagement à retardement dans la mobilisation politique typique du Hizb al-Kanaba et par
une stratégie d’exit s’agissant des enjeux socio-politiques à l’échelon métropolitain, il s’agit
d’étudier l’effet du quartier fermé lui-même et la manière dont ses caractéristiques peuvent
influencer le ROP des habitants.
4.1 Pourquoi chercher à fuir la ville n’est pas synonyme de sécession politique égoïste
Le choix d’habiter dans un quartier fermé hors du Caire relève d’une diversité de motifs
dont tous ne suffisent pas à expliquer le manque d’intérêt et d’investissement dans la politique
à l’échelle métropolitaine. Parmi les raisons régulièrement soulevées en entretien, on a déjà
évoqué la recherche d’un meilleur cadre de vie et, symétriquement, la volonté d’échapper aux
inconvénients matériels de la vie au Caire. D’autres motifs justifient le départ vers un
compound dans l’objectif de contourner certaines contraintes – sans pour autant suffire à
expliquer un manque d’investissement ou d’intérêt pour la gouvernance métropolitaine en
- 33 -
général. Certains analystes (Denis, 2006) accordent une (trop) grande importance à la valeur
symbolique du choix d’habiter dans un compound. Celui-ci est souvent interprété comme un
choix égoïste sans réellement chercher à comprendre, en discutant avec des habitants, ces
logiques résidentielles dans le contexte spécifique du Caire, celui d’une ville dont le marché
résidentiel est saturé, dont le gouvernement local est inefficace voire inexistant et dont il est
difficile de faire abstraction des nuisances quotidiennes.
Outre le souci d’échapper aux pollutions diverses de la ville-mère, le choix d’habiter dans
un quartier fermé est souvent déterminé par des contraintes matérielles qui jouent tout autant,
sinon plus, que la recherche d’un lieu de vie répondant à une certaine idée de la modernité et
satisfaisant les exigences d’un « rêve global » (De Konig, 2009 ; Denis, Séjourné, 2003).
Dans un contexte de saturation du marché immobilier, l’acquisition d’un logement dans
un compound peut représenter un choix particulièrement attractif sur le plan économique. Le
prix d’un appartement, voire d’une villa, dans un quartier résidentiel intégré est généralement
plus élevé qu’au Caire, avec de fortes variations selon le standing des compounds, et a
fortement augmenté depuis le début des années 2000 (Bouhali, 2009). Toutefois, alors que la
règle générale au Caire suppose le versement du prix du logement en une fois pour concrétiser
l’achat, le mode de paiement offert aux propriétaires d’un logement dans un compound est
beaucoup plus souple. Wadia explique ainsi qu’il lui a été possible de payer son appartement
à Rehab en plusieurs fois, avec des versements échelonnés sur plusieurs années. Si ce mode
de financement, courant dans d’autres pays, peut paraître anodin, il constitue une innovation
et un réel avantage dans le contexte cairote où le paiement intégral en liquide représente un
obstacle insurmontable pour beaucoup de ménages, notamment les plus jeunes. Pour Wadia,
c’est précisément cette possibilité de paiement échelonné qui a joué le plus dans sa décision
d’acheter à Rehab :
-‐ Quand j’ai réservé mon appartement, je l’ai réservé sur des maquettes. C’était le désert, il n’y avait que du désert. J’ai vu sur les maquettes qu’il y aurait de la verdure, un club sportif… Ce qui était le plus important pour la majorité des gens qui ont acheté à ce moment et qui continuent à acheter maintenant c’est qu’on n’était pas obligés de payer en cash le prix de l’appartement ou de la maison, c’était en versements. C’était une facilité qui encourageait les gens à acheter à Rehab.
-‐ Au Caire en général ça ne se passe pas comme ça ? -‐ Si je voulais acheter un appartement au Caire là, oui, je devrais payer cash. Donc [le
paiement par versement] c’était un avantage. Moi j’ai commencé à payer le prix de mon appartement quand je l’ai réservé, quand c’était encore le désert, et j’ai continué à payer les versements après mon installation, pendant un certain nombre d’années. Je me souviens que le versement que je payais pour mon appartement était à peu près de 980 LE par mois plus une grosse somme d’argent que je devais payer 2 fois par an, tous les 6 mois.
- 34 -
Cette facilité de paiement, associée à la valeur ajoutée apportée par les équipements du
quartier (espaces verts, voierie, écoles, centres commerciaux…) dont l’entretien est garanti
par une société privée, fait de l’acquisition d’un logement dans un quartier résidentiel fermé
un investissement rentable (Le Goix, Vesselinov, 2012). De plus, dans un contexte
économique relativement instable depuis la libéralisation économique du début des années
1990, sous l’égide des plans d’ajustement structurel du FMI (Moisseron, Clément, 2007), et
que les récents bouleversements liés à la transition politique ont de nouveau ébranlé,
l’investissement immobilier reste aux yeux de la plupart des acquéreurs une valeur sure.
Ainsi, le constat dressé par plusieurs observateurs de la non-occupation de beaucoup de
logements construits dans certains compounds (Florin, 2005 ; Barthel, 2011 ; Denis, 2006),
autorisant parfois la comparaison avec des « villes fantômes », peut s’expliquer par cette
stratégie d’investissement économique, notamment à destination des enfants non mariés38.
Par conséquent, qu’il s’agisse des facilités de paiement ou d’une stratégie
d’investissement dans le long terme, l’achat d’un logement dans un compound obéit à une
logique guidée avant tout par des contraintes de nature économique, même si la recherche
d’un environnement de qualité entre également dans la prise en compte des arguments en
faveur de cette localisation en périphérie.
Toutefois, on a montré que, dans le discours des habitants rencontrés, la mise à distance
physique de la ville glissait rapidement vers un rejet mental de certaines catégories sociales,
traduisant une distanciation assez nette avec une large partie de la société cairote et une
méconnaissance voire une indifférence à l’égard des enjeux socio-économiques liés au
développement métropolitain. Si les habitants interrogés se sentent peu concernés par les
problèmes auxquels sont confrontés leurs voisins des quartiers informels, et optent pour une
stratégie d’exit dans leur répertoire de mobilisation à l’échelon métropolitain, peut-être
faudrait-il y voir, plus qu’un instinct égoïste et la recherche d’une sécession urbaine et
politique, la conséquence d’un certain mode de vie qui ne les incite pas à faire corps sur des
enjeux voire des luttes politiques communes. Dès lors, il est intéressant d’essayer de
comprendre en quoi la gestion privée du quartier contribue, parmi d’autres facteurs, à placer
38 Pour beaucoup de jeunes Egyptiens, le triptyque « travail, voiture, appartement » généralement exigé par la famille de la jeune femme à celui qui la demande en mariage contribue, dans un contexte économique caractérisé par un fort taux de chômage des jeunes et une crise du logement, à faire du mariage un fantasme inatteignable (Boutaleb, 2011). Les désillusions liées à cette attente du mariage sont croquées avec beaucoup d’humour et de cynisme par la blogueuse Ghada Abdel Aal dans La ronde des prétendants (2012, Editions de l’aube).
- 35 -
les habitants des compounds dans une réalité parallèle qui les rend en partie étrangers aux
problèmes relatifs à un développement métropolitain dont ils sont directement bénéficiaires.
4.2 Quand la gestion privée façonne une « vie en parallèle » et nourrit une rationalité en finalité
A la suite des travaux d’Alan R. Walks (2004) et Andrew Kirby (2008), nous faisons
l’hypothèse que la nature même du quartier, fermé et privé, tend à jouer a posteriori sur le
rapport au politique des habitants. Parmi les caractéristiques d’une ville comme Rehab, nous
avons déjà montré que la distance n’était pas un réel facteur de différenciation avec le reste de
la ville en raison des interdépendances mises en évidence par les mobilités quotidiennes.
Deux caractéristiques méritent toutefois d’être étudiées : la fermeture et la gestion privée.
S’agissant de la fermeture de la ville, celle-ci est toute relative : Rehab est clôturée par un
simple grillage et les portails, que l’on peut franchir en bus grâce à la flotte privée qui assure
des liaisons quotidiennes avec le quartier d’Héliopolis au Caire, ne font pas l’objet d’un
contrôle systématique à l’entrée. La fermeture est beaucoup plus marquée dans d’autres
compounds résidentiels, plus petits et d’un plus haut standing, que j’ai visités : pour entrer à
Mirage City par exemple, il faut s’arrêter à l’entrée pour un premier contrôle de la voiture
puis pour un second contrôle d’identité, lors duquel on doit donner le nom voire appeler
devant le garde la personne à qui on rend visite. Si Rehab ressemble donc à bien des égards à
une ville nouvelle « non fermée », elle se distingue du reste des quartiers de même niveau
social au Caire par sa gestion privée. Celle-ci, loin de représenter un détail, introduit une
différence majeure entre le fonctionnement quotidien de Rehab et celui d’un quartier planifié
ailleurs au Caire qui dépend des institutions publiques pour sa gestion quotidienne.
Dans le cas de Rehab (qui n’est pas généralisable à l’ensemble des compounds cairotes),
la compagnie privée Talaat Mustafa Group (TMG) qui a conçu le quartier s’occupe également
de sa gestion quotidienne en restant à la disposition des habitants par l’intermédiaire d’un
bureau présent dans le quartier, le gehaz al-medina. Cette structure, qui n’a pas d’équivalent
ailleurs au Caire et ne correspond pas à un échelon administratif officiel pourrait s’apparenter
au hay (lit. « quartier »), soit la maille la plus fine des mahaliyyat (structures de gouvernement
local)39. Responsable de la maintenance des espaces communs, de la sécurité et de la
résolution des problèmes divers rencontrés par les habitants dans la jouissance de leur
39 Merci à Lise Debout et Roman Stadnicki pour m’avoir fait remarquer l’originalité de cette structure, spécifique à ces nouveaux quartiers. Le terme « gehaz » est également employé par d’autres habitants rencontrés pour faire référence cette fois à un bureau de l’administration publique responsable de la gestion de plusieurs quartiers (tagammu) du Nouveau Caire.
- 36 -
logement (de la présence de rats aux disputes de voisinage), le gehaz de Rehab est présenté
par tous les habitants rencontrés comme une structure efficace dont ils sont très satisfaits. A
ce titre, la satisfaction des habitants quant à la gestion privée de la ville contraste fortement
avec le sentiment d’impuissance relevé par les habitants de quartiers non privés au Caire face
à l’inefficacité et la corruption des antennes administratives locales40. Cette différence dans le
mode de gestion, caractérisée par une plus grande réactivité aux problèmes soulevés par les
habitants et par un suivi plus attentif de la qualité des infrastructures de la ville, contribue à
offrir aux habitants un confort de vie sans comparaison avec d’autres quartiers du Caire.
Dans le contexte heurté de la transition politique, la gestion privée est par ailleurs
considérée par les habitants comme un avantage. Par exemple, lorsque le nouveau régime
dirigé par l’armée a imposé un couvre-feu dans toute la ville à l’automne 2013, celui-ci ne
concernait pas Rehab, dont seule la société privée gérante TMG est autorisée à modifier le
règlement intérieur du quartier. De la même manière, alors que la plupart des habitants du
Caire ont subi de fréquentes coupures d’électricité au printemps 2014, ces inconvénients
quotidiens n’ont pas été ressentis par les habitants de Rehab dont l’approvisionnement en
électricité, certes par des infrastructures publiques, est géré par la société privée TMG. Ces
deux exemples, donnés par les habitants comme une illustration de l’efficacité de la gestion
privée, permettent de saisir le fossé qui peut exister entre le confort de la vie quotidienne à
Rehab et dans d’autres quartiers du Caire, dont les habitants sont non seulement confrontés à
des dysfonctionnements majeurs qui nuisent au confort quotidien mais n’ont aucun
interlocuteur local susceptible d’intervenir efficacement pour résoudre ces problèmes.
Ainsi, même si de nombreux facteurs individuels peuvent jouer dans le rapport au
politique des habitants (âge, catégorie sociale, niveau d’éducation…), la nature privée de la
gestion du compound peut contribuer à comprendre certaines divergences en termes d’intérêt
et d’engagement politique entre les habitants de ces quartiers et les autres habitants du Caire,
ainsi qu’une mobilisation guidée par une rationalité en finalité41. Si le choix d’habiter à Rehab
relève en premier lieu de motifs économiques et matériels, la distance mentale avec le reste de
la ville et ses habitants est accentuée par une gestion privée qui assure un confort de vie en net
40 L’enquête « Resident Perspective » publiée sur le blog Cairobserver donne un bon aperçu du point de vue des habitants de différents quartiers du Caire sur les dysfonctionnements des mahaliyyat, tels qu’ils ont par ailleurs été précisément décrits par Sarah Ben Néfissa (2011). 41 Max Weber distingue, dans Economie et société (1922), la rationalité en finalité de la rationalité en valeur. Toutes deux peuvent mener à la mobilisation politique mais selon des logiques différentes : la première place au cœur un objectif spécifique qu’elle cherche à atteindre en fonction des moyens à sa disposition et des conséquences envisagées, tandis que la seconde inscrit l’action dans un système de valeurs considérées comme supérieures (par exemple la justice ou la liberté).
- 37 -
contraste avec celui que peine à garantir un gouvernement local inefficace voire inexistant
dans la plupart des autres quartiers de la ville. Le confort de cette « vie en parallèle » (Florin,
2005) rend à la fois plus distants et moins urgents les enjeux politiques liés au développement
métropolitain, notamment les questions d’inégalités socio-spatiales, que ces quartiers privés
contribuent à creuser tout en anesthésiant la perception par leurs habitants de ces mêmes
enjeux. Dès lors, le désintérêt constaté chez certains habitants pour ces questions, ainsi qu’un
passage plus tardif à la « prise de parole » dans la transition politique, peuvent être en partie
compris par cette anesthésie provoquée par une gestion privée qui place les habitants dans une
réalité quotidienne plus confortable en parallèle de celle de leurs voisins hors les murs. En les
délaissant de la pression de l’urgence, ressentie par d’autres habitants, notamment dans les
quartiers informels, face à certains dysfonctionnements liés à la non-gestion par les pouvoirs
publics du développement métropolitain, l’efficacité de la gestion privée permet aux habitants
d’opter pour une mobilisation guidée par une rationalité en finalité, au sens de Max Weber.
La combinaison de la distance, de la sécurité (accrue en 2011) et de la gestion privée a pu
ainsi constituer un terreau favorable au développement, chez certains habitants de Rehab,
d’une rationalité en finalité qui a guidé leur mobilisation aux côtés du mouvement Tamarod
contre les Frères musulmans, comme beaucoup d’Egyptiens qui appartiendraient à cette vaste
nébuleuse du Hizb al-Kanaba.
* * *
Après avoir décrit le rapport ordinaire au politique et le répertoire de mobilisation de
certains habitants rencontrés dans les quartiers fermés du Nouveau Caire et montré comment
ceux-ci pouvaient être influencés par la gestion privée, garante d’un confort quotidien et de
pratiques résidentielles spécifiques, il s’agit de comprendre quelle place les quartiers fermés
occupent dans le paysage politique égyptien (et cairote) actuel. Les compounds sont-ils des
lieux apolitiques ou, si ce n’est pas le cas, quelle(s) forme(s) de participation politique locale
peut-on observer dans ces quartiers ? Le cas de Rehab permet d’illustrer les différentes
modalités par lesquelles les compounds s’inscrivent dans la configuration politique, à la fois
spatiale et symbolique, de la transition postrévolutionnaire.
- 38 -
(4) (3)
TROISIEME PARTIE La place et la nature des compounds dans le paysage politique
égyptien : pratiques et représentations des habitants
Fig. 8 : Etude des pratiques et représentations des habitants (3) sur la place des compounds dans la configuration spatiale et symbolique du politique en Egypte (4).
Si le mode de production, la morphologie et le relatif succès des compounds, souvent les
plus exclusifs, ont déjà fait l’objet de nombreuses études, peu se sont intéressés à ces quartiers
sous l’angle politique. Les premières analyses de la révolution de 2011, même si elles
soulignent son caractère de « fait urbain total » (Stadnicki, 2011), ignorent pour la plupart ce
qui a pu se passer hors de l’hyper-centre ou estiment que les quartiers périphériques sont
restés à l’écart des bouleversements politiques récents (Pagès El-Karoui, 2012). Or, comme
on l’a souligné précédemment, les habitants de ces quartiers partagent un réel intérêt pour la
politique nationale égyptienne et ont pour certains participé activement aux mobilisations
telles que le mouvement Tamarod de juin 2013. Qu’en est-il alors de la place de ces quartiers
fermés et privés dans le paysage politique égyptien ? Constituent-ils des lieux apolitiques, au
sein desquels toute forme d’expression politique est bannie, ou bien au contraire un espace
complémentaire des lieux symboliques des mobilisations révolutionnaires, permettant ainsi
l’expression d’une modalité différente de participation politique ?
En s’appuyant sur le cas de Rehab, on cherche à préciser la nature de la relation entre le
lieu, privé et fermé, et le politique, entendu comme un ensemble de pratiques, telles que des
actions collectives ou des manifestations, associées à une configuration spatiale et symbolique
marquée par des « lieux-symboles » du politique à l’échelle de la ville du Caire (cf. Fig. 2),
dont la place Tahrir est devenue le modèle depuis 2011. Afin de comprendre l’inscription des
LIEU Compound
POLITIQUE Rapport ordinaire
ACTEURS Habitants
- 39 -
compounds dans le paysage politique égyptien, il est nécessaire de prendre en compte les
pratiques et représentations des habitants, qui contribuent à façonner la nature de la relation
entre leur quartier et le contexte politique à l’échelle de la ville du Caire. L’espace perçu des
habitants, marqué par des pratiques politiques à visée locale et nationale, mérite ainsi d’être
distingué de l’espace conçu par les promoteurs du quartier, articulé autour d’une logique
commerciale.
1. Le compound, un lieu apolitique dans la conception et les
représentations
En tant qu’espace social, irréductible à sa seule matérialité physique, le compound peut
être étudié comme un « produit social », au sens d’Henri Lefebvre (1974). Cette apparente
tautologie implique en réalité que chaque groupe social contribue à produire l’espace dans
lequel il vit et que l’espace social est produit par l’entrecroisement de trois forces : la pratique
sociale, correspondant à l’espace perçu, les « représentations de l’espace », correspondant à
l’espace conçu (celui des urbanistes et des promoteurs qui représente souvent la vision
dominante de l’espace) et enfin « l’espace des représentations » ou espace vécu des habitants
ou des usagers, qui se réapproprient l’espace conçu par l’imagination.
Dans le cas de Rehab, les « représentations de l’espace » du promoteur Talaat Mustafa
Group (TMG), qui se traduisent dans les choix d’aménagement et de gestion de la ville, ainsi
que « l’espace des représentations » des habitants, saisi lors des entretiens, convergent vers
une vision partagée du compound comme un lieu apolitique. A la fois pour TMG et pour les
habitants rencontrés, Rehab n’est pas envisagé comme un lieu d’expression ou de débat
politique. Si, dans la conception du quartier, l’usage politique des espaces communs n’a
semble-t-il tout simplement pas été envisagé, les habitants partagent quant à eux l’idéal d’un
quartier politiquement neutre.
1.1 Le projet du promoteur : un espace commercial sans marque politique visible
Rehab ressemble à bien des égards, en terme de morphologie et d’organisation spatiale, à
une ville plus qu’à un quartier résidentiel intégré sur le modèle des gated communities
américaines. Si beaucoup de compounds résidentiels cairotes disposent seulement d’un club
sportif et de quelques commerces de proximité (voire d’un hôtel comme le Marriott de
Mirage, ou d’un restaurant comme à Katameya Heights), Rehab présente les attributs d’une
ville, conçue selon un zonage fonctionnel (cf. Fig. 3). Les zones résidentielles (elles-mêmes
divisées entre groupements de villas et groupements d’immeubles) entourent ainsi une zone
- 40 -
centrale qui regroupe à la fois les fonctions économiques (office building, banques), médicales
(medical center), éducatives (dont trois écoles de langues où l’enseignement est dispensé dans
une langue étrangère), religieuses (plusieurs mosquées et une église), commerciales (deux
malls, un marché) et de loisirs (restaurants, cinéma). La place centrale occupée par le food
court (Fig. 9), longue esplanade bordée de restaurants (pour la plupart des chaînes locales ou
étrangères), et les centres commerciaux (malls) révèle l’importance de l’organisation spatiale
du quartier autour de la fonction commerciale.
Fig. 10 : Vendeur de livres près de la place Talaat Harb dans le centre du Caire. Cliché : E. Braud, 2014.
Fig. 11 : L’hommage au constructeur de Rehab dans la toponymie de la ville. Cliché : E. Braud, 2014.
Fig. 9 : Le food court et une mosquée de Rehab. Cliché : E. Braud, 2014.
- 41 -
L’impression d’une éradication des marques visibles de culture et de politique est
frappante pour l’observateur familier des quartiers commerciaux du centre-ville du Caire,
dont les dispositifs visuels sont très différents. Ceux-ci sont caractérisés par l’omniprésence
d’affiches, de slogans et d’images politiques, telles que des portraits géants du maréchal Sissi
ou des tags appelant à voter « oui » au référendum de janvier dernier pour l’adoption de la
nouvelle constitution. En comparaison, aucun slogan politique ou portrait de Sissi ne couvre
les murs de Rehab et les seules images visibles dans la rue sont des affiches publicitaires,
faisant notamment la promotion du nouveau compound Madinaty, en cours de développement
par TMG à l’est de Rehab. L’impression d’épuration visuelle des espaces ouverts de Rehab,
par rapport aux rues du centre-ville du Caire ou même à un quartier résidentiel aisé tel que
Zamalek, passe aussi par l’absence remarquable des kiosques42 ou des vendeurs de livres et de
journaux (Fig. 10), omniprésents dans l’espace public cairote. Hors du divertissement et de la
consommation, aucun espace ne semble avoir été prévu pour des pratiques culturelles : il est
frappant de constater que les seuls lieux non commerciaux ou utilitaires du quartier sont les
lieux de culte et les écoles privées. La dimension commerciale de Rehab s’incarne d’ailleurs
jusque dans la toponymie, support marketing de l’image de la marque TMG, puisque l’artère
principale de la ville porte le nom du fondateur du groupe, Talaat Mustafa (Fig. 11).
Cette absence de visibilité du politique dans la conception et l’aménagement du quartier
s’inscrit dans une vision néolibérale de la ville (Marafi, 2011) guidée par une logique, pour le
promoteur, de rentabilité économique. Rehab est conçu comme un projet d’investissement et
les différents services proposés sur place participent d’un objectif de maximisation des profits
en augmentant la valeur liée à l’acquisition d’un logement. Que cette ville ne laisse pas de
place au politique ou à des formes d’expression culturelle non rentables pour le concepteur
représente ainsi la conséquence logique d’un projet de nature purement économique. Sans
doute plus qu’une éradication consciente et volontaire du politique 43 , la neutralité et
l’aseptisation constituent des valeurs distinctives, protégeant le cadre de vie et la qualité du
projet résidentiel qui se distingue ainsi du reste de l’espace urbain.
42 La gestion des kiosques dépend du gouvernement égyptien, qui distribue ces emplois de gérants dans le cadre d’un programme d’aide sociale. Ces petites échoppes qui vendent, entre autres, des cigarettes, des snacks ou des cartes de téléphones, ponctuent le paysage urbain cairote (et représentent d’excellents postes d’observation et de contrôle). La gestion privée des compounds explique leur absence notable dans ces quartiers. 43 Il est prudent toutefois de ne pas sous-estimer la violence symbolique d’un tel projet immobilier dont la logique économique est sous-tendue par un agenda politique néolibéral. L’objectif de rentabilité économique est ainsi intrinsèquement lié, selon nous, à un cadre idéologique néolibéral qui a profondément influencé la politique autoritaire du régime de Moubarak.
- 42 -
Cependant, si, dans le projet du promoteur, Rehab est conçu comme un lieu apolitique,
qu’en est-il de « l’espace des représentations » des habitants ? Perçoivent-ils et imaginent-ils
leur quartier comme un espace dénué de dimension politique ?
1.2 L’espace vécu des habitants : Rehab, un lieu politiquement neutre
Des entretiens réalisés avec des habitants de Rehab ressort très nettement une tendance
générale à considérer leur ville ou leur quartier comme un lieu étranger au politique. Si la
plupart ont volontiers accepté de parler de l’actualité politique égyptienne voire de la
révolution, tous ont exprimé la même expression de surprise, aussitôt suivie d’un rejet
catégorique à la question « votre quartier a-t-il été le lieu de manifestations politiques en 2011
ou plus récemment ? ». Alors que tous répondent systématiquement « non », comme si
l’association mentale entre leur quartier et la politique était par nature inconcevable, certains
nuancent ensuite en mentionnant des événements ponctuels (des marches ou des panneaux
brandis à la sortie de la mosquée), dont ils relativisent aussitôt l’impact. Dans un seul cas,
l’évocation même de la politique égyptienne au tournant d’une question a essuyé un refus
catégorique de la part de mon interlocuteur : « Je ne veux pas qu’on parle de politique, je ne
veux pas avoir de problèmes »44. Dans tous les cas, les habitants rencontrés m’ont fait sentir
d’une manière ou d’une autre qu’envisager Rehab sous un angle politique représentait une
idée incongrue, comme si la politique relevait intrinsèquement du centre-ville et que les
compounds devaient rester hors de cette sphère politique cantonnée au centre. Parmi les
représentations de Rehab partagées par les habitants, celle d’un quartier résidentiel, dont les
autres fonctions, notamment commerciales, ne sont pas remises en question, n’est pas
compatible avec la représentation qu’ils ont du politique.
Toutefois, lorsqu’on réoriente les questions lors de l’entretien vers des pratiques
politiques hypothétiques (par exemple : « est-il possible d’exprimer une opinion politique
dans la rue à Rehab ? Est-il possible de manifester ? »), la réponse est toujours « oui », avec
certaines nuances. Pour Shady, qui évoque rapidement les quelques manifestations organisées
par des partisans des Frères musulmans à Rehab, « on ne peut pas les empêcher de manifester,
ils ont le droit »45. Si Ahmed reconnaît également la possibilité de s’exprimer ouvertement à
Rehab, il souligne l’existence d’un certain contrôle social, conforme aux représentations
partagées du quartier comme d’un lieu « calme », apolitique et sans « problèmes », qui étouffe
rapidement les manifestations susceptibles, aux yeux des habitants, de dégénérer : 44 Entretien avec Ibrahim, réalisé le 12 avril 2014. 45 Entretien avec Shady, réalisé le 24 avril 2014.
- 43 -
-‐ Do you feel it’s ok to talk about politics in the streets here in Rehab? -‐ People who live here are peaceful, we don’t want any politics to happen here. There were
people with Morsi who organized a protest here in the food court but all people got angry because they didn’t want that to happen in Rehab, they didn’t want any problem46.
Le fait qu’une forme ponctuelle et non violente d’expression politique soit envisagée
comme possible par certains habitants, et qu’elle ne soit pas rejetée immédiatement comme
une pratique incongrue, suggère que ce n’est pas tant le politique en soit, comme objet de
débat et d’expression ouverte, qui semble inenvisageable dans l’enceinte de Rehab mais
plutôt la forme incontrôlable et parfois violente de l’expression politique telle qu’elle a été
perçue par les habitants lors de la révolution. Il semble que le politique soit synonyme, chez la
plupart des gens rencontrés, des manifestations qui ont eu lieu ces dernières années dans le
centre-ville et dont les violents affrontements ont été largement médiatisés. Pour beaucoup, la
politique est imaginée comme intrinsèquement violente. Ainsi, lorsque les habitants affirment
qu’il n’y a pas et ne saurait y avoir de politique à Rehab, ils refusent la possibilité de
concevoir leur quartier comme un espace de violence.
Cette association immédiate, dans les représentations, de la politique avec ses formes
d’expression violentes se comprend dans le contexte politique autoritaire égyptien hérité de
l’époque Moubarak, marqué par une stigmatisation et une forte répression de l’opposition
politique, dont le régime actuel reproduit la même ligne depuis son arrivée au pouvoir en
juillet 2013. Dans ce contexte autoritaire, un contrôle social conservateur tend par ailleurs à
dissuader la prise de parole politique. Ainsi, selon Chaymaa Hassabo (2009), « l’engagement
politique, dans le contexte égyptien, est assez souvent considéré comme une exception ; le
jeune militant est souvent comme « stigmatisé », dans le sens où l’entend Erving Goffman,
par ses amis non engagés politiquement ». En raison de cette stigmatisation persistante de
l’activité politique, associée à une forme de déviance sociale et présentée dans le discours
officiel du régime comme concomitant avec une forme intrinsèque de violence, « l’espace des
représentations » des habitants de Rehab tend à converger vers « les représentations de
l’espace » du groupe TMG. Les représentations à la fois du promoteur et des habitants se
combinent ainsi pour faire de l’espace conçu et de l’espace vécu de Rehab un même lieu
apolitique.
46 Entretien avec Ahmed, réalisé le 12 avril 2014.
- 44 -
2. Des pratiques politiques locales aux mobilisations nationales : le compound comme un lieu d’expression politique
Si la conception de Rehab par le promoteur et les représentations partagées par les
habitants, toutes deux normatives, convergent pour faire de la ville un lieu apolitique, les
pratiques politiques décrites par les personnes rencontrées tendent à nuancer cette réalité. La
troisième force de production de l’espace, selon le triptyque de Lefebvre, tend à remettre en
cause cette norme apolitique en dotant le quartier d’une véritable dimension politique.
2.1 Le jeu politique local : quand le quartier devient le lieu et l’enjeu des mobilisations
Parler de politique locale pour décrire la manière dont les habitants sont amenés à agir, en
coopération avec la société privée de gestion et pour résoudre certains dysfonctionnements
locaux, ne rentre pas dans la représentation mentale que les personnes rencontrées semblent
partager de la politique – nécessairement violente et étrangère au quartier. Cependant, même
si ce jeu politique local s’apparente à bien des égards à une gestion managériale du quartier,
celle-ci n’est pas exempte de rapports de pouvoir qui permettent de s’y intéresser en tant que
« champ politique, entendu à la fois comme champ de forces et comme champ des luttes
visant à transformer le rapport de forces qui confère à ce champ sa structure à un moment
donné » (Bourdieu, 1981). Plutôt qu’une gestion similaire à celle d’une copropriété où
l’objectif est de maximiser les intérêts – partagés – de chacun (Glasze, 2005 ; Kirby, 2008), la
résolution des problèmes intérieurs au quartier s’inscrit dans le champ d’un rapport de force
entre les habitants eux-mêmes et le gehaz al-medina.
Le champ politique local à Rehab s’articule autour de problèmes communs qui conduisent
les habitants concernés à mobiliser des ressources individuelles et collectives en vue de leur
résolution. Parmi les problèmes auxquels les habitants sont confrontés dans leur vie
quotidienne, tous ne nécessitent pas le même investissement en termes de temps ou d’argent
ni la même interaction avec les représentants de la société TMG, figures de l’autorité locale.
Si les problèmes liés à la sécurité ne peuvent être réglés que par une intervention auprès du
gehaz al-medina, l’entretien intérieur des immeubles fait plus souvent directement l’objet
d’une concertation entre les propriétaires. Selon les problèmes, les habitants vont donc agir en
concertation ou se tourner vers le gehaz.
Ces deux modes de résolution présentent chacun leurs limites en termes d’efficacité. Les
initiatives lancées par les habitants ne semblent porter leurs fruits que sur des projets
- 45 -
ponctuels, à la fois dans le temps et l’espace. Plusieurs habitants nous ont ainsi donné
l’exemple de projets de rénovation de leur immeuble pour lesquels les quelques familles
propriétaires ont toutes participé financièrement à l’investissement commun, comme dans
l’immeuble de Wadia :
Quand quelque chose est abimé, un des habitant prend l’initiative et commence à voir avec les autres habitants s’ils veulent participer pour réparer. Par exemple, les petits enfants… Malheureusement, il y a des familles qui ne savent pas comment bien élever leurs enfants, ils peuvent prendre un stylo et écrire sur le mur donc c’est pas beau à voir. Si tu viens chez moi tu verras, les murs sont abimés. Donc, ce que moi je peux faire de temps en temps, c’est que je badigeonne le mur de l’escalier [avec de la peinture pour couvrir les traces de stylo]. Une fois j’ai payé toute seule [le matériel nécessaire] et, deux fois, j’ai demandé aux habitants de participer et ils n’ont pas dit non, au contraire, ils étaient très coopératifs et ils ont tous participé. On a badigeonné tout l’escalier de l’immeuble47.
Cependant, aucune association officielle de propriétaires n’existe à Rehab, ce qui limite la
portée des actions collectives à l’initiative des habitants. Comme le révèle une recherche sur
les réseaux sociaux (Facebook en particulier), beaucoup de compounds disposent d’un groupe
ou de plusieurs pages pouvant servir de plateforme de discussion entre les habitants (cf.
annexe 1)48. Toutefois, s’il existe par exemple au moins quatre pages Facebook créées par des
résidents de Rehab, la dernière publication du modérateur est souvent ancienne et la plupart
des publications récentes sont en réalité des publicités commerciales. L’une d’entre elles,
« Rehab Owners », émane d’un groupe d’habitants qui organise des réunions à Rehab mais
dont l’efficacité et la représentativité est critiquée par certains résidents comme Ahmed :
-‐ Is there any owners association in Rehab? -‐ No. In fact there is one but it’s not effective. They did a few meetings, but they didn’t know
what to do so they created a group on Facebook, called “Rehab owners”. According to me they are not effective and they think about things that are not important. For example, some people wanted more control at the gates for visitors. I think it’s a good idea because Rehab is crowded, a lot of people come on Thursday night and they fight… But this group rejected this idea and the company [TMG] sided with them.
-‐ And how does this group work? Are they elected? -‐ No, they are friends. They are now like 20, they have a flat here and they organize meetings
and ask people if they want to join but I never go. Seven years ago, my dad went to the meetings but they don’t do anything, they just talk49.
L’absence d’une association de propriétaires efficace pour représenter les habitants et agir
collectivement nécessite dans la plupart des cas le recours individuel auprès du gehaz,
47 Entretien avec Wadia, réalisé le 22 avril 2014. 48 A Rehab, des habitants ont par exemple créé une page Facebook « Ensemble contre la corruption du gehaz al-medina » sur laquelle ils partagent leurs expériences et leurs problèmes rencontrés dans la gestion du quartier. URL : https://www.facebook.com/pages/ ً -ممددييننةة-ججههاازز-ففسساادد-للممححااررببةة-معا (en arabe) 190223294343538/االلررححاابب49 Entretien avec Ahmed, réalisé le 12 avril 2014.
- 46 -
responsable de la gestion de la ville. La société TMG en charge du gehaz représente ainsi le
décideur principal dans la gestion de la ville auprès duquel les habitants disposent d’un
pouvoir de doléances, sans réelle participation à la prise de décision. Toutefois, le rapport de
forces dans le champ politique aimanté par ces deux pôles n’est pas si statique : le fait que
l’autorité de la ville soit incarnée par la société TMG, également prestataire de service dont la
profitabilité dépend entre autres de la satisfaction de sa clientèle, place les habitants dans une
position de force relative. Si certains habitants ont noté une diminution dans la qualité de la
gestion et la disponibilité du gehaz pour recevoir leurs doléances, en raison du contexte
politique qui diminuerait leur marge d’intervention ou suite au changement de responsable à
la tête du gehaz, tous ne semblent pas disposer de la même force d’influence pour obtenir
satisfaction.
D’après les différents témoignages recueillis auprès des habitants, certaines
caractéristiques personnelles favorisent à la fois l’intérêt et l’implication dans le jeu politique
local. Le statut de propriétaire joue en faveur d’un souci plus marqué pour la préservation du
cadre de vie, dont dépend la valeur du bien immobilier. Ainsi, Wadia, qui est propriétaire de
son appartement, estime se sentir plus responsable des espaces communs, notamment des
espaces verts, que ses voisins locataires50, ce qui la conduit à déposer davantage de requêtes
auprès du gehaz pour garantir une bonne maintenance. Associée au statut de propriétaire, la
date d’arrivée dans le quartier distingue les premiers résidents de Rehab des plus récents dans
leur attachement à la préservation d’un mode de vie qu’ils partageaient à leur arrivée et
refusent de voir menacé par les nouveaux habitants51. Une hypothèse permettant d’expliquer
ces observations résiderait dans le fait que les propriétaires arrivés depuis le début des années
2000 à Rehab, comme Wadia par exemple, disposent d’un plus grand capital social au sein du
quartier. Comme nous l’a confirmé son fils, Shady, ils entretiennent avec leurs voisins arrivés
à la même époque qu’eux de très bonnes relations et leurs enfants forment un bon groupe
d’amis. Or, comme l’ont mis en évidence les auteurs d’une étude économétrique sur le cas de
Phoenix aux Etats-Unis (Larsen et al., 2004), il existe une relation positive entre capital social
et propension à s’investir dans la vie locale. Au-delà de la formation de bonding capital, la
plus grande familiarité au quartier permet souvent le développement de bridging capital,
moteur d’un investissement plus grand dans des actions collectives locales52.
50 Cf. citation p. 29. 51 Idem. 52 Au contraire du bonding capital, constitué des relations nouées par interconnaissance et proximité affective, le bridging capital correspond au capital social acquis en vue de servir une cause commune.
- 47 -
Ainsi, malgré une gestion privée dont la prise de décision est largement dominée par la
compagnie TMG sans réel pouvoir de participation des habitants, le jeu politique local est
sous-tendu par des relations d’influence entre le gehaz et certains habitants disposant d’un
capital social suffisant pour défendre leurs intérêts. Plus qu’une « démocratie d’actionnaires »
observés dans d’autres contextes (Glasze, 2005), Rehab incarnerait davantage une
technocratie commerciale, où la société privée offre aux résidents, considérés comme des
consommateurs, un service après-vente dont l’efficacité peut être plus ou moins négociée en
fonction du capital social du résident-client.
2.2 Le compound, un théâtre de mobilisations aux enjeux nationaux
Si les relations de négociations entre les habitants de Rehab et le gehaz contribuent à
constituer un champ politique autour d’enjeux locaux, la ville est aussi le théâtre d’actions
collectives s’inscrivant dans le contexte politique national. Contrairement à « l’espace des
représentations » des habitants, présenté comme apolitique ou politiquement neutre, Rehab
n’est pas resté complètement à l’écart des manifestations politiques depuis la révolution de
2011. La recherche de vidéos sur Youtube nous a permis de combler un biais de notre enquête
lors de laquelle seule une interlocutrice nous a parlé en détail de manifestations organisées à
Rehab en juin 2013 contre le régime des Frères musulmans. En plus de ces manifestations,
plusieurs se sont déroulées entre décembre 2011 et septembre 2013 à Rehab et ont fait l’objet
d’une publication sur Internet. L’étude de ces matériaux visuels et discursifs, attestant du fait
que des manifestations politiques ont été organisées à Rehab, permet de nuancer certaines
idées reçues quant à la place de ce compound dans la configuration politique nationale.
Premièrement, ces vidéos témoignent d’une pratique des espaces communs de la ville
destinée à l’expression d’un message politique et permettent donc de nuancer la
représentation de Rehab comme d’un lieu hors du politique. Lors de ces actions collectives,
les slogans criés ainsi que les symboles politiques portés par les manifestants chargent
ponctuellement les rues du quartier d’un message politique explicite, les détournant de leur
fonction utilitaire épurée à l’ordinaire de tout signe politique visible. L’importation par
exemple du signe de Rabia, devenu le symbole des partisans du président déchu Mohammed
Si l’amitié ou l’appréciation est le ciment du bonding capital, l’action collective unit les membres connectés par une forme de bridging capital. Certains auteurs ont particulièrement étudié les modalités de ces deux formes de capital social dans les banlieues résidentielles américaines (Putnam, 2001 ; Larsen et al., 2004 ; Kirby, 2008).
- 48 -
Morsi suite à la répression violente des manifestations du 14 août 201353, imprime une
dimension politique partisane dans le paysage urbain de Rehab (Fig. 12). La réappropriation
de certains lieux centraux du quartier à des fins politiques est manifeste également dans le
rassemblement de joie qui a eu lieu sur le food court le jour de la destitution de Morsi, comme
se le rappelle Mirna :
Après le départ de Morsi, les gens se sont réunis dans le food court, il y a eu des célébrations, des jeux, des gens ont mis de la musique très fort. Tout le monde était très content54.
Autre signe visible du politique, qui transforme l’apparence neutre du quartier, les drapeaux
égyptiens aux fenêtres contribuent à exprimer, dans l’espace privé et fermé de Rehab, une
fierté patriotique révélatrice d’un sentiment d’appartenance à la nation égyptienne (Fig. 13).
Deuxièmement, la diversité des manifestations organisées à Rehab en termes d’affiliation
partisane est révélatrice d’une certaine tolérance par les habitants et la sécurité privée du
quartier à l’égard de luttes politiques suscitant ailleurs au Caire de violents affrontements.
L’été 2013, les manifestations anti-Morsi ont précédé en juin celles des soutiens au président
déchu, faisant des rues de Rehab un théâtre pour l’expression politique des deux camps
53 La place Rabia al-Adawiyya, lieu de rassemblement des pro-Morsi (cf. Fig. 1), a donné son nom au signe de Rabia, figurant une main à quatre doigts, en raison de l’homonymie entre le nom de la place et la prononciation en arabe du chiffre quatre. 54 Entretien avec Mirna, réalisé le 6 avril 2014.
Fig. 13 : Une façade de Rehab décorée du drapeau égyptien. Cliché : E. Braud, 2014.
Fig. 12 : Le signe de Rabia, lors d’une manifestation pro-Morsi à Rehab (août 2013). Source : Shalaby O. (31/08/2013). Rab3a Protests in Al-Rehab City Cairo [vidéo en ligne]. URL : https://www.youtube.com/watch?v=zfYlonJq3gE
- 49 -
opposés sur la scène politique nationale. Sally, qui habite à Banafseg, a activement participé à
l’organisation de manifestations de soutien au mouvement Tamarod en juin à Rehab. Pendant
une semaine, avant le 30 juin fixée comme date de mobilisation nationale, Sally est allée tous
les soirs manifester à Rehab avec des amies pour recueillir des signatures de soutien à
Tamarod auprès des habitants. Organiser des manifestations à Rehab lui semblait à la fois
naturel et nécessaire : « C’est chez nous, on voulait organiser des manifestations plus
sécurisées pour les femmes et les enfants. Les hommes, eux, voulaient manifester dans le
centre »55.
Les vidéos des manifestations pro-Morsi du 30 août et du 4 septembre 2013 montrent
également un cortège pacifique circulant à pied dans les rues de Rehab et animé par des
leaders scandant des slogans au porte-voix et distribuant des pancartes jaunes figurant la main
de Rabia. Dans chacune, la composition du groupe de manifestants est assez hétérogène, avec
une majorité de jeunes hommes mais également des femmes et des personnes plus âgées. Il
est remarquable de noter que ces manifestations pro-Morsi réussissent à se dérouler sans
heurts à Rehab tandis qu’elles font l’objet dans le centre-ville, à la même époque, d’une vive
répression des forces de sécurité du régime. Les vidéos de ces manifestations révèlent par
ailleurs l’existence à Rehab de soutiens du camp partisan des Frères musulmans, ce qui
permet de ne pas généraliser les idées anti-Frères relevées auprès des habitants rencontrés. Si
je n’ai pas eu l’opportunité de discuter avec des habitants favorables aux Frères pendant mon
enquête, ceux-ci n’en constituent pas moins une tendance à prendre en compte pour nuancer
l’idée reçue que les résidents des compounds comme Rehab seraient des fervents soutiens du
régime autoritaire actuel.
D’autres événements marquants de la vie politique nationale depuis 2011 se sont
également traduits par des manifestations ponctuelles à Rehab comme celle du 3 février 2012,
dont une vidéo a également été publiée sur Youtube (cf. annexe 1). Ce jour-là, les habitants
protestaient contre le régime transitoire, dirigé par le Conseil supérieur des forces armées
(CSFA) depuis la destitution de Moubarak en 2011. Le CSFA était accusé de complicité dans
les émeutes du match de Port-Saïd du 1er février 2012 qui ont causé la mort de 73 supporters
du club cairote al-Ahly56.
55 Entretien avec Sally, réalisé le 29 avril 2014. 56 Le régime est accusé d’avoir incité les supporters du club al-Masry de Port-Saïd à attaquer les Ultras, supporters du club al-Ahly, en répression du rôle actif de ces derniers dans les manifestations qui ont mené à la chute du régime de Moubarak en février 2011 (France 24, 23/01/2013).
- 50 -
Ces différentes actions collectives organisées à Rehab révèlent que, par les pratiques des
habitants, l’espace conçu et vécu comme apolitique est ponctuellement réapproprié pour
devenir le théâtre de manifestations, dont les discours et les symboles chargent d’une
dimension politique nouvelle un espace ordinairement épuré de toute forme d’expression
politique.
3. Les compounds dans la configuration politique égyptienne : lieux satellites ou complémentaires de la contestation postrévolutionnaire ?
Si les pratiques des habitants contribuent à faire de la ville fermée de Rehab un espace
d’expression politique, quelle place celui-ci occupe-t-il dans la configuration politique
égyptienne postrévolutionnaire ? Souvent perçus comme les lointains récepteurs d’un écho de
Tahrir, les compounds méritent d’être étudiés dans une perspective historique qui les replace
dans une histoire urbaine locale et permet de remettre en question la double opposition espace
public-démocratie/espace privé-apolitisme. Dans cette perspective, la comparaison de la
fermeture physique et symbolique de ces quartiers avec celle des espaces publics centraux
depuis 2011 suggère plutôt une relation de complémentarité entre ces différents espaces
d’expression politique.
3.1 Les compounds, un épiphénomène dans la configuration politique égyptienne ?
Si la plupart des analyses de la transition postrévolutionnaire égyptienne se sont
largement désintéressées des quartiers périphériques, les compounds ont parfois été présentés
comme des bastions conservateurs ou des espaces tenus à l’écart du jeu politique. Cette
analyse, qui se heurte à la réalité des pratiques observées par exemple à Rehab, concorde avec
le procès généralement dressé à l’égard des villes nouvelles périphériques, dont la plus faible
densité et la distance au centre-ville contribueraient à une urbanité de moindre intensité. Selon
Delphine Pagès El-Karoui (2012), « les villes nouvelles n’ont pas été des grands lieux de la
contestation populaire : leurs habitants ont préféré se déplacer à Tahrir pour aller manifester,
ce qui peut être interprété comme un échec à créer de la centralité symbolique ». Même si
certains quartiers de ces villes nouvelles, notamment fermés, ont été le théâtre de
manifestations politiques, comme notre enquête de terrain l’a montré pour Rehab,
l’interprétation dominante circonscrit ces espaces politiques satellites et secondaires dans un
rapport de dépendance matérielle et symbolique aux espaces publics centraux devenus les
symboles de la révolution. Cette double dépendance se traduit tout d’abord par l’attractivité
- 51 -
qu’exercent ces lieux-symboles sur les habitants des quartiers périphériques qui désirent
manifester. Les places Tahrir, Rabia al-Adawiyya et Ittihadeya représentent trois lieux
symboliques de l’activisme politique57. Aller manifester sur l’une de ces places constitue
selon certains habitants une manière plus efficace de faire porter leur voix que s’ils
manifestaient dans leur quartier. Ainsi, pour Sally qui a participé et organisé les
manifestations pro-Tamarod avant le 30 juin à Rehab, aller à Ittihadeya représentait une étape
supérieure dans son engagement politique, permettant de gagner en visibilité. Ahmed déclare
également avoir « senti qu’[il] pouvait être utile » en se joignant aux manifestations
organisées par Tamarod à Ittihadeya58.
A chacun de ces lieux sont associés des slogans et des symboles, dont certains ont été
« importés » dans les manifestations organisées à Rehab. Le slogan « irhal ! »
(lit. « dégage ! ») a été repris, depuis son utilisation contre le régime de Moubarak place
Tahrir en 2011, lors des manifestations à Rehab contre le Conseil supérieur des forces armées
en décembre 201159 ou contre le régime des Frères musulmans en juin 2013. La main de
Rabia, symbole de ralliement des partisans des Frères musulmans, a également été récupérée
lors de manifestations à Rehab (Fig. 12), en référence à la place Rabia al-Adawiyya, bastion
du camp frériste devenu le symbole de la répression violente du régime à l’égard de la
congrégation après les évènements d’août 2013. Par l’attraction et l’aura symbolique qui les
caractérisent, ces principaux lieux de rassemblement dans le centre-ville tendent à accaparer
l’attention générale, reléguant les théâtres secondaires de l’expression politique à leur
situation satellitaire d’imitateur ou de relai d’un écho révolutionnaire parti du centre-ville.
3.2 Espaces privés et politique dans le contexte égyptien : l’importance du recul historique
Concevoir les compounds comme des espaces secondaires d’expression politique,
dépendant symboliquement et matériellement des lieux centraux du politique, peut toutefois
sembler réducteur. Même s’il ne s’agit de pas de nier la moindre intensité des manifestations
tenues à Rehab, voire le décalage dans l’engagement politique de certains habitants, qui
peuvent suggérer l’analogie avec un écho de la ferveur révolutionnaire, il est intéressant de
questionner le cadre analytique implicite de cette relation de dépendance au centre des
57 Cf. Fig. 2 et Première partie, 1.3. 58 Entretiens avec Sally et Ahmed, réalisés respectivement le 29 et le 12 avril 2014. 59 Cette manifestation du 30 décembre 2011 à Rehab s’inscrit dans le cadre d’une critique générale du Conseil des forces armées alors à la tête du régime de transition depuis la destitution de Moubarak en février et dans l’attente des élections présidentielles de mai 2012. Cf. annexe 1.
- 52 -
quartiers périphériques. Tout se passe comme si l’expression politique, a fortiori
révolutionnaire, ne pouvait trouver de terrain favorable hors des « espaces publics » de la
ville-centre dense, socialement mixte et ancienne. Cette idée repose, à nos yeux, sur une
critique normative des compounds, qui empêche de saisir leur spécificité dans l’histoire
urbaine locale et qui obscurcit en conséquence la compréhension de la place qu’ils sont
susceptibles d’occuper dans la configuration politique actuelle. Souvent interprétés comme un
modèle urbain global importé indirectement des Etats-Unis après un passage par les pays du
Golfe, les compounds introduiraient une rupture inédite avec le modèle de la ville mixte
traditionnelle. Marion Séjourné déplore ainsi l’émergence d’une « structure duale “dans les
modes d’habiter”, mettant à mal la structure et le modèle jusqu’alors prédominant de ville
mixte, dense et compacte ». Cette dernière se trouverait dédoublée par une « ville en chantier
(…) où fait défaut l’urbanité, qui, comme le rappelle Jacques Lévy “consiste en la mise en co-
présence du maximum d’objets sociaux dans une conjonction de distance minimale” et donc
synonyme de densité et de diversité » (2005, p.199).
Or, cette critique normative et négative des compounds omet généralement toute analyse
historique sur la place des espaces privés dans la ville du Caire et laisse penser que certains
commentateurs étrangers, familiers d’une histoire urbaine européenne marquée par
l’importance symbolique et politique des espaces publics, font peu de cas d’un contexte
historique et urbain différent. Si l’on opte pour une perspective historique tenant compte de la
« dépendance au sentier »60 propre à chaque contexte local (Glasze, 2005), les quartiers
résidentiels fermés qui se développent aujourd’hui sous une forme standardisée dans le monde
entier s’inscrivent à chaque fois dans une histoire urbaine locale spécifique dont l’analyse sur
le temps long permet éventuellement de relativiser la nouveauté de cette forme de
privatisation résidentielle. Dans le cas européen, le développement de lotissements
résidentiels sécurisés peut ainsi être lu comme une variation formelle de la privatisation
résidentielle qui existait déjà sous la forme de rues fermées, ou « villas » depuis plusieurs
siècles (Callen, Le Goix, 2007). Dans le cas égyptien, le modèle de la « ville mixte »
traditionnelle que ruinerait l’émergence des compounds mérite d’être nuancé par une
perspective historique tenant compte de la place des espaces privés, et notamment des
60 Le concept de « dépendance au sentier », ou « path-dependency » en anglais, est importé en géographie depuis l’économie institutionnelle pour étudier comment les transformations urbaines ou les mutations des systèmes productifs dépendent des institutions formelles et informelles propres à un pays ou un contexte local particulier. Glasze (2005) résume ainsi cette idée : « Formal institutions like laws or contracts as well as informal institutions such as traditional social values and arrangements make urban development path-dependent. »
- 53 -
quartiers résidentiels, dans le tissu urbain cairote. André Raymond (1989 ; 1993), dont le
travail d’historien sur la ville du Caire reste une référence incontournable, nuance ainsi deux
idées reçues sur la ville arabe traditionnelle. Premièrement, loin d’être caractérisée par une
mixité sociale et économique, la ville du Caire, comme la plupart des villes arabes, est
marquée dans son tissu urbain ancien par une forte ségrégation résidentielle :
« Notre vision de l’habitat a également été quelque peu obscurcie par des stéréotypes. L’illusion que la société musulmane réelle serait fondamentalement égalitaire, comme la société envisagée sous l’angle de la religion, en est un. (…) Ou encore l’idée qu’il n’y aurait dans les villes arabes aucune ségrégation sur des bases socio-économiques, le pauvre côtoyant habituellement le riche dans des quartiers mixtes de ce point de vue. » (Raymond, 1993, p. 262).
Deuxièmement, la ville arabe musulmane traditionnelle se caractérise par une
prédominance de l’espace privé et fermé sur l’espace public, contrairement à la plupart des
villes européennes. Selon Claude Chaline (1989), la « référence islamique » de l’urbanisation
traditionnelle des villes arabes explique « la priorité donnée à l’introversion de l’individu et
de la famille ». Il remarque également que « l’importance du temps consacré à la vie privée et
une codification de la pratique des espaces urbains conduisent à une parfaite opposition entre
espace public et espace privé. L’espace public ne prend quelque ampleur que dans le centre-
ville, en relation avec la présence quasi exclusive des fonctions de centralité (…). A l’inverse,
l’espace privé prend une extrême importance ». La prédominance de l’espace privé dans le
tissu urbain est manifeste dans la répartition fonctionnelle des usages du sol : dans la médina
de Tunis, l’espace privé représente par exemple 69% de l’espace urbain total. Au Caire, les
quartiers résidentiels, situés à l’écart du centre de la ville traditionnelle, réservent ainsi une
large superficie de la ville à un usage privé.
« A quelque distance du centre se déployaient les quartiers de résidence (hâra). Ils constituaient, comme dans toutes les villes arabes, la cellule urbaine de base. C’est là que vivait la plus grande partie de la population. (…). Les quartiers constituaient des ensembles relativement fermés. Ils ne comportaient qu’un nombre limité d’ouvertures sur l’extérieur, souvent une seule qui pouvait être fermée (la nuit en règle générale) par une porte : la rue principale, darb, d’où le quartier tirait souvent son nom, donnait accès à un réseau hiérarchisé de voies et, finalement, à des impasses. Habituellement, les quartiers ne comptaient pas d’activités économiques, mais disposaient d’un marché (…), éventuellement un moulin et un four public. L’équipement du quartier pouvait être complété par un petit oratoire, pour les prières quotidiennes, la prière du vendredi se déroulant normalement dans les grandes mosquées du centre. Cellule fondamentale de la ville le quartier était le théâtre d’une vie communautaire active. » (Raymond, 1993, p. 270-271)
Il est frappant de constater, pour l’observateur de la ville du Caire contemporaine, la
grande ressemblance de ces quartiers traditionnels décrits par André Raymond avec les
compounds récents en termes de morphologie, d’organisation fonctionnelle voire de
- 54 -
dépendance au centre pour certaines fonctions commerciales et religieuses. Loin de
représenter une complète anomalie dans le paysage urbain cairote, et malgré leurs spécificités
communes au modèle global de la gated community, les compounds s’inscrivent d’une
certaine manière dans l’héritage historique de cet urbanisme arabe traditionnel caractérisé par
l’importance de la fermeture résidentielle. Ainsi, la prise en compte de l’histoire urbaine
cairote permet à la fois de relativiser l’idée que les compounds apporteraient une forme de
segmentation socio-spatiale fondamentalement nouvelle et de nuancer l’importance des
espaces publics dans le fonctionnement général de la ville. Dès lors, peut-être faudrait-il
réinterroger la qualification des compounds comme des lieux secondaires du politique par
rapport aux espaces publics centraux en déconstruisant la dichotomie souvent posée comme
une évidence qui oppose l’espace public, pensé comme le lieu d’expression politique, trop
rapidement qualifiée de démocratique, à l’espace privé, comme lieu apolitique ou d’absence
de liberté d’expression politique.
3.3 Derrière les murs, l’invention d’un nouveau mode d’expression politique ?
Dans le contexte postrévolutionnaire égyptien, la comparaison entre la liberté
d’expression permise dans l’espace public, notamment les grandes places du centre-ville
cairote, et celle autorisée dans l’espace privé et fermé des compounds permet de nuancer cette
dichotomie simpliste61. Les espaces publics du centre-ville qui ont été à l’épicentre des actions
collectives de contestation du régime ont tout d'abord fait l’objet d’un fort contrôle policier,
limitant grandement la liberté d’expression des manifestants. La répression policière sur
Tahrir ou la place Rabia a ainsi causé plusieurs milliers de morts aussitôt revendiqués par les
groupes d’opposition comme autant de martyrs tombés pour leur cause. Par ailleurs, le
harcèlement sexuel omniprésent dans les rues du centre-ville cairote rend particulièrement
difficile voire dangereux pour des femmes de se rendre seules à ces manifestations. Comme
l’écrit Nisrin Abu Amara (2011), le harcèlement sexuel restreint in fine l’expression politique,
notamment celle des femmes, dans l’espace public :
« Inséparable d’un contexte de répression de l’État, cette forme de harcèlement constitue une violence politique destinée à contrôler la liberté d’expression des femmes et des hommes dans l’espace politique ».
De plus, certains lieux symboliques de la révolution, tels que la place Tahrir et les rues
alentour du centre-ville, ont été verrouillés par l’armée dès sa reprise en main du pouvoir dans
61 Cette déconstruction théorique de la dichotomie espace public démocratique/espace privé apolitique est menée avec pertinence par Andrew Kirby dans le contexte nord-américain (Kirby, 2008).
- 55 -
le régime de transition suivant la destitution de Moubarak en 2011. Comme le remarque
Roman Stadnicki (2012), « cette stratégie de fermeture de l’espace est tout à fait
contradictoire avec la fonction de lieu ouvert, de circulations et d’échanges endossée par
Tahrîr pendant la révolution. En quelques mois, l’armée est ainsi parvenue à en briser le
premier symbole ». Certains murs sont aujourd’hui encore visibles dans les rues desservant
Tahrir et d’autres ont été remplacés par des portails souvent encore fermés le vendredi et
pendant la nuit (Fig. 14).
Parallèlement au verrouillage des espaces publics et à l’omniprésence de la répression
dans ces lieux symboliques de la contestation révolutionnaire, certains quartiers résidentiels
du Caire sont devenus des bastions de la résistance contre la tentative organisée par le régime
de faire cesser les manifestations par la peur. En réaction à l’insécurité générale liée
notamment au retrait des forces de police de l’espace public, des comités populaires, les
lajaan chaabeya, ont été formés par des habitants soucieux d’assurer la sécurité de leur
quartier (Bremer, 2011). Pour Perrine Lachenal, qui a étudié le fonctionnement de ces
organisations notamment dans le quartier huppé de Zamalek, « ces « comités populaires »
constituent une des scènes majeures de [la période révolutionnaire] : scène sur laquelle se sont
improvisées et s’improvisent toujours des formes inédites de mobilisation et de participation,
et scène sur laquelle les habitants et les habitantes, acteurs et actrices politiques de l’Egypte,
contribuent à l’ « échelle » du quartier, à faire l’Histoire » (Lachenal, 2012, p.132). Alors que
l’espace public, verrouillé matériellement ou symboliquement par des régimes autoritaires, ne
permet pas la libre expression politique, d’autres lieux, tels que les quartiers de résidence,
Fig. 14 : Portail au croisement de la rue Falaki et de la rue Mohammed Mahmoud. Près de la place Tahrir, ce passage est ouvert le jour mais fermé aux voitures après minuit. Cliché : E. Braud, 2014.
- 56 -
émergent comme des échelles pertinentes de la contestation, en Egypte mais également au
Moyen-Orient en général (Bozarslan, 2011).
A l’échelle des quartiers résidentiels, les compounds privés et fermés de la périphérie du
Caire représenteraient-ils alors de nouveaux espaces garants d’une liberté d’expression
réprimée partout ailleurs dans le pays ? S’il est trop tôt pour répondre à cette question, force
est de constater que, dans le cas de Rehab, les pratiques politiques des habitants ces dernières
années suggèrent la possibilité pour cette ville fermée d’offrir un mode d’expression politique
alternatif dans le contexte postrévolutionnaire et autoritaire actuel. D’une part, cette modalité
différente de l’expression politique se caractérise par sa non-violence. Selon Shady, « à
Rehab, les manifestations ne sont pas des manifestations agressives, c’est pas la même chose
qu’au Caire »62. Cette différence s’explique sans doute moins par le comportement des
manifestants, similaire à celui des participants aux manifestations dans le centre-ville d’après
nos observations, mais davantage par l’absence de répression par les forces de sécurité privées
du quartier. Le contrôle social et le souci, exprimé par les habitants, de ne pas ruiner la
tranquillité ou le cadre de vie de leur quartier jouent sans doute également dans la prévention
d’éventuels débordements violents, survenus ailleurs au Caire, qui ont contribué à associer,
dans les représentations des habitants, la politique à la violence. D’autre part, la possibilité
pour les partisans à la fois de Tamarod et des Frères musulmans de manifester dans les rues
de Rehab illustre une relative tolérance vis-à-vis d’une expression politique plurielle.
Toutefois, l’intolérance générale à l’égard des Frères musulmans qui s’est emparée du pays, et
n’a pas épargné les habitants des compounds, ainsi que le caractère relativement exclusif de
ces actions collectives organisées dans une enceinte privée incitent à relativiser cette plus
grande pluralité d’expression.
La gestion privée de Rehab, qui garantit un certain détachement du contrôle autoritaire du
régime, offre ainsi un potentiel favorable à une modalité alternative d’expression politique,
forme non-violente, presque « feutrée », et tolérante d’un certain pluralisme. Cependant, si, à
certains égard, un degré plus grand de liberté d’expression semble exister à Rehab que dans
les espaces publics verrouillés du centre-ville, ceux-ci ne perdent en rien de leur force
symbolique et l’activation du potentiel politique alternatif de Rehab et des quartiers
résidentiels privés en général, pour en faire des lieux complémentaires du politique, dépend
de l’investissement futur des habitants et de l’évolution de leurs représentations quant à la
place de leur quartier dans la configuration politique autoritaire actuelle.
62 Entretien avec Shady, réalisé le 24 avril 2014.
- 57 -
CONCLUSION
Le développement récent et rapide de quartiers fermés, les compounds, dans les
périphéries désertiques du Caire s’inscrit dans une tendance plus générale à la privatisation
résidentielle telle qu’elle peut être observée ailleurs dans le monde. En choisissant de prêter
attention aux discours et aux représentations des habitants de ces nouveaux quartiers, par une
approche de géographie politique « par le bas », on a esquissé une première réflexion à la fois
sur l’effet de la gestion privée sur le rapport ordinaire au politique des habitants, et sur la
place des compounds dans la configuration politique postrévolutionnaire.
Habiter dans un compound se traduit tout d’abord, dans les discours et les pratiques des
habitants rencontrés à Rehab, par une certaine déconnexion des enjeux politiques méso ainsi
qu’un décalage temporel dans la participation à la révolution et la transition politique. Si les
habitants rencontrés manifestent un intérêt général pour la politique nationale égyptienne, ils
font preuve pour beaucoup d’une méconnaissance voire d’un désintérêt très net à l’égard des
enjeux, notamment sociaux, inhérents au développement métropolitain. La prise en charge
efficace de la gestion du quartier par le promoteur privé, comme c’est le cas à Rehab, rend les
habitants indépendants des institutions publiques et, par là même, relativement imperméables
aux enjeux urbains métropolitains. Ainsi, la distance physique et géographique avec les autres
quartiers et habitants de la ville du Caire, distance finalement toute relative en raison des
interdépendances dues aux mobilités quotidiennes, se double toutefois d’une déconnexion
mentale qui isole d’autant plus les habitants des compounds d’une société cairote dont ils ne
partagent ni les préoccupations quotidiennes ni les aspirations. Cette « vie en parallèle »
encourage par ailleurs l’adoption d’une rationalité en finalité qui se traduit notamment chez
certains par un décalage temporel dans la participation à la transition politique. Si quelques
habitants ont participé aux premières manifestations de la révolution en 2011, beaucoup ont
observé la révolution de loin – et avec méfiance. Les échos de Tahrir ont tout d’abord suscité
la peur et le repli, avant que le mouvement Tamarod appelant au départ du gouvernement
Morsi en juin 2013 recueille un fort soutien dans ces quartiers.
Cette enquête de terrain nous a également permis de mieux comprendre la place de ces
quartiers et leurs habitants dans la configuration politique égyptienne post-2011. Si les
compounds apparaissent de prime abord, tant dans les discours promotionnels que ceux des
habitants, comme des lieux apolitiques, la réalité des pratiques traduit une réappropriation de
l’espace du compound pour en faire un territoire politique ou, tout du moins, un support de
- 58 -
visibilité de l’expression politique. Cette politisation du lieu de vie diffère selon les quartiers
et notamment leur taille : pour les compounds uniquement résidentiels la politisation est
largement dématérialisée tandis que dans une ville fermée à usage mixte comme Rehab
l’espace commun est réapproprié par certains habitants, ponctuellement, comme un lieu
d’expression politique à la fois locale et nationale. Cependant, la politisation du quartier
fermé diffère de celle, largement décrite, des lieux désormais symboliques de la lutte politique
au Caire, à la fois par sa nature et son intensité. Lieux satellites du politique, les compounds
recueillent ainsi les échos dépassionnés des revendications politiques exprimées dans les lieux
publics du centre-ville sous la forme de manifestations « exclusives » et strictement non
violentes. En permettant l’expression d’une modalité « feutrée » du politique, on peut se
demander si ces quartiers introduisent une nouvelle forme d’expression politique susceptible
d’être généralisée ailleurs comme une alternative au modèle révolutionnaire ou se contentent
de reproduire un pâle ersatz de la mobilisation politique. Malgré les limites de son
implémentation, notamment lors des manifestations de soutien à Tamarod à Rehab, la
revendication par les habitants des compounds d’une « politique sans violence » révèle
toutefois une manière de penser la politique en complémentarité voire en opposition avec la
modalité révolutionnaire aujourd’hui vivement réprimée dans des espaces publics verrouillés.
Au terme de cette enquête de terrain, le rapport au politique des habitants des quartiers
fermés du Nouveau Caire ne saurait donc être réduit à un strict apolitisme et une mise à
l’écart radicale du reste de la société. Selon l’échelle et la nature du quartier, l’effet de lieu
joue différemment sur le rapport et la participation à la vie politique nationale, faute d’un
désintérêt manifeste pour les échelons inférieurs du politique, mais les échos de Tahrir
continuent indéniablement de résonner dans les compounds et une forme de politisation
nouvelle pourrait être en marche.
Alaa el-Aswany appelait, avant la révolution, au boycott des élections prévues par le
régime de Moubarak, qu’il comparait à une « pièce stupide et ennuyeuse » qui n’avait pas
besoin de « figurants »63. Avec prudence et sans se risquer sur la voie périlleuse de la
divination, on peut tout du moins s’accorder aujourd’hui sur l’idée que les habitants des
quartiers fermés du Caire, malgré la distanciation mentale qui les éloigne de leurs voisins hors
les murs, se défont peu à peu de leurs costumes de figurants dans le jeu politique égyptien.
L’inconnue cependant reste entière quant au rôle qu’ils souhaiteront s’attribuer lors de la
prochaine représentation.
63 El-Aswany, A. (2011). Chroniques de la révolution égyptienne. Paris : Actes sud, p.131.
- 59 -
ANNEXES
Annexe 1 : Sources et données collectées sur le terrain……...…………………………p. 59
Annexe 2 : Canevas d’entretien.…………………………………………………………p. 61
Annexe 3 : Dates-clés de la transition politique égyptienne (2011 – 2014) ……...……p. 62
* * *
Annexe 1 : Sources et données collectées sur le terrain
1) Entretiens
Entretiens avec des habitants de Rehab (ville fermée du Nouveau Caire) : -‐ Abdullahi (6/04/2014) -‐ Mirna (6/04/2014) -‐ Manel (12/04/2014) -‐ Ibrahim (12/04/2014) -‐ Ahmed (12/04/2014) -‐ Wadia (22/04/2014) -‐ Shady (24/04/2014) -‐ Hamida (29/04/2014) -‐ Sally (29/04/2014) : habite à Banafseg, en face de Rehab
Entretiens « témoins » :
Avec des habitants d’autres compounds et quartiers du Caire : -‐ Randa, habite à Mirage City (compound du Nouveau Caire) et Nasr city (6/04/2014) -‐ Périhane, habite à Madinaty, un compound au sud de Shorouk (6/04/2014) -‐ Hala, habite à Maadi al-Gedid, un quartier de classes moyennes-supérieures au sud du
Caire (25/04/2014) Experts : -‐ Nicholas a habité un an à Haram City, quartier résidentiel non fermé de la ville
nouvelle de Six-Octobre (19/04/2014) -‐ Employé de Rehaby, agence immobilière à Rehab et Madinaty (26/04/2014)
2) Observations Observations et visites au Nouveau Caire :
-‐ Rehab : une visite en voiture, deux visites plus longues à pied sur deux jours -‐ Nouveau Caire : visite en voiture de plusieurs compounds (Mirage, Katameya
Residence, Swan Lake, Katameya Heights), de la zone commerciale de Tagamu el-Khames autour de Downtown et de Cairo Festival City
Observations « témoins » :
- 60 -
-‐ Plusieurs quartiers du Caire fréquentés au quotidien : Munira, Downtown, Zamalek, Dokki etc.
-‐ Quartier informel Izbet al-Hagana (ou Arbaa wu nos) situé en face du Nouveau Caire : entretiens informels avec des habitants sur la construction des logements (13/04/2014)
3) Réseaux sociaux sur Internet
Vidéos de manifestations à Rehab
• Manifestation à Rehab le 30 décembre 2011: Negm O. (01/01/2012). Al Rehab City, New Cairo Protests 30/12/2011 Part 1 [vidéo en ligne]. URL : https://www.youtube.com/watch?v=Lun8u5_BH5Q (consulté le 18 avril 2014) Negm O. (01/01/2012). Al Rehab City, New Cairo Protests 30/12/2011 Part 2 [vidéo en ligne]. URL : https://www.youtube.com/watch?v=jT_UWRqJF70 (consulté le 18 avril 2014)
• Manifestation à Rehab le 3 février 2012: Negm O. (03/02/2012). Protests in Al Rehab City 3rd of Feb 2012 Part 1 [vidéo en ligne]. URL : https://www.youtube.com/watch?v=cw7A6QjjBbs (consulté le 18 avril 2014)
• Manifestation à Rehab le 30 août 2013 : Shalaby O. (31/08/2013). Rab3a Protests in Al-Rehab City Cairo [vidéo en ligne]. URL : https://www.youtube.com/watch?v=zfYlonJq3gE (consulté le 18 avril 2014) Muslim Ummah Productions. (03/09/2013).
[vidéo en ligne]. URL : https://www.youtube.com/watch?v=WLUdzCjHlOE (consulté le 18 avril 2014)
• Manifestation à Rehab le 4 septembre 2013 : Abuelnga. (ca. 09/2013). Protestors peacefully protesting in Al-rehab city [vidéo en ligne]. URL : https://www.keek.com/abuelnga/keeks/HCpfdab#hHTddab (consulté le 18 avril 2014) Pages ou groupes Facebook créés par des habitants de compounds
• Rehab (pages et groupes ouverts): « Rehab residents ». URL : https://www.facebook.com/rehabresidents « Al-Rehab City ». URL : http://www.facebook.com/RehabARC « Rehab City ». URL : https://www.facebook.com/rehabcity : « Ensemble contre la corruption du gehaz al-medina de Rehab ». URL : https://www.facebook.com/pages/ ً 190223294343538/االلررححاابب-ممددييننةة-ججههاازز-ففسساادد-للممححااررببةة-معا
• Autres quartiers (groupes privés): « Katameya Heights Owners & Tenants Forum ». URL : https://www.facebook.com/groups/168600326524840/?fref=ts « Allegria Home Owners ». URL : https://www.facebook.com/groups/allegriahomeowners/?fref=ts « Madinaty Owners Union ». URL : https://www.facebook.com/groups/madinatyouners/?fref=ts
- 61 -
Annexe 2 : Canevas d’entretien
Biographie : Nom, âge, situation (célibataire ou marié), profession ou activité Lieu de vie et pratiques résidentielles : Quartier, date de l’emménagement, statut de propriété (propriétaire ou locataire) Pourquoi avez-vous choisi de vous installer dans ce quartier ? Quels sont d’après vous les points positifs de votre quartier ? Quels sont d’après vous les points négatifs de votre quartier ? Depuis votre installation, votre quartier a-t-il changé ? De quelle façon ? Vous sentez-vous proches de vos voisins ? Leur parlez-vous souvent ? Mobilités et représentations à l’échelle de l’agglomération : Quels sont les lieux que vous fréquentez régulièrement au Caire et pour quelles raisons ? Y a-t-il des lieux que vous évitez au Caire ? Pourquoi ? Quels sont les lieux que vous préférez au Caire ? Pourquoi ? Que pensez-vous des compounds ? (si habitant extérieur : aimeriez-vous y habiter ?) Comment vous déplacez-vous au quotidien ? Quel temps passez-vous dans les transports ? Quels problèmes rencontrez-vous lors de vos déplacements ? (trafic, stationnement…) Vos habitudes quotidiennes ont-elles changé depuis la révolution ? Opinion sur Le Caire en général : Etes-vous satisfait de vivre au Caire ? Quels sont d’après vous les problèmes les plus importants de cette ville ? Comment y remédier ? Trouvez-vous que la ville du Caire a changé depuis la révolution ? Et votre quartier ? Politique :
Politique nationale : Etes-vous intéressé-e par la politique du pays ? Pensez-vous aller voter pour les élections présidentielles ? - si non : pourquoi ? - si oui : pourquoi la politique est-elle importante pour vous ? Avez-vous participé à des manifestations depuis 2011 ? Si oui, lesquelles et pourquoi ? Avez-vous observé voire participé à des manifestations dans votre quartier ? Que pensez-vous de la révolution en général ? Politique locale : Faites-vous partie d’une association de copropriétaires/résidents ? Que pensez-vous de la gestion du quartier ? Avez-vous souvent recours au gehaz al-medina pour régler des problèmes ? En cas de problème ou de désaccord avec vos voisins, que faites-vous ?
- 62 -
Annexe 3 : Dates-clés de la transition politique égyptienne (2011 – 2014)
Extrait de « Chronologie de trois années de révolution ». 18/01/2014. Egypte en révolution(s). Les carnets du Cédej. URL : http://egrev.hypotheses.org/1092 25 janvier 2011 : une manifestation est organisée au Caire et dans certains gouvernorats. Des milliers de personnes participent à cette manifestation qui a coïncidé avec la fête de la police [l’appel avait été lancé par l’activiste bloggeur Waël Ghoneim sur la page Facebook « nous sommes tous Khaled Saïd », du nom du jeune homme de 28 ans torturé à mort par la police en juin 2010 à Alexandrie]. Ils protestent contre la dégradation de la situation politique, économique, sociale et contre les politiques du ministère de l’Intérieur.
28 janvier 2011 (le « vendredi de la colère ») : le régime de Moubarak a coupé le service de téléphone mobile et de l’internet. Des centaines de milliers de personnes sont sortis des mosquées pour se diriger vers la place al-Tahrir en scandant : « le peuple veut la chute du régime » : (al-cha‘ab yurîd isqât al-nizâm). Pas moins de 800 manifestants ont été ensuite tués et plus de 1000 personnes ont été blessées. Les manifestants ont imposé leur contrôle sur les villes de Suez et d’Alexandrie tout en en mettant le feu aux différents sièges du parti national démocratique (PND) et à des commissariats de police.
29 janvier 2011 : Moubarak adresse son premier discours au peuple. Il annonce le limogeage du gouvernement de Ahmed Nazif et la nomination de Omar Suleyman comme vice-président [la nomination d’un vice-président signifie que Moubarak a abandonné l’idée d’une succession dynastique au profit de son fils Gamal]. Il demande en outre au général Ahmed al-Chafiq de former le nouveau gouvernement.
30 janvier 2011: l’insécurité se généralise, la police déserte les rues et des commissariats sont incendiés. Des prisonniers se rebellent dans certaines prisons, 34 cadres des Frères emprisonnés se sont évadés de la prison de Wâdî Natroun.
31 janvier 2011 : le gouvernement formé par le général Ahmad Chafiq prête serment
1er février 2011 : Moubarak adresse son deuxième discours au peuple où il refuse de quitter le pouvoir. Il insiste sur le fait que le peuple doit choisir entre le chaos (al-fawda) et la stabilité.
2 février 2011 : montés sur des chevaux et des chameaux, un certain nombre de partisans de Moubarak, accompagnés d’hommes de mains et d’anciens condamnés, se sont dirigés vers la place Tahrîr. Ils portaient des bâtons, des armes blanches et des gourdins et ont lancé l’assaut sur la place Tahrir. Il y a eu ensuite échange de pierres entre les deux parties au cours de combats intermittents. Cela a continué des heures durant, les manifestants ont essayé de se défendre. Le cœur de la place s’est ensuite transformé en hôpital de fortune accueillant les blessés en grand nombre.
8 février 2011 : les manifestations géantes dans le cadre du troisième grand rassemblement « millionnaire » (milyôniyyat) se sont poursuivies, dans le cadre de la « semaine de la résistance » sur la place Tahrir, à Alexandrie et dans certaines villes d’Egypte, pour demander la chute du régime.
11 février 2011 : Omar Soleyman déclare que Moubarak a quitté le pouvoir. Après l’annonce de cette démission, une explosion de joie s’est emparée du pays, des millions de gens sont sortis dans toutes les rues et places du pays pour célébrer la nouvelle.
- 63 -
14 février 2011 : le Conseil suprême des forces armées annonce une nouvelle fois son espoir de terminer sa mission et de remettre l’Etat, dans un délai de 6 mois, à un pouvoir civil et à un président élu.
22 février 2011 : la confrérie des Frères musulmans a décidé de créer un parti politique – parti de Liberté et de la Justice (hizb al-huriyya wa al-adâla).
30 mars – la Déclaration constitutionnelle de 2011. Après le référendum sur les amendements constitutionnels, le 19 mars 2011, et la proclamation des résultats avec 77% de oui, le Conseil militaire a publié une Déclaration constitutionnelle qui a suspendu l’intégralité de la Constitution de 1971. La Déclaration a repris les dispositions adoptées par referendum, et a rajouté d’autres dispositions jugées par certains favorables à l’institution militaire.
3 août 2011 : début de la première session publique du procès de Moubarak.
19 novembre 2011 – les événements de Mohammed Mahmoud. Lors du vendredi appelé « vendredi de la demande exclusive », qui demande au Conseil militaire de céder le pouvoir aux civils, des affrontements se sont produits aux alentours de la place Tahrir et de la rue Mohammad Mahmoud. Les heurts se sont poursuivis du samedi 19 novembre au vendredi 25 novembre 2011 et se sont soldés par la mort de 41 martyrs parmi les manifestants.
23 janvier 2012 : première session de la nouvelle Assemblée du peuple, dominée par les Frères musulmans et les salafistes.
25 janvier 2012 : rupture entre les Frères musulmans et les forces révolutionnaires.
1er février 2012 – les événements de Port Saïd. Le massacre suivant un piège tendu aux membres des ultras d’al-Ahly au stade de Port Saïd, 73 supporters ont été tués et des centaines ont été blessés. C’est la plus grande catastrophe de l’histoire du sport égyptien.
24 mai 2012 : premier tour des élections présidentielles ; le général Ahmed Chafiq et le Dr. Mohammad Morsi sont qualifiés pour le deuxième tour.
30 juin 2012 : Morsi prête serment devant la Cour constitutionnelle, après sa proclamation comme président de la république.
19 novembre 2012 - les seconds événements de Mohammed Mahmoud : affrontements entre les forces de la sécurité et les manifestants qui s’étaient rassemblés dans la rue Mohammad Mahmoud pour demander que justice soit rendue et que les assassins des révolutionnaires morts à Mohammed Mahmoud en 2011 soient jugés et condamnés.
22 novembre 2012 : Morsi publie une déclaration Constitutionnelle où il s’attribue le pouvoir législatif et immunise ses décisions contre tout recours judiciaire, ce qui a provoqué la colère de l’opposition.
4-5 décembre 2012 : des milliers d’opposants ont manifesté devant le palais présidentiel d’al-’Ittihâdiyya contre la Déclaration constitutionnelle.
25 janvier 2013 : des manifestants ont investi la place Tahrir et d’autres places pour demander la réalisation des objectifs de la révolution et la fin du régime des Frères.
26 avril 2013 : la campagne de pétition de Tamarrud (« rébellion ») a été lancée pour
- 64 -
collecter des signatures, retirer la confiance à Mohammad Morsi et obtenir l’organisation d’élections présidentielles anticipées. Après quelques semaines, Tamarrud a annoncé avoir collecté 22 millions de signatures et a demandé à ceux qui ont signé de sortir manifester le 30 juin.
30 juin 2013 : des millions d’opposants à Morsi ont manifesté sur la place Tahrir et sur d’autres places de la république en demandant le limogeage de Morsi et l’organisation d’élections présidentielles anticipées.
1er juillet 2013 : l’état major de l’armée a publié une déclaration où il a donné 48 heures à tous pour répondre [favorablement] « aux demandes du peuple ».
3 juillet 2013 : la chaine de la télévision officielle a publié une déclaration prononcée par le ministre de la défense, le Général de l’armée, Abd al-Fatah al-Sîsî, qui a déclaré la destitution de Mohammad Morsi. Les forces nationales se sont mises d’accord sur une feuille de route, le poste de président a été confié au magistrat Adly Mansour, président de la Cour constitutionnelle.
8 juillet 2013 : le président Adly Mansour a publié une Déclaration constitutionnelle, suivie par la formation d’un comité des experts pour rédiger les amendements de la Constitution. Le Comité des cinquante a été ensuite formé, ses travaux et ses débats ont duré 60 jours et ont pris fin début décembre 2013.
14 août 2013 : les forces de la police et de l’armée ont dispersé les sit-in des partisans des Frères musulmans sur les places Râbia al-Adawiyya et al-Nahda, 45 jours après le début dudit sit-in. Les chiffres sont contradictoires sur le nombre de victimes lors de cet événement. Après la dispersion de deux sit-in, les partisans des Frères musulmans ont attaqué les commissariats de police en différents endroits de la république. Certains saboteurs ont attaqué des églises dans certains gouvernorats. L’Egypte est donc entrée dans le cycle de la violence. Le terrorisme a visé les institutions de l’Etat, les services de sécurité, et les éléments de la police et de l’armée
14-15 janvier 2014 : referendum sur les nouveaux amendements constitutionnels. Le « oui » l’emporte à 38,8% des voix (avec une participation d’environ 36% des inscrits). [27 mai 2014 : Abdel Fatah al-Sisi, ancien ministre de la Défense, est élu Président de la République avec 96% des voix contre son seul opposant, le nassériste Hamdeen Sabahi.]
- 65 -
BIBLIOGRAPHIE 1. Ouvrages et articles scientifiques Abu Amara N. (2011). « Le débat sur le harcèlement sexuel en Égypte : une violence sociale et politique ». Égypte/Monde arabe, Troisième série, n°9. Arnaud J.-L. (dir.). (2006). L’urbain dans le monde musulman de Méditerranée. Maisonneuve & Larose, coll. Connaissance du Maghreb, 224 p. Bajoit G. (1988). « Exit, voice, loyalty... and apathy. Les réactions individuelles au mécontentement ». Revue française de sociologie, vol. 29, n°2, p. 325-345. Barthel P.-A. (2011). « Repenser les « villes nouvelles » du Caire : défis pour mettre fin à un développement non durable ». Égypte/Monde arabe, Troisième série, n°8, p. 181–207. Barthel P.-A., Monqid S. (2011). Le Caire, réinventer la ville. Paris : Ed. Autrement, 253 p. Battesti V., Ireton F. (dir.) (2011). L’Egypte au présent. Paris : Actes Sud, 1179 p. Beaud S., Weber F. (2003, éd. 2010). Guide de l’enquête de terrain (4e édition). Paris : La découverte, coll. Guides Repères, 331 p. Béchir Ayari M. (2011). « Non, les révolutions tunisienne et égyptienne ne sont pas des « révolutions 2.0 » ». Mouvements, vol. 2, n° 66, p. 56-61. Ben Nefissa S. (2007). « “Ça suffit”? Le “haut” et le “bas” du politique en Egypte ». Politique africaine, n°108, p. 5-24. Ben Nefissa S. (2011). « La vie politique locale : les mahalliyyât et le refus du politique ». In Battesti V., Ireton F. (dir.), L’Egypte au présent. Paris : Actes Sud, p. 343-366. Ben Néfissa S. (2011). « Révolution arabes : les angles morts de l'analyse politique des sociétés de la région ». Confluences Méditerranée, vol.2, n° 77, p. 75-90. Bouhali A. (2008). Les compounds cairotes ou la fabrique d’un nouveau mode d’habiter. Des communautés fermées à la ville privatisée ?. Lyon : ENS-LSH, mémoire de Master 1. Bourdieu P. (1979). La distinction : critique sociale du jugement. Paris : Les Editions de Minuit, coll. Le sens commun, 672 p. Bourdieu P. (1981). « La représentation politique [Éléments pour une théorie du champ politique] ». Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 36-37, p. 3-24. Boutaleb A. (2009). « Jeunes et « carrières publiques » en Égypte ». Agora débats/jeunesses, vol. 2, n° 52, p. 105-120. Boutaleb A. (2011). « La jeunesse : une réalité massive, une catégorie émergente ». In Battesti V., Ireton F. (dir.), L’Egypte au présent. Paris : Actes Sud, p. 731-748. Bozarslan H. (2011). Sociologie politique du Moyen-Orient. Paris: La Découverte, 125 p.
- 66 -
Bremer J. A. (2011). “Leadership and Collective Action in Egypt's Popular Committees: Emergence of Authentic Civic Activism in the Absence of the State”. The International Journal of Not-for-Profit Law, vol. 13, n°4.
Callen D., Le Goix R. (2007). « Fermetures et “entre soi” dans les enclaves résidentielles ». In Le Goix, Saint-Julien, La métropole parisienne. Centralités, inégalités, proximités. Paris : Belin, coll. Mappemonde.
Capron G. (dir.). (2006). Quand la ville se ferme. Quartiers résidentiels sécurisés. Paris : Editions Bréal, coll. D’autre part, 288 p. Catusse M., Bonnefoy L. (dir.). (2014). Jeunesses arabes. Du Maroc au Yémen : Loisirs, cultures et politique. Paris : La Découverte, 447 p. Cséfalvay Z., Webster C. (2012). « Gates or No Gates? A Cross-European Enquiry into the Driving Forces behind Gated Communities ». Regional Studies, vol. 46, n°3, p. 293-308. Chaline C. (1989). Les villes du monde arabe. Paris: Masson, 188 p. Charmes E., Launay L., Vermeersch S. (2013). « Le périurbain, France du repli ? ». La Vie des idées. URL : http://www.laviedesidees.fr/Le-periurbain-France-du-repli.html (consulté le 3 mai 2014) Cohen A., Lacroix B., Riutort P. (dir.). (2009). Nouveau manuel de science politique. Paris : La Découverte, 792 p. Curtelin M., Frais C. (2010). Les développeurs privés et l’aménagement urbain durable au Caire. Paris : Université Paris 1, mémoire de Master 1. Danic I. (2006). « La notion de représentation pour les sociologues. Premier aperçu ». Revue ESO, n°25. Davis M. (1999). Ecology of Fear: Los Angeles and the Imagination of Disaster. New York : Vintage.
Davis M., Monk D. (dir.). (2007). Paradis infernaux. Les villes hallucinées du néo-capitalisme. Paris : Les Prairies Ordinaires. De Koning A. (2009). Global Dreams : Space, Class and Gender in Middle Class Cairo. Cairo : American University in Cairo Press, 195 p. Denis E. (1995). « Le Caire : aspects sociaux de l’étalement urbain ». Égypte/Monde arabe, Première série, n°23. Denis E. (2006). “Cairo as a neo-liberal capital?”. In Singerman D., Amar P., Cairo Cosmopolitan: Politics, Culture, And Urban Space In The New Globalized Middle East. Cairo: American University in Cairo Press, p. 47-71. Denis E., Séjourné M. (2003). « Le Caire, métropole privatisée ». Urbanisme, n°328, p. 31-37. Dureau F., Dupont V., Lelièvre E., Lévy J.-P., Lulle T. (dir.). (2000). Métropoles en mouvement. Une comparaison internationale. Paris: Anthropos Economica-IRD, coll. Villes, 656 p. El Chazli Y. (2012). « Sur les sentiers de la révolution ». Revue française de science politique, vol. 62, p. 843-865.
- 67 -
El Kadi G. (1994). « Le Caire : la ville spontanée sous contrôle ». Monde arabe Maghreb-Machrek, numéro spécial, p. 30-41. Fillieule O., Bennani-Chraïbi M. (2003). « Chapitre 1. Exit, voice, loyalty et bien d’autres choses encore… ». In Fillieule O., Bennani-Chraïbi M., Résistances et protestations dans les sociétés musulmanes. Paris : Presses de Sciences Po « Académique », p. 43-126. Florin B. (2003). « Faire la ville hors la ville ou l’extraterritorialité des compounds, quartiers fermés du Grand Caire ». Regards sociologiques, nos 25 & 26. Florin B. (2005). « Vivre en parallèle ou à l’écart : l’évolution des villes nouvelles du Grand Caire ». Annales de la recherche urbaine, n° 98, p. 97-105. Florin B. (2011). « Des cités nassériennes aux villes nouvelles du désert : la fin du logement social ? ». In Battesti V., Ireton F. (dir.), L’Egypte au présent. Paris : Actes Sud, p. 129-144. Florin B. (2012). « Les quartiers fermés du Grand Caire. Dimensions urbanistiques et idéologiques d’une forme de ville : nouvelle urbanité ou césure urbaine ? ». L’Espace Politique, n°17 [en ligne]. URL : http://espacepolitique.revues.org/2393 (consulté le 3 avril 2014). Glasze G. (2002). “The global spread of gated communities”. Environment and Planning B: Planning and Design, vol. 29. Glasze G. (2005). “Some reflections on the Economic and Political Organisation of Private Neighbourhoods”. Housing Studies, vol. 20, n°2, p.221-233. Glasze G., Webster C., Frantz K. (dir.). (2006). Private cities. Global and Local Perspectives. Routledge Studies in Human Geography, 256 p. Guyot S. (2009). « Une méthodologie de terrain ‘avec de vrais bricolages et plein de petits arrangements’... ». Communication au colloque « À travers l'espace de la méthode : les dimensions du terrain en géographie ». Arras, 18-20 juin 2008.
Hassabo C. (2009). « Du rassemblement à l'effritement des Jeunes pour le changement égyptiens. L'expérience de « générations qui ont vécu et vivent toujours sous la loi d'urgence » ». Revue internationale de politique comparée, vol. 16, p. 241-261. Hirschman A. (1970). Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States. Cambridge, MA, Harvard University Press, 162 p. Ibrahim K., Singerman D. (2014). « L’Égypte urbaine : de la révolution vers l'État ? Gouvernance, urbanisme et justice sociale ». Égypte/Monde arabe, Troisième série, n°11. Jossifort S. (1995). « L'aventure des villes nouvelles ». Égypte/Monde arabe, Première série, n°23.
Kirby A. (2008). “The production of private space and its implications for urban social relations”. Political Geography, vol. 27, n°1, p. 74-95.
Lachenal P. (2012). « « Il n’y avait plus personne pour nous protéger, il fallait agir ! », Ethnographie des lajân sha’abeya (comités populaires), le Caire, 2011 ». In Lavergne M. (dir.), Une société en quête d’avenir. Egypte, an deux de la révolution. Paris : L’Harmattan, p. 109-123. Larsen L. et al. (2004). « Bonding and Bridging : Understanding the Relationship between Social Capital and Civic Action ». Journal of Planning Education and Research, n° 24, p.64-77.
- 68 -
Lavergne M. (dir.). (2012). Une société en quête d’avenir. Egypte, an deux de la révolution. Paris : L’Harmattan, 154 p. Lavergne M. (dir.). (2012). L’émergence d’une nouvelle scène politique. Egypte, an deux de la révolution. Paris : L’Harmattan, 116 p. Lefébure P. (2009). « Les rapports ordinaires à la politique ». In Cohen A., Lacroix B., Riutort P. (dir.), Nouveau manuel de science politique. Paris : La Découverte, p. 374-392. Lefebvre H. (1974, éd. 2000). La production de l’espace (4e édition). Paris: Economica, 512 p. Le Goix R. (2001). « Les “communautés fermées” dans les villes des Etats-Unis. Aspects géographiques d’une sécession urbaine ». L’Espace géographique, n°1. Le Goix R. (2006). « Les gated communities aux Etats-Unis et en France : une innovation dans le développement périurbain ? ». Hérodote, n° 122. Le Goix R., Loudier-Malgouyres C. (2004). « “L’espace défendable” aux Etats-Unis et en France ». Urbanisme, n° 337. Le Goix R., Vesselinov E. (2012). « Gated Communities and House Prices : Suburban Change in Southern California, 1980–2008. ». International Journal of Urban and Regional Research, DOI 10.1111/j.1468-2427.2012.01139.x. Le Houérou F. (2007). « Voisins ou ennemis à Arba Wa Nus ? La mise en scène du quotidien des migrants forcés égyptiens et réfugiés sud soudanais dans un quartier populaire du Caire ». Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, n°119-120.
Low S. M. (2001). “The Edge and the Center: Gated Communities and the Discourse of Urban Fear”. American Anthropologist, New Series, vol. 103, n°1, p. 45-58.
Marafi S. (2011). The Neoliberal Dream of Segregation: Rethinking Gated Communities in Greater Cairo, a Case Study, Al-Rehab City Gated Community. Cairo : The American University in Cairo, Master thesis. Mitchell D. (1995). “The End of Public Space? People's Park, Definitions of the Public, and Democracy”. Annals of the Association of American Geographers, vol. 85, n°1, p. 108-133. Moisseron J.-Y., Clément F. (2007). « Changements visibles ou invisibles : la question de l’émergence de l’économie égyptienne ». Politique Africaine, n°108.
Nada M. (2014). « The Politics and Governance of Implementing Urban Expansion Policies in Egyptian Cities ». Égypte/Monde arabe, Troisième série, n°11.
Neveu E. (2009). « Les mobilisations ». In Cohen A., Lacroix B., Riutort P. (dir.), Nouveau manuel de science politique. Paris : La Découverte, p. 495-513. Olivier de Sardan J.-P. (1995). « La politique du terrain ». Enquête, n°1. Pagès-El Karoui D. (2012). « Géographie du changement social en Égypte ». EchoGéo, n°21 [en ligne]. URL : http://echogeo.revues.org/13204 (consulté le 7 janvier 2014). Pagès-El Karoui D., Vignal L. (2011). « Les racines de la « révolution du 25 janvier » en Égypte : une réflexion géographique ». EchoGéo, Sur le Vif [en ligne]. URL : http://echogeo.revues.org/12627 (consulté le 7 janvier 2014).
- 69 -
Pagès-El Karoui D. (2013). « Utopia ou l’anti-Tahrir: le pire des mondes dans le roman de A. K. Towfik ». EchoGéo, n°25 [en ligne]. URL : http://echogeo.revues.org/13512 (consulté le 7 janvier 2014). Putnam R. D. (2001). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon and Schuster, 652 p. Raymond A. (1989). « Espaces publics et espaces privés dans les villes arabes traditionnelles ». Maghreb-Machrek, n° 123, p. 194-201. Raymond A. (1993). Le Caire, Paris : Fayard, 428 p. Séjourné M. (2005). « Les figures contradictoires de la privatisation de l’espace cairote ». In Souiah S.-A. (dir.), Villes arabes en mouvement. Paris : l’Harmattan, p. 195-210. Sims D. (2012). Understanding Cairo: The Logic of a City Out of Control. Cairo: American University in Cairo Press, 388 p. Singerman D., Amar P. (2006). Cairo Cosmopolitan: Politics, Culture, And Urban Space In The New Globalized Middle East. Cairo: American University in Cairo Press, 564 p. Singerman, D., Amar P. (2011). Cairo Contested: Governance, Urban Space, and Global Modernity. Cairo: American University in Cairo Press, 544 p. Stadnicki R. (2012). « Le Caire après la révolution : blocages de la ville et déblocage de l’urbanisme ». Les Carnets de l’Ifpo. La recherche en train de se faire à l’Institut français du Proche-Orient [en ligne]. URL : http://ifpo.hypotheses.org/4419 (consulté le 5 janvier 2014). Stadnicki R. (2013). « De l’activisme urbain en Égypte : émergence et stratégies depuis la révolution de 2011 ». EchoGéo, n°25 [en ligne]. URL : http://echogeo.revues.org/13491 (consulté le 7 janvier 2014). Stadnicki R. (2014). “Les acteurs urbains à l’épreuve de la transition en Egypte”. Egypte/Monde Arabe, Troisième série, n°11. Steuer C. (2013). « Le moment thermidorien de la révolution égyptienne ». Confluences Méditerranée, vol. 4, n°87, p. 165-181. Walks R. A. (2004). “Place of residence, party preferences, and political attitudes in Canadian cities and suburbs”. Journal of urban affairs, vol. 26, n° 3, p. 269-295. Walks R. A. (2005). “The City-Suburban Cleavage in Canadian Federal Politics”. Canadian Journal of Political Science / Revue canadienne de science politique, vol. 2, n°38, p. 383-413. Walks R. A. (2006). “The Causes of City-Suburban Political Polarization. A Canadian Case Study”. Annals of the Association of American Geographers, vol. 96, n°2, p. 390-414.
- 70 -
2. Articles de presse Darwich D. « L’autogestion de la misère ». Al-Ahram Hebdo, 4/06/2008 [en ligne]. URL : http://hebdo.ahram.org.eg/Archive/2008/6/4/null0.htm (consulté le 10 avril 2014). Elshahed M. “From Tahrir Square to Emaar Square: Cairo’s private road to a private city”. The Guardian, 7/04/2014 [en ligne]. URL: http://www.theguardian.com/cities/2014/apr/07/tahrir-square-emaar-square-cairo-private-road-city (consulté le 7 avril 2014). Nawara W. “Egypt Should Preserve Unity Among Disparate Parties”. Al-Monitor, 09/2013 [en ligne]. URL : http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/09/egypt-alliance-crack-june-30.html# (consulté le 10 avril 2014). “Is There a Couch Party in Egypt?”. Al-Ahram online, 24/12/2011 [en ligne]. URL: http://english.ahram.org.eg/NewsContent/4/0/30129/Opinion/Is-there-a-Couch-Party-in-Egypt.aspx (consulté le 10 avril 2014). “Egypt's "couch party" takes to the streets”. Egypt independent, 01/07/2013 [en ligne]. URL: http://www.egyptindependent.com/news/egypt-s-couch-party-takes-streets (consulté le 10 avril 2014). « Un an après la tuerie de Port Saïd, les Ultras d'Al-Ahly demandent justice ». France 24, 23/01/2013 [en ligne]. URL : http://observers.france24.com/fr/content/20130123-apres-tuerie-port-said-«-ultras-»-al-ahly-demandent-justice (consulté le 14 mai 2014). Urban Research. “Urbanism and the Arab Uprisings: Beyond the Square”. Jadaliyya, 30/11/2013 [en ligne]. URL: http://www.jadaliyya.com/pages/index/15394/urbanism-and-the-arab-uprisings_beyond-the-square (consulté le 12 décembre 2013). 3. Sitographie Journaux égyptiens ou medias indépendants : Al-Ahram Hebdo. [en ligne] URL : http://hebdo.ahram.org.eg Daily News Egypt. [en ligne] URL http://www.dailynewsegypt.com Egypt Independent. [en ligne] URL : http://www.egyptindependent.com Jadaliyya Egypt. [en ligne] URL : http://egypt.jadaliyya.com Orient XXI. [en ligne] URL : http://orientxxi.info Blogs : Cairobserver. [en ligne] URL : http://cairobserver.com Culture et politique arabes. [en ligne] URL : http://cpa.hypotheses.org Egypte en révolution. Les Carnets du Cédej. [en ligne] URL : http://egrev.hypotheses.org
- 71 -
TABLE DES FIGURES Fig. 1: Une approche de géographie politique « par le bas » à l’articulation de trois pôles…………p. 5
Fig. 2 : Du Caire au Nouveau Caire, quartiers centraux et extensions périurbaines............................p. 7
Fig. 3 : Rehab, une ville fermée et privée du Nouveau Caire………………………………………. p. 7
Fig. 4 : Etude de l’effet de lieu du compound sur le rapport ordinaire au politique des habitants.…p. 20
Fig. 5 : « Une touche de sérénité » à Allegria……………………………………..………………. p. 26
Fig. 6 : Boutique, dans le mall 2 de Rehab…………………………………....…………………….p.28
Fig. 7 : Coiffeur féminin, dans le mall 1 de Rehab. …………………..……………………………p. 28
Fig. 8 : Etude des pratiques et représentations des habitants sur la place des compounds dans la
configuration spatiale et symbolique du politique en Egypte……………………………………….p. 38
Fig. 9 : Le food court et une mosquée de Rehab…………………………………………………... p. 40
Fig. 10 : Vendeur de livres près de la place Talaat Harb dans le centre du Caire…………………..p. 40
Fig. 11 : L’hommage au constructeur de Rehab dans la toponymie de la ville…………………….p. 40
Fig. 12 : Le signe de Rabia, lors d’une manifestation pro-Morsi à Rehab (août 2013)…….………p. 48
Fig. 13 : Une façade de Rehab décorée du drapeau égyptien………………………...…………….p. 48
Fig. 14 : Portail au croisement de la rue Falaki et de la rue Mohammed Mahmoud….……………p. 55
- 72 -
TABLE DES MATIERES REMERCIEMENTS .................................................................................................................................... 2
SOMMAIRE ............................................................................................................................................... 3
INTRODUCTION ........................................................................................................................................ 4
PREMIERE PARTIE : Privatisation résidentielle et rapport au politique : les éléments du débat dans le contexte égyptien ........................................................................................................................ 8
1. Mutations urbaines et transition politique : quelques éléments de contexte ........................ 8 1.1 L’extension périurbaine d’une ville « hors de contrôle » .................................................................... 8 1.2 Une gouvernance locale déficiente .................................................................................................... 10 1.3 Ville et révolution : des lieux-symboles du centre aux marges périurbaines ..................................... 11
2. Privatisation résidentielle et rapport au politique ................................................................. 13 2.1 La gated community : marqueur urbain d’un apolitisme néolibéral ? ................................................ 13 2.2 Les compounds cairotes : des enclaves apolitiques ? ......................................................................... 14
3. L’enquête de terrain : une méthodologie faite de « bricolages et d’arrangements » ......... 17 3.1 Le choix d’une approche qualitative .................................................................................................. 17 3.2 L’expérience de terrain : s’adapter aux aléas et faire feu de tout bois ............................................... 18
DEUXIEME PARTIE : Le rapport ordinaire au politique des habitants des compounds cairotes, quel effet de lieu ? ................................................................................................................................. 20
1. A la recherche des « répertoires invisibles » du politique .................................................... 20 2. L’écho de Tahrir : un intérêt général pour la politique égyptienne, une mobilisation de l’apathie à la prise de parole ........................................................................................................... 22
2.1 Le rapport à la politique nationale derrière les murs : un intérêt manifeste et partagé ...................... 22 2.2 Le réveil du Hizb al-Kanaba en 2013 : une mobilisation massive, deux ans après 2011 .................. 23
3. Echapper à la ville : une stratégie d’exit au service de la distinction sociale ...................... 25 3.1 Fuir Oum el-Dounia, son trafic, sa pollution… et ses habitants : un rapport distant aux enjeux politiques du développement métropolitain ................................................................................................. 25 3.2 La méconnaissance au service d’une mise à distance mentale des habitants des quartiers informels29 3.3 Une autre voie possible : une perception différente de la ville par des habitants hors les murs ........ 31
4. L’effet de lieu sur le rapport ordinaire au politique et les répertoires de mobilisation ..... 32 4.1 Pourquoi chercher à fuir la ville n’est pas synonyme de sécession politique égoïste ........................ 32 4.2 Quand la gestion privée façonne une « vie en parallèle » et nourrit une rationalité en finalité ......... 35
TROISIEME PARTIE : La place et la nature des compounds dans le paysage politique égyptien : pratiques et représentations des habitants ......................................................................................... 38
1. Le compound, un lieu apolitique dans la conception et les représentations ........................ 39 1.1 Le projet du promoteur : un espace commercial sans marque politique visible ................................ 39 1.2 L’espace vécu des habitants : Rehab, un lieu politiquement neutre .................................................. 42
2. Des pratiques politiques locales aux mobilisations nationales : le compound comme un lieu d’expression politique ............................................................................................................... 44
2.1 Le jeu politique local : quand le quartier devient le lieu et l’enjeu des mobilisations ....................... 44 2.2 Le compound, un théâtre de mobilisations aux enjeux nationaux ..................................................... 47
3. Les compounds dans la configuration politique égyptienne : lieux satellites ou complémentaires de la contestation postrévolutionnaire ? .......................................................... 50
3.1 Les compounds, un épiphénomène dans la configuration politique égyptienne ? ............................. 50 3.2 Espaces privés et politique dans le contexte égyptien : l’importance du recul historique ................. 51 3.3 Derrière les murs, l’invention d’un nouveau mode d’expression politique ? .................................... 54
CONCLUSION ......................................................................................................................................... 57
ANNEXES ................................................................................................................................................ 59
BIBLIOGRAPHIE ..................................................................................................................................... 65
TABLE DES FIGURES .............................................................................................................................. 71
TABLE DES MATIERES ........................................................................................................................... 72
Derrière les murs, l’écho de Tahrir Le rapport au politique des habitants des quartiers fermés du Grand Caire
Elise Braud
Résumé : Ce mémoire a pour objectif d’apporter, par une étude de cas sur les compounds, quartiers résidentiels privés et fermés du Grand Caire, un éclairage sur la relation entre participation politique et privatisation du périurbain résidentiel. Largement ignorée dans les analyses politiques de la transition postrévolutionnaire, la place de ces développements périphériques et de leurs habitants dans la configuration spatio-politique actuelle en Egypte mérite d’être étudiée. L’objectif de notre enquête de terrain, qui s’est concentrée sur la ville fermée de Rehab à l’est du Caire, était double. Il s’agissait de saisir, premièrement, le rapport ordinaire au politique des habitants et de comprendre, deuxièmement, quelle place leur quartier occupe par rapport aux lieux centraux de la contestation (post)révolutionnaire. Au terme de cette enquête, deux observations permettent de nuancer les représentations communément admises sur ces quartiers. Premièrement, le cas de Rehab suggère que la gestion privée du compound influence le rapport au politique des habitants, caractérisé par un désintérêt pour l’échelon métropolitain, et favorise une mobilisation politique guidée par une rationalité en finalité. Deuxièmement, loin de constituer des enclaves apolitiques, les compounds ont été le théâtre de mobilisations politiques, à visée locale ou nationale, et semblent entretenir davantage un rapport de complémentarité que de dépendance avec les lieux centraux de la contestation. Mots-clés : Egypte, compounds, privatisation, périurbain, révolution.