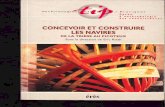La question des quartiers d’artisans en Grèce : quelle approche ? in A.Esposito, G.M.Sanidas...
-
Upload
univ-lille -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of La question des quartiers d’artisans en Grèce : quelle approche ? in A.Esposito, G.M.Sanidas...
AVANT-PROPOS
Le Symposium international sur la question des « quartiers d’artisans » en Grèce a été organisé dans le cadre du programme « Archéologie des espaces économiques », d’Halma-Ipel–UMR 8164 (CNRS, Lille 3, MCC). En plus du soutien du laboratoire d’origine, ce programme a bénéficié pour l'année 2009 d’un financement BQR par la Direction de la Recherche de l’Université Charles-de-Gaulle–Lille 3. Il a également bénéficié du soutien du CNRS et du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Conçue dans un premier temps comme une journée d’étude, cette rencontre internationale a dû être élargie en raison de nombreuses participations spontanées, particulièrement intéressantes pour la thématique. Le terme de cette manifestation scientifique est marqué par la publication du présent volume d'actes accueilli avec grande hospitalité dans la collection Archaiologia des Presses Universitaires du Septentrion.
Des remerciements chaleureux sont, avant tout, adressés aux communicants et auteurs mais aussi aux nombreux participants au symposium, dont certains sont venus de très loin. Parmi ces derniers, Marie-Françoise Billot, Francine Blondé, Roland Étienne et Alexandre Mazarakis-Ainian1 qui ont accepté d’animer la table ronde finale : nous leur exprimons toute notre reconnaissance.
De même, nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce symposium et à la publication de ces actes :
- l’Université Lille 3, qui par la décision de son conseil scientifique a généreusement soutenu cette entreprise ;
- les Presses Universitaires du Septentrion : Jérôme Vaillant, directeur exécutif, Arthur Muller, direc-teur de la collection Archaiologia, Nicolas Delargilière, directeur administratif et tous ses collaborateurs.
Nous exprimons également notre grande reconnaissance à Marie-Françoise Billot, Roger Hanoune, Jean-Jacques Maffre et Marion Muller-Dufeu pour leur aide précieuse.
Christine Aubry (UMR 8164) s’est chargée très courageusement de la mise en forme du volume ; elle a également participé, de manière exemplaire, à la coordination éditoriale. Gilbert Naessens (UMR 8164) a mis son art photographique et esthétique au service des illustrations du présent volume. Christophe Hugot (Bibliothèque des Sciences de l’Antiquité-Lille 3) a été la source d'inspiration de la première de couverture. Qu’ils en soient, tous les trois, vivement remerciés.
Ce volume est dédié à la mémoire de nos pères.Arianna Esposito, Giorgos M. Sanidas
1 Marie-Christine Hellmann, faisait également partie des animateurs de la table ronde finale. Des raisons indépendantes de sa volonté l’ont retenue à Paris. Nous la remercions de son intérêt et d’avoir transmis son texte et ses documents afin qu’ils puissent être présentés lors de la séance et être publiés.
La question des regroupements des activités économiques et le concept de « quartier d’artisans » : quelle approche ?
Arianna EspositoUniversité de Bourgogne, ARTeHIS–UMR 6298
Résumé – Les concepts de « quartier d’artisans » et de « zone », ainsi que d’autres, plus ou moins équivalents, sont souvent employés afin de décrire et d’analyser les concentrations d’activités de production et d’échanges dans les villes antiques. Le rôle du Céramique d’Athènes, en tant que « quartier » des potiers d’Athènes, est indéniablement décisif puisqu’il en est considéré comme le modèle. Ce type d’approche n’est pas dépourvu de contradictions et d’anachronismes. Une approche critique et une analyse circonstanciée des données disponibles permettent de mieux cerner la nature et la variété de contextes désignés par ces expressions dans la littérature courante. Dans cette perspective, quelques exemples sont présentés ici, de manière succincte, afin d’introduire une série de questions qui seront développés dans le cadre des contributions à ce volume. Le but est d’initier une réflexion plus large, à partir des données récentes et d’observations globales. En effet, si le recours aux notions de « quartier » ou de « zone » est récurrent dans la vulgate scientifique, leur conceptualisation en matière d’économie et d’urbanisme antiques peut s’avérer lourde de conséquences.
Abstract – The concepts of « craftsmen neighbourhood » and « zone », amongst other terms more or less equivalents, are often used to describe and analyse the production and exchange activities concentrations in antique cities. The Athens’ Ceramic role, as Athens’ potters neighbourhood, is definitely decisive in this context, being considered as the model of it. This kind of approaches is not devoided of contradictions and anachronisms. A critical approach and a circumstantial analysis of the available data allow a better understanding of the nature and variety of contexts designated by these expressions in the usual literature. In this perspective, some examples are succinctly presented here in order to introduce series of questions that will be developed in this volume’s contributions. The goal is to initiate a larger reflexion based on recent data and general observations.Indeed, if the usage of « neighbourhood » and « zone » notions is recurrent in the scientific vulgate, their conceptualization in terms of antique economy and urbanism can have serious consequences.
Mots-clés – Monde grec ; ville ; urbanisme ; artisanat ; « quartier » spécialisé ; « zone » ; concentration spatiale ; implantations artisanales.
Giorgos M. SanidasUniversité Lille 3, Halma-Ipel–UMR 8164
12 Arianna Esposito, Giorgos M. Sanidas
Dans les études classiques et en archéologie méditerranéenne, la notion de « quartier d’artisans » ou de « quartier spécialisé » s’impose dès qu’il est question d’urbanisme1 ou dès que l’on aborde, dans son ensemble2, le fonctionnement de l’artisanat dans la ville. Elle tient une place toute particulière dans l’archéologie grecque, car dans l’étude des villes classiques, grecques mais aussi romaines, le Céramique, le Kerameikos de la topographie et de la toponymie athéniennes, compris à Athènes au sens littéral de « quartier des potiers », est érigé en modèle de « quartier d’artisans ».
1. La notion de « quartier » et ses avatars : concepts et sources
En effet, qu’il s’agisse d’Athènes ou de nombreux autres sites urbains grecs, les vestiges laissent assez souvent déceler une certaine densité d’activités céramiques ou d’autres activités artisanales : dans plusieurs cas, elle se manifeste par une concentration de structures et d’autres vestiges liés à la production, soit à l’intérieur de l’agglomération soit aux « marges », souvent extra-muros3. Parallèlement, dans le cadre de travaux et de synthèses sur l’urbanisme, pour cerner la répartition des activités de production, les chercheurs recourent parfois aussi à un autre concept, celui de « zone » et de « zonage »4. Même si ces termes revêtent souvent une signification relativement « neutre », leur utilisation marque une étape supplémentaire dans la conceptualisation d’une spécialisation des espaces dans les villes antiques, notamment grecques5. Or ces concepts et notions de « zonage », de « spécialisation des quartiers » sont empruntés à l’urbanisme moderne. Leur emploi pour désigner et décrire la réalité antique influence inévitablement l’approche de l’urbanisme, du droit et de l’économie antiques, et ce d’autant plus fortement que cette approche intègre implicitement des analogies ou des différences entre l’Antiquité6 et des réalités plus récentes. Certes, on constate des groupements d’activités à l’Âge du bronze en Méditerranée orientale, en Égée7 et dans les Balkans ; mais dans la manière dont on imagine ou idéalise les « quartiers » grecs ou romains, les analogies conceptuelles se réfèrent plutôt aux réalités médiévales, celles de l’Italie où les statuts (statuti)8 qui règlent les implantations de certains métiers, ou celles des quartiers de souks ou de bazar de l’Orient, byzantin ou arabe9. Les notions de « quartier », de « zone », le concept de « zonage » risquent fort de n’être pas exempts d’anachronismes, tout particulièrement dans l’analyse de l’urbanisme grec antique10.
1 Martin 1974, p. 34-35 ; aussi Schwandner 1988 ; pour une approche plus nuancée voir Hellmann 2010, p. 128-138, ainsi que la contribution de M.-Chr. Hellmann dans le présent volume.
2 Coulton, Morgan 1997, p. 99-103 ; Vidale 2002, p. 47, parle de quartieri funzionalmente omogenei.3 Treister 1996, p. 194-195 ; toutefois, il n’accepte pas l’existence de « zones » ou de « quartiers » dans les villes, mais il
reconnnaît l’existence de « zones » de production extra-muros. 4 Martin 1974, p. 46 et n. 2 : s’il souligne judicieusement que ce sont les spécialistes des villes d’Italie antique, tels que
A. Boëthius et J. B. Ward-Perkins, qui ont introduit ce concept afin de les différencier des villes grecques ou de l’Orient hellénisé (cf. Boëthius 1948, p. 15-17 et 1948b, p. 397-398), il l’adopte néanmoins.
5 Boëthius 1948, p. 15 ; Martin 1974, p. 46-47. 6 P. Chardon-Picault (éd.), Aspects de l’artisanat en milieu urbain. Gaule et Occident romain : actes du colloque international
d’Autun (20-22 septembre 2007), Revue archéologique de l’Est, Supplément 28, Dijon, 2010 ; S. Fontaine, S. Satre, A. Tekki (éd.), La ville au quotidien. Regards croisés sur l’habitat et l’artisanat antiques : Afrique du Nord, Gaule et Italie, Actes du colloque international, MMSH, Aix-en-Provence (23-24 novembre 2007), Aix-en-Provence, 2011.
7 À propos des quartiers d’artisans liés ou rattachés aux complexes palatiaux, voir J.-Cl. Poursat et al., Artisans Minoens : les maisons ateliers du Quartier Mu, Études Crétoises XXXII, Athènes-Paris, 1996. Pour le monde mycénien, cf. la réflexion de J. Zurbach sur les « communautés spécialisées » dans sa propre contribution.
8 Notamment entre 1100 et 1400 : J. Heers, La ville au Moyen-Âge, Paris, 1990, p. 373-383. Pour une synthèse générale plus récente : É. Hubert, « La construction de la ville. Sur l’urbanisation de l’Italie médiévale », Annales HSS 59 (2004), p. 109-139, en particulier, p. 135-139. Sur les aspects juridiques : M. Asheri, O. Redon, « Formes du droit dans l’Italie communale : les statuts », Médiévales 39 (2000), p. 137-152.
9 Boëthius 1948, p. 16 et 1948b, p. 398-399 ; Martin 1974, p. 46. 10 Cf. ci-dessus, n. 4. Les historiens de l’urbanisme ne sont pas unanimes à propos des « quartiers » et des « zones » grecs :
certains y voient même l’origine de la chose (cf. A. Kriesis, Greek Town Building, Athènes, 1965, p. 95), mais le plus souvent ils dissocient la Grèce ancienne de ce type de fonctionnement : C. Rosier, L’urbanisme ou la science de l’agglomération, Paris, 1953, p. 253 : « il n’y a aucune différenciation dans les quartiers », ou L. Benevolo, Histoire de la ville, Marseille, 1983, p. 44 : « la ville est un tout unique où n’existent pas de zones fermées et indépendantes ».
La question des regroupements des activités économiques et le concept de « quartier d’artisans » 13
Il faut donc se demander dans quelle mesure ces analogies sont opératoires, notamment dans le cas de la ville grecque, ne serait-ce que parce qu’on lui attribue volontiers un « quartier de potiers » sur le modèle d’Athènes. Peut-on discerner une répartition des fonctions par quartier ? Qu’en est-il des activités économiques en général ? Les productions artisanales sont-elles toujours groupées ? Et lorsqu’elles le sont effectivement, est-ce le fait d’une planification centrale ? Quels types de facteurs interviennent alors ? Sont-ils les mêmes dans tous les cas ? Enfin, les autres activités économiques contribuent-elles à l’organisation des villes antiques par quartiers ?
Avant de proposer des réponses « définitives » ou des lectures « globales », il serait utile de procéder, par étapes, à des études par site ou par domaines d’activités. Parallèlement, il serait intéressant de définir la notion même de quartier.
R. Ginouvès en propose la définition suivante : « ensemble de blocs de constructions individualisé par une fonction ou par une qualité spéciale de l’habitation, à moins qu’il s’agisse d’une division de fondement juridique »11. Deux concepts sont ainsi mobilisés pour définir le quartier : l’individualité d’une portion de l’espace urbain, et le(s) motif(s) de cette individualité : fondement juridique et/ou fonction et/ou qualité de l’habitat. Progressivement constituée par l’habitude ou pour la commodité des usagers, ou bien définie d’avance par un statut juridique ou dans un plan d’urbanisme, la différenciation fonctionnelle des blocs de constructions retient ici notre attention. Est-elle une constante des agglomérations antiques ou intervient-elle de manière exceptionnelle ? D’autres dictionnaires, qui relèvent plutôt de l’urbanisme moderne, insistent sur le fait que certains quartiers sont nettement délimités par un périmètre bien distinct ou définis par une discontinuité spatiale plus ou moins artificielle voire planifiée12. À cet égard, il est révélateur que R. Ginouvès ne consacre pas de lemme au terme « zone » en matière d’urbanisme gréco-romain. Il reste légitime de s’interroger sur l’origine et la nature des groupes ou des concentrations de fonctions dans les villes antiques.
C’est pourquoi on sollicite aussi, du point de vue philosophique ou juridique, le passage des Lois où Platon préconise la mise en place de secteurs spécifiques dans la cité (meros, -è) afin de réunir les artisans et les travailleurs manuels à la périphérie de l’habitat, aussi bien dans la ville que dans les villages de la chôra (848c-849a). Mais le lien entre ce texte programmatique et la réalité concrète des cités grecques reste une question très difficile que l’analyse philosophique et juridique seule ne suffit pas à élucider13.
Lorsque les textes signalent dans une ville – Athènes surtout – l’exercice d’une activité artisanale à tel ou tel endroit, celui-ci est souvent identifié comme « quartier artisanal » ou secteur « spécialisé ». Est-ce justifié ? Ainsi plusieurs textes mentionnent le travail du marbre à Athènes : chez Platon (Banquet 215b) il est question d’hermoglyphoi sans localisation précise de leur activité ; mais Plutarque (Œuvres morales 43, Le démon de Socrate 10, 580d) signale des hermoglyphoi près des tribunaux, et Lucien des andriantopoioi près de la Stoa Poikilè. Si l’on entend par « tribunaux » la cour péristyle et ses prédécesseurs mis au jour sous la Stoa d’Attale, les deux sites d’activité de ces marbriers peuvent être situés sur la bordure nord de l’Agora et concorder assez bien avec des découvertes archéologiques effectuées dans le
11 Dictionnaire méthodique d’architecture grecque et romaine, vol. III (1998), p. 175. Le terme grec ancien plus ou moins équivalent serait amphodon (a[mfodon), présent, entre autres, dans le règlement des astynomes de Pergame, qui renvoie plutôt à des blocs de constructions, intra-muros, délimités par une ou plusieurs rues ; c’est également le sens établi par Pollux (IX 36, 1), qui reproduit un passage d’Aristophane et un autre d’Hypéride. Indépendamment de la signification pratique de ce terme et de celle d’autres vocables, la notion de quartier apparaît étroitement liée à celle de « fonction » plus ou moins spécialisée. Voir les contributions de M.-Chr. Hellmann et de C. Saliou et aussi les travaux de J. Du Bouchet, cités par M.-Chr. Hellmann à côté d’autres références bibliographiques intéressantes.
12 En géographie humaine, les notions de « quartier » et de « zone » sont employées de manière large et souple, cf. R. Brunet et al., Les mots de la géographie, Montpellier-Paris, 1992, p. 411 et 517 ; en urbanisme, ces notions sont à la fois plus strictes et souvent connotées, cf. P. Merlin, F. Choay (dir.), Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, Paris, 1988 : « quartier », p. 743-746 et « zonage », p. 952 ; Ph. Châteaureynaud, Urbanisme, 750 mots, actes et procédures2, Paris, 1999, « zonage » : p. 701.
13 Voir à ce propos Piérart 1974 [2008], p. 41-47 ; Bertrand 1992, p. 54-56 ; Vidal-Naquet 1979, p. 295-303.
14 Arianna Esposito, Giorgos M. Sanidas
Commercial Building II14, au nord de la Stoa Poikilè, et dans les Classical Buildings15 au nord de l’Agora. Par ailleurs, un certain nombre de traces de travail du marbre16 avaient été déjà mises au jour au sud-ouest de l’Agora, dans la « Maison de Mikion et Menon » et à proximité, un peu plus au sud, dans le fameux Industrial District17 : ces vestiges bordent une voie identifiée par conséquent comme la « rue des marbriers »18. En outre, la fouille de W. Dörpfeld dans le secteur de l’Aréopage, au sud de l’Agora, avait également livré des indices de sculpture, notamment des statuettes inachevées19. Récemment, au sud du théâtre de Dionysos, des fouilles ont exploré un important atelier de production de petite sculpture néoattique et d’objets utilitaires en marbre, occupé à la fin de l’hellénisme et au début de l’époque impériale20. Ajoutons qu’un horos de prasis epi lysei (IG II2 2752) retrouvé près du Dipylon signale, dans cette région, un lithourgeion situé extra-muros. Ainsi, le travail du marbre à Athènes, tant au temps de Platon qu’à l’époque de Plutarque et de Lucien, est localisé aussi bien aux abords de l’Agora que dans l’habitat et n’est pas groupé dans un seul « quartier » ou une seule « rue spécialisée ». Par ailleurs, les densités peuvent varier et les implantations peuvent changer au cours du temps. Les observations sont analogues à propos des forgerons ou des coroplathes ; ceux-ci sont établis souvent à proximité des marbriers. Une confrontation systématique des sources textuelles et des vestiges matériels montre que le fonctionnement de la production par quartiers ou par rues spécialisés n’est absolument pas évident et incite à accueillir avec prudence certaines idées reçues.
2. Les données archéologiques et leur interprétation
À Athènes, les fouilles du Céramique conduites par l’Institut allemand dans les années 1930 et 1940, puis à partir des années 1970 par le Service archéologique grec dans le cadre de travaux d’urgence, ont mis au jour de nombreux vestiges de fabrication céramique aux abords nord-ouest de la ville, depuis le Dipylon jusqu’à l’Académie et à Hippios Kolonos (Colone)21. Ces vestiges se situent en grande partie dans le dème de Kerameikos. D’après Thucydide (II 34), il s’agit à l’origine d’un proasteion, un faubourg surtout occupé par des nécropoles, que la construction de la muraille de Thémistocle divisera en deux parties, intérieure et extérieure (I 93 ; VI 57). S’agit-il de ce « quartier culturellement homogène » qu’on imagine réunir, sinon la totalité, du moins la plus grande partie de la production céramique athénienne ? Est-ce le seul secteur de production céramique ? Et cette fréquence spatiale des implantations suffit-elle à désigner, à définir un « quartier spécialisé » ?
En effet, l’origine et l’interprétation du toponyme, ses liens concrets avec la production céramique ainsi que la surface réelle que celle-ci occupe posent problème. Aucun texte classique ne mentionne une étymologie mettant en avant la fabrication céramique : la seule version étymologique disponible associe plutôt le toponyme à un héros fondateur, Kerameus (Pausanias I 3, 1). Néanmoins, l’idée qu’il s’agirait du quartier des céramistes athéniens s’est imposée. Associée à l’importante production de céramique attique peinte, cette idée a même prospéré dans l’imaginaire : le Céramique serait le quartier où tous les potiers et peintres identifiés auraient vécu et travaillé. Or, la question du Céramique ne se réduit pas au simple rapport entre un toponyme et des vestiges matériels, ni à Athènes, ni ailleurs.
Ainsi à Corinthe : dans les années 1930, alors que l’idée d’un quartier de potiers installé à Kérameikos commence à prendre consistance et une ampleur particulière, ce « quartier » paraissait même idéalement susceptible d’occuper une surface supérieure à celle d’une nécropole et d’un dème. Avant même que les fouilles n’en apportent la preuve, le concept de quartier de céramistes, potiers et peintres sur vases,
14 T. L. Shear, Hesperia 53 (1984), p. 45. 15 T. L. Shear, Hesperia 42 (1973), p. 140. 16 Voir aussi Nolte 2006 ; Lewton 2006 ; Rottrof 2009. 17 T. L. Shear, Hesperia 38 (1969), p. 382 ; Lawton 2006, p. 17-19 ; Nolte 2006, p. 264-272.18 Young 1951, p. 178-181, 217-228 ; 271 ; 229 ; 234-236 ; 238-240. 19 C. Watzinger, AM 26 (1901), p. 305-308. 20 ADelt 54, 1999 [2005], B1, p. 48 ; Eleutheratou 2006, p. 29 et 30-33, n° 29-41 et 43 et Eleutheratou 2008. 21 Baziotopoulou 1994, Monaco 1999 et 2000 ; Papadopoulos 2003, en particulier, p. 271-316.
La question des regroupements des activités économiques et le concept de « quartier d’artisans » 15
semble connaître déjà une justification archéologique spectaculaire à Corinthe, lors de la fouille du secteur occidental du rempart. Il est aussitôt nommé « quartier des potiers » (Potters’ Quarter)22 par analogie avec le Céramique d’Athènes, que l’on ne connaissait alors que par les textes. Or, ce secteur d’habitat archaïque de Corinthe, partiellement fouillé, est moins densément occupé à l’époque classique et sera abandonné avant la fin du ive siècle. Un peu plus à l’est, à Anaploga23, l’exploration d’un puits-dépotoir, dans un secteur malheureusement moins aisément accessible aux archéologues, laisse restituer dans la partie occidentale de Corinthe plutôt qu’un « quartier », une région relativement vaste où la présence des potiers est naturellement plus fréquente puisqu’ils exploitent des gisements d’argile abondants et propices à la production de la céramique fine. Enfin, une dizaine d’années plus tard, une fouille conduite à Kokkinovrysi, juste à l’extérieur du rempart nord, en direction de Léchaion, met au jour un site longtemps occupé par des céramistes, où les découvertes de terres cuites architecturales sont nombreuses. Les archéologues ne résistent pas à la tentation d’y voir un deuxième « Céramique » corinthien : ainsi, Corinthe, elle aussi grande productrice et exportatrice de céramique peinte, semblait-elle avoir, à l’instar d’Athènes, son propre « quartier de potiers » ; et dans la mesure où elle était aussi réputée pour sa production de tuiles, il ne paraissait pas étonnant que celle-ci ait été pratiquée dans un autre quartier dit désormais Tile Works, même si la production issue de ce quartier était en réalité très variée24. Dans ce deuxième cas, l’exploitation d’un riche filon d’argile et la proximité d’un axe majeur qui relie la ville au port attirent une activité importante, d’une longévité étonnante : s’il est parfaitement logique d’y voir un gros atelier périurbain, rien, toutefois, ne semble indiquer un « quartier spécialisé » dans la production céramique.
Le cas intéressant de Figaretto à Corfou mérite d’être placé au cœur de la réflexion actuelle sur ces quartiers. Ici, la concentration d’une douzaine de fours et d’autres installations, accompagnées de riches dépotoirs révélant une production très variée, connaît une véritable continuité dans le temps25. Ce vaste établissement artisanal se situe dans l’enceinte, près du site présumé de l’agora : dans ce cas, l’exploitation d’un filon d’argile est bien le critère primordial d’installation, plutôt qu’une règle urbanistique supposée. Par ailleurs, un certain nombre de sites, moins bien conservés et moins connus pour l’instant, situés dans la ville antique ou à ses abords, ont également livré des vestiges de production céramique26. Par conséquent, malgré l’existence d’une concentration importante et diachronique de fours au cœur de l’habitat, il est difficile de parler, dans ce cas aussi, de « quartier spécialisé » : le voisinage artisanat-habitat et la dispersion des vestiges imposent une approche plus globale.
Le modèle du « quartier des potiers » du type Kerameikos a été par la suite « exporté » pour désigner et interpréter des concentrations de production céramique en Grande-Grèce et en Sicile. Il a été également employé pour de vastes structures artisanales. Toutefois, dans la plupart des cas, nous manquons de données suffisantes pour envisager le fonctionnement de la production céramique par quartiers. Ainsi, l’existence d’un « Kerameikos » à Métaponte27 a-t-elle été évoquée dès la découverte de vestiges, entre 1973 et 1977, près du côté nord des fortifications urbaines, en relation avec la plateia occidentale menant à la porte nord de la cité. La stratigraphie a permis aux archéologues de supposer que le « quartier » se situait dans un secteur laissé libre d’habitations dès le premier aménagement urbain de la cité. La présence d’ateliers y est documentée sans solution de continuité entre le vie et le iiie siècle. Peut-on dès lors affirmer que ce secteur était destiné dès sa création à accueillir des ateliers ? La réponse donnée
22 Comme Agnes Newhall l’affirmait dans son premier rapport en 1931 : cf. AJA 35, 1931, p. 1-30. Sur la relation entre vestiges architecturaux et production céramique, voir Ch. K. Williams II, ASAAtene (1984), p. 17-18.
23 D. A. Amyx, P. Lawrence, Archaic Corinthian Pottery and the Anaploga Well, Corinth VII, 2, Princeton, 1975. 24 Merker 2006 ; recensions par M.-Fr. Billot, Bull. Archi. 2008, n° 110, RA (2008), p. 320-321; G. Hübner, Gnomon 80, 2008,
p. 714-722 ; Ead., « Überlegungen zu den ‘GreekTile Works’ in Korinth », Thetis 16/17 (2010), p. 17-28. 25 Preka-Alexandri 2010, p. 40 (qui parle explicitement de Kerameikos). 26 Ibid., p. 40-41, 52, 58, etc. 27 D’Andria 1975 ; voir aussi Osanna 1996 et Cracolici 2004. On signale la publication imminente du travail de
Fr. Silvestrelli, Il kerameikos di Metaponto. Impianti artigianali e modi di produzione dall’età arcaica all’ellenismo, diss. Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan, 2000, à paraître (non uidi).
16 Arianna Esposito, Giorgos M. Sanidas
est généralement affirmative. Or, pour le vie siècle on n’a retrouvé qu’un seul atelier, situé au centre de la zone fouillée. Pour le ve siècle, les témoignages ne sont guère plus imposants qu’une décharge attestant de la continuité de l’activité artisanale dans le secteur. Entre la fin du ve siècle et le début du ive siècle – moment qui correspond à l’essor de la céramique lucanienne – le « quartier » connaît une phase d’activité nettement plus intense : on assiste alors à un accroissement assez régulier du nombre d’ateliers tout au long de la plateia occidentale et contre les murs. Toutefois, on constate à cette période un développement général du périmètre urbain, notamment dans le secteur septentrional. Par ailleurs, les dimensions assez réduites de la zone fouillée ne permettent pas d’appréhender l’extension et les limites du « quartier » et ne livrent qu’une image partielle de l’occupation artisanale. Les fouilleurs eux-mêmes n’ont pas exclu l’existence de nombreux ateliers dans une partie plus centrale de ce secteur, mais, faute de fouilles plus étendues, la question demeure ouverte.
Le terme de « Céramique » désigne aussi, dans le secteur sud-est de Poséidonia, des structures actives entre la fin du ive siècle et le début du siècle suivant28 ; à Laos29, à Crotone30 et surtout à Locres31, dans le célèbre « quartier de Centocamere », à l’intérieur de la fortification, mais en position périphérique desservie par trois importants passages à travers l’enceinte, la poterne, le propylée monumental et la porte d’« Aphrodite » par où débouche un axe Est-Ouest identifié comme une plateia. Cette position par rapport à la voirie antique était propice à l’approvisionnement en argile et combustible et à l’écoulement des produits manufacturés vers l’intérieur de la ville et les marchés extérieurs. La documentation est assez fournie pour l’époque hellénistique32, mais les vestiges archaïques sont assez rares et plutôt dispersés, de sorte qu’il serait imprudent de parler d’un « quartier céramique » dès cette époque.
À Sybaris33, la topographie urbaine demeure assez méconue, en raison des contraintes géologiques, mais les fouilles récentes dans le quartier de Stombi ont permis de dégager au moins deux édifices avec fours à côté de maisons datées entre la fin du viie et pendant le vie siècle av. J.-C.
À Caulonia34, un complexe artisanal a été identifié dans le secteur extra moenia de Contrada Lupa. Il est en activité à l’époque archaïque.
À Héraclée de Lucanie35, les structures, hellénistiques, sont englobées dans le tissu urbain, aussi bien sur la Colline del Castello que dans la « ville basse » (habitation-atelier).
Quant à Naxos, si les synthèses publiées par P. Pelagatti et M. C. Lentini36 offrent un solide point de départ, l’état de la documentation ne permet pas une analyse détaillée de toutes les structures connues. Néanmoins, on peut dresser un tableau diachronique des quelque trente ateliers céramiques, du premier archaïsme jusqu’à l’époque byzantine. Leur localisation périurbaine, tout au long de la limite septentrionale de l’asty s’explique par la nature géologique de la région et l’implantation des nécropoles classiques et hellénistiques. Des fours de potiers subsistent dans cette région à l’époque romaine, durant laquelle d’autres ateliers se concentrent aussi dans le secteur de la mansio romana. Enfin, près du Castello, dans la péninsule de Schisò, on a retrouvé dans l’îlot 9, donc près du port, une quantité assez importante de rebuts de cuisson d’amphores du type MGSIII Van der Meersch.
28 Greco 1990, p. 26. 29 Cf. Munzi 2009. 30 Verbicaro 2010. 31 Barra Bagnasco 1999. 32 L’acmè de la production se situe dans le courant du ive siècle av. J.-C. : Barra Bagnasco 1996, p. 27-34. 33 Greco 2003, p. 371. 34 Iannelli 2001, p. 323-328 ; Gagliardi 2007. 35 Giardino 1996, p. 35-43. 36 P. Pelagatti, dans G. Nenci, G. Vallet (dir.), Bibliografia topografica delle colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche,
vol. XII, Pise-Naples (1993) et M. C. Lentini, Naxos ellenistica romana e bizantina, Bari, 2000 ; aussi Pelagatti 1968-1969, p. 349-353 ; Pelagatti 1972, p. 211-220 ; Pelagatti 1972-1973, p. 180-182.
La question des regroupements des activités économiques et le concept de « quartier d’artisans » 17
On constate donc à Naxos une continuité fonctionnelle que l’on peut mettre aussi en relation avec la localisation du port, de l’agora et des anciennes routes vers Taormine et Messine, celle-ci en liaison avec le stenopos 6. En témoignent, entre autres, la mansio romana située à l’angle Sud-Ouest de la baie de Naxos et les structures d’époque impériales, thermes et magasin de dolia ; les horrea du port (ier siècle av. J.-C. - iie siècle ap. J.-C.) se situent eux-mêmes sur la route littorale pour Messine.
Les cas de Morgantina37 ou de Camarina38, sont bien différents : l’implantation des ateliers y varie avec le développement de la ville et le changement de fonction des espaces urbains. Celui de Crotone, désormais bien étudié, avec ses ateliers implantés entre îlots réservés à la fois à des ateliers et à des habitations privées, permet de souligner les différences avec Métaponte et Naxos et les analogies avec Sybaris, Mégara Hyblaea, ainsi qu’avec Locres et Héraclée de Lucanie pour des époques ultérieures.
À côté des « quartiers de potiers » que nous venons d’examiner, il est des secteurs dits « quartiers d’artisans »39 qui réunissent une certaine densité d’activités artisanales souvent très diverses. À Athènes, à la fin des années 1940 les fouilles préalables à la construction du Musée de l’Agora ont mis au jour un secteur d’édifices privés d’aspects très variés, souvent atypiques, qui fut qualifié d’Industrial District40. Celle que dirigea W. Dörpfeld a révélé la présence de coroplathes, de marbriers et de pressoirs au moins à partir du ive siècle, sinon avant. Au sud de l’Acropole41, les fouilles récentes du terrain destiné au Musée de l’Acropole et celles de la station de métro ont mis au jour un habitat à forte densité d’activités artisanales très variées, là aussi à partir du ive siècle. Et l’ensemble de la documentation archéologique disponible, succincte ou développée, donne d’Athènes une image urbaine où l’artisanat est partout représenté, aussi bien intra-muros qu’à la périphérie de la ville antique. Il est donc légitime de s’interroger sur l’existence de véritables « quartiers artisanaux » à Athènes et sur leur nombre éventuel. L’image globale de l’espace athénien, caractérisée par « la complexité, l’enchevêtrement des habitations, des boutiques, des ateliers, tout à l’image du plan de la ville »42 semble faire hésiter même les savants les plus convaincus de l’organisation des villes en quartiers et en « zones », R. Martin le premier.
Ailleurs dans le bassin égéen, les restes d’ateliers et autres vestiges d’activités de production sont encore plus dispersés. Pour l’époque archaïque, hormis Athènes, peu de sites urbains sont connus de manière satisfaisante. À Kalabaktépé, secteur de Milet fouillé de façon systématique, l’habitat inclut un artisanat varié (céramique, métallurgie, tabletterie) ; et d’autres secteurs de la ville ont connu des activités artisanales43. Pour l’époque classique, peu de sites fournissent des données avérées sur une éventuelle concentration des activités. À Olynthe, largement fouillée et encore récemment étudiée, les activités de production n’ont pas été réparties, contrairement à ce que pensait Boëthius, suivant une logique de planification urbaine44. Pour l’époque hellénistique, les exemples de villes comme Argos ou Délos45 indiquent, de même qu’Athènes, une répartition relativement libre des activités artisanales au sein de l’habitat, avec de plus grandes densités, selon le cas, à proximité des grands marqueurs urbains (agoras, sanctuaires, axes majeurs, etc.).
3. Quelle approche ?
Dans quelle mesure le concept de « quartier » et, par extension, de « quartier spécialisé », notion certainement problématique pour l’Antiquité grecque à plusieurs égards et notamment en termes de
37 Allen 1974, p. 361-382 ; Bell 1988, p. 319 ; Cuomo di Caprio 1992. 38 Di Stefano 2008. 39 Hoepfner et al. 1999, p. 235-237.40 Young 1951.41 Eleutheratou 2006 et 2008.42 Martin 1974, p. 225.43 Lang 1996, p. 198-217. 44 Cahill 2002, p. 264-265. 45 Brunet 1998.
18 Arianna Esposito, Giorgos M. Sanidas
fonctionnements urbains et économiques46, peut-il expliquer les implantations des activités artisanales ? Au risque de bousculer un usage bien commode, il est désormais indispensable d’examiner très soigneusement leur répartition spatiale au cas par cas, site par site, avant d’oser tenter une conclusion générale du genre « les artisans étaient groupés en quartiers ».
Or les archéologues recourent assez spontanément à ce concept pour rendre compte de certaines concentrations d’activités de production dans les centres urbains ou à leurs abords. Et bien que ces concentrations soient loin d’être majoritaires, les travaux sur l’urbanisme et la topographie des villes reprennent quasi traditionnellement le thème du « quartier artisanal », voire du « quartier spécialisé » comme s’il s’agissait d’une pratique commune47, impliquant la volonté de séparer les activités de production de l’habitat48. Or artisanat et habitat sont très souvent liés, dans des proportions variables. Le concept est donc rarement, voire jamais pertinent.
La notion de « zone », qu'on utilise parfois, à la façon des géographes, en la supposant plus neutre49, comme terme alternatif à celui de « quartier », peut s’avérer plus lourde encore de conséquences dans la conceptualisation de l’organisation urbaine. Le zonage, pratique urbanistique moderne appliquée aux États-Unis dès la fin du xixe siècle, prévoit des implantations spécifiques pour les activités industrielles ; les nuisances tendent à exclure l’industrie du centre-ville et des secteurs résidentiels. On pourrait éventuellement reconnaître une pratique analogue dans les « statuts » (statuti) des villes médiévales d’Italie. L’apparition de « statuts » urbains répartissant et localisant les activités de production dans des zones bien définies sont donc le produit de contextes historiques précis. Or, la cité et la ville classiques ne semblent pas répondre à ce genre de modèles. Dès que l’on s’éloigne des domaines publics et religieux qui sont souvent délimités, qu’ils se trouvent au sein de l’habitat ou dans des secteurs libres de construction (ta erema tes poleôs), les activités artisanales sont de facto omniprésentes. Du reste, les secteurs civiques et religieux sont souvent, eux aussi, gagnés de manière plus ou moins temporaire par les installations artisanales car les institutions civiques et religieuses sont de grands employeurs ou clients d’artisans. Dès lors, il est à craindre que le recours aux termes de « zone » et de « zonage » n’implique ou n’impose un réel anachronisme de la démarche archéologique.
Ces questions et réflexions ont été au cœur des communications et des discussions de la rencontre lilloise. Entre les idées héritées du passé et les données ou approches plus récentes, l’archéologie apporte une grande partie des éléments qui renouvellent notre vision de l’espace occupé par les activités économiques dans le monde grec. Elle est indispensable à une juste appréhension des contextes concrets de production et d’échange, donc de l’économie ancienne. Il est tout aussi clair que les études les plus fécondes sont celles qui peuvent utiliser conjointement les sources matérielles et textuelles : l’opposition artificielle entre textes et données matérielles apparaît plus que jamais stérile. L’organisation spatiale des villes grecques implique des croyances religieuses (les sanctuaires), des pratiques sociales (les nécropoles par exemple), des institutions politiques, des dispositions juridiques et des fonctionnements économiques dont la compréhension exige une approche pluridisciplinaire.
Par ailleurs, même si le monde grec – pour lequel la notion de « quartier » a été largement employée et doit être reconsidérée – constituait le point de départ et le domaine privilégié des réflexions de ces deux journées, plusieurs exemples issus d’autres contextes méditerranéens ou datés de l’époque impériale ont permis de discerner d’autres critères possibles d’analyse et d’ouvrir d’autres perspectives de réflexion.
46 Voir les contributions de M.-Chr. Hellmann et C. Saliou. 47 Burford 1972, p. 82. 48 Production and trade in the hellenistic towns were separated from the residential parts : Boëthius 1948, p. 15. Cette idée a connu
une grande postérité. 49 Étienne 2004, p. 140.
La question des regroupements des activités économiques et le concept de « quartier d’artisans » 19
Bibliographie
Allen 1974 H. L. Allen, « Excavations at Morgantina (Serra Orlando) 1970-1972, Preliminary Report XI », AJA 78 (1974), p. 361–382.
Barra Bagnasco 1996 M. Barra Bagnasco, « Il ceramico di Locri: struttura e tecnologie », dans E. Lippolis (éd.), I Greci in Occidente, arte e artigianato in Magna Grecia, Naples, 1996, p. 27-34.
Barra Bagnasco 1999 M. Barra Bagnasco, « Strutture esterne alle mura di Locri Epizefiri e il problema del porto », dans M. Barra Bagnasco, M. C. Conti (éd.), Studi di Archeologia Classica dedicati a Giorgio Gullini per i quarant’anni di insegnamento, Alexandrie (Italie), 1999, p. 1-18.
Baziotopoulou 1994 E. Baziotopoulou-Valavani, « Anaskafev" se aqhnai>kav keramikav ergasthvria arcai>kwvn kai klasikwvn crovnwn », dans W. D.E. Coulson, O. Palagia, T. L. Shear, H. A. Shapiro, F. J. Frost (éd.), The Archaeology of Athens and Attica under the Democracy, Proceedings of an International Conference, Athens 1992, Oxford, 1994, p. 45-54.
Bell 1988 M. Bell, « Excavations at Morgantina 1980-1985. Preliminary Report XII. », AJA 92 (1988), p. 313-342.
Bertrand 1992 J.-M. Bertrand, Cités et royaumes du monde grec : espace et politique, Paris, 1992.
Boëthius 1948 A. Boëthius, « Roman and Greek Town Architecture », Göteborgs Högskolas Årrkrift - Acta Universitatis Gotoburgensis 54 (1948/3), p. 1-22.
Boëthius 1948b A. Boëthius, « Ancient town architecture and the new material from Olynthus », AJPh 69 (1948), p. 396-407.
Brunet 1998 M. Brunet, « L’artisanat dans la Délos hellénistique : essai de bilan archéologique », dans F. Blondé, A. Muller (éd.), L’artisanat en Grèce ancienne : les artisans, les ateliers, Actes du colloque, Lille 1997, Topoi 8, fasc. 2 (1998), p. 681-691.
Burford 1972 A. Burford, Craftsmen in Greek and Roman Society, Londres, 1972.
Cahill 2002 N. Cahill, Household and City Organization at Olynthus, New Haven – Londres, 2002.
Cracolici 2004 V. Cracolici, I sostegni di fornace dal kerameikos di Metaponto, Bari, 2004.
Cuomo di Caprio 1992 N. Cuomo di Caprio, « Les ateliers de potiers en Grande-Grèce : quelques aspects techniques », dans F. Blondé, J. Y. Perreault (éd.), Les ateliers des potiers dans le monde grec aux époques géométrique, archaïque et classique, Actes de la Table Ronde, Athènes 1987, BCH Suppl. 23 (1992), p. 69-85.
D’Andria 1975 F. D’Andria, « Metaponto. Scavi nella zona del kerameikos », dans D. Adamesteanu, D. Mertens, F. D’Andria, Metaponto I, NSA XXIX Suppl. 1975 [1980], p. 355-452.
Di Stefano 2008 G. Di Stefano, « Fornaci e aree artigianali a Camarina. Una nota topografica », appendi-ce à M. Pisani, Camarina. Le terrecotte figurate e la ceramica da una fornace di v e iv sec. A.C., Studia Archaeologica 164, Rome, 2008, p. 207-211.
Eleutheratou 2006 S. Eleutheratou, To mouseivo kai h anaskafhv. Eurhvmata apov to cwvro anevgersh" tou nevou mouseivou th" Akrovpolh", Athènes, 2006.
Eleutheratou 2008 S. Eleutheratou, « Stoiceiva poleodomikhv" kai oikistikhv" orgavnwsh" apov to novtio tmhvma th" arcaiva" Aqhvna" », dans S. Vlizos (éd.), Athens during the roman period. Recent disco-veries, New evidence, Mouseio Benaki, 4th Supplement (2008), p. 185-205.
Étienne 2004 R. Étienne Athènes : espaces urbains et histoire des origines à la fin du iiie siècle ap. J.-C., Paris, 2004.
Gagliardi 2007 V. Gagliardi, « Il kerameikos di contrada Lupa: per una revisione dei dati », dans M. C. Parra (éd), Kaulonia, Caulonia, Stilida (e oltre). Contributi storici, archeologici e topo-grafici, II, ASNP, s. 4, Quaderno, 17-18, 2004, Pise, 2007, p. 493-533.
Giardino 1996 L. Giardino, « L’argilla: Herakleia », dans E. Lippolis (éd.), I Greci in Occidente, arte et artigianato in Magna Grecia, Naples, 1996, p. 35-44.
20 Arianna Esposito, Giorgos M. Sanidas
Greco 1990 E. Greco, « Spazi pubblici e impianti urbani », dans G. Pugliese Carratelli (éd.), Magna Grecia IV. Arte e Artigianato, Milan, 1990, p. 9-48.
Greco 2003 E. Greco, « Tra Sibari, Thurii e Copiae. Qualche ipotesi di lavoro », dans G. Fiorentini, E. De Miro, M. Caccamo Caltabiano, A. Calderone (éd.), Archeologia del Mediterraneo. Studi in onore di Ernesto De Miro, Rome, 2003, p. 369-374.
Hellmann 2010 M.-Chr. Hellmann, L’architecture grecque 3. Habitat, urbanisme et fortifications, Paris, 2010.
Hoepfner et al. 1999 W. Hoepfner et al., Geschichte des Wohnens, Band 1, 5000 v. Chr. - 500 n. Chr., Vorgeschichte, Frühgeschichte, Antike, Berlin, 1999.
Iannelli 2003 M. T. Iannelli, « Nuove acquisizioni a proposito della presenza dei Brettii a Caulonia » dans M. C. Parra (éd.), Kaulonia, Caulonia, Stilida (e oltre). Contributi storici, archeologici e topografici, II, ASNP, s. 4, Quaderni, 11-12, 2001, Pise, 2003, p. 319-335.
Lang 1996 F. Lang, Archaische Siedlungen in Griechenland. Struktur und Entwicklung, Berlin, 1996.
Lentini 2000 M. C. Lentini, « Naxos », dans M. Gras., E. Greco, P. G. Guzzo (éd.), Nel cuore del mediterraneo antico, Rome, 2000, p. 115-122.
Lewton 2006 C. Lewton, Marbleworkers in the Athenian Agora, Agora Picture Book 27, Princeton, 2006.
Martin 1974 R. Martin, L’urbanisme dans la Grèce antique2, Paris, 1974.
Merker 2006 G. S. Merker, The Greek Tile Works at Corinth. The Site and the Finds, Hesperia Suppl. 35, Princeton, 2006.
Monaco 1999 M. C. Monaco, « Fornaci da ceramica e scarti di produzione di età classica e tardo- classica », AM 114 (1999), p. 105-116.
Monaco 2000 M. C. Monaco, Ergasteria: impianti artigianali ceramici ad Atene ed in Attica dal Proto- geometrico alle soglie dell’Ellenismo, Rome, 2000.
Morgan, Coulton 1997 C. Morgan, J. J. Coulton, « The Polis as a Physical Entity », dans M. H. Hansen (éd.), The Polis as an Urban Centre and as a Political Community, Symposium August, 29-31 1996, Acts of the Copenhagen Polis Centre, vol. 4, Copenhague, 1997, p. 87-144.
Munzi 2009 P. Munzi Santoriello, « Les fours de potiers et la production céramique à Laos (Calabre) », dans J.-P. Brun (éd.), Artisanats antiques d’Italie et de Gaule. Mélanges offerts à Maria Francesca Buonaiuto, Naples, 2009, p. 265-283.
Nolte 2006 S. Nolte, Steinbruch, Werkstatt, Skulptur. Untersuchungen zu Aufbau und Organisation griechischen Bildhauerwerkstätten, Göttingen, 2006.
Osanna 1996 M. Osanna, « L’argilla. Metaponto », E. Lippolis (éd.), I Greci in Occidente, arte et artigianato in Magna Grecia, Naples, 1996, p. 45-49.
Papadopoulos 2003 J. K. Papadopoulos, Ceramicus Redivivus: the Early Iron Age Potters’ Field in the Area of the Classical Athenian Agora, Hesperia Suppl. 31, Princeton, 2003.
Pelagatti 1968-1969 P. Pelagatti, « L’attività della Soprintendenza alle Antichità della Sicilia orientale tra il 1965 e il 1968 », Kokalos XIV-XV (1968-1969), p. 344-357.
Pelagatti 1972-1973 P. Pelagatti, « Naxos », Kokalos XVIII-XIX (1972-1973), p. 180-182.
Piérart 1974 [2008] M. Piérart Platon et la cité grecque. Théorie et réalité dans la constitution des Lois, Bruxelles – Paris, 1974 [2008].
Preka-Alexandri 2010 K. Preka-Alexandri, Oi arcaiovthte" th" Kevrkura", Athènes, 2010.
Rottrof 2009 S. I. Rottrof, « Commerce and Crafts around the Athenian Agora », J. McK. Camp II, C. A. Mauzy (éd.), The Athenian Agora. New Perspectives on an Ancient Site, Mayence, p. 39-46.
La question des regroupements des activités économiques et le concept de « quartier d’artisans » 21
Schwandner 1988 E. L. Schwandner, « Handwerkerviertel in Gründungsstätten des 5. und 4. Jahrhunderts », dans Praktikav tou 12ou Sunedrivou Klasikhv» Arcaiologiva», Aqhvna 1983, vol. 4, Athènes (1988), p. 183-187.
Treister 1996 M. Y. Treister, The Role of Metals in Ancient Greek History, Mnemosyne Suppl. 156, Leiden, 1996.
Verbicaro 2010 G. Verbicaro, « Aree produttive a Crotone tra vii e iii sec. A.C. », dans Lepore, P. Turi (éd.), Caulonia tra Crotone e Locri, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Firenze 30 maggio-1 giugno 2007, Florence, 2010, p. 227-241.
Vidal-Naquet 1979 P. Vidal-Naquet, « Étude d’une ambiguïté : les artisans dans la cité platonicienne », dans B. Vincent (éd.), Les marginaux et les exclus dans l’histoire, Paris, 1979, p. 232-261, repris dans P. Vidal-Naquet, Le chasseur et la cité, Paris, 1992, p. 289-316.
Vidale 2002 M. Vidale L’idea di un lavoro lieve: il lavoro artigianale nelle immagini della ceramica greca tra vi e iv secolo a.C., Padoue, 2002.
Young 1951 R. S. Young « An Industrial District of Ancient Athens », Hesperia 20 (1951), p. 135-288.
Mario DentiUniversité Rennes 2 UMR 6566 CReAAH, Laboratoire LAHM263 av. du Général LeclercCampus de Beaulieu, bâtiment 24-25, CS7420535042 Rennes Cedex [email protected]
Giovanni Di StefanoUniversità della Calabria, CosenzaFacoltà di Lettere e FilosofiaDipartimento di Archeologia e Storia delle ArtiVia P. Bucci87036 Arcavacata di Rende (SC) (Italie)[email protected]
Arianna EspositoUniversité de BourgogneARTeHIS–UMR 6298Bâtiment Droit-Lettres2 boulevard Gabriel21000 [email protected]
Jean-Sébastien GrosUniversité de StrasbourgFaculté des Sciences Historiques 9 place de l’Université67084 Strasbourg [email protected]
Marie-Christine HellmannUniversité de Paris OuestNanterre-La Défense ArScAn – UMR 704121 allée de l’Université92023 Nanterre [email protected]
Marie-Pierre JézégouDRASSM, MCC, Marseille147 plage de l’Estaque13016 Marseille [email protected]
Maria Costanza LentiniMuseo archeologico di Giardini NaxosVia Naxos, 198035 Giardini Naxos Messine (Italie)[email protected]
Dimitri MathiotConservation d’Archéologie de Moselle-BliesbruckUMR 70441, rue R. Schuman, F-57200 [email protected]
Alexandre Mazarakis AinianUniversité de ThessalieArgonautes et Filellinon38221 Volos (Grèce)[email protected]
Liste des contributeurs
408
Valeria MeiranoUniversité de TurinVia Verdi, 810124 Turin (Italie)[email protected]
Maria Chiara MonacoUniversità degli Studi della BasilicataScuola Archeologica Italiana di AteneFacolà di Lettere e FilosifiaDipartimento di Scienze Storiche Linguistiche e AntropologicheVia N. Sauro 8585100 Potenza (Italie)[email protected]@unibas.it
Nicolas MonteixUniversité de RouenGRHIS (EA 3831)UFR Lettres Sciences HumainesDépartement HistoireRue Lavoisier76821 Mont Saint [email protected]
Gaspard PagèsCentre Européen d’Archéométrie Université de Liège Département des Sciences de la VieBât B22 Génétique des microorganismesboulevard du Rectorat 274000 Liège 1 (Belgique)[email protected]
Valérie PichotCNRS, CEAlex, USR 3134Centre d’Études Alexandrines,50 rue Soliman Yousri21131 Alexandrie (Égypte)[email protected]
Marcella PisaniUniversità degli Studi di Roma Tor Vergata Scuola Archeologica Italiana di AteneVia Columbia, 100133 Rome (Italie)[email protected]
Bérangère RedonHiSoMA – UMR 5189 Maison de l’Orient et de la Méditerranée-J. PouillouxUniversité Lyon 2 CNRS7 rue Raulin69007 [email protected]
Catherine SaliouUniversité de Paris 8–Vincennes-St-DenisEA 1571/UMR 81672 rue de la Liberté93526 Saint-Denis [email protected]
Réjane RoureUniversité Paul-Valéry-Montpellier 3UMR 5140Archéologie des Sociétés MéditerranéennesDépartement Histoire de l’art et ArchéologieRoute de Mende 34199 Montpellier cedex [email protected]
Valérie SalleUniversité Toulouse II-Le MirailPatrimoine, Littérature, HistoirePavillon de la Recherche5 allées Antonio-Machado31058 Toulouse cedex [email protected]
Corinne SanchezUMR 5140, Lattes/MontpellierCDAR390 avenue de Pérols34970 [email protected]
Giorgos M. SanidasUniversité Charles-de-Gaulle–Lille 3Halma-Ipel–UMR 8164Pont de Bois, BP 6014959653 Villeneuve d’Ascq [email protected]
Vladimir StissiUniversity of AmsterdamSpuistraat 2101012 VT Amsterdam (Pays-Bas)[email protected]
Julien ZurbachEns ParisDépartement d’Histoire45 rue d’Ulm75005 [email protected]
Avant-propos
1. APPROCHES D’ENSEMBLE
Arianna Esposito, Giorgos M. Sanidas ............................................................................................................... 11La question de la concentration des activités économiques et le concept de « quartier d’artisans » :quelle approche ?
Marie-Christine Hellmann.................................................................................................................................... 23Quartiers ou rues ? La notion de quartier économique spécialisé dans le monde grec : comparaison des données textuelles et archéologiques
Catherine Saliou...................................................................................................................................................... 39Artisanats et espace urbain dans le monde romain : droit et projets urbains (ier s. av. J.-C.–vie siècles ap. J.-C.)
2. ÉGYPTE GRÉCO-ROMAINE
Bérangère Redon .................................................................................................................................................... 57L’insertion spatiale et économique des établissements balnéaires en Égypte aux époques hellénistique et romaine
Valérie Pichot ......................................................................................................................................................... 81La Maréotide : région fertile de la chôra d’Alexandrie, carrefour du commerce à l’époque gréco-romaine
3. GRÈCE ÉGEENNE
Jean-Sébastien Gros, Julien Zurbach .................................................................................................................. 107Espaces de la production céramique et spécialisation artisanale entre Bronze et Fer en Égée
Alexandre Mazarakis Ainian ............................................................................................................................. 125Des quartiers spécialisés d’artisans à l’époque géométrique ?
Table des matières
410
Maria Chiara Monaco ........................................................................................................................................... 155Dix ans après : nouvelles données et considérations à propos du Céramique d’Athènes
Caroline Huguenot ............................................................................................................................................... 175Production et commerce dans la cité hellénistique d’Érétrie
Vladimir Stissi ......................................................................................................................................................... 201Giving the kerameikos a context: ancient Greek potters’ quarters as part of the polis space, economy and society
4. GRANDE-GRÈCE, SICILE, ITALIE
Mario Denti ............................................................................................................................................................ 233Potiers œnôtres et grecs dans un espace artisanal du viie siècle av. J.-C. à l’Incoronata
Valéria Meirano ...................................................................................................................................................... 257Productions et espaces artisanaux à Locres Épizéphyrienne
Maria Costanza Lentini ......................................................................................................................................... 281Fours et quartiers de potiers à Naxos de Sicile (viie-ve siècles av. J.-C.)
Giovanni Di Stefano ............................................................................................................................................. 301Camarina (Sicilia). Le aree artigianali e produttive di età classica. Un esempio di organizzazione dello spazio produttivo della Grecia d’Occidente
Marcella Pisani ....................................................................................................................................................... 311Impianti di produzione ceramica e coroplastica in Sicilia dal periodo arcaico a quello ellenistico: distribuzione spaziale e risvolti socio-economici
Nicolas Monteix ..................................................................................................................................................... 333« Caius Lucretius […], marchand de couleurs de la rue du fabricant de courroies ».Réflexions critiques sur les concentrations de métiers à Rome
5. GAULE
Réjane Roure, Gaspard Pages, Valérie Salle ..................................................................................................... 355Forgerons à travers les générations ? La métallurgie dans l’îlot VI d’Olbia de Provence (Hyères, Var) de 325 av. J.-C. à 20 ap. J.-C.
Marie-Pierre Jezegou, Gaspard Pages, Corinne Sanchez ................................................................................ 373Entre littoral et arrière-pays, l’organisation des activités artisanales : le cas de Narbonne antique
Dimitri Mathiot ..................................................................................................................................................... 387La structuration spatiale de l’économie à l’Âge du fer en Gaule du Nord : une organisation originale au cœur des campagnes
Liste des contributeurs .......................................................................................................................................... 407
Ouvrage composé parChristine Aubry
Ingénieur d’Études à la Valorisation de la RechercheHalma-Ipel – UMR 8164
Images traitées parGilbert Naessens
Ingénieur d’Études, Photographe en imagerie scientifiqueHalma-Ipel – UMR 8164
Achevé d’imprimer - décembre 2012Imprimerie de l’Université Charles-de-Gaulle – Lille 3
Dépôt légal - décembre 20121 361e volume édité par les
Presses Universitaires du SeptentrionVilleneuve d’Ascq - France