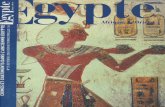Politesse et savoir-vivre en Grèce ancienne
Transcript of Politesse et savoir-vivre en Grèce ancienne
UNIVERSITÉ DE STRASBOURG UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
ÉCOLE DOCTORALE SHS-PE UMR 7044 – ARCHIMÈDE
en co-tutelle avec :
SCUOLA DI DOTTORATO in CULTURE CLASSICHE E MODERNE – XXVII ciclo
THÈSE présentée par :
Francesco MARI
soutenue le : 26 septembre 2015
pour obtenir les grades de :
Docteur de l’Université de Strasbourg Dottore di ricerca dell’Università degli Studi di Genova
Discipline : Histoire Grecque
Politesse et savoir-vivre en Grèce ancienne
THÈSE dirigée par :
Mme Dominique LENFANT Professeur, Université de Strasbourg Mme Francesca GAZZANO Professeur, Università degli Studi di Genova
RAPPORTEURS : M. Vincent AZOULAY Professeur, Université Paris-Est – Marne-la-Vallée M. Stefano FERRUCCI Professeur, Università degli Studi di Siena
AUTRES MEMBRES DU JURY :
Mme Lia Raffaella CRESCI Professeur, Università degli Studi di Genova M. Alain DUPLOUY Maître de conférences, Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne
Ai miei professori del Liceo
Lo sguardo fruga d’intorno, la mente indaga accorda disunisce
nel profumo che dilaga
quando il giorno più languisce.
EUGENIO MONTALE , I Limoni
SOMMAIRE
REMERCIEMENTS ........................................................................................................ 1
AVANT-PROPOS .......................................................................................................... 3
INTRODUCTION .......................................................................................................... 5
PREMIÈRE PARTIE : POLITESSE MODERNE ET ANTIQUITÉ GRECQUE ................... 15
CHAP. I : La politesse comme catégorie d’analyse ................................................ 19
I.1 Petite histoire des croyances contemporaines sur les convenances sociales ...................... 19
I.2. Le code de politesse en sociologie ...................................................................................... 24
I.3. Les fonctions de la politesse ............................................................................................... 27
I.4. L’approche sociolinguistique et ses limites ....................................................................... 29
I.5. Les pratiques de politesse ................................................................................................... 31
I.6. Sanction et apprentissage .................................................................................................. 34
I.7. L’étude historique de l’interaction sociale ......................................................................... 35
CHAP. II : Les enjeux d’une « politesse grecque » .................................................. 37
II.1. Les bonnes manières grecques en quatre mots ................................................................ 41
II.1.1. Les objets du jugement ................................................................................................ 41
II.2.2. Les critères de jugement ............................................................................................... 56
II.3. La vérité dans les apparences : esquisse d’une synthèse ................................................... 66
II.4. Code de comportement et morale : bref parcours dans les études contemporaines sur la Grèce antique .............................................................................. 69
II.5. Pour un code de comportements rituels .......................................................................... 78
II.6. Constellations de sens (antiques et modernes) ................................................................ 80
II.7. Deux couteaux au lieu d’un ............................................................................................... 87
SOMMAIRE II
CHAP. III : Modèles et méthode ................................................................................ 89
III.1. L’interaction selon Erving Goffman .............................................................................. 90
III.2. Goffman et l’histoire ....................................................................................................... 95
III.3. Fracture du temps et fragmentation de l’identité ........................................................... 95
III.4. Les situations sociales dynamiques .............................................................................. 100
III.5. Quelques repères analytiques ....................................................................................... 102
III.6. Un exemple grec ............................................................................................................ 105
III.7. Précision finale .............................................................................................................. 110
DEUXIÈME PARTIE : EN QUÊTE D ’UN MANUEL .................................................... 113
CHAP. IV : L’honneur et la parole ........................................................................... 129
IV.1. Des actes de parole de l’épopée homérique .................................................................. 136
IV.2. Apostropher l’autre : respect, mépris et colère .............................................................. 144
IV.2.1. Le tact verbal .......................................................................................................... 146
IV.2.2. Les insultes des héros ................................................................................................ 151
IV.1.3. La malséance populaire ............................................................................................ 158
IV.3. Dialogues humains et dialogues divins ......................................................................... 161
CHAP. V : Maîtres des lieux homériques ............................................................... 169
V.A. L E S C H A M B R E S .......................................................................................................... 177
V.A.1. Le rôle du maître de maison dans le thalamos ............................................................. 178
V.A.2. L’influence féminine sur l’équilibre du thalamos ........................................................ 182
V.A.3. Troubles de l’ordre symbolique : Hélène entre Pâris et Hector ................................. 184
V.B. L E S D E M E U R E S À B A S S E C O N C E N T R A T I O N H U M A I N E ............................... 192
V.B.1. Accueillir (et être accueilli) comme il se doit : Ulysse chez les Phéaciens .................. 195
V.B.2. Le mendiant et le porcher, ou la politesse des humbles ............................................. 203
V.B.3. Le roi inopportun : Priam dans la tente d’Achille ..................................................... 211
V.C. L E S G R A N D S P A L A I S D E S R O I S ........................................................................... 222
V.C.1. Chez Nestor et chez Ménélas ..................................................................................... 222
V.C.2. Le palais d’Ithaque : l’accueil de Télémaque à Athéna .............................................. 230
III
V.D. L E S M A I S O N S D E S Ê T R E S P S E U D O - D I V I N S ..................................................... 238
V.D.1. Bref retour dans la grotte de Polyphème .................................................................... 238
V.D.2. Circé, ou la duplicité d’une maîtresse de maison ...................................................... 240
CHAP. VI : Les élites homériques à l’épreuve du regard collectif ...................... 247
VI.1. Bagarre au sommet de l’Olympe ................................................................................... 249
VI.2. Rebondissement sur Thersite ....................................................................................... 255
VI.3. Antiloque, Euryale et le respect de la politesse agonistique ......................................... 266
TROISIÈME PARTIE : SAVOIR-VIVRE GREC ANTIQUE ........................................... 283
CHAP. VII : Le tyran et le baladin ............................................................................ 289
VII.1. Le soin de sa réputation ............................................................................................... 290
VII.2. Le festin de Sicyone tel qu’en parle Hérodote ............................................................. 294
VII.3. Le festin de Sicyone du point de vue de la situation sociale ....................................... 298
VII.4. Clisthène de Sicyone pris entre deux feux ................................................................... 310
VII.5. L’hybris d’Hippocleidès ............................................................................................... 318
VII.6. Ou phrontis…Alkibiadēi ............................................................................................... 323
CHAP. VIII : S’en prendre à Socrate ........................................................................ 327
VIII.1. Les formules d’adresse élogieuses : des expressions polies ? ..................................... 328
VIII.2. Les éloges de Socrate .................................................................................................. 332
VIII.3. Deux cas exceptionnels et le langage du Socrate historique ..................................... 337
VIII.4. Quel rôle pour l’« éloge ironique » chez Platon ? ....................................................... 343
VIII.5. Quelques considérations conclusives ........................................................................ 352
CHAP. IX : Histoire d’un geste : la dexiōsis ............................................................ 357
IX.1. Hē dexia cheīr. Spécificités grecques antiques d’une geste toujours actuel .................. 359
IX.2. L’accueil par la dexiōsis .................................................................................................. 361
IX.3. Exiger l’attention : le recours à la dexiōsis pour amplifier un propos ............................ 369
IX.4. La proxémique de la poignée de main .......................................................................... 374
SOMMAIRE IV
IX.5. L’exemple des stèles funéraires attiques ....................................................................... 376
IX.6. La dexiōsis dans les traités diplomatiques ...................................................................... 380
IX.7. La comparaison avec les Perses chez Xénophon : une leçon pour les Grecs ? ............. 394
IX.8. La dexiōsis comme catachrèse comportementale .......................................................... 399
CONCLUSION .......................................................................................................... 407
GLOSSAIRE .............................................................................................................. 419
L ISTE DES ABRÉVIATIONS ..................................................................................... 423
B IBLIOGRAPHIE ...................................................................................................... 427
REMERCIEMENTS
Il me semble hier que j’ai franchi les Alpes à bord d’un train en provenance de Milan, mon sac à dos comme seul compagnon de voyage, et pour la première fois j’ai mis pied à Strasbourg, avec la perspective d’y entreprendre mon doctorat de recherche. C’était le début de l’automne, et je ne connaissais personne dans la ville. Ainsi c’est un vrai bonheur, quatre ans depuis ce jour, de pouvoir adresser mes remerciements aux nombreuses personnes qui m’ont soutenu durant mon travail. Merci, d’abord, à mes directrices de recherche : Dominique Lenfant, qui a eu l’idée de ce travail, si intéressant et novateur, me l’a proposé et ne m’a jamais fait manquer ses conseils lors de sa réalisation ; et Francesca Gazzano, qui me guide sur les voies escarpées de l’université depuis maintenant sept ans.
Merci à Vincent Azoulay, Lia Raffaella Cresci, Alain Duplouy et Stafano Ferrucci, qui ont ac-cepté de faire partie de mon jury de thèse. Merci à toutes les professeures et à tous les profes-seurs qui m’ont aidé et conseillé durant ce travail : Sandra Boehringer, Nicola Cucuzza, Nico-letta Diasio, Manuela Giordano, Pascal Hintermeyer, Anne Jacquemin, Andrew Lear, Fran-çois Lefèvre, Franco Montanari, Lara Pagani, Luana Quattrocelli, Giusto Traina. Merci à Kim Ridealgh, de l’University of East Anglia, qui m’a accepté en tant que membre du Historical Po-
liteness Network for Ancient Languages. Merci à Eckhard Wirbelauer, Thomas Späth et Konrad Vössing, directeurs du Collège Doctoral Trinational FISA-MIAG des Universités de Stras-bourg, Berne et Bonn, dont je fais partie. Merci à tous les membres de l’UMR 7044 de l’Université de Strasbourg. Merci, enfin, à l’École française d’Athènes, qui m’a accueilli pen-dant deux séjours d’études en Grèce.
Ma première et plus grande dette intellectuelle va à mes enseignants du lycée. Merci à Gian-franco Di Pasquale, qui m’a transmis l’amour pour la pensée. Merci à Gilda Mana, qui m’a ap-pris à la structurer. Merci à Rosa Elisa Giangoia, qui m’a montré ce que je pouvais en faire. Merci à Fully Doragrossa, qui m’a démontré avec l’exemple, dès mon adolescence, que l’éducation est à la fois une mission et un défi qu’il vaut la peine de relever. C’est à eux que cette thèse est dédiée. Merci à mes étudiants, tous.
Merci à mes amis : Alberto, Antoine, Claire, Cloé, Francesca et Matteo, François, Katerina, Luca, Paolo, Tommaso, Vulca. Vous avez été ma bonne humeur. Merci à Giovanna, voisine de pupitre à la MISHA et meilleure des camarades. Merci aux amis qui m’ont aidé à corriger mon français : Aurian, Christine, Méryl, Nora, Thomas. Merci à Fabio, relecteur infatigable.
Merci infiniment à ma famille : à ma mère, Silvia, et à mon père, Sergio, parce qu’ils ont tou-jours cru en moi, quoi que je fasse ; à ma sœur et à mon frère, Giulia et Alberto, qui ont été, sont et seront ma force et mon équipe.
Merci enfin à tous ceux que je ne cite pas, mais que je n’oublie pas pour autant. Casa Galotta, Orbicella di Molare (AL)
6 août 2015
AVANT-PROPOS
Toutes les traductions des textes anciens que nous présentons dans ce travail de recherche
sont empruntées à la Collection des Universités de France, sauf quand il nous a semblé né-
cessaire de les modifier ou de les refaire nous-même. Dans chacun de ces cas, nous avons
indiqué le type de modification apporté dans une note en bas de page. Nous avons aussi
translittéré la plupart des mots et des périphrases grecs, sauf dans certains cas où garder la
forme originale nous a paru important ou lorsque nous reprenons, en les commentant, les
mots d’un texte que nous avons précédemment cité et dont nous avons donné la traduction.
Nous espérons ainsi que notre lecteur pourra aisément se reporter aux originaux grecs
quand il le souhaite, sans risquer de s’égarer en essayant de situer dans les textes des termes
qui n’y figurent pas.
Le lexique dont nous nous servons dans ce travail est souvent emprunté à la sociologie, par-
fois à la sociolinguistique. Nous avons nous-même introduit un petit nombre de tournures
visant à mieux cerner les objets de notre étude. Comme les antiquisants ne sont pas tou-
jours familiers avec ce genre d’expressions, nous avons pensé insérer, après les conclusions,
un glossaire des expressions « techniques » les plus récurrentes dans ce travail, que nous
avons également indiquées en gras lors de leur première apparition.
Nous précisons enfin que le raisonnement qui sous-tend ce travail a un caractère unitaire.
L’articulation des chapitres est linéaire, chacun présupposant le précédent. C’est pourquoi
nous avons pensé introduire un système de renvois internes ponctuels, en espérant rendre
la lecture aussi facile que possible.
INTRODUCTION
Peu à peu conservée par la mémoire, c’est la chaîne de toutes les impressions inexactes, où ne reste rien de ce que nous avons réellement éprouvé, qui constitue pour nous notre pensée, notre vie, la réalité.
Marcel Proust (1927, p. 43)
On raconte que quand Clisthène, le puissant tyran de Sicyone, jugea que le moment était
venu de donner un mari à sa fille, il ne se contenta pas de chercher un jeune homme de
bonne famille, mais voulut lui trouver le meilleur parmi les Grecs. La tâche n’était pas des
plus simples. Ainsi Clisthène attendit-il le moment des Jeux Olympiques, où se rassemblait
la fleur de la jeunesse de la Grèce, et il y fit proclamer publiquement que quiconque d’entre
les Grecs s’estimait digne de devenir son gendre se rendît à Sicyone avant soixante jours. Il
invitait les prétendants à vivre auprès de lui pendant un an. Pendant tout ce temps, il ob-
serverait ses hôtes avec attention, et il concéderait enfin Agaristé — tel était le nom de sa
fille — à celui qu’il tiendrait pour le meilleur.
Tous ceux qui se sentaient fiers d’eux-mêmes et de leur patrie se firent alors prétendants
d’Agaristé. De près et de loin ils vinrent à Sicyone pour se soumettre à l’examen de Clis-
thène, qui leur fit un accueil magnifique. Ensuite, durant de longs mois, le tyran les observa
et mesura leurs qualités en s’entretenant avec eux. Parmi tous, le candidat qu’il appréciait le
plus était un jeune homme beau, noble et plein de talent : Hippocleidès d’Athènes, fils de
Teisandros.
Vint enfin le jour établi pour le banquet des noces. Pour l’occasion, Clisthène fit sacrifier
cent bœufs et invita tous les Sicyoniens à participer au festin. Tous les hommes présents
n’attendaient que l’annonce du nom du vainqueur, mais le repas prit fin que Clisthène
n’avait toujours pas dévoilé l’identité de son futur gendre. Les prétendants s’engagèrent
INTRODUCTION
6
alors dans des concours de musique et de déclamation. Le temps passait, on continuait à
boire, mais nul ne réussissait à l’emporter sur Hippocleidès. Ce fut ainsi que, plein de satis-
faction pour ses exploits, le jeune homme ordonna qu’on lui apportât une table, il monta
dessus et s’abandonna à des danses de plus en plus indécentes. Finalement, il appuya la tête
sur la table et se mit à gesticuler avec ses jambes. Jusque-là, Clisthène avait évité d’éclater
contre Hippocleidès, mais lorsqu’il vit ses jambes nues remuer en l’air il ne put se contenir
plus longtemps et « Fils de Teisandros ! — s’écria-t-il en se levant — par ta danse tu as
manqué le mariage ».
L’honneur de la main d’Agaristè échut donc à un autre Athénien, Mégaclès. Néanmoins, la
réponse qu’Hippocleidès fit au tyran devait rester proverbiale : Οὐ φροντὶς Ἱπποκλείδῃ,
« Hippocleidès s’en moque ! »1. Trop orgueilleux pour admettre d’avoir laissé la fougue
l’emporter sur la décence, Hippocleidès préféra se défendre en radicalisant son attitude : en
définitive, le jugement de son hôte ne portait que sur une question de forme. Si Clisthène
n’était pas en mesure de dépasser de telles petitesses au vu de l’évidente primauté
d’Hippocleidès sur tous les autres, eh bien, tant pis pour lui. Hippocleidès, lui, aimait
mieux être qu’apparaître. Piètre défense, pour quelqu’un qui venait de voir s’envoler le prix
d’un an d’efforts pour un manque de savoir-vivre. Un Grec aurait ainsi pu dégager la mo-
rale suivante de l’exemplum du jeune homme athénien : « Aux gens qui ne soignent pas les
apparences arrivent des malheurs ».
Il existe de nos jours une tendance assez répandue à partager l’opinion d’Hippocleidès, et il
n’est pas rare de soulever des doutes sur l’importance réelle des normes de politesse. La vie
en société impose sans cesse aux individus une multiplicité de circonstances et de contextes
qui les engage à se mettre en jeu devant les autres et à prendre les risques auxquels expose
toute relation (manque de compréhension ou d’accord, conflits, manque de respect de la
part des autres et perte consécutive de confiance en soi, etc.). C’est la politesse qui oriente
les différentes conduites individuelles face à de telles dynamiques. Véritable principe
d’ordre, ses préceptes sous-tendent un grand nombre de détails de notre quotidien. Cepen-
1 Tout ce récit est paraphrasé de Hdt. VI 126, 2-130.
7
dant, lorsqu’il nous arrive de nous interroger sur le fondement d’une de ces normes (ce qui
advient souvent, de façon générale, quand pour une raison ou pour une autre celle-ci n’est
pas respectée), nous ne sommes pas toujours en mesure de donner une réponse satisfaisante.
Il nous manque un sens, une signification profonde à attribuer au comportement que nous
serions censés suivre. La question : « pourquoi devrais-je faire cela ? » n’obtient trop sou-
vent que des réponses telles que « parce que c’est comme ça que l’on fait » ou bien « sinon,
tu serais malpoli ». L’alternative la plus commune aux explications tautologiques, au de-
meurant, consiste à avoir recours à la sphère morale. Ainsi les bons enfants ne poseront pas
les coudes sur la table lors des repas, et n’imiteront pas leurs camarades qui tutoient les
adultes.
Qu’elle nous paraît fanée, pourtant, cette morale des mœurs, dont nous peinons tellement à
trouver la place dans la société contemporaine ! Il nous semble que l’obligation sociale de
nous comporter d’une certaine façon devant les autres ne relève que de l’artifice et qu’elle
nous éloigne, finalement, du véritable noyau de notre existence : cet enchevêtrement du
sentir individuel auquel nous attachons notre notion de vérité et que, par conséquent, nous
allons rechercher chez l’autre. Il n’est pas poli de couper la parole aux gens, lors d’une con-
versation ? Οὐ φροντὶς Ἱπποκλείδῃ ! Le plus important est ailleurs. Voilà des pensées qui tra-
versent souvent les esprits.
Toutefois, on ne saurait nier que nos journées sont constellées par les pratiques de politesse.
Nous nous y plions constamment, sans presque nous en rendre compte : dans le langage
que nous utilisons aussi bien que dans les gestes que nous accomplissons, dans nos attitudes
et dans nos regards. En effet, quand bien même une pratique donnée sort de l’usage à cause
du sentiment commun de vide qu’on lui attache, ce n’est que pour être remplacée par une
autre pratique qui comble ce vide. Ainsi, aujourd’hui, le code de politesse semble caractérisé
par une forme d’appréhension paradoxale : nous ne l’aimons guère dans la mesure où il
nous est difficile de lui reconnaître une substance, mais nous ne sommes pas capables de
nous en passer, car il donne malgré tout une forme à nos relations sociales.
Nos sociétés ont sans doute ôté aux bonnes manières l’attention dont elles faisaient l’objet il
INTRODUCTION
8
n’y a qu’un siècle, alors que la baronne de Staffe en recueillait les normes dans un manuel
destiné à faire autorité2 ; il n’en demeure pas moins que la centralité de la politesse dans les
interactions quotidiennes n’a pas vraiment été entamée et les sciences humaines ont, très
récemment, commencé à en remarquer l’intérêt. Enfin envisagée en tant que phénomène
social et sociologique et non plus comme ensemble incohérent de préceptes dépourvus de
sens, la politesse a vu la reconnaissance progressive de son importance, au moins dans le
milieu académique3.
À la lumière de ce renouveau, il est frappant de remarquer le peu d’attention que les anti-
quisants ont jusqu’à présent accordé aux apparences grecques. En effet, il n’existe presque
aucun ouvrage consacré exclusivement à ce sujet : les exceptions les plus remarquables à
cette règle sont le livre d’Icky Maria Hohendahl-Zoetelief (Manners in the Homeric Epic) et
celui de Robin Nadeau (Les manières de table dans le monde gréco‑romain)4. Pourtant, ces au-
teurs consacrent moins leurs efforts à expliquer les normes de politesse étudiées qu’à en
faire la liste et à donner une description de chacune d’elles5. Certes, aborder l’étude des
codes comportementaux d’une société ou d’un groupe social n’est jamais une tâche simple.
Il n’existe pas de société qui n’en possède pas : l’existence d’un code comportemental est es-
sentielle afin de permettre la vie en commun6. Il n’en demeure pas moins que celui-ci varie
de société en société, se déclinant dans une quantité innombrable de réalisations qui
s’adaptent au caractère et aux nécessités de divers groupes humains. De plus, quelle que soit
la communauté que l’on analyse, il se trouve que son code comportemental n’est jamais un
2 ST A F F E 1899. L’histoire éditoriale de ce manuel, qui a fait l’objet de nouveaux tirages tout au long du XXe siècle, suffit à témoigner de sa valeur de référence. La dernière édition date de 2007 (Paris : Tallandier). 3 La bibliographie récente est vaste et variée. Quoiqu’il ne soit pas possible, ici, d’en rendre un compte ex-haustif, il convient de souligner d’emblée l’importance fondatrice de l’œuvre de Norbert Elias (EL I A S 1973) et des études d’Erving Goffman (notamment G O F F M A N 1959 et G O F F M A N 1972). C’est chez ces deux auteurs — sur lesquels on reviendra (voir infra, p. 24-27) que se trouvent les points de départ de toute la re-cherche postérieure. 4 H O H E N D A H L-ZO E T E L I E F 1980 et NA D E A U 2010.
5 Il existe un petit nombre d’autres ouvrages qui abordent indirectement la question de la politesse. Nous nous limitons pour l’instant à fournir au lecteur quelque titre : G A R L A N D 1998 ; SC O D E L 2008 ; W I L -
G A U X 2008 ; SC H M I T T-PA N T E L 2009 ; M U R R A Y 2012. Un status quaestionis complet est dressé infra, p. 69-78. 6 Cela est vrai pour les être humains comme pour les autres animaux : cf. p. ex. LO R E N Z 1966 et [1963] 1967, p. 72 et s.
9
corpus homogène de normes suivant une logique commune. Il s’agit plutôt d’un système
complexe, où des préceptes qui répondent à des besoins et des exigences divers sont inter-
connectés dans des réseaux aux mailles étroites, qui constituent l’arrière-plan et le guide de
l’action de l’individu en société. Sous cette lumière, le manque de travaux sur le code de po-
litesse de la société grecque antique s’explique assez facilement par le fait qu’elle ne nous a
légué aucun équivalent des traités de civilité des époques moderne et contemporaine7. À la
différence de ses collègues modernistes et contemporanéistes, aussi bien que des socio-
logues qui s’intéressent aux convenances sociales, donc, l’historien de l’Antiquité n’a guère
de repères pour déceler la spécificité de la politesse grecque.
Pourtant la norme est là, le geste est accompli, ses retombées sont évidentes. Voilà à la fois
la raison du désir de s’attaquer à ce sujet quelque peu négligé, et la contrainte majeure
qu’implique une telle recherche : pour étudier les normes de politesse de la Grèce archaïque
et classique, il faut fabriquer des outils de travail qui prennent en compte le fait que les
sources semblent en ignorer la notion. Dans les pages ci-dessous, nous allons présenter la
démarche que nous avons adoptée pour mener à bien la tâche, en commençant par les
questions documentaires.
Quelles sources utiliser ? Au début de nos réflexions, cette question s’imposait comme
d’autant plus primordiale que nous n’avions à notre disposition aucun recueil thématique de
documents susceptible de nous fournir des pistes de recherches initiales. Ce corpus, il fallait
que nous le constituions nous-mêmes, et par conséquent que nous établissions dans un
premier temps les limites chronologiques de notre étude et les types de sources que nous étudie-
7 Pour ne citer que les plus célèbres : au De institutione novitiorum d’Hugues de Saint-Victor (XIIe s.) s’ajoutent les maximes sur le bon comportement à table attribuées à Tannhäuser (1205-1270) dont EL I A S 1973, p. 136-9 offre un beau florilège ; si le De civilitate morum puerilium d’Erasme de Rotterdam (1530) est considéré comme le premier traité d’éducation à proprement parler, nul ne saurait nier l’importance qu’eut une œuvre telle que le Cortegiano de Baldassarre Castiglione (1528), dont la renommée perdura dans les siècles et inspira d’autres ouvrages célèbres comme le Galateo de Giovanni della Casa (1558) et le Nouveau traité de la civilité qui se pratique en France parmi les honnêtes gens de De Courtin (1671). La tra-dition se poursuit après la Révolution, avec le développement des traités de savoir-vivre bourgeois du XIXe siècle, dont le plus représentatif est l’ouvrage déjà cité de ST A F F E 1899. Plus récemment, on enregistre le succès éditorial du manuel de savoir-vivre de RO T H S C H I L D 2001. Cf. M O N T A N D O N 1994 et P I -
C A R D 1995, p. 15.
INTRODUCTION
10
rions. Nous l’annonçons dès le début : le premier prix à payer a été la renonciation à l’étude
systématique de la documentation iconographique, qui pourtant constitue une source in-
dispensable pour l’appréhension non seulement de la gestuelle, mais aussi de la tenue. Con-
vaincu comme nous le sommes de l’importance de ce volet et de l’ampleur qu’il prendrait
s’il était abordé de façon exhaustive et rigoureuse, nous avons préféré le reporter à un avenir
où il sera possible de lui octroyer la place qu’il mérite. Fort d’une formation principalement
philologique, nous avons en revanche pris le parti de débuter l’enquête par la lecture in ex-
tenso des œuvres de la littérature grecque, dès ses commencements jusqu’à la fin du IVe
siècle avant J.-C. : Homère, Hésiode et les poètes lyriques ; les pièces théâtrales des trois
grands poètes tragiques et d’Aristophane ; l’œuvre entière d’Hérodote et Thucydide, ainsi
que celle de Xénophon ; les dialogues de Platon, aussi bien que la Politique et les Éthiques
d’Aristote ; les plaidoyers des orateurs attiques et enfin les comédies de Ménandre8. Nous
allions à la recherche de normes et de pratiques de politesse qui donnaient une forme aux
relations quotidiennes des Grecs. Nous avons émergé d’une telle exploration avec une im-
posante sélection de passages très hétérogènes et quelques convictions qui ont inspiré toute
notre démarche postérieure. Il nous a d’abord paru clair que le temps à notre disposition
n’aurait pas permis une étude approfondie de tout le matériel. Ainsi, parmi les différents
critères envisageables afin de le restreindre ultérieurement (selon le genre littéraire, les
thèmes abordés, l’époque de composition, etc.), nous avons opté pour une approche histo-
rico-évolutive, non tant des pratiques de politesse grecques elles-mêmes que des jugements
sociaux que leur respect ou leur infraction ont engendrés. Concernant ce sujet, il ressortait
de notre enquête que ces jugements connaissent une transformation qualitative importante
entre la fin du Ve siècle av. J.-C. et les années soixante du IVe. Il s’agit de la fin de l’emprise
idéologique du principe de correspondance entre les apparences d’un individu et la disposi-
tion de son esprit, à savoir la conviction que l’aspect extérieur et le comportement d’une
personne ne sont que le reflet des mouvements de son esprit9. Ce principe, dominant dans
8 Nous avons également fait le choix de ne pas prendre systématiquement en considération d’autres sources fragmentaires que les poètes lyriques d’époque archaïque. C’est pourquoi nos références aux philosophes pré-socratiques, aux fragments d’historiens ou d’auteurs théâtraux dans ce travail ne sont que sporadiques. 9 Ce point est approfondi infra, dans le chapitre II.
11
les sources jusqu’au dernier quart du Ve siècle, se fissure par la suite et laisse la place à
d’autres formes d’appréhension des phénomènes sociaux, qui lui font concurrence10. Ce
tournant de l’histoire culturelle grecque ne cessait d’attirer notre attention, pour autant que
nous sachions que, avant de tenter toute synthèse ou explication historique d’un phéno-
mène pareil, il fallait maîtriser les jugements sociaux sur les conduites sociales des deux pé-
riodes distinctes que nous avions cernées. C’est le travail d’au moins deux thèses : nous
avons choisi quant à nous de nous consacrer à la période la plus reculée dans le temps, et
avons fixé la limite basse de notre étude aux dialogues de Platon. En réalité, la cohérence
aurait voulu que nous nous arrêtions bien avant : un regroupement qui inclue la littérature
grecque jusqu’à Eschyle et à Sophocle compris aurait été envisageable. Toutefois nous
n’avons pas voulu renoncer à l’ambition de pousser le regard sur les débats culturels qui fu-
rent le berceau de l’évolution idéologique dont nous venons de parler. À quel titre,
d’ailleurs, aurions-nous situé une césure entre des auteurs presque contemporains, dont les
opinions sont souvent le simple reflet d’une participation au débat culturel ? Ces difficultés,
de pair avec le besoin d’étudier simultanément des textes très divers quant à leur genre litté-
raire, rendaient d’autant plus urgent de se munir d’une grille d’analyse adéquate.
C’est précisément à cette tâche qu’est consacrée la première partie de la thèse. Organisée en
trois chapitres, elle constitue le véritable noyau de notre travail. En premier lieu, elle syn-
thétise les débats des sociologues et des sociolinguistes contemporains11 avec les approches
descriptives des chercheurs qui aspirent en revanche à dresser un tableau des normes et des
pratiques diverses, caractérisant les sociétés humaines aussi bien présentes que passées. Il
s’agit d’un passage indispensable pour estimer à la fois les capacités herméneutiques et les
limites de notre outil d’enquête : le concept de politesse, envisagé notamment dans
l’acception que lui donnent les sociologues anglophones lorsqu’ils parlent de politeness. Une
fois franchie cette étape, nous nous consacrons en deuxième lieu aux nombreux problèmes
préalables que pose l’appréhension du code de comportement des Grecs anciens par le biais
10 Au sujet de ce phénomène, voir l’introduction à la deuxième partie de ce travail. 11 Qui sont actuellement en train de repenser profondément à la fois la catégorie d’action polie et les types d’interactions humaines que celle-ci permet de décrire, cf. chap. I.
INTRODUCTION
12
d’une idée qui leur était étrangère. Il est question non seulement d’établir des marges con-
ceptuelles, à l’intérieur desquelles il convient que notre étude se meuve pour ne pas s’enliser
dans l’anachronisme culturel, mais aussi et surtout de montrer quels sont les enjeux et les
qualités de notre approche vis-à-vis des manières traditionnelles d’aborder les codes de
comportement des Grecs antiques. Enfin, dans le troisième chapitre, nous présentons le
modèle d’analyse que nous avons élaboré afin d’inclure toutes nos réflexions dans un ins-
trument d’enquête adapté à la fois à l’étude des convenances qui règlent l’action individuelle
en société et à la spécificité culturelle de la Grèce telle qu’elle transparaît dans les sources
antiques. Notre point de départ a été le travail du sociologue américain Erving Goffman12.
Le lecteur familier des recherches sociolinguistiques sur la politesse trouvera peut-être
notre modèle trop simple : c’est un choix délibéré que nous assumons volontiers. Nous
sommes en effet convaincu que l’étude d’un phénomène complexe comme la politesse ne
peut pas se limiter au domaine du langage, mais nécessite un regard plus vaste, qui inclut
également la communication non verbale. C’est pourquoi nous avons surtout visé à la sou-
plesse de notre approche, que nous avons pensée pour fonctionner avec plusieurs aspects
divers de l’interaction. Aussi avons-nous cherché à alléger autant que possible le poids de
nos catégories, en leur ôtant les éléments qui à notre avis découlaient des croyances de la
société occidentale contemporaine, et qui ont peu affaire au monde grec antique. Ce faisant,
nous avons voulu construire moins un tamis pour chercher les traces d’une idée choisie a
priori dans les sources grecques qu’une caisse de résonnance pour mieux écouter la voix qui
leur est propre.
Arnold Gomme a dit un jour que « every scholar, once in his lifetime, wants to talk about
Homer; no other scholar wants to listen to him »13. Tout en nous reconnaissant pleinement
dans la première moitié de ce propos, nous osons espérer que ce chercheur avait tort quant
à la seconde moitié : notre deuxième partie est en effet entièrement consacrée à l’épopée
homérique. Nous l’avons dit : l’obstacle peut-être le plus sérieux à dépasser pour l’étude de
la politesse chez les Grecs anciens est représenté par l’absence de manuels de politesse con-
12 Cf. infra, p. 90-95. 13 G O M M E [1957] 1962, p. 1.
13
temporains. Nous savons par quelques mentions éparses que vers la fin de l’époque clas-
sique des ouvrages semblables ont dû exister, pourtant aucun de ceux-ci n’a survécu au nau-
frage de la majorité de la littérature grecque antique durant les siècles médiévaux. Interpré-
ter les relations quotidiennes des Grecs sous le jour de la politesse, c’est avant tout appré-
hender les jugements sur la conduite des individus que contiennent nos sources en les pe-
sant sur la balance des normes de bienséance qui étaient les leurs. Pour réussir dans ce but,
il ne nous fallait pas moins faire référence à un discours paradigmatique en matière de
comportement. Le choix d’Homère, pilier incontesté de la paideia grecque jusqu’aux at-
taques de Platon, nous a paru presque obligé. C’est avec l’œil d’un Grec d’époque histo-
rique, qui cherchait dans l’épopée des modèles à suivre, par conséquent, que nous regardons
vers l’Iliade et vers l’Odyssée. Cet exercice — d’autant plus séduisant qu’il puise dans un ma-
tériau poétique si dense et foisonnant qu’il paraît inépuisable — vise à mettre en lumière à
la fois des normes de savoir-vivre et les jugements sociaux qui frappent les individus selon
leur degré de respect de ces dernières. Autrement dit, il s’agit de définir par des cas particu-
liers un certain type de regard sur la société et sur ses membres, qui n’est rien d’autre, fina-
lement, que celui des élites dirigeantes dont l’idéologie imprègne la quasi-totalité de nos
sources14.
La troisième partie est moins ambitieuse. Elle vise deux objectifs : d’une part, il est question
d’évaluer la valeur des conclusions atteintes dans la deuxième partie à la lumière des autres
sources qui composent notre corpus ; d’autre part, il s’agit de mettre les principes de la poli-
tesse « homérique » à l’épreuve de l’action des individus et des cas particuliers, pour appré-
cier la distance qui existe entre les paradigmes de comportement tels qu’ils étaient prônés
en théorie et les réalisations diverses qui en étaient données dans la pratique des relations
quotidiennes. Au cas par cas, la comparaison entre le degré d’adhérence d’une conduite in- 14 En ayant recours ici pour la première fois au concept contemporain d’idéologie pour se référer à la société et à la pensée grecque antique, il convient de préciser que nous l’employons pour indiquer « un ensemble d’idées, de représentations, des valeurs morales, des préceptes, voire des comportements ou des attitudes. […] L’idéologie, au sens où nous l’entendons, n’a pas pour objet de dissimuler une réalité ou de la travestir au profit de telle ou telle classe dominante ou de tel système politique. Elle peut avoir cet effet, mais non forcément et non exclusivement » (FO U C H A R D 1997, p. 4). Au demeurant, cette définition peut servir de référence pour l’ensemble de ce travail de recherche, y compris les passages ne se référant pas spécifiquement aux sociétés antiques.
INTRODUCTION
14
dividuelle aux règles de politesse et les jugements sociaux que pareille conduite suscitait
permettra d’évaluer définitivement la pertinence de la catégorie de politesse pour l’étude de
la société grecque ; il s’agira aussi de saisir les débuts du processus évolutif des croyances qui
mena à la crise du principe de symétrie idéale entre les apparences de l’individu et sa dispo-
sition éthique. Il va de soi que la réalisation d’une étude diachronique exhaustive embras-
sant une période de quatre siècles dépasse les limites d’un mémoire de thèse, quitte à re-
noncer à l’analyse approfondie des textes grecs. Il aurait était impossible, au demeurant, de
réunir et de maîtriser une bibliographie complète pour tous les auteurs, les genres, les occa-
sions de rencontre sociale et les siècles que couvre notre corpus de sources. Par conséquent
nous avons pris la décision d’effectuer trois « incursions » dans la documentation, voire des
études de cas très ciblées, concernant des sujets divers et particulièrement intéressants, à
notre avis, pour l’approfondissement de notre sujet d’enquête.
Notre idée, notre espoir, c’est que notre travail pourra aider d’autres chercheurs à entre-
prendre de nouvelles études, tant qu’on n’aura pas assez de matériau pour tenter une syn-
thèse de grande haleine. Finalement, l’étude de la politesse des Grecs antiques est un sujet
novateur : il fallait bien commencer quelque part.