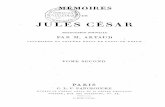G. Lebrun, G. Fronteau, Diffusion des tuiles dans le nord de la Gaule : le cas de la région...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of G. Lebrun, G. Fronteau, Diffusion des tuiles dans le nord de la Gaule : le cas de la région...
CONSOMMER DANS LES CAMPAGNESDE LA GAULE ROMAINE
Actes du Xe congrès de l’Association AGER
Sous la direction deXavier Deru et Ricardo González Villaescusa
REVUE DU NORDHors série. Collection Art et Archéologie N° 21. 2014. Université Charles-de-Gaulle - Lille 3
Depuis le début des années 2000, la Communautéd’Agglomération du Douaisis par le biais de saDirection de l’Archéologie Préventive (CAD-DAP) amis en place des prospections pédestres systéma-tiques. Celles-ci ont permis de mieux appréhender larégion du Douaisis et ont notamment montré la fortedensité d’ateliers de tuilier sur les argiles locales dites« Argiles d’Orchies »1. Cette découverte singulièred’un grand nombre d’officines destinées à la produc-tion de terres cuites architecturales met en lumière unphénomène inconnu jusqu’à ce jour en Gaule : laconcentration de lieux de production de ce domaineparticulier de l’économie au sein d’une micro-région.
Malheureusement le nombre d’ateliers connus dansles territoires septentrionaux de l’empire reste encoreinsuffisant, même si cette tendance commence douce-ment à s’inverser avec l’essor de l’archéologie pré-ventive2. En ce qui concerne l’étude du mobilier issude ces productions, il est bien trop souvent délaissé età peine ramassé lors des opérations archéologiques.Aujourd’hui encore, l’intérêt ne porte seulement quesur les tuiles portant des empreintes ou des estam-pilles ; sans réellement tenir compte du reste de la pro-duction qui est finalement la plus grande part du maté-riel mis au jour. Ainsi il est très difficile d’obtenir desdonnées sur les tuiles que cela soit pour des étudesmétriques3 ou d’avoir accès au mobilier pour échan-tillonner le matériel (souvent non conservé). La notionde consommation et l’organisation de ce secteur lourd
de l’économie, pour reprendre les termes de T. Darvillet A. McWhirr4, sont encore méconnus5.
Nous présenterons lors de cette étude la productionde ces ateliers, par le biais des estampilles, mais aussipar la caractérisation du groupe de pâtes d’Orchies, àl’aide d’observations réalisées à l’échelle macrosco-pique (loupe binoculaire) et microscopique (lamemince). Nous aborderons la question de la diffusiondes produits par les premières cartes de répartitionobtenues et par la comparaison avec d’autres modèlesexistants.
1. Les ateLiers de La région d’orchies
Le groupe d’ateliers d’Orchies est situé, pour l’es-sentiel sur le territoire des Atrébates, à la frontièreavec celui des Ménapiens. Les officines sont locali-sées sur le versant septentrional de la moyenne valléede la Scarpe (fig. 1). Cette plaine d’environ 40 km delong sur 6 à 15 km de large comporte des reliefs trèsdoux avec des altitudes variant de 16 à 30 m. Desvariations dans le contexte géologique de cette airesont discernables et ont fait l’objet de plusieursétudes6. Les ressources en argile qui ont dû êtreexploitées par les artisans gallo-romains sont lesargiles d’Orchies datées de l’Éocène (yprésien infé-rieur).
« C’est une argile plastique noire ou bleuâtre, par-fois feuilletée dans sa partie inférieure […], en sur-
*. — Guillaume LEbRUN, archéologue, membre associé au projetd’Atlas de belgique et Germanie (AbG). Un sujet de recherche sur lesateliers de tuiliers du Nord de la Gaule, à l’époque gallo-romaine, nousa été proposé. Celui-ci a fait l’objet d’un master I et II effectué àl’Université Charles-de-Gaulle—Lille 3 dont une partie des résultatsest présentée dans cet article. Je remercie les personnes qui ont permiset soutenu cette recherche J. Arce, Ch. Hoët-van Cauwenberghe,X. Deru (Université de Lille 3) et particulièrement E. Louis (CAD-DAP) ; Gilles FRONTEAU, géologue pétrographe, GEGENA2, EA3795,Université de Reims Champagne-Ardenne.1. — Pour une première synthèse voir LOUIS, THUILLIER 2007, p. 131-140.
2. — Nous pouvons citer par exemple les sites de Capellen (STOFFEL2009, p. 239-244), d’Hermalle-sous-Huy (bRULET 2008, p. 406-407),des Savins (MARCOULT 1999, p. 86-93), ou encore des Ventes (ADRIAN2005, p. 38-39) qui ont été fouillés ces dernières années.3. — GOULPEAU 1988, p. 97-107 ; CLÉMENT 2009, p. 611-6364. — DARVILL, MCWHIRR 1984, p. 239-261.5. — Les répartitions ne se font, principalement, qu’à partir des tuilesestampillées. Voir par exemple MCWHIRR, VINER 1978, p. 359-377 ; DEPOORTER, CLAEyS 1989, 300 p. ; RICO 1993, p. 51-86 ou LE ROUX 1999,p. 111-123.6. — FOURRIER 1992, p. 206-216 ; DESCHODT 2009, p. 20-22 ;DEMOLON 2010, p. 69-71.
REVUE DU NORD - N° 21 HORS SÉRIE COLLECTION ART ET ARCHÉOLOGIE - 2014, P. 249-264
GUILLAUME LEBRUN, GILLES FRONTEAU*
Diffusion des tuiles dans le nord de la Gaule :le cas de la région d’Orchies (Nord)
face, elle peut être jaunâtre ou bigarrée par altéra-tion. La pyrite est abondante ; sa décompositiondonne naissance à des cristaux de gypse irrégulière-ment répartis. L’extrême base est souvent marquéepar un niveau de sable limoniteux fauve ou mar-ron. »7.
En ce qui concerne l’hydrographie de cette région,la Scarpe, se jetant dans l’Escaut, a montré une his-toire complexe8 et a livré des aménagements dès le IVe
ou Ve siècle9.Les prospections pédestres, menées principalement
par E. Louis et F. Thuillier, ont été doublées depuis2004 par une prospection thématique axée sur l’artisa-nat de la terre cuite. En effet, ces actions ont révélé ungrand nombre d’indices spécifiques de cette activité.
Les résultats de ces prospections ont permis de locali-ser avec certitude quinze sites de production sur plu-sieurs communes. Des indices moins assurés permet-tent d’envisager l’existence de quatorze autres sites10.
À la vue de la forte concentration de sites de pro-duction repérés par les prospections pédestres et doncdu potentiel archéologique important, un autre typed’intervention sur le terrain ne nécessitant aucuneopération destructive pour les structures a étéemployé. Il s’agit de prospections magnétiques. Grâceà une collaboration menée avec Marc Munschy etÉmilie Nodot de l’Institut de Physique du Globe deStrasbourg11, deux campagnes de prospections magné-tiques ont été réalisées sur quelques sites douaisiens12.Des cartes d’anomalies magnétiques ont été élaborées
250 GUILLAUME LEbRUN, GILLES FRONTEAU
7. — Notice de la Carte Géologique de la France au 1/50000e, Saint-Amand-Crespin-Mons, 26-5, bureau de recherches géologiques etminières (notice disponible sur http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0021N.pdf).8. — LOUIS 1990, I-7 ; LOUIS 2009, p. 92-94.9. — VERGNE et alii 2009, p. 207-211 ; LOUIS 2009, p. 81-100 ; DERU etalii 2012, p. 113-115. Voir aussi infra 4.2 Les voies de distribution.10. — LOUIS, THUILLIER 2007, p. 135-137 ; LEbRUN et alii 2012,p. 194-197. Une étude concernant les aspects topographiques et chro-
nologiques de ces ateliers est en préparation (F. Thuillier et E. Louis).11. — M. Munschy, E. Nodot, École et Observatoire des Sciences de laTerre, Institut de Physique du Globe de Strasbourg (UMR 7516 CNRS-UNISTRA/EOST). Je me permets de les remercier chaleureusementpour leur apprentissage et leur patience durant ces deux années de col-laboration pour la réalisation de ce mémoire.12. — Pour la méthodologie employée voir MUNSCHy et alii 2007,p. 168-183 ; bOUIFLANE 2008, p. 17-70 ; LEbRUN 2011, vol. 1, p. 25-38 ; LEbRUN et alii 2012, p. 197-199.
FIG. 1. — Carte de répartition des tuileries par rapport à la couche géologique « argile d’Orchies».Couche reprise à partir du site du bRGM en vecteur harmonisé, © AbG, éch. 1/250 000e.
pour quatre ateliers13 dans le but de caractériser lesstructures repérées, notamment à l’aide d’un corpusqualitatif d’officines bien documentées14.
Au cours de notre recherche, une question fonda-mentale s’est posée : pourquoi trouve-t-on autantd’ateliers de production dans cette région ? La dispo-nibilité de la matière première est un premier élémentde réponse, le deuxième élément étant la proximité demarchés potentiels pour les produits. Il nous a doncsemblé intéressant d’étudier le mobilier, d’abord issudes ateliers, pour essayer de caractériser un groupe depâtes, puis d’ouvrir cette perspective de recherche àdu mobilier provenant de sites de consommation.
2. Le mobiLier : Les tuiLes estampiLLées
L’analyse des tuiles et briques passe systématique-ment par l’observation des estampilles, des marqueslaissées par les artisans ou par les animaux dans l’en-vironnement immédiat de l’officine. Nous avons lachance, d’avoir pour l’un de ces ateliers, des timbresconnus.2.1. Les estampilles recensées
Deux types d’estampilles sont reconnues : CAVTI-TITICAE et OF TITICAE (fig 2). Ce sont les seulesmarques civiles produites à ce jour dans le Nord-Pas-de-Calais. Plusieurs variantes de ces sigles ont notam-
ment été découvertes sur l’atelier de bouvignies,« Champ à Cailloux ». Ces trouvailles ont permis desituer l’origine géographique des tuiles estampilléesde cette même marque recensées dans les années qua-tre-vingt-dix par R. Delmaire15 (tab. 1). Ce dernieravait identifié l’estampille OF TITICAE comme lenom du tuilier Titica, nom à consonance celtique.L’interprétation du sigle CAVTITITICAE pose plusde problèmes. Selon C. Hoët-Van Cauwenberghe16,cette estampille témoigne de l’acquisition par le tuilierou par ses enfants ou petits-enfants ayant repris l’af-faire, de la citoyenneté romaine. L’épigraphiste a ainsipu proposer d’identifier le gentilice suivant :C. Avitius Titica17. Cette interprétation réfute donccelle qui avait été proposée précédemment. Il ne s’agitdonc plus de lire deux noms accolés au génitif,CAVTI et TITICAE, avec ici Cautus nom d’origineromaine18.
Le statut exact de cette personne est inconnu. Nousne pouvons affirmer si Titica était l’artisan-tuilier, lepropriétaire du domaine, le propriétaire de l’officineou même si ce dernier remplissait tous ces rôles à lafois19.2.2. La répartition des estampilles
À ce jour peu de timbres OF TITICA ou CAVTITI-TICAE sont connus : vingt sont recensés sur onzesites différents (fig. 3). Toutes ces marques ont été
DIFFUSION DES TUILES DANS LE NORD DE LA GAULE : LE CAS DE LA RÉGION D’ORCHIES (NORD) 251
13. — bouvignies, « Champ à Cailloux », bouvignies, « GrandeCourbe », Marchiennes, « Les Evoïches » et Marchiennes, « Marais debouvignies » ; les surfaces prospectées représentent entre 2 et 4,5 ha.14. — LEbRUN et alii 2012, p. 194-204.15. — DELMAIRE, NOTTE 1996, p. 64-66.16. — Maître de conférence en histoire romaine (Université de Lille 3– Halma-Ipel). Je la remercie vivement pour les données inédites
qu’elle m’a transmises.17. — HOëT-VAN CAUWENbERGHE 2013.18. — LEbRUN 2011, vol. 1, p. 87.19. — Pour plus d’informations sur l’organisation hiérarchique et lestatut des artisans-tuiliers, notamment en Italie, voir HELEN 1975,154 p.20. — De POORTER, CLAEyS 1989.
12
34 5 3
FIG. 2. — Exemples d’estampilles OF TITICAE et CAVTITICAE.1. bouvignies, « Champ à Cailloux » (d’après Louis, Thuillier 2007, p. 137) ; 2. Rouvroy (d’après Caron, Monchy 1991, p. 13) ; 3. biache-Saint-Vaast (Fouilles A. Jacques, Service archéologique Arras) ; 4. Cambrai (d’après Machelart 1982, pl. 20) ; 5. Soignies (d’après De Poorter,Claeys 1989, p. 34).
252 GUILLAUME LEbRUN, GILLES FRONTEAU
Commune Nombre d’estampilles Type Contexte Bibliographiebavay 2 ]TICAE Agglomération bIEVELET 1952, p. 57 Non précisé Fouille F. Loridantbiache-Saint-Vaast 2 ]TITICA(E) Villa (IIe-IVe s.) JELSkI 1972, p. 139-140 ; ]CAE DELMAIRE 1994, p.481Cambrai 1 OF TI[ Agglomération MACHELART 1982, pl. 20Harelbeke 1 CAVT[ Trouvaille hors contexte DE POORTER, CLAEyS 1989, p. 34-35Meslin-l’Eveque 1 CAVTITIT[ Villa Donnée exclusive Eric LebloisOrchies 6 ]VTITITICAE Villa (Ier-IIe s.) MANIEz 2007, p. 96-98 ]TITIC[Rouvroy 2 ]TITICAE Rural (IIe s.) CARON, MONCHy 1991, p. 13 ; ]TITICAE Découverte XIXe siècle DELMAIRE 1994, p. 512Soignies 2 CAVTI[ bâtiment gallo-romain DE POORTER, CLAEyS CAVTI[ bâtiment gallo-romain 1989, p. 34-35Tournai 1 ]ICAE Agglomération DE POORTER, CLAEyS 1989, p. 210Vaulx-Vraucourt 1 Non précisé Non précisé DELMAIRE, NOTTE 1996, p. 64Vitry-en-Artois 1 ]TITICAE Découverte XIXe siècle CDMH 1979, p. 324 ; DELMAIRE 1994, p. 494
Tableau 1. — Lieux de découverte et types des estampilles mises au jour(sur la base de l’inventaire réalisé par R. Delmaire ; Delmaire, Notte 1996, p. 64-66).
FIG. 3.— Répartition des estampilles retrouvées par rapport au site de Bouvignies, « Champ à Cailloux ».© AbG, éch. 1/1 000 000e.
Tournai
Bavay
Cambrai
Arras
Cassel
Thérouanne
Bouvignies
Orchies
Rouvroy
Biache-Saint-Vaast
Vitry-en-Artois
Vaulx-Vraucourt
Harelbeke
Soignies
Meslin-l’Eveque
Scarpe
Esca
ut
Estampilles
Tuilerie
Agglomérations
Voies romaines
0 20 km
mises au jour dans un rayon de 50 km autourd’Orchies, les plus éloignées étant celles découvertesà Soignies (55 km) et à Meslin-l’Évêque (env. 50 km).Il est maintenant essentiel de voir si le modèle de dif-fusion qui semble se dégager ici, se retrouve ou nondans d’autres études sur des tuiles civiles : c’est-à-dire, une zone tampon d’une cinquantaine de kilomè-tres autour des ateliers.
Le meilleur exemple concernant les régions du nordde la Gaule est à reprendre dans l’ouvrage de A. DePoorter et P.-J. Claeys20. Les auteurs ont dressé descartes de diffusion régionale des estampilles. Ils ontainsi pu mettre en évidence cinq groupes de réparti-tion des sigles à travers la belgique actuelle. Lafigure 4A nous montre la distribution des timbres dugroupe I, ceux-ci sont concentrés d’une manière trèsdense autour de Maastricht, dans une zone de 20 kmenviron. bien qu’aucune officine n’y ait été retrouvée,les auteurs proposent de localiser l’atelier à proximitéde Maastricht21. Les sigles que A. De Poorter et P.-J.Claeys classent dans le groupe II (fig. 4b) sont focali-sés autour des agglomérations d’Amay et de braives.Ici, la répartition est un peu plus étendue que pour leurgroupe I car ils retrouvent des timbres à 50 km etmême jusqu’à 70 km de leur zone de concentration22.Si on se tourne vers l’étude de A. McWhirr et D.Viner23 pour la Grande-bretagne, nous observons que,les ateliers, localisés à proximité de Cirencester ontproduit des estampilles TPF. Ces dernières se retrou-vent, au maximum, à une trentaine de kilomètres parrapport à cette aire de production. Ici, l’écart maximalentre une même marque est d’une cinquantaine dekilomètres.
Ces divers exemples de répartition coïncident avecce que nous observons à Orchies. Ces quelques décou-vertes et cette première carte nous montrent une zoneconcentrique, autour des d’ateliers d’Orchies, d’unecinquantaine de kilomètres où nous retrouvons nossigles.
3. Le mobiLier : Les groupes de pâtes
L’occasion nous a été donnée d’observer des échan-tillons de terres cuites architecturales à la loupe bino-culaire, à l’image des études réalisées pour la céra-mique. Il était ainsi question d’évaluer le potentiel decette méthode sur ce type de mobilier. L’objectif était
de voir s’il était possible de discerner des caractéris-tiques communes entre plusieurs échantillons et parconséquent de reconnaître des groupes homogènes.D’abord, des échantillons ont été collectés directe-ment sur les sites reconnus en prospection pédestre,puis des contacts ont été pris avec les différentsacteurs de l’archéologie dans le Nord-Pas-Calais et enPicardie afin de réunir un corpus de tuiles provenantde sites de consommation24.3.1. Le groupe de pâtes d’Orchies
La description à l’échelle macroscopique s’appuiesur une observation à la loupe binoculaire (de 8 à 32fois) des échantillons. Celle à l’échelle microscopiquese base sur les constations effectuées sur neuf lamesminces, provenant d’échantillons pris sur trois ateliersdifférents25. La description comprend l’énonciation dela couleur de la pâte (Guide Philatélique Michel) etune description des inclusions : couleur, fréquence(rare 1-2 %, clairsemé inférieur à 10 %, modéré entre10 et 30 % et abondant supérieur à 30 %), taille (petit,inférieur à 0,25 mm ; moyen, entre 0,25 et 0,6 mm etgros, supérieur à 0,6 mm) et nature26. C’est un total decent cinquante-trois échantillons qui ont été étudiésprovenant de dix sites de production (tab. 2).
La pâte offre un panel de teinte orange clair homo-gène, avec quelques rares nuances d’orange un peuplus foncé (qui correspondent souvent aux échan-tillons surcuits) ; elle apparaît plutôt fine au regard desautres échantillons observés. Elle possède des quartzde très petite taille, qui semblent indénombrables.Quelques grains de glauconie ont également été repé-rés, ils sont d’une couleur rouge-orangé, émoussés et
DIFFUSION DES TUILES DANS LE NORD DE LA GAULE : LE CAS DE LA RÉGION D’ORCHIES (NORD) 253
21. — De POORTER, CLAEyS 1989, p. 231.22. — De POORTER, CLAEyS 1989, p. 232.23. — MCWHIRR, VINER 1978, p. 359-377.24. — Il faut pour cela remercier R. blondeau (Eveha), X. Deru(Lille 3), J. Donadieu (Lille 3, étudiante), L. Gubellini (Archéopole),A. Jacques (Service archéologique d’Arras), F. Loridant † (CG 59),E. Louis (CAD-DAP), C. Louvion (CG 59), V. Merkenbreack (CG 62),
L. Meurisse (Archéopole), P. Neaud (INRAP), R. Plouriel(Archéopole), J.-C. Routier (INRAP) et S. Vasseur (Lille 3, étudiant).25. — Coutiches, « Les Soussottes », Marchiennes, « Les Evoïches » etFlines-lez-Râches, « Pont des Vaches ».26. — Pour plus de détails sur la caractérisation des minéraux, voir parexemple ADAMS et alii 1994, p. 3 et 24.
Commune Lieu-dit Nombre d’échantillonsbeuvry-la-Forêt Pannerie Delemer 16bouvignies Champ à Cailloux 16bouvignies Grande Courbe 16Coutiches Fromet Bru 16Coutiches Soussottes 15Faumont Rue du Bois 18Flines-lez-Râches Au Tiélloy 16Flines-lez-Râches Pont des Vaches 16Marchiennes Faux Vivier 12Marchiennes Les Evoïches 12Total 153
Tableau 2. — Les échantillons collectés sur les tuileries.
254 GUILLAUME LEbRUN, GILLES FRONTEAU
Bavay
Arlon
Namur
Tongres
Maastricht
Bavay
Arlon
Namur
Tongres
Amay
Braives
A
BFIG. 4. — Carte de répartition des estampilles belges.
A. Distribution des timbres du groupe I (d’après De Poorter, Claeys 1989, p. 231) ; b. Distri-bution des marques du groupe II (d’après De Poorter, Claeys 1989, p. 232).
de taille moyenne. Des inclusions d’oxyde de fer ontété observées : de grosse taille, hétérogènes, elles sontde couleur orange et parfois brune (plus rarementnoire). Des inclusions d’argilite viennent compléter lespectre de la pâte, de taille moyenne à grosse, ellessont rares, émoussées et de couleur brun-orange oujaune chrome. D’autres éléments plus rares peuvents’observer. Il s’agit d’inclusions noires, de taillemoyenne à grosse et anguleuse, qui correspondent àdu silex. De même, des inclusions blanches, de taillemoyenne, émoussées représentent de la calcite. Detrès rares petites inclusions grises anguleuses sontégalement visibles, sans qu’il soit possible de détermi-ner la nature précise de celles-ci. Enfin, des tracesd’éléments organiques sont apercevables sous laforme de grosses « tâches » noires un peu luisantes27
(fig. 5 A et b).
Cette description est à compléter par l’ajout de deuxnuances. La présence de quartz de taille moyenne,homogène avec une fréquence rare à clairsemée et deforme sub-arrondie. Ces inclusions correspondent au« sous-groupe Orchies A » et ont été repérées sur 66 %des échantillons étudiés. La deuxième nuanceconcorde également avec ce même type d’inclusionsde quartz. Mais cette fois-ci, la fréquence de celles-ciest plus élevée : de modérée à abondante. Les échan-tillons comportant cette caractéristique ont été classésdans le « sous-groupe Orchies b » et constituent 34 %des individus analysés.
Ces deux sous-groupes se retrouvent sur les dixsites étudiés avec à chaque fois, une part plus impor-tante du « sous-groupe Orchies A ». Il serait intéres-sant par la suite de voir si ces nuances correspondent à
DIFFUSION DES TUILES DANS LE NORD DE LA GAULE : LE CAS DE LA RÉGION D’ORCHIES (NORD) 255
27. — Cette description concorde avec les observations réalisées pourla céramique sur le site de Marcq-en-barœul (59), « Le Cheval blanc ».Voir CENSE et alii 2009, p. 115-117.
Orchies A Orchies B
A
B FIG. 5. — Groupe de pâtes d’Orchies. G. Fronteau.
A. Photographies loupe binoculaire ; b. photographies lames minces.
un geste volontaire de l’artisan ou si c’est un phéno-mène totalement naturel, ce qui nous semble le plusprobable aujourd’hui.
Les officines étant localisées sur le versant situé encontrebas de la couche géologique, on peut imaginerdes phénomènes de colluvionnement entre le reborddu plateau et la vallée de la Scarpe où le mélangeargile et sable se fait naturellement28.
Il faudrait pour cela réaliser des prélèvements direc-tement dans les bancs d’argile pour avoir une parfaitetraçabilité des inclusions et des éléments physico-chi-miques de cette matière première.3.2. Les autres groupes de pâtes
Nous avons observé des échantillons provenant detrente-huit sites de consommation (tab. 3) pour voir sinous pouvions retrouver le groupe de pâtes d’Orchies,mais également apercevoir de réelles différences avecce dernier. Un total de deux cent vingt et un échan-tillons ont été analysés. Ceux-ci proviennent decontextes ruraux, urbains ou funéraires. Nous vou-lions caractériser au mieux les différents groupeshomogènes et ne pas biaiser les résultats en se limitantà telle ou telle structure, mais également vérifier l’effi-cacité de la méthode. Il est bien entendu impossible icide présenter l’intégralité des résultats obtenus, c’estpourquoi nous nous limiterons à quelques exemplesconcrets29.
Un groupe homogène a été identifié sur des échan-tillons provenant de la ville d’Arras (Pas-de-Calais)30,antique cité de Nemetacum. Sur les quinze échan-tillons observés, cinq ont pu être rattachés à ce groupe(AR.1). La pâte est de couleur homogène, orange pâle.Des inclusions d’oxyde de fer sont visibles, de taillemoyenne à grande, rares et de couleur orange. Desquartz de taille moyenne et homogène, abondants,translucides et émoussés sont présents. De rares inclu-sions d’argilite, moyennes, rares et orange ont étéaperçues. Enfin, des inclusions noires, moyennes,rares et anguleuses (silex ?) complètent le panel decette pâte (fig. 6, A).
Sur le site d’Attin (Pas-de-Calais)31, quinze échan-tillons ont été étudiés. Six d’entre eux ont pu êtreregroupés en un groupe homogène (AT.1). La pâte decouleur hétérogène (différentes teintes d’orange avecun cœur généralement gris) est grossière. Des oxydesde fer sont visibles. Ils sont soit moyens à gros, hété-
rogènes, clairsemés, émoussés et orange, soit degrande taille, rares, émoussés et de couleur noire. Lesquartz sont de petite taille, homogènes, translucides,abondants et émoussés. De l’argilite est aussi observa-ble, elle est de couleur orangée, de grande taille, rareet émoussée. Enfin, des inclusions blanches, rares, detaille moyenne et homogène, émoussées correspon-draient à de la calcite ou à des microfossiles (fig. 6,b).
Vingt et un échantillons provenant du site de bavay(Nord)32 ont été analysés. Cinq échantillons ont étérattachés au groupe de pâtes du Noyonnais. Ce rallie-ment a pu se faire grâce à des comparaisons avec desamphores et mortiers gallo-romains, dont les groupesde pâtes sont beaucoup mieux connus33. La pâte fineest homogène, blanche ou hétérogène, rosâtre en soncœur et jaune chrome clair aux extrémités (mélangede matrices) ; elle comporte de nombreux oxydes defer. Ceux-ci sont de différentes tailles : de petite taille,abondant et hétérogène ; de taille moyenne à grande,rare à clairsemé et hétérogène. Ces oxydes sont tousémoussés et de couleur orange-rouge. Des quartz depetite taille, homogènes, clairsemés, émoussés ettranslucides sont aussi présents (fig. 6, C).
Enfin, un dernier exemple provenant de la com-mune d’Hébecourt (Somme)34, nous montre un typede pâte différent. Sur les six échantillons étudiés, deuxsemblent correspondre à un groupe homogène (HE.1).La pâte, grossière, est de couleur brune. De petitsoxydes de fer bruns, subangulaires et rares sont pré-sents. Des inclusions de quartz de petite taille (hétéro-gène), abondantes, de faible sphéricité, émoussées etde couleur translucide gris-blanc à transparent sontvisibles. Des inclusions gris-blanc à noires, rares,hétérogènes en taille (petit à moyen), subanguleuses àanguleuses et de faible sphéricité sont égalementobservables (ajout de silex ? – fig. 6, D).
À travers ces exemples, il semble donc possible derepérer plusieurs groupes de pâtes homogènes au seind’un même site. Toutefois, ces études n’en étant qu’àleurs prémices, il faut continuer les observationsmacroscopiques, car le nombre d’échantillons analy-sés est encore insuffisant, notamment sur les sites oùmoins d’une dizaine de prélèvements ont pu êtreeffectués. Il serait également très intéressant de pou-voir associer ces observations avec des analysesmicroscopiques et/ou physico-chimiques pour tracerles composants des différents groupes de pâtes.
256 GUILLAUME LEbRUN, GILLES FRONTEAU
28. — LEbRUN 2011, vol. 1, p. 68-69.29. — Pour le détails des résultats voir LEbRUN 2011, vol. 1, p. 70-78.30. — Fouilles Service archéologique de la ville d’Arras, voir JACQUES,JELSkI 1984, p. 121-122.31. — Fouilles INRAP, voir ROUTIER, RÉVILLION 2007, p. 89-100.
32. — Fouilles Archéopole. Données exclusives transmises par V.Merkenbreak (CG 62).33. — FLORENT 2007, p. 31.34. — Matériel de prospection, SRA Picardie.
DIFFUSION DES TUILES DANS LE NORD DE LA GAULE : LE CAS DE LA RÉGION D’ORCHIES (NORD) 257
Commune Éch. Orchies Autre groupe Occupation BibliographieArleux 1 Oui Non Rural Fouilles CAD-DAPArras 15 Oui AR.1 Urbain Fouilles A. Jacques (Service archéologique d’Arras)
AR.2Attin 15 Oui AT.1 Villa ROUTIER, RÉVILLION 2007, p. 89-100
AT.2bailleul 10 Oui Non Villa « bailleul, la zAC des collines », BSR Nord/Pas-de-
Calais 2008, noticebavay 7 Oui bA.1 Urbain Service départemental du Nord, fouilles C. Louvionbavay 20 Oui bA.2 à 7 Urbain Fouilles Archéopole, V. Merkenbreack (CG 62)brie 1 Non bR.1 Rural Prospections SRA Picardiebruay-la-buissière 8 Oui Non Voirie, bâtiments Fouilles Archéopole, V. Merkenbreack (CG 62)Cartigny 1 Non CA.1 Rural Prospections SRA PicardieCattenières 9 Oui Non Rural ? Service départemental du Nord (C. Louvion)Cysoing 2 Oui Non Villa Fouilles CAD-DAPDoingt 4 Non NOyONNAIS Rural Prospections SRA Picardie
DO.1Doingt-Flamicourt 3 Non DF.1 Rural Prospections SRA Picardie
DF.2DF.3
Douai 1 Oui Non Urbain Fouilles CAD-DAPDourges 1 Oui Non Rural Fouilles CAD-DAPEterpigny 1 Oui Non Rural Prospections SRA PicardieFrethun 10 Oui FE.1 Rural Fouilles Laëtitia Meurisse (Archéopole)
FE.2FE.3
Hébecourt 6 Oui HE.1 et 2 Rural Prospections SRA PicardieLa bassée 3 Oui Non Rural ? Service départemental du Nord (C. Louvion)Laboissière-en-Santerre 4 Non NOyONNAIS Rural Prospections SRA Picardie
LS.1LS.2
Lauwin-Plancque, site 1 2 Oui Non Rural Diagnostic CAD-DAP(C17)Lauwin-Plancque, site 2 2 Oui Non Ferme Fouilles CAD-DAPLes-Rues-des-Vignes 14 Oui Non Quartier artisanal Communications X. DeruLes-Rues-des-Vignes 18 Oui RV.1 à 4 Occupation liée au sanctuaire ? Fouilles Archéopole, R. blondeau (Eveha)Mérignies 15 Oui Non Villa GUbELLINI et al. 2009, p. 155-180Orchies 2 Oui Non Villa Fouilles CAD-DAPPecquencourt 1 Oui Non Rural Fouilles CAD-DAPPéronne 4 Oui Non Rural Prospections SRA PicardiePont-à-Marcq 8 Oui Non Rural ? Service départemental du Nord, fouilles F. LoridantQuiéry-la-Motte 1 Oui Non Réemploi dans des tombes Fouilles CAD-DAPRoisel 3 Oui RO.1
RO.2 Rural Prospections SRA PicardieSains-du-Nord 17 Oui NOyONNAIS Village Fouilles P. Neaud (INRAP)
SN.1 à 11Sars-et-Rosières 7 Oui Non Rural Fouilles Laëtitia Meurisse (Archéopole)Tilloloy 1 Non TI.1 Rural Prospections SRA PicardieVillers-bocage 1 Non Vb.1 Rural Prospections SRA PicardieVitry-en-Artois 2 Oui Non Villa Fouilles CAD-DAPyzeux 1 Non yz.1 Rural Prospections SRA PicardieTotal : 221 échantillons
Tableau 3. — Les échantillons collectés sur les sites de consommation (Éch. : nombre d’échantillons collectés).
3.3. La répartition des tuiles par groupes de pâtes3.3.1. Les exemples des sites de Mérignies et ArrasLe site de Mérignies (Nord)
Il s’agit d’une occupation agro-pastorale laténienne(IIe - Ier s. av. J.-C.) ayant évolué en une uilla gallo-romaine à plan axial (Ier- début IIIe s. de notre ère)35.
Quinze prélèvements ont été réalisés sur cette uilla,les échantillons viennent de fragments de tegulae,imbrices ou pilettes d’hypocauste. Ils ont été pris defaçon aléatoire sur le mobilier disponible, afin d’obte-nir une vue globale du site. Huit échantillons provien-nent d’un puits (structure 2421) qui présentait sur 3 mde haut des rangs de tegulae. Ces dernières, utilisées
en réemploi, semblent provenir d’un bâtiment situé àproximité. La totalité de ces échantillons a pu être rat-tachée au groupe d’Orchies. Nous sommes ici à unequinzaine de kilomètres des ateliers de production. Lesite est localisé dans la vallée de la Marque, sur deslimons quaternaires recouvrant une argile yprésienne(la même que celle trouvée sur les ateliers).Le site d’Arras (Pas-de-Calais)
Les échantillons proviennent de la fouille réalisée« Rue baudimont » où des quartiers d’habitat ont étémis au jour36. Quinze échantillons ont été analysés, ilsont été prélevés sur des tegulae, des imbrices, destubuli et des pilettes d’hypocauste. Ici aussi, les prélè-vements ont été pris de façon aléatoire sur le mobilier
258 GUILLAUME LEbRUN, GILLES FRONTEAU
35. — GUbELLINI et alii 2009, p. 157-162. 36. — JACQUES, JELSkI 1984, p. 121-124.
2 mm 1 0 0 1 2 mm
0 1 2 mm 1 2 mm 0
A B
C D FIG. 6. — Divers groupes de pâtes.
A. Arras (62) ; b. Attin (62) ; C. bavay (59) ; D. Hébecourt (80).
disponible. Sur la totalité des échantillons, huit ont étérattachés au groupe d’Orchies, tandis que les septautres sont de nature différente. Ces derniers ont puêtre divisés en deux « entités » distinctes AR.1 (cinqindividus) et AR.2 (deux individus). Ceci est à relati-viser car le nombre d’échantillons est trop faible pouridentifier clairement un groupe. Mais il y a bien desdifférences notables dans la nature de leur pâte aveccelle d’Orchies. Nous nous trouvons à une quaran-taine de kilomètres des ateliers d’Orchies. Le sous-solde la cité antique est composé de craie blanche(Sénonien) ou de limon argilo-sableux (Pléistocène)présent à différentes hauteurs (plateaux et valléescreusées par la Scarpe)37.3.3.2. Les cartes de répartition
Globalement, les sites dont les échantillons mon-trent le plus de ressemblances avec ceux d’Orchiessont situés dans un rayon de 50 km (fig. 7, A). À l’in-térieur même de cette zone, nous trouvons un « noyaudur » de 20 à 30 km où seul le groupe de pâtes observéest celui d’Orchies. Au-delà de cette aire d’environ50 km, l’exclusivité de notre groupe de pâtes se perd,voire disparaît totalement (fig. 7, b).
Encore une fois, il faut se tourner vers d’autresétudes pour comparer le modèle qui semble se déga-ger ici. Les analyses macroscopiques des pâtes sontchoses rares dans la bibliographie. À notre connais-sance, seul N. Coulthard fait mention d’observationspétrographiques sur des tuiles de l’atelier gallo-romain de Touffréville (Calvados) pour le nord de laGaule38. Il faut s’orienter vers la littérature britanniquepour trouver des cartes de répartition du matériel à tra-vers des analyses macroscopiques et/ou pétrogra-phiques.
Dans son article, D. P. S. Peacock39 décrit deuxgroupes de pâtes visibles à travers la production destuiles (estampillées ou non) de la Classis Britannica.Le groupe 1 (fabric 1), celui fabriqué àboulogne/Desvres, se retrouve essentiellement autourde ces deux villes. Le second groupe (fabric 2) com-prend des tuiles fabriquées dans le sud-est del’Angleterre. L’auteur a dressé une carte de diffusionde ce deuxième groupe. Il voit des tuiles envoyéesdans un rayon de 60 km par rapport à la zone de pro-duction (Hastings Beds). De plus, il affirme qu’untiers des échantillons étudiés à boulogne appartient àla fabric 2. On se trouve ici à 80 km de la zone de pro-duction en traversant la Manche. Pour D. P. S Peacockun trajet de la production boulogne/Desvres vers
l’Angleterre devait être plus limité car les indices sontplus faibles.
Un autre exemple se trouve dans l’article de T.Darvill sur les tuiles de la Costwold Region40.L’auteur a identifié une aire de production, autour dela localité de Minety, sur les bancs d’argile d’Oxford.Plusieurs ateliers et sans doute plusieurs tuiliersdevaient exploiter ces ressources, car deux estampillessont recensées (TPF et LHS). La répartition de cesdeux timbres, par rapport à Minety, s’observe sur unequarantaine de kilomètres. L’une allant plutôt vers lenord (TPF) et l’autre plutôt vers le sud (LHS).T. Darvill circonscrit une zone de production occupéepar plusieurs artisans qui diffusent leurs produitsjusqu’à 40 km de leur officine.
Ces divers cas semblent appuyer le modèle quenous constatons pour les productions du groupe depâtes d’Orchies. Un cœur dédié à la production autourduquel les produits sont répartis dans un rayon de 40 à50 km de distance de manière exclusive (ou quasi-exclusive).
4. synthèse
4.1. La répartition des tuiles de la région d’OrchiesAu vu de ces premiers résultats, il a été possible de
dresser des cartes de répartition du mobilierd’Orchies. Il sera donc possible de discuter de lanotion de « consommer de la terre cuite architectu-rale » à travers l’ébauche de cette distribution ; et parla suite, espérons-le, à travers les réseaux écono-miques de ce type de matériaux. Ces cartes sont bienévidemment incomplètes, mais permettent de dégagerune première piste d’étude.
Que cela soit par l’analyse des estampilles ou parcelle des groupes de pâtes, il semble que le modèleéconomique se présente sous la forme d’un point cen-tral dédié à la production (présence des matières pre-mières, de voies de circulation et d’un marché deman-deur en tuiles) et d’une aire de diffusion de cesproduits répartie sur une cinquantaine de kilomètresde diamètre. Il apparaît donc qu’un atelier perd de sa« mainmise » sur le marché au-delà de 50 km, noussommes ainsi en présence d’un transport à courte dis-tance. C’est également le constat que fait C. Rico41
pour les matériaux civils dans la péninsule ibérique :« les tuiles, les briques et les nombreux autres maté-riaux qui en sont dérivés constituent la productioncéramique qui, par essence, a le moins voyagé ».
DIFFUSION DES TUILES DANS LE NORD DE LA GAULE : LE CAS DE LA RÉGION D’ORCHIES (NORD) 259
37. — Notice de la Carte géologique de la France à 1/50000, Arras, 24-6, bureau de recherches géologiques et minières (notice disponible surhttp://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0026N.pdf). 38. — COULTHARD 1999, p. 171-172.
39. — PEACOCk 1977, p. 235-248.40. — DARVIL 1979, p. 310-348.41. — RICO 1993, p. 68-71.
260 GUILLAUME LEbRUN, GILLES FRONTEAU
Cassel
Therouanne
Arras Bavay
Saint-QuentinAmiens
Tuileries
Agglomérations
Voies romaines
A
B
C
20 km
180 km
0 25 50 km
Mer du Nord
Manche
B
Bavay
Tournai
Boulogne-sur-Mer
Cassel
Thérouanne
Arras
Cambrai
Amiens
Saint-Quentin
Tuileries Agglomérations
Sites de consommation (moins de 6 échantillons) - Groupe Orchies
Sites de consommation (plus de 6 échantillons):
Orchies
Noyonnais
Autres
Voies romaines
Mer du Nord
Man
che
0 20 km
A
FIG. 7. — Cartes de répartition des échantillons observés.A. Localisation des sites de consommation étudiés et zones tampons (A : monopole, b : partiel, C : absence, © AbG, éch. 1/2 000 000e) ; b. Répartition du groupe de pâte d’Orchies, © AbG, éch. 1/1 000 000e.
Pourtant, nous avons pu observer le grouped’Orchies sur des sites situés à plus de 100 km de lazone de production (Frethun ou Attin par exemple). Ilfaudrait pouvoir déterminer s’il existe des argiles pré-sentes dans ces régions de même nature que celled’Orchies ou si, ce sont bel et bien les ateliersd’Orchies qui ont fourni les produits. La raison pour-rait être des besoins importants d’un chantier que nepouvaient pas satisfaire des officines locales.
Nous pouvons également envisager, pour un trans-port à plus longue distance, des personnes ayant lesmoyens financiers de se procurer des matériauxvenant de plus loin. y. Thébert dans un article paru en200042 souligne le fait que l’on sous-estime souvent lavaleur des briques. Même s’il illustre ces propos avecdes exemples de commerce à grande distance entrel’Italie et l’Afrique du Nord, modèle différent de ceque nous avons pour notre région, il a le mérite deposer la question de la valeur marchande de ces pro-duits ; et comme n’importe quel autre bien deconsommation, de réhabiliter le transport par bateaudes briques comme objet de commerce et non seule-ment comme « objet mis entre deux amphores pour lelest ». P. Ouzoulias suggère également, de voir unecertaine forme de richesse dans l’acquisition d’unetoiture en tuiles43. Il prend en exemple le cas d’un petitétablissement rural se dotant d’un toit en tuile audébut du IIe siècle, et cite Strabon rapportant« qu’avant l’arrivée des Romains, Troie n’était plusqu’un modeste village, tellement pauvre que les bâti-ments étaient dépourvus de tuiles » (Géographie,XIII, 1, 27).4.2. Les voies de distribution
Le transport de ce type de produit, lourd et encom-brant, fait toujours débat et reste encore à explorermême si l’acheminement par voie navigable semble leplus communément accepté. Leur circulation doit sefaire sur des distances limitées comme nous l’avonsvu précédemment.
La nécessité de chantier est un critère important àprendre en compte. Si nous nous référons à l’article deT. Derks44, sur les dynamiques ville-campagne enGaule du nord, l’auteur suggère de voir les élites poli-tiques locales également comme managers d’entre-prises agraires avec les uillae, ce qui sous-entend uneromanisation de ces constructions, notamment avec
l’acquisition d’une toiture en tuiles. Il en résulte doncune demande très importante en terres cuites architec-turales si l’on considère qu’il y a autant de marchéspotentiels que de gérants agraires.
En ce qui concerne l’hydrographie de la régiond’Orchies, les études ont montré un réseau complexede cours d’eau et de voies navigables (Satis, Scarbea)connu pour la période médiévale45. Des structuresd’appontement ou de gué sont datées du IVe-Ve siècle àDouai, en bordure de rivière46, mais ce sont là les seulsindices attestant une navigation sur la Scarbea àl’époque romaine. Le transport de marchandises surcette rivière est donc encore au stade de l’hypothèse. Ilne fait aucun doute que ce vaste réseau de cours d’eauremaniés par le temps et les hommes est difficile àappréhender.
Le réseau routier est à prendre en compte égale-ment. Les ateliers considérés sont au centre des agglo-mérations Tournai/Arras/Cambrai/bavay, qui sontdesservies par de grands axes viaires47. Il est certainque le transport par charrette ou autre moyen s’en rap-prochant a dû jouer un rôle important dans l’achemi-nement des tuiles. Le transfert des matériaux d’uneofficine à un port fluvial ne peut se faire que par laroute, le déchargement (après transport en barque)également. Il semble aussi que le transport routier estplus facile à mettre en œuvre pour de courtes dis-tances48 que le transport fluvial. Que ce soit achemine-ment par la route ou par les eaux, la notion de rupturede charge (nombre de chargements/déchargements)est un critère essentiel à appréhender et reste encoreassez flou aujourd’hui.
Une nouvelle fois, nous nous tournerons vers d’au-tres exemples pour percevoir les hypothèses envisa-gées vis-à-vis du transport des terres cuites architectu-rales.
En belgique, A. De Poorter et P.-J. Claeys notentl’importance des fleuves comme la Meuse, où « leslieux de trouvailles se succèdent sur des centaines dekm49 ». Néanmoins, ces auteurs remarquent égalementla présence de nombreuses tuiles estampillées le longde certaines voies romaines traversant l’intérieur desterres (bavay-Cologne ou bavay-Dinant)50. Lesauteurs ne favorisent pas l’un ou l’autre moyen detransport et semblent penser qu’ils sont complémen-taires.
DIFFUSION DES TUILES DANS LE NORD DE LA GAULE : LE CAS DE LA RÉGION D’ORCHIES (NORD) 261
42. — THÉbERT 2000, p. 341-356.43. — OUzOULIAS 2010, p. 210.44. — DERkS 2011, p. 107-114.45. — LOUIS 2009, p. 81-100 ; VERGNE et alii 2009, p. 207-211.46. — COMPAGNON 1996, p. 6.
47. — TALbERT 2000.48. — Si nous admettons qu’un trajet journalier de 20 km est réalisableen charrette.49. — DE POORTER, CLAEyS 1989, p. 239-240.50. — DE POORTER, CLAEyS 1989, p. 239-240.
Dans l’article de D. P. S. Peacock traitant des tuilesdu sud-est de la Grande-bretagne et de boulogne,celui-ci privilégie le transport par bateau. Cela ne faitaucun doute pour les échanges entre le continent etl’île. Mais l’auteur pense aussi que c’est ce type demoyen d’acheminement qui a été utilisé comme voiede diffusion entre les sites anglais51.
Un exemple beaucoup plus méridional nous montrel’importance des cours d’eau pour le transport de cetype de marchandise. En effet, pour la péninsule ibé-rique, C. Rico pense que « la localisation de tous cescomplexes manufacturiers [production de matériauxde construction] le long des grands cours d’eau navi-gables […] assurait aux briquetiers une excellente dif-fusion de leurs produits »52.
Il semble donc possible que la Scarbea et sesaffluents aient pu jouer un rôle dans l’acheminementdes marchandises. On peut se demander d’ailleurs siles ateliers d’Orchies ne se sont pas volontairementrapprochés de ce cours d’eau pour pouvoir diffuserleurs produits plus facilement. Des routes passent éga-lement à proximité de nos officines, routes dont le rôlen’est pas à négliger. Que cela soit par un transport flu-vial ou routier, il semble qu’un réseau de communica-tion solide et facile d’accès soit un des critères d’im-plantation des sites de production. À cela, il fautégalement toujours garder en tête la localisation deschantiers. En effet, les uillae ou autres exploitationsagricoles ayant, de même, besoin de voies de distribu-tion pour écouler facilement leurs produits, sontautant de marchés potentiels pour les artisans-tuiliersde notre étude.
concLusion
Cette première étude nous a permis de mettre enavant une piste de recherche sur les terres cuites archi-tecturales. En effet, l’analyse du mobilier, notammentpar le biais d’observations macroscopiques et micro-scopiques, nous a autorisé à définir le groupe de pâtesd’Orchies. Ces observations nous ont également mon-tré un panel de pâtes différentes et ainsi la possibilitéde former des groupes homogènes au sein des sites. Ilfaudrait pouvoir poursuivre ce type d’intervention à lafois, sur les ateliers et sur les sites de consommationpour continuer à examiner les aires de diffusion desproduits. Mais également, développer les analysespétrographiques, que cela soit par la lecture des cartesgéologiques, par des observations microscopiques etpar des carottages effectués à même les argiles. Ceci
afin de définir très précisément la nature des argilesutilisées et de constater les éventuels ajouts des arti-sans dans la préparation de leur matière.
Un travail bibliographique a donné la possibilité defaire le point sur les estampilles OF TITICAE et CAV-TITITICAE. Une nouvelle hypothèse a été formuléepour l’interprétation de ces estampilles par C. Hoët-Van Cauwenberghe.
Les premières cartes de répartition du mobilier viales groupes de pâtes et les estampilles nous ont donnédes débuts d’indice sur le modèle économique et laconsommation de la terre cuite architecturale pour lenord de la Gaule. Il semble que ces matériaux voya-gent dans une aire géographique réduite et qu’ungroupe d’ateliers doit posséder une région de diffusionde ses produits. Il apparaît que les voies fluviales sontcertainement le meilleur moyen pour transporter cesmarchandises lourdes et encombrantes sur desdizaines de kilomètres. Sans pour autant négliger leréseau routier, surtout sur des distances très courtes oupour des sites non desservis par les eaux.
Ces résultats, qui ne sont encore qu’un préambuleaux futures recherches, permettent de faire un premierpoint sur ce type d’étude. Ils ne sont en rien fixés defaçon définitive et ces premières tendances restentencore à confirmer. Elles nous autorisent maintenant àregarder les terres cuites architecturales comme unbien de consommation à l’instar de la céramique, desaliments (plantes ou animaux), du métal ou encore dela pierre.
Mots-clés : tuiles, époque gallo-romaine, Orchies(Nord), groupes de pâtes, estampilles, diffusion.
BibliographieAuteur ancienSTrABON : STRAbON, The Geography. VI (books XIII & XIV),Cambridge (Mass.), 1929 (réimpr. 1950). (Loeb ClassicalLibrary) Texte édité et traduit en anglais par Jones H. L.Auteurs modernesAdAmS et alii 1994 : ADAMS A. E., MACkENzIE W. S.,GUILFORD C., Atlas des roches sédimentaires, Paris, 1994,104 p.AdriAN 2005 : ADRIAN y.-M., « Les Ventes », BSR Haute-Normandie, 2005, p. 38-39.BieveLeT 1952 : bIEVELET H., « Notes sur les marques de bri-quetiers gallo-romains communes à bavai et au Namurois »,dans COURTOy F., Études d’histoire et d’archéologie namu-
262 GUILLAUME LEbRUN, GILLES FRONTEAU
51. — PEACOCk 1977, p. 238, 245-246. 52. — RICO 2000, p. 178-192.
roises dédiées à F. Courtoy, Namur, 1952, p. 57. (Publicationextraordinaire de la Société archéologique de Namur)BOuifLANe 2008 : bOUIFLANE M., Cartographie aéromagné-tique et magnétique multi-échelles : étude structurale d’unerégion du fossé rhénan, Strasbourg, 2008, 206 p. (Thèse dedoctorat, EOST – Strasbourg I)BruLeT 2008 : bRULET R., Les Romains en Wallonie,bruxelles, 2008, p. 406-407.CArON, mONChy 1991 : CARON b., MONCHy E., « Une marquesur tuile découverte à Rouvroy », Gauheria, 23, 1991, p. 13.Cdmh 1979 : Dictionnaire historique et archéologique duPas-de-Calais : arrondissement d’Arras, 2, bruxelles, 1979,p. 324. (Commission départementale des MonumentsHistoriques)CeNSe et alii 2009 : CENSE D. avec la coll. de FLORENT G. etOUESLATI T., « L’habitat rural du Ve s. av. J.-C. au IIe s. ap. J.-C.à Marcq-en-baroeul, “Le Cheval blanc” (Nord) », Revue duNord. Archéologie de la Picardie et du Nord de la France,2009, 91, 383, p. 75-153.CLemeNT 2009 : CLEMENT b., « Nouvelles données sur lestuiles de couverture en Gaule du Centre-Est, de la fin de larépublique au IIIe siècle : typologie et chronologie », dansSociété française d’étude de la céramique antique en Gaule,Actes du congrès de Colmar, 21-24 mai 2009, Marseille, 2009,p. 611-636.COmpAgNON 1996 : COMPAGNON E., Douai (59) « Rue Saint-Benoît », Douai, 1996. (DFS inédit, SRA Nord Pas-de-Calais)COuLThArd 1999 : COULTHARD N., « Les activités artisanalesgallo-romaines à Touffréville (Calvados, France), et quelquesréflexions sur leur importance dans le développement du site »,dans POLFER M., Artisanat et productions artisanales en milieurural dans les provinces du nord-ouest de l’Empire romain,Montagnac, 1999, p. 165-183. (Monographies Instrumentum,9)dArviLL 1979 : DARVILL T., « A Petrological Study of LHS andTPF Stamped Tiles from the Cotswold Region », dansMCWHIRR A., Roman brick and tile : Studies in Manufacture,Distribution and Use int he Western Empire, 1979, p. 310-348.(bAR International Series, 68)dArviLL, mCWhirr 1984 : DARVILL T., MCWHIRR A., « brickand Tile Production in Roman britain : Models of EconomicOrganisation », World Archaeology, 15, 3, 1984, p. 239-261.deLmAire 1994 : DELMAIRE R., Le Pas-de-Calais, Paris,1994, 608 p. (Carte Archéologique de la Gaule, 62)deLmAire, deLmAire 1990 : DELMAIRE b., DELMAIRE R.,« Les limites de la cité des Atrébates (nouvelle approche d’unvieux problème) », Revue du Nord, 72 (288), 1990, p. 697-735.deLmAire, NOTTe 1996 : DELMAIRE R., NOTTE L., Trouvaillesarchéologiques dans la région de Bapaume. Prospections etfouilles d’Edmond Fontaine (1926-1987), Arras, 1996, p. 64-66.demOLON 2010 : DEMOLON P., Archéologie en Douaisis,Douai, 2010, 197 p.de pOOrTer, CLAeyS 1989 : DE POORTER A., CLAEyS P.-J., Lessigles sur matériaux de construction romains en terre cuite enBelgique, Louvain, 1989, 300 p.derkS 2011 : DERkS T., « Town-country dynamics in RomanGaul. The epigraphy of the ruling elite », dans ROyMANS N.,DERkS T., Villa Landscapes in the Roman North, Amsterdam,2011, p. 107-133.deru 1996 : DERU X., La céramique belge dans le nord de laGaule. Caractérisation, Chronologie, Phénomène Culturels etEconomiques, Louvain-la-Neuve, 1996, 463 p.
deru et alii 2012 : DERU X., SÉVERIN C., LOUIS E.,« Introduction à l’occupation romaine dans le Douaisis », dansLEROy-LANGELLIN E., WILLOT J.-M. (éd.), Du Néolithique auxTemps modernes. 40 ans d’archéologie territoriale. Mélangesofferts à Pierre Demolon, 2012, p. 111-124. (Revue du Nord-Archéologie, hors série 17).deSChOdT 2009 : DESCHODT L., « Quelques exemples demodifications du tracé des rivières dans le Nord de la France »,dans bECk C., GUIzARD-DUCHAMP F., HEUDE J., Lit mineur, litmajeur, lit voyageur : mémoires et cours d’eau, 2009, p. 19-28(Revue du Nord-Archéologie, hors série 14).fLOreNT 2007 : FLORENT G., La céramique gallo-romaine dela rue Maucroix à Reims (Marne), Villeneuve-d’Ascq, 2007,p. 31-32. (Mémoire de Master 2, Université Lille 3)fOurrier 1992 : FOURRIER H., « Données nouvelles sur lesformations superficielles de la plaine de la Scarpe et de ses bor-dures (Nord de la France) », Hommes et Terres du Nord, 1992,p. 206-216.gOuLpeAu 1988 : GOULPEAU L., « Introduction à une étudemétrologique des tuiles et briques gallo-romaines », Revuearchéologique de l’Ouest, 5, 1988, p. 97-107.guBeLLiNi et alii 2009 : GUbELLINI L, LOCATELLI C., POURIELR., POUSSET D., « La construction des puits sur quatre sites dela vallée de la Marque (Nord) : Marcq-en-barœul, Mérignies 1et 2 et Marquette-lez-Lille », Revue du Nord. Archéologie de laPicardie et du Nord de la France, 91, 383, 2009, p. 155-180.heLeN 1975 : HELEN T., Organization of roman brick produc-tion in the first and second centuries A.D., Helsinki, 1975,154p.hOëT-vAN CAuWeNBerghe 2013 : HOëT-VAN CAUWENbERGHEC., « Supports d’écriture et gestion de production au quotidiendans le Nord de la Gaule (Nerviens, Atrébates) : estampilles etgraffiti sur briques et sur tuiles », Gallia, 70 (2), 2013, p. 295-313.JACqueS, JeLSki 1984 : JACQUES A., JELSkI G., « Arrasantique : bilan et perspectives », Revue archéologique dePicardie, 3-4, 1984, p. 113-137.JeLSki 1972 : JELSkI G., « biache-Saint-Vaast », Bulletin de laCommission des Monuments Historiques du Pas-de-Calais, 9,2, 1972, p. 139-140.LeBruN 2011 : LEbRUN G., Les ateliers de tuilier de la régiond’Orchies à l’époque gallo-romaine : approches multi-sca-laires, Villeneuve-d’Ascq, 2011, 2 vol., 203 p. (Mémoire demaster 2, Université de Lille 3)LeBruN et alii 2012 : LEbRUN G., MUNSCHy M., NODOT E.,LOUIS E., « Les ateliers de tuilier de nord de la Gaule : étude decas de la région d’Orchies (59) », dans LEROy-LANGELLIN E.,WILLOT J.-M. (éd.), Du Néolithique aux Temps modernes. 40ans d’archéologie territoriale. Mélanges offerts à PierreDemolon, 2012, p. 191-205. (Revue du Nord-Archéologie, horssérie 17).Le Ny 1992 : LE Ny F., La production des matériaux deconstruction en terre cuite en Gaule romaine, Rennes, 1992, 4vol., 623 p. (Thèse de doctorat, Université de Rennes I)Le Ny 1993 : LE Ny F., (dir.), Un atelier gallo-romain de pro-ductions céramiques à Tresse (Ille-et-Vilaine). Synthèse dequatre années de recherches 1986-1989, Saint-Malo, 1993, 182p. (Les dossiers du centre régional d’archéologie d’Alet, sup-plément, P)Le rOux 1999 : LE ROUX P., « briques et tuiles militaires dansla péninsule ibérique : problèmes de production et de diffu-sion », El ladrillo y sus derivados en la época romana.Monografías de Arquitectura Romana, 4, 1999, p. 111-123.
DIFFUSION DES TUILES DANS LE NORD DE LA GAULE : LE CAS DE LA RÉGION D’ORCHIES (NORD) 263
LOuiS 1990 : LOUIS E., « L’alimentation de Douai en eau, auMoyen Âge », dans DEMOLON P., HALbOUT H., LOUIS E.,LOUIS-VANbAUCE M., Douai, cité médiévale, bilan d’archéolo-gie et d’histoire, Douai, 1990, p. 1-7. (ArchaeologiaDouacensis, 3)LOuiS 2009 : LOUIS E., « Douai et les contournements de laScarpe IXe-XIe s. », dans bECk C., GUIzARD-DUCHAMP F.,HEUDE J., Lit mineur, lit majeur, lit voyageur : mémoires etcours d’eau, Villeneuve-d’Ascq, 2009, p. 81-100. (Revue duNord-Archéologie, hors série 14).LOuiS, ThuiLLier 2007 : LOUIS E., THUILLIER F., « La bassevallée de la Scarpe : une région de production de terres cuitesarchitecturales en Gaule romaine », Revue du Nord.Archéologie de la Picardie et du Nord de la France, 89 (373),2007, p. 131-140.mACheLArT 1982 : MACHELART I., Topographie historique deCambrai des origines à la fin du Ixe siècle. Etat des connais-sances, Villeneuve-d’Ascq, p. 34, pl. 20. (Maîtrise, Universitéde Lille 3)mANiez 2007 : MANIEz J., « Orchies, zAC de la CarrièreDorée », Rapport de Diagnostic, Direction de l’ArchéologiePréventive Communauté d’Agglomération du Douaisis,mai 2007, 251 p. (disponible sur http://www.douaisis-agglo.com/rubriques.php?nID=66&e=10&cad=ENTREPREN-DRE-L-archeologie-Presentation-du-service).mArCOuLT 1999 : MARCOULT F., « L’atelier de tuilier desSavins », dans POLFER M. (dir.), Artisanat et productions arti-sanales en milieu rural dans les provinces nord-ouest del’Empire romain, Actes du colloque d’Erpeldange, 4 et 5 mars1999, Montagnac, 1999, p. 86-93. (MonographiesInstrumentum, 9)mCWhirr, viNer 1978 : MCWHIRR A., VINER D., « TheProduction and Distribution of Tiles in Roman britain withParticular Reference to the Cirencester Region », Britannia, 9,1978, p. 359-377.muNSChy et alii 2007 : MUNSCHy M., bOULANGER D., ULRICHP., bOUIFLANE M., « Magnetic cartography for UXO detectionand characterization : use of multi-sensor Fluxgate 3-axismagnetometers and methods of interpretation », Journal ofApplied Geophysics, 61, 3-4, 2007, p. 168-183.OuzOuLiAS 2010 : OUzOULIAS P., « Les campagnes gallo-romaines : quelle place pour la villa ? », dans OUzOULIAS P.,TRANOy L. (dir.), Comment les Gaules devinrent romaines,Paris, 2010, p. 189-210. peACOCk 1977 : PEACOCk D.P.S., « bricks and Tiles of theClassis britannica : Petrology and Origin », Britannia, 8, 1977,p. 235-248.riCO 1993 : RICO C., « Production et diffusion des matériauxde construction en terre cuite dans le monde romain : l’exemple
de la Tarraconnaise d’après l’épigraphie », Mélanges de laCasa de Velázquez, 29 (1), 1993, p. 51-86.riCO 2000 : RICO C., « La production de briques et de tuilesdans la province romaine de bétique. L’exemple de la vallée duGuadalquivir », dans bOUCHERON P. et alii, La brique antiqueet médiévale : production et commercialisation d’un matériau,Actes du Colloque international organisé par le Centre d’his-toire urbaine de l’École normale supérieure deFontenay/Saint-Cloud et l’École française de Rome, Saint-Cloud, 16-18 novembre 1995, Rome, Paris, 2000, p. 178-192.rOuTier, reviLLON 2007 : ROUTIER J.-C., RÉVILLION S., « Lesite gallo-romain des “Trentes” à Attin (Pas-de-Calais) : uneoccupation du bas-Empire en vallée de Canche », Revue duNord. Archéologie de la Picardie et du Nord de la France, 89(373), 2007, p. 89-100.SeveriN 2006 : SEVERIN C., Hordain, « La fosse à loups »,Douai, 2006, 163 p. (Rapport final d’opération, SRA Nord-Pas-de-Calais)SeveriN, mANiez 2007 : SEVERIN C., MANIEz J., Orchies (59)« ZAC de la Carrière Dorée », Douai, 2007, 251 p. (Rapportfinal d’opération, SRA Nord-Pas-de-Calais)STOffeL 2009 : STOFFEL L., « La tuilerie gallo-romaine deHiereboesch à Capellen (Luxembourg) », dans Société fran-çaise d’étude de la céramique antique en Gaule, Actes ducongrès de Colmar, 21-24 mai 2009, Marseille, 2009, p. 239-244.TALBerT 2000 : TALbERT R. J. A. (éd.), Barrington atlas of theGreek and Roman world, Oxford, 2000.ThÉBerT 2000 : THÉbERT y., « Transport à grande distance etmagasinage de briques dans l’empire romain. Quelquesremarques sur les relations entre production et consomma-tion », dans bOUCHERON P. et alii (dir.), La brique antique etmédiévale : production et commercialisation d’un matériau,Actes du colloque international organisé par le Centre d’his-toire urbaine de l’École normale supérieure deFontenay/Saint-Cloud et l’École française de Rome, Saint-Cloud, 16-18 novembre 1995, Rome, Paris, 2000, p. 341-356.ThuiLLier 2003 : THUILLIER F., Les ateliers céramiquesd’époque gallo-romaine dans le nord de la Gaule : organisa-tion et typologie des structures de production, Tours, 2003, 14vol. (Thèse de doctorat, Université de Tours)vergNe et alii 2009 : VERGNE V., DELANGUE b., DELIGNE C.,« Approche géohistorique des paysages d’eau en Scarpe-Escaut du XIIe au XXIe siècle », dans bECk C., GUIzARD-DUCHAMP F., HEUDE J., Lit mineur, lit majeur, lit voyageur :mémoires et cours d’eau, Villeneuve-d’Ascq, 2009, p. 207-211.(Revue du Nord-Archéologie, hors série 14)
264 GUILLAUME LEbRUN, GILLES FRONTEAU
Sommaire
Préface Michel Reddé 9Xavier Deru,
Discussion préalable autour du concept de consommation. Ricardo González Villaescusa 13
Se nourrirL’essor des blés nus en France septentrionale : Véronique Zech-Matterne,systèmes de culture et commerce céréalier autour de Julian Wiethold et Bénédicte Pradatla conquête césarienne et dans les siècles qui suivent. avec la coll. de Françoise Toulemonde 23Mouture de subsistance, d’appoint et artisanat alimentairede rendement. Les meules gallo-romaines entre villeset campagnes dans le nord de la Gaule. Paul Picavet 51Le matériel de mouture des habitats du Pôle d’activités Alexandre Audebert,du Griffon, à Barenton-Bugny et Laon (Aisne). Vincent Le Quellec 67Les meules rotatives en territoire carnute : provenances et consommation. Boris Robin 85La consommation des poissons en France du nord àla période romaine. Marqueur socio-culturel et Benoît Clavel etartefacts taphonomiques. Sébastien Lepetz 93Coquillages des villes et coquillages des champs :une enquête en cours. Anne Bardot-Cambot 109La consommation des ressources animales en milieu rural :quels indices pour quelle caractérisation de cet espacesocio-économique ? Tarek Oueslati 121Caractérisation de la consommation d’origine animale et Sophie Lefebvre,végétale dans une exploitation agropastorale du début de Emmanuelle Bonnaire, Samuel Lacroixl’Antiquité à Vitry-en-Artois (Pas-de-Calais). et Oscar Reverter-Gil 129La diversité morphologique du porc en tant qu’indicateurdes mécanismes de gestion de l’élevage porcin et del’approvisionnement des villes romaines. Apport de l’analyse Tarek Oueslati,du contour des troisièmes molaires inférieures du porc. Catherine Cronier 151Une économie de marché entre la ville de Tongres etson arrière-pays ? Les exemples de la gestion des ressources animales et de l’approvisionnement en Fabienne Pigière etcéramique. Annick Lepot 155De la viande et des pots dans la proche campagne David Germinet,d’Avaricum (Bourges-Cher) : exemple de la villa Emmanuel Marot,de Lazenay et mise en perspective. Marilyne Salin 171La céramique des quatre habitats du IIIe siècle du« Pôle d’activité du Griffon » à Barenton-Bugny etLaon (Aisne). Amélie Corsiez 181La consommation alimentaire d’après la céramique enChampagne : comparaisons raisonnées entre la capitale Anne Delor-Ahü,des Rèmes et son territoire. Pierre Mathelart 193
La consommation de denrées méditerranéennes dans lesmilieux ruraux de la Cité des Tongres : le témoignage desamphores. Noémie Nicolas 219
Se logerLa circulation des terres cuites architecturales dans lesud-est de l’Entre-Sambre-et-Meuse et zones contiguës, Laurent Luppens etd’après la répartition des estampilles. Pierre Cattelain 227Diffusion des tuiles dans le nord de la Gaule : Guillaume Lebrun,le cas de la région d’Orchies (Nord). Gilles Fronteau 249
Échanger
La monétarisation des grands domaines ruraux de Gaule septentrionale : une problématique nouvelle. Jean-Marc Doyen 267La circulation monétaire dans les campagnes du Languedoc à l’époque gallo-romaine : une première approche. Marie-Laure Berdeaux-Le Brazidec 277
Guillaume Varennes, Cécile Batigne-Vallet, Christine Bonnet,François Dumoulin, Karine Giry,Colette Laroche, Odile Leblanc,Guillaume Maza, Tony Silvino et
Apports de l’ACR Céramiques de cuisine d’époque l’ensemble des collaborateurs deromaine en région Rhône-Alpes et Sud-Bourgogne à l’ACR Céramiques de cuisine d’époque la question des faciès céramiques urbains et ruraux : romaine en région Rhône-Alpes et bilan, limites et perspectives. Sud-Bourgogne 291
Consommer à l’échelle du site et de la régionMatthieu Poux avec la coll. deBenjamin Clément, Thierry Argant,Fanny Blanc, Laurent Bouby,Aline Colombier, Thibaut Debize,Arnaud Galliegue, Amaury Gilles,Lucas Guillaud, Cindy Lemaistre,Marjorie Leperlier, Gaëlle Morillon,
Produire et consommer dans l’arrière-pays colonial de Margaux Tillier, Yves-Marie ToutinLugdunum et de Vienne : étude de cas. Aurélie Tripier 323La Vulkaneifel occidentale comme lieu de consommation et de production du Ier au IVe siècle. Peter Henrich 357
Résumés (français, anglais). 365