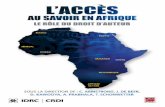Réglementer l’accès à l’eau dans l’Empire romain
Transcript of Réglementer l’accès à l’eau dans l’Empire romain
CHlprrnn 2
Réglementer I'accès à I'eau dans l'Empire romainr
Marguerite RoNrr.r
Docteur en histoire romaineChe rche us e en po s t - do ctorat
Exzellenzcluster 264 - Topoi, BerlinMembre associée uun 7041 ArScAn
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
L'existence d'une réglementation de I'eau peut tout d,abord être liéeà la nécessité d'une gestion collective de la concurrence. Dans certainsmilieux naturels, les difficultés d'accès aux sources et les faibles quan-tités disponibles s'ajoutent à la nature fluctuante de l'eau et au principede l'écoulement naturel entre amont et aval. En ville, les besoins en eausont principalement liés à des usages domestiques, artisanaux, ainsi qu'àI'agrément et aux loisirs urbains. En campagne, I'exploitation des res-sources hydriques pour I'irrigation des cultures détermine directementles conditions de subsistance des communautés rurales. L'organisationcommune de l'accès à I'eau détermine donc les modalités du partage etde la répartition qui font I'objet d'une réglementation. L'Empire romainoffre un champ d'étude particulièrement riche dans ce domáine, en rai-son de la multiplicité des normes qu'on peut y étudier et mettre en rela-tion avec des milieux naturels et des organisations sociales très variés.
La documentation sur la réglementation de I'accès aux res-sources hydriques dans le monde romain est abondante. Elle nousest tout d'abord connue par le droit prétorien et la réflexion des juris-consultes sur le droit des servitudeJ d'eau, régissant les rapports de
]Liti.nlg": Ces disposirions furent compilées dans le Dig)ste, auvr" siècle. Un principe gén&al de liberté d'accès à l, aqua publi"o y
"rt
état des premiers résultats d'une thèse de doctorat soutenue à I'Université deIn gestion commune d.e I'eau dans le ùoit tomain, L'exemple de I'Afrique et4vant - f siècle après J.-C./, Thèse, Histoire, Université de Nantes, Université14).
3l
La police de l'eau
énonc:,.L'eau pérenne et courante' cell3 des fleuves et des rivières était
ainsi théoriquement tã**""" ¿' tous' de *ã*" que les canaux^aména-
sés pour en contrôler ;ä'' ll existe ttp"nOun' des exceptions à ce
óaractère public' pu"qJun cours d'eau pouvait être détenu par un par-
ticulief' À '''nut""'uiT
n""îäîät;tl-::: d" "uu*
stagnantes soient
considérées comrne il;tï;"-t tt 1pP.*uit
donc que les juristes romalns'
conscients¿"tunutui'";;uo""o:'i''?\iî:iÎäi#å:"#tråi:"ä;
ï',:ffi ¡ïåi'J,!J"i;r'r¡,;i*i:nr*#i**,"":,u::::;"ffi trc, tn'ui'on du perpétuel ilïï ãã'i"^t"*,ton d' extraits
;,,'J:'::ïjJåïä'tri:x,iïi"'ffi T::Trrä#:lJärt'"ï:llåiålï
mglïi::,iJf äÏlil,lJ:i'"'i'föËä;ü'*eu111eesoansI e temps ""'
ttnu""l' iî ;tì ;;t"f"it *"'i'à' ã-s les deux cas"do évaluer
dans quelle *"rur"' .åJäiffii"., u,utrii ãppiiqoe* dans I' ensemble
dumonderomain'r';ã"ài¿"tacitoyennetéiã*antàtousleshabitantslibresdesp'ouin"å'äîti'"on'lio"";';ê*àuneformed'unifor-misation qui ne ilË,tít'nä""iJ"tta; **flètt*tnt ftlite'
L'ac-
croissementu.,""lï*î"représentantsá.riotn"danslesprovinces'à partir de ta réfo#e "äJ"trit""u"
¿. öil.f¿tien, à 'a
fin du ur' siècleo
a)
Réglementer I'accès à l'eau dans l'Empire romain
put également contribuer à la diffusion du droit romain. Cette améliora-
iion ã" l'accès à lajustice des gouverneurs poussa peut-être les provin-
ciaux à se conformer aux cadres juridiques foumis par Rome, en même
temps que s'accrut le contrôle de I'action des cités, par l'administration
romãine8. Une étude de la gestion de I'eau et de ses modalités juridiques
ne peut cependant faire l'économie d'une nécessaire prise en compte des
.onditiont locales. Le contexte environnemental détermine, en effet, en
grande partie, les besoins et les contraintes des usagers, et le contexte
foütique, institutionnel et administratif permet de comprendre quelles
sont teì autorités liées à la prise de décision en matière de réglementation
de I'accès aux ressources. C'est la raison pour laquelle d'autres textes
doivent être pris en compte dans cette étude. Les statuts municipaux dont
certaines cités se dotèrent, par exemple en Bétique, pouvaient inclure des
dispositions sur I'eau. Enfin, des communautés de cultivateurs pouvaient
se doter d'une forme de réglementation destinée au partage de ressources
communes pour l' irrigation'
Cette diversité juridique en matière de gestion de l'eau s'explique
en partie par la nécessité d'adapter des normes au milieu dans lequel
elles s'appliquent. or, l'Empire romain se caractérise par une grande
variété géographique et climatique. certaines provinces connaissent
de fortes sécheresses estivales et des pluies d'hiver parfois abondantes.
Cette situation est particulièrement bien observable dans I'ensemble de
I'Afrique du Nord ãt dans la moitié sud-est de la Péninsule ibériquee. Àcette vafiabilité saisonnière, il faut ajouter I'imprévisibilité des précipita-
tions. Après un été aride, en Afrique du Nord conìme en Espagne méri-
dionale, il n'est en effet pas certain que I'hiver procure les quantités d'eau
nécessaires à reconstituer les réserves. Dans les provinces de ces deux
régions, la réglementation de l'accès à I'eau apparaît donc nécessaire en
raison d'une forte concuffence autour des ressources disponibles' Ellesfoumissent, en outre, une riche documentation : les statuts municipauxd'Irni et d'lJrso, en Bétique, mais aussi des règlements de communautéd'irrigation, à Lamasba, en Numidie, et à Agón, en Tarraconaise.
Les situations de rivalités autour des ressources hydriques étaientsans nul doute très fréquentes dans les provinces romaines d'Espagneet d'Afrique du nord. Il y a donc lieu de se demander comment, et par
8. læ pouvoir des représentants de Rome était déjà manifeste au début du l" siècle. Laconespondance de Pline le Jeune témoigne amplement des modalités du contrôle exercé par un¡eprésentant de Rome auprès des cités orientales, sous le règne de Trajan (PrrNe, Epistolae, X).9.J BsrlEMoNr Géogruphie de Ia Méditerranée. Du mythe unitaire à I'espace fragmenté,3e êd.,Paris, Armand Colin,2008, pp. 29-30.
33
La Police de l'eau
quellesmodalitésjuridiquesetinstitutionnelles,étaitréglementél'accèsà l,eau. Trois types de-systèmes normatifs semblent particulièrement
pertinents pour reponO'" fcette question : le droit des servitudes d'eau'
ãJ-ã "".":tion e ,'upftquer en milieu rural et à organiser les rapports
de voisinage, la réglementution des communautés urbaines' et celle des
communauté. o,irrigation qui, malgré rarareté des témoignages à notre
disposition, présente un "^"*pf"
original de gestion commune de l'eau'
I. Ll nÉcmnmwrATloN DE LtaccÈs À Itn¡'u PAR LE DRorr
DES SERVITT]DES
L'Ed\tdu préteur, amplement commenté et enrichi par les juriscon-
sultes romains, tire son ãrigine de la reconnaissance et de la protec-
tion juridiqu", pu, t.' tagii'ats romains' des règles traditionnelles qui
régissaient les relations d"e voisinage dans le Latium' dès les premiers
siècles de la République' notamment en matière de gestion de l'eau10'
La fixation ¿u "orpoiî'¿to'i"n'
autour du règne d'Hadrien'favorisa
pål.Uf.-"nt la dif sion de ce droit dans les provinces' où les com-
pif"ri"n, de Théodose et de Justinien' au ve et au vt" siècles' montrent
qu'ilétait sans doute devenu une source parmi d'autres du droit appli
cable1l. Il détermine, entre autres,les normes applicables-aux servitudes
prédiales, un urp""t essentiel de la réglementation de I'accès à I'eau
en milieu rural. en province, les litigãs qui pouvaient surgir dans ce
cadre devaient être rå*tu* devant la justicó du gouverneur. ces derniers
étaient souvent d,anciens préteurs, que ce soit dans les provinces impé-
riales à légat propréteo', "tt-" la Tarraconaise' ou dans les provinces
sénatoriales,.ornt'" iÁi'iqo" Proconsulaire' Quel que s:it l': type de
préture qu'ils avaient exercé, ils avaient donc une connaissance suffi-
sante du droit Prétorien'
Strictement appliqué, le droit de la propr\été ptévoit que chacun
exploite ses terres en utilisant ses ressources propres et en s'accommo-
dant des contraintes à" .o' domaine. Or ces cãntraintes, pour naturelles
qu'elles soient, pzuvent constituer de véritables obstacles au travail
ffidupréteurà.partirdestextesdtlDigeste,voiro.LrNnr-,D¿sEdictum Perpetuum. nn v'i'l'i- "'
dessen wiederh""iui"s' l-eiplig' B' Tauchnitz' 1883 ;
O. LsNer-, Essai de ,t,o'u¡'åîon' i'" íÿli p"pa"l'o"¿'l'-pi r' pt"úo' Paris' Læose' 1901'
pour des complé."ntr, uoi, ft.I"*ur, . fo*urå. ¡dditions to Lenel's Palingenesia luris Ciuilis >'
îîi'fäl"i:; :ii?:#å""e del'edito perpetuo >' Aufsties ønd Niedergang der römischen
Welt, 1980, rt, 13, PP. 62-102'
34
Réglementer l'accès à l'eau dans I'Empire romnin
agricole. Elles peuvent, en premier lieu, être causées par l'écoulementnaturel de I'eau, lié à la configuration des parcelles. ulpien précise àce propos que les fonds inférieurs, situés en aval, sont soumis à la ser-vitude perpétuelle et naturelle de recevoir I'eau qui coule des champssupérieurs, situés en amont12. selon sa taille et sa force, cet écoulementpeut alors constituer une contrainte ou un avantage, et entraîner, selonles cas, des dissensions pour conserver ou se débarrasser de cette eau.En second lieu, les parcelles ne bénéficient pas toutes des ressourceshydriques suffisantes à l'exploitation agricole. Les propriétaires sevoient alors dans l'obligation d'obtenir de l'eau en dehors de leur pro-pnété'. Les servitudes offrent donc la possibilité d'aménager le droit dela propriété, en adoucissant, lorsque cela est nécessaire (et possible), larigueur des conditions naturelles des terres. Le droit des servitudes pré-diales régit ainsi des rapports de droit privé entre des fonds servants etdes fonds dominants, c'est-à-dire entre les propriétés Qtraedia) sur les-quelles porte une charge, les fonds servants, et les propriétés auxquellesest due une charge, les fonds dominants. Les servitudes peuvent portersur des fonds bâtis (servitudes urbaines) ou sur des fonds non bâtis (ser-vitudes rurales)13. on parle, de façon générale, de << servitudes d'eau >>
pour toutes les catégories de servitudes qui permettent de se procurer oud'évacuer de l'eau. Le droit des servitudes est considéré comme déroga-toire au droit commun de la propriété, puisqu'il permet à un propriétairede bénéficier, selon des modalités conventionnelles, des avantages etdes ressources d'une parcelle qui ne lui appartient pas1a.
Les servitudes semblent avoir été des solutions précocement adop-tées par le droit romain. Les fonds privés peuvent donc être soumis àdes servitudes de sentier, de chemin, de voie (iter, actus, uia) oud'aque-duc (aquaeductus)ls. Ce dernier est identifié à une servitude de passage,puisqu'il a pour conséquence de ménager un passage pour l, eai (aquamducendi). Les servitudes prédiales ,ont run* ¿oute tãs plus anciennesqu'ait connues le droit romain. Suivant le témoignagè de Gaius, la
35
servitude de voie (uia) seruit, en effet, évoquée dans les XII Tøbles' at
uiliJ.f" avant J.-C.16. Par analogie, plusieurs auteurs en ont donc déduit
que la servitude d'aqueduc, intégrée à la même catégorie des servitudes
irédiales, était aussianciennelz- Cette hypothèse est d'ailleurs justifiée
par tes écrits des agronomes antiques' Caton l'Ancien' au ne siècle avant
J.-C., et Varron, entre le tf et le i" tiè"ltt avant J'-C'' soulignent ainsi
la nécessité, pour toute exploitation agricole, de disposer d'un accès
à I'eau18. caton rappelle d'ailleurs I'importance de se comporter en
bon voisin, c'est-à-dire de rendre des services autour de soi, et ainsi
de participer à un système d'échangesle. Plusieurs types de servitudes
sont prévùs pour assurer aux fonds ruraux un accès à l'eau. si une par-
celle ne comporte pas de ressources hydriques propres' ou si.elles sont
insuffisantes, elle peut bénéficier d'une servitude qui donne à son pro-
priétaire le droit dã conduire de I'eau depuis, ou à travers' une parcelle
voisine (seruitus aquae ductus)2o,de traverser une parcelle pour y pui
ser de l,eau (seruitus aquae haustus), et d'amener ses bêtes s'abreuver
dans une parcelle voisine (seruitus pecoris ad aquam appellendi)zl. La
fonction d" .", droits est de fournir de I'eau à une exploitation aussi
longtemps que la ressource est disponible, et aussi longtemps que le
bénéficiaire fait usage de son droit.
La servitude d'aqueduc peut aussi être assortie d'horaires ne per-
mettant au fonds dominant de faire usage de son droit qu'à certaines
périodes de lajournée. Lejuriste Paul, actifentre la fin du n'et le début
àu nr" siècle, râppelle que les conventions peuvent stipuler les périodes
de la journé" p"ìOuntl.squelles il est possible de faire usage de son
droit(nocturnae aquae I iiurnae)z2. Le contrat de servitude peut donc
expreÀsément prévóir de restreindre I'accès à I'eau pour le fonds domi-
nant, peut-être pour préserver les ressources du fonds servant' Dans
cette hypoth¿se, il tau¿rait penser que le droit des servitudes pouvait
auoi, poìr fonction de protéger un propriétaire, contraint de partager
aon "uu
avec ses voisins, d'un dessaisissement total de ses ressources'
l'Édit provincial).Water'Use in the Roman Suburbium >>, Historia,200l' 50ll'positions de différents auteurs sur I'ancienneté des servitudes
Tabtes, voir G.Fn¡¡.rctosI, Studi sulle senitù prediali'Naples'
¿àr"ná, toi uu.ri, la thèse selon laquelle I'adduction fait partie
16. Dig.8.3.8 (Gaius au livre 7 sur
l'1 . C.L B¡tlNoN, < Servitudes forn" 2, p.34. Pour un récaPitulatif des
et leur existence à l'époque des XIIE. Jovene, 196'7 , pp.25-26 (l' a:utelur
La police de I'eau
36
des plus anciennes servitudes)'
18. ClroN, Agr, I, 3 ; V¡nno¡¡, R. R., I' u, 2'
19. Cnron,Agr,w.20. Dic.8.3.33 $ 1 (Africanus au livre 9 des Questions)'
Zt. O¡à. 8.3. 1 $ 1 (Ulpien au livrc 2 des Institutions)'
ZZ. O¡s.39.3.77 præmium (Paul au livte 15 sw Plautius)
Réglementer I'accès à l'eau dans I'Empire romain
Une fois tirée du fonds servanto l'eau peut être Épatt\e entre diffé-
rents bénéficiaires. Là encore, ce partage entraîne de nécessaires amé-
nagements, notamment en ce qui concerne les horaires d'exercice des
droits de chacun. La règle générale de partage, édictée par Nératius,
consiste à établir un roulement entre les différents usagers d'une même
source23. La convention de servitude doit être établie de manière que
chacun ait son jour ou son heure pour puiser ou conduire l'eau (<< ut
diuersis diebus uel horis ducatur >, précise le juriste). Une telle orga-
nisation a bien sûr pour objectif d'éviter les conflits entre exploitants.
C'est aussi, semble-t-il, la raison pour laquelle une certaine liberté est
laissée aux propriétaires des fonds dominants dans l'organisation des
horaires de partage de I'eau24. Dans la mesure où elle n'affecte en rien
la gestion des ressources du fonds servant, la possibilité de changer les
horaires appartient entièrement aux propriétaires des fonds dominants.
Cette souplesse d'organisation qui leur est accordée par la jurisprudence
montre que le droit des servitudes d'eau, cadre juridique des relations
de voisinage, était avant tout conçu comme un instrument de régulation
de la concurrence pour la gestion et I'accès à des ressources naturelles,
ce que la liberté des bénéficiaires à organiser leurs horaires ne gênait en
rien.
Comme le montrent les textes réunis dans le Digeste, de multiples
solutions juridiques permettaient de gérer la concurrence pour l'accès
à l'eau. Le droit romain garantissait ainsi les conditions de la produc-
tion agricole et de la subsistance des agriculteurs. Les servitudes étaient
manifestement en usage dès l'époque de la Loi des XII Tables, voitebien avant. Elles ont ensuite été formalisées par le droit prétorien, dontla valeur procédurale suggère que les occasions de conflit étaient nom-breuses. Les juristes, dont les écrits ont été compilés dans le Digeste, se
sont fondés surl'Édit d.u préteur, ainsi que sur les pratiques des com-munautés rurales2s. Le droit des servitudes a donc avant tout une originecoutumière. Sa formalisation dans le droit privé et dans la jurisprudencea ensuite permis sa protection par le système juridique romain.
23, Dìp.z+. ois.25. C. J
8.3.2 $ 1
43.20.s g
B¡n¡lo¡1,
(Nératius au livre 4 des Règles).I (Julien au livre 4 tiré de Minucius).
< Servitudes forWater Use in the Roman Saå¿¿ rbium >, op. cit., pp.36-37
3'l
La police de l'eau
IL Moo¡,r,rrÉs ¡umnrQUES ET rNsrrrurroNNELLEs DE
r.t¡,ccÈs À Itnlu EN vrLLE
L'eau était indispensable, dans les villes antiques, à toute une série
d'usages domestiques et artisanaux. Le puisage et le recueil des eaux de
pluie ãans des citemes privées suffisaient généralement à répondre à ces
ùesoins. La majeure partie des habitations antiques possédaient ainsi des
citemes souterraines, alimentées par I'eau recueillie grâce aux pentes de
toit et ùl'impluuiuLø. Quelques cultures vivrières dans les jardins pou-
vaient aussi entraîner un arosage, qui ne nécessitait jamais de grandes
quantités d'eau. À ces différents usagesn les cités romaines avaient cepen-
dant ajouté I'alimentation de thermes et de fontaines, destinées à enri-
chir la parure monumentale et à accroître I'agrément de la vie urbaine.
Ainsi naquit la nécessité de recourir aux adductions, parfois sous |a forme
monumentale d' aqueducs à arches26'
Les cités peuvent prendre en charge les adductions publiques.La Lex
Flauia lrnitana et la Lex Coloniøe Genetiuae Vrsonensis, en Bétique,
disposent que la construction et la restauration des canaux d'adduction
constitueniune mission des duouiri ou des édiles27. Le texte d'Urso ne
contient pas de disposition plus précise sur la répartition des compétences
entre les deux collèges de magistrats2s. À lrni, il est spécifié que seuls les
duouiri sont responsables des travaux d'adduction, et qu'ils peuvent agir
ensemble ou séparément2e. Dans ces deux cités espagnoles, la responsa-
bilité des travaux revient donc aux magistrats. Le pouvoir de décision, en
revanche, semble appartenir à I'assemblée des décurions. Cette dernière
se prononçait à la majorité des présents, à Urso30. Les conditions de vote
étaient plus contraignantes à Irni : I'adoption d'une décision concernant
26. Des sources et des puits pouvaient, dans certains cas, pefrnettre I'alimentation des thermes
(A. Bouer, Les thermes privéi et publics en Gaule Narbonnaise, Collection de I'Ecole française
àe Rome, 320, Rome, École française de Rome,2003, pp. 190 et s.). Pour une synthèse exhaustive
sur les thermes d'Afrique, voirY. Trcnrnr, Thermes rcmains d'Afrique du Nord eî leur contexte
méditerranéen : études d.'histoire et d'archéologie, Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes
et de Rome, 315, Rome, École française de Rome,2003.
2'.7. La loi municipale de la colonie d'urso remonte au milieu du re' siècle avanf l:c. (ctt' tt'
1022= ctr,t,5439 = ctt,l,5439a= ctr,t,594;voir aussi M. H. Cuw¡ono ldir'f,Roman Statutes t'
Londres, Institute of Classical Studies - School of Advanced Study - University of London, 1996'
p, 25). Laloi du municipe d'Imi est datée de la fin du siècle suivant (¡t, 1984, 454 = m, 7986,
zlz-zzz.voir égalemeniF. L¡vseRÏ, Tabulae lrnitanøe. Municipalita e lus Romanoruø, Naples'
Casa Editrice Jovene, 1993).
28. Lex Coloniae Genetiuae Vrsonensis, r-xxw, 29-33.
29. Lex Flauia Imitana,82, tæs compétences des édiles d'trni sont énumérées ailleurs dans la
lex, au chapitre 19.
30. I¿x Coloniae Genetiuae Vrsonensis, C,3-7 .
38
Réglementer I'accès à I'equ dans I'Empire romain
une adduction publique devait réunir une majorité des deux tiers, lorsqueles trois quarts des membres étaient présents31.
L'intervention des institutions municipales, par l'intermédiaire desmagistrats ou de l'ordo, est théoriquement liée à un financement assurépar les revenus de la cité. Richard Duncan-Jones s'est cependant livré àdes calculs sur le coût des constructions publiques, qu'il a mis en rela-tion avec une estimation des revenus municipaux moyens, assez bienconnus en Afrique. Il considère qu'une cité pouvait mettre 120 à 140 anspour acquérir un équipement urbain complet32. une partie des ressourcesdes cités provenait du paiement de la summa honoraria par les magis-trats, mais Paul-Albert Février a estimé que ces sommes modiques nepouvaient servir qu'à des restaurations ou des décorations33. Le recours àdes financements privés, par le biais de l'éveryétisme, était alors crucialpour les cités. Dans ce cas, les capitaux devaient, en principe, être d'ori-gine privée. La pratique était cependant beaucoup plus nuancée et surtoutbeaucoup plus complexe34. En réalité,les sources de financement avaientde multiples origines qu'il est difficile de déterminer avec précision, d'au-tant plus dans le cas de travaux qui pouvaient s'étaler sur de nombreusesannées3s. Il faut souligner que les textes, et en paficulier la documenta-tion épigraphique, sont très loin d'apporter des certitudes sur les-quelles s'appuyer. Mireille Cébeillac-Gervasoni constate en effet qu,un
31. Lex Flauia It nitana, chapifre 83.32. R. Durc¡N-JoNrs, << Who paid for public building ? >r, Structu,.e and Scale ín the Roman
!c^ono!y, Cambridge, Cambridge Univeriity press, 199õ, pp. 177-178.33._ P-4. FÉvnr¡n, Approches du Maghreb romnin : pàirot,.r, dffirences et conflits r, Aix-e¡-Provence, Édisud, 1989, p. 200. claude Briand-ponsart incline cependant à penser que leversement de cette somme pouvait être la principale source de revenus four bon nómbre de cités(C. Bnrn¡¡o-Porusaur, <. Summa honotarii et.errour.", des cités d,Afrique >, Il capitolo delleenl,mte nelle finanze municipali in occidente ed in oriente, Actes de lá x" Rencontre franco-ttaltenne sur l'épigraphie du monde romain, Rome,27-29 mai r996, Rome, università di Roma-La
ì|pt.l*: Ecole française de Rome. 1999, p.2tT.14..surlacomplexitédeschantiersetlamultiplicitédesacteurs,danslecadredestravauxd'intérêtpublic' voir en premier lieu p.-4. FÉvnmn, A¿p roches du Maghreb rcmain : pouvoirs, différences et
L'Í{tTjj:l]--*-Provence, Édisud, 1990, p. 19, pour des réflexions générates. Voir aussi C. Sru_rou,
;ìir::::i.ï"t du chanrier à Rome ef dans le monde romain duranr la période republicaine
;;:1:t;"tPtl_: une approche juridique >, Arqueología de la construcción : la economía de
rf níilÌ;"T^"1ÌTrmale Supérieure, paris, 10-11 décembre 2009, sous la dir. de S. Cavronnem,
l:'*Í,;ilr:"å11hîtillì,lilif#::îåi:ä!1iä'J,:i::l?få,Ti:,?¡îï*," superior
;"i::"::.llions africaines permeuent, par exèmple, de meftre en évidence les différentes
f *.....,{*:i,lidåidn:ååi_ïs."1äJ"[J;"i$,äïi"¿,",}H,",2',tf !T¿i;i:^:,O. rZ¡i ='^r, ììii:':ffi "* deuxième quetques années plus rarut, en 290-293 (cn, vm,2660 =
39
La police de l'eau
particulier pouvait très bien effectuer des travaux avec des fonds munici'p**
", un *agistrat financer lui-même des travaux publics36'
Une fois acheminée en ville, l,eau pouvait être répartie à travers un
réseau public d'adduction et de distribution. L'accès aux ressources
hydriquls était alors, en partie, assuré par le puisage dans les fontaines
puutiqu.*. Bien attesté dans les sources littéraires, notamment celles qui
mettent en scène la vie domestique, les modalités juridiques de ce mode
de répartition de I'eau, en ville, ne sont en revanche pas connues pour les
p.ouirrr", d'Afrique et d'Espagne3T' Les sources évoquent davantage les
ioncessions qui pouvaient êire-faites à des particuliers, à partir du réseau
public de disìribution, La précision d'Ulpien, sur I'interdit concernant
i,eau conduite depuis un réservoir public, indique à la fois la présence
d'un réseau et I'existence d'un droit de concession'
Dìg,4S,2}.LVtpianuslibroT0adeilictum'â39'Aequissimumuisumestei quoque, qui ex castello ducit, interdictum døri' Id est ex eo receptaculo'
qròd oqro* publicam suscipit, castellum accipe'
Ulpien au livre 70 sar l'Éitít du préteur' $ 39' n a paru très juste de donner
aussi un interdit à celui qui conãuit l'eau depuis un réservoir dans lequel
tombe l'eau publique, ce qu'on appelle château d'eau'
L'aqua publicaqui est ici protégée (ex eo receptaculo, quod aquam
pubticirn suscipit)nã provient pas d,un fleuve ou d'une rivière. Elle est
dite < publique ,, car elie fait partie du patrimoine de la cité, la res publica,
qui la cèdeã un particulier. En fonction des cités, différentes autorités
åunicipales pouvaient être chargées d'attribuer les concessions. Dans la
Rome iéputiicaine, les magistrats qui avaient pour mission d'octroyer
les concãssions d'eau aux particuliers pouvaient varier38. Les édiles
et les censeurs étaient compétents en matière de travaux publics, qu'il
s,agisse de maîtrise d'ouvrage ou d'adjudication' Toutefois,les censeurs
.,eã occupuient de préférence, sans aucun doute en raison du lien étroit
entre l,accès à l'eau courante et la distinction sociale qu'acquérait ainsi
36. M. CÉs¡nl¡c-Grnv¡sottl, < Le notable local dans l'épigraphie et les sources littérarres latines
problèmes et équivoques >>,Les < Bourgeoisies , municipales italiennes awtf ette'siècles øv. J.-C"
Centre Jean Bérard, lnstitut français de Naples, 7-10 décembre 1981, sous la dir. de M. CÉs¡r-I-lc-
Gnnv¡soxr, Paris, Éditions du cxns, 1983' p' 53'
37. Horace témoigne de la dimension iociale de ces petites fontaines qui animent la vie du
quartier, où chacun peut venir fuiser de l'eau et s'informer des nouvelles i'et quodcumque semel
chøt tis inleuerit, omnis gestiet afurno redeuntis scire lacuque et pueros et anus-(A'peine [le poètel
a{-il jeté quelque nouvelle in¡ff" ,o, le papier à toute iorce il en fait part même aux vieilles
ménagères qui reviennent ¿u iour, *C,n" uuì enfants qui vont remplir l'ãmphore à la fontarne)'
Voir Honrcs., Sat., t, 4'37.38. Fnoxrn¡, De Aq.,xcv,l-2.
40
Réglementer l'accès à l'eau dans l'Empire romain
uîe domus urbaine3e. Sous I'Empire, les sources juridiques et littéraires
attestent que l'eau était concédée par l'Empereur. Cette prérogative est
observable aussi bien à Rome au t" siècle, qu'à Constantinople aux lve et
v" sièclesa0. Dans les provinces, et en particulier dans les villes d'Afriqueet d'Espagne, les conditions d'attribution des concessions d'eau sont
cependant beaucoup moins bien connues. La chancellerie impérialedevait théoriquement être tenue au courant, en dernier ressort, de toutes
les concessions. Ce principe est maintenu etrépété, du l" siècle à la fin du
v'siècleal. Toutefois, les dispositions impériales précisent que le souve-
rain déléguait en pratique à ses représentants le soin de gérer le nombre
des concessions. Au ve siècle, le préfet du prétoire fut chargé de ce soin et
non plus le gouvemeur de provincea2. Bien qu'une constitution impériale
de 517 , confirmant une décision de Théodose, datée de379-395, rappelleque la permission du prince était nécessaire, tant à Constantinople que
dans les provinces, pour octroyer une concession, cette disposition ne
semble concerner que les aqueducs financés par le pouvoir impériala3.
Autant que nous sachions, en province, les concessions octroyéesdepuis les aqueducs municipaux étaient gérées par les cités elles-mêmes.
La loi d'Urso précise que les magistrats ont le droit d'introduire cettequestion à I'ordre du jour, mais que la décision finale d'accorder uneconcession, comme en matière d'adduction publique, appartient en faità I'assemblée des décurions4. Le texte évoque les concessions d'aquacaduce, c'est-à-dire celle qui n'a pas été utilisée dans les thermes et quis'écoule des fontaines. Les concessions d'eau publique ne sont manifeste-ment pas des décisions d'importance secondaire dans I'agenda du conseilmunicipal d'Urso. En effet, le vote doit être effectué en présence de lamajorité des décurions. Cette mesure avait pour but de conférer la plusgrande légitimité possible à ce type de décision, puisque la responsabilitéde son adoption pesait sur une large partie des notables.
39,. Sur I'eau courante comme privilège des demeures aristocratiques, et expression d'uneprééminence sociale. voir C. BnuuN, Thi Water Supply of Ancient Rome : a Study of Romnntmpe_riol Administrarlon, Helsinki, The Finnish Society of Sciences and Letters, 1991, pp.77 -87 ;A' Wrso¡r, < Running Water and Social Status in North Africa >, North Africa frorn Antiquity'2-".'or: sous la dir. de M. HonroN et T. Wm¡¡rr¡¡r¡N, Bristol, Centre for Mediterranean Studies,
::lj:"f":theStudyof theReceptionof ClassicalAntiquity, 1995,pp.52-56;H.Dsss¡r-¡s, 12p:X:!:!, I'eau : fontaines et diitribution hydrøulique ãoni I'hob¡tot urbain de I,Italie romaine,
;ðiÏ:ilÌt;ii;åÉcoles Françaises d'Athènes et de Rome, 351, Rome, licole rrançaise de Rome,
1?. li:-:1,?.Aq.,rxxxv'o, z;c.rh.,15.2.6:c.rh.,15.2.2:c. J.,n.43.5,C, J.,n.43.6.;;. "i.t;|i¡'i;ts$ 4l-42 (ulpien au tivre'70 sur L'Édiù.
13.. c.t, t1.43.11.'t+, Lex Coloniae Genetiuae,C, 9_ 16.
4l
In police de I'eau
III. Ll nÉcmMENTATroN DEs coMMuNAUTÉs utnruG¡'ttoN
Les communautés d'inigation sont un type particulier de.communau-
tés -agraires.
Leur existence ãst en effet fondée sur le partage de ressources
;;dõ;. rafes ou précieuses, et destinées aux cultures. L',eau d'irrigation
n,estpastiréed,uneoudeplusieurspropriétésprivées,maisd'unouvragehydraulique, parfois monumentat, åertainement mis en place grâce à la
pánl.rpuii"n de l'ensemble des membres de la communaute'Lepattage
del,eauestdoncaucceurdufonctionngmentdecescommunautésd'irri-gation, qui pouvaient à*. ."rtuln. cas posséder des institutions propresas.
Deux solutions sont mises en place pour pennettre à chaque membre d'ac-
céder à l'eau. Le pt";;;pü être;ff;tué en volumes' calculés à partir
de la taille ¿". .unuti.uïi*s, ou en temps d,écoulement de I'eau. Dans les
deux cas, des règles pte"it"t sont déterminées par la communauté'
LaTable de Lamasba,tê'digée entre 218 et222 en Numidie' four-
nit l'exemple le plus complet s-ur le partage de I'eau e-l temq.s d'écou-
lementao. Chaque profJäuir" ,.""niit ta totatité de I'eau disponible
dans le système pendant un laps de temps et selon un ordre déterminé
à l'avance pæ la.o,t onuutá L'inscrþtion se présente sous la forme
d'une liste qui comp.eø' foo' chucun'.ia date et l'lreyrl à laquelle doit
débuter l'approvisioìn.ttnt, et récapitule le total du temps d'iniga-
tion octroyé47' I1 s'agit, dans cette communauté' d'un arrosage hivemal'
vraisemblablement ãår,in¿ à remédier à une irrégularité du régime des
prJcipitations qui peut compromettre la levée des semailles d'automne'
La liste des irrigateurs suiì un ordre chronologique et les fragments
retrouvéspennettentdeconnaîtrelarépartitiondel'eaudu25septembre(vtt Kalendas Octo'bres)au 4 décembte (¡tridie Nonas Decembres)
g'
t
45. C'estPeut-être le cas de la communauté des irrigateurs du canal de l'Èbre, c onnte pæ la kx Riui
Híberiensis (tn't993' ro43=HEp5(1995), 911 =.q¿,2006'6'16). Le texte mentionnew concilium'
assemblée qui Pouvait réunir les inigateurs. Toutefois ce règlement ne traite Pas exPlicitement des
conditions de l'accès à l'eau par le biais d'un Patage des ressources (sur ce texte, voir en Premier
lieu F. BelrnÁll Llonrs, < An hrigation Decree ftom Roman Spain : the I'ex Rivi Hiberiensis >, ns'
'^T.','!"t*rY;ÅT:',:), r*'18587 = D. s?e3 B' D' SH¡w' < Lamasba : an Ancient lrrigation
ðitt*""i v t' ¿ ntiquités Africaines' 7982' n' 18' pp' 61-103'
47. Lepremierno-upp*rrr"uîïr"îf"ii*ru*iui¿"tttuttiu.¡ottis,<depuislapremièreheuredujour, le septième3ooruu*tt"' JJertes àùto¡'e' jusqu'àlacinquièmeheweet demie le mêmejour
Pour sa parcelle, un totut o" q"i;î"o""tt ¿"*" ' (Maníus iortß K(---) cccwtt' ex h(oru) t d(iei)
vu Kal(endas) octobr(es), tu hî;;;;;;;õ**) d(¡'i) '¡u'd'*t'
P(ro) p(arte) s(ua) h(oraÐ m s(emß))'
48. sur 'a
reconstit",io" i"'î*t"'-'náqoun'"' tt t'"titíi* des dimensions totales de
l,inscription, voir B. D. S**-, "îu-ur¡u , * ¡n"i"nt lrrieation community >, op. cit., p' 96 :
M. D¡srooun, " t-e proutemå;;î;;;¿-t une cité-deïumidie :l'inscription hydraulique
de "Lamasba" ,r, (Jrbanismîeä*""1t'¡"" en Numidie mílitaire' Actes du colloque des 7 et
8 mars 2008, sous la dir. ¿'e' ðoãtiot""nr' Paris' De Boccæd' 2009' pp 156-15'7 '
42
Réglementer l'accès à l'eau dans l'Empire romain
Durant cette période, le texte ne mentionne qu'un tour d'irrigation
unique pour chaque parcelle. cette parcimonie fait penser que les res-
souic.s en eau de cette plaine pré-désertique aride devaient être par-
ticulièrement rafes. Elles faisaient donc I'objet d'une scrupuleuse
répartition, ce qui mena à la rédaction de ce texteae. Il faut souligner
qul t. fonctionnement des communautés d'irrigation était en général
irès probablement coutumier. La rédaction d'un texte aussi précis que la
Table de Lamasbaétait donc, somme toute, exceptionnelle et avait sans
doute pour but de clarifier les droits de chacun et de les rendre oppo-
sables à I'ensemble de la communauté.
Il n'existe pas, à notre connaissance, de textes évoquant un système
fondé exclusivement sur la répartition en volumes d'eau. En revanche,
un plan de marbre de Tivoli, datant du Haut-Empire, présente un
exemple explicite, quoique fragmentaire, du mélange entre paftage en
temps et partage en volumessO. La mesure du volume y est d'abord cal-
culée d'après le nombre des ouvertures et la taille des conduits. Ensuite
apparaît la mesure en temps d'irrigation, calculé en heures. Le temps
..i Oé.o-posé en heures du jour et de la nuit, exactement de la même
façon qu'à Lamasba. Quel que fût le mode de répartition de I'eau adopté
par les communautés d'irrigateurs, les documents écrits révèlent tou-jours l'existence de calculs précis, certainement destinés à prévenir les
conflits et les contestations qui pourraient naître du fonctionnement
quotidien de la communauté.
La superficie des parcelles à irriguer semble avoir constitué un élé-
ment déterminant dans |e calcul des quantités d'eau attribuables à cha-
cun. Chaque entrée de la liste de Lamasba comporte un chiffre expriméen k(---), accompagné d'un temps d'irrigation exprimé en heures et
demi-heures. La plus petite propriété reçoit une demi-heure d'ano-sage pour une parcelle évaluée entre 30 et 5O k(-'-), et la plus grande,
71 heures et demie d'arrosage pour 4 000 k(---). Bien que personne'jusqu'à aujourd'hui, n'ait établi de façon certaine ce que signifie cetteabréviation, l'opinion la plus communément admise est, en fait, quek(---) exprimerait la superficie des parcelles, sans que cela permettetoutefois de déterminer la valeur de l'unités1. Cette hypothèse pour-
43
La police de l'eau
rait toutefois être étayée par un rescrit des empereurs Marc Aurèle et
Lucius Verus, ¿ut¿ ¿ïìär ' Ce texte dispose que " 1'eau d'un fleuve
i'uii, 0" " "1 ::î: j *î::: ;:m; ; i:'î: -i:îi îï"ï:ä,ä' J i;
:'å""i J ffi i iÏ i ä':i';'ä ii'* äI ù::nï ;lî å1ff ï de 1' e au
ãst bien conditionné par la taille des pu'ätt"t à irriguer Qtro modo
oossessionvtm)' Mais \t aeÉ'proposé qo" it type de culture'pratiqué
sur chaque pu'""tt"'poittt cä" i"it t1 ton'iäètution dans le calcul
des volumes d,eau. dun* ." "u., i. texte viserait à proportionner I'eau
distribuée uu* U"..íJTJ;;; des cultures (nisi proprio iure quts
11^ t¡U¡ d'atum ostenderit)s3'
L'objectif des communautés d'inigation est de tirer le meilleur parti
possible d","*tot""ål'* "uo destinées aux cultures' tout en garantis-
sant une ,¿pu.nron?jiïriurå" "n*" t"s-ãimotents membres' L'équi-
libre du partùge'"pot" *u' la prise 'n
to*pt" de la taille des parcelles'
et peut-être des cultures p'utqué"t' ce qui indique bien la préoccupa-
tion essenti"["*""ä!trã"i" ä" ce mode de partage de I'eau'
i<
L'accès à l'eau est plus ou moins précisément réglementé' selon
les situations étudiees'vit "ttt"' ns åispositions juridiques portent
principalem"n' t"'.ru "ít" Ln ïrut" d'adductions publiques' or' si
l'intervention des '*t*;Jns'municipates est bien prévue par les
textes, dans la p'"ti;";';; revanche' o^n constate que de multiples
acteurs pouvaient intä'utni'' selon des modalités qui ne sont pas tou-
jours bien connues' L effort important que devaient fournir les cités
dans ce tvpe d'entr#;;;l;i*;::li:t contribution des notables
öi";'#':ryïi:::ui**l-;"*i'ijåî:";ïi::'.îïå'#:l,î"::iî::[ff :Ji:::'#:""'i:ffi i":::k*:*¿;lî#ìJ:réseaupublic, semblent uuoJete entièrement réglementées par les statuts
Pæis, 1902, P, 456)'
44
Réglententer l'accès à l'eau dans I'Empire romain
municipaux. En milieu rural, l'étude des conventions de droit privé,
qui organisent les servitudes, et des réglementations collectives des
"or¡r¡unuutés d'irrigation montrent que deux systèmes pouvaient être
mis en place et parfois fusionner : la répartition en temps d'alimenta-
tion ou en volumes. Dans les deux cas, la réglementation de I'accès
à I'eau a pour but de garantir I'approvisionnement à des cultivateurs
dont la subsistance pouvait dépendre de I'irrigation.
45