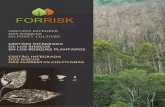Litus maris: definition et controverses, in Riparia, un patrimoine culturel. La gestion intégrée...
Transcript of Litus maris: definition et controverses, in Riparia, un patrimoine culturel. La gestion intégrée...
Riparia,un patrimoine culturel
La gestion intégrée des bords de l’eau
Proceedings of the Sudbury Workshop, April 12–14, 2012 / Actes de l’atelier Savoirs et pratiques de gestion intégrée des
bords de l’eau – Riparia, Sudbury, 12 –14 avril 2012
Sous la direction de
Ella HermonAnne Watelet
Préface deHenri Décamps
BAR International Series 25872014
Published by
ArchaeopressPublishers of British Archaeological ReportsGordon House276 Banbury RoadOxford OX2 [email protected]
BAR S2587
Riparia, un patrimoine culturel: La gestion intégrée des bords de l’eau. Proceedings of the Sudbury Workshop, April 12–14, 2012 / Actes de l’atelier Savoirs et pratiques de gestion intégrée des bords de l’eau – Riparia, Sudbury, 12–14 avril 2012
© Archaeopress and the individual authors 2014
ISBN 978 1 4073 1215 6
Cover illustration: Port antique de Milet, en Turquie. Photographie de Anne Watelet
Printed in England by Information Press, Oxford
All BAR titles are available from:
Hadrian Books Ltd122 Banbury RoadOxfordOX2 7BPEnglandwww.hadrianbooks.co.uk
The current BAR catalogue with details of all titles in print, prices and means of payment is available free from Hadrian Books or may be downloaded from www.archaeopress.com
233
LITUS MARIS : DEFINITION ET CONTROVERSES
1
Carla MASI DORIA Università di Napoli Federico II, Italia
Résumé Le bord de mer est un lieu hybride, entre l’eau et la terre, dont la définition est difficile, floue. Qu’est le bord de mer et, quelle est sa taille, ce sont des questions qui nécessitent le recours à des savoirs multiples, qui vont des sciences naturelles aux sciences juridiques. C’est l’un des cas dans lesquels la nature détermine fortement le choix du droit. Le problème de la définition du bord de mer est très ancien et dépend, en substance, de la différence de régime – en droit romain et dans la tradition romanistique – qui est attribué à la mer et à la terre. Mais où finit la mer ? Où commence la terre ? C’est la question qui est posée à la nature dans le cadre du litus. Interroger l’histoire du droit et le droit romain sur cette question, signifie de remonter aux origines des systèmes juridiques de droit civil. Il ne s’agit pas ici de tracer une ligne simpliste entre l’antiquité et la modernité, mais de comprendre en profondeur la construction d’un système juridique qui cherche l’équilibre entre la nature et l’humanité par des règles de droit. La question des controverses sur la nature juridique (publique) du littoral (litus), cet environnement qui possède les caractéristiques propres des riparia, est au cœur de cette communication. Ce problème est abordé à partir de la définition du juriste républicain Aquilius Gallus (rapportée par Cic. top. 7.32), et du jugement arbitral de Cicéron, le point de référence de la tradition de la jurisprudence jusqu’à la compilation de Justinien qui l’a accueillie à travers les Digesta de Celse (D 50.16.96, Cels. 25 dig.). Il est intéressant de souligner à cet effet que la conception naturaliste du litus, qui se prolonge jusqu’à l’endroit où aboutit le fluctus maximus des vagues de la mer, oriente la réflexion juridique. Ce mouvement des flots crée ainsi un environnement (aussi important économiquement) qui n’est plus la mer (res communis omnium, bien commun de tous et non soumis aux critères de propriété), mais qui n’est pas encore un territoire ouvert à la stricte appropriation (dominium) des personnes privées. Le cas des maisonnettes des pêcheurs constitue le témoignage très important d’une spécificité juridique du droit romain : une sorte de propriété temporaire, conçue seulement à partir de sa fonction économique provisoire. Abstract The seashore, the somewhat fluid space between land and sea, is a hybrid area. Indeed, its definition isn’t easy. What is the seashore, and how far does it extend? These are questions requiring a comprehensive knowledge, from natural sciences to jurisprudence and law rules. Here we have a typical case of nature’s influence on legal choices. The problem of defining the seashore is very old (from ancient Roman law to Roman legal tradition in medieval and modern times) and it depends on the differences attributed to sea and land. But where does the sea end? Where does the land begin? These are the appropriate questions to ask in order to establish the definition the litus (Latin term for seashore). Legal history (and Roman law especially) is a means of answering the question by going to the very beginning of the problem in the civil law systems. The research shouldn’t be a simple line from the past to the present, but should offer a deep understanding of the building strategies of a juridical system, through history, a system in search of the balance of nature-orientation and the humanity of legal rules. The problem of the juridical definition of seashore (considered as a public space), an environment with the characteristics of riparia, is the very centre of this paper. The starting-points are the definition proposed by the republican jurist Aquilius Gallus (reference in Cic. top. 7.32) and an arbitration of Cicero, reported as central in a tradition that reaches the Justinian era, such as reported in the Digesta of Celsus and then in the Corpus iuris civilis (D 50.16.96, Cels. 25 dig.). It is very interesting to highlight the naturalistic conception of seashore as high-water mark, meaning the highest line reached by the water of the sea, influences the juridical work and opinions: the principle for the definition comes from natural circumstances. The storm and wave movements also define an environment, which is very important for the economy. This environment is not sea (a res communis omnium, a common wealth, not an ownership in the sense of private law), but also not proper land capable of being submitted to a typical dominium right. The juridical speciality of the seashore in Roman law is well shown by the case of fishermen’s little buildings: a sort of temporary ownership functionally oriented. Mots-clés : Droit romain, bord de mer, juristes romain, Digeste de Justinien, propriété. Keywords: Roman law, seashore, Roman jurists, Justinian’s Digest, ownership.
* * *
1 Je remercie de tout cœur l’ami et collègue Jean-François Gerkens, de l’Université de Liège, pour l’aide apportée à l’établissement de la version
française du texte.
RIPARIA, UN PATRIMOINE CULTUREL
234
Le bord de mer est un lieu hybride, entre l’eau et la terre, dont la définition est difficile, floue. Qu’est le bord de mer, quelle est sa taille, sont des questions qui nécessitent le recours à des savoirs multiples, qui vont des sciences naturelles aux sciences juridiques. Mieux : C’est l’un des cas dans lesquels la nature détermine fortement le choix du droit. Le problème de la définition juridique du bord de mer2 est très ancien et dépend, en substance, de la différence de régime – je parle ici du régime en droit romain et dans la tradition romanistique – qui est attribué à la mer et à la terre3. Alors que la terre peut généralement faire l’objet d’une occupation et peut donc être appropriée par des particuliers, la mer est considérée comme n’étant pas susceptible d’acquisition ni sur le plan de la possession ni sur celui de la propriété. La mer, dans le système descriptif que nous en donnent les juristes romains (et je le dis en termes très généraux et qui ne font pas difficulté ici4) est une res communis omnium, chose commune à tous, dont chacun peut faire usage. Mais où finit la mer ? Où commence la terre ? C’est la question qui est posée à la nature dans le cadre du litus5. Interroger l’histoire du droit et le droit romain sur cette question, signifie remonter aux origines des systèmes juridiques de droit civil. Il ne s’agit pas ici de tracer une ligne simpliste entre l’antiquité et la modernité, mais de comprendre la construction d’un système juridique qui cherche l’équilibre entre la nature et l’humanité dans les règles de droit. La sagesse lexicographique antique, synthétisée dans les Origines d’Isidore de Séville, pose le problème de la signification du litus dans une série de termes relatifs à l’eau (au rapport entre la terre et l’eau). Il aborde la question dans la section de montibus ceterisque locorum vocabulis. Les termes : Portus, baia, circumluvium, margo, maritima, Ostia, continens sont envisagés en même temps que le nôtre (litus).
2 Comme ont écrit avec raison CHARBONNEL et MORABITO, 1987, p. 24,
les rivages de la mer avaient en droit romain « un statut complexe ». 3 La bibliographie sur ces thèmes et sur les textes que j’examinerai dans
le présent travail est infinie et je ne pourrai pas tenir compte de toutes les interprétations dans le moindre détail. Je renvoie au moins à : PAMPALONI, 1892, p. 197 ss. ; SCHERILLO, 1945, p. 70 ss. (une lecture utile sur l’ouvrage de Scherillo est dans PUGLIESE, 1994, p. 182 ss. [2007, p. 783 ss.]) ; BONFANTE, 1966, p. 56 ss.; NÖRR, 1978 [2003, p. 1187 ss.]; SCARANO USSANI, 1979, p. 32 s., 122 ; CHARBONNEL et MORABITO, 1987, p. 23-44 ; SCARANO USSANI, 1989, p. 67, 123 ; IMPALLOMENI, 1990 [1996, p. 583-599] ; KASER, 1993, p. 107-112 ; GUTIERREZ-MASSON, 1993, p. 293-315 ; ANKUM, 1998, p. 361-381 ; ZOZ, 1999, p. 36 nt. 107, 50 ss., 149 nt. 471 ; HARKE, 1999, p. 41 nt. 140, 111 nt. 453; MARRONE, 2001, p. 275 ss. [2003, p. 799 ss.] ; FIORENTINI, 2003, spec. p. 427 ss. ; DE MARCO, 2004, 34 ss. ; FANIZZA, 2004, p. 14 ss. ; PARRA MARTÍN, 2005, p. 126, 129 ; SCARANO USSANI, 2008, p. 79 nt. 58.
4 Sur les diverses théories concernant les res publicae/communes, v. la très recente contribution de SCHERMAIER, 2012, p. 776 ss., 783 ss. Pour une synthèse, très utile, de la littèrature romanistique sur le thème de l’eau : SCHIAVON, 2011, p. 129 ss.
5 « In base al particolare rapporto che aveva con il mare, il litus … poteva apparire prodotto spontaneo di quell’elemento naturale, ai cui mutamenti era legata la sua stessa esistenza », ainsi SCARANO
USSANI, 1989, p. 68.
Isid. orig. 14.8.41. Litus est terra aquae et mari vicina: et dictum litus quia fluctu eliditur, vel quo aqua adluitur. Il faudra revenir plus tard à l’explication étymologique qui est développée dans la seconde partie du texte. J’ajoute cependant d’ors et déjà que pour les modernes, l’origine étymologique du terme litus est un problème non résolu6. Pour l’instant, nous pouvons réfléchir sur le cadre du lemme. Litus indique le sol, mais une terre qui est particulière, à proximité de l’eau, notamment de la mer. La proximité de la mer détermine des interprétations divergentes, réduites pour nous à la tradition glossématique, dans laquelle le litus peut devenir l’extrema pars maris (CGL IV 110.11), et étant dès lors carrément exclue de la terre. Et in litore, en raison d’une expression de Virgile, est interprété in ora maris (CGL IV 528.37)7. Le caractère problématique de ce lieu, sa nature indéterminée, double, semble évidente. Mais passons aux témoignages juridiques. Sous le titre De verborum significatione du Digeste de Justinien (D 50.16)8, spécifiquement consacré à la signification des mots, aux définitions, on peut lire une explication du terme litus, qui devait évidemment être légèrement controversé. Le juriste cité est Celse fils, éminent représentant de la dernière phase de l’école proculienne, actif à l’époque antonine et dont Justinien cite un fragment tiré du livre 25 de ses Digestes. Voici le texte : D 50.16.96 pr. (Cels. 25 dig.). Litus est, quousque maximus fluctus a mari pervenit: idque Marcum Tullium aiunt, cum arbiter esset, primum constituisse9. Le fragment peut être divisé en deux parties. La première est strictement une définition, la seconde permet d’en retracer la provenance, reportant une tradition qui remonte à Cicéron10. La formulation de la définition est assez typique, avec le definiendum au nominatif suivi de est et de l’explication. Plusieurs définitions du grand juriste proculien nous sont parvenues11. La définition est brève et élégante : quousque maximus fluctus a mari pervenit. Est litus, d’après Celse, cette partie de la terre qui effleurée par la mer, jusqu’à l’extension maximale du flux, de la vague qui de la mer touche le rivage. La deuxième partie du texte montre que
6 ERNOUT et MEILLET, 1959, p. 647 s.; WALDE et HOFMANN, 1954,
p. 815. 7 Verg. ecl. 1.60. 8 Dont traite en particulier PENTA, 1998, p. 357-389. 9 A propos de ce texte, objet d’analyses approfondies de la doctrine,
voyez : COSTA, 1927, p. 412 nt. 2 ; SCHERILLO, 1945, p. 73 s. ; LOMBARDI, 1946, p. 116 ; MARTINI, 1966, p. 99 ; ID. 1995, p. 169 ss., spécialement p. 171 ; SCARANO USSANI, 1977, p. 164 ; PLESCIA, p. 436 et nt. 34 ; CHARBONNEL et MORABITO, 1987, p. 25 et notes 6 et 7 ; PENTA, 1998, p. 382 s. ; FIORENTINI, 2003, p. 436 s. ; DE
MARCO, 2004, spécialement p. 37 s. nt. 103. 10 Cfr. ANKUM, 1998, p. 361, nt. 2 et 5 p. 376. 11 Cfr. HARKE, 1999, p. 41 et nt. 140.
C. MASI DORIA. Litus maris : définition et controverses
235
la définition de Celse est une citation. Telle qu’elle nous est parvenue (nous verrons plus tard qu’il subsiste des doutes quant à la transmission du texte), l’explication est attribuée à Cicéron (identifié par son prénom et son gentilice, Marcus Tullius), qui en aurait ainsi ‘décidé’ (on remarquera l’utilisation du verbe constituo, qui indique généralement la construction et l’introduction d’une source de droit dans le système juridique12), non dans son activité d’orateur ou dans un quelconque traité, mais dans l’exercice de sa fonction d’arbitre13, donc en tranchant une controverse. La citation semble donc faire référence à une activité orale de Cicéron. Elle semble même avoir été transmise oralement (ce qui ressort de l’utilisation de aiunt, ils disent, on dit). Celse n’aurait donc pas utilisé une œuvre de Cicéron au moment où il a incorporé l’ancienne définition dans son traité juridique, mais aurait plutôt recouru à sa mémoire (ce qui pourrait expliquer quelque imprécision ou adaptation). La définition est – en substance – très semblable à celle de Javolène Priscus14, qui appartient à la génération précédente à celle de Celse et qui adhère à l’école concurrente, l’école sabinienne. D 50.16.112 (Iav. 11 ex. Cass.). Litus publicus est eatenus, qua maxime flucts exaestuat ...15 La teneur du texte de Javolène ajoute le qualificatif publicus au litus, spécifiant le problème juridique que le rivage de la mer fait apparaître : Il s’agit d’une res publica, appartenant au peuple romain et dès lors exclue du commerce (de la même manière, Javolène nous informe également – plus loin dans le même fragment – à propos du rivage d’un lac qui pose le même problème, sauf si la totalité du lac est privée, alors le rivage appartient lui aussi au propriétaire: idem iuris est ei in lacu, nisi is totus privatus est). La partie du texte qui définit le rivage correspond au fragment de Celse/Cicéron : eatenus, qua remplace quousque (par ce que publicus est strictement lié au substantif) ; exaestuat est peut-être plus recherché (dans le sens d’‘inonder’) que le simple pervenit. L’issue de cette brève histoire de la définition peut être trouvée dans les Institutes de Justinien, le manuel élémentaire formé d’éléments classiques et d’ajouts des compilateurs, proposé aux étudiants mais aussi promulgué en tant que loi impériale en 533. Sous le titre consacré à la « division des choses », l’empereur présente les res qui en vertu du droit naturel appartiennent à tout le monde (naturali iure communia sunt omnium : I 2.1.1) et
12 Sur l’utilization dans Celsus voyez HARKE, 1999, p. 111 et nt. 453. 13 PUGLIESE, 1978, p. 198 [1985, p. 140]. 14 Cfr. ANKUM, 1998, p. 361, nt. 6 p. 376. Pour MARTINI, 1966, p. 69,
« … qui mentre si definisce cosa sia … giuridicamente il litus maris … si enuncia al tempo stesso un principio di diritto ».
15 A propos de ce texte, v. MANTHE, 1982, avec la bibliographie dans la nt. 184 à la p. 299. D’après D’IPPOLITO, 1969, 82 nt. 8, « qui Cassio dipende, evidentemente, da Aquilio Gallo le cui opere egli ben poteva conoscere direttamente o per il tramite serviano ».
les énumère : aer, aqua profluens, mare, litora maris16. C’est justement et uniquement pour le litus qu’il ressent la nécessité d’expliquer pourquoi c’est une chose commune et dont les particuliers ne peuvent dès lors pas disposer : nemo igitur ad litus maris accedere prohibetur (que l’accès au bord de mer ne soit interdit à personne). Le lien naturel rivage-mer devient fonction juridique : Puisque la mer est un bien commun, l’accès à la mer ne doit pas être interdit, donc le rivage doit être libre et à tous. Peu après il revient la définition du litus qui – cela saute aux yeux – doit beaucoup à celle qui a été transmise par Celse : I 2.1.3. Est autem litus maris, quatenus hibernus fluctus maximus excurrit. On ne trouve pas plus la qualification directe de la condition juridique du litus, mais il y a un surplus d’information de type naturaliste, au moment où l’on souligne que le fluctus maximus est celui de l’hiver, lorsque par la force du vent et des tempêtes, les vagues pénètrent plus loin sur la terre ferme. Après cette introduction – simplificatrice – on peut retourner au texte de Celse, pour en évaluer la seconde partie, c’est-à-dire la citation de Cicéron. Il faut avant tout examiner le contexte. L’arbiter auquel l’on doit la définition est un particulier chargé de trancher une controverse. La question devait relever des interdits. Selon toute probabilité, Cicéron avait été appelé à trancher sur ordre du préteur, d’un conflit relatif à quelque chose qui avait été fait sur le rivage de la mer. Aux bords de mer, l’on appliquait en effet l’interdit qui servait à l’origine à la protection des fleuves publics et de leurs rives : ne quid in flumine publico ripave eius fiat17. Cet interdit était aussi restitutoire18, c’est-à-dire que dès lors qu’il était attesté qu’une interdiction avait été violée, il fallait remettre les choses dans l’état antérieur19. Nous
16 D’après une opinion partagée par plusieurs auteurs (v. ANKUM, 1998,
nt. 7 p. 376 ; FERRINI, 1901 [1929, p. 354]), les compilateurs des Institutes de Justinien auraient repris ici une affirmation de Marcianus, cfr. D 1.8.2.1 (Marcian. 3 inst.). Cfr. SCHERMAIER, 2012, p. 775 nt. 19. On trouve quelque naïveté en SCHIAVON, 2011, p. 127 : « Il testo che i compilatori assumono aver tratto dalle Institutiones di Marciano … ».
17 LENEL, 1956, p. 460. Cfr. D 43.12.1.17 (Ulp. 68 ad ed.). Si in mari aliquid fiat, Labeo competere tale interdictum: ‘ne quid in mari inve litore’ ‘quo portus, statio iterve navigio deterius fiat’, repris sous le titre 43.12 (De fluminibus. Ne quid in flumine publico ripave eius fiat, quo peius navigetur). À propos de la question de l’extension de l’interdit à un interdit utile et l’hypothèse d’après laquelle il conviendrait de lire utile au lieu de tale dans le texte d’Ulpien, v. NÖRR, 1978, p. 127 ainsi que la littérature citée [2003, p. 1203] ; MARRONE, 2001, p. 281 et nt. 22 [2003, p. 804 et nt. 22]. Cfr. aussi D 43.8.2.8 (Ulp. 68 ad ed.). Adversus eum, qui molem in mare proiecit, interdictum utile competit ei, cui forte haec res nocitura sit: si autem nemo damnum sentit, tuendus est is, qui in litore aedificat vel molem in mare iacit.
18 Cfr. NÖRR, 1978, p. 127 et la littérature citée [2003, p. 1203] ; MARRONE, 2001, p. 281 et nt. 23 [2003, p. 804 et nt. 23].
19 « Analog dem interdictum directum dürfte auch dieses interdictum eine Restitutionsklausel enthalten haben » : NÖRR, 1978, p. 127 [2003, p. 1203]. Cfr. également le cas parallèle, relatif à l’interdit ne quid in loco publico fiat in D 43.8.2.43 (Ulp. 68 ad ed.). ‘Restituas’ inquit. Restituere videtur, qui in pristinum statum reducit: quod fit,
RIPARIA, UN PATRIMOINE CULTUREL
236
pouvons supposer que les choses se sont passées comme suit : Quelqu’un avait élevé une construction près de la plage. Un tel comportement pouvait entrer en conflit avec l’intérêt public à maintenir libre accès au rivage. Ces interdits pouvaient contenir une clause arbitrale, confiant le jugement à un arbitre (précisément la qualification que Celse attribue à Cicéron). Le préteur donnait donc ordre de vérifier et d’agir en conséquence. La définition du litus, dans ce contexte, semble être un préalable à la décision, à prendre dans l’agere ex interdicto, d’absoudre ou de condamner celui qui aurait « fait » ce « quid » prohibé par l’interdit. L’agere ex interdicto constituait en fait le processus décisoire qui faisait suite à l’ordre du préteur. Pour décider, par exemple, si l’ouvrage était ou non interdit, il fallait indiquer précisément la ligne de démarcation entre le lieu public et le lieu privé, ce qui supposait préalablement une définition du concept de litus. Matteo Marrone s’est montré très intéressé par cette décision de Cicéron arbitre, parce qu’elle montre à tout le moins une partie de la motivation de la décision d’un juge privé romain. Le maître palermitain écrit que le fait est remarquable, comme si l’on traitait d’une motivation qui exprime une interprétation précise d’une expression juridiquement relevante. Pour Marrone, il s’agirait donc – si l’on utilise la terminologie moderne – d’une « sentence interprétative »20. Pour Pugliese, nous sommes face à un véritable « précédent judiciaire »21. Comme on l’a vu, il faut évaluer le rapport entre le texte transmis par Celse et attribué par ce juriste à Cicéron et l’extrait des Topiques dans lequel Cicéron, traitant précisément du problème juridique de l’appartenance du rivage, attribue la solution à ce problème à son ami, le célèbre juriste Aquilius Gallus : Cic. Top. 7.32. Solebat igitur Aquilius, conlega et familiaris meus, cum de litoribus ageretur, quae omnia publica esse vultis, quaerentibus eis, quos ad id pertinebat, quid esset litus, ita definire ‘qua fluctus eluderet’22. Le dialogue imaginaire avec le jurisconsulte Trébatius Testa, destinataire de l’œuvrette rhétorique, fait entendre l’interlocution de Cicéron : Ce sont les juristes, dans leur globalité, qui veulent que tous les littoraux soient publics. Publicus ne doit pas être compris comme une entité dans la disponibilité du peuple romain (qui, s’il en était ainsi, pourrait transférer la chose à d’autres, même à des particuliers), mais plutôt comme une qualification qui exclut, pour des motifs fonctionnels, la propriété privée :
sive quis tollit id quod factum est vel reponat quod sublatum est. Et interdum suo sumptu: nam si ipse, quo qui interdixit, fecerit, vel iussu eius alius, aut ratum habitum sit quod fecit, ipse suis sumptibus debet restituere: si vero nihil horum intervenit, sed habet factum, tunc dicemus patientiam solam eum praestare debere.
20 MARRONE, 2001, p. 281 [2003, p. 804]. 21 PUGLIESE, 1978, p. 198 [1985, p. 140]. 22 « The point appears o be that eludere is a verbum fictum in a
definition of litus », così REINHARDT, 2006, p. 272 ; cfr. Quint. Inst. or. 5.14.34, à propos duquel : BRETONE, 1982, p. 346 nt. 34 ; SCARANO USSANI, 2008, p. 64.
on parle de res publicae iuris gentium23. Cicéron s’attarde ensuite sur un exemple tiré de sa mémoire, introduit par solebat à l’imparfait et par un affectueux rappel de son ami et collègue (lors de la préture de 66 avant J.C.) Aquilius. On fait référence à une réponse du juriste, qui, dans le cas présent, donne une définition (ita definire)24. Cela signifie donc qu’ à la question pratique posée par les sujets intéressés (quaerentibus eis, quos ad id pertinebat) quant à la nature juridique du litus, la réponse d’Aquilius était invariablement la même réponse laconique : ‘qua fluctus eluderet’. La consonance et la substantielle homogénéité (du moins en apparence) de l’interprétation du problème juridique reposant sur l’élément naturaliste, c’est-à-dire le flux de la mer par rapport à la terre (et donc la quantité de terre contenue dans la définition du litus), comparée à la citation de Celse, a conduit à une hypothèse de restitution textuelle de D 50.16.96 pr. déformée de la tradition. C’est en particulier Théodore Mommsen qui a réécrit substantiellement le texte dans son édition du Digeste de Justinien25. Là où l’on trouve idque Marcum Tullium aiunt, le savant allemand propose idque Aquilium M. Tullium ait. Ce faisant, il fait remonter la solution à Aquilius26 alors que Celse l’attribue à Cicéron. Cicéron (ou mieux Marcus Tullius) n’aurait été que le relais. La bévue de Celse pourrait se justifier par l’oralité (aiunt) qui, comme nous l’avons déjà dit, semble avoir été le mode par lequel le juriste avait pris connaissance de l’information27. La correction, cependant, ainsi que la superposition des deux décisions n’est pas indispensable28. Le récit de Celse est en réalité détaillé sur un point qui semble crucial : l’expérience spécifique de Cicéron dans sa fonction d’arbitre. A son tour, le témoignage de Cicéron est lui aussi précis lorsqu’il fait référence aux mots d’Aquilius Gallus : ce dernier ne les a pas prononcés dans une activité décisoire, mais dans une série de cas dans lesquels il a été appelé à donner un avis. Dans la restitution de Mommsen29, au contraire, ce serait plutôt Gallus qui aurait fait fonction d’arbitre. La grande et profonde connaissance des sources antiques de Mommsen a eu pour conséquence, dans notre cas, de provoquer une correction inutile. Elle résulte en partie de l’assonance due à la présence dans les deux textes de
23 Cfr. WATSON, 1968, p. 13, avec le compte-rendu de GROSSO, 1969,
spécialement p. 631 s. [2001, spécialement p. 713 s.]. 24 Une définition avec « funzione topico-interpretativa », « in vista di
una sua utilizzazione nel dibattito processuale » d’après MARTINI, 1966, p. 100.
25 Editio maior, ad h. l. 26 C'est la solution préconisée par MARRONE, 2001, p. 281 [2003, p.
804]. 27 « In ogni caso a questa definizione si era giunti attraverso un
itinerario complesso, una controversia de litoribus in cui Cicerone o Aquilio Gallo si erano espressi nella qualità di ‘arbitri’ » : FANIZZA, 2004, p. 15.
28 Cfr. également MANTHE, 1982, p. 300 nt. 187. 29 Suivie par une série d’auteurs modernes (cfr. par exemple nt. 27).
C. MASI DORIA. Litus maris : définition et controverses
237
fluctus et de la relative similitude qui n’est peut-être qu’apparente. La définition attribuée à Cicéron arbitre est plus précise (rappelons l’usage de l’adjectif maximus et la réference à primum constituisse) que celle plus brève et peut-être même ironique (par l’utilisation du verbe eludo) d’Aquilius Gallus. Je proposerais dès lors de restituer les faits comme suit : Cicéron avait été personnellement chargé de faire œuvre d’arbitre dans le cadre d’une procédure interdictale, comme nous l’avons déjà vu. Il connaissait l’interprétation jurisprudentielle courante, dont les constantes étaient, d’une part le caractère public des littoraux, et d’autre part l’importance de la mention du fluctus pour la définition. C’est de sa décision, tout aussi opportune que techniquement bien fondée, qu’il fallait garder la mémoire30. Celse est un juriste à qui le jeu de la mémoire n’est pas étranger. Souvenons-nous que c’est précisément lui qui relate le plus ancien témoignage de l’histoire de la jurisprudence romaine conservé dans le Digeste, à une distance de trois siècles. Il réussit à transmettre, par le recours à un dixerunt et apparemment sans aucune trace écrite, l’ancienne opinion de Sextus Aelius et Livius Drusus (D 19.1.38.1, 8 dig.)31. Arrêtons notre attention un instant sur ce que le texte des Topiques de Cicéron attribue à l’opinion commune des juristes de son temps, c’est-à-dire le caractère public des bords de mer. Sur ce point, les sources juridiques successives semblent contradictoires. Elles (nous allons les aborder) oscillent entre l’affirmation que le bord de mer est une res nullius ou communes omnium, ou appartient à la res publica, et une qualification qui montre au contraire des connotations juridiques moins nettes et qui admet la possession (voire l’appropriation) privée du littoral. S’ajoute à cela également le problème du rapport du littoral avec l’extension de l’imperium populi Romani, qui est pris en compte par les jurisconsultes, à tout le moins sous le Principat. L’affirmation qu’il s’agit d’une res nullius se trouve dans un texte de Paul, juriste de l’époque sévérienne, relatif à la vente: D 18.1.51 (Paul. 21 ad ed.). Litora, quae fundo vendito coniuncta sunt, in modum non computantur, quia nullius sunt, sed iure gentium omnibus vacant: nec viae publicae aut loca religiosa vel sacra. Le problème est celui de la surface de terrain à mesurer dans le cadre de la vente. Si le terrain borde la mer, le littoral ne doit pas être inclus dans la mesure du sol à vendre. La surface du littoral doit donc être exclue également du prix. L’explication quia nullius sunt sert à écarter l’appartenance au vendeur (et en même temps la possibilité d’acquisition par l’acheteur). Dans le cadre de la vente, les bords de mer n’appartiennent à personne.
30 NÖRR, 1978, p. 131 [2003, p. 1207] : « … lässt sich vielleicht die
Hypothese formulieren, dass Cicero-Zitat nicht nu reine ornamentale, sondern auch eine ‘historische’ Funktion erfüllte ».
31 CASCIONE, 2003, p. 305 ss.; maintenant BRETONE, 2008, p. 843.
Paul ajoute une réflexion supplémentaire : d’après le ius gentium (droit des gens), ils sont à la disposition de tous. Les voies publiques, les lieux religieux et sacrés sont également exclus de l’arpentage et de la vente. En conséquence, nullius esse n’a pas ici le sens habituel qu’il prend quand il est question des res nullius et qui signifie que la chose peut faire l’objet d’une occupatio. Dans ses Institutes, Marcien inclut les littoraux parmi les communia omnium, en se référant pour cela au droit naturel : D 1.8.2.1 (Marcian. 3 inst.). Et quidem naturali iure omnium communia sunt illa: aer, aqua profluens, et mare, et per hoc litora maris32. On notera que la perspective du juriste de l’époque des Sévères est étroitement liée à une référence naturaliste : Sont communs l’air, l’eau qui ruisselle et la mer. L’approche est claire : ces biens répondent à des besoins communs et sont donc communs. La qualification des littoraux dérive directement et explicitement (per hoc) de celle de la mer : il s’agit d’une équation. Si la mer est commune, le littoral doit l’être également, afin de pouvoir y accéder. Dans le même contexte palingénétique, Marcien souligne le problème de l’accès : D 1.8.4 pr. (Marcian. 3 inst.). Nemo igitur ad litus maris accedere prohibetur piscandi causa, dum tamen villis et aedificiis et monumentis abstineatur, quia non sunt iuris gentium sicut et mare: idque et divus Pius piscatoribus Formianis et Capenatis rescripsit33. Cette fois, la proximité de la mer a une connotation économique : la pêche (piscandi causa). Personne ne peut être empêché d’exercer cette activité. Le fragment dévoile également l’état des côtes, en particulier les côtes italiques, entre le second et le troisième siècle après J.C. (La datation s’obtient en prenant en considérant le laps de temps écoulé entre le rescrit d’Antonin le Pieux et la rédaction de Marcien ; la localisation se déduit des destinataires de la constitution impériale : les pêcheurs sont ceux de Formia et Capena). Il y a des édifices, des villas et des monuments. L’accès à la mer ne doit pas signifier intrusion dans les propriétés privées, parce que celles-ci ne relèvent pas du droit des gens, comme la mer. L’attribution au droit des gens qui semble contredire celle que nous venons d’examiner et qui se faisait par rapport au droit naturel ne doit pas surprendre : dans notre cas, les deux concepts semblent pouvoir parfaitement être superposés. Le choix du fondement repose sur le caractère public. Déjà du point de vue des définitions trouvées chez Celse et Javolène, nous avons pu noter que ce dernier qualifiait le rivage de public. Et c’est cette même perspective que nous retrouvons également dans un fragment de Celse, qui procède – même si c’est de façon prudente – à une
32 V. également I. 2.1.1, et à ce propos: v. KASER, 1993, p. 108, et la
littérature citée. Adde BRETONE, 1998, spéc. p. 259 s. 33 Repris dans I. 2.1.1.
RIPARIA, UN PATRIMOINE CULTUREL
238
classification de type institutionnel, par la référence à l’imperium populi Romani : D 43.8.3 (Cels. 39 dig.). Litora, in quae populus Romanus imperium habet, populi Romani esse arbitror: 1. Maris communem usum omnibus hominibus, ut aeris, iactasque in id pilas eius esse qui iecerit: sed id concedendum non esse, si deterior litoris marisve usus eo modo futurus sit. Bien entendu, selon toute probabilité, le juriste connaît la thèse de l’attribution de les litora maris aux ius gentium, ainsi que la possibilité de les considérer res nullius. Son choix, cependant, reflète la valeur politique et stratégique des côtes. Si l’imperium romain est exercé sur la côte, l’attribution formelle doit se faire au populus Romanus34. Cela ne signifie pas la patrimonialisation du bien, qui, par sa nature est indisponible (comme l’aer). Entre autres choses, le texte enseigne que les activités en mer, même lorsqu’elles sont permises, ne doivent pas entraîner une dégradation de la condition du litus (et donc une diminution de son utilité). La définition de Celse (une « persönliche Meinung » selon Schermaier35) englobe un autre problème en faisant référence à la puissance militaire de commande (imperium), elle comprend à la fois les côtes italiques et celles des provinces36. Du reste, c’est précisément Nérace, le juriste qui n’hésite pas à parler de litus publicus lorsqu’il définit le bord de mer, est contraint de faire une distinction, lorsqu’il est confronté à la question de l’appartenance : D 41.1.14 pr. (Nerat. 5 membr.). Quod in litore quis aedificaverit, eius erit37: nam litora publica non ita sunt, ut ea, quae in patrimonio sunt populi, sed ut ea, quae primum a natura prodita sunt et in nullius adhuc dominium pervenerunt: nec dissimilis condicio eorum est atque piscium et ferarum, quae simul atque adprehensae sunt, sine dubio eius, in cuius potestatem pervenerunt, dominii fiunt38. Litora publica non ita sunt : les litora ne sont pas publics de la même manière que les choses qui sont dans le
34 D’après KASER, 1993, p. 108 nt. 445 Celsus « der an den litora maris
Staateigentum annahm » constituerait une « Ausnahme ». 35 Qui a reflechi sur le mot ‘arbitror’ : SCHERMAIER, 2012, p. 780. 36 On trouve une idée très semblable dans l’article de Schermaier, paru
en 2012, lorsque cette contribution a eté dejà en épreves (SCHERMAIER, 2012, p. 780).
37 Il existait évidemment une différence par rapport aux ripae du fleuve, comme il ressort du texte immédiatement successif, extrait des Libri regularum du même juriste : D 41.1.15 (Ner. 5 reg.). Qui autem in ripa fluminis aedificat, non suum facit. Pour DE MARCO, 2004, p. 39 ss., les deux textes de Nérace seraient utiles, également pour soutenir l’hypothèse d’après laquelle, le terme de litus, dans l’usage linguistique courant, lorsqu’il est utilisé sans autre spécification, désigne le seul bord de mer (« nell’uso linguistico corrente … se utilizzato senza ulteriori specificazioni, designasse il solo lido del mare »). Ripa prend le sens de bord de mer dans un seul texte (D 19.1.52.3, Scaev. 7 dig.), mais cela désignerait d’un ouvrage artificiel, d’une ripa réalisée par un jet de moles (« ripa realizzata con il getto di moles ». Cfr. aussi FIORENTINI, 2003, p. 371).
38 À propos de ce texte, v. entre autres : CHARBONNEL, et MORABITO
1987, p. 26 et nt. 18 ; GUTIÉRREZ-MASSON, 1993, p. 308 ss.; ANKUM, 1998, p. 361 ss. ; DE MARCO, 2004, p. 34 s. avec une ample bibliographie, à laquelle je renvoie, citée en note 97.
patrimoine du peuple (in patrimonio sunt populi). Ils ne sont pas, en fait, des biens patrimoniaux, de sorte qu'ils ne sont pas négociables. Le point de référence est toujours la nature (en comparaison avec les poissons et la faune39). La question juridique se pose à propos de l’aedificatio: si quelqu’un bâtit sur le bord de mer, quelle est la condition de l’immeuble? La question se pose en raison de la nature du lieu. La qualification commune du bien peut signifier en théorie: tout le monde peut construire, ou personne ne peut le faire. Le choix est de considérer légitime la position de l’édificateur presque comme s’il avait opéré une adprehensio entraînant la potestas (la puissance de fait) et donc le dominium (la propriété, le pouvoir légalement qualifié). Cette interprétation est confirmée par un passage de Pomponius, qui restitue une élégante et intéressante symétrie : D 1.8.10 (Pomp. 6 ex Plautio). Aristo ait, sicut id, quod in mare aedificatum sit, fieret privatum, ita quod mari occupatum sit, fieri publicum. Pomponius mentionne Aristo: pour ce juriste, ce qui est construit dans la mer (c'est-à-dire carrément dans la mer. Sont visés ici, les bâtiments ayant des fondations reposant sur le fond marin) – et donc d’autant plus in litore – devient privé. C’est comme cela que le critère de l'appartenance commune, indifférenciée, s’est relâché. On spécifie comme cela le droit sur une partie du bien qui, par nature appartient à tous. Dans le même temps – conformément à la citation – ce qui est «occupé» par la mer devient « public »40. Le point intéressant est l’instabilité des relations juridiques ainsi établies sur les côtes. Cette instabilité est telle que même ma propriété qui n’est pas immédiatement sur la côte (mais seulement proche de la mer) peut devenir « publique » (dans le sens où nous l’avons vu) par une inondation ou par un changement de la ligne côtière. Evidemment, l’édification – et l’acquisition du droit sur la construction qui en résulte – est soumise à des limites. Celles-ci correspondent à la nature des lieux et au problème fondamental : L’édifice ne peut pas limiter le droit d’autrui. Il l’affirme clairement : D 43.8.4 (Scaev. 5 resp.). Respondit in litore iure gentium aedificare licere, nisi usus publicus impediretur. Le responsum de Cervidius Scaevola confirme la légalité (licere) de la construction sur le litus et du bâtiment obtenu, mais à la condition que l’usus général ne soit pas restreint. En cohérence avec le système mis en place, cet usage général est ici appelé publicus. Il est
39 SCARANO USSANI, 1979, p. 79 nt. 58, a affirmé que la comparaison de
Nérace entra la condition du litus et des animaux sauvages et des poissons constituerait une tentative de démontrer la validité des solutions traditionnelles, en les fondant sur une critère de ‘naturalisme élémentaire’ (« tentativo di dimostrare la validità delle soluzioni tradizionali, fondandola su un criterio di elementare ‘naturalismo’ ».).
40 DE MARCO, 2004, p. 29 s. Cfr. D 41.2.30.3 (Paul. 15 ad Sab.).
C. MASI DORIA. Litus maris : définition et controverses
239
particulièrement important de relever que le juriste fait reposer sa décision sur le ius gentium, c’est-à-dire le même cadre juridique que celui qui garantit la liberté du litus, nous l’avons vu. On réaffirme donc le caractère central de l’usus dans la gestion juridique des riparia marines, la possibilité de faire un usage économique du bien qu’est le rivage et c’est celui-ci qui constitue le paradigme de son caractère public. La pêche (qui est l’activité la plus commune et la plus visible que l’on exerce sur les côtes) ne peut être empêchée par le fait que quelqu’un décide de construire sur la plage (assumant par ailleurs le risque de l’inondation, avec ses conséquences juridiques). L’accès à la mer doit être autorisé en toute hypothèse. C’est ce que rappelle un texte d’Ulpien, qui présente aussi plusieurs profils d’intérêt : D 47.10.13.7 (Ulp. 57 ad ed.). ... Et quidem mare commune omnium est et litora, sicuti aer, et est saepissime rescriptum non posse quem piscari prohiberi: sed nec aucupari, nisi quod ingredi quis agrum alienum prohiberi potest. Usurpatum tamen et hoc est, tametsi nullo iure, ut quis prohiberi possit ante aedes meas vel praetorium meum piscari ... In lacu tamen, qui mei dominii est, utique piscari aliquem prohibere possum. La mer est à tout le monde. Il en est de même des littoraux. Dans ce cas également, l’élément de comparaison est l’air, la chose qui par excellence ne peut faire l’objet d’une appropriation privée. Le juriste rappelle que, très souvent, les empereurs sont intervenus pour garantir le principe, mais surtout ses retombées socio-économiques, c’est-à-dire la liberté de la pêche41. De même, il ajoute que l’on ne peut interdire la chasse, à moins qu’elle n’implique une pénétration abusive sur le terrain d’autrui. Cette liberté est en réalité entravée par un usage usurpé (usurpatum prend ici tout son sens), dont Ulpien dit qu’il ne repose sur aucune base légale (nullo iure) et en vertu duquel le propriétaire d’une construction ou praetorium se situant en bord de mer s’arroge la possibilité d’interdire que l’on pêche dans l’espace se situant devant sa construction. Dans le cas de la pêche dans un lac privé, en revanche, le ius prohibendi du propriétaire est pleinement légitime. Face aux différentes thèses qui se sont opposées, cherchant à expliquer les contradictions (présumées) entre les sources, je pense qu’il faut avant tout poser la question autrement. Il faut relire les textes en adoptant un paradigme fonctionnaliste. Publicus a un sens étroit solidement ancré dans les catégories du droit public de l’époque républicaine et où ce mot désigne la pleine appartenance au peuple romain. Mais déjà à l’époque des crises, à la fin de la République, le terme prend parfois une signification plus large, moins technique. Il suffit de penser aux communautés municipales42, pour lesquelles l’utilisation du qualificatif est utilisé, même si formellement, il est abusif, comme le rappelle également
41 Cfr. KASER, 1993, p. 108 et nt. 446. 42 V. CASCIONE, 2007, p. 56 ss. ; SCHERILLO, 1945, p. 90 ss. ; PUGLIESE,
1994 [2007, p. 785 ss.].
Ulpien (D 50.16.15, 10 ad ed.)43. Le problème peut être lié à une plus ample question historico-dogmatique, que nous appellerions aujourd’hui de la personnalité juridique des communautés citoyennes de l’empire romain. La dialectique, particulièrement en reliée aux les critères de l’appartenance, entre la res publica générale et les municipes assujettis (mais également intégré à la première) déterminera en réalité cette perte de précision du terme et en affaiblira la portée technique. Il faut alors revenir – comme il me semble que l’ont fait les juristes romains – à une réflexion centrée sur le complexe d’intérêts déterminés par la situation naturelle du bord de l’eau. Il y a un intérêt général d’accessibilité à la mer pour tous et d’exploitation économique de ses ressources. C’est à ceux-ci que font référence les textes sur la nature publique ou commune du bien littoral. Mais dans le même temps, c’est précisément la spécification de certains intérêts économiques relatifs à des activités qui se tiennent sur le littoral, qui peut déterminer une utilitas particulière que le système juridique entend protéger (même si ce n’est pas dans tous les cas). Une situation intéressante pour expliquer cette contradiction apparente peut être trouvée dans la réponse jurisprudentielle à la situation juridique des maisonnettes, des refuges construits par les pêcheurs sur la rive. La perspective strictement utilitariste de ce type de rapport juridique sur le bord de mer ressort clairement, à mon avis, de la combinaison de deux textes jurisprudentiels. Le premier, de Gaius, est extrait des res cottidianae : D 1.8.5.1 (Gai. 2 rer. cott.). In mare piscantibus liberum est casam in litore ponere, in qua se recipiant44. Pour favoriser les activités économiques des pêcheurs qui pêchent en mer, on leur donne la possibilité de casam in litore ponere, c’est-à-dire de construire un refuge, une maisonnette sur le bord de mer (c’est-à-dire sur cette partie de la terre qui est balayée par les vagues et qui a été définie comme étant publique). L’autre fragment remonte au Institutes de Marcien, qui explique et délimite la position subjective de ce qui est construit sur la plage. D 1.8.6 pr. (Marcian. 6 inst.). In tantum, ut et soli domini constituantur qui ibi aedificant, sed quamdiu aedificium manet: alioquin aedificio dilapso quasi iure postliminii revertitur locus in pristinam causam, et si alius in eodem loco aedificaverit, eius fiet45.
43 Bona civitatis abusive ‘publica’ dicta sunt: sola enim ea publica sunt,
quae populi Romani sunt. 44 KASER, 1993, p. 109 et notes 447 et 448, avec références à la
littérature interpolationniste. 45 À propos de ce texte, aussi en relation avec le texte de Gaius
immédiatement précédent, v. BRANCA, 1940, p. 21 ss.; LOMBARDI, 1946, p. 144 ss. ; SOLAZZI, 1949, p. 7 [1972, p. 161]; CURSI, 1996, p. 305 ss. ; ANKUM, 1998, p. 365 ; FIORENTINI, 2003, p 366 ; DE
MARCO, 2004, p. 45 ss.
RIPARIA, UN PATRIMOINE CULTUREL
240
Le juriste affirme que ceux qui construisent dans ces conditions voient naître un dominium soli à leur profit. Mais ce droit de propriété est très particulier, puisqu’il est limité dans le temps et ne vaut qu’autant l’édifice est sur pied (quamdiu aedificium manet). Si la construction n’est plus fonctionnelle, le lieu est restitué dans sa situation juridique antérieure (revertitur locus in pristinam causam). Marcien s’explique en faisant une comparaison singulière avec le postliminium (quasi iure postliminii) qui se justifie par l’image du retour à la situation antérieure. Il en découle la conséquence que si par la suite quelqu’un construit quelque chose sur le même endroit, cette construction lui appartiendra. La contradiction de cette solution avec la structure typique de la propriété est évidente, mais apparaît pleinement justifiée par la fonction économique. Les pêcheurs maintiennent le droit tant qu’ils utilisent la maison ; dès lors qu’ils la laissent dépérir, cela signifie que l’utilité qui avait justifié la constitution du droit a disparu également. Il en ressort la restitution à l’état naturel et la possibilité que d’autres y érigent une construction sur la base des mêmes motivations économico-sociales. Nous pouvons maintenant revenir à un fragment de Nérace, dont nous avions déjà discuté le principium : D 41.1.14.1 (Nerat. 5 membr.). Illud videndum est, sublato aedificio, quod in litore positum erat, cuius condicionis is locus sit, hoc est utrum maneat eius cuius fuit aedificium, an rursus in pristinam causam recidit perindeque publicus sit, ac si numquam in eo aedificatum fuisset. quod propius est, ut existimari debeat, si modo recipit pristinam litoris speciem. Pour rappel, le juriste avait admis la possibilité de construire sur le bord de mer et l’acquisition de la propriété de l’édifice par le constructeur. Dans le §1er, Nérace se pose cependant une nouvelle question : que se passe-t-il si l’édifice s’écroule ? Quelle est alors la situation juridique du lieu ? La question est utrum maneat eius cuius fuit aedificium, an rursus in pristinam causam recidt. Dans le premier cas, il y aurait une sorte d’accession inversée : le propriétaire de la surface serait devenu propriétaire du sol également (par antithèse avec le principe superficies solo cedit). Dans le second, au contraire, le retour à l’état antérieur signifierait que le bord de mer avait été public, comme si il n’avait jamais été construit46. C’est précisément cette dernière solution qui semble avoir été celle que le jurisconsulte a préconisé, qui raisonne sur le retour du bord de mer à son état antérieur47. On peut donc affirmer sans retenue que le droit de l’édificateur ne s’étendait pas à un vrai et plein dominium, droit de propriété48. Comme on peut le déduire des différentes perspectives, la situation juridique du litus maris est beaucoup plus
46 Cfr. KASER, 1993, p. 111, d’après lequel le texte laisserait
transparaître une controverse (« eine Kontroverse erkennen »). 47 Cfr. DE MARCO, 2004, p. 45. 48 Au contraire, selon PUGLIESE, 1994, p. 190 [2007, p. 791]: «
divenendo proprietari dell’edificio (e, di conseguenza, anche del sottostante tratto di lido) », mais sans considérer le trait « in pristinam causam – fuisset ».
fluide, moins rigide que celle de la terre ferme. Et la particularité du régime se justifie par l’utilitas que l’homme peut tirer de la nature dans ce lieu hybride, entre la terre et la mer. La qualification de lieu public, ne doit pas être prise au sens du patrimoine public. Les littoraux sont indisponibles, comme la res publica, mais ils peuvent être utilisés par les particuliers qui sont en mesure de les exploiter (par exemple les pêcheurs). Le droit romain connaît des biens qui, tout en étant publics, ne se trouvent pas parmi la pecunia populi, c’est-à-dire dans le patrimoine disponible pour la communauté. Ils sont exclus du commerce précisément parce qu’ils sont d’usage public. On pourrait ici utiliser la différence entre les choses in usu et in patrimonio populi49. Il suffit pour s’en convaincre de se souvenir de la citation du texte bien connu de Pomponius : D 18.1.6 pr. (Pomp. 9 ad Sab.). Sed Celsus filius ait hominem liberum scientem te emere non posse nec cuiuscumque rei si scias alienationem esse: ut sacra et religiosa loca aut quorum commercium non sit, ut publica, quae non in pecunia populi, sed in publico usu habeatur, ut est Campus Martius. Les acquisitions sur le bord de la mer ont en réalité une caractérisation plus flexible. Ils peuvent se réaliser par l’activité de construction, à laquelle on reconnait la valeur de l’usage (mais ne peuvent résulter de modes dérivés d’acquisition de la propriété). Mais même ce caractère utilisable ne produit pas de droit de propriété stable, mais uniquement temporaire, strictement lié aux fins du résultat économique. Et cela donne raison, me semble-t-il, à l’idée des juristes de la fin de la République qui – si l’on en croit le témoignage de Cicéron – considéraient que tous les littoraux marins étaient publics. Il nous faut, une fois de plus, revenir à la définition d’Isidore, par laquelle j’ai commencé mon exposé. La première partie de l’étymologie semble avoir souffert d’une étrange contamination par le texte d’Aquilius Gallus, repris par Cicéron dans les Topiques. Il y a seulement une petite différence entre eludo et elido. U et i sont lettres qui s’échangent très facilement dans l’écriture et la prononciation du latin. Mais sur le fond, cette partie du passage d’Isidore n’est pas crédible. Fluctu eliditur signifie que le litus n’est pas touché par l’eau. La deuxième partie semble avoir plus de sens : le litus c’est le lieu où l’eau de mer arrive. La présence de la consonne « l » dans les deux parties de l’étymologie est importante : elle confère à la définition un ton liquide. Nous avons déjà cité des fragments de la tradition glossématique. Parmi cette textes on peut lire aussi des témoignages accordant une certaine sacralité au litus : locus circa aram et mari vicinus (CGL V 554.2) ; spatium inter aras et templum. Le rivage de la mer devient un lieu sacré (avec la confusion entre litus et lituus) évidemment précieux par son importance économique.
49 Cfr. SCHERILLO, 1945, p. 90 ss.
C. MASI DORIA. Litus maris : définition et controverses
241
On va tenter une conjecture, une comparaison avec la sémantique du Grec ancien. La traduction grecque du litus est aighialòs, mot attestée depuis Homère. Le terme se retrouve chez Hérodote, Aristote, etc. L’étymologie n’est pas facile : selon Chantraine50 l’hypothèse facile d’un emprunt égéen (aighìos) doit être écartée. Pour expliquer le mot on envisage un composé dont le premier terme aighi – est rapproché de aighes ‘vagues’, attesté chez Hésicus. Une fois de plus les vagues servent à la définition du bord de mer. Le témoignage du mycénien enseigne que – alos doit être un second terme du composé, avec l’initiale aspirée. Le second terme du composé serait selon Hirt51, le génitif du mot alos, et le mot grec pour « bord de mer » serait issu de l’expression en aighì alòs ‘à l’endroit où sautent les vagues’. Cela semble sans doute moins naturel, lorsque l’on aborde la question sous l’angle strictement étymologique, mais il nous semble intéressant de constater que cette perspective nous donne la même sémantique de la définition juridique romaine de litus : un endroit touché par les vagues. Bibliographie ANKUM, H., 1998. Litora maris et longi temporis praescriptio. Index 26, 361-381. BONFANTE, P., 1966. Corso di diritto romano II.1. La proprietà2, cur. G. BONFANTE, G. CRIFÒ, Milano. BRANCA, G., 1940. Le cose extra patrimonium humani iuris, Trieste. BRETONE, M., 1982. Tecniche e ideologie dei giuristi romani, Napoli (19822). BRETONE, M., 1998. I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura, Roma-Bari. BRETONE, M., 2008. ‘Ius controversum’ nella giurisprudenza classica, in Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Memorie, 405 ser. 9 vol. 23 fasc. 3., 834 ss. CASCIONE, C., 2003. ‘Consensus’. Problemi di origine, tutela processuale, prospettive sistematiche, Napoli. CASCIONE, C., 2007. ‘Municipes’ e ‘consensus’, in Forme di aggregazione nel mondo romano, Bari, 49-58. CHANTRAINE, P., 1968. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, Paris. CHARBONNEL, N. et MORABITO, M., 1987. Les rivages de la mer : droit romain et glossateurs. RHD. 65, 23-44. COSTA, E., 1927. Cicerone giureconsulto I, Bologna.
50 CHANTRAINE, 1968, p. 30. 51 HIRT, 1917, p. 229 ss.
CURSI, M.F., 1996. La struttura del ‘postliminium’ nella repubblica e nel principato, Napoli. DE MARCO, N., 2004. I ‘loci publici’ dal I al III secolo. Le identificazioni dottrinali, il ruolo dell’usus, gli strumenti di tutela, Napoli. D’IPPOLITO, F., 1969. Ideologia e diritto in Gaio Cassio Longino, Napoli. ERNOUT, A. et MEILLET, A., 1959. Dictionnaire étymologique de la langue Latine. Histoire des mots4, Paris. FANIZZA, L., 2004. Autorità e diritto. L’esempio di Augusto, Roma. FERRINI, C., 1901. Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano. BIDR. 1, 101-207 [= in ID., Opere II (Milano 1929) 307-419]. FIORENTINI, M., 2003. Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana. Profili di tutela processuale e di inquadramento sistematico, Milano. GROSSO, G., 1969. Rec. di A. WATSON, The Law of Property in the Later Roman Republic1 (Oxford 1968). Iura 20, 630-635 [= in ID., Scritti storico giuridici IV. Recensioni e ricordi (Torino 2001) 712-717]. GUTIÉRREZ-MASSON, L., 1993. Mare nostrum : imperium ou dominium ? RIDA 3 s., 40, 293-315. HARKE, J.D., 1999. Argumenta Iuventiana. Entscheidungsbegründungen eines hochklassischen Juristen, Berlin. HIRT, H., 1917. Zu den lepontischen und thrakischen Inschrifen. IF. 37, 229 ss. IMPALLOMENI, G., 1990. Le rade, i porti, le darsene e le opere a terra. Rivista trimestrale di Diritto Pubblico 40, 1182-1201 [= in ID., Scritti di diritto romano e tradizione romanistica (Padova 1996) 583-599]. KASER, M., 1993. Ius gentium, Köln-Weimar-Wien. LENEL, O., 1956. Das Edictum Perpetuum, Leipzig (19273, rist. Aalen). LOMBARDI, G., 1946. Ricerche in tema di ‘ius gentium’, Milano. MANTHE, U., 1982. Die libri ex Cassio des Iavolenus Priscus, Berlin. MARRONE, M., 2001. Su struttura delle sentenze, motivazione e ‘precedenti’ nel processo privato romano, in Iuris Vincula. Studi in onore di M. Talamanca V, Napoli, 275-290 [= in ID., Scritti giuridici, cur. G. FALCONE II (Palermo 2003) 799-809 = BIDR. 100 (1997, pubbl. 2003) 37 ss.].
RIPARIA, UN PATRIMOINE CULTUREL
242
MARTINI, R., 1966. Le definizioni dei giuristi romani, Milano. MARTINI, R., 1995. Di nuovo sulla ‘definitio’ fra retorica e giurisprudenza. Labeo 41, 169-180. MONTGOMERY, H.C., 1964. Thomas Jefferson admirer and user of roman law, in Synteleia V. Arangio-Ruiz, cur. A. GUARINO, L. LABRUNA, Napoli, 170 ss. NÖRR, D., 1976. Pomponius oder Zum Geschichtsverständnis der römischen Juristen, in ANRW. II.15, Berlin-New York, 497 ss. [= in ID., Historiae iuris antiqui. Gesammelte Schriften, hrsg. T.J. CHIUSI, W. KAISER, H.D. SPENGLER II (Goldbach 2003) 985 ss.]. NÖRR, D., 1978. Cicero-Zitate bei den klassischen Juristen. Zur bedeutung literarischer Zitate bei den Juristen und zur Wirkungsgeschichte Ciceros, Ciceroniana n.s. 3, 111 ss. [= in ID., Historiae iuris antiqui. Gesammelte Schriften, hrsg. T.J. CHIUSI, W. KAISER, H.D. SPENGLER II (Goldbach 2003) 1187 ss.]. PAMPALONI, M., 1892. Sulla condizione giuridica delle rive del mare in diritto romano e odierno. Contributo alla teoria delle ‘res communes omnium’. BIDR. 4, 197 ss. PARRA MARTÍN, M.D., 2005. La argumentación retórica en Juvencio Celso, Madrid. PENTA, M., 1998. Note sul ‘liber definitionum’ (D 50.16), in Fraterna munera. Studi in onore di L. Amirante, Salerno, 357-389. PLESCIA, J., 1993. The roman law on waters. Index 21, 433-451. PUGLIESE, G., 1978. Intervento di chiusura del III « Colloquium Tullianum » (Roma 3-5 ott. 1976), Ciceroniana n.s. 3, 189 ss. [= in ID., Scritti giuridici scelti III. Diritto romano, cur. I. BUTI, G. SACCONI (Napoli 1985) 129 ss.]. PUGLIESE, G., 1994. ‘Res publicae in usu populi’ e ‘in patrimonio populi’ nel corso di Gaetano Scherillo sulle cose, in Atti del Convegno Gaetano Scherillo, Milano, 182-198 [2007. Scritti giuridici (1985-1995), Napoli, 783-799].
REINHARDT, T. (eds.), 2006. Cicero’s Topica, Oxford. SCARANO USSANI, V., 1977. Ermeneutica, diritto e ‘valori’ in L. Nerazio Prisco. Labeo 23, 146 ss. SCARANO USSANI, V., 1979. Valori e storia nella cultura giuridica fra Nerva e Adriano. Studi su Nerazio e Celso, Napoli. SCARANO USSANI, V., 1989. Empiria e dogmi. La scuola proculiana fra Nerva e Adriano, Torino. SCARANO USSANI, V., 2008. Il retore e il potere. Progetto formativo e strategie del consenso nell’Institutio oratoria, Napoli. SCHERILLO G., 1945. Lezioni di diritto romano. Le cose I. Concetto di cosa – cose extra patrimonium, Milano. SCHERMAIER, M., 2012. Private Rechte an ‘res communes’?, in Carmina Iuris. Mélanges en l’honneur de M. Humbert, cur. E. CHEVREAU, D. KREMER et A. LACROIX-LAQUERRIERE, Paris, 773-792. SCHIAVON, A., 2011. Acqua e diritto romano : ‘invenzione’ di un modello?, in SANTUCCI, G., SIMONATI, A., CORTESE, F. (eds.), L’acqua e il diritto. Atti del Convegno tenutosi presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento (2 febbraio 2011), Trento, 117-181. SOLAZZI S., 1949. Studi romanistici I. Il ‘postliminium rei’ e gli immobili. RISG. ns. 3, 1 ss. [= in ID., 1972. Scritti di diritto romano V (1947-1956), Napoli, 155 ss.]. WALDE, A. et HOFMANN, J.B., 1954. Lateinisches etymologisches Wörterbuch3 II, Heidelberg. WATSON, A., 1968. The Law of Property in the Later Roman Republic, Oxford. ZOZ, M.G., 1999. Riflessioni in tema di ‘res publicae’, Torino.