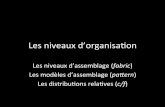NIVEAUX DE VIE BIOLOGIQUES, DISPONIBILITÉS ALIMENTAIRES ET CONSOMMATIONS POPULAIRES EN FRANCE AU...
-
Upload
multiagent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of NIVEAUX DE VIE BIOLOGIQUES, DISPONIBILITÉS ALIMENTAIRES ET CONSOMMATIONS POPULAIRES EN FRANCE AU...
NIVEAUX DE VIE BIOLOGIQUES,
DISPONIBILITÉS ALIMENTAIRES
ET CONSOMMATIONS POPULAIRES
EN FRANCE AU MILIEU DU XIXe SIÈCLE
par Laurent HEYBERGER1
ANNALES DE DÉMOGRAPHIE HISTORIQUE 2009 n° 2 p. 167 à 191
167
LE MILIEU DU XIXe SIÈCLE :UN MOMENT CLEF DE L’HISTOIREÉCONOMIQUE ET SOCIALEDE LA FRANCE ?
Le milieu du XIXe siècle constitue àplusieurs égards un moment privilégiépour étudier les disparités de niveau devie en France, particulièrement dans lescampagnes où l’on assiste à l’« apogée dusystème classique » (Juillard, 1992, 199).La France est alors un «monde plein »qui ne commence à se vider réellementque sous le Second Empire. Les années1845-1847 voient la dernière crisefrumentaire de type ancien, puis lesdernières difficultés alimentaires degrande ampleur disparaissent au prixd’une simplification séculaire du régimealimentaire, en dépit d’une dernière crisede cherté de longue durée (1853-1857,Montanari, 1995, 196). Cependant leséchanges commerciaux entre départe-ments et même entre arrondissementssont encore modestes2 car, en dépit del’extension des canaux et de l’améliora-tion du réseau routier, le prix du roulageet dans une moindre mesure celui de labatellerie rendent encore peu attractif lecommerce des céréales sur longuesdistances (Renouard, 1960, 41-43, 58-59 et 68 ; Grantham, 1997, 695 ;Laurent, 1977, 115-117 ; Margairaz1982 ; Demonet, 1990, 18-20). On necompte en 1852 que 3500 km de voies
ferrées, qui ne forment pas encore unréseau national d’approvisionnement àbon marché : l’essentiel des 17 000 kmconstruits entre 1842 et 1870 est posté-rieur à l’enquête agricole de 1852 quiconstitue une source privilégiée pourbrosser un tableau de l’agriculture fran-çaise au milieu du siècle (Demonet,1990 ; Ministère de l’agriculture, ducommerce et des travaux publics, 1858et 1860). L’espace économique françaisest donc encore relativement cloisonné(Lévy-Leboyer, 1982, 29-32). En 1850,les Français tirent encore l’essentiel deleurs protéines des céréales, avant que laseconde moitié du siècle voie l’essor sansprécédent de la consommation deprotéines d’origine animale (Toutain,1971). De plus, pour Michel Morineau –dont l’analyse a souvent été critiquée –,les rendements en blé et la consomma-tion alimentaire des Français stagnententre 1740 et 1840 (Morineau, 1971,1972 et 1974), ce qui confirme lesinquiétudes malthusiennes de nombre detémoignages contemporains. Toutefois,pour Jean-ClaudeToutain, la consomma-tion alimentaire augmente modestementdurant la première moitié du siècle(Toutain, 1971, 1992-1993, 1995 ;Grantham, 1995). Toujours est-il qu’aumilieu du siècle, l’ensemble des régionsrurales françaises vit encore dans unsystème alimentaire archaïque de pénurierelative (Bonnain-Moerdijk, 1975, 30).
LAURENT HEYBERGER
168
Les indices anthropométriques confir-ment cette impression générale de monderural en changement lent, encore forte-ment marqué du sceau de la tradition. Àl’échelle nationale, la stature moyennedes conscrits, puis la part des réforméspour défaut de taille, se dégagent progres-sivement de l’influence des prix du blé(Heyberger, 2003, 63-80). Parallèlement,la stature moyenne des Françaisaugmente légèrement durant la premièremoitié du siècle (Weir, 1997, 191), alorsque dans les autres pays en voie d’indus-trialisation on assiste au contraire à unebaisse du niveau de vie biologique(Komlos, 2003, 7-8). Cependant, àl’échelle locale, des sondages sur des espa-ces aux profils socio-économiquescontrastés ont montré que la Franceconnaissait alors un creusement des écartsanthropométriques (Heyberger, 2005)3.
LES PROBLÈMES POSÉS :STATURE, NUTRITIONET URBANISATION
Observer et tenter d’expliquer les varia-tions de stature en France au milieu duXIXe siècle semble donc judicieux tant dupoint de vue de l’intégration au marché,de l’histoire alimentaire, de l’histoire dela population, que de l’histoire anthropo-métrique4. De plus, on dispose avec l’en-quête agricole de 1852 d’un documentde grande qualité qui permet de saisir lesdisponibilités alimentaires et les consom-mations populaires à l’échelle de l’arron-dissement5. La stature moyenne estdésormais largement considérée dans lacommunauté scientifique internationalecomme un indice de niveau de vie biolo-gique très fiable ; elle peut être utiliséepour vérifier la cohérence des apportsnutritionnels calculés d’après la produc-tion agricole ou les budgets6. On se
propose ainsi de vérifier à un niveaud’analyse assez fin quelles estimationsdonnent les meilleurs résultats : les dispo-nibilités ou les consommations? D’autrepart, les apports en protéines d’origineanimale, et plus particulièrement le lait,constituent-ils un élément essentiel de lacroissance staturale ? Baten a déjà montréle rôle positif de la disponibilité en laitsur la taille des conscrits pour la France àl’échelle des départements et pour lesLänder de Bade et du Wurtemberg àl’échelle plus fine des districts (Baten,1999). La prise en compte de variablesdémographiques permet par ailleurs devérifier à l’échelle locale une hypothèseoriginale de Weir, à savoir l’influencepositive qu’aurait l’urbanisation enFrance sur la stature moyenne mesurée àl’échelle du département (Weir, 1997,180-183). La France se trouverait alorsdans une position singulière, car lors dela première vague d’industrialisation,l’urbanisation s’accompagne plutôtd’une baisse de la stature, en l’absence derévolution des transports permettant denourrir des citadins de plus en plusnombreux. Dans les deux cas – lait eturbanisation –, le changement d’échellepermet de voir si la relation envisagéen’est pas due à une simple illusion d’op-tique associée à une unité statistiquetrop vaste.
LA CLASSE 1868 :LES RAISONS D’UN CHOIX
Pour confronter disponibilités alimen-taires et consommations populaires, tiréesde l’enquête agricole de 1852, et indicesanthropométriques, il est nécessaire deconsidérer une cohorte de naissance chro-nologiquement proche de cette source.En effet, les influences socio-économiquessur la stature moyenne atteinte à l’âge
NIVEAUX DE VIE BIOLOGIQUES EN FRANCE AU MILIEU DU XIXe SIÈCLE
169
adulte sont particulièrement sensiblesdurant la croissance de la petite enfance,lorsque la croissance naturelle est spéciale-ment importante. Pour cette raison, lesétudes d’histoire anthropométrique citentles statures moyennes observées à l’âge dela conscription à l’année de naissance etnon à l’année d’examen. La cohorte denaissance 1848 a donc été retenue7. On aprocédé au relevé des dossiers individuelsde conscrits dans les listes de tirage au sortde la classe 1868 dans 36 départements,parmi lesquels on a sélectionné 81605individus toisés, répartis en 111 arrondis-sements8. Outre la stature, le degré d’ins-truction, le canton de résidence légale et laprofession des conscrits ont été relevés àl’échelle individuelle. On dispose ainsi dedonnées anthropométriques et socio-économiques sommaires pour près d’untiers des arrondissements existant en1848-1852 et plus du quart des conscritsde la classe 1868. La stature moyenne del’échantillon s’élève à 165,82 cm, maisles valeurs moyennes extrêmes s’éche-lonnent de 161,51 dans l’arrondisse-ment de Guingamp (N= 1 211) à169,28 (N = 533) dans l’arrondissementde Baume-les- Dames. Cette différencetrès sensible – près de 8 cm – confirmele grand écart qui caractérise alors lesniveaux de vie biologiques en France.
DISPONIBILITÉS MOYENNES ETCONSOMMATIONS POPULAIRES :PROBLÈMES MÉTHODOLOGIQUESET RÉSULTATS
Le calcul de la disponibilité alimentairemoyenne par arrondissement à partir del’enquête agricole de 1852 se heurte àplusieurs problèmes. Les deux principalessources de protéines et calories9, les céréa-les d’une part, les viandes et poissons
d’autre part, sont connues à travers ce quel’enquête présente comme des consom-mations. La consommation est en effetsupérieure à la production dans les arron-dissements urbains. Pour chaque aliment,et lorsque cela est nécessaire, les disponi-bilités sont calculées nettes de la consom-mation animale et des pertes dues au stoc-kage et seule la partie comestible est priseen compte10. Dans le cas plus spécifiquedu lait, dont on ne connaît que la produc-tion, on suit Demonet qui suggère dedéfalquer de la production laitière laconsommation des veaux. La consomma-tion parisienne en produits laitiers nousest par ailleurs connue grâce à ArmandHusson (Husson, 1856). Confrontée àl’enquête agricole qui fournit les quantitésde lait nécessaires à la confection des beur-res et fromages locaux, elle permet deproposer une disponibilité en lait pararrondissement nette de la consommationparisienne en produits laitiers11. Cecipermet de prendre en compte une deshypothèses de Baten qui a observé desrésidus dans sa corrélation entre stature etdisponibilités en lait pour deux régionsd’élevage : la Basse-Normandie (négatifs)et le Jura (positifs). Pour cet historien, cesrésidus s’expliquent pour les premiers parl’exportation des produits laitiers sousforme de beurre et de fromage, notam-ment vers la capitale, et pour les secondspar un isolement relatif de la région parrapport aux grands marchés urbains(Baten, 1999, 106)12. Enfin, le lait devache constitue un aliment complet pourla croissance harmonieuse du corpshumain : il renferme des protides maisaussi du calcium en grande quantité13.Nous avons donc créé une variable«calcium» afin de tester l’hypothèse selonlaquelle le lait de vache constituerait unaliment important par rapport aux autressources animales de protides.
LAURENT HEYBERGER
170
Pour d’autres aliments, les disponibili-tés nous sont connues à partir de laproduction. C’est le cas des pommes deterre, des légumes de plein champ – netsde la consommation animale – et deslégumes secs. Enfin, pour d’autresaliments, on a dû recourir à une estima-tion selon la valeur de la production.C’est le cas des légumes du jardin14, deschâtaignes15, de la volaille16 et desœufs17. Le degré d’incertitude qui enta-che ces estimations est donc plus impor-tant, mais les aliments concernés jouentun rôle très secondaire dans les disponi-bilités en calories et en protides encomparaison des précédents aliments.
D’autre part, certains aliments sontexclus des estimations finales, bien queprésents dans l’enquête de 1852 :fruits18, sucre19 et graisses d’origine végé-tale20. Enfin, les denrées coloniales, à laconsommation encore très marginale,tel le chocolat, n’ont pas été inclusesdans les estimations, car en l’absence dedonnées sur les consommations locales,on aurait alors procédé à une répartitionproportionnelle à la population dechaque arrondissement qui n’aurait rienajouté à la variance des disponibilités21.
L’enquête agricole de 1852 offreégalement l’opportunité d’évaluer lesconsommations populaires grâce aubudget type d’une famille de cinq jour-naliers. Ce budget, estimé par les nota-bles locaux, constitue une approchealternative aux disponibilités alimentai-res. Ces dernières présentent l’avantaged’être calculées à partir de quantitésconsommées ou produites, ou encore devaleurs qui peuvent sembler plus pré-cises que de simples estimations deconsommations par des notables.
Cependant précision n’est pas syno-nyme de vérité. On peut en effet penserque les disponibilités alimentaires ainsi
obtenues reposent elles-mêmes davan-tage sur des estimations de consomma-tions et de productions que sur de réel-les mesures. De plus, ces estimations desdisponibilités alimentaires ne prennentpas en compte un certain nombre dephénomènes qui interdisent d’évoquerdes consommations plutôt que des dispo-nibilités. Tout d’abord, les disponibilitésne tiennent pas compte du commerceinter-arrondissement ainsi que du rôleinégal joué par les importations pour lesdisponibilités calculées d’après laproduction (à l’exception notoire maispartielle du lait). On a toutefois déjàsignalé que le commerce entre arrondis-sements est assez limité. De plus, lesdenrées concernées par ce phénomènesont périssables – le lait – ou sont despondéreux – pommes de terre, châtai-gnes, légumes – qui s’exportent de cefait moins que les denrées connues parleur consommation. D’autre part, lesdisponibilités ne tiennent pas compte del’autoconsommation pour les disponibi-lités calculées d’après des consomma-tions, en particulier pour la viande dansles campagnes. Il y a là un risque bienconnu : la sous-estimation de la consom-mation rurale en viande.
Les budgets populaires présenteraientalors l’intérêt d’avoir pour but de donnerune image proche de la réalité des condi-tions de vie d’une part importante de lapopulation rurale22. Ils peuvent théori-quement être traduits en apports calo-riques et protéiques selon deux hypothè-ses. En effet, pour la partie alimentation,ils sont divisés suivant six postes aux défi-nitions génériques qui laissent place à l’in-terrogation23. La première hypothèse,haute, consiste à suivre l’école classique età postuler un comportement «rationnel»des journaliers où ceux-ci optimisent leursapports alimentaires en fonction des prix
Note : pour les valeurs des 111 arrondissements, moyennes pondérées par la population du recensement de 1851.Rappel : pour la moyenne des disponibilités, les estimations excluent les graisses d’origine végétale.
Tab. 1 Consommations et disponibilités alimentaires
Calories Protides (g) Calcium (mg)Journalier (consommation, 111 arrondissements) 2334 67 292
Moyenne (disponibilités, 111 arrondissements) 2262 74 474
Moyenne nationale (Toutain, pour 1845-1854) 2480
Moyenne nationale (Demonet, pour 1852) 2579
NIVEAUX DE VIE BIOLOGIQUES EN FRANCE AU MILIEU DU XIXe SIÈCLE
171
du marché. Cela signifie que la totalité dela somme dévolue aux dépenses pour laviande sera allouée à l’achat de la viande lamoins chère. La seconde hypothèse, basse,consiste à suivre une approche plus prag-matique et plus culturelle de l’histoire del’alimentation en attribuant pour chaqueposte la structure de consommation quiapparaît lors de l’étude des disponibilitésmoyennes pour chaque arrondissement(cas des céréales et de la viande). Cetteseconde hypothèse, retenue, présentedeux avantages principaux. Tout d’abord,elle est sans conteste plus réaliste que lapremière qui donne des consommationspar journalier en général très nettementsupérieures aux disponibilités moyennespar habitant. Ensuite, en tenant comptede la structure des disponibilités de lamoyenne de l’arrondissement, la consom-mation estimée des journaliers renddavantage compte des différences d’habi-tus alimentaires qui existent de manièretrès prononcée dans une France à la nour-riture certes très monotone mais auxmarchés encore fortement cloisonnés24.
Le budget tel qu’il est donné ne peuttoutefois satisfaire pleinement l’historien.Tout d’abord, dans quelle mesure lebudget d’une famille type de journaliersrend-il compte des conditions de vie desplus démunis et au-delà de la moyenne dechaque arrondissement ? Il s’agit d’une
«catégorie importante du monde paysan,puisqu’elle représente près de quatremillions et demi d’actifs et 2,7 millions depersonnes à charge » (Demonet, 1990,117), soit près de 20% de la populationfrançaise. Le tableau 1, qui compare pourles arrondissements retenus les disponibi-lités alimentaires et les consommationsdes journaliers peut surprendre aupremier abord. Le Français moyen yparaît moins bien loti que le journalier25.Cela tient essentiellement au fait que l’ondéfalque pour les céréales les traditionnels10% de poids pour pertes de stockage etde transport mais non pour le budget desjournaliers26. Cette soustraction est d’au-tant plus importante que les céréales cons-tituent de loin la première source de calo-ries27. Sans la soustraction de ces 10%, ladisponibilité calorique moyenne remonteà 2426 calories, repasse devant la rationdu journalier et devient très proche de laconsommation estimée à l’échelle natio-nale par Toutain. La richesse du « régime »moyen – à strictement parler, il s’agit dedisponibilités – en protides et en lait vientpar ailleurs confirmer la robustesse de noscalculs. De plus, l’ajout ou la soustractionde ces 10% uniformément pour tous lesarrondissements ne joue en rien sur lavariance des disponibilités alimentairesentre arrondissements et donc sur le butdu présent travail.
LAURENT HEYBERGER
172
D’autre part, le budget du journaliersemble ne donner à voir qu’un rapport aumarché : il ne renseigne donc peut-êtrepas sur la consommation totale desfamilles des plus démunis, à une époqueoù l’autoconsommation est encoreprésente, bien que de façon moins impor-tante qu’on ne l’a souvent décrit aveccomplaisance28. La chose semble confir-mée par le dépouillement – pour lesdépartements étudiés – des bordereauxcantonaux de l’enquête agricole : danscertains cantons, les enquêteurs précisentque la dépense pour le poste considéré estnulle du fait que le journalier n’a pasrecours au marché pour subvenir à cebesoin. Ce type d’annotation est toutefoisrarissime. Il laisse cependant planer undoute sur les colonnes restées vierges pourcertaines dépenses dans quelques raresarrondissements (logement, alcools, lait):absence totale de consommation ourecours à l’autoconsommation?
En dernier lieu, l’utilisation parallèledes budgets et des disponibilités moyen-nes permet d’estimer l’importance desinégalités dans la détermination de lastature moyenne29, suivant une interpréta-tion anthropométrique de la théorie deKuznets. Il est probable que la staturemoyenne réagisse davantage aux inégalitésnutritionnelles exprimées en termes debudgets populaires qu’en termes de dispo-nibilités moyennes. En effet, dans lespremiers temps de l’industrialisation, unefaible augmentation des revenus de la partde la population la plus défavorisée peutavoir des manifestations anthropomé-triques nettement plus sensibles qu’uneaugmentation identique concernant descouches plus aisées de la population, carles plus pauvres investissent directementdans l’achat de nutriments essentiels à leursanté, dont ils étaient auparavant privés.
L’IMPORTANCE DU CHOIXDES VARIABLES MESURANTL’URBANISATION
Afin de cerner l’influence de l’urbanisa-tion, la population a été répartie enquatre catégories de milieux de vie selonle tableau 230. Le seuil traditionnel et légalde 2000 habitants agglomérés n’a pas étéretenu pour définir la populationurbaine. Il apparaît en effet comme trèsbas, on préfère donc adopter le seuil de5000 qui est couramment retenu dans lesétudes historiques31. On peut en effetsupposer que l’impact débilitant desconditions de vie urbaine sur le corps desconscrits durant la première révolutionindustrielle ne s’exprime qu’à partir d’unseuil nettement plus élevé que le seuillégal. Ce dernier amène à considérercomme villes un grand nombre de bourgsaux fonctions et aux conditions de vieéloignées de ce que l’on peut considérercomme véritablement urbain. Plus la villeest petite, plus le contact entre ville etcampagne est étroit, plus on doit s’atten-dre à ce que l’approvisionnement de laville se fasse facilement et à ce que lesconditions hygiéniques et épidémiolo-giques soient proches de celles descampagnes.
L’IMPORTANCE D’UN RÉGIMEALIMENTAIRE ÉQUILIBRÉ ETABONDANTET DU CHOIX DES SOURCES
Conformément à l’hypothèse émise,pour l’ensemble des analyses envisagées(modèles 2 à 4 des tableaux 3 à 6), l’ap-port en protides joue un rôle positif etstatistiquement significatif dans l’explica-tion des variations de la stature indivi-duelle ou moyenne (sauf modèle 2 dutableau 6)32. L’apport en calories, consi-
Note : lorsque les régressions sont envisagées avec comme variable expli-quée la stature individuelle, les variables rangs de ville sont les seulesobservées à l’échelle du canton (rappel : les variables extraites de l’en-quête agricole sont observées à l’échelle de l’arrondissement). Lorsque lesrégressions sont envisagées avec comme variable expliquée la staturemoyenne par arrondissement, ces variables sont considérées à l’échelle del’arrondissement.
Tab. 2 Ventilation de la population par rangs de villes
Nombre de citadins Type de milieu Effectif de conscrits toisés
Moins de 5000 Rural 55551
De 5000 à 19999 Petites villes 15439
De 20000 à 74999 Villes moyennes 6889
75000 et plus Grandes villes 3726
NIVEAUX DE VIE BIOLOGIQUES EN FRANCE AU MILIEU DU XIXe SIÈCLE
173
déré séparément (modèle 1 des tableaux 3à 6) joue également un rôle positif, maispas toujours (tableau 6) ou de manièrenon significative (tableau 5). De plus, lerôle des apports en calories est moinssensible. Ainsi, dans le tableau 3, touteschoses étant égales par ailleurs, une dispo-nibilité supplémentaire de 2500 caloriespar jour – deux fois plus dans le tableau 5– correspond à un gain statural d’uncentimètre. En revanche, l’arrondisse-ment qui gagne «seulement» 37 grammesde protides – contre 90 g dans le tableau5–, voit les conscrits obtenir le mêmegain. Ces chiffres, qui correspondentpresque à des rations complètes, consti-tuent, au risque de surprendre, des chiff-res plausibles33. Ils invitent à prendre encompte l’équilibre du régime alimentaire,puisque les protides semblent jouer unrôle plus sensible que les calories.
La prise en compte simultanée de l’ap-port en calories et en protides précise lephénomène. Le signe négatif attribué aucoefficient de la variable calories, aussibien dans les régressions menées à l’échelleindividuelle qu’agglomérée (modèles 3 et4 des tableaux 4 à 6), montre qu’à apporten protides identique, une consommationsupplémentaire de calories exerce un effet
négatif sur la stature. Ce résultat semblerobuste: il se retrouve aussi bien dans lesanalyses menées avec les disponibilitésalimentaires moyennes que dans cellesmenées avec le budget des journaliers.
Dans le cas des régressions menées aveccomme individus statistiques le conscrit(tableaux 3 et 4) ou l’arrondissement(tableaux 5 et 6), les coefficients associésaux variables protides et calories sont plusélevés avec les consommations des journa-liers qu’avec les disponibilités moyennes.Les variations de la stature moyenne s’ex-pliquent donc mieux au moyen desconsommations populaires (budget desjournaliers) que des disponibilités alimen-taires moyennes (R2 également plus élevé)ce qui tendrait à montrer la meilleurequalité des consommations estimées parrapport aux disponibilités34. Ces résultatsconfirment également que la staturemoyenne observée au début de l’indus-trialisation est plus sensible à uneaugmentation des apports nutritionnelschez les plus défavorisés (journaliers) qu’àune augmentation identique qui concernela moyenne de la population(disponibilités). Il ne suffit donc pasd’étudier l’augmentation – ou la diminu-tion – de la ration moyenne pour rendre
LAURENT HEYBERGER
174
compte de l’amélioration – ou de ladégradation – des niveaux de vie biolo-giques durant la première révolutionindustrielle, il faut aussi tenir compte de larépartition des apports nutritionnels ausein même de la population. Cependant,les consommations alimentaires semblentde moins bonne qualité lorsque l’onconsidère calories et protides séparémentdans les tableaux 5 et 6. Les consomma-tions rendent mieux compte du déséquili-bre alimentaire (malnutrition) à l’échelleindividuelle ou de l’arrondissement ainsique des apports globaux (sous-nutrition)à l’échelle individuelle, alors que les dispo-nibilités renseignent mieux sur les apportsglobaux à l’échelle de l’arrondissement.Dans un siècle où le problème alimentairen’est plus la sous-nutrition mais plutôt lamalnutrition, les budgets des journalierssont plus riches en enseignement que lesdisponibilités moyennes calculées princi-palement d’après la consommation et laproduction.
En effet, l’apport en calories ne jouepas à lui seul une influence négative surla stature, mais seulement en regard del’apport en protides. On aurait pu crain-dre que l’ajout de la variable calories à lavariable protides dans les régressionsn’amène à un résultat statistiquementnon significatif en raison de la forteproximité de ces deux variables. Lerégime des Français étant alors encoreessentiellement fondé sur la consomma-tion de céréales, ces dernières consti-tuent la principale source de calories etde protides, et, avec les légumes,jusqu’aux quatre cinquièmes dans le casdes journaliers35. On peut donc suppo-ser que l’apport en calories est étroite-ment corrélé à l’apport en protides36.Cependant, dans cette France de semi-végétaliens, les modestes gains nutri-tionnels qu’assure la consommation de
viande et de produits laitiers n’en parais-sent que plus importants. Ils détermi-nent un régime relativement plus équili-bré que celui des mangeurs de céréales etapportent ainsi un gain statural.
LE RÔLE AMBIGU DU LAIT
Conformément à l’hypothèse émise,les analyses menées montrent que le laitjoue un rôle important dans la nutritiondes Français au milieu du XIXe siècle. Àconsidérer les disponibilités alimentairesmoyennes, il représente près de la moitiédes protides d’origine animale, et encoreplus dans la consommation des journa-liers37. Si on considère les apports en lait(calcium) relativement aux apports encalories, les conclusions sont un peudifférentes qu’avec l’apport total en proti-des, car le lait joue un rôle somme toutesecondaire par rapport à l’ensemble desprotéines végétales et animales (régres-sions non reproduites ici). Pour lesrégressions menées avec la stature indivi-duelle et où l’on utilise simultanément lescalories et le calcium, les deux variablesjouent un rôle positif et significatif dansles variations de la stature, plus sensiblepour le lait. Dans le cas d’une régressionn’envisageant que le rôle des disponibili-tés en lait dans les variations de la statureindividuelle, les arrondissements quibénéficient d’un apport supplémentairede 555 mg de calcium par jour, soit envi-ron 44 cl de lait entier cru, voient lesconscrits gagner un centimètre, touteschoses étant égales par ailleurs.
Dans le cas des régressions menéesavec la stature moyenne par arrondisse-ment et où l’on utilise simultanémentles calories et le calcium, seuls lesapports en calcium jouent un rôle posi-tif et significatif sur la stature. Dans lecas des modèles qui ne retiennent que le
NIVEAUX DE VIE BIOLOGIQUES EN FRANCE AU MILIEU DU XIXe SIÈCLE
175
calcium, l’hypothèse « lait » de JörgBaten, émise à l’échelle départementale,est à nouveau validée à l’échelle de l’ar-rondissement avec les disponibilitésmoyennes, mais beaucoup moins avecles consommations populaires38. Laconsommation estimée de lait est peut-être de mauvaise qualité : l’autoconsom-mation est un phénomène à prendre enconsidération. De plus, si le lait repré-sente plus de la moitié des protidesd’origine animale pour les journaliers,ces derniers tirent plus de 80% de leursprotides des végétaux. Enfin, il ne fautpas oublier l’importance du lait mater-nel. Il n’est au final pas surprenant quel’influence du lait sur la taille se lisemoins au moyen des budgets populairesque des disponibilités alimentairesmoyennes.
L’INSTRUCTION: RETOUR SURINVESTISSEMENT ET IDH
La première étude ayant mis enévidence la relation entre stature etinstruction, avant les travaux de l’équiped’Emmanuel Le Roy Ladurie, remonte à1882 mais est restée longtemps mécon-nue (Carret, 1882). Ce lien fait désormaispartie des fondamentaux de l’histoireanthropométrique. Le principe déclaratifsur lequel repose notre connaissance del’instruction des conscrits ne pose pasproblème39. À l’échelle individuelle, ledegré d’instruction joue un rôle sensible –et statistiquement significatif – sur lastature. Les conscrits analphabètes mesu-rent de 1,9 à 2,5 cm de moins que lesconscrits instruits, toutes choses étantégales par ailleurs (tableau 4 modèle 3 ettableau 3, modèle 1, même référencepour les données suivantes). Ceux n’ayantreçu qu’une instruction très sommaire –conscrits ne sachant que lire – occupent
une position intermédiaire. Les plusgrands, ici le groupe de référence, sont lesconscrits sachant lire et écrire. Il s’agit dedifférences importantes, sachant qu’à titrede comparaison la stature médiane àl’échelle nationale progresse de 3,4 cmentre 1784 et 1902 (années de naissance,Weir, 1997, 191).
À l’échelle de l’arrondissement,l’influence de l’instruction a été saisie aumoyen du pourcentage de conscritssachant lire et écrire. À elle seule, cettevariable rend compte de plus de la moitiédes variations de la stature moyenne40. Laformation du «capital humain » sembledonc constituer le meilleur facteurexplicatif des inégalités staturalesobservées41. D’une part, dans uneperspective bourdieusienne, le degréd’instruction du conscrit reflète le capitalculturel, social et économique de safamille d’origine. Les «héritiers» sont icifavorisés: ils sont nés dans un milieu plusaisé, qui leur assure une meilleureinstruction, mais aussi de meilleurs soinset une meilleure nutrition. D’autre part,ce capital culturel leur permet également,à l’adolescence, de mieux s’insérer sur lemarché du travail et ainsi de bénéficier deplus forts revenus leur garantissant ànouveau de meilleurs soins, un régimealimentaire plus varié et un travailphysique moins pénible. La chose estd’autant plus importante que la crois-sance de l’adolescence, qui se déroule auXXe siècle plus précocément, est plustardive au XIXe siècle : l’impact desrevenus peu avant l’âge d’examen estdonc très probablement plus fort au XIXe
siècle qu’au XXe siècle.Cependant, il ne faut pas envisager
l’instruction seulement en tant quefacteur explicatif de la stature moyenne.En effet, l’instruction constitueactuellement l’une des composantes de
LAURENT HEYBERGER
176
l’IDH (Indice de DéveloppementHumain) défini par les Nations Unies.Elle est donc considérée à part entièrecomme un indice du niveau de vie, aumême titre que la stature moyenne(OMS, 1995). La forte corrélation entrestature et taux d’alphabétisation àl’échelle de l’arrondissement donnedonc aussi à voir la forte proximité deces deux indices de développementhumain au milieu du XIXe siècle.
DES CAMPAGNESAUX GRANDES MÉTROPOLES:LE RÔLE DE L’URBANISATION
Dans les régressions calculées à l’échelleindividuelle, le milieu de vie exerce uneinfluence sensible et significative sur lastature à l’exception notoire des petitesvilles, telles Alençon, Beaune, Épinal,Quimper ou Rodez, où les conscrits ont lamême taille que dans les campagnes, ce quisemble alors rejoindre un modèle méditer-ranéen d’urbanisation faible sans industria-lisation, où les citadins sont plus grandsque les ruraux ou aussi grands qu’eux42.Ceci vient confirmer que la définitionlégale de la ville n’est pas pertinente lorsquel’on étudie les niveaux de vie biologiquespuisque même avec un seuil largementsupérieur au seuil légal, l’influence dumilieu urbain n’est pas évidente. Seules lesvilles d’une taille conséquente – au-delà de20000 habitants – exercent une influencedébilitante sur la croissance des corps. Parrapport au groupe de référence, vivant enmilieu rural, les habitants de villes moyen-nes telles qu’Aix, Mulhouse, Cambrai,Brest ou Poitiers perdent environ 0,3 cm(de 2 à 6 mm selon les modèles). Ceux desgrandes métropoles (Rouen, Lille, Lyon etMarseille) perdent environ 0,8 cm (d’undemi à un centimètre selon les modèles).La perte est donc réduite, même pour les
habitants des plus grandes villes du pays,surtout si l’on compare ces différences destature aux inégalités socioprofessionnelles.
La France a donc la chance de s’indus-trialiser sans connaître l’essor de grandscentres industriels et urbains tropnombreux. Ce résultat vient nuancer lesconclusions de Weir qui observe toute-fois l’influence de la variable urbanisa-tion à l’échelle du département et aumoyen du pourcentage de la populationurbaine ou de son logarithme, ce quivient justement gommer l’effet de seuilmis ici en évidence43. Ainsi, même si lesquatre métropoles citées sont reliées àun réseau de chemin de fer dès la petiteenfance des conscrits – bien qu’à l’étatembryonnaire pour Marseille et surtoutpour Lyon –, cela n’empêche pas lemilieu urbain d’exercer une influencenégative sur la taille. D’ailleurs lesréseaux traditionnels d’approvisionne-ment qui déterminent le semis urbaineuropéen supportent tant bien que malla croissance urbaine avant l’arrivée dutrain (Grantham, 1997, 714 et Bairoch,1990). Davantage qu’à une déficiencetechnique de l’approvisionnement ennutriment, la plus petite taille de cescitadins pourrait donc renvoyer à d’au-tres problèmes spécifiquement métro-politains, comme les mauvaises condi-tions hygiéniques et épidémiologiquesrésultant de l’hyper-densification de laville historique ou, plus généralement,les prix relatifs plus élevés des alimentsqui désavantagent les citadins.
STATURE ET PROFESSION:ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ
Hormis les professions dont les cons-crits ont en moyenne moins d’un milli-mètre d’écart avec les exploitants agrico-les, groupe le plus nombreux et donc
NIVEAUX DE VIE BIOLOGIQUES EN FRANCE AU MILIEU DU XIXe SIÈCLE
177
groupe de référence, ces dernières jouentun rôle sensible et significatif dans lesvariations de stature44. La définition deces groupes est très problématique carelle doit répondre à certaines questionspropres à l’histoire anthropométriquetout en essayant de respecter les hiérar-chies sociales contemporaines, exercicetoujours difficile pour l’historien45.Ainsi, outre le foisonnement extrêmedes activités, on a dû composer avec lefait que certains préfèrent s’identifierpar leur statut plutôt que par leur bran-che d’activité.
Les groupes de l’alimentation et descommerçants de l’alimentation testentl’hypothèse d’un avantage que tireraientles conscrits de leur proximité aux sourcesde nutriments. De même, la distinctionentre «artisans» spécialisés (bois, métal-lurgie, etc.) ou non et « industrie» vise àcerner l’influence de la taille de l’entre-prise et de l’organisation du travail enmilieu industriel. Seuls les conscrits dontla profession indiquait sans doute possiblel’appartenance à la grande industrie nais-sante46 ont été agrégés à la catégorie«industrie», alors que de nombreux autresconscrits auraient pu l’être si on avaitconnu leur entreprise d’activité. Il y adonc des ouvriers de grandes unités deproduction (plutôt qualifiés) rattachés ennombre inconnu aux catégories «arti-sans ». Toutefois ce phénomène restemodeste dans une France encore trèslargement dominée par la petite unité deproduction, tant dans l’agriculture quedans l’industrie. La distinction entre«étudiants » et «professions libérales »prête elle aussi à discussion. Pour laplupart des conscrits de ce dernier groupe,l’activité déclarée est en fait celle d’étu-diant en droit47, le premier groupe réunis-sant les étudiants sans précision supplé-mentaire ou les étudiants en sciences.
L’historien est par ailleurs tributaire de sasource. Par exemple, trop de conscritssont, dans certaines régions, enregistréscomme simples «cultivateurs» alors quedans d’autres, tout aussi viticoles, lesvignerons sont recensés comme tels48.
L’influence de la profession du cons-crit sur la taille rend compte de plusieursphénomènes complexes. Tout d’abord,dans une société aux mobilités sociopro-fessionnelles réelles mais inégales, ellerenvoie pour beaucoup à la professiondes parents et donc in fine au milieusocial d’origine49. Utiliser la professiondu conscrit en tant qu’approximation deson milieu d’origine constitue donc uneapproche pertinente en l’absence demention de la profession des parentsdans nos sources. De plus, une analyserécente sur des données bavaroisesmontre qu’après contrôle pour la profes-sion des parents, la profession du cons-crit joue un rôle propre qui renvoienotamment aux bonnes ou aux mauvai-ses conditions de travail durant l’adoles-cence (Lantzsch et Schuster, 2009, 53).
La hiérarchie anthropométrique qui sedégage de l’analyse professionnelleconfirme très nettement l’influence ducapital culturel sur la taille moyenne : lesfuturs avocats ou ingénieurs dominent de3,5 cm les tailleurs et autres conscrits del’habillement (tableau 3, modèle 1). Ils’agit là d’une différence considérablecomparée au gain séculaire de la moyen-ne nationale (rappel : 3,4 cm entre 1784et 1902). De manière générale, les colsblancs sont tous nettement favorisés parrapport aux agriculteurs exploitants : ilssont plus instruits mais exercent égale-ment des métiers moins fatigants. Gaged’un certain archaïsme, les commerçantsde l’alimentaire tirent un profit de leurproximité aux nutriments, ce qui estmoins le cas des commerçants en général
LAURENT HEYBERGER
178
et encore moins des professions debouche (boulangers, bouchers, charcu-tiers, etc.) qui, pour beaucoup – cas desouvriers –, voient les aliments transiterdevant eux sans en bénéficier. Ausommet de la hiérarchie anthropomé-trique des manuels, les artisans du bois etde la métallurgie dominent de très peu lesexploitants agricoles. Ces derniers sonten définitive relativement proches desnon exploitants. Les salaires agricolesont sensiblement augmenté durant lapériode de croissance de l’adolescence desconscrits et expliquent peut-être la chose.
On retrouve en bas de la hiérarchieanthropométrique des professions tradi-tionnellement tenues pour mal payées et engénéral à faible qualification: habillement,textile, bâtiment. La taille de l’échantillonpermet de faire apparaître les ouvriers peuqualifiés de la grande industrie naissante :ceux-ci sont parmi les plus mal lotis, maisils sont aussi peu nombreux, contraire-ment aux professions plus traditionnellesde l’habillement et du bâtiment. Les casdu textile et de la mine sont plus délicats.D’une part ces deux branches comportenten leur sein aussi bien des actifs travaillantdans de petites unités de production tradi-tionnelles que dans de grands ensemblesmodernes – encore peu nombreux –, d’au-tre part les mineurs peuvent devoir leurpetite taille aussi bien à leur faible salaire –cas le plus probable – qu’à une sélectionsur critère anthropométrique50.
Au total, la hiérarchie anthropomé-trique qui se dégage de l’analyse parprofession est frappée du sceau dela tradition mais laisse apparaître, au-delà des nombreux artisans51 et cultiva-teurs au niveau de vie biologique assezmédiocre, des traces de modernitéurbaine, industrielle et tertiaire où lesécarts entre professions semblent davan-tage marqués.
CONCLUSION
La confrontation de l’enquête agricolede 1852 et d’une partie des listes detirage au sort de la classe 1868 permetde déterminer assez précisément lesfacteurs explicatifs de la stature àl’échelle individuelle ou de l’arrondisse-ment, à un moment où les inégalitésspatiales de statures sont considérables,où le marché national est en voie d’uni-fication, les sources de protides encoreessentiellement végétales et les campa-gnes à leur apogée démographique.Considérés séparément, les apports encalories, protides et calcium jouent unrôle dans les variations de la stature.Davantage que les seules disponibilitésou consommations en lait ou en proti-des, la combinaison des apports enprotides et en calories rend compte deprès d’un tiers (disponibilités) à deuxcinquièmes (consommations des journa-liers) des variations de stature moyenne.Le budget d’une famille de cinq journa-liers, estimé par les notables de l’époque,semble donc constituer un bon outilpour expliquer la stature moyenne etindividuelle des Français nés en 1848,en comparaison des disponibilitésalimentaires, elles aussi tirées de l’en-quête de 1852. La stature réagit davan-tage aux variations des consommationspopulaires qu’aux variations des dispo-nibilités moyennes. Les inégalités nutri-tionnelles semblent jouer un rôle impor-tant pour expliquer cette différence.Une augmentation identique en valeurabsolue de l’apport nutritionnel adavantage de conséquences anthropo-métriques sur la stature moyenne lors-qu’elle est le fait des populations les plusdéfavorisées, car elle vient combler lescarences alimentaires les plus criantes, cequi n’est pas le cas parmi les populations
NIVEAUX DE VIE BIOLOGIQUES EN FRANCE AU MILIEU DU XIXe SIÈCLE
179
plus aisées. Par ailleurs, les régimes rela-tivement riches en protides pour unapport calorique identique, qui se trou-vent au nord de la fameuse ligne Saint-Malo-Genève, semblent plus propicesau développement des corps. Le tauxd’alphabétisation, composante actuellede l’IDH, paraît également étroitementcorrélé à la stature moyenne.
Le rôle de l’urbanisation doit être traitéavec précaution. À l’échelle du départe-ment et au moyen de taux d’urbanisationou de leurs logarithmes, Weir montre unerelation entre forte urbanisation et hautestature moyenne. Cependant avec commeindividu statistique l’arrondissement, lacorrélation devient négative mais nonsignificative – analyse non reproduite ici.Enfin, avec comme individu statistique leconscrit et une variable urbanisationdiscrétisée à l’échelle du canton, la corré-lation est négative et significative. Ainsi, àmesure que l’on descend dans les unitésécologiques d’observation, la relationentre urbanisation et stature se voitprofondément modifiée : il y a là ecologi-cal fallacy. Il n’y aurait donc pas d’excep-tion française concernant le rôle de l’urba-nisation durant la première révolutionindustrielle, sinon par le fait que le payss’est peu urbanisé tout en s’industriali-sant, ce qui lui a vraisemblablement valude ne pas connaître de baisse de stature
aussi sensible que dans d’autres pays. Ence qui concerne l’histoire urbaine du pays,il en va de la stature comme d’autresphénomènes socio-économiques : pourJohn Merriman, la France « reste unenation de paysans» (ou plutôt de ruraux)mais « l’impact de l’urbanisation est aussiimportant en France que dans d’autresnations plus urbanisées » (Bourillon,1995, 7). Dans les quatre grandes métro-poles (Rouen, Lille, Lyon et Marseille), lastature atteint un minimum : la métropo-lisation n’est pas au milieu du XIXe siècleun facteur de mieux-être, en Francecomme à l’étranger, même si la baissestaturale reste modeste.
Au vu de ces résultats, on peut suppo-ser que l’unification du marché nationalet l’enrichissement du régime alimen-taire, tous deux favorisés par la construc-tion d’un réseau ferré national etd’intérêt local, mais également l’achève-ment de la scolarisation primaire desFrançais et des Françaises et les amélio-rations hygiéniques en ville contribuentfortement à modifier la géographieanthropométrique de la France à la findu XIXe siècle et au début du XXe siècle.
Laurent HEYBERGERLaboratoire RECITS,
UTBM Site de Sévenans,90 010 Belfort cedex.
NOTES
LAURENT HEYBERGER
180
1. Ce travail a bénéficié du support financier duprogramme franco-japonais Chorus sur lesniveaux de vie en France et au Japon. Je tiens àremercier l’ensemble des intervenants de ceprogramme pour leurs remarques et suggestions,et tout particulièrement Jean-Pierre Dormois, demême que les membres du workshop sur lesniveaux de vie en France et en Espagne organisépar l’AEHE et l’AFHE (Aix, 2008), et toutspécialement le regretté Gérard Gayot. Merciégalement à Robert Allen, Jean-Pascal Bassino,Vincent Bignon, Matthieu Bunel, Michel Hau,Alexander Moradi, Gilles Postel-Vinay et auxauditeurs du workshop d’histoire économique duNuffield College qui ont contribué à précisercertaines hypothèses, notamment dans le traite-ment statistique des données. Je remercie égale-ment les rapporteurs pour leurs suggestions.Enfin, cette étude n’aurait pu se faire sans lacollaboration passionnée des élèves-ingénieurs del’UTBM qui se sont penchés sur les listes detirage au sort, travail parfois ingrat car les sourcesne permettent pas toujours d’aboutir : OlivierAlquier, Pierre-Étienne Ballant, Romain Besesty,Timothée Birckel, Lionel Bousquet, Jean-CharlesCancian, Michaël Casaux, Thomas Chabanne,Romain Coisne, Émilien Colmagne, ThomasCroizé, Clément Dague, Yves Derkac, ClémentDespeyroux, Alexis Dolé, Julien Ehrhart, NicolasEmery, Nicolas Fariault, Vincent Féry, NicolasGalmiche, Aurélien Gruny, Kianouch Hargou,Pierre Haritchabalet, Alexandre Honoré, NicolasKarmann, Johan Laroche, Amaury Leroux deLens, Jean-Baptiste Lombard, SébastienLombard, Thomas Martzolff, Frédéric Mille,François Minaud, Michaël Monnier, MehdiMoutamani, Bernard Paris, Bruno Ronzani,Pierre-Yves Savary, Dora Louisa Songo-Kette,Thomas Spitz, Jean-Baptiste Staebler, DelphineTerrier, Solange Umuhire et Claire Visot.
2. Demonet (1990, 214-215) estime que seuls13% du froment produit dans les arrondisse-ments sont exportés hors de ceux-ci. Or les bledsfournissent plus du tiers du commerce au-delà del’arrondissement. En tout, environ 19% desdenrées où le calcul est possible ne sont pas utili-sés sur place. Ce fort pourcentage s’expliquesurtout du fait que le vin s’exporte pour moitié,
mais il n’entre pas en compte dans le calcul desrations alimentaires.
3. La stature semble par ailleurs atteindre unminimum séculaire, voire millénaire, à la fin duXVIIe siècle (Steckel, 2009, 15) : au milieu du XIXe
siècle, la menace de crise malthusienne est passée.Ce n’est « que » dans la période 1800-2000 que lemilieu du XIXe siècle apparaît comme un momentde fortes inégalités anthropométriques.
4. D’autres études d’histoire anthropométriqueenvisageant spécifiquement les rapports entrenutrition et stature : Alter, 2004; Baten et Murray,2000; Baten, 2009; Craig, Goodwin et al., 2004;Federico, 2003 ; Fogel, 2004 ; Schneider, 1996.Avant même le développement de la nouvellehistoire anthropométrique, Toutain avait prudem-ment émis l’hypothèse d’un lien entre disponibili-tés alimentaires et stature pour la France (Toutain,1971, 1992-1995).
5. L’enquête agricole a fait l’objet d’une premièreexploitation en ce sens par Gabriel Désert : (Désert,1975) ; voir aussi les analyses de Demonet, 1990,ainsi que Postel-Vinay et Robin, 1992.
6. À l’échelle historique – sans contrôle par l’an-thropométrie –, voir Vecchi et Coppola, 2006.Pour une approche de données contemporaines(FAO) éclairées par l’anthropométrie, voirSvedberg, 2002.
7. Les historiens débattent de la période la plusimportante à considérer pour déterminer uneinfluence des conditions de vie sur la taille adulte.Ainsi, conformément à « l’hypothèse Barker »,Baten et Murray (Baten et Murray, 2000, 367)mettent en évidence une influence maximale desdisponibilités alimentaires durant l’année mêmede naissance alors que Banerjee, Duflo, Postel-Vinay et al. montrent l’impact du phylloxerapour la seule année de naissance (Banerjee, Dufloet Postel-Vinay, 2007, 4). Cependant les spécia-listes en auxologie insistent généralement surl’importance de l’ensemble de la petite enfance(de la croissance in utero à l’âge de 3 ans). Lesjeunes gens nés en 1848 sont âgés de 4 ans lors del’enquête agricole de 1852 : cette dernière renddonc bien compte des conditions de vie de l’en-semble de la petite enfance de la cohorte considé-rée. La cohorte née en 1848 a par ailleurs
NIVEAUX DE VIE BIOLOGIQUES EN FRANCE AU MILIEU DU XIXe SIÈCLE
181
peut-être particulièrement souffert durant sapériode de croissance initiale, car elle fut exposéeà l’épidémie de choléra de 1849. Toutefois, lesnourrissons ont pu être épargnés grâce à l’allaite-ment maternel. De plus, bien que la moyennenationale pour les années 1849 et 1850 ne soitpas calculée par David Weir, les données àl’échelle locale (Heyberger 2005, 605) nepermettent pas de conclure à une baisse généralede la stature en 1848 par rapport aux annéesantérieures ou postérieures.
8. Les départements concernés sont : l’Aube,l’Aude, l’Aveyron, les Bouches-du-Rhône, leCalvados, la Corrèze, La Côte d’Or, les Côtes-du-Nord, la Creuse, le Doubs, la Drôme, le Finistère,le Gard, le Gers, l’Hérault, l’Indre, le Jura, laLoire-Inférieure, le Maine-et-Loire, la Marne, laHaute-Marne, la Meurthe, le Morbihan, laMoselle, le Nord, l’Orne, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, La Haute-Saône, la Seine-et-Marne, la Seine-Inférieure, la Somme, la Vienne,la Haute-Vienne et les Vosges. Certains dossiersde conscrits ne comportent pas de mention destature, c’est parfois le cas d’arrondissementsentiers. D’autres – très rarement – mentionnentdes tailles douteuses (très faibles) et ont été élimi-nés. La vérification de la normalité de la distribu-tion de taille pour chaque arrondissement amènepar ailleurs à éliminer quelques arrondissementsoù les effectifs en-deçà de deux écarts-types sonttrop faibles (existence d’une taille minimalelégale, fixée à 155 cm). De plus, les arrondisse-ments où il restait moins de 100 conscrits toisésont été éliminés des observations. Enfin, on a dûéliminer un arrondissement où le degré d’instruc-tion des conscrits n’était pas renseigné, ce quiinterdisait de calculer un taux d’alphabétisation.
9. La stature est un indice synthétique du niveau devie. L’alimentation est elle-même un phénomènecomplexe où il serait vain de vouloir isoler unaliment plutôt qu’un autre selon l’importancesupposée qu’on lui accorderait dans le retard oul’avance de croissance en raison de sa compositionnutritionnelle. Plutôt que de tenter de saisir l’in-fluence de la consommation d’aliments réputésmauvais pour la croissance (pommes de terre,châtaignes, etc), mieux vaut donc confronter unindice synthétique du niveau de vie biologique à unindice synthétique des apports nutritionnels. Nousconservons toutefois par convention le termedisponibilités alimentaires bien qu’à strictement
parler il s’agisse plutôt de disponibilités nutrition-nelles. Sur le rapport non linéaire entre apports (oudisponibilités) en aliments et apports en nutri-ments, voir Logan, 2006.
10. Suivant le plus souvent les hypothèses deDemonet, 1990, qui nous paraissent les plus plau-sibles et plus rarement celles de Toutain, 1971.Pour les parties comestibles de chaque denrée et lacomposition nutritionnelle des aliments, voirRandouin et al., 1961 (ouvrage utilisé par J.-C.Toutain). Des tables plus récentes ont été consul-tées, mais elles fournissent des teneurs en calories etprotides encore plus éloignées de ce que devaientêtre les teneurs au XIXe siècle (même entre les diffé-rentes tables actuelles, les teneurs peuvent variersensiblement entre pays). Par ailleurs, même si lesdictionnaires médicaux et autres ouvrages scienti-fiques du XIXe siècle donnent des indications peut-être plus proches de la réalité contemporaine, il n’apas été possible de reconstituer pour tous lesaliments les indications nécessaires. Quand bienmême cela aurait été possible, cela n’aurait pasconstitué une garantie suffisante : dans un mondeencore très cloisonné, il est plus que probable queles teneurs effectives variaient fortement d’unerégion à l’autre du fait d’une biodiversité bien plusforte que de nos jours et d’une standardisation dessemences encore à venir. Vision plus optimiste dece problème de la conversion en apports nutrition-nels d’après des tables actuelles (pour une périodeun peu plus récente) dans Logan, 2006, 531.
11. Les disponibilités locales en lait ont étéconservées telles quelles : on n’a pas essayé deprendre en compte les pertes inégales – surtoutpour la teneur en calcium et en protides – quirésultent des processus de transformation enbeurre et en fromage. Nos estimations sont en cesens des hypothèses hautes. Il en va de mêmepour les autres denrées : on n’a pas considéré lesmodes de préparation culinaires qui viennentinégalement diminuer la quantité de calories etde protides – sans parler des vitamines – effecti-vement absorbée.
12. Le Doubs, le Jura et le Calvados font partiede notre échantillon.
13. Cependant le lait de brebis, très consomménotamment dans le Massif central, contient plusde protides et de calcium. Il n’est pas inclus dansles présentes estimations, faute de données sur laproductivité des brebis.
LAURENT HEYBERGER
182
14. Disponibilité déduite de la production et dela valeur des légumes de plein champ, bien qu’ilsoit évident que la valeur des légumes du jardinest supérieure à celle des légumes de plein champ.
15. Déduit de la production nationale donnéepar d’Angeville, 1836, 116. Vue l’inertie quicaractérise la production des « arbres à pain »avant la grande maladie qui s’abat sur ces derniersaprès 1875, la date de 1836 ne paraît pas tropéloignée de 1852.
16. Déduit des prix et des poids donnés parArmand Husson.
17. Également d’après la productivité annuelledes poules de l’enquête agricole de 1862 donnéepar département. C’est là la moins bonne sérieconcernant les aliments d’origine animale.
18. Car il était impossible de déterminer la naturede ceux-ci à l’échelle locale. Toutefois, commepour les légumes, l’apport calorique et protéiquedes fruits est très faible en comparaison desaliments précédents. Il s’agit d’un problème trèscourant : de nos jours, la FAO, faute de sources,n’inclut ni les fruits ni les légumes dans ces esti-mations.
19. Le sucre de betterave est produit dans unnombre très réduit d’arrondissements, puisexporté dans le reste du pays. Attribuer la totalitéde la production de sucre à la consommation del’arrondissement producteur constituerait uneaberration.
20. Pour la même raison que pour le sucre.
21. Cette remarque vaut également pour lesimportations – encore modestes – prises dansleur ensemble.
22. Les agriculteurs non exploitants (salariés agri-coles, dont journaliers – 4,9% de l’échantillondes conscrits toisés –, domestiques – 5,9% –,bergers, manouvriers, etc.) représentent 13,9%de notre échantillon de conscrits toisés. Comptetenu des cycles de vie, ils sont moins nombreuxdans la population totale : voir Demonet, 1990,43 ainsi que Marchand et Thélot, 1997. Uneapproche antérieure des consommations populai-res dans Postel-Vinay et Robin, 1992.
23. Ce sont dans l’ordre : le pain, les légumes,la viande, les alcools (lait, vin, bière et cidre) etle sel.
24. Ainsi, pour le «pain», on considère, suivantEugen Weber, que ce mot générique désigne davan-
tage les farines que le pain proprement dit, encorepeu commercialisé tel quel (Weber, 2005, 171-174).Le budget pain a lui-même été subdivisé en consom-mation de farine de froment, de seigle, de méteil,etc. Les estimations de consommations populairesde Michel Demonet (Demonet, 1990, 120) appli-quent un panier national identique à tous les arron-dissements et ne retiennent comme valeurs localesque les prix. Pour le poste « légumes », on retientl’hypothèse de Demonet, à savoir une assimilationtotale de ce poste à l’achat de pommes de terre.
25. La confrontation des disponibilités (d’après laproduction) et des consommations populaires(d’après budgets) peut amener à remettre enquestion des idées préconçues. Voir note 6.
26. Il est évident que les phénomènes de stockageet de transport jouent de fait des rôles forts diffé-rents d’une région à l’autre, dans un siècle où lesconditions de stockage évoluent inégalement mais,faute de mieux, on est obligé d’appliquer un tauxde perte uniforme pour tous les arrondissements.
27. Toujours pour les 111 arrondissementsétudiés, les céréales représentent 72,6% desdisponibilités totales en calories.
28. Notamment chez Eugen Weber (1983). Pourune remise en cause statistique de cette thèse, voirGilles Postel-Vinay et Jean-Marc Robin. Selonces auteurs, la consommation est extrêmementlocalisée mais fait appel au marché : 70% de laproduction nette de blé est commercialisée(Postel-Vinay et Robin, 1992, 497).
29. Des modèles – non reproduits ici – ont étéconstruits avec comme variable dépendante nonplus la stature de l’ensemble de la population del’arrondissement, mais avec la stature des seulsjournaliers ou assimilés. En effet, on peut supposerque l’influence des apports nutritionnels tirés dubudget d’une famille de cinq journaliers se faitdavantage sentir sur cette population que sur l’en-semble des conscrits. Toutefois, les résultats obte-nus ne sont pas satisfaisants, notamment en raisondu nombre beaucoup trop réduit de conscrits jour-naliers ou assimilés toisés par arrondissement.
30. Les populations totales par arrondissementsont empruntées au recensement de 1851, lespopulations urbaines à René Le Mée (Le Mée,1989, 332-393). Les régressions ont égalementété calculées en exprimant la variable urbanisa-tion en pourcentage de la population totale. Lesconclusions restent les mêmes, que l’on envisage
NIVEAUX DE VIE BIOLOGIQUES EN FRANCE AU MILIEU DU XIXe SIÈCLE
183
un pourcentage ou un logarithme du pourcen-tage : l’urbanisation exerce une influence négativesur la stature. En dépit d’un classement qui peutparaître sommaire et prêter à discussion, ladiscrétisation de la variable urbanisation enquatre catégories permet de saisir immédiatementet concrètement l’influence du milieu urbainexprimée en centimètres.
31. Que ce soit par les historiens économistescomme Paul Bairoch depuis 1985, par les histo-riens des villes (Pinol et Walter, 2003, 25-26) ouencore par les chercheurs en histoire anthropo-métrique (Baten et Murray, 2000, 362).
32. Les régressions sont calculées avec des observa-tions à l’échelle individuelle et à l’échelle agglomé-rée (arrondissement), chaque méthode présentantson propre intérêt. La première permet de saisir audegré d’analyse le plus fin l’influence de l’un oul’autre facteur explicatif. Cependant, compte tenudu très grand nombre d’observations individuelles,la variance totale de la stature est davantage le faitde la génétique que de facteurs socio-économiques.Le R2 ajusté est donc très faible, même si les coeffi-cients pris individuellement présentent un intérêt.Les analyses à l’échelle agglomérée permettent aucontraire de voir pleinement jouer le rôle plus oumoins important des facteurs socio-économiquesdans la mesure où la stature moyenne, contraire-ment à la stature individuelle, constitue un indicebien plus socio-économique que génétique. Sur ceproblème méthodologique, voir Baten et Murray,2000, 363.
33. Voir des résultats similaires avec une appro-che un peu différente : Haines, Craig et Weiss,2003, 404.
34. Sur le problème de la validation de la qualité desestimations alimentaires par les données anthropo-métriques, nous renvoyons à Peter Svedberg, 2002.
35. Les protides d’origine animale ne représen-tent que 32,2% des protides totales (disponibili-tés alimentaires) pour la moyenne de la popula-tion et – assez logiquement – encore moins chezles journaliers : 18,3% (moyennes pondéréespour les 111 arrondissements).
36. La régression protides/calories donne R2=0,89pour les disponibilités moyennes et R2=0,85 pourles consommations des journaliers.
37. Respectivement 49,4 et 60,6% (moyennespondérées pour les 111 arrondissements).
38. La corrélation entre disponibilités moyennesen calcium (lait d’origine bovine) – nettes de laconsommation parisienne – et stature moyennepour 111 arrondissements donne R2 = 0,25 auseuil de rejet de l’hypothèse nulle de 0,1 %. Ilfaut 36 cl de lait (454 mg de calcium) pourgagner un centimètre de taille moyenne.Contrairement aux analyses de Baten, la corréla-tion, bien que statistiquement significative auseuil de rejet de 0,1%, est beaucoup plus faibleavec la consommation de calcium des journa-liers : R2 = 0,08.
39. Sur la fiabilité et la signification de cettevariable, voir Furet et Ozouf, 1977, 18-24.
40. R2 = 0,59, probabilité de l’hypothèse nulleinférieure à 0,1 % pour 111 arrondissements.
41. Sur la relation entre stature et instruction (desparents ou de l’individu toisé), voir Steckel,2009, 8-9, ainsi que Meyer et Selmer, 1999, pourune régression contrôlant l’influence de la duréedes études par les revenus sur un échantillonnorvégien du XXe siècle.
42. Pour l’Espagne, faiblement urbanisée etindustrialisée, Martinez-Carrion et Moreno-Lazaro (2007) concluent, avec la même défini-tion de la population urbaine, à une influencepositive de l’urbanisation au milieu du XIXe siècle.
43. Les corrélations – non reproduites ici – calculéesavec une variable urbanisation observée à l’échellede l’arrondissement (variable expliquée : staturemoyenne) et non plus du canton (variable expli-quée: stature individuelle) donnent des résultats parailleurs non significatifs, signe supplémentaire quele département ou l’arrondissement constituent desentités trop vastes pour cerner avec pertinence l’in-fluence du milieu urbain sur la stature.
44. L’introduction de deux variables profession-nelles (groupes « textile » et « agriculteurs nonexploitants ») dans les régressions calculées àl’échelle de l’arrondissement ne donne cependantpas de résultats satisfaisants. La répartitionspatiale des groupes professionnels est tropcomplexe pour pouvoir rendre compte des diffé-rences de taille moyenne entre arrondissement.
45. Voir notamment Desrosières, 1987, 156-165, Desrosières, 2000, 289-342 ; Marchand etThélot, 1997. Nous avons rencontré les mêmesdifficultés et adopté en grande partie la mêmestratégie que Jacques Dupâquier et Jean-Pierre
Pélissier (Dupâquier et Pélissier, 1992, 125-177). Pour une approche différente du mêmetype de source, voir Farcy et Faure, 2003, 48-50et 106-110.
46. Contremaître, dessinateur, ouvrier defabrique, etc.
47. En dépit de quelques conscrits qui se décla-rent déjà à 20 ans avocats ou architectes. Lesfuturs ingénieurs font également partie de cettecatégorie.
48. Ceci est d’autant plus gênant que le vignoblefrançais est alors à son apogée…
49. Sur la corrélation entre profession des enfants etprofession des parents en France, voir Dupâquier etPélissier, 1992, 149-153.
50. Sur ce point, voir le débat anglo-saxon :P. Kirby, 1995 et 1997, ainsi que J. Humphries,1997.
51. La présence conséquente des artisans dans unpays encore fortement rural peut être perçuecomme un indice supplémentaire de «mondeplein » : au-delà de 50/60 hab./km2, la diversifica-tion des activités semble devenir une nécessité (cf.Gavignaud, 1990, 12).
184
LAURENT HEYBERGER
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ALTER, George (2004), “Height, Frailty, andthe Standard of Living: Modelling theEffects of Diet and Disease on DecliningMortality and Increasing Height”, Popula-tion Studies, 58 (3), 265-279.
ANGEVILLE, Adolphe d’ (1836), Essai sur lastatistique de la population française consi-dérée sous quelques-uns de ses rapportsphysiques et moraux, Bourg-en-Bresse,F.Dufour, réédition, Paris, New York, LaHaye, Mouton, 1969.
BAIROCH, Paul (1990), “The Impact of CropYields, Agricultural Productivity, andTransports Costs on Urban Growthbetween 1800 and 1910”, 134-151, inUrbanization in History. A Process ofDynamic Interactions, Akira Hayami, Adri-anus M. van der Woude et Jan de Vries(eds.), Oxford, Clarendon Press, coll.« International Studies in Demography».
BANERJEE, Abhijit, DUFLO, Esther, POSTEL-VINAY, Gilles et al. (2007), Long RunHealth Impacts of Income Shocks :Wine andPhylloxera in 19th Century France, NBERWorking Paper W12895, Cambridge,EUA.
BATEN, Jörg (1999), “Kartographische Resi-duenanalyse am Beispiel der Regionalöko-nomischen Lebensstandardforschung über
Baden, Württemberg und Frankreich”, 98-109, in Historisch-thematische Kartographie.Konzepte -Methoden-Anwendungen ,Dietrich Ebeling (ed.), Bielefeld, Vg. fürRegionalgeschichte.
BATEN, Jörg (2009), “Protein Supply andNutritional Status in Nineteenth CenturyBavaria, Prussia and France”, Economicsand Human Biology, 7, 2, 165-180.
BATEN, Jörg, MURRAY, John. E. (2000),“Heights of Men and Women in 19th
-Century Bavaria: Economic, Nutritionaland Diseases Influences”, Exploration inEconomic History, 37 (4), 351-369.
BONNAIN-MOERDIJK, Rolande (1975),« L’alimentation paysanne en France entre1850 et 1936 », Études rurales, 58, 29-49.
BOURILLON, Florence (1992), Les Villes enFrance au XIXe siècle, Paris, Ophrys [réédi-tion, Paris, Ophrys, 1995].
CARRET, Jules (1882), Études sur lesSavoyards, Chambéry.
CRAIG, Lee A., GOODWIN, B. et al. (2004),“The Effect of Mechanical Refrigerationon Nutrition in the United States”, SocialScience History, 28 (2), 325-336.
DEMONET, Michel (1990), Tableau de l’agri-culture française au milieu du XIXe siècle.L’enquête agricole de 1852, Paris, EHESS.
185
NIVEAUX DE VIE BIOLOGIQUES EN FRANCE AU MILIEU DU XIXe SIÈCLE
DÉSERT, Gabriel (1975), « Viande et poissondans l’alimentation des Français au milieudu XIXe siècle », Annales E. S. C., 30, 519-536.
DESROSIÈRES Alain (1987), « Eléments pourl’histoire des nomenclatures socioprofes-sionnelles », 155-194, in Pour une histoirede la statistique, t. I, contributions, INSEE,Paris, Economica.
DESROSIÈRES Alain (1993), La Politique desgrands nombres. Histoire de la raison statis-tique, Paris, La Découverte [réédition,Paris, La Découverte, 2000, coll. « Scien-ces humaines et sociales »].
DUPÂQUIER, Jacques, PELISSIER, Jean-Pierre(1992), «Mutation d’une société : lamobilité professionnelle », 121-179, in LaSociété française au XIXe siècle. Tradition,transition, transformations, Paris, JacquesDupâquier et Denis Kessler (éd.), Fayard,coll. « Pluriel ».
FARCY, Jean-Claude, FAURE, Alain (2003),La Mobilité d’une génération de Français.Recherche sur les migrations et les déménage-ments vers et dans Paris à la fin du XIXe
siècle, Paris, INED.FEDERICO, Giovanni (2003), “Heights, Calo-
ries and Welfare: a New Perspective on Ital-ian Industrialization, 1854-1913”, Econo-mics and Human Biology, 3 (1), 289-308.
FOGEL, Robert W. (2004), “Health, Nutri-tion and Economic Growth”, EconomicDevelopment and Cultural Change, 52 (3),643-658.
FURET, François, OZOUF, Jacques (1977),«L’alphabétisation sans retour », 13-68, inLire et écrire. L’alphabétisation des Français deCalvin à Jules Ferry, François Furet etJacques Ozouf (éd.), Paris, Les Éditions deMinuit, vol. 1, coll. «Le sens commun».
GAVIGNAUD, Geneviève (1990), Les Campa-gnes en France au XIXe siècle (1780-1914),Paris, Ophrys.
GRANTHAM, George W. (1995), “FoodRations in France in the Eighteenth andEarly Nineteenth Century: a Reply”, TheEconomic History Review, 48, 774-777.
GRANTHAM, George W. (1997), « Espacesprivilégiés : productivité agraire et zoned’approvisionnement des villes dans l’Eu-rope préindustrielle », Annales H. S. S., 52(3), 695-725.
HAINES, Michael R., CRAIG, Lee A., WEISS,Thomas (2003), “The Short and theDead: Nutrition, Mortality and the ‘Ante-bellum Puzzle’ in the United States”, Jour-nal of Economic History, 63 (2), 382-413.
HEYBERGER, Laurent (2003), Santé et déve-loppement économique en France au XIXe
siècle. Essai d’histoire anthropométrique,Paris, L’Harmattan, coll. « Acteur de laScience ».
HEYBERGER, Laurent (2005), La Révolutiondes corps. Décroissance et croissance staturaledes habitants des villes et des campagnes enFrance, 1780-1940, Belfort, UTBM, Stras-bourg, Presses universitaires de Strasbourg,coll. «Sciences humaines et technologie».
HUMPHRIES, J. (1997), “Short Stature amongCoalmining Children: a Comment”, TheEconomic History Review, 50, 531-537.
HUSSON, Armand (1856), Les Consomma-tions de Paris, Paris, Guillaumin.
JUILLARD, Étienne (1953), La Vie rurale dela plaine de Basse-Alsace. Essai de géographiesociale, Paris, Société d’édition des BellesLettres [réédition, Strasbourg, Pressesuniversitaires de Strasbourg, 1992].
KIRBY, P. (1995), “Causes of Short Statureamong Coalmining Children, 1823-1850”,The Economic History Review, 48, 687-699.
KIRBY, P. (1997), “Short Stature amongCoalmining Children: a Rejoinder”, TheEconomic History Review, 50, 538-541.
KOMLOS, John (2003), «Histoire anthropo-métrique : bilan de deux décennies derecherche », Cahiers de l’ISMEA, Écono-mies et Sociétés, Série histoire économiquequantitative, AF 29.
LANTZSCH, Jana, SCHUSTER, Klaus (2009),“Socioeconomic Status and Physical Staturein 19th Century Bavaria”, Economics andHuman Biology, 7, 46-54.
LAURENT, Robert (1978), «Les variationsdépartementales du prix du froment enFrance (1801-1870) », in Histoire, écono-mies, sociétés. Journées d’études en l’honneurde Pierre Léon (6-7 mai 1977), CentrePierre Léon, Lyon, Presses universitaires deLyon.
LE MÉE, René (1989), «Les villes de France etleur population de 1806 à 1851», Annalesde Démographie Historique, 321-394.
LÉVY-LEBOYER, Maurice (1982), «Les inéga-lités interregionales : évolution au XIXe
siècle », Économie rurale, 152.LOGAN, Trevon D. (2006), “Food, Nutrition
and Substitution in the Late NinetheenthCentury”, Explorations in EconomicHistory, 43, 527-545.
MARCHAND, Olivier, THÉLOT, Claude(1997), Le Travail en France (1800-2000),Paris, Nathan.
MARGAIRAZ, Dominique (1982), Les Dénivel-lations interrégionales des prix du froment enFrance, 1756-1870, thèse Paris I, Paris.
MARTINEZ-CARRION, José-Miguel, MORENO-LAZARO, Javier (2007), “Was there an UrbanHeight Penalty in Spain, 1840-1913?”,Economics and Human Biology, 5, 144-164.
MEYER, Haakon E., SELMER, Randi (1999),“Income, Educational Level and BodyHeight”, Annals of Human Biology, 26 (3),219-227.
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE
ET DES TRAVAUX PUBLICS, (1858 – Premièrepartie, 1860 – Deuxième partie), Statistiquede la France.Deuxième série. Statistique agri-cole, Paris, Imprimerie impériale.
MONTANARI, Massimo (1995), La Faim etl’abondance. Histoire de l’alimentation enEurope, Paris, Seuil, coll. «Faire l’Europe».
MORINEAU, Michel (1971), Les Faux-semblants d’un démarrage économique :agriculture et démographie en France auXVIIIe siècle, Paris, A. Colin, Cahiers desAnnales 30.
MORINEAU, Michel (1972), «Budgets popu-laires en France au XVIIIe siècle », Revue
d’Histoire économique et sociale, 203-237et 449-481.
MORINEAU, Michel (1974), « Révolutionagricole, révolution alimentaire, révolu-tion démographique », Annales de Démo-graphie Historique, 335-371.
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ,série des rapports techniques, 854 (1995),Utilisation et interprétation de l’anthropo-métrie. Rapport d’un comité OMS d’experts,OMS, Genève.
PINOL, Jean-Luc, WALTER, François (2003),«La ville contemporaine jusqu’à la secondeguerre mondiale », 11-275, in Histoire del’Europe urbaine II, de l’Ancien Régime à nosjours, Jean-Luc Pinol (éd.), Paris, Seuil.
POSTEL-VINAY, Gilles, ROBIN, Jean-Marc(1992), “Eating, Working and Saving inan Unstable World: Consumers in Nine-teenth-Century France”, The EconomicHistory Review, 45, 494-513.
RANDOUIN, Lucie, BERNARDIN, André,DUPUIS, Yvon et al. (1961), Tables decomposition des aliments, Paris, JacquesLanore éditeur.
RENOUARD, Dominique (1960), Les Transportsde marchandises par fer, route et eau depuis1850, Paris, Armand Colin, Fondationnationale des sciences politiques, coll.«Recherches sur l’économie française».
SCHNEIDER, R. (1996), “Historical Note onHeight and Parental Consumption Deci-sions”, Economic Letters, 50 (2), 279-283.
STECKEL, Richard H. (2009), “Heights andHuman Welfare: Recent Developmentsand New Directions”, Explorations inEconomic History, 46, 1-23.
SVEDBERG, Peter (2002), “UndernutritionOverestimated”, Economic Developmentand Cultural Changes, 51 (1), 5-36.
TOUTAIN, Jean-Claude (1971), «La consom-mation alimentaire en France de 1789 à1964 », Cahiers de l’ISEA, Économies etSociétés, t. V, 9, 1909-2049.
TOUTAIN, Jean-Claude (1992 et 1993), « Laproduction agricole de la France de 1810
LAURENT HEYBERGER
186
à 1990 : départements et régions. Crois-sance, productivité, structures », Cahiersde l’ISMEA, Économies et Sociétés. Histoirequantitative de l’économie française, AF 17,3 vol.
TOUTAIN, Jean-Claude (1995), “FoodRations in France in the Eighteenth andEarly Nineteenth Centuries: a Comment”,The Economic History Review, 48, 769-773.
VECCHI, Giovanni, COPPOLA, Michela(2006), “Nutrition and Growth in Italy,1861-1911: What Macroeconomic Data
Hide?”, Exploration in Economic History,43, 438-464.
WEBER, Eugen (1983), La Fin des terroirs.La modernisation de la France rurale 1870-1914, Paris, Fayard, [réédition, ParisFayard, 2005].
WEIR, David R. (1997), “Economic Welfareand Physical Well-Being in France, 1750-1990”, 161-200, in Health and Welfareduring Industrialization, Richard H.Steckel et Roderick Floud (eds.), Chicago,NBER.
NIVEAUX DE VIE BIOLOGIQUES EN FRANCE AU MILIEU DU XIXe SIÈCLE
187
Tab. 3 Régression à l’échelle individuelle, disponibilités alimentaires moyennes
Modèle 1 P Modèle 2 P Modèle 3 P
Constante (cm) 165,55 0 164,64 0 164,98 0
Disponibilités moyennesen calories (cal)
0,0004 0 -0,0029 0
Disponibilités moyennesen protides (g)
0,0268 0 0,1123 0
Agriculteurs exploitants Référence Référence Référence
non exploitants -0,311 0 -0,4986 0 -0,7957 0
Alimentaire -0,0924 0,485 -0,1861 0,159 -0,3225 0,014
Artisans divers -0,0709 0,569 -0,1719 0,167 -0,3625 0,003
Bâtiment -0,5372 0 -0,5606 0 -0,5202 0
Bois 0,1677 0,088 0,0832 0,396 -0,033 0,736
Commerce alimentaire 0,8065 0,014 0,5992 0,066 0,3703 0,254
Commerce 0,5229 0 0,4251 0,004 0,2354 0,111
Divers 0,4824 0 0,4034 0,003 0,2297 0,091
Employé 1,3482 0 1,2016 0 1,0463 0
Étudiant 0,9659 0 0,9423 0,001 0,9242 0,001
Habillement -1,1513 0 -1,2248 0 -1,3213 0
Industrie -0,9092 0 -1,0241 0 -1,3326 0Instructionpublique/clergé 0,9349 0,001 0,8645 0,002 0,7489 0,008
Métallurgie 0,0995 0,36 0,0046 0,966 -0,1571 0,146
Mines -0,6298 0,001 -0,7513 0 -0,7681 0Profession inconnue -0,0776 0,707 -0,095 0,645 -0,1913 0,351
Profession libérale 2,332 0 2,2447 0 2,1355 0
Textile -0,5287 0 -0,6867 0 -1,0297 0
Transport -0,0997 0,464 -0,2243 0,099 -0,4207 0,002
Analphabète -2,5116 0 -2,4201 0 -2,1596 0Sait lire -1,7418 0 -1,6208 0 -1,3374 0
Sait lire et écrire Référence Référence Référence
Instruction inconnue -1,6591 0 -1,5138 0 -1,3883 0Campagnes Référence Référence RéférencePetites villes -0,0012 0,984 -0,0146 0,802 -0,146 0,012
Villes moyennes -0,169 0,043 -0,2055 0,013 -0,5879 0Grandes villes -0,5465 0 -0,5591 0 -1,0852 0
R2 ajusté 0,0346 0,0386 0,0468N observations (conscrits) 81605 81605 81605Note : les variables disponibilités en calories et en protides sont calculées à l’échelle de l’arrondissement. Les varia-bles professions et degrés d’instruction sont observées à l’échelle du conscrit. Les variables villes/campagne sontobservées à l’échelle du canton.
LAURENT HEYBERGER
188
Tab. 4 Régression à l’échelle individuelle, consommation par journalierd’après le budget d’une famille de cinq journaliers
Modèle 1 P Modèle 2 P Modèle 3 P
Constante (cm) 164,81 0 162,97 0 163,84 0
Consommation decalories (cal) 0,0008 0 -0,0042 0
Consommation deprotides (g) 0,0548 0 0,1889 0
Agriculteursexploitants Référence Référence Référence
Non exploitants -0,3187 0 -0,5461 0 -0,7919 0
Alimentaire -0,0912 0,491 -0,1816 0,169 -0,2518 0,055
Artisans divers -0,1084 0,385 -0,2638 0,034 -0,4035 0,001
Bâtiment -0,623 0 -0,7493 0 -0,6851 0
Bois 0,1554 0,114 0,038 0,699 -0,0657 0,501Commercealimentaire 0,8136 0,013 0,5911 0,07 0,4365 0,178
Commerce 0,492 0,001 0,3462 0,019 0,2015 0,172
Divers 0,4417 0,001 0,3099 0,023 0,1876 0,167
Employé 1,369 0 1,214 0 1,0684 0
Étudiant 0,9728 0 0,949 0,001 0,9244 0,001
Habillement -1,1705 0 -1,2829 0 -1,3676 0
Industrie -0,9753 0 -1,2554 0 -1,6825 0
Instructionpublique/clergé 0,9039 0,001 0,8336 0,003 0,8608 0,002
Métallurgie 0,0957 0,378 -0,0524 0,629 -0,2686 0,013
Mines -0,6197 0,002 -0,7814 0 -0,8554 0
Profession inconnue -0,0982 0,635 -0,1443 0,484 -0,2325 0,257
Profession libérale 2,3171 0 2,2129 0 2,1652 0
Textile -0,5924 0 -0,8557 0 -1,1502 0
Transport -0,1094 0,422 -0,1746 0,198 -0,1126 0,405
Analphabète -2,4509 0 -2,2325 0 -1,9151 0
Sait lire -1,7168 0 -1,5525 0 -1,325 0
Sait lire et écrire Référence Référence Référence
Instruction inconnue -1,6436 0 -1,4726 0 -1,4238 0
Campagnes Référence Référence Référence
Petites villes -0,0528 0,366 -0,075 0,198 -0,0547 0,345
Villes moyennes -0,308 0 -0,3635 0 -0,3249 0
Grandes villes -0,8087 0 -0,8792 0 -0,708 0
R2 ajusté 0,0344 0,0401 0,0488
N observations(conscrits) 81605 81605 81605Note : voir tableau 3.
NIVEAUX DE VIE BIOLOGIQUES EN FRANCE AU MILIEU DU XIXe SIÈCLE
189
190
LAURENT HEYBERGER
Tab. 5 Régressions à l’échelle de l’arrondissement, disponibilités alimentaires moyennes
Tab. 6 Régressions à l’échelle de l’arrondissement, consommations par journalierd’après le budget d’une famille de cinq journaliers
Modèle 1 P Modèle 2 P Modèle 3 P Modèle 4 PConstante (cm) 160,03 0 159,88 0 164,57 0 160,59 0
Disponibilitésmoyennesen calories (cal)
0,0002 0,187 -0,0036 0 -0,0014 0,005
Disponibilitésmoyennesen protides (g)
0,0111 0,024 0,1287 0 0,0541 0,001
Alphabétisation 0,0698 0 0,0672 0 0,0594 0
R2 ajusté 0,5903 0,6028 0,312 0,6277
N observations(arrondissements)
111 111 111 111
Modèle 1 P Modèle 2 P Modèle 3 P Modèle 4 PConstante (cm) 160,8 0 160,28 0 163,42 0 161,18 0Consommation decalories (cal)
-0,0002 0,553 -0,0063 0 -0,0025 0,004
Consommation deprotides (g)
0,0037 0,732 0,2555 0 0,0929 0,005
Alphabétisation 0,0713 0 0,0695 0 0,0565 0
R2 ajusté 0,585 0,5841 0,4166 0,6112N observations(arrondissements)
111 111 111 111
191
NIVEAUX DE VIE BIOLOGIQUES EN FRANCE AU MILIEU DU XIXe SIÈCLE
Le milieu du XIXe siècle est marqué enFrance par des écarts anthropométriquesimportants, une intégration des marchésencore imparfaite, une alimentation encorepeu riche en protéines d’origine animale etun maximum de population dans les campa-gnes. La confrontation de l’indice anthropo-métrique et des données sur l’alimentationpermet de préciser les rapports entre nutri-tion et niveau de vie biologique à unmoment clef de l’industrialisation enmontrant notamment l’importance d’un
régime riche en protéines. Elle amène égale-ment à préférer les budgets populaires auxdisponibilités alimentaires dans l’estimationdes apports en nutriments. Le lien entrealphabétisation et indice anthropométriqueapparaît très fort. L’approche à l’échelle indi-viduelle (81 605 dossiers de conscrits nés en1848) puis de l’arrondissement (111 unités)amène aussi à reconsidérer l’impact de l’ur-banisation sur la stature à un momentcritique de l’histoire urbaine.
The middle of the 19th century in France ischaracterized by large anthropometricinequalities, an imperfect market integra-tion, an unbalanced diet, and a maximum ofrural population. The comparison of staturewith nutritional supply allows us to clarifythe relationships between nutrition and thebiological standard of living during a keyperiod of the industrial revolution, showing
the importance of a diet rich in protein. Italso brings us to prefer to use householdbudget rather than food availabilities whenestimating nutritional supply. The linkbetween literacy and stature is very strong.The use of individual data (81 605 cons-cripts born in 1848) and of French districts(111 arrondissements) also brings us toreconsider the impact of urbanization
RÉSUMÉ
SUMMARY





































![Aspects aristocratiques et aspects populaires de l'être-chrétien aux IIIe et IVe siècles [2001]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6335bd91b5f91cb18a0b88b7/aspects-aristocratiques-et-aspects-populaires-de-letre-chretien-aux-iiie-et-ive.jpg)