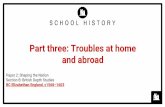Part three: Troubles at home and abroad - The Grange Academy
Évaluation d’un biais de mémoire explicite chez les jeunes femmes françaises à risque de...
-
Upload
univ-lille -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Évaluation d’un biais de mémoire explicite chez les jeunes femmes françaises à risque de...
ARTICLE IN PRESSModele +JTCC-235; No. of Pages 8
Journal de thérapie comportementale et cognitive (2014) xxx, xxx—xxx
Disponible en ligne sur
ScienceDirectwww.sciencedirect.com
ARTICLE ORIGINAL
Évaluation d’un biais de mémoire explicitechez les jeunes femmes francaises à risquede troubles des conduites alimentairesEvaluation of an explicit memory bias in young French womenat risk of eating disorders
Céline Gasperini ∗, Amélie Rousseau
Université Lille 3, UFR de psychologie, domaine universitaire du Pont-de -Bois, BP 60149,59653 Villeneuve-d’Ascq cedex, France
Recu le 14 avril 2014 ; recu sous la forme révisée le 11 juin 2014 ; accepté le 12 juin 2014
MOTS CLÉSBiais mnésique ;Self-schema ;Trouble ducomportementalimentaire ;Image corporelle ;Insatisfactioncorporelle
RésuméObjectif. — Un biais de mémoire explicite en faveur de stimuli positifs et négatifs liés àl’apparence corporelle et au poids a été évalué chez 42 jeunes femmes étudiantes à l’université.Cette recherche visait à étudier dans quelles mesures les personnes à risque ou souffrantde troubles du comportement alimentaire montrent un biais mnésique congruent avec leurspréoccupations liées à l’apparence et au poids.Méthode. — Les participantes ont été invitées à s’exposer à une liste de mots cibles et contrôlestout en réalisant une tâche d’encodage incident auto-référentielle, puis ont réalisé une tâchede rappel libre. Des mesures auto-rapportées ont été proposées aux participantes afin d’évaluerl’insatisfaction corporelle ainsi que les conduites alimentaires.Résultats. — Les analyses montrent que l’ensemble des participantes rappellent plus de motsliés à l’apparence corporelle et au poids comparativement aux mots non liés. Aucune différencen’a été trouvée entre les différents groupes. De plus, les participantes ne rappellent pas plus demots négatifs que de mots positifs ou neutres en lien avec l’apparence corporelle et le poids.Discussion. — Ces résultats sont en contradiction avec les hypothèses découlant du modèle cog-nitif des troubles du comportement alimentaire. Les implications cliniques et pour de futures
sont discutés.
recherches de ces résultatsPour citer cet article : Gasperini C, Rousseau A. Évaluation d’un biais de mémoire explicite chez les jeunes femmesfrancaises à risque de troubles des conduites alimentaires. Journal de thérapie comportementale et cognitive (2014),http://dx.doi.org/10.1016/j.jtcc.2014.06.001
© 2014 Publie par Elsevier Masson SAS pour l’Association française de thérapie comporte-mentale et cognitive.
∗ Auteur correspondant.Adresse e-mail : [email protected] (C. Gasperini).
http://dx.doi.org/10.1016/j.jtcc.2014.06.0011155-1704/© 2014 Publie par Elsevier Masson SAS pour l’Association française de thérapie comportementale et cognitive.
Pour citer cet article : Gasperini C, Rousseau A. Évaluation dfrancaises à risque de troubles des conduites alimentaires. Johttp://dx.doi.org/10.1016/j.jtcc.2014.06.001
ARTICLE IN PRESSModele +JTCC-235; No. of Pages 8
2 C. Gasperini, A. Rousseau
KEYWORDSMemory bias;Self-schema;Eating disorder;Body image;Body dissatisfaction
SummaryObjective. — Memory bias for weight and shape related words was investigated in 42 youngwomen university students. According to the eating disorders cognitive model proposed byVitousek and Hollon, 1990 [3], women suffering from eating disorder develop self-schemasabout weight and shape considered to be at the core of eating disorder pathology. Self-schemasabout weight and shape appear to bias information processing with a confirmatory objective.Cognitive biases for congruent information, such as memory bias for negative information aboutweight and shape, are believed to be implicated in the development and maintenance of eatingdisorders (Williamson et al., 1999) [4]. The literature supports this cognitive model in clinicalsamples, with women suffering of anorexia nervosa, bulimia nervosa or binge eating disorder(McNally, 2001; King et al., 1991) [5,6]. Results, however, are inconsistent in non-clinical samplesor women with subclinical eating disorders (Hunt and Cooper, 2001; Israeli and Stewart, 2001)[10,11]. These inconsistencies could be linked to the use of different methodologies to evaluatememory bias or the lack of pre-test methods for experimental material. Taking into accountsuggestions from previous researcher in this field, the objective of this study was to investi-gate whether a non-clinical sample of women with eating disorder or high body dissatisfactiondemonstrate a memory bias congruent with their concerns.Method. — Participants (n = 42) were invited to view target and control words, i.e., posi-tive, negative and neutral words related to weight and shape and positive, negative andneutral words not related to weight and shape. They performed a self-referent enco-ding task during the exposition to words and recall memory was subsequently assessed.Self-report measures were taken in order to evaluate body dissatisfaction and eatingbehaviour.Results. — Non-parametric statistical analysis indicated that all women demonstrated a memorybias to weight and shape related words compared to control words. Indeed, Wilcoxon test issignificant (z = 2.82, P = 0.005), indicating that all women selectively recall more weight andshape related words than not related ones. On the other hand, no difference was found bet-ween groups. Indeed, Mann-Whitney T test is not significant (z = −0.57; P = 0.57), indicatingthat women with body dissatisfaction do not recall more weight and shape related words thanwomen satisfied. Likewise, women suffering of eating disorders do not recall more weightand shape related words than women without eating disorder (z = −0.38: P = 0.70). Moreover,women did not recall more negative weight and shape related words (those congruent withtheir preoccupations) than positive or neutral ones.Discussion. — These findings are in contradiction with hypothesis based on the eating disor-ders cognitive model (Vitousek and Hollon, 1999; Williamson et al., 1999) [3,4]. Indeed, allwomen demonstrated a memory bias for information related to self-schemas about weight andshape. These results suggest that the self-schema about weight and shape was activated forall women and thus available for information processing. Therefore, availability of this specificself-schema about weight and shape do not appear to be the core of eating disorders in so faras it seems to be adopted by women without body dissatisfaction or eating disorder. The pre-ferential use of this self-schema about weight and shape by women suffering of eating disorderin information processing, instead of another self-schema, could be a factor in the develop-ment and maintenance of eating disorders. Results show also that women did not selectivelyrecall congruent information, i.e., negative words related to weight and shape. These resultscould have implications for therapeutic interventions in eating disorders. Indeed, it could berelevant to target not only worries about be or becoming fat, but also the desire to be thin.Indeed, results suggest that this theme, drive for thinness, could be an important factor ofvulnerability to certain women and could lead them to adopt unhealthy behaviours in orderto achieve an ideally thin body. Therefore, prevention programs should target the develop-ment and assimilation of self-schemas not related to weight and shape as well as the drive forthinness.© 2014 Published by Elsevier Masson SAS on behalf of Association française de thérapiecomportementale et cognitive.
’un biais de mémoire explicite chez les jeunes femmesurnal de thérapie comportementale et cognitive (2014),
INModele +
à ri
cécd«((vmmddnccddapeeéndiad
bTcldirucCrcpscsldcatur[td
M
Participantes
ARTICLEJTCC-235; No. of Pages 8
Évaluation d’un biais de mémoire explicite chez les femmes
Introduction
Dans nos sociétés occidentales, l’apparence corporelle estune des préoccupations majeures chez la plupart desfemmes [1]. Cette quête de l’idéal de minceur peut entraî-ner une insatisfaction corporelle qui constitue un risquereconnu dans le développement des troubles du compor-tement alimentaire (TCA) avérés [2]. Les TCA ainsi quel’insatisfaction corporelle sont conceptualisés dans le cadredu modèle cognitif du traitement de l’information [3,4].Selon ce modèle, les individus développent des schémascognitifs élaborés à propos de problématiques liées àl’alimentation, au poids et à l’apparence corporelle. Ceux-cibiaisent le traitement en faveur de l’information consistanteavec ce schéma et permettent donc de les confirmer. Le self-schema lié au poids et à l’apparence est considéré commereprésentant le cœur de la psychopathologie des TCA. Ilrenvoie aux implications que les attitudes dysfonctionnellesenvers l’alimentation et l’apparence corporelle ont pourl’évaluation de soi. Ainsi, tout comme les personnes dépres-sives montrent des biais cognitifs spécifiques aux thèmestels que l’échec ne pas être aimé ou être abandonné, lesindividus préoccupés par leur apparence corporelle et leurpoids pourraient exprimer des biais cognitifs, et notammentun biais mnésique, qui sont spécifiques à la peur de grossiret/ou des perceptions erronées de leur silhouette et de leurpoids [3,4].
Les paradigmes issus de la psychologie cognitive ontpermis aux chercheurs d’étudier les biais cognitifs. Cesparadigmes permettent d’atteindre des processus cognitifsinaccessibles à la conscience même [5]. Spécifiquement,un biais mnésique réfère à la tendance qu’ont certainespersonnes de rappeler plus facilement les informations spé-cifiques liées à la pathologie. Comparativement aux biaisattentionnels ou de jugement, peu de recherches ont étémenées sur l’étude d’un biais mnésique dans le contextede l’image corporelle et des TCA en utilisant ces para-digmes. Par ailleurs, les résultats retrouvés dans différentesétudes apparaissent comme divergents. En effet, certainesétudes ont mis en évidence un biais mnésique en faveur destimuli liés à l’apparence corporelle, le poids et la nour-riture chez des personnes souffrant de TCA avérés [6], detroubles non spécifiés [7], de troubles subcliniques [6,8]mais aussi d’insatisfaction corporelle [9], comparativementà des personnes sans TCA ou satisfaites de leur silhouette.Cependant, d’autres études n’ont pas retrouvé ces effetsou les ont nuancés. Hunt et Cooper [10] ont bien mis enévidence un biais mnésique en faveur de stimuli congruentsavec le schéma, c’est-à-dire des mots positifs et négatifsliés au poids, à l’apparence ou l’alimentation (par exemple« minceur » ou « gâteau ») chez des personnes souffrant deboulimie, mais également chez des patients souffrant dedépression. Par ailleurs, en ce qui concerne les TCA sub-cliniques et l’insatisfaction corporelle, les résultats sontdavantage inconsistants. En effet, Israeli et Stewart [11]n’ont pas trouvé de biais mnésique chez des personnes prati-quant le jeûne ou les régimes chroniques. Dans cette étude,les stimuli utilisés se répartissaient en deux catégories : desmots correspondant à des aliments interdits (par exemple
Pour citer cet article : Gasperini C, Rousseau A. Évaluation dfrancaises à risque de troubles des conduites alimentaires. Johttp://dx.doi.org/10.1016/j.jtcc.2014.06.001
« chocolat » ou « hamburger ») et des noms d’animaux (parexemple « éléphant » ou « dauphin »). De même, Sebastianet al. [12] n’ont pas mis en évidence de biais de mémoire
Lp
PRESSsque de TCA 3
hez des personnes présentant une insatisfaction corporellelevée, comparativement à des personnes contrôles. Troisatégories de stimuli ont été utilisées dans cette étude :es mots liés à la grosseur (par exemple « surpoids » ou
obèse »), des mots liés au corps sans référence au poidspar exemple « doigt » ou « épaule ») et des mots neutrespar exemple « poire », « croisière »). Enfin, concernant laalence positive ou négative des stimuli, la littératureontre des résultats inconsistants. Certaines études ontontré que le biais mnésique s’exprimait indifféremmente la valence des stimuli [6,10]. La littérature montre donces résultats inconsistants pour des patients avec des diag-ostics différents et des degrés différents d’insatisfactionorporelle [13]. Certains auteurs [9,12] ont souligné quees inconsistances pourraient s’expliquer par l’utilisationans ces recherches de méthodologies différentes (tâchese mémoire, stimuli par exemple) et ont proposé desméliorations des protocoles. Ces améliorations pourraientermettre de remédier aux limites méthodologiques, parxemple en appariant les stimuli contrôles et expérimentauxn termes de valence et de fréquence, tout en présentantgalement des mots neutres [8,12]. L’utilisation de motségatifs mais également positifs et neutres permettrait ainsi’examiner si les individus traitent préférentiellement lesnformations congruentes avec le schéma tout en résistantux informations incongruentes, tel que les modèles le pré-isent [3,4].
L’étude que nous proposons porte sur l’évaluation d’uniais de mémoire explicite chez les personnes présentant unCA avéré, non spécifié, subclinique ou une insatisfactionorporelle élevée en faveur de stimuli positifs et négatifsiés à l’apparence corporelle et le poids comparativement àes personnes non symptomatiques ou présentant une faiblensatisfaction corporelle. Un modèle transdiagnostique plusécent [14] que le modèle cognitif [3,4] a mis en évidencen continuum concernant les TCA, pourtant classés dans desatégories différentes (anorexie, boulimie par exemple).e modèle postule que des processus communs aux diffé-ents TCA, et notamment les biais cognitifs, pourraient agiromme facteurs de maintien du trouble, quel qu’il soit. Delus, l’inconsistance des résultats pour des patients pré-entant des diagnostics différents souligne la pertinencelinique de s’intéresser aux biais cognitifs chez les personnesouffrant de n’importe quel TCA [13], d’autant que la réa-ité clinique est largement plus riche que la classificationes TCA. Enfin, il importe de souligner que les thérapiesognitivo-comportementales, interventions thérapeutiquesctuellement privilégiées dans les TCA, ont démontré cer-ains points forts mais souffrent de limites [15], notammentn taux très élevé de rechute : « au mieux 50 % des patientsépondent complètement et durablement au traitement »14]. Par ailleurs, le potentiel des interventions thérapeu-iques centrées sur la modification des biais cognitifs a étéémontré par certaines études [16].
éthode
’un biais de mémoire explicite chez les jeunes femmesurnal de thérapie comportementale et cognitive (2014),
es participantes ont été recrutées sur différents cam-us universitaires. L’échantillon est composé de 42 jeunes
INModele +J
4
f(é(ps
I
BLqleCfd(elscdécom
QLé[mllqddf
ELmceeapàbvecdtoa
P
MIs
•
•
•
•
•
•
pmsdemet[éllddé
ldéàddDipi3prpmdcpcet
ARTICLETCC-235; No. of Pages 8
emmes étudiantes dont l’âge moyen est de 20,98 ans ± 2,09min = 18 ; max = 25). L’IMC moyen est de 21,8. Dans cetchantillon, 23 participantes présentaient un IMC moyencompris entre 20,1 et 25), 15 participantes étaient en sous-oids (IMC inférieur à 20) et 4 participantes étaient enurpoids ou plus (IMC supérieur à 25).
nstruments de mesure
ody Shape Questionnairee Body Shape Questionnaire (BSQ) est un auto-uestionnaire unidimensionnel utilisé afin d’évaluer’insatisfaction corporelle et notamment les préoccupationsnvers le corps et le poids. Il a été élaboré en 1987 parooper, Taylor, Cooper et Fairburn [17] et validé enrancais [18]. Il contient 34 items et se présente sous forme’échelles de Likert en six points allant de 1 (jamais) à 6toujours). La consistance interne de la version francaisest de 0,95 et la fidélité test-retest est de 0,93 [18]. Enfin,es coefficients alpha de Cronbach de la validation francaiseont élevés (0,85 pour le test et 0,84 pour le retest). Dans leadre de cette étude, le coefficient alpha de Cronbach este 0,97. Nous avons utilisé le score seuil de 110 : un scoregal ou inférieur à 110 indique une absence d’insatisfactionorporelle ou une insatisfaction faible, et un score égalu supérieur à 111 indique une insatisfaction corporelleodérée ou extrême.
uestionnaire for Eating Disorder Diagnosise Questionnaire for Eating Disorder Diagnosis (QEDD) até élaboré par Mintz et al. [19] puis validé en francais20] afin de diagnostiquer les troubles des conduites ali-entaires avérés et non spécifiés, qui sont référencés dans
e DSM-IV ainsi que les TCA subcliniques développés pares auteurs de ce questionnaire. Le QEDD est un auto-uestionnaire composé de 50 questions. Le Q-EDD montree bonnes qualités psychométriques en termes de validité ete fidélité, tant dans la version originale que dans la versionrancaise.
ating Atttitudes Teste Eating Atttitudes Test (EAT-26) est un questionnaire per-ettant d’évaluer la symptomatologie et les préoccupations
aractéristiques des TCA et développé en 1982 par Garnert al. [21] puis validé en francais [22]. Il contient 26 itemst se présente sous forme d’échelles de Likert en six pointsllant de 1 (jamais) à 6 (toujours). La version francaiserésente des caractéristiques psychométriques similaires
la version anglaise. Ainsi, le coefficient alpha de Cron-ach pour le score total est de 0,86 [22]. De même, laersion francophone montre une bonne sensibilité (89 %)t une bonne spécificité (89,9 %) [22]. Dans le cadre deette étude, le coefficient alpha de Cronbach est également
Pour citer cet article : Gasperini C, Rousseau A. Évaluation dfrancaises à risque de troubles des conduites alimentaires. Johttp://dx.doi.org/10.1016/j.jtcc.2014.06.001
e 0,86. Seul le score total a été utilisé. Ainsi, un scoreotal égal ou supérieur 20 indique un degré élevé de pré-ccupations caractéristiques des troubles du comportementlimentaire.
cdéd
PRESSC. Gasperini, A. Rousseau
rocédure
atériel expérimentall s’agit d’un ensemble de 36 mots non composés répartis enix catégories :
C1 : 6 mots positifs liés à la silhouette et au poids (parexemple : « minceur ») ;
C2 : 6 mots négatifs liés à la silhouette et au poids (parexemple : « grosseur ») ;
C3 : 6 mots neutres liés à la silhouette et au poids (parexemple : « figure ») ;
C4 : 6 mots positifs non liés à la silhouette et au poids (parexemple : « bambin ») ;
C5 : 6 mots négatifs non liés à la silhouette et au poids(par exemple : « cimetière ») ;
C6 : 6 mots neutres non liés à la silhouette et au poids (parexemple : « trompette »).
Ces 36 mots ont été sélectionnés à partir d’un pré-testroposé à 15 participantes sans TCA (étudiantes dont l’âgeoyen est de 24,20 ans ± 2,11). Les participantes ont été
électionnées après un entretien visant évaluer l’absencee TCA. Les participantes ont répondu à un questionnairen ligne leur présentant un ensemble de 180 mots, issus deots utilisés dans d’autres recherches portant sur les TCA
t les biais cognitifs [8,12,23]. La fréquence des mots sélec-ionnés a été contrôlée grâce à des listes de mots validées24,25]. Pour chaque mot présenté, les participantes ontvalué si le mot est en rapport ou non avec la silhouette oue poids, sa valence, sa familiarité. La fréquence, la valence,a familiarité et le nombre de lettres des mots dans chacunees six conditions ont été comparés et n’ont pas montré deifférence significative. Enfin, ces participantes n’ont pasté par la suite incluses dans l’étude.
Le but de l’étude était présenté comme portant sur’imagination afin d’éviter que les participantes ne tentente mémoriser les mots. Après avoir signé le consentementclairé et recu les consignes, 36 mots leur étaient présentés
l’écran pendant dix secondes chacun avec un intervallee deux secondes. Dix ordres différents de présentationes stimuli ont été créés afin de pallier les effets d’ordre.urant la présentation de chaque mot, la tâche d’encodage
ncidente était une tâche d’imagerie auto-référencée : lesarticipantes devaient imaginer une scène passée, future oumaginaire les mettant en relation avec le mot présenté. Les6 stimuli étaient présentés deux fois afin d’éviter les effetslancher dans les performances à la tâche subséquente deappel libre. Une tâche interposée leur était ensuite pro-osée, empêchant toute répétition mentale. Pendant uneinute, elles décomptaient à haute voix de trois en trois,ans un ordre décroissant, à partir du chiffre 372. Les parti-ipantes étaient ensuite invitées à rappeler le plus de motsossible qu’elles se souvenaient avoir vu. Le nombre de motsorrectement rappelés en fonction des six catégories étaitnregistré. Enfin, elles étaient invitées à remplir les ques-ionnaires (ordre contrebalancé). L’expérimentation étaitlôturée par un bref débriefing présentant l’objectif réel
’un biais de mémoire explicite chez les jeunes femmesurnal de thérapie comportementale et cognitive (2014),
e l’étude et permettant de s’assurer que celui-ci n’a pasté deviné avant la phase de rappel libre. La durée totalee la passation était d’environ 45 minutes.
IN PRESSModele +
à risque de TCA 5
Figure 1 Nombre moyen de mots rappelés en fonction dutype de mots pour l’ensemble des 42 participantes. Les barresd’erreurs correspondent aux intervalles de confiance à 0,95.*La différence est significative au niveau 0,05.Average number of words recalled according to the type ofwc
dez
D
Lmesure les jeunes femmes francaises présentant une insa-tisfaction corporelle élevée, des préoccupations liées aupoids et l’apparence corporelle ou un TCA pourraient mon-trer un biais de mémoire explicite en faveur des stimuli en
3.48
3.98 4.05
3.05
3.45 3.55
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
C1 C2 C3 C4 C5 C6
Figure 2 Nombre moyen de mots rappelés par les parti-cipantes en fonction de la catégorie des mots. Seules lesdifférences entre C2 et C4 et entre C3 et C4 sont significatives auseuil corrigé. � < 0,002. C1 : 6 mots positifs liés à la silhouetteet au poids ; C2 : 6 mots négatifs liés à la silhouette et au poids ;C3 : 6 mots neutres liés à la silhouette et au poids ; C4 : 6 motspositifs non liés à la silhouette et au poids ; C5 : 6 mots négatifs
ARTICLEJTCC-235; No. of Pages 8
Évaluation d’un biais de mémoire explicite chez les femmes
Résultats
Le QEDD nous permet de connaître la répartitiondes jeunes femmes de notre échantillon en fonctiondes différentes catégories de TCA : absence de TCA(69 % soit 29 participantes), troubles avérés (4,8 % soit2 participantes), troubles alimentaires non spécifiés (11,9 %soit 5 participantes) et troubles alimentaires subcliniques(14,3 % soit 6 participantes).
Les conditions d’application des tests statistiques para-métriques n’étant pas remplies (normalité des résidus ethomogénéité des variances), des tests statistiques non para-métriques ont été utilisés. Le nombre moyen de motscorrectement rappelés est présenté dans le Tableau 1, enfonction :
• du groupe de satisfaction corporelle ;• du groupe de préoccupations liées aux TCA ;• du groupe de TCA et le type de mots.
Analyses du rappel libre des mots liés au poids et àl’apparence
Le test non paramétrique U de Mann-Whitney a été uti-lisé pour comparer le nombre de mots positifs et négatifsliés à l’apparence corporelle et au poids rappelés par lesparticipantes en fonction de leur degré d’insatisfaction,de leur niveau de préoccupations et de la présence ounon de TCA. Les jeunes femmes présentant une insatis-faction corporelle modérée ou forte ne rapportent passignificativement plus de mots positifs et négatifs liés àl’apparence corporelle et au poids que les jeunes femmessatisfaites ou présentant une insatisfaction corporelle faible(z = −0,57, p = 0,57). De même, les jeunes femmes présen-tant des préoccupations envers leur poids ou leur silhouettene rapportent pas significativement plus de mots positifs etnégatifs liés à l’apparence corporelle et au poids que lesjeunes femmes sans préoccupation caractéristique (z = 1,52,p = 0,13). Enfin, les jeunes femmes présentant un TCA nerapportent pas significativement plus de mots positifs etnégatifs liés à l’apparence corporelle et au poids que lesjeunes femmes sans TCA (z = −0,38, p = 0,70).
Analyses du rappel libre en fonction de lacatégorie des mots
Le test non paramétrique de Wilcoxon a été réalisé pourcomparer le nombre de mots rappelés par l’ensembledes participantes selon qu’ils appartiennent ou non àl’apparence corporelle et au poids. Il y a bien un effet prin-cipal du type de mots (z = 2,82, p = 0,005) : l’ensemble desparticipantes rappellent significativement plus de mots liésà l’apparence corporelle et au poids que de mots non liés(Fig. 1).
Le test non paramétrique de Friedman par rangs étantsignificatif (F = 17,03, p = 0,004) pour toutes les six caté-
Pour citer cet article : Gasperini C, Rousseau A. Évaluation dfrancaises à risque de troubles des conduites alimentaires. Johttp://dx.doi.org/10.1016/j.jtcc.2014.06.001
gories confondues, une série de tests T de Wilcoxon avecla correction de Bonferroni a été utilisée pour détermi-ner les différences significatives entre les catégories demots. Les participantes ont rappelé significativement plus
nàAt
ords for all 42 participants. The error bars correspond toonfidence intervals 0.95.
e mots négatifs et neutres liés à l’apparence corporellet au poids que de mots positifs non liés (respectivement,
= 3,24, p = 0,001 et z = 3,25, p = 0,001) (Fig. 2).
iscussion
’objectif de cette recherche était d’évaluer dans quelle
’un biais de mémoire explicite chez les jeunes femmesurnal de thérapie comportementale et cognitive (2014),
on liés à la silhouette et au poids ; C6 : 6 mots neutres non liés la silhouette et au poids.verage number of words recalled by the participants accordingo the category of words.
ARTICLE IN PRESSModele +JTCC-235; No. of Pages 8
6 C. Gasperini, A. Rousseau
Tableau 1 Moyennes (écarts-type) des performances à la tâche de rappel libre en (1) fonction du groupe de satisfactioncorporelle (BSQ), (2) du groupe de préoccupations liées aux TCA (EAT-26) et (3) du groupe de TCA (QEDD) et du type de mot(6 catégories).Means (standard deviations) performances to free recall task according to (1) body satisfaction groups (BSQ), (2) worries relatedto eating disorders groups (EAT-26) and (3) types of words (6 categories).
(1) Satisfaction corporelle (2) Préoccupations (3) Groupe TCA
Satisfaites oufaiblementinsatisfaites
Modérément oufortementinsatisfaites
Caractéristiques des TCA
Sans Avec Sans Avec
(n = 31) (n = 11) (n = 35) (n = 7) (n = 29) (n = 13)
Mots liés àl’apparence, au poids
C1 : positif 3,48 (1,59) 3,45 (1,97) 3,40 (1,63) 3,86 (1,95) 3,66 (1,56) 3,08 (1,89)C2 : négatif 3,94 (1,03) 4,09 (1,14) 3,89 (1,05) 4,43 (0,98) 3,93 (1,10) 4,08 (0,95)C3 : neutre 4,06 (1,29) 4,00 (1,48) 4,00 (1,33) 4,29 (1,38) 4,07 (1,25) 4,00 (1,53)
Mots non liés àl’apparence, au poids
C4 : positif 3,03 (1,33) 3,09 (1,45) 2,97 (1,36) 3,43 (1,27) 3,14 (1,27) 2,85 (1,52)C5 : négatif 3,58 (1,15) 3,09 (1,30) 3,43 (1,22) 3,57 (1,13) 3,55 (1,06) 3,23 (1,48)
(1,69
lmplemc
ufnjEtpsàqnsceCdmmmppdptspéddecMi
tsilrpdtep
qdrcNsamslmlfplasLvdddmrlp
C6 : neutre 3,52 (1,23) 3,64
ien avec le self-schema lié au poids tel que prédit par leodèle cognitif des TCA [3,4]. L’ensemble des résultats neermet pas de confirmer cette hypothèse dans une popu-ation tout venant. Les patterns de résultats suggèrent enffet que l’ensemble des jeunes femmes présente un biaisnésique explicite en faveur des stimuli liés à l’apparence
orporelle et au poids.Selon le modèle cognitif [3,4], les personnes présentant
n trouble de l’image corporelle ou un TCA utilisent plusréquemment le self-schema lié au poids comme cadre orga-isant le traitement de l’information, comparativement auxeunes femmes satisfaites, sans préoccupation et sans TCA.n effet, pour les personnes accordant une importance par-iculière à leur poids, ce self-schema serait plus élaboré etlus saillant dans ce domaine spécifique [26,27]. Ces per-onnes seraient dès lors davantage susceptibles de se référer
ce self-schema lié au poids, plus facilement accessibleue d’autres self-schemas, pour traiter l’information perti-ente pour soi [3,4]. Nos résultats suggèrent en effet que leelf-schema lié au poids a été activé chez toutes les parti-ipantes (donc disponible), entraînant un biais de mémoirexplicite en faveur des stimuli congruents avec ce schéma.assin et al. [28] ont observé également que l’ensemblees jeunes femmes de leur étude rappelaient significative-ent plus de mots liés à la grosseur et à la minceur que deots neutres non liés à la silhouette. Cette meilleure perfor-ance dans le rappel n’était pas affectée par l’activationréalable ou non du self-schema lié au poids. Ainsi, il seourrait que ce ne soit pas tant le self-schema lié au poidsisponible pour traiter l’information qui soit au cœur de lasychopathologie des TCA, mais plutôt son usage préféren-iel (accessibilité) dans la définition de soi par les personnesouffrant d’un TCA, d’insatisfaction corporelle ou préoccu-ées par leur poids et leur apparence physique. Certainestudes ont montré que pour les personnes ayant bénéficié’une prise en charge, le risque de rechute était associé àes attitudes dysfonctionnelles résiduelles envers le poids
Pour citer cet article : Gasperini C, Rousseau A. Évaluation dfrancaises à risque de troubles des conduites alimentaires. Johttp://dx.doi.org/10.1016/j.jtcc.2014.06.001
t l’alimentation et ce en lien avec les implications que cesomportements ont pour la définition de soi [29]. De plus,acLeod et al. [16] ont mis en évidence le potentiel des
nterventions thérapeutiques axées sur la modification du
lslj
) 3,51 (1,36) 3,71 (1,38) 3,66 (1,26) 3,31 (1,55)
raitement de l’information dans la prise en charge des per-onnes souffrant de TCA. Ainsi, dans de prochaines études,l pourrait être utile de sélectionner les items non liés à’apparence et au poids en fonction de leur potentialité àenvoyer à d’autres dimensions du self-schema (par exemplerofession, traits de personnalité). Cela pourrait permettree fournir des pistes de réflexion en matière d’interventionhérapeutique, comme par exemple la mémorisation desxpériences de moqueries en lien avec la silhouette et leoids.
Les résultats de la présente étude suggèrent égalementue les jeunes femmes ne rappellent pas préférentiellementes mots négatifs liés au poids ou à l’apparence corpo-elle comparativement aux mots positifs. Ceux-ci rejoignenteux retrouvés auprès de populations non cliniques [28,30].os résultats suggèrent ainsi que les jeunes femmes neont pas seulement réceptives aux informations en lienvec leurs préoccupations (peur de grossir) mais égale-ent aux informations relatives à la silhouette qu’elles
ouhaitent atteindre (minceur). Cela pourrait suggérer quea « peur de grossir » tout autant que la « volonté d’êtreince » pourrait affecter à la fois les préoccupations en
ien avec la silhouette que l’image corporelle des jeunesemmes [30]. Lors de futures recherches, il pourrait êtreertinent de s’intéresser non seulement à la facon dontes personnes répondent quant à leurs préoccupations liéesu corps mais également les informations relatives à lailhouette qu’elles désirent atteindre (idéal de minceur).a poursuite effrénée du thigh gap par exemple (écartisible entre les cuisses lorsque les pieds sont joints) pares jeunes femmes qui ne craignent pas de grossir maisésirent être plus minces reflète un nouvel idéal sociétale minceur véhiculée non spécifiquement par les modèlesédiatiques. Cela pourrait ouvrir de nouvelles pistes de
éflexion en matière d’intervention thérapeutique mais éga-ement de prévention. Il se pourrait en effet que cet aspectarticulier, le désir de mincir, soit un facteur de vulnérabi-
’un biais de mémoire explicite chez les jeunes femmesurnal de thérapie comportementale et cognitive (2014),
ité pour certaines femmes et potentiellement à risque de’engager dans des conduites drastiques visant à atteindreeur idéal. Par ailleurs, le taux élevé dans notre étude deeunes femmes présentant un TCA, 31 %, toutes catégories
INModele +
à ri
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
ARTICLEJTCC-235; No. of Pages 8
Évaluation d’un biais de mémoire explicite chez les femmes
confondues (avéré, non spécifié et subclinique) suggère queles étudiantes francaises semblent à risque de développer unTCA, tout comme les adolescentes. Il pourrait donc s’avérertout à fait nécessaire de développer des programmes deprévention spécifique à destination des étudiantes.
Cette étude comporte certaines limites. Tout d’abord, ilpourrait être pertinent d’adjoindre au questionnaire diag-nostique de TCA un entretien clinique. Celui-ci permettraitd’affiner l’évaluation mais également d’apporter des infor-mations supplémentaires quant aux cognitions en lien lasilhouette et le poids, comme le désir de mincir ou lesauto-évaluations spécifiques liées au poids et la silhouetteen lien avec la définition de soi. Enfin, il serait égalementpertinent de mesurer d’autres dimensions en lien avec lespréoccupations liées à l’apparence corporelle et au poids,comme par exemple l’investissement corporel (dans quellemesure les jeunes femmes considèrent leur poids et leursilhouette comme influencant l’opinion ou l’estime qu’ellesont d’elles-mêmes) ou le body checking (c.-à-d. vérificationsde son apparence ou de son poids).
Conclusion
Bien que notre étude ne permette pas de confirmer leshypothèses découlant du modèle cognitif des TCA [3,4],les résultats semblent souligner l’importance des informa-tions liées à la silhouette et au poids chez les étudiantesfrancaises, et non spécifiquement celles congruentes avecle self-schéma liés au poids. Cela suggèrerait que contrai-rement à ce que le modèle cognitif propose [3,4], leself-schema lié au poids et à l’apparence de biaiserait pasle traitement de l’information en résistant aux informa-tions non congruentes et en traitant sélectivement cellesle confirmant. Ainsi, les jeunes femmes fortement insatis-faites ou souffrant de TCA, tout comme celles satisfaites etsans TCA, traitent à la fois les informations congruentes etincongruentes avec le self-schéma lié au poids. Dès lors, lesinformations en lien avec la silhouette et le poids qu’ellesdésirent atteindre pourraient également être la cible desinterventions thérapeutiques axées sur la modification dutraitement de l’information ou encore des programmesde prévention primaire ou secondaire sur l’image ducorps.
Déclaration d’intérêts
Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d’intérêts enrelation avec cet article.
Organisme de recherche ayant soutenu le travail : labo-ratoire Psitec EA 4072, Université Lille 3.
Congrès : concours « Jeunes chercheurs 2013 », 41e
Congrès de l’AFTCC, décembre 2013.
Références
[1] Halliwell E, Dittmar H. A qualitative investigation of women’sand men’s body image concerns and their attitudes towards
Pour citer cet article : Gasperini C, Rousseau A. Évaluation dfrancaises à risque de troubles des conduites alimentaires. Johttp://dx.doi.org/10.1016/j.jtcc.2014.06.001
aging. Sex Roles 2003;49:675—84.[2] Stice E, Presnell K, Spangler D. Risk factors for binge eating
onset: a prospective investigation. Health Psychol 2002;21:131—8.
[
[
PRESSsque de TCA 7
[3] Vitousek KB, Hollon SD. The investigation of schematiccontent and processing in eating disorders. Cognit Ther Res1990;14(2):191—214.
[4] Williamson D, Muller S, Reas D, Thaw J. Cognitive bias in eatingdisorders: implications for theory and treatment. Behav Modif1999;23:556—77.
[5] McNally RJ. On the scientific status of cognitive apprai-sal models of anxiety disorder. Behav Res Ther 2001;39(5):513—21.
[6] King GA, Ph D, Polivy J, Herman CP. Cognitive aspects of die-tary restraint: effects on Person memory. Int J Eat Disord1991;10(3):313—21.
[7] Svaldi J, Bender C, Tuschen-Caffier B. Explicit memory biasfor positively valenced body-related cues in women withbinge eating disorder. J Behav Ther Exp Psychiatry 2010;41(3):251—7.
[8] Hermans D, Pieters G, Eelen P. Implicit and explicit memory forshape, body weight, and food-related words in patients withanorexia nervosa and nondieting controls. J Abnorm Psychol1998;107(2):193—202.
[9] Baker JD, Williamson DA, Sylve C. Body image disturbance,memory bias, and body dysphoria: effects of negative moodinduction. Behav Ther 1995;26(4):747—59.
10] Hunt J, Cooper M. Selective memory bias in women withbulimia nervosa and women with depression. Behav Cogn Psy-chother 2001;29:93—102.
11] Israeli AL, Stewart SH. Memory bias for forbidden food cues inrestrained eaters. Cognit Ther Res 2001;25(1):37—47.
12] Sebastian SB, Williamson DA, Blouin DC. Memory bias forfatness stimuli in the eating disorders. Cognit Ther Res1996;20(3):275—86.
13] Lee M, Shafran R. Information processing biases in eating disor-ders. Clin Psychol Rev 2004;24(2):215—38.
14] Fairburn CG, Cooper Z, Shafran R. Cognitive behaviour therapyfor eating disorders: a ‘‘transdiagnostic’’ theory and treat-ment. Behav Res Ther 2003;41(5):509—28.
15] Wilson GT. Cognitive behavior therapy for eating disor-ders: progress and problems. Behav Res Ther 1999;37:S79—95.
16] MacLeod C, Rutherford E, Campbell L, Ebsworthy G, HolkerL. Selective attention and emotional vulnerability: assessingthe causal basis of their association through the experi-mental manipulation of attentional bias. J Abnorm Psychol2002;111(1):107—23.
17] Cooper P, Taylor M, Cooper Z, Fairburn C. The development andvalidation of the Body Shape Questionnaire. Int J Eat Disord1987;6:485—94.
18] Rousseau A, Knotter A, Barbe P, Raich R, Chabrol H. Étude devalidation de la version francaise du Body Shape Questionnaire.Encephale 2005;31:162—73.
19] Mintz LB, O’Halloran MS, Mulholland AM, Schneider PA. Ques-tionnaire for eating disorder diagnoses: reliability and validityof operationalizing DSM — IV criteria into a self-report format.J Couns Psychol 1997;44(1):63—79.
20] Callahan S, Rousseau A, Knotter A, Bru V, Danel M, CuetoC, et al. Les troubles alimentaires : présentation d’un outilde diagnostic et résultats d’une étude épidémiologique chezl’adolescent. Encephale 2003;29:239—47.
21] Garner D, Olmsted M, Bohr Y, Garfinkel P. The Eating AttitudesTest: psychometric features and clinical correlates. PsycholMed 1982;12:871—8.
22] Leichner P, Steiger H, Puentes-Neuman G, Perreault M, GottheilN. Validation of an eating attitude scale in a French-speakingQuebec population. Can J Psychiatry 1994;39:49—54.
’un biais de mémoire explicite chez les jeunes femmesurnal de thérapie comportementale et cognitive (2014),
23] Cassin SE, von Ranson KM. Word lists for testing cognitive biasesin eating disorders. Eur Eat Disord Rev 2005;13(3):216—20.
24] New B, Pallier C, Ferrand L, Matos R. Une base de donnéeslexicales du francais contemporain sur internet: LEXIQUETM//A
INModele +J
8
[
[
[
[
[
ARTICLETCC-235; No. of Pages 8
lexical database for contemporary french: LEXIQUETM. AnneePsychol 2001;101(3):447—62.
25] New B, Brysbaert M, Veronis J, Pallier C. The use of filmsubtitles to estimate word frequencies. Appl Psycholinguist2007;28:661—77.
26] Markus H, Hamill R, Sentis K. Thinking fat: self-schemas forbody weight and the processing of weight relevant information.
Pour citer cet article : Gasperini C, Rousseau A. Évaluation dfrancaises à risque de troubles des conduites alimentaires. Johttp://dx.doi.org/10.1016/j.jtcc.2014.06.001
J Appl Soc Psychol 1987;17:50—71.27] Stein KF. The self-schema model: a theoretical approach
to the self-concept in eating disorders. Arch Psychiatr Nurs1996;10(2):96—109.
[
PRESSC. Gasperini, A. Rousseau
28] Cassin SE, von Ranson KM, Whiteford S. Cognitive pro-cessing of body and appearance words as a function ofthin-ideal internalization and schematic activation. BodyImage 2008;5(3):271—8.
29] Nikendei C, Funiok C, Pfüller U, Zastrow A, Aschenbren-ner S, Weisbrod M, et al. Memory performance in acuteand weight-restored anorexia nervosa patients. Psychol Med
’un biais de mémoire explicite chez les jeunes femmesurnal de thérapie comportementale et cognitive (2014),
2011;41(4):829—38.30] Unterhalter G, Farrell S, Mohr C. Selective memory biases for
words reflecting sex-specific body image concerns. Eat Behav2007;8(3):382—9.