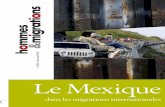Le Cheval dans l'Art paléolithique : observé, disséqué... interprété
« Le sacrifice disparu : les reliefs de boucherie », dans William van Andringa (éd.), Sacrifice...
-
Upload
univ-brest -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of « Le sacrifice disparu : les reliefs de boucherie », dans William van Andringa (éd.), Sacrifice...
Valérie HuetUniversité Paris-Diderot, France Centre Louis Gernet, EHESS, UMR 8567
Le sacrifice disparu : les reliefs de boucherie 1
Tous les animaux sont égaux mais certains sont plus égaux que d’autres.George Orwell, La Ferme des Animaux 2
AbstractReliefs of butchers, of animal carvings and
of butcher’s shops, do not seem related to sacrificial reliefs. On sacrificial images, though sheep and pigs appear, the main victim is the ox ; from all the stages in the ritual, only the ones starting with the procession to the altar, up to the killing of the animal are displayed ; except in some cases, there is a silence on the stages of carving meat, cooking and banqueting. Butcher’s images are focused above all on on pigs and the gesture of carving meat ; the viewer is drawn in images of banquets and of hunting. However it does not mean that pigs were not sacrificed before being carved and consumed. Simply, the sculptors’choices put a partial light on a lengthy and complex process. Images of carving meat fill a specific role : displaying the technical ability of the butcher, mainly of the man commemorated on his funerary monument. Sacrificial images serve another purpose as they carry the sacrificant’s piety to the gods ; though they can be seen on funerary monuments, they often decorate public monuments.
1 Je remercie William van Andringa de m’avoir entraîné un peu loin de mes terrains de prédilection.
2 Je cite la traduction de J. Quéval (Paris, 1981), p. 144.
Food & History, vol. 5, n° 1 (2007), pp. 197-223 10.1484 / J.FOOD.1.100191
KeywordsReliefs of butchersButcher’s shopCarvingHuntingBanquetSacrificeAnimal statusPigOxFowlMeat cutting
198 Valérie Huet
RésuméLes reliefs de boucherie, c’est-à-dire de
découpe animale et de boutiques de viande, semblent rarement avoir de liens explicites avec les reliefs sacrificiels. Sur les images sacrificielles, même si les ovins et les porcins sont aussi représentés, c’est la sculpture du bovin qui est privilégiée ; de l’ensemble des phases, ne sont retenues que celles allant de la procession à la mort de l’animal ; hormis quelques exceptions, ce qui relève de la cuisine et du banquet est omis. Les images de boucherie, elles, mettent essentiellement en scène le porcin, et un geste technique de découpe ; elles tirent le spectateur vers les séries d’images de banquet et de la chasse. On ne peut en déduire pour autant que le porc n’était pas sacrifié avant d’être transformé en parts alimentaires. Simplement, cela ne correspond pas au choix imagé qui ne peut qu’être une proposition synthétique ou un éclairage partiel de processus et rituels complexes et longs. Les images de découpe ont un rôle spécifique : montrer l’habileté du “boucher”, généralement de l’homme commémoré sur son monument funéraire. Les images sacrifi-cielles énoncent, elles, la piété du sacrifiant offrant une victime opime ; bien qu’elles se développent sur des monuments funéraires, elles ornent souvent des monuments publics.
Les images sacrificielles à Rome et en Italie mettent principalement en scène trois espèces animales : les bovins, les ovins et les porcins. S’ils peuvent apparaître séparément ou ensemble dans les phases de la pompa et de la praefatio, le bovidé se distingue par le fait que c’est l’animal le plus souvent représenté et le seul à figurer dans les représentations de mise à mort.3 Sur les reliefs provenant des Gaules romaines, une autre séquence apparaît, celle de la cuisine et de la découpe animale : une image concerne un bœuf, trois autres des porcins ; néanmoins, leurs liens avec le sacrifice ne sont pas toujours évidents, même si je les avais
3 Valérie HUET, “La mise à mort sacrificielle sur les reliefs romains : une image banalisée et ritualisée de la violence ?” in J.-M. BERTRAND (ed.), La violence dans les mondes grec et romain (Paris, 2005), pp. 91-119.
Mots - clés Reliefs de boucherieBoutiques de viandeViande -CoupeChasseBanquetSacrificeStatut de l’animalPorcBœufVolaille
Le sacrifice disparu : les reliefs de boucherie 199
intégré au corpus de scènes sacrificielles dressé à partir du catalogue d’Espérandieu-Lantier.4 Ainsi la scène avec le bœuf suspendu semble plutôt renvoyer au métier de boucher (voir infra, fig. 23). L’absence presque générale de liens explicites avec le rituel sacrificiel apparaît aussi lorsque l’on étudie les reliefs de banquet.5 Il semble donc que des phases du sacrifice, les sculpteurs n’aient essentiellement retenu que celles allant de la procession de l’animal à sa mort rituelle.6 Pourtant, les sources littéraires et épigraphiques révèlent l’importance du banquet sacrificiel et de la distribution de parts inégales qui soulignent l’établissement d’une hiérarchie entre les divinités et les hommes, mais aussi entre les hommes eux-mêmes, et enfin entre les hommes et les animaux.7 C’est de ce hiatus apparent entre ce que racontent les images et ce que narrent les sources écrites qu’est né cet article. J’ai volontairement – momentanément – 8 détourné mon regard des images sacrificielles habituelles pour le centrer sur des images que j’avais jusqu’alors ignorées, celles traitant l’animal comme de la viande à découper, vendre et cuisiner. Pourquoi ne semblent-elles pas renvoyer au sacrifice ? Que veulent mettre en évidence les sculpteurs et les commanditaires ?
Je propose donc d’analyser le corpus des images de boucherie, c’est-à-dire de découpe animale et de boutiques de viande. Je distinguerai ce que j’appelle les “images de boucherie” des “reliefs de bouchers” qui peuvent présenter à côté d’une inscription des instruments isolés et des scènes de
4 Emile ESPÉRANDIEU, Raymond LANTIER, Recueil général des bas-reliefs, statues et bustes de la Gaule romaine, I-XVI, (Paris, 1907-1981) ; Valérie HUET, “Les images de sacrifice en Gaule romaine” in S. LEPETZ, W. VAN ANDRINGA (eds.), Archéologie du sacrifice animal en Gaule romaine, Rituels et pratiques alimentaires (Montagnac, 2008), pp. 43-74.
5 Sylvia ESTIENNE, Valérie HUET, Nathalie GILLES, Stéphanie WYLER “Le banquet à Rome”, in ThesCRA, vol. 2 (Los Angeles, 2004), pp. 268-297.
6 Notons que ce choix des sculpteurs romains est très différent de celui opéré par les peintres de vases grecs, qui n’hésitent pas à montrer en image, dans le contexte sacrificiel, des scènes de découpe d’animal (dont des bovidés) et de cuisson de parts sacrificielles : je renvoie ici aux travaux de Jean-Louis DURAND, notamment à son ouvrage, Sacrifice et labour en Grèce ancienne. Essai d’anthropologie religieuse (Paris / Roma, 1986). Les options des représentations romaines diffèrent aussi de celles des reliefs grecs étudiés par Folkert T. VAN STRATEN, Hierà Kala : Images of animal Sacrifice in archaic and classical Greece (Leiden / New York / Köln, 1995).
7 Il suffit de se référer aux nombreux travaux de John SCHEID sur le sacrifice, notamment Romulus et ses frères. Le collège des frères arvales, modèle du culte public dans la Rome des empereurs (Paris / Roma, 1990) et Façons de faire, façons de croire. Recherches sur les rites sacrificiels des Romains (Paris, 2005). Voir aussi Francesca PRESCENDI, Décrire et comprendre le sacrifice. Les réflexions des Romains sur leur propre religion à partir de la littérature antiquaire (Stuttgart, 2007).
8 Un livre, issu en partie de ma thèse, sur les images sacrificielles romaines dans le monde romain occidental est en préparation.
200 Valérie Huet
transports d’animaux.9 Etant donné le maigre nombre de documents, je présenterai brièvement l’ensemble du corpus, avant d’en tirer, je l’espère, le miel ou plutôt le jus et la saveur. J’essaierai d’appréhender le corpus en le resituant dans le contexte des images de sacrifice et de banquet.10 J’établirai un parallèle avec des sources littéraires pour mieux comprendre le statut des animaux et la logique des images.
Le document le plus ancien est conservé au Museo Civico de Bologne (fig. 1) : la stèle funéraire en forme d’édicule est sculptée dans le calcaire local et date probablement du Ier s. de notre ère.11 La scène occupe le tiers inférieur de l’espace délimité par deux colonnes torsadées. À droite, un homme de profil vêtu d’une tunique s’affaire au-dessus d’un billot à trois
9 En dehors des catalogues de musées, la première personne à s’être intéressée à des reliefs de métiers est Natalie KAMPEN, Image and Status : Roman Working Women in Ostia (Berlin, 1981). Elle présente dans son catalogue cinq reliefs en rapport avec la viande et sa vente répartis selon rapport à leur provenance, deux d’Ostie, d’autres de Rome en insérant des reliefs comparatifs qui mettent en scène des hommes et non des femmes. Gerhard ZIMMER, Römische Berufsdarstellungen (Berlin, 1982), commence son catalogue par le métier de boucher : Fleischerhandwerk. Son corpus comprend dix-sept numéros. L’auteur distingue le boucher dans sa boutique ou son arrière-boutique, découpant par petits bouts la viande (1-5) ; le boucher ou la bouchère travaillant la bête suspendue par les pattes, la tête en bas (6-7) ; le métier du boucher signifié par les instruments du boucher et parfois un morceau de viande (8-17). Deux des reliefs qu’il présente ne sont connus que par des dessins. À ces reliefs, j’ajouterai l’enseigne d’une boutique, son n° 180. Le troisième ouvrage sur lequel repose mon corpus est celui de Laura CHIOFFI, Caro : il mercato della carne nell’occidente romano. Riflessi epigrafici ed iconografici, (Roma, 1999). La logique est épigraphique ; elle permet parfois de présenter des reliefs de bouchers montrant ceux-ci en citoyens romains qui auraient été impossibles à identifier comme bouchers s’il n’y avait pas eu l’inscription ; l’inverse est aussi vrai comme nous le verrons infra. Certaines images montrent la conduite des animaux, peut-être au marché : ils peuvent marcher ou être transportés en carriole. Le corpus s’étend aux provinces occidentales. C’est en se basant sur ces trois livres et sur le corpus d’Espérandieu qu’Adélaïde MALBRANQUE a constitué son corpus iconographique pour son mémoire de Master 2 intitulé La boucherie romaine : à Rome, en Gaule, en Bretagne et en Italie. Approches comparées des textes et des vestiges matériels, dirigé par Javier Arce, soutenu en 2007 à l’université de Lille 3. Son catalogue comprend vingt-cinq numéros qu’elle a organisés en distinguant les différentes phases relatives à la viande, le transport des animaux, la saignée et l’éviscération, la découpe, la vente puis leur représentation synthétisée par des signes, les instruments, les jarrets ; une des qualités de ce mémoire est son étude du vocabulaire latin et sa bonne utilisation du vocabulaire français pour décrire les instruments.
10 Mon interrogation portera entre autres sur le manque apparent d’allusion au sacrifice dans ces reliefs, en regard du débat de ces dernières années autour du statut de la viande consommée lors des banquets et de la nature de la viande vendue en boucherie : John SCHEID, “La spartizione a Roma”, Studi storici 4 (1984), pp. 945-956 ; John SCHEID, “Sacrifice et banquet à Rome. Quelques problèmes”, Mélanges de l’Ecole Française a Rome – Antiquité 97 (1985), pp. 193-206 ; Mika KAJAVA, “Visceratio”, Arctos 32 (1998), pp. 109-131 ; John SCHEID, Façons de faire..., pp. 213-254 ; John SCHEID, “Manger avec les dieux” in S. GEORGOUDI, R. KOCH PIETTRE, F. SCHMIDT (eds.), La cuisine et l’autel. Les sacrifices en questions dans les sociétés de la méditerranée ancienne (Turnhout, 2005), pp. 273-287. Voir bien entendu l’ensemble du dossier édité par William van Andringa, dans lequel cet article s’insère.
11 Provenant de Bononia ; H. 1, 89 m ; L. 0, 68 m. Gerhard ZIMMER, Römische Berufs-darstellungen…, n°1, pp. 93-94 ; Laura CHIOFFI, Caro..., n° 98, pp. 77-78. C’est volontairement que j’ai choisi de ne pas utiliser les mots latins pour décrire et analyser les scènes.
Le sacrifice disparu : les reliefs de boucherie 201
pieds ; même si l’on a du mal à discerner les détails en raison de l’état de conservation du monument, on peut penser qu’il est en train de découper de la viande. Ce sont peut-être des morceaux de viande qui reposent sur la table (ou vasque) supportée par un pied central ; pour G. Zimmer et L. Chioffi, il s’agit de côtes. Au-dessus, légèrement décalé vers le billot, une balance est suspendue à un support ; un objet semble flotter dans l’espace entre les deux plateaux de la balance : il a été interprété comme une boîte contenant six poids. L’inscription encadre la scène imagée, puisqu’elle s’étale au-dessus dans l’entrecolonnement et aussi en dessous de la niche.12 Selon L. Chioffi, le boucher serait l’affranchi Q. Valerius Restitutus. Néanmoins, sans l’image, il serait impossible de savoir que son métier était la découpe, car ce que met en avant l’inscription c’est le fait qu’il ait été sévir. Le relief funéraire du Trastevere conservé au Musée de Dresde (fig. 2)13 présente une scène plus détaillée et mieux conservée. On retrouve le boucher de profil tourné vers la gauche ; il a les cheveux courts et une barbe ; il est vêtu d’une tunique resserrée à la taille et porte des chaussures ; les muscles de ses jambes sont saillants et en partie mal dégrossis ce qui fait qu’on a presque l’impression qu’il porte des braies. Il est saisi en pleine action puisqu’il brandit un couperet au-dessus d’un morceau de viande qu’il soulève de la main gauche et qui repose en partie sur un billot à trois pieds. De l’autre côté du billot, apparaît un large récipient qui servait probablement à récolter le sang et peut-être des morceaux de viande. L’ensemble de ces éléments est encadré par des poutres ornées de crochets. Si l’on observe ce qui pend aux crochets en partant de la droite, on discerne une balance, une pince, un hachereau ou hachoir ; une longe, un jambon, deux pieds de cochon, une épaule avec des tétines, des intérieurs et une tête de cochon. Celle-ci fait face à une femme assise dans un fauteuil, les pieds sur un reposoir, tenant des tablettes ; de la main droite, elle semble soit pointer avec son doigt un élément de la tablette, soit écrire : probablement était-elle en charge de la comptabilité de la boucherie. L’association de la bassine ou du récipient à terre dans un espace voisin du billot est à retenir : elle se retrouve sur le dessin d’un relief aujourd’hui disparu (fig. 3).14 L’espace imagé met en relation deux groupes d’hommes. À droite, un homme en tunique lève un
12 Corpus Inscriptionum Latinarum [désormais CIL] XI, 6832 : V(iuus) f(ecit) / Q(uintus) Valerius / Q(uinti) l(ibertus) Restitutus / VI uir sibi et / Gaviae Cogitatae / uxori et / L(ucio) Metello Niceroti / Q(uo)q(uo) v(ersum) p(edes) XX.
13 Le relief était inséré dans le mur d’une maison du Trastevere ; marbre de Carrare ; H. 0, 38 m. ; L. 1, 35 m. ; inv. 415. Il est daté de l’époque d’Hadrien. Natalie KAMPEN, Image and Status..., n° 53, pp. 99, 157, fig. 45 ; Gerhard ZIMMER, Römische Berufsdarstellungen…, n° 2, pp. 94-95 ; Laura CHIOFFI, Caro..., n° 24, fig. 13, pp. 34-35.
14 Dessin de la collection Dal-Pozzo Albani, conservé au British Museum à Londres. Gerhard ZIMMER, Römische Berufsdarstellungen…, n° 3, p. 95 ; Laura CHIOFFI, Caro..., n° 27, fig. 16, pp. 37-38.
202 Valérie Huet
couperet au-dessus d’un morceau de viande, un cuissot qui repose sur un billot qui est en un seul bloc et non plus tripode. Lui fait face un homme vêtu d’une tunique qui avance la main vers le morceau de viande : pour G. Zimmer, il s’agirait d’un client qui indiquerait quelle portion de viande il désire. Néanmoins, étant donné qu’il s’agit d’un dessin, il est difficile de s’y fier totalement et d’aller aussi loin dans l’interprétation, me semble-t-il. Un homme en tunique et manteau lui tourne le dos ; il tient de la main gauche un objet long et semble désigner, comme l’indique son geste de la main droite, un quatrième homme qui tend une forme molle de la main droite au dessus du large récipient posé au sol. Est-ce un morceau de viande dont il égoutterait le sang ? Au-dessus, deux têtes de suidés semblent se regarder. Le relief provenant de Rome conservé à la Villa Albani (fig. 4) inverse la position du boucher par rapport au billot.15 L’homme a le corps face au spectateur, mais la tête tournée vers la droite, plus exactement vers la tête du porcin posée sur le billot massif. Il a les cheveux courts ondulés et porte la barbe ; il est vêtu d’une tunique probablement longue sur laquelle est enroulée autour des hanches un tissu qui pouvait faire office de tablier et qui, par sa manière de tenir, fait penser, comme le remarque justement G. Zimmer, au limus des uictimarii, les esclaves chargés des animaux sacrificiels ; néanmoins ces derniers étaient toujours torse nu et pieds nus ; ici, non seulement l’homme porte une tunique à manches courtes, mais il est aussi chaussé de sandales. De la main gauche, il tient, semble-t-il, l’oreille du cochon tandis que sa main droite lève l’instrument déjà vu auparavant, à savoir un couperet. L’homme est surélevé par une sorte de petit tabouret ou piedestal relativement plat. La scène est délimitée au-dessus par une poutre à crochets à laquelle sont suspendus, en allant de la gauche vers la droite, une seconde tête de cochon, un jambon, des tétines, des côtes avec épaule, et à nouveau des intérieurs ou intestins. Dans le champ de l’image apparaît l’inscription Marcio semper ebria.16 L’ensemble de la scène fait office de vignette, si je la compare en proportions au buste statuaire d’un homme barbu présenté de face et posé sur une base portant le nom Ti(berio) Iulio Vitali. Il porte un manteau militaire 17 maintenu par une fibule ronde. Ses traits, la forme de ses oreilles, l’ossature de sa tête, le nez épaté, sa coupe de cheveux et sa barbe prouvent qu’il s’agit de la même personne que celui exerçant le métier de boucher. Comme précédemment, sans l’image
15 La provenance est inconnue. Le relief est daté du IIe s., probablement de l’époque de Marc-Aurèle. Rome, villa Albani, inv. 11 ; marbre ; H. 0, 54 m. ; L. 0, 68 m. CIL VI, 9501 ; Natalie KAMPEN, Image and Status..., pp. 63, 99, fig. 44 ; Gerhard ZIMMER, Römische Berufsdarstellungen…, n° 5, pp. 96-97 ; Laura CHIOFFI, Caro..., n° 26, fig. 15, pp. 36-37.
16 CIL VI, 9501. Cette inscription est considérée comme postérieure au relief et reste en partie mytérieuse.
17 Traditionnellement, il est désigné par les historiens d’art sous le nom de paludamentum.
Le sacrifice disparu : les reliefs de boucherie 203
représentée, il serait impossible d’identifier l’occupation du défunt. Pour le spectateur, la vision du buste va de pair avec les tria nomina qui donnent l’identité du personnage, un citoyen romain ; le raccourci de la vie est révélé à la fois par le paludamentum qui renvoie au monde militaire, et par la vignette qui énonce la tâche de découpe de cochon. Sur la partie droite d’une plaque funéraire d’Ostie (figs. 5 et 6), on retrouve un ensemble d’éléments identiques.18 Un personnage face à nous, vêtu d’une tunique lâche, élève de la main droite un couperet au-dessus d’un cuissot posé sur un billot. La scène est encadrée par des instruments suspendus aux crochets de deux poutres ou barres : à gauche une balance constituée d’un balancier et d’un poids, à droite des parties d’un porcin parmi lesquelles, en lisant de gauche à droite, une épaule, un morceau, des côtes, une tête et une patte. En-dessous, un objet presque rectangulaire avec une ouverture ; sa forme n’est pas tout à fait évidente à interpréter ; mais sa fonction peut probablement être éclairée par sa position par rapport au billot qui renvoie au large récipient ou bassine que nous avions repéré sur le relief de Dresde et sur le dessin du relief disparu (fig. 2 et 3 ). La plaque de la tabula ansata (fig. 5) est cassée à droite, mais laisse néanmoins apercevoir le museau et les pattes avant d’un porcin. Cet ensemble est sculpté à droite de l’inscription D(iis) M(anibus). Il ne peut se comprendre sans la lecture des deux truies qui sont représentées à gauche de l’inscription : elles semblent flotter dans l’espace puisqu’elles ne reposent pas sur une ligne de sol, mais leur orientation et leur grosseur font que le spectateur les imagine se dirigeant vers l’espace de découpe. La perspective montre que l’insistance du sculpteur porte sur la splendeur des animaux, leur sexe féminin ; en comparaison, la figure du boucher est peu détaillée et correspond plus à l’expression de gestes techniques. Il est intéressant de noter que les truies ne sont ornées d’aucune parure sacrificielle ; rappelons néanmoins que si les infulae et dorsual ornaient le plus souvent les porcins pendant la pompa, ils étaient enlevés avant la mise à mort effective. Cependant, pour notre propos, cela signifie que le sculpteur, dans son choix synthétique d’éléments, ne privilégie pas l’évocation du sacrifice, mais celui des bêtes amenées à l’abattoir.19
18 Il est daté du IIe s. Ostie, Museo Ostiense, inv. 133 ; marbre ; H. 0, 22 m. ; L. 1, 30 m. Natalie KAMPEN, Image and Status..., p. 99, n° 8, p. 141, fig. 43 ; Gerhard ZIMMER, Römische Berufsdarstellungen…, n° 4, pp. 95-96.
19 Ainsi le caractère sacrificiel des animaux représentés seuls sur les Anaglypha Hadriani est donné par les parures dont ils sont ornés. Cependant, sur un relief tel que le petit côté du sarcophage conservé à St Laurent Hors les Murs, la truie conduite au sacrifice par un uictimarius ne porte aucune parure. Sur la dénudation rituelle des animaux avant la mise à mort, voir John SCHEID, “La mise à mort de la victime sacrificielle. À propos de quelques interprétations antiques du sacrifice romain” in A. MÜLLER-KARPE, H. BRANDT, H. JÖNS, D. KRAUSSE, A. WIGG (eds.), Studien zur Archäologie der Kelten, Römer und Germanen in Mittel-und West-Europa. Alfred Haffner zum 60. Geburtstag gewidmet (Rahden, 1998), pp. 519-529.
204 Valérie Huet
Cette petite série de reliefs est cohérente : même si elle ne présente pas de scène identique, les choix des sculpteurs mettent en général en avant le geste technique (celui de la découpe avec un couperet réalisée par un homme habillé au moins d’une tunique), un mobilier spécifique (le billot et le large récipient), des instruments parmi lesquels la balance semble jouer un rôle important, et des morceaux de viande suspendus à des crochets qui se répètent en partie d’un relief à un autre. Ce qui est frappant, c’est que tous ces reliefs traitent d’une seule espèce animale : le porcin, aisément reconnaissable par l’usage d’exhiber au moins une tête de cochon. C’est principalement cette espèce que je suivrai au gré d’autres reliefs que j’ai classés, de nouveau dans la mesure du possible, par petites séries : en premier la découpe sur un billot ou une table, puis l’éviscération ou le découpage de l’animal suspendu à une poutre par les pattes arrière, enfin la vente de la viande.
La première image que j’aimerais discuter est une scène de découpe et de cuisine qui orne un couvercle de sarcophage provenant d’Ostie (fig.7).20 À gauche, on voit un homme vêtu d’un limus court alimentant un feu sous un large récipient ; un homme en tunique tient de la main droite un instrument, une feuille, afin de découper une cuisse sur un billot composé d’une table épaisse posée sur deux tréteaux. Deux autres personnages portent un plat sur lequel on distingue un morceau de viande équivalent, allant de la cuisse à la patte du sanglier, et un pain rond. Par leurs limus courts, on peut assimiler ces personnages à des esclaves. Cependant pour mieux comprendre cette scène, il faut la remettre dans son contexte (fig. 8). Cette scène est séparée d’une autre par un titulus anépigraphe ; elle met en scène un banquet de quatre hommes buvant ; devant le stibadium sont disposés trois pains et des morceaux de viande, des cuissots. Les deux hommes au centre du banquet sont interprétés comme les Dioscures et l’homme à gauche serait peut-être Méléagre. La cuve du sarcophage représente la chasse de Méléagre. À la série de sarcophages liés à la chasse de Méléagre, se rattache un autre sarcophage provenant d’Ostie qui montre sur le couvercle la phase de la découpe du sanglier (fig. 9).21 De nouveau, deux scènes sont séparées par une tabula
20 Frascati, Villa Aldobrandini ; marbre ; H. 0, 265 m., L. 2, 33 m. ; daté du milieu de l’époque antonine. Guntram KOCH, Die Mythologischen Sarkophage. VI Teil : Meleager (Berlin, 1975), p. 87, n°7, pl. 4,5g-h, 114e et 118 a-b ; Elisabeth JASTRZEBOWSKA, “Les scènes de banquet dans les peintures et sculptures chrétiennes des III et IVe siècles”, Recherches Augustiniennes IV (1979), p. 54, n°64 ; Laura CHIOFFI, Caro..., n°55, p. 55, fig. 30 ; Paul ZANKER, “I sarcofagi mitologici e i loro osservatori” in Paul ZANKER, Un’arte per l’impero. Funzione e intenzione delle immagini nel mondo romano (Milano, 2002), p. 163, fig. 128 ; Sylvia ESTIENNE, Valérie HUET, Nathalie GILLES, Stéphanie WYLER, “Le banquet...”, p. 295, n°141.
21 Ostie, Isola sacra. H. 0, 18 m. ; L. 2, 18 m. ; l. 0, 36 m. ; milieu de l’époque antonine. Guntram KOCH, Die Mythologischen Sarkophage..., pp. 126-127, n° 130, pl. 114f ; Elisabeth JASTRZEBOWSKA, “Les scènes de banquet...”, p. 54, n° 67.
Le sacrifice disparu : les reliefs de boucherie 205
ansata, cette fois-ci comprenant une inscription.22 À gauche, la scène de cuisine présente un homme alimentant un feu sous un cratère pendant que deux hommes découpent un sanglier renversé et qu’un quatrième personnage prépare un morceau de viande posé sur un bloc à terre. Le banquet de droite met en scène cinq personnages parmi lesquels on identifie les dioscures, Atalante et Méléagre. On peut rapprocher la scène de découpe de celle d’un relief placé sous la voûte centrale de la porte de Mars à Reims (fig. 10) : 23 un homme est en train de découper un porc renversé sur une petite table basse, pendant que, lui tournant le dos, un autre homme s’apprête à occire ou saigner un autre porc. Le contexte est différent et probablement lié aux travaux agricoles, voire à un sacrifice effectué au mois de novembre tel qu’on l’interprète habituellement, puisque cette scène s’intègre dans un calendrier et évoquerait ce mois ; néanmoins, il n’existe aucun indice spécifiquement sacrificiel dans l’espace imagé. Cette manière d’inciser un animal étendu sur le dos rappelle un relief du Louvre bien connu, mais qui met en scène un bovidé : le contexte est alors sacrificiel, puisque la représentation montre une scène de litatio, celle de l’examen des organes intérieurs par l’haruspice pour vérifier que la victime est agréée par la divinité à laquelle elle est offerte. Mais revenons à la série de la chasse de Méléagre : bien que les autres reliefs ne présentent pas de scènes de découpe à proprement parler, l’aspect culinaire lié à la chasse, à la prise du sanglier, à son transport et au banquet final reste évoqué : ainsi sur le couvercle de sarcophage conservé à Istanbul (fig. 11), à droite du banquet de neuf personnages parmi lesquels on reconnaît de nouveau Atalante, Méléagre et les Dioscures, un personnage tient un sanglier abattu ; le groupe est orienté vers un homme allumant un feu sous un récipient.24 Le couvercle de sarcophage de S. Cecilia in Trastevere (fig. 12) montre, de part et d’autre du banquet d’Atalante, Méléagre et les Dioscures (vers lequel vole à droite un homme tenant un sceptre qui est interprété comme Oineus), à droite trois personnages s’affairant autour d’un sanglier à terre, encore attaché, à gauche un homme alimentant un feu sous un cratère pendant qu’un autre verse du vin d’une amphore dans un second cratère.25
22 Berria Zosime / fecit sibi et / Berrio Euhelpisto / coiugi suo.23 Emile ESPÉRANDIEU, Recueil ..., V, n° 3681, pp. 33-39. Je ne l’avais pas intégré dans le
corpus proposé dans Valérie HUET, “Les images... ”.24 H. 0, 215 m. Istanbul, Mus. Archéologique, inv. 2100. − début de la période antonine.
Guntram KOCH, Die Mythologischen Sarkophage..., pp. 110-111, n° 81, pl. 68, 116 a-c ; Elisabeth JASTRZEBOWSKA, “Les scènes de banquet...”, p. 54, n°65 ; Paul ZANKER, Björn Christian EWALD, Mit Mythen leben. Die Bilderwelt der römischen Sarkophage (München, 2004), pp. 71-73 et 353-354, n°27.
25 Rome, crypte de S. Cecilia in Trastevere ; H. 0, 25 m. ; L. 2, 16 m. ; l. 0, 52 m. ; fin de l’époque antonine. Guntram KOCH, Die Mythologischen Sarkophage..., p. 126, n° 128, pl. 114c ; Elisabeth JASTRZEBOWSKA, “Les scènes de banquet...”, p. 54, n° 63 ; Katherine M.D. DUNBABIN, “Wine and water at the Roman convivium”, Journal of Roman Archaeology 6 (1993), pp. 136-138, fig. 27.
206 Valérie Huet
Sur un fragment de couvercle de sarcophage (fig. 13),26 je retrouve quelques éléments identiques, à gauche du buste d’un personnage autour duquel virevoltent deux érotès tenant une guirlande : en effet, trois personnages semblent détacher un sanglier de l’armature qui a servi à le transporter ; à côté, un personnage verse du liquide d’une longue amphore dans un récipient, pendant qu’un autre brandit une hache ; pour G. Koch, ce dernier casse du bois. À l’extrémité gauche, un homme en partie agenouillé devait alimenter un feu, ce qui est confirmé par deux dessins qui subsistent et qui permettent de restituer la scène de droite qui représentait un banquet avec Atalante, Méléagre et les Dioscures devant lesquels était disposé un plat avec une hure (fig. 14). Et il est assez facile de remarquer que sur de nombreux couvercles de sarcophage datés du IIIe siècle, sculptés principalement dans des ateliers romains, les scènes de banquet, liées ou non à la chasse, montrent fréquemment, comme nourriture ornant les plats, la tête d’un cochon à côté de volaille ou de poisson. Je n’en citerai qu’un exemple conservé à Naples (fig. 15) : trois hommes participent à un banquet en sigma ; un homme en tunique tend un gobelet à l’un d’entre eux tandis que de l’autre main il tient un vase ; derrière lui, on aperçoit un cratère chauffant dans un four ; devant le puluinus, est exhibée une tête de cochon ou hure sur un plateau entre deux pains.27
Ainsi, au IIe et IIIe siècles à Rome, les représentations des couvercles de sarcophages entraînent la découpe des suidés vers le monde des chasses et des banquets.
Une autre scène de découpe sur une table apparaît sur un relief de Bordeaux (fig. 16) ; mais son contexte reste mystérieux et semble en tout cas ne pas être lié à la chasse.28 Un homme en tunique tranche, à l’aide d’un couteau, un porc dont manquent déjà la tête et les pattes ;
26 Rome, atelier Canova ; H. 0, 28 m. ; L. 0, 85 m. ; première moitié du IIIe s. Guntram KOCH, Die Mythologischen Sarkophage..., pp. 48-50 n° 132, p. 127, pl. 115a-c ; Elisabeth JASTRZEBOWSKA, “Les scènes de banquet...”, p. 55, n°72 ; Valérie HUET, “À table. Des images romaines de “banquet” ou des gestes à suivre”, Cahiers du centre de recherches historiques, n° 37, avril 2006, pp. 64 et 66, fig. 9.
27 Couvercle de sarcophage, fragment, Museo Nazionale, inv. 6595. L. 0, 60 m. ; H. 0, 31 m. ; fin IIIe s. Nikolaus HIMMELMANN, Typologische Untersuchungen an römischen Sarkophagreliefs des 3. und 4. Jahrhunderts n. Chr. (Mainz, 1973), p. 59, n° 14, pl. 46 ; Elisabeth JASTRZEBOWSKA, “Les scènes de banquet...”, p. 53 n° 59 ; Francesca GHEDINI, “Raffigurazioni conviviali nei monumenti funerari romani”, Rivista di Archeologia 14 (1990), fig. 18 ; Rita AMEDICK, Die Sarkophage mit Darstellungen aus dem Menschenleben, Vierter Teil : Vita Privata, ASR 1.4 (Berlin, 1991), pp. 134-135, n° 78, pl. 34.5. Ce relief est classé par Jastrzebowska dans les scènes de banquet non chrétiennes accompagnées de scènes de chasse.
28 Bordeaux, Musée des antiques. Provenant de la muraille romaine de Bordeaux ; pierre commune. Émile ESPÉRANDIEU, Recueil ... II, n° 1100, pp. 149-150 ; Valérie HUET, “Les images... ”, p. 47, n°15, pp. 58 et 61.
Le sacrifice disparu : les reliefs de boucherie 207
une corbeille, placée en partie sous la table basse, semble recueillir des morceaux coupés ; l’homme est entouré de trois personnages ; à gauche on distingue une autre corbeille sur laquelle semble apparaître la tête d’un animal, peut-être celle du cochon ; ce qui est curieux, c’est qu’elle semble chevauchée par un petit putto ; mais peut-être est-ce la photographie qui m’induit en erreur. À droite, trois personnages assis, probablement un homme et deux femmes, semblent observer la procédure de découpe. Faut-il lier cette image au sacrifice ? Il existe au moins deux scènes qui lient la cuisine au sacrifice : la première figure sur un autel fragmentaire conservé au Musée de Bonn.29 La face principale (fig. 17) présente deux registres imagés séparés par une inscription 30 : au registre supérieur, les Matronae Aufaniae encadrées par deux victoires ; au registre inférieur, une scène de libation, qu’on peut néanmoins interpréter comme une praefatio, en raison des figures apparaissant sur les faces latérales. En effet, les faces latérales (fig. 18) montrent chacune au registre supérieur un assistant (une femme et un homme) entre deux pilastres décorés de végétaux ; au registre inférieur, un homme en tunique porte, renversé sur son dos, un cochon tandis que sur l’autre face, un homme torse nu, vêtu d’un limus court, semble surveiller le bouillonnement d’un chaudron suspendu à une crémaillère au-dessus d’un feu ; de la main gauche, il tient un instrument percé de six trous. Le transport du cochon fait penser à celui d’une truie sur le relief de Beaujeu.31 La truie est représentée à la fois au sein des victimes conduites dans la pompa sacrificielle et dans la partie des personnages s’éloignant de l’autel ; dans cette dernière, elle figure renversée au-dessus de l’épaule d’un victimarius (fig. 19), comme si elle appuyait ses sabots sur la ligne délimitant la partie supérieure de la frise ; quel que soit l’aspect peu réaliste du relief, il est intéressant de noter que, des diverses espèces animales conduites à l’autel, seule celle des porcins est montrée prête à être découpée et cuisinée.32 Le second
29 Provenant des fondations d’une église du IV ème siècle, sous la crypte de la cathédrale de Bonn ; calcaire. Émile ESPÉRANDIEU, Recueil ..., XI, n° 7762, pp. 80-82. Ines SCOTT RYBERG, Rites of the State Religion in Roman Art, Memoirs of the American Academy in Rome 22 (1955), pp. 171-172, pl. 62, fig. 102 a ; Ton DERKS, Gods, Temples and Ritual Practices. The Transformation of religious Ideas and Values in Roman Gaul (Amsterdam, 1998), pp. 221-224, fig. 5.1 ; Valérie HUET, “Les images... ”, p. 47, n°14, pp. 60-61.
30 Aufanis, C(aius) Candidinius Verus, dec(urio) c(oloniae) C(laudiae) A(rae) A(grippinensium), pro se et suis, v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
31 Lyon, Musée de la civilisation gallo-romaine. Émile ESPÉRANDIEU, Recueil ..., III, n° 1801, pp. 42-43 ; Valérie HUET, “Les images... ”, p. 47, n°4 p. 57.
32 Je n’ai pas tenu compte dans cet article des scènes isolées de transport d’animaux. Je souhaite pourtant signaler le relief de Rome conservé au Pal. Mattei qui montre dans une charette un sanglier et trois animaux renversés ; le contexte est probablement celui d’un retour de chasse : voir Laura CHIOFFI, Caro..., n° 29, pp. 38-39, fig. 18.
208 Valérie Huet
monument qui renvoie explicitement le porc au sacrifice et au banquet est conservé au Musée de Cologne.33 La face principale montre une scène de praefatio (fig. 20) : le sacrifiant, vêtu d’une tunique et d’un manteau lui couvrant la tête, accomplit une libation de la main droite au-dessus des flammes d’un focus ; il est entouré de deux personnages dont l’un, placé derrière l’autel, tient, semble-t-il, une boîte à encens ; à gauche du focus, trois personnages parmi lesquels deux victimaires : l’un est courbé pour maintenir la victime sacrificielle, un porc, et l’autre porte un plat. Les deux côtés (fig. 21) présentent chacun une table couverte d’aliments parmi lesquels sont reconnaissables des fruits et une tête de porc ; en dessous de chaque table, des objets tels que des vases et un panier.
L’incision des animaux peut être traitée différemment. Nous avons ainsi trois reliefs présentant des animaux suspendus par les pattes arrière. Sur l’une des faces de l’autel funéraire conservé au musée archéologique de Vérone daté de la fin du Ier ou du début du IIe s. (fig. 22), le porc est accroché par les pattes aux crochets d’une poutre.34 Un homme en tunique courte avec des sandales aux pieds tient une hache ou hachette pour inciser la bête. Devant son pied, sous l’animal, est visible un couteau. L’inscription prend place sur la face principale : elle nous indique que l’autel est dédié aux Mânes de C. Cornelius Successus appartenant à la XII cohorte urbaine.35 Sur une troisième face, apparaît un homme en tunique, manteau (paenula), les pieds chaussés, portant une lance ou pilum. Il a les cheveux courts comme l’homme qui ouvre le cochon. C’est donc probablement le même homme, C. Cornelius Successus, qui est représenté sur les deux faces, l’une le montrant dans son métier de découpe, l’autre dans son activité de fantassin. Le seul relief montrant un bovidé suspendu par les pattes arrière est conservé au Musée de Dijon (fig. 23) : 36 deux hommes habillés d’une tunique encadrent l’animal et semblent procéder à son dépeçage avec des instruments (feuilles de boucher ?) tenus l’un dans la main droite, l’autre dans la main gauche.
33 Émile ESPÉRANDIEU, Recueil ..., VIII, n° 6430, pp. 338-339 ; Ines SCOTT RYBERG, Rites..., p. 171 ; Valérie HUET, “Les images... ”, p. 47, n° 6, p. 57.
34 Provenant d’Aquileia ; Vérone, Mus. Civ. Arch. Inv. 73 ; calcaire ; H.1, 11 m. ; L. 0, 60 m. ; l. 0, 45 m. Gerhard ZIMMER, Römische Berufsdarstellungen…, n° 6, pp. 97-98 ; Laura CHIOFFI, Caro..., n° 105, pp. 81-82, fig. 48.
35 CIL V, 909 : D(is) M(anibus) / C(ai) Corneli / C(ai) f(ilii) Successi / mil(itis) coh(ortis) XII urb(anae) / ann(orum) XVII m(ensium) V / C(aius) Cusonius / Dionysius et / Statia Cale nepot(i) / in solacium / L(ucii) Gavili Secundini et / Statiae Danae / parentum eius.
36 Fragment de cippe, pierre commune. Provenant des fondations du palais des Etats de Bourgogne de Dijon. Émile ESPÉRANDIEU, Recueil ..., IV, n° 3454, pp. 379-380 ; Raymond LANTIER, Recueil ..., XV, p. 157, pl. 112 ; Laura CHIOFFI, Caro..., n° 139, pp. 101-102, fig. 60 ; Valérie HUET, “Les images... ”, p. 46, n° 16, p. 61. Je remercie Christian Vernou pour m’avoir autorisée à reproduire le cliché du musée archéologique de Dijon réalisé par F. Perrodin.
Le sacrifice disparu : les reliefs de boucherie 209
Le dernier document à présenter des animaux suspendus pour être ouverts et découpés est conservé au Musée Torlonia à Rome (fig. 24) : il semble presque trop beau pour être vrai.37 L’espace est scindé en deux par une colonne : à gauche une femme debout, un tissu dans la main gauche, désigne de la main droite un vers tiré de l’Énéide de Virgile, I, 607-609 : “...tant que l’ombre glissera dans le repli des montagnes, tant que l’air du ciel nourrira le feu des astres, ta gloire, ton nom, tes louanges vivront...”.38 Ce sont des paroles que prononce Enée à Didon lors de sa rencontre avec la reine. Devant la femme debout, une femme assise de profil tourne sa tête et fait presque face au spectateur : ses pieds reposent sur une sorte de plaque la rehaussant ; sa main droite tient la tête d’une oie suspendue par les pattes ; probablement s’apprête-t-elle à la saigner au-dessus du plateau de la table circulaire ; elle devait tenir un couteau de la main gauche. À droite de la colonne, six animaux sont suspendus sur deux niveaux, la tête en bas : on distingue en haut deux porcs (dont l’un aux ventre et poitrail ouverts et dégarnis)39 encadrant une oie, en bas deux oies flanquant un lièvre. Pour L. Chioffi, la scène représenterait l’intérieur d’une boutique, la vendeuse assise s’occupant de la bête choisie par la cliente. L’association volaille et lièvre se retrouve sur un relief d’Ostie qui montre une boutique (fig. 25).40 En effet, de derrière les barreaux à droite sous le comptoir, sortent deux têtes de lapins ou lièvres et à côté, selon G. Zimmer, des oiseaux ; sur le comptoir sont assis à droite deux singes à côté d’une grande corbeille fermée qui contenait peut-être un serpent ; un escargot jouxte l’objet ; deux personnages sont derrière le comptoir, parmi lesquels une femme qui tend une forme ronde (œuf ou fruit ? ) prise manifestement sur l’un des deux plateaux. À côté, sont suspendus, à un gibet, deux volailles. La partie gauche du relief montre deux hommes semblant en pourparlers concernant la vente d’un animal, un lièvre ( ? ). Le foisonnement de la marchandise à vendre est
37 Rome, Mus. Torlonia, inv. 379 ; provenance inconnue, marbre ; H. 1, 40 m. ; L. 2, 18 m. ; vers le milieu du IIe s. Natalie KAMPEN, Image and Status..., pp. 99-100, 154, fig. 84 ; Gerhard ZIMMER, Römische Berufsdarstellungen…, n° 7, pp. 98-99 ; Laura CHIOFFI, Caro..., n° 23, pp. 33-34 fig. 12. Le marbre a été très restauré ; selon certains commentateurs, l’inscription serait un ajout de la Renaissance ; selon d’autres, la fabrication entière du relief date du XVIIIe s.
38 CIL, VI, 9685 : ... dum montibus umbrae / lustrabunt conuexa polus dum sidera pascet / semper honos nomenque tuum laudesque manebunt...
39 La taille réduite des porcs par rapport aux autres animaux pourrait faire penser qu’il s’agit de porcelets, à moins qu’il ne s’agisse de l’adoption d’une perspective hiérarchique. Étant données les multiples restaurations du relief, il est impossible de trancher.
40 Provenant d’Ostie, Regio III, d’un batiment antonin via della Foce. Ostie, Museo Ostiense, inv. 134 ; marbre ; H. 0, 245 m. ; L. 0, 545 m. ; deuxième moitié du IIe s. Natalie KAMPEN, Image and Status..., pp. 52-59, 139, fig. 28 ; Gerhard ZIMMER, Römische Berufsdarstellungen…, n° 180, pp. 220-221 ; Laura CHIOFFI, Caro..., n° 54, pp. 54-55, fig. 29.
210 Valérie Huet
d’autant plus intéressant que le relief servait probablement d’enseigne pour signaler une boutique. Notons qu’un parallèle peut être établi avec des images sur des sarcophages romains datés de la seconde moitié du IIe et du IIIe siècles, qui exhibent volailles et lièvres à côté de scènes de banquet.41 Mais revenons aux reliefs montrant des boutiques : deux concernent la vente de porc. Le premier document conservé à Rome (fig. 26)42 semble présenter, au registre supérieur d’une base ronde ou colonne,43 une scène de vente de viande, probablement de porc : un homme tend une forme molle à un autre au-dessus d’un billot massif sur laquelle on distingue un autre morceau. Une balance est suspendue entre les deux personnages vêtus de tunique. Ce serait aussi une boutique de viande de porc ou de charcuterie que l’on verrait sur le côté droit du relief fragmentaire provenant de Til Chatel, plus connu pour la boutique de vin qui la jouxte (fig. 27) : 44 à côté du comptoir, on distingue le billot sur lequel semble planté un hachoir ; devant le comptoir, un grand récipient, comme une sorte de tonneau ouvert ; sur le comptoir des morceaux de viande parmi lesquels peut-être une tête de cochon ; un petit personnage en tunique est visible derrière le comptoir. Au-dessus de lui, sont suspendus à trois crochets des formes longues faisant penser à des saucisses ou des boudins.
Ainsi, ce corpus de reliefs de boucherie provenant d’Italie et de Gaule/Germanie expose à nos yeux la place primordiale qu’y occupe le porcin ; montrer les porcins entraîne le spectateur vers les scènes de découpe, de cuisine, le tirant un peu du côté du sacrifice, mais surtout vers les contextes du banquet et de la chasse. La sculpture du bovidé rattache par contre celui-ci essentiellement au sacrifice. C’est pourquoi, avant de conclure, j’aimerais explorer brièvement ce que certains auteurs anciens,
41 L’exemple le plus frappant se trouve sur la cuve de sarcophage de P. CaeciliusVallianus, conservé au Vatican, Museo Gregorio Profano. Voir Rita AMEDICK, Die Sarkophage..., pp. 167-168, n° 286, pl. 15.2-4, 16-17, 108 ; Katherine M.D. DUNBABIN, The Roman Banquet, Images of Conviviality (Cambridge, 2003), pp. 120-122, fig. 68-69 ; Paul ZANKER, Björn Christian EWALD, Mit Mythen leben..., p. 177, n° 161 ; Sylvia ESTIENNE, Valérie HUET, Nathalie GILLES, Stéphanie WYLER, “Le banquet...”, pp. 294-295, n° 140, pl. 62 ; Valérie HUET, “À table... ”, p. 57, fig. 8.
42 Roma Antiq. Com. inv. 3037 ; provenance inconnue ; IIe s. ; H. 0, 55 m. Gerhard ZIMMER, “Römische Handwerker”, ANRW II 12.3 (1985), p. 208, pl. 12, 1-2 ; Laura CHIOFFI, Caro..., n°28, pp. 37-38, fig. 17.
43 Les scènes réparties sur deux registres se développent à l’arrière de la figure de Mercure. 44 De Dibio ; conservé au Musée archéologique de Dijon ; H. 0, 86 m. ; L. 1, 50 m. Émile
ESPÉRANDIEU, Recueil ..., IV, n° 3608 ; Chantal NERZIC, La sculpture en Gaule romaine (Paris, 1989), pp. 252-253 ; Laura CHIOFFI, Caro..., n° 140 p. 102 fig. 61. Pour C. Nerzic, il y aurait des boudins suspendus, 3 têtes de porc et 6 quartiers de lard.
Le sacrifice disparu : les reliefs de boucherie 211
Varron, Columelle et Pline l’ancien,45 ont rapporté sur le statut de diverses espèces animales, notamment les trois les plus couramment sacrifiées, à savoir les bovins, les ovins et les porcins. Mythiquement, les trois espèces sont liées à Rome et à l’Italie : les bovins par les uituli dont dériverait le nom de la contrée (dû soit au nombre particulièrement important des bœufs sur la terre italique, soit au taureau nommé Italus qu’Hercule aurait poursuivi depuis la Sicile)46 et par l’usage de bœufs pour les rites de fondation des villes ; les ovins par le fait que les Romains seraient issus de bergers (Faustulus, qui a recueilli Romulus et Rémus, était un berger), et que Romulus et Rémus, bergers eux-mêmes, aient choisi les Parilia pour fonder Rome ;47 les porcins par l’abondance des cochons sauvages ou sangliers sur le territoire 48 et par la truie blanche accompagnée de ses petits qu’aurait découvert Énée sur le sol italique, signe envoyé par les dieux pour lui indiquer de s’installer définitivement sur ce territoire, signe immédiatement offert en sacrifice.49 Les trois espèces renvoient donc à l’histoire mythique de Rome et sont dès l’origine bonnes à sacrifier : ensemble par le rite des suouetaurilia, elles purifient le peuple romain.50 Elles sont étudiées dans un ordre quasiment identique : en premier le bovin, puis l’ovin, enfin le porcin, mais au milieu d’autres animaux.51
45 Varron, Columelle et Pline l’Ancien colportent avec peu de variantes la même tradition ; les deux premiers prodiguent des conseils aux propriétaires terriens et agriculteurs pour les aider dans leurs besognes fermières, ce qui explique les détails innombrables sur le choix des animaux au moment de l’achat, sur la reproduction, la castration, le soin et l’élevage des animaux, les remèdes contre les maladies, et quelques observations fondamentales sur le comportement des animaux. Je m’attacherai essentiellement aux écrits de Varron et Pline l’Ancien.
46 VARRON, De re rustica, 2, 1, 9 : Denique non Italia a uitulis, ut scribit Piso? ; Ibid., 2, 5, 3 : Nam bos in pecuaria maxima debet esse auctoritate, praesertim in Italia, quae a bubus nomen habere sit existimata. Graecia enim antiqua, ut scribit Timaeus, tauros uocabat italos, a quorum multidine et pulchritudine et fetu uitulorum Italiam dixerunt. Alii scripserunt quod ex Sicilia Hercules persecutus sit eo nobilem taurum qui diceretur Italus. COLUMELLE, De re rustica, 6, praef. 7 : Nec dubium, quin, ut ait Varro, ceteras pecudes bos honore superare debeat, praesertim in Italia, quae ab hoc nuncupationem traxisse creditur, quod olim Graeci tauros italos vocabant... Je ne présente pas ici tous les mythes qui relient des bovins à l’histoire de Rome.
47 VARRON, De re rustica, 2, 1, 9-10 : Romanorum uero populum a pastoribus esse ortum quis non dicit? Quis Faustulum nescit pastorem fuisse nutricium qui Romulum et Remum educauit? Non ipsos quoque fuisse pastores obtinebit quod Parilibus potissimum condidere urbem ? Non idem quod multa etiam nunc ex uetere instituto bubus et ouibus dicitur, et quod aes antiquissimum quod est flatum pecore est notatum, et quod urbis, cum condita est, tauro et uacca qua essent muri et portae definitum...
48 Ibid., 2, 1, 5.49 Le prodige de la truie avec ses trente gorets est mentionné par Varron : Ibid., 2, 4, 18.50 Ibid., 2, 1, 10 : et quod, populus Romanus cum lustratur suouitaurilibus, circumaguntur
uerres aries taurus...51 Mais les raisons invoquées pour l’ordre adopté peuvent différer. Selon la préface de
Columelle, deux catégories d’animaux à quatre pattes sont à distinguer : ceux qui partagent le travail de l’homme comme le bœuf, la mule, le cheval et l’âne, et ceux qui sont gardés pour
212 Valérie Huet
le plaisir de l’homme ou pour son profit, tels le mouton, la chèvre, le cochon et le chien : COLUMELLE, De re rustica, 6, praef., 6. Varron, quant à lui, distingue gros et petit bétail, séparant de facto les bovidés des ovidés et porcidés : VARRON, De re rustica, 2, 1, 10 ; 2, 1, 12. Mais il les étudie aussi selon des principes d’élevage, ce qui lui permet de comparer les diverses espèces : par ex. Ibid., 2, 1, 20. Pline l’ancien range les bœufs dans la catégorie des chevaux et en parle après les chevaux et les ânes (PLINE L’ANCIEN, Naturalis historia, 8, 70-71) ; il classe les moutons et porcs dans la catégorie des bêtes à laine : d’abord le mouton et la chèvre (Ibid., 8, 72-76) ; puis le cochon et le sanglier (Ibid., 8, 77-79).
52 PLINE L’ANCIEN, Naturalis historia, 8, 70, 179.53 Ibid., 8, 70, 183 : Hinc uictimae opimae et lautissima deorum placatio.54 VARRON, De re rustica 2, 5, 3-4 : Hic socius hominum in rustico opere et Cereris minister,
ab hoc antiqui manus ita abstineri uoluerunt ut capite sanxerint, siquis occidisset. COLUMELLE, De re rustica 6, praef. 7 : quod deinde laboriosissimus adhuc hominis socius in agricultura : cuius tanta fuit apud antiquos veneratio, ut tam capitale esset bovem necuisse, quam civem.
55 Je cite la traduction d’A. Ernout, dans l’édition de la CUF. PLINE L’ANCIEN, Naturalis historia, 8, 70, 180 : Socium enim laboris agrique culturae habemus hoc animal, tantae apud priores curae, ut sit inter exempla damnatus a P<opulo> R<omano> die dicta, qui concubino procaci rure omassum edisse se negante occiderat bouem, actusque in exilium tamquam colono suo interempto.
56 VARRON, De re rustica, 2, 1, 20 : Sic boues altiles ad sacrificia publica saginati dicuntur opimi.
57 Mais cela ne signifie pas pour autant que des bœufs non réservés pour le sacrifice ne puissent après être sacrifiés. Voir plus loin note 61.
58 Ibid., 2, 5, 10 : Tametsi quidam de Italicis, quos propter amplitudinem praestare dicunt, [ad] uictimas faciunt atque ad deorum seruant supplicia, qui sine dubio ad res diuinas propter dignitatem amplitudinis et coloris praeponendi.
Le bœuf est par essence même l’ami des hommes, son compagnon indispensable pour le labour et le travail de la terre, la vache fournit le lait ; 52 ils sont appréciés des divinités comme offrande majeure,53 même si, dans un temps reculé il existait l’interdit de tuer un bœuf.54 Le bœuf doit être respecté et ne pas servir la gourmandise des hommes, comme le raconte l’anecdote rapportée par Pline l’Ancien : “Car pour compagnon dans le travail et l’agriculture nous avons cet animal, dont nos ancêtres avaient tant de soin qu’on cite l’exemple d’une condamnation prononcée, après assignation, par le peuple romain contre un citoyen : celui-ci, pour plaire à son mignon qui lui réclamait des tripes dont il prétendait n’avoir jamais mangé à la campagne, avait tué un boeuf : il fut envoyé en exil, comme s’il avait tué un colon.”55 Varron définit les boues opimi comme les animaux nourris en vue du sacrifice 56 ce qui laisse présumer une séparation entre animaux d’une même espèce et peut-être un régime spécial appliqué suivant les fins de ces animaux et leur rôle par rapport à l’homme : l’un l’aide dans la vie quotidienne à survivre, l’autre lui permet d’être pius et constitue l’intermédiaire du dialogue entre homme et divinité.57 Les bœufs préférés pour le sacrifice proviennent d’Italie en raison de leur grande taille et de leur couleur, nous dit-il plus loin.58
Le sacrifice disparu : les reliefs de boucherie 213
59 PLINE L’ANCIEN, Naturalis historia, 8, 70, 183 : Quam ob rem uictimarum probatio in uitulo, ut articulum suffraginis contingat ; breuiore non litant. Hoc quoque notatum, uitulos ad aras umeris hominis adlatos non fere litare, sicut nec claudicante, nec aliena hostia deos placari, nec trahente se ab aris.
60 VARRON, De re rustica, 2, 5, 11 : Paulo uerbosius haec, qui Manili actiones secuntur lanii, qui ad cultrum bouem emunt ; qui ad altaria, hostiae sanitatem non solent stipulari.
61 Sur ce passage, lire John SCHEID, Façons de faire…, pp. 227-228 et 253-254.62 PLINE L’ANCIEN, Naturalis historia, 8, 72, 187 : Magna et pecori gratia uel in
placamentis deorum uel in usu uellerum. Vt boues uictum hominum excolunt, ita corporum tutela pecori debetur.
63 VARRON, De re rustica, 2, 1, 4 : In quis primum non sine causa putant oues adsumptas et propter utilitatem et propter placiditatem. Maxime enim hae natura quietae et aptissimae ad uitam hominum. Ad cibum enim lacte et caseum adhibitum, ad corpus uestitum et pelles adtulerunt. La primeure en domestication est de nouveau soulignée chez Varron (Ibid., 2, 2, 2) comme argument pour savoir qui parlera de quelle espèce en premier. Sur les références aux profits de la tonte de la laine (mouton et chèvre), Ibid., 2, 1, 28 et 2, 11, 11.
Pline l’Ancien expose les caractéristiques des victimes qui plaisent aux divinités : un veau doit avoir la queue atteignant l’articulation du jarret ; il ne doit pas être porté à dos d’homme à l’autel sacrificiel ; la victime ne doit pas être boiteuse, ni être prise en dehors de celles qui reviennent en propre aux divinités, ni chercher à fuir l’autel.59 Les conseils que prodigue Varron pour l’achat des bovins révèlent la possibilité d’acheter un bœuf en vue d’un sacrifice ou pour l’abattoir : pour le bœuf sacrificiel, il n’est plus nécessaire de s’enquérir de la santé de l’animal, tandis que cette question est obligatoire pour les acheteurs de bœufs déjà domestiqués ou non, et les acheteurs de bœufs pour l’abattoir.60 C’est intéressant, parce que cela indique qu’il y avait de la viande de bœuf conçue avant tout comme nourriture, en parallèle à celle primordialement réservée au sacrifice et partagée dans les banquets sacrificiels. Cela ne signifie pas pour autant, comme l’a écrit John Scheid, que la viande du boucher n’était pas au préalable sacrifiée ; le rituel sacrificiel était peut-être simplement moins développé.61 Dans sa partie sur les ovins, Pline l’ancien compare le mouton au bœuf, et met en avant la propriété de nourriture du bœuf : “Les moutons sont aussi très précieux, soit par les victimes qu’ils fournissent pour apaiser les dieux, soit par l’usage qu’on fait de leurs toisons. Si les boeufs assurent la nourriture de l’homme, nous devons aux moutons le vêtement qui nous protège.” 62 Varron, dans son explication de l’origine de l’agriculture et de la domestication des animaux, affirme que les brebis ont été certainement les premiers animaux à être domestiqués en raison de leur utilité et placidité. Cette utilité est caractérisée justement par la nourriture (le lait et le fromage) et la matière première fournie pour habiller l’homme (laine et peau) qui rapporte beaucoup d’argent.63 C’est encore en se référant à la notion d’utilitas que Columelle accorde la place
214 Valérie Huet
64 COLUMELLE, De re rustica, 7, 2, 1 : Post huius quadrupedis ovilli pecoris secunda ratio est, quae prima fit, si ad utilitatis magnitudinem referas. Nam id praecipue nos contra frigoris violentiam protegit, corporibusque nostris liberaliora praebet velamina. Tum etiam casei lactisque abundatia non solum agrestes saturat, sed etiam elegantium mensas iucundis et numerosis dapibus exornat.
65 PLINE L’ANCIEN, Naturalis historia, 8, 75, 199.66 Ibid., 8, 77, 207 : Animalium hoc maxime brutum, animamque ei pro sale datam, non
inlepide existimabatur.67 VARRON, De re rustica, 2, 4, 10 : Suillum pecus donatum ab natura dicunt [iis] ad
epulandum. Itaque iis animam datam esse proinde ac salem quae seruaret carnem. Ce passage est suivi de considérations sur les quartiers de porc salé gaulois, qui sont réputés les meilleurs.
68 Ibid., 2, 4, 6 : Hoc pecus alitur maxime glande, deinde faba et hordeo et cetero frumento, quae res non modo pinguitudinem efficiunt, sed etiam carnis iucundu saporem.
69 PLINE L’ANCIEN, Naturalis historia, 8, 77, 209 : Adhibetur et ars iecori feminarum sicut anserum, inuentum M. Apici, fico arida saginatis ac satie necatis repente mulsi potu dato. Neque alio ex animali numerosior materia ganeae : quinquaginta prope sapores, cum ceteris singuli. Hinc censoriarum legum paginae, interdictaque cenis abdomina, glandia, testiculi, uuluae, sincipita uerrina, ut tamen Publili mimorum poetae cena, postquam seruitutem exuerat, nulla memoretur sine abdomine, etiam uocabulo suminis ab eo inposito.
première aux ovins.64 Si le mouton est le plus sot (stultus) des animaux pour Pline l’ancien,65 le porcin est le plus stupide (brutus) des animaux, et l’auteur poursuit par ces paroles : “et l’on dit, non sans esprit, que l’âme leur avait été donnée en guise de sel < pour conserver la chair>”. 66 Ce jeu de mots s’explique aisément par la réputation des porcins. Selon Varron, ils ont été donnés aux hommes pour festoyer et le sel a été également donné aux hommes pour pouvoir conserver la chair du porc.67 Leur agréable saveur vient de leur nourriture de glands, fèves, orge et grains.68 Pour Pline l’ancien, le porc est aussi réputé pour sa chair qui excite la gourmandise de l’homme, comme le prouve le gavage des truies et les multiples saveurs de la viande : “On pratique aussi l’art d’améliorer le foie des truies comme celui des oies : invention de M. Apicius, elle consiste à les engraisser avec des figues sèches, et une fois bien grasse, à les tuer soudainement en leur donnant à boire du vin miellé. Aucun autre animal ne fournit plus d’aliments à la gourmandise : sa viande présente environ cinquante saveurs, tandis que celle des autres n’en a qu’une. De là tant d’articles dans les lois censoriales, interdisant dans les repas les ventres, les glandes, les testicules, les matrices, les têtes de porc ; ce qui n’empêche pas que le mimographe Publilius, une fois qu’il fut sorti d’esclavage, ne fit jamais un dîner, dit-on, sans un ventre de truie ; c’est même lui qui donna à ce morceau le nom de sumen.” 69 Remarquons que ces morceaux sont justement bien visibles sur les reliefs, mais il est vrai que ceux-ci datent d’une époque où probablement la plupart de ces interdits avait été levée. La gourmandise des hommes se manifeste aussi dans la consommation de cochons sauvages ou sangliers, ce que rapporte
Le sacrifice disparu : les reliefs de boucherie 215
70 Ibid., 8, 78, 210-211.71 VARRON, De re rustica, 2, 4, 8 : Verris octo mensum incipit salire, permanet [et] ut id recte
facere possit ad trimum, deinde it retro, quaad peruenit ad lanium. Hic enim conciliator suillae carnis datus populo.
72 Ibid., 2, 4, 3 : Quis enim fundum colit nostrum quin sues habeat et qui non audierit patres nostros dicere ignauum et sumptuosum esse qui succidiam in carnario suspenderit potius ab lanario quam e domestico fundo ?
73 Ibid., 2, 4, 9. On rejoint ici le discours de Pythagore chez Ovide sur la culpabilité des animaux et leur lien avec leur sacrifice : voir l’analyse subtile de John SCHEID, “La mise à mort de la victime sacrificielle...”
74 VARRON, De re rustica, 2, 4, 16. Sur les porcs sacrés : aussi Ibid., 2, 1, 20.75 PLINE L’ANCIEN, Naturalis historia, 8, 77, 206 : “Pour le sacrifice, un cochon de lait est
pur à cinq jours ; un agneau, à sept ; un veau, à trente. Coruncanius a soutenu que les victimes prises parmi les ruminants n’étaient pas pures avant d’avoir deux dents (Suis fetus sacrificio die quinto purus est, pecoris die VII, bouis XXX. Coruncanius ruminalis hostias, donec bidentes fierent, puras negauit).”
76 Ibid., 8, 77, 207 : Intorta cauda ; id etiam notatum, facilius litare in dexterum quam in laeuum detorta.
Pline l’Ancien, dans le paragraphe qui suit : “Les cochons sauvages eux aussi sont venus à plaire. Déjà Caton le Censeur, dans ses discours, reproche à ses contemporains la couenne de sanglier. Après avoir divisé l’animal en trois, on ne servait pourtant que le milieu, qu’on appelait le râble de sanglier. Le premier Romain qui servit sur sa table un sanglier tout entier fut P. Servilius Rufus, père du Rullus, qui, sous le consulat de Cicéron, promulgua la loi agraire : tant est proche de nous l’origine d’un usage maintenant quotidien. Les Annales ont aussi noté ce fait, sans doute afin d’amender les mœurs des gens qui mangent deux ou trois sangliers à la fois, et ce non dans tout le repas, mais comme entrée. Le premier des Romains qui ait inventé les parcs pour sangliers et autres bêtes sauvages est Fulvius Lippinus.” 70 Il est clair donc, que parler de la consommation du porc entraîne de discuter de celle du cochon sauvage, de même que nos reliefs de découpe nous avaient entraînés vers les sangliers mangés dans le contexte de la chasse de Méléagre. Selon Varron, la fin naturelle du porc est chez le boucher, intermédiaire nécessaire entre le peuple et la viande de porc ;71 mais tout bon exploitant agricole doit avoir des porcs en suffisante quantité pour pouvoir les consommer sans avoir à recourir au boucher.72 Cependant, bien sûr, les porcins jouent un grand rôle dans les sacrifices ; d’ailleurs, nous dit Varron, l’étymologie grecque de leur nom les rattache au sacrifice : la raison invoquée est que le porc aurait donné naissance à la coutume de sacrifices d’animaux ; le porc est sacrifié dans les rites d’initiation à Cérès, quand un traité est conclu, et dans les rites nuptiaux.73 Les porcs sont “purs” et donc propres au sacrifice, ce qui explique leur désignation sacres, dix jours après la naissance pour Varron,74 cinq jours pour Pline l’Ancien.75 Les divinités préfèrent les porcs avec la queue tordue à droite plutôt qu’à gauche.76
216 Valérie Huet
Si je rapporte ces discours aux reliefs romains, il semble logique que sur les reliefs sacrificiels, bien qu’ils montrent les trois espèces animales, les sculpteurs et commanditaires aient cependant exprimé une préférence pour exhiber le bovin, victime principale de sacrifices publics, animal coûteux non seulement en valeur marchande mais en valeur affective. C’est le statut de l’animal par rapport au citoyen romain et aux divinités qui est en cause dans l’image sacrificielle et qui explique les divers degrés d’importance sur l’échelle sacrificielle qu’occupent les victimes. Pour la compréhension de la mise en images, l’animal sacrificiel ne peut être séparé de l’animal dans son rôle “de tous les jours”. Que l’animal sacrificiel soit essentiellement un animal domestique, de ferme, revient à opposer ou à rendre complémentaires deux rituels différents : le sacrifice et la chasse. Tous deux mettent à mort des “êtres vivants”, mais ni la même catégorie, ni la même technique, ni le même “prétexte” – pour reprendre un jugement pythagoricien- ne sont employés. Et la chasse renvoie aux reliefs de boucherie. Prendre en compte les scènes de découpe, c’est donc, comme pour les textes, choisir de mettre en avant le porc ou le sanglier et le geste technique du boucher. Mais cela ne signifie aucunement que le porc n’était pas sacrifié, même a minima, avant d’être transformé en parts alimentaires. Simplement, cela ne correspond pas au choix imagé qui, rappelle-t-on, ne peut qu’être une proposition synthétique ou un éclairage partiel de processus et rituels complexes et longs. De plus, les images de découpe ont toutes un rôle spécifique : montrer l’habileté du “boucher”, à savoir de l’homme commémoré sur son monument funéraire. Or le “boucher” n’est jamais le sacrifiant dans les sacrifices publics, et ne l’est probablement que très rarement dans les sacrifices privés. A contrario, montrer le rituel sacrificiel à Rome, c’est mettre en scène le sacrifiant ; c’est démontrer sa piété envers les dieux, de préférence en exhibant une victime majeure, le bœuf ; c’est également établir son rang parmi les hommes, parmi les citoyens romains. Le hiatus entre les séries d’images sacrificielles et d’images de “boucherie” s’explique donc aisément : dans la première, c’est la piété du sacrifiant et la hiérarchie qu’établit le rituel qui sont mises en scène ; dans la seconde, c’est le métier avec toute sa “technicité” qui est en cause. Les deux séries, même si l’on ne considère que les reliefs funéraires, font donc appel à deux logiques différentes.
Le sacrifice disparu : les reliefs de boucherie 217
Figure 1. Relief, Museo Civico de Bologne, d’après Gerhard ZIMMER, Römische Berufsdar-stellungen (Berlin, 1982), p. 94.
Figure 2. Relief du Trastevere, Musée de Dresde, d’après Gerhard ZIMMER, Römische Berufsdarstellungen (Berlin, 1982), p. 94.
Figure 3. Dessin de la collection Dal-Pozzo Albani, Londres, British Museum, d’après Gerhard ZIMMER, Römische Berufsdarstellungen (Berlin, 1982), p. 95.
Figure 4. Relief, Rome, villa Albani, d’après Gerhard ZIMMER, Römische Berufsdarstellungen (Berlin, 1982), p. 97.
218 Valérie Huet
Figure 6. Détail de la figure 5.
Figure 7. Fragment de couvercle de sarcophage, Frascati, Villa Aldobrandini, d’après Guntram KOCH, Die Mythologischen Sarkophage. VI Teil : Meleager (Berlin, 1975), pl. 114 e.
Figure 8. Sarcophage, Frascati, Villa Aldobrandini, d’après Guntram KOCH, Die Mythologischen Sarkophage. VI Teil : Meleager (Berlin, 1975), pl. 4a.
Figure 5. Relief, Ostie, Museo Ostiense, d’après Natalie KAMPEN, Image and Status : Roman Working Women in Ostia (Berlin 1981), fig. 43.
Le sacrifice disparu : les reliefs de boucherie 219
Figure 9. Couvercle de sarcophage, Ostie, Isola sacra, de sarcophage, Frascati, Villa Aldobrandini, d’après Guntram KOCH, Die Mythologischen Sarkophage. VI Teil : Meleager (Berlin, 1975), pl. 114f.
Figure 10. Dessin d’un relief de la porte de Mars à Reims, d’après Emile ESPÉRANDIEU, Recueil général des bas-reliefs, statues et bustes de la Gaule romaine, V (1913), n° 3681.
Figure 11. Couvercle de sarcophage, Istanbul, Musée archéologique, d’après Guntram KOCH, Die Mythologischen Sarkophage. VI Teil : Meleager (Berlin, 1975), pl. 114a.
Figure 12. Couvercle de sarcophage, Rome, crypte de S. Cecilia in Trastevere, d’après Guntram KOCH, Die Mythologischen Sarkophage. VI Teil : Meleager (Berlin, 1975), pl. 114c.
220 Valérie Huet
Figure 14. Dessin de couvercle de sarcophage, Rome, atelier Canova, d’après Guntram KOCH, Die Mythologischen Sarkophage. VI Teil : Meleager (Berlin, 1975), pl. 115b.
Figure 15. Fragment de couvercle de sarcophage, Naples, Museo Nazionale, d’après Rita AMEDICK, Die Sarkophage mit Darstellungen aus dem Menschenleben, Vierter Teil : Vita Privata, ASR 1.4 (Berlin, 1991), pl. 34.5.
Figure 16. Relief, Bordeaux, Musée des antiques, d’après Emile ESPÉRANDIEU, Recueil général des bas-reliefs, statues et bustes de la Gaule romaine, II, n° 100.
Figure 13. Fragment de couvercle de sarcophage, Rome, atelier Canova, d’après Guntram KOCH, Die Mythologischen Sarkophage. VI Teil : Meleager (Berlin, 1975), pl. 115c.
Le sacrifice disparu : les reliefs de boucherie 221
Figure 17. Autel, Musée de Bonn, face principale, d’après Emile ESPÉRANDIEU, Recueil général des bas-reliefs, statues et bustes de la Gaule romaine, XI, n° 7762.
Figure 18. Autel, Musée de Bonn, faces latérales, d’après Emile ESPÉRANDIEU, Recueil général des bas-reliefs, statues et bustes de la Gaule romaine, XI, n° 7762.
Figure 19. Relief de Beaujeu, détail, Musée de la civilisation gallo-romaine de Lyon.
Figure 20. Autel, Musée de Cologne, face principale, d’après Emile ESPÉRANDIEU, Recueil général des bas-reliefs, statues et bustes de la Gaule romaine, VIII, n° 6430.
Figure 21. Autel, Musée de Cologne, faces latérales, d’après Emile ESPÉRANDIEU, Recueil général des bas-reliefs, statues et bustes de la Gaule romaine, VIII, n° 6430.
222 Valérie Huet
Figure 22. Autel, Musée de Vérone, face latérale, d’après A. DOSI, F. SCHNELL, Le abitudini alimentari dei Romani (Rome 1986), p. 73.
Figure 23. Relief, Musée archéologique de Dijon, cliché F. Perrodin, avec l’aimable autorisation de Christian Vernou.
Figure 24. Relief, Rome, Museo Torlonia, Relief, Ostie, Museo Ostiense, d’après Gerhard ZIMMER, Römische Berufsdarstellungen (Berlin, 1982), p. 99.
Le sacrifice disparu : les reliefs de boucherie 223
Figure 25. Relief, Ostie, Museo Ostiense, d’après Gerhard ZIMMER, Römische Berufsdar-stellungen (Berlin, 1982), p. 220.
Figure 26. Relief, Rome, Antiq. Com., d’après Laura CHIOFFI, Caro : il mercato della carne nell’occidente romano. Riflessi epigrafici ed iconografici, (Rome, 1999), fig. 17.
Figure 27. Relief, Dijon, Musée archéologique, d’après Laura CHIOFFI, Caro : il mercato della carne nell’occidente romano. Riflessi epigrafici ed iconografici, (Rome, 1999), fig. 61.