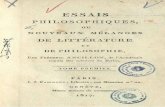Essais philosophiques ou Nouveau mélanges de littérature et de ...
Multiplication et illisibilité des niveaux politiques : quelles ressources philosophiques ?
-
Upload
paris-sorbonne -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Multiplication et illisibilité des niveaux politiques : quelles ressources philosophiques ?
La multiplication des niveaux du politique
Multiplication des niveaux et appropriation du politique
« L'illisibilité des pouvoirs comme problème politique »
Laurent Chapuis, CIPPA – Paris-Sorbonne, [email protected]
Vous pourriez être surpris, trouver original et presque
paradoxal, d'attribuer le prédicat « lisible » au sujet
« pouvoir ». En effet, d'ordinaire, ce n'est pas ce prédicat qui
lui est attribué, mais par exemple « légitime », « public » ou
« économique », « spirituel » ou « temporel », « civil » ou
« absolu ».
Lorsque, sur quelques dizaines de centimètres de voie publique,
le citoyen français doit comprendre le périmètre d'action et
l'articulation de trois personnes publiques distinctes qui se
partagent la compétence sur la voirie, l'éclairage public et le
stationnement, enfin sur le trottoir, il est dès lors aisé de
formuler le constat que la question « qui peut quoi ? » est devenue
redoutable. À côté de cet exemple fort peu complexe sur la gestion
de la voirie, nous pourrions réfléchir à l'organisation de
certaines politiques publiques, qui, comme le logement, l'aide
sociale ou la culture, laisse le citoyen dans l'incapacité de
formuler une réponse éclairée, parce que la réponse elle-même
n'est pas éclairée. Lorsque par ailleurs cette répartition des
compétences n'est pas homogénéisée — parce que le transfert de
1
certaines compétences de la commune à l'E.P.C.I.1 sont optionnels,
parce que les E.P.C.I. fixent leurs propres compétences — ni à
l'échelle nationale ni encore moins à l'échelle européenne,
comment une culture politique commune peut-elle advenir ? Est-ce à
dire que les sciences politiques et administratives devraient
pouvoir faire partie du socle commun de compétences de l'éducation
et de la citoyenneté ? Si les spécialistes de sciences
administratives et politiques peuvent répondre — certains ne le
peuvent, soit dit en passant, qu'à la condition d'une étude aussi
copieuse que spécifique — le fait que les citoyens ne le puissent
est un problème politique.
Problème politique, d'abord parce que le pouvoir politique
fonctionne à partir de sa représentation comme pouvoir — je ne
rappellerai pas ici la substance des Trois discours sur la condition des
grands attribué à B. Pascal — et de la représentation de ses
objectifs dans les théories contractualistes. Chez J.-J. Rousseau,
comme chez Rawls, l'association politique n'est pas un but en soi,
mais elle est réalisée pour atteindre un but commun qui a une
valeur supérieure à ce contrat. Chez Rousseau, cela prend la forme
d'une convention « jamais formellement énoncées » et « partout
tacitement admise ». Cette convention est faite selon « la suprême
direction de la volonté générale », qu'il assimile à la production d'« un corps
moral et collectif composé d’autant de membres que l’assemblée a de voix, lequel reçoit de
ce même acte son unité, son moi commun, sa vie et sa volonté »2. Chez
Rawls, l'idée de contrat social est celle d'une fiction servant à
1 Établissement Public de Coopération Intercommunale, habituellement désignéscomme formant l'intercommunalité, et regroupant les syndicats mixtes, lessyndicats intercommunaux, les communautés d'agglomération, les métropoles.
2 Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, éd. Robert Derathé, Paris, France,Gallimard, 1993, 535 p., Livre I, chapitre VI.
2
montrer comment, dans une situation hypothétique, les deux
principes de justice seraient adoptés par tous pour régir la
société. Ces quelques rappels n'ont pour but que de montrer
combien la pensée contractualiste est tributaire de fiction, de
récits, de représentations hypothétiques, comme dans l'expérience
de pensée pascalienne. Ces représentations prennent sens dans des
récits. Ainsi, alors que le mythe révolutionnaire donne aux
pouvoirs républicains, centralisés et unitaires, leur lieu et leur
efficacité, l'organisation multi-niveaux des pouvoirs n'a plus de
puissance symbolique fondatrice : elle manque de relais dans les
subjectivités, alors même qu'elle correspond à l'esprit de la
démocratie libérale définie comme régime de limitation et de
séparation des pouvoirs.
Problème politique ensuite, parce que les compétences — les
pouvoirs au sens de la théorie juridique — sont quelquefois
exclusives, mais souvent interdépendantes et partagées. Pouvoirs
multiples, séparés mais emboîtés : « le pouvoir politique » est
désormais une donnée agrégée — artificiellement homogène — de «
sous-pouvoirs » et « sur-pouvoirs » hétérogènes (pouvoirs
déconcentrés, décentralisés, transférés, directs ou indirects).
En conserver un concept agrégé ne permet pas d'en déterminer et
d'en analyser les modes d'exercice, les évolutions, les effets de
groupes. Nous pourrions même affirmer qu'aujourd'hui, à la
rigueur, « le pouvoir » est plus une notion qu'un concept
politique. Et nous ne pourrions dire mieux qu'Ulrich Beck
lorsqu'il écrit qu' « en réalité, [...] les anciennes catégories
du pouvoir et de la politique centrés autour de l’État deviennent
des catégories zombies »3. Mais tandis qu'il concentre son analyse3 Ulrich Beck, « Redéfinir le pouvoir à l’âge de la mondialisation : huit
3
sur « un méta-pouvoir économique », nous la fondons sur des
pouvoirs politiques, et des infra-pouvoirs comme des méta-
pouvoirs : bref, sur une analyse multi-niveaux du pouvoir.
1. Dissémination et appropriation politique des pouvoirs
P. Rosanvallon (2008) a décrit un mouvement historique de
concentration de la démocratie explicable par le suffrage direct.
Inversement, il décrit une « logique de dissémination, de
diffraction et de démultiplication » (p. 348), précisant que « la
représentation [...] prend dorénavant des formes qui se
diversifient et se superposent pour s'accomplir ».
Selon lui, le paradigme de la représentation politique a
évolué : il est passé de la « logique d'identification entre
gouvernants et gouvernés » à celle d'une « distance reconnue dans
sa nécessité fonctionnelle », opposant par là même deux
démocraties, une démocratie d'identification à un démocratie d'appropriation (p.
350).
Cette notion d'appropriation est la clef de voute de sa pensée,
puisque la « division effective des pouvoirs vers laquelle tendent
les démocraties contemporaines réside dans l'existence des formes
contre-démocratiques et des institutions de démocratie indirecte »
(p. 351).
C'est ici que mon chemin se sépare de l'analyse de P.
Rosanvallon. Si l'objectif reste partagé, à savoir celui d'une
appropriation sociale des institutions, la solution proposée par
P. Rosanvallon repose sur le passage de formes de démocraties
indirectes à des formes de démocraties directes, passage dont la
France possède un bon exemple dans la réforme récente du mode dethèses », Le Débat, n° 125, mai 2003, p. 75-84.
4
désignation des délégués des communes dans les EPCI à fiscalité
propre, auparavant au scrutin indirect, et désormais au scrutin
direct. Or nous avons des raisons de penser que ce paradigme
participatif constitue un présupposé politique ; nous
souhaiterions lui substituer un paradigme narratif ou historique.
Pourquoi substituer un paradigme narratif au paradigme
participatif ? P. Rosanvallon précise de manière programmatique et
heuristique : « les citoyens ne considéreront que [les
institutions de la démocratie] les expriment et qu'elle les
servent que si les preuves de leur utilité sont insérées de façon
compréhensible par tous dans une philosophie partagée de la
démocratie » (p. 352), ajoutant que c'est la condition « pour que
le pouvoir soit contraint de se faire de façon plus lisible et
plus explicite » (ibid.). Introduisant la propriété de lisibilité du
pouvoir et des manières de le faire, P. Rosanvallon introduit
l'idée d'un symbolisme.
Cette introduction de l'idée d'un symbolisme du pouvoir est
classique. Elle nous a amené à nous interroger sur les liens qui
pouvaient exister entre l'institution et le symbolique, et le
symbolique et l'imaginaire. Dans l'ouvrage L'institution imaginaire de la
société, C. Castoriadis précise que « la maîtrise du symbolisme des
institutions ne poserait donc pas de problèmes essentiellement
différents de ceux de la maîtrise du langage »4. Or, poursuit-il
« le symbolique est ce qu'utilise l'imaginaire « pour exister et
s'exprimer ». Les sociétés cherchent donc dans l'imaginaire, selon
lui, « le complément nécessaire à leur ordre, […] quelque chose
d'irréductible au fonctionnel […] qui confère à ses facteurs réels
4 Cornelius Castoriadis, L’Institution imaginaire de la société, Paris, France, Éditions duSeuil, 1975, 502 p., ici p. 176 et suiv.
5
telle importance et telle place dans l'univers que se constitue
cette société », par où l'auteur montre que la réduction de la
signification de l'institution au fonctionnel n'est « que
partiellement correcte » et procède d'une inversion causale :
c'est l'imaginaire qui donne sens au fonctionnel, non l'inverse.
Marcel Gauchet écrit tout aussi radicalement, dans un article
intitulé Les tâches de la philosophie politique, que « la constitution de la
politique, cela veut dire la formation d’un pouvoir appropriable par
la communauté politique, d’un pouvoir en lequel la collectivité
peut se projeter et se reconnaître, à l’opposé de la formule des
anciens pouvoirs qui se présentent et s’exhibent sous le signe du
dissemblable et de l’hétéronomie »5. Cette appropriation passe,
selon lui, non seulement par la participation des citoyens mais
aussi par l'individualisation du lien social et politique,
notamment à partir du caractère sans cesse constituant du pouvoir
démocratique — un pouvoir sans certitude, qui se pense sans cesse
lui-même.
Quelles sont conséquences de tout ceci pour notre propos ? Il
s'agissait pour moi d'introduire la « lisibilité » comme propriété
de mon objet, c'est désormais chose faite. Plusieurs risques se
dessinent si cette philosophie partagée, autre nom de la
lisibilité annoncée, est manquante : l'avénement d'une démocratie
impolitique, dépolitisée et antipolitique, composée de manière
hétéroclite, d'un rejet des politiques et du politique, rejet des
institutions, du suffrage et du dissensus.
2. La philosophie politique contemporaine et l'impératif
5 Marcel Gauchet, « Les tâches de la philosophie politique », Revue du MAUSS, no 19, mars 2002, p. 275-303.
6
d'appropriation sociale des pouvoirs : une prescription sans
traitement.
« Ce qui fait l'essence même de la démocratie [est]
l'appropriation sociale des pouvoirs »6. En ce sens, la suffrage a
été historiquement le mode d'appropriation de l'État par le
citoyen.Trois raisons fondent, selon P. Rosanvallon, un impératif
d'appropriation sociale : premièrement, l'appropriation des
pouvoirs par les citoyens favorise leur « valorisation d'eux-
mêmes », deuxièmement elle conditionne « l'efficacité de l'action
publique » et troisièmement « détermine la façon dont [les
citoyens] appréhendent la qualité démocratique du pays ».
La question qui nous guide désormais est donc : comment
concevoir cette philosophie partagée de la démocratie, comment
favoriser cette lisibilité et cette appropriation sociale ?
Nous le voyons, la première condition est de produire cette
philosophie partagée. Or elle n'existe pas, à notre connaissance ;
et nous pouvons même constater que la philosophie politique
contemporaine se développe en grande partie sur d'autres objets,
et dans d'autres directions. Quels sont ces objets ? Il est
difficile de dresser un panorama aussi complet que synthétique, et
surtout, nous prendrions le risque, en l'entreprenant, de sortir
du cadre fixé par l'objet de cette rencontre. Mais la philosophie
politique française se caractérise plus par d'autres débats, comme
le souligne C. Larmore7 :
un débat général sur la rationalité politique, et donc sur la6 Pierre Rosanvallon, La légitimité démocratique: impartialité, réflexivité, proximité, Paris,
France, Éd. du Seuil, 2008, 367 p., (« Les Livres du nouveau monde, ISSN 1954-0558 »), p. 21.
7 Alain Renaut, Patrick Savidan et Pierre-Henri Tavoillot, Histoire de la philosophiepolitique, tome 5 : Les Philosophies politiques contemporaines, Calmann-Lévy, 1999, 500 p.,p. 97-124.
7
question de savoir s'il existe des connaissances morales ou
des vérités pratiques ;
un débat sur le concept d'autonomie du sujet comme fondement de
l'humanisme moderne, où s'affrontent néokantiens et
wittgensteiniens, en ce que les premiers fondent l'autonomie
sur la liberté et les seconds sur les règles, débat dont une
des issues possible est la dissociation radicale du droit et
de la morale, notamment dans le positivisme juridique
kelsenien, et qui s'articule au retour à des théories du
droit naturel comme instance critique du droit ;
un débat sur l'universalisme, qu'il soit considéré à partir de
la question morale ou de celle des droits, et sa fondation
sur l'idée d'un droit naturel, impliquant le recours à des
concepts métaphysiques et à l'hétéronomie du sujet ;
le dernier débat porte selon lui sur la question de savoir si
nos raisonnements politiques et moraux sont pensables ex nihilo,
à partir des lois de la raison ou toujours historiquement
enracinés, débat à l'intérieur duquel il situe les
discussions autour de la théorie rawlsienne de la justice,
dans la mesure où se pose la question de savoir si nos
principes de justice possèdent une justification purement
rationnelle et procédurale ou si ces procédures sont déjà
elle-mêmes prises dans une tradition et un langage moral
déterminé.
Néanmoins, et si nous tenons à l'écart l'ensemble de la
production d'histoire de la philosophie, force est de constater
que la philosophie politique qui reste à notre disposition est fort
peu appliquée à l'analyse multi-niveaux des pouvoirs. Si nous
8
recherchons du côté de la philosophie politique une pensée des
formes politiques récentes que sont les concepts de
supranationalité (qu'il soit sui generis avec l'Union Européenne ou
plus classique avec le droit international public), de
décentralisation ou de déconcentration territoriales, nous
constatons que la production sur ces sujets est limitée. À
l'exception, et ce n'en est pas une petite, de J. Habermas et J.-
M. Ferry (nous y reviendrons), lesquels ont pleinement intégré la
supranationalité à leur réflexion théorique, un petit nombre de
chapitres d'ouvrages de philosophie politique se consacrent à
penser le fait que l'État-Nation n'est plus l'unique cadre de
notre pensée des formes politiques8. Pour les auteurs de ces
chapitres, ces nouvelles formes politiques constituent plus des
limites au-delà desquelles leurs réflexions ne peuvent s'étendre, que
des bornes définies comme repères pour quantifier positivement la
validité de leurs énoncés.
Ainsi S. Mesure et A. Renaut précisent que « le contexte de
toute cette interrogation » sur l'identité démocratique est,
« pour les sociétés dites continentales, celui de la construction
européenne »9. P. Manent, quant à lui, ne fait que dessiner un
choix : « si vous pensez avec Dante qu'il y a une société générale
du genre humain, que celui-ci est virtuellement en ordre dans son
tout, vous serez favorable à la construction européenne actuelle,
y compris avec le caractère d'extension indéfinie qui la signale.
Si vous pensez avec Rousseau qu'une telle société générale, qu'un
tel ordre, n'existe pas, vous serez comme lui partisan de la
8 Sylvie Mesure et Alain Renaut, Alter ego: les paradoxes de l’identité démocratique, Paris,France, Flammarion, 2001, p. 297-298 et Pierre Manent, Cours familier de philosophiepolitique, Paris, France, Gallimard, impr. 2004, 2004, p. 71-84.
9 Sylvie Mesure et Alain Renaut, op. cit., p. 297.
9
nation, c'est-à-dire d'un ordre politique qui avoue sa
particularité »10.
Dans son article intitulé Les tâches de la philosophie politique,
précédemment cité, Marcel Gauchet n'évoque pas ces formes
nouvelles de souveraineté, ni les tensions qui s'exercent sur la
notion même de souveraineté. Si donc la supranationalité constitue
pour certains un fait nouveau et générateur, notamment mais pas
exclusivement à l'aune de la construction d'une Union Européenne,
elle est loin de s'imposer comme question centrale de la
philosophie politique, ni dans son processus de développement, ni
dans ses conséquences pour notre pensée politique. Pire encore est
la situation, il faut en convenir, pour les processus de
décentralisation et de déconcentration des pouvoirs en France,
soit que les philosophes politiques laissent sous silence le fait
que ces processus politiques ne possèdent pas d'intérêt pour leur
réflexion théorique, soit qu'ils n'en discernent pas.
Ce silence relatif est d'autant plus incompréhensible que la
philosophie politique française a connu l'influence de M.Foucault.
En 1976, dans son cours prononcé au collège de France11, Michel
Foucault dégageait définitivement le concept de pouvoir du cadre
au sein duquel il était habituellement pensé : le cadre juridico-
institutionnel et celui de l'État-Nation. À la suite d'Althusser12,
pouvoir et histoire n'étaient plus attribuables à un ou des
sujets. Il créait les concepts désormais fameux de « micro-
pouvoirs » (1976), de « biopolitique » (1978) et les « jeux de
10 Pierre Manent, op. cit., p. 84.11 Michel Foucault, Il faut défendre la société: cours au Collège de France, 1975-1976, éds. Mauro
Bertiani et Association pour le Centre Michel Foucault, Paris, Seuil, 1997,283 p., (« Hautes études »).
12 Louis Althusser, Positions, Paris, France, Éditions sociales, 1982, 185 p..
10
pouvoir » (1978), objet d'une philosophie analytique de la
politique qu'il n'a fait qu'ébaucher. De manière programmatique,
prenant modèle sur ce que la philosophie analytique fait avec
« l'usage quotidien que l'on fait de la langue », il invente par
analogie une « philosophie analytico-politique » qui ferait de
même avec le quotidien des relations de pouvoir : qui « se donne
pour tâche d'analyser, d'élucider, de rendre visible, et donc
d'intensifier les luttes qui se déroulent autour du pouvoir, les
stratégies des adversaires à l'intérieur des rapports de pouvoir,
les tactiques utilisés, les foyers de résistance, à condition en
somme que la philosophie cesse de poser la question du pouvoir en
terme de bien ou de mal, mais en terme d'existence […] simplement,
essayer d'alléger la question du pouvoir de toutes les surcharges
morales et juridiques dont on l'a affecté et poser cette question
naïve [...] : les relations de pouvoir, en quoi cela consiste-t-
il ? »13. Il développait donc une conception stratégique et diffuse
du pouvoir, au moment où en France, le législateur procédait
parallèlement à deux types de transfert de souveraineté : au
niveau supranational et au niveau territorial. Coïncidence ? En
moins de vingt ans, l'organisation et la pensée politique seront
bouleversées : les lois de décentralisation de 1982, l'acte unique
de 1986, prolongeront cette transformation et la sédimenteront.
La question des relations de pouvoir posée par M. Foucault est
cependant aiguë. Cette nouvelle coexistence de strates nationale,
supranationale et territoriale induit des stratégies, comme le
signifie le concept même de compétence (du latin petere, qui
signifie rechercher). Les relations entre les pouvoirs sont
13 Michel Foucault, Dits et écrits, 1954-1988, II: 1976-1988, Paris, Gallimard, 2001, 1735 p., (« Quarto »), p. 540.
11
essentiellement des compétitions de compétence, compétition que le
droit administratif a la responsabilité d'encadrer. Mais
l'encadrement par le droit administratif reste un encadrement lié
à un processus d'action en litige. Or, en amont des litiges, on
trouve d'autres critères susceptibles de constituer des raisons
politiques : l'efficacité de l'action publique, l'opportunité
politique, mais aussi et surtout l'opinion publique.
Ainsi, du refus de transfert de compétence de communes à des
intercommunalités alors même que ces compétences ne sont pas
exercées par ces communes ; ainsi, du principe de subsidiarité en
droit de l'union, véritable contre-pouvoir régional du pouvoir
supranational, mais qui prend la forme d'un pouvoir d'empêchement
de l'action ; ainsi, des stratégies de mutualisations locales ou
continentale des pouvoirs avec effets de groupes politiques14. La
démultiplication des niveaux génèrent des concepts politiques
nouveaux, comme celui de « chef de file », et tendent à créer de
nouveaux types d'unités politiques, échappant à au processus
classique de la formation de la volonté politique.
Un examen analytique des relations de pouvoirs serait
instructif, mais il dépasse, tant par sa méthode que par son
contenu, l'objectif de notre démarche d'aujourd'hui. Il
permettrait en effet d'éclairer plus précisément ce que nous
nommons, par suffisance intellectuelle, efficacité de l'action
publique ou fonctionnement des pouvoirs publics. Bornons-nous
toutefois à constater que ces relations de pouvoirs entre les14 Nous renvoyons sur ce point, par exemple, à la carte de l'intercommunalité en
région PACA en France et plus spécifiquement à l'intercommunalité deMarseille et Aix-en-Provence ; de la même manière au niveau de l'UnionEuropéenne, nous renvoyons à la structure d'opportunité qu'incarnel'intergouvernementalité (le Conseil) face à la méthode communautaire (laCommission).
12
pouvoirs constituent un angle mort de la philosophie politique
contemporaine.
3. Des tentatives de redistribution effective de la pensée des
pouvoirs politiques : J.-M. Ferry et J. Habermas.
Dans notre perspective, la compréhension des phénomènes de
normativité politiques et juridiques contemporains, autre nom de
la répartition des pouvoirs ou des compétences, procède d'une
déconstruction et d'une redistribution du concept de pouvoirs,
déconstruction et redistribution qui ne sont pas appropriées par
les citoyens.
Bien sûr, évoluant dans le champ de la philosophie politique,
nous n'avons pas d'études quantitative ou empirique pour étayer
cette affirmation. Elle est donc largement prospective et
heuristique, et elle est soumise aux résultats obtenus par
d'autres disciplines comme les sciences politiques ou la
sociologie politique. Comment néanmoins décrire cette
déconstruction et cette redistribution nécessaires ?
Cette déconstruction et cette redistribution passent d'abord
par la pluralisation des pouvoirs. Le cadre traditionnel de la
pensée politique, spécialement sur le concept central qu'est le
concept du pouvoir, est l'État-Nation : il n'y a qu'à se référer
sur ce point à l'ouvrage de Bertrand de Jouvenel, Du pouvoir : histoire
naturelle de sa croissance, datant de 1945. L'obsolescence dont celui-ci
est victime est criante, en ce qu'il ne considère que l'État-
Nation comme personne morale exerçant le pouvoir politique.
L'analyse de l'évolution des formes de légitimité menée par P.
Rosanvallon dans La légitimité démocratique est ici transposée à celle de
13
l'évolution des formes de normativité politique (ou phénomènes de
puissance, d'obéissance ou de coercition caractérisant les pouvoirs publics).
À l'instar de cet auteur, nous estimons qu'il faut d'abandonner
une conception moniste et substantialiste des faits politiques,
laquelle se caractérise par la mobilisation de concept tels que le
ou la politique, le pouvoir. Cela implique ensuite de complexifier
les approches méthodologiques, et donc nos descriptions des faits
politiques comme nos enquêtes philosophiques. Certains auteurs
participent déjà pleinement de cette redistribution et de cette
complexification de nos descriptions, tels J. Habermas ou J.-M.
Ferry.
A/ Le fait postnational selon J. Habermas :
J. Habermas écrit qu'« il s'agit essentiellement de savoir s'il
est possible de faire surgir la conscience qu'une solidarité
cosmopolitique est nécessaire dans les sociétés civiles et les
espaces publics politiques des régimes qui commencent à s'unir à
grande échelle. Car ce n'est que sous la pression d'un tel
changement dans la conscience des citoyens, rendu effectif au
niveau de la politique intérieure, qu'il sera possible de changer
l'idée qu'ont d'eux-mêmes les acteurs capables d'agir à l'échelle
de la planète »15. Cet appel à la « conscience » nécessaire est un
appel à l'appropriation sociale et à la lisibilité des processus
supranationaux.
Chez Habermas, cette appropriation sociale passe moins par le
concept de participation16 que par celui de communication, comme
15 Jürgen Habermas, Après l’État-nation: une nouvelle constellation politique. Paris, Fayard,2000, chapitre IV « Au-delà de l’État Nation ? »
16 Jürgen Habermas, Raison et légitimité: problèmes de légitimation dans le capitalisme avancé,trad. Jean Lacoste, Paris, France, Payot, 2012, 248 p.
14
méthode de genèse normative et processus de formation de la
volonté. Plus exactement, il s'agit selon lui de combiner une
rationalité de type communicationnelle, de type incrémentale et
participative, avec une rationalité fonctionnaliste,
technocratique et stratégique, inspirée de la théorie des systèmes
de Luhman, globale et sans participation17. Nous renvoyons sur ce
point, pour un approfondissement, à Raison et légitimité et à son
chapitre III, « Sur la logique des problèmes de légitimation ».
Pour J. Habermas, le choix d'un type de rationalité est décisif,
en ce qu'il ne saurait être question de sacrifier les composantes
de la « dignité humaine » à cette rationalité fonctionnelle et
systémique, caractérisée par des « prétentions à la puissance […]
et au monopole [qui ne seraient pas] mesurées, comme dans le
Léviathan, aux critères de la rationalité pratique »18.
Dans l'ouvrage intitulé Après l'État-Nation, et principalement dans
son chapitre « La constellation postnationale et l'avenir de la
démocratie », J. Habermas propose cette analyse de la structure de
l'État-Nation : « l'État moderne est né en tant qu'État
administratif et fiscal, et en tant qu'État territorial souverain,
et il a pu se développer dans le cadre de l'État-Nation pour
prendre la forme d'un État de droit démocratique et d'un État
social »19. Le mérite de cette analyse consiste à poser
objectivement et explicitement la question de savoir si les défis
postnationaux, comme J. Habermas les nomme lui-même, entament la
« capacité d'une société nationale à assurer son autorégulation
démocratique ». Si, en effet, il résulte de l'analyse des formes
politiques postnationales qu'elles améliorent « la sécurité17 Ibidem, p. 216.18 Ibidem, p. 220.19 Jürgen Habermas, op. cit., sect. 2, II.
15
juridique et l'efficacité de l'État administratif, la souveraineté
de l'État territorial, l'identité collective et la légitimité
démocratique de l'État-Nation », il ne ferait aucun doute que ces
formes nouvelles seraient jugées politiquement utiles.
Plus encore, J. Habermas procède à une déconnexion des concepts
de démocratie et de nation : c'est la condition même de la thèse
du « patriotisme constitutionnel ». Il explique ainsi que « c'est
une erreur de penser que l'ordre démocratique requiert par nature
un ancrage mental dans la Nation entendue comme communauté
prépolitique fondée sur un destin partagé »20. Il reconnaît donc
que cette redistribution et cette complexification de notre
concept des pouvoirs politiques est possible en restant à
l'intérieur d'un régime de type démocratique et représentatif.
Il conclut que « nous ne serons à même de répondre
rationnellement aux défis de la mondialisation que si nous
réussissons à développer dans la constellation postnationale un
certain nombre de formes nouvelles d'autorégulation démocratique
de la société »21, sans préciser l'échelle de la société dont il
parle, ni déterminer ces « formes nouvelles ». De même lorsqu'il
évoque les positions partisanes europhiles et eurosceptiques, J.
Habermas appelle à un projet « image de l'Europe future qui
éveille l'imagination et suscite, dans les différentes arènes
nationales, un débat public autour d'un thème commun ». Cette
image, renvoyant le lecteur à la relation de l'institution avec
l'imaginaire, demeure manquante.
B/ « La médiation d'une culture politique partagée est
20 Jürgen Habermas, op. cit., sect. 2, II, d.21 Jürgen Habermas, op. cit.
16
stratégiquement centrale » (J.-M. Ferry)
C'est sans aucun doute J.-M. Ferry qui développe de la manière
la plus centrale les tensions qui s'exercent sur le concept
d'État-Nation, parce qu'il articule nationalité, supranationalité
et infranationalité. Celui-ci n'hésite pas à proposer « un
continuum participatif à tous les niveaux : local, régional,
national, et métanational de délibération démocratique et de
décision politique dans l’Union européenne »22, seule « ressource
rationnelle qui permet de former chez les individus le sentiment
d’appartenance indispensable à une intégration politique
réussie », mais soumise à l'invention « de mécanismes et de
procédures adaptés à une réalité postnationale »23. J.-M. Ferry
postule comme P. Rosanvallon que le processus normatif de
formation des volontés doit emprunter la voie d'un paradigme de la
participation, mais ne l'y réduit pas.
Dans l'article intitulé Du politique au-delà des Nations24, J.-M. Ferry
traite la question de l'appropriation citoyenne des nouvelles
formes politiques en contexte postnational de manière centrale. Il
écrit ainsi que « l’identité postnationale signifie que : a) le
citoyen ne voit plus dans la nation la référence et l’appartenance
politiques ultimes ; b) sans nier les solidarités locales,
régionales, nationales, les motifs suprêmes d’adhésion à une
communauté politique ne sont plus ceux de la parenté, de la
proximité, de la filiation, ni même les motifs de la nationalité
selon Renan, mais l’adhésion à des principes universalistes tels
22 Jean-Marc Ferry, « Dix thèses sur « la question de l’État européen » », Droit etsociété, vol. n°53 / 1, mars 2003, p. 13-26.
23 Ibidem.24 Jean-Marc Ferry, « Du politique au-delà des nations », Politique européenne, n°
19, juin 2006, p. 5-20.
17
qu’ils s’expriment dans les droits de l’homme, l’État
constitutionnel, la démocratie »25. Ainsi, J.-M. Ferry souligne que
« c’est la médiation d’une culture politique partagée, qui est
stratégiquement centrale. Elle ne peut résulter que d’une pratique
où les identités nationales s’ouvrent les unes aux autres dans une
communication impliquant un décentrement des intérêts, des
mentalités et des mémoires elles-mêmes au sein d’un espace public
politiquement orienté et capable d’intégrer une participation des
citoyens ». Or ce point « stratégiquement central » ne fait
l'objet d'aucun projet politique à sa mesure, quel qu'il soit et à
notre connaissance. Las d'entendre répétée ad nauseam la formule
selon laquelle la postmodernité s'inscrit dans le contexte de la
fin des grands récits, J.-M. Ferry dessine l'« utopie réaliste »
d'un patriotisme constitutionnel dans le cadre d'un cosmopolitisme
républicain, lequel patriotisme se distingue tant du patriotisme
géographique, que du patriotisme culturel et du patriotisme
juridique.
Plus encore, lorsqu'il s'agit de les distinguer entre eux, J.-
M. Ferry affirme que « si l’on demandait alors – questions
didactiques – en quoi exactement le patriotisme constitutionnel se
distingue-t-il d’un patriotisme juridique, la réponse serait : en
ce qu’il s’articule dans un rapport intime à l’histoire ; et si l’on
demandait en quoi, dans ce cas, il se distingue d’un patriotisme
historique, la réponse serait : en ce qu’il s’articule dans un
rapport autocritique à l’histoire propre »26. En distinguant le
patriotisme constitutionnel des autres patriotismes par les
25 Ibidem, p. 11.26 Jean-Marc Ferry, « Avatars du sentiment national en Europe à la lumière du
rapport à la culture et à l’histoire », in « Les identités culturelles », Paris, PUF,2000, (« Comprendre », 1).
18
concepts d'« histoire » et de « rapport autocritique à l'histoire
propre », J.-M. Ferry propose une pensée historique des pouvoirs
politiques et un mode d’appropriation social, collectif et
imaginaire, des institutions politiques.
4. Conclusion
Cette pensée historique, produite par les pensées et les
décisions de législateurs différents tant selon leur nationalité
que selon leur génération, n'est en aucun cas une pensée
superflue, mais la saisie par un même regard, et relativement aux
nombreux enjeux que nous venons d'énumérer, de la topologie
politique qui forme le fond de carte de toutes nos considérations,
et plus exactement, la forme même de notre espace politique,
laquelle conditionne les règles que nous pouvons ou non lui
appliquer, tant individuellement et collectivement.
C. Castoriadis précisait que « l'histoire est toujours
l'histoire pour nous, ce qui ne veut pas dire que nous avons le
droit de l'estropier comme il nous chante, ni de la soumettre
naïvement à nos projections, puisque précisément ce qui nous
intéresse dans l'histoire c'est notre altérité authentique, les
autres possibles de l'homme dans leur singularité absolue »27. Le
risque de ce défaut d'histoire politique est, au-delà du défaut
d'appropriation sociale du politique, que cette lacune historique
ne fasse disparaître notre « altérité authentique », comme il
l'appelle. Et cela ne porterait pas en soi à conséquence, si cela
ne nous exposait au risque de devenir politiquement anhistorique
ou humainement égocentrique. Ce qui revient, sous quelques
aspects, au même.27 Cornelius Castoriadis, op. cit., p. 229.
19
Références bibliographiques :
1. BECK, Ulrich, « Redéfinir le pouvoir à l’âge de la
mondialisation : huit thèses », Le Débat, n° 125, mai 2003,
p. 75-84.
2. CASTORIADIS, Cornelius, L’Institution imaginaire de la société, Paris,
France, Éditions du Seuil, 1975, 502 p., (« Les Collections
Esprit. La Cité prochaine »).
3. FERRY, Jean-Marc, « « Avatars du sentiment national en Europe
à la lumière du rapport à la culture et à l’histoire » »,
in « Les identités culturelles », Paris, PUF, 2000, (« Comprendre »,
n°1).
4. FERRY, Jean-Marc, « Dix thèses sur « la question de l’État
européen » », Droit et société, vol. n°53 / 1, mars 2003,
p. 13-26.
5. FERRY, Jean-Marc, « Du politique au-delà des nations »,
Politique européenne, n° 19, juin 2006, p. 5-20.
6. FERRY, Jean-Marc, Europe, la voie kantienne: essai sur l’identité
postnationale, Paris, France, les Éditions du Cerf, 2006,
215 p., (« Humanités (Paris. 1994) »).
7. FERRY, Jean-Marc, « Face à la question européenne, quelle
intégration postnationale ? », Critique internationale, no 23, juin
2004, p. 81-96.
8. FERRY, Jean-Marc, La question de l’État européen, Paris, Gallimard,
2000.
9. GAUCHET, Marcel, « Les tâches de la philosophie politique »,
Revue du MAUSS, no 19, mars 2002, p. 275-303.
10. HABERMAS, Jürgen, Après l’État-nation: une nouvelle constellation
20
politique, [Paris], Fayard, 2000.
11. MANENT, Pierre, Cours familier de philosophie politique, Paris,
France, Gallimard, impr. 2004, 2004, 346 p., (« Collection
Tel », 332).
12. MESURE, Sylvie et RENAUT, Alain, Alter ego: les paradoxes de
l’identité démocratique, Paris, France, Flammarion, 2001, 304 p.,
(coll. « Champs », 497).
13. RENAUT, Alain, Les philosophies politiques contemporaines (depuis 1945),
Paris, Calmann-Lévy, 2001.
14. ROSANVALLON, Pierre, La légitimité démocratique: impartialité, réflexivité,
proximité, Paris, France, Éd. du Seuil, 2008, 367 p., (« Les
Livres du nouveau monde »).
15. ROUSSEAU, Jean-Jacques, Du contrat social, éd. Robert Derathé,
Paris, France, Gallimard, 1993, 535 p., (« Folio. Essais »,
233).
21