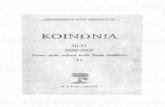Niveaux de grammaticité: de la fonction primaire à l'autonomie grammaticale
-
Upload
uni-freiburg -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Niveaux de grammaticité: de la fonction primaire à l'autonomie grammaticale
. Niveaux de grammaticite : de la fonction primaire a l' autonomie grammaticale
o. Introduction 1
. 11 est communement admis que le processus de grammaticalisation repose sur deux. formes d'evolution differentes: d'un cöte le rerriplacement d'une forme grammaticale par une autre, consideree comme moins grammaticale et plus informatrice, au moins au debut; de l'autre l'evolution formelle et fonctionnelle continue de certaines formes, allant d'un etat plus syntagmatique (et a la fois plus Iexical) a un etat plus grammatical..Tandis que le premier des deux processus paratt abrupt quand on Ie considere au niveau du systeme abstrait et ne montre de continuite qu'au niveau de la parole2
, Ie second processu.s est de caractere continu a priori. Le modele, deja classique, de ce dernier a ete etabli par Christian Lehmann (1985, 1982/1995 ; cf. aussi Reine et aL 1991, Hagege 1993). Ce processus, a son tour, comporte deux aspects : un cöte materiel, qui met en jeu la forme, et un cöte fonctionnel ou semantique. Il a deja coule beaucoup d'encre sur la question de savoir en quoi consiste exactement Ie changement fonctionnel .. qu 'une forme determinee subit au coUrs de sa grammaticalisation3
• On a essaye de trouver des formules pour caracteriser l' evol ution fonctionnelle subie par des formes en voie de grammaticalisation, la plus. connue etant celle de T. Giv6n ('de la
1 Je remercie Monique Krötsch de la revision de cet article et de ses observations. 2 Evidemment, le processus de remplacement d'une forme par une autre est une
evolution graduelle dans le comportement linguistique d'une communaute. 3 Au fond, ce probleme revient a Ja question de savoir en quoi consiste·"'Je
grammatical', question chargee d'un eminent d'interet theorique, si on ne se contente pas de la celebre explication formelle de Martinet, definissant le caractere grammatical d'un morpheme par sa position dans un paradigme limite. I1 faut avertir que la reponse que je vais donner acette question est en large mesure inspiree des idees que T. Giv6n a emis sur cette question des 1979, et qu'il a resumes dans Giv6n 1995. .
60 Daniel JACOB
pragmatique a la grammaire')4. Certains voient un mouvement qui va de Ia « pragmatique» a la semantique propositionnelle. Et on ameme propose d'y voir la tendanee inverse, dans laquelle le « pragmatique >~ ne eonstitue pas le point de depart mais le but de I' evolution (Traugott passim).
Le present" artide a pour but de faire une mise au point sur les differents niveaux fonetionnels qui entrent en jeu au eours d'un proeessus de grammatiealisation, eonstituailt en meme temps les differentes phases de ee proeessus. Par rapport a la majorite des travaux existants, qui posent eette question a partir des formes ou des morphemes qui subissent le proeessus en question, on va opter pour une vue a Ia fois plus globale (qui eonsidere plutöt des systemes que des formes) et plus abstraite (qui, a eöte de eertains morphemes ou syntagmes, se reportera aussi ades eategories abstraites ou meme ades inventaires de regles). Pour illustrer mon raisonnement, je me baserai sur plusieurs faits de diachronie grammaticale bien connus dans 1 'histoire du fran~ais et des langues romanes, voire d'autres langues (non romanes), mettant au centre la categorie du genre grammatical et Ie systeme de marquage actanciel.
1. Perspective et objet d'etude dans une theorie de grammaticalisation
Comme je viens de le dire, la plupart des travaux sur la nature de la grammaticalisation se situent dans la perspective de A. Meillet, qui definissait la grammaticalisation comme « le passage d'un mot autonome au röle d'element grammatical » (1912/1948 : 131). Cela veut dire ·que le processus de grammaticalisation est considere a partir des formes, c' est-a-dire de certains morphemes ou syntagmes qui subissent un ehangement formel et fonctionnel. A mon avis, il faudrait elargir eette perspective en admettant explieitement, comme entites soumises a la grammaticalisation, des objets linguistiques plus abstraits.
D'abord, il faut preciser que tres souvent, dans la theorie de la grammaticalisation, quand on parle de I'evolution d'une fOrrrle, on se reIere plutöt aux paradigmes qu'aux morphemes singuliers, et qu'on s'interesse particulierement a des morphemes ou des mots pouvant etre regroupes en paradigmes. S 'il est vrai que, selon la these de A. Martinet et de Ch. Lehmann (1985, 1995), l'appartenance a un paradigme restreint est en elle-meme un eritere de grammaticite, il faut dire qu'un paradigme a son tour peut etre J?1esure en termes de grammaticite plus ou moins avancee : il en est ainsi pour lescelebres verbes praeterito-praesentia des langues germaniques qui, a partir d'un paradigme de definition plutat lexicale
4 «While pragmatics gives rise to syntax, syntax in turn gives rise to grammatical morphology ... », 1979: 232, cf. aussi Giv6n 1976).
Niveaux de grammaticite : de lafonction primaire ... 61·
(verbes de pereeption avee eertaines partieularites morpho-semantiques, cf. Jaeob 1998 :115) en sont venus a former les inventaires d'auxiliaires modaux dans les langues germaniques aetuelles. Et si - pour prendre un autre exemple -le paradigme des pronoms personneis avait deja bien aquis un earaetere' grammatical en latin, on eonsidere de fa~on unanime l' evolution ulterieure de ees pronoms vers un paradigme d' elements elitiques (voire meme en paradigme d'affixes personneis) en fran~ais modeme eomme un processus de grammatiealisation. On peut done eonstater qu'un paradigme en tant que tel peut etre soumis a un proeessus de grammatiealisation, passant d'un etat moins grammatieal a un etat plus grammatiealise. L' exemple des pronoms personnels monke d' ailleurs qu'un autre eritere souvent invoque pour prouver le earaetere grammatieal d'une forme, a savoir lafrequence ou la presence obligatoire, se reIere le
. plus souvent ades paradigmes, rarement ades formes singulieres. Si la transitio du morpheme au paradigme n' est qu'une question
d'abstraction et de perspective (dire qu'un paradigme « se grammaticalise » revient a dire que les morphemes de ce paradigme se grammatiealisent), il y a d' autres «objets» linguistiques suseeptibles de grammatiealisation dont le earactere abstrait ne peut pas se reduire a une question de perspeetive : Ainsi, on connait le. changement fonetionnel que l' ordre lineaire des mots (ou mieux : des constituants de la phrase) a subi du latin au fran~ais : tandis qu'en latin, l'ordre des mots obeissait aux exigences de la strueture d'information, en fran~ais moderne il est regi par (ou mieux : il sert a marquer) la fonction syntaxique du syntagme en question. Ce developpement correspond exactement a l' evolution deerite par T. Givon sous la formule citee plus haut. On pourrait done dire que l' ordre des mots a subi un proeessus de grammaticalisation. Mis apart la position lineaire,
.on pourrait imaginer que d'autres proprietes de morphemes sont soumises a la grammatiealisation, que par exemple l' accord entre deux morphemes peut etre plus ou moins grarnmaticalise. Ainsi; on dira que la marque du genre (independemment de la forme d' expression que cette rnarque Jevet) est plus sernantique, moins grammatiealisee en anglais que dans la plupart des autres langues SAE. C'est-a-dire que parmi les objets soumis a la grammaticalisation, il faut aussi compter des proprietes abstraites de certaines formes, ou, plus generalement, des categories qui peuvent, a partir de classes semantiques (comme 1'animation, le sexe d'un individu, la structure et reference temporelle d'un processus) se transformer en classes grammaticales et meme aboutir ades classes purement formelles (comme le genre grarnmatical, les temps ou les modes verbaux ou meme des classes de flexion tout a fait abstraitesi,. .
5 Meme si on dira que ce sont, au fond, les morphemes realisant la categorie qui se grammaticalisent, les exemples montrent qu' on a interet a pouvoir parler de la
62 Daniel JACOB
Si on accepte de considerer le caractere plus semantique ou plus formel de certaines categories abstraites comme un degre de grammaticite plus ou moins avance, il faut egalement considerer les regles qui regissent l'usage de certaines formes comme plus ou moins grammaticales. Ainsi, on pourrait dire que I 'usage du subjonctif apres certains verbes ou dans certaines constellations syntaxfques en fran\=ais moderne, ou encore la concordance des temps sont des traits de desemantisation des regles correspondantes. On pourrait aussi considerer les regles plus fixes pour la position de 1 'adjectif qualificatif en fran\=ais (par rapport au latin ou aux autres langues romanes) comme uri cas de grammaticalisatiori. On reviendra plus tard sur ces exemples.
Tout ce qui a ete dit revient a postuler des objets plus abstraits, moins materiels comme objets du processus de grammaticalisation, a cöte des morphemes ou syntagmes concrets. En meme temps, cela rend necessaire une perspective plus globale: pour coristater la grammaticalisation de l'ordre des mots, d'une categorie grammaticale, ou d'une regle, il ne suffit pas de retracer l'evolution diachronique du comportement d'un morpheme ou d'un syntagme precis. Il faut plutöt partir de certains« sous-systemes» (comme le systeme des cas ou l'usage des formes 'verbales) ou meme de certains domaines fonctionnels (tels le marquage des relationsactantielles ou temporelles), de sorte que le processus de 'grammaticalisation' lui-meme n'est plus per\=u comme l'evolution du statut linguistique de certaines formes, mais plutöt comme le changement du mode d'organisation et de , fonctionnement de certains domaines fonctionnels a I 'interieur d'une langue. Une perspective plus globale s'impose d'ailleurs pour pouvoir cerner un autre probleme qui, a mon avis, n'a pas encore re\=u toute l'attention qui lui est due : la co-existence de formes differentes ou de solutions linguistiques differentes pout certains problemes communicatifs. Je ne parle pas des divergences typologiques entre des langues qui, au cours de l'evolution, optent pour des strategies differentes danscertains
grammaticalisation des categories abstraites. On peut meme soup90nner que ceci correspond mieux a l'intuitiori, c'est-a-dire a la verite psychologique et cognitive des sujets parlants. Un tel realisme vis-a-vis des categories abstraites est d'ailleurs requispour expliquer pourquoi des moyens d'expression de nature differente mais appartenant a la meme categorie grammaticale (p. ex. la position post-verbale et les morphemes d'accusatif en fran9ais) peuvent suivre une evolution fonctionnelle parallele (la categorie grammaticale etant le seul lien entre les differentes formes). Ainsi, dans des cas de syncretisme grammatical (p. ex. les syncretismes datif/genitif ou datif/ablatif apparaissant au cours de la diachronie indeuropeenne, ou encore la confusion des cas en latin vulgaire), on a interet a distinguer les situations qui sont basees sur unehomonymie materielle des formes, des situations basees sur Ia confusion notionnelle des categories correspondantes (meme si la confusion des notions peut etre declenchee par une homonymie). Pour pouvoir maintenir cette distinction, il faut supposer I' existence reelle de categories grammaticales abstraites. ' ,
Niveaux de grammaticite : de lafonction primaire ... 63
domaines fonctionnels (p. ex. les options divergentes prises par l' espagnol et le fran~ais pour remplacer le passif synthetique du latin) ou qui donnent des fonctions differentes a une forme etymologiquement identique (p. ex. l'usage divergent que les langues romanes font du passe compose). Je parle de la coexistence de strategies differentes au sein d'un domaine fonctionnel ou d'un sous-systeme d'une meme langue ou variete de langue. Ainsi, les travaux de Werner (1988 et passim) et de Ronneberger-Sibold (1988) montrent que dans des paradigmes comme la conjugaison verbale des langues SAE, la coexistence d'un systeme flexionnel regulier avec des formes irregulieres (suppletives ou araeine modifiee) d'un cöte, et avec des temps composes (donc des formes periphrastiques) de 1'autre, lein d'etre le caprice d'une evolution aleatoire ou un simple decalage anachronique (<< layering» dans le sens de Hopper 1991, «anachronisme» pour Hagege 1993), suit des principes generaux d'ordre synchronique, c'est-a-dire qu'elle tend a satisfaire les exigences d'une organisation grammaticale optimisee. Tels principes d' organisation meritent d' etre pris en consideration dans l'etude de 1'evolution grammaticale d'une langue6
, ce qui n' est possible que dans une perspective qui se centre sur l' evolution de systemes (partiels) plutöt que sur l'evolution de certaines formes7
•
A cöte de cette forme de coexistence, ou differentes formes ou strategies d' expression se relaient a l'interieur d'un sous-systeme grammatical, il y a la coexistence concurrentielle de formes ou de strategies alternatives pour realiser une fonction communicative: il est evident que le remplacement d'une forme par une autre au cours de la grammaticalisation passe par une periode de copresence simultanee, parfois ' bien longue, comme le montre la copresence plus que bi-millenaire du passe compose et du passe simple, de Plaute jusqu' aux langues romanes
6 V. § 5 l'exemple du marquage actanciel en fran~ais. Bien sur, il ne faut pas retomber dans l'ancienne perspective idealisatrice du structuralisme qui voulait tout expliquer a partir d'un systeme coherent et global, ignorant l'aspect historique de la langue qui ressemble parfois a un champ de fouilles archeologiques avec des couches chronologiques qui s' entremelent, des structures ou des formes appartenant ades epoques ou ades phases de developpement distinctes, qui en partie continuent a fonetionner a l'interieur de leur systeme traditionneI, en partie se relaient dans un meme systeme fonctionnel avec des formes appartenant a d'autres epoques ou d'autres phases et qui relevent d'autres sources etymologiques.
7 Parlant de eoexistence et d'anachronisme il faut encore signaler le cas que differentes fonetions ou signifieations d'une meme forme, appartenant ades phases de grammatiealisation distinctes, coexistent a l' interieur d' un meme systeme (p. ex. la copresence de signifieations loeales et de significations abstraites de prepositions comme Cl et de). La copresence synchronique, dans une forme, de differentes significations issues d'une evolution diachronique est la source plus naturelle de la polysemie, au point que l'inventeur meme du terme polysemie, M. Breal, l'a prise comme sa definition (Breal 1897 : 154);
64 Daniel JACOB
modernes. Pour cerner le processus de remplacement d'une forme par une autre, i1 faut determiner la relation ou l'opposition exacte entre les formes au cours du temps. Comme touts les cas de synonymie, cette opposition peut se situer dans une dimension fonctionnelle (c'est-a-dire que les formes concurrentes ont une signification ou un rendement communicatif legerernent distinct) autant- que dans une dimension variationnelle (c'est-a-dire que la difference est d'ordre « stylistique »), sans qu'il soit possible de separer nettement ces deux aspects8
• Tres souvent, c'est dans la langue 'parlee oudans les langues techniques que les innovations lexicales ou grammaticales trouvent leur 'origine. La grande permeabilitede ces formes de discours a I 'innovation est facile a expliquer : en dehors du fait que ce sont les formes de discours les plus courantes (il ne faut pas oublier que le changement linguistique se fait dans la parole), ces formes-Ia paraissent a la fois moins exposees au contröle de la norme linguistique et plus·confrontees ace qu'on appelle la «detresse communicative », etant forcees de conceptuali ser et de transfJ:1.ettre des etats de choses parfois inconnus ou pragmatiquement precaires. Ces facteurs favopsent la creativite et 'l'expressivite' qui conditionnent l'innovation lexicale et grammaticale (v. plus bas).
Pour re tracer la «normalisation» et la dispersion des formes innovatrices a travers le diasysteme, aux depens des formes anciennes, il faut egalement adopter une perspective qui se situe non seulement au-dessus d'une forme precise mais aussi au dessus des differents types de. discours qui constituent une langue. '
2. « Expressivite », « pragmatique » et grammaticalisation
L'une des formules les plus courantes pour decrire I 'aspect fonctionnel ou' semantique de la grammaticalisation est celle d'un affaiblissement semantique (<< bleaching »). Cette formule s' appuie sur la vieille idee que les significations grammaticales seraient plus ab straites, plus generales que les significations lexicales. Dans une perspective
8 C'est un truisme qu'i1 est impossible de separer completement le contenu et le style d'un discours correspondant a un contexte situationnel particulier. C'est pourquoi iI semble preferable, au lieu de parler de differentes varietes de langue, ou « styles », de parlerde differentes situations communicatives (ce qui implique a la fois la difference de contenu et de style). Un bel exemple pour demontrer ce genre de problemes est la coexistence de deux formes de plus-que-parfait en espagnol, ou Ia forme « normale », periphrastique (habfa conocido) est c6toyee par la vielle forme synthetique (conociera), qui se distingue de la premiere autant par sa marque stylistique que par son applicabilite contextuelle et sa polysemie (fonctionnant en meme temps comme forme du subjonctif imparfait).
Niveaux de grammaticite : de lafo11.ction primaire . .. 65
extensionnelle, cette generalisation correspond a une applicabilite croissante (<< a wider range ofuse », BybeelPagliuca 1985 : 61) de la fonne consideree, dans une perspective intensionnelle comme une perte de traits ~emantiques (Bybee/Pagliuca 1985 : 63). II est plausible qu'une teIle generalite Oll genericite semantique va de pair avec une frequence d' usage croissante, qui peut, a son tour, favoriser les processus de gramrnaticalisation du cöte du signifiant, a savoir la reduction phonetique et la fusion des morphemes concernes (BybeelPagliuca 1985 : 61l L'idee d.e l' affaiblissement semantique se base donc sur une perception quantitative -de l'evolution : elargissement de l'extension semantique, de l'applicabilite et de la frequence d'usage, reduction du nombre de traits semantiques (ou de semes). En dehors d'ignorer que la genericite semantique n'est nullement limitee a la grammaire, cette theorie est defaillante quand il s' agit d' ana1yser des exemples comme 1a fonnation du futur ou du passe compose des langues romanes : i1 est difficile de prouver que la signification de verbes comme habere, ire, volere et autres, qui ont servi a former ces temps, auraient une signification plus specifique, c'est-a-dire qu'ils auraient plus de semes que la signification temporelle des temps grammaticaux qui en sont issuslO
• C'est pourquoi Sweetser (1988, cf. surtout 392) et HopperfTraugott (1993 : 87ss.) proposent une vue plus qualitative: tout en admettant que la grammaticalisation implique.le passage du plus concret au plus abstrait, Hs ne con<;oivent pas ce changement en fonne de perte de traits semantiques, mais de remplacement des traits plus concrets par des traits plus abstraits. Sweetser (1988 : 392s.) precise que l' abstraction de ces traits reside dans leur caractere plus 'schematique' ou 'topologique' ..
A mi-chemin entre vue quantitative et vue qualitative, se situe l'idee traditionnelle d'une perte d'expressivite au cours de 1a grammaticalisation (v. d. Gabelentz 1891 ; Meillet 1912/1948 ; Lüdtke 1980; Lehmann 1985, 1995; Hopper/Traugott 1993: 87ff). Comme on 1'a dit, les fonnes rempla<;antes passent generalement pour etre plus «expressives» que les formes remplacees, l' ~xpressivite etant definie a la fois comme un haut degre d' engagement personnel et emotionnel du sujet parlant dans ses propos, et comme le besoin d'assurer un haut degre d'attention du cöte du recepteur. Ces besoins favorisent l' emploi d' expressions saillantes,' marquees, enrichies de connotations,' souvent metaphoriques ou metonymiques. La recurrence de ces expressions dans leur contexte initialement inaccoutume fait qu' elles perdent peu a peu leur caractere inhabituel et leurs effets expressifs, qu' elles deviennent obligatoires dans
·leur contexte nouveau, et qu' elles restreignent leur signification et leur
9 Cf. dans ce sens deja les propos de Weinrich 1966. 10 Pour une critique plus profonde du concept de« bleaching» cf. Detges 1999.
66 Daniel JACOB
applicabilite au domaine referentiel de ce contexte. tehmann (l985), Mair (1992), Keller (1994), Koch/Oesterreicher (1996) et Detges (1999), entre autres, donnent des analyses avancees sur ce que c' est que «l'expressivit6 », et sur ce quimotive l'usage de la forme plus expressive au lieu de la forme traditionnelle. Cependant, l'analyse de ce qu'est l'expressivite ne resout pas le probleme pose ici, a savoir en quoi consiste le caractere 'grammatical' d'un objet linguistique: il para!t insuffisant d'expliquer 'le grammatical' comme l'absence d'expressivite. Notons aussi que le processus de remplacement d'une forme neutre par une forme expressive, qui ensuite perd son expressiyite pour se transformer a nouveau en une forme neutre, conceme autant le lexique que la grammaire.
La meme objection vaut pour toutes les approches qui supposent une fonction «pragmatique-» comme point-de depart de grammaticalisation. Pareille vue aete rendue populaire sous la formule 'from pragmatics to syntax', deja mentionnee (cf. surtout Giv6n 1976 ; 1979 chapitre 5). Il faut tout d'abord constater qu'il y ades divergences sur ee qu'on entend par « pragmatique ». Giv6n (l.c.) et Hopper (1979), en parlant de fonetion pragmatique, se referaient surtout a la topicalite et aux construetions de topicalisation. Ainsi, en fran~ais, la grammatiealisation avaneee des pronoms personneis clitiques (consideres parfois eomme des marques de personne quasi-obligatoires) a pris son depart dans une construction segmentee servant a souligner la fonetion topicale -du sujet.
S._ Fleischman (1983), qui decrit la formation du futur etdu passe periphrastique (avec aller et avoir respeetivement) dans les langues romanes comme un passage de la pragmatique a la semantique propositionn~lle, preeise la notion de «pragmatique» par des termes eomme « psychological », « participation, interest, or personal involvement in the situation» ou «the speaker's subjecti ve view» (1983: 190), done des eategories qui correspondent a la notion d' expressivite evoquee plus haut.
D'autres auteurs se fondent sur une acception gricienne du terme « pragmatique » : ainsi, en anglais, la transformation des conjonctions temporellessince et while en eonjonctions de causalite ou de coneessivite respectivement passe par un usage metonymique des deux formes, ce qui presuppose une implicature dans le sens de Grice, qui s'est conventionnaliseeensuite (TraugottlKönig 1991 ; cf. aussi Carey 1990 pour la formation du passe compose). Effectivement, I'innovation - souvent metaphorique ou metonymique - necessaire eomme point initial de tout changement linguistique, ne peut fonctionner qu'a travers les mecanismes deerits par Grice.
Voila donc trois aceeptions tout a fait divergentes de ce que serait la fonction «pragmatique» situee au depart du processus de grammatiealisation. 11 est incontestable que chacune des trois notions est
Niveaux di! grammaticiM: de lafonction primaire ... 67
applicable a certains developpements diachroniques qu' on considere COID.J+I.e des cas de grammaticalisation, et qu' elles sont necessaires pour expliquer ce qui met en marche le changement linguistique. I1 est aussi hors de douteque la specificite des expressions qui sont a l' origine du changement linguistique reside dans un surplus fonctionnel qui se situe au deIa de la pure signification semantico-propositionnelle (qu'on parle d' expressivite, de pragmatique ou d'autre chose). Mais, comme on l'a deja fait remarquer, deux des trois acceptions de «pragmatique» (expressivite/subjectivite; implicature) s'appliquent aussi bi~n au changement lexical qu'a la grammaticalisation. D'ailleurs, comme toutes. ces formules s' occupent de la fonction qui se situe au depart du processus de grammaticalisation, elles nous apprennent plus sur le non-grammatical que sut le grammatical.
I1 y a pourtant une theorie qui considere la fonction pragmatique non pas comme le poiIit de depart mais comme le resultat de la grammaticalisationll
. Nous avons a faire ici a une quatrierne acception du terme «pragmat~que », a savoir toute signification qui renvoie a la situation de l' acte de communication, ou aux participants de celui-ci. Pour TraugottfKönig (1991 : 208s.), il s'agit de «meanings based in the internal (evaluative/perceptual/cognitive) situation », «meanings based in the textual situation» ou de «meanings situated in the speakers subjecti ve belief-state/attitude toward the situation» (cf. aussi Traugott 1982, 1999 ete.). Selon R. Langacker, ... «grammaticized elements often shift from "propositional" to "textual" meanings, or from describing an external situation to reflecting evaluative, pereeptual or cognitive aspects of the "intern al situation" ( ... ). This last factor amounts to subjectification, under a broad interpretation of the term ». (1990 :16; soulignement D. J.). Traugott et Langacker insistent donc sur la qualite reflexive et metalinguistique des elements grammaticalises. En reliant la grammaticallsation a son concept - eognitif et plutot statique - de « subjectivity », Langacker se centre sur le degre d'explicite avec laquelle un etat de choses· rapporte est relie a la perspective des « eoneeptualisateurs », et par la, des participants a l' aete de communication, alors que les propos de TraugottfKönig mettent l' accent sur l' aspect 'pragmatique' dans le sens etroit du terme: evaluation, attitude du locuteur vis-a-vis de ee qui est die2
,
Finalement, les termes «textual meaning» et «textual situation» permettent de mettre eIl valeur l' aspect procedural de cette reflexivite
11 Le paradoxe de cette interpretation par rapport aux autres theories presentees plus haut n'est pas passee inaper~ue, cf. la discussion dans Fleischman (1983 : 203s.) ;
. Traugott (1982, 1988) ; TraugottIKönig (1991 : 190) ; Langacker (1990: 16) etc. 12 Pour une discussion des difff5rences v. Traugott (1999) et Langacker (1999).
68 Daniel JACOB
metalinguistique: tres souvent, les entites et l'organisation grammaticales servent a orienter et a soutenir le « text processing », c'est-a-dire qu'ils signalent la maniere et 1 'attitude dont il faut recevoir et decoder ce qui est dito Ceci correspond a une idee elaboree il y a deja bien longtemps par H. Weinrich dans son livre sur les categories du temps grammatical (Weinrich 1964/1985 ; cf. p. 29, 32, "33): selon Weinrich, les signes grammaticaux (plus precisement : les signes d'occurrence obligatoire ou « obstinee », comme les articles, les desinences et pronoms personneIs, les temps) mettent en jeu le «processus communicatif en Iui meme », «permettarit au locuteur'd'influencer et de conduire I'interlocuteur dans la reception du texte» (33, trad. D. J.). Appliquant la theorie de Ehlich (1991), qui reprend a Bühler (1934/1965) I'idee de differents champs fonctioimels linguistiques, on pourrait dire que la grammaticalisation correspond a une transition des elements concemes du champ symbolique au champ operationnel (Le. la fonction de regler 1 'interaction linguistique et discursive).
Vöila donc des precisions possibles a une notion de « pragmatique » apparemment beaucoup trop floue pour expliquer ce qu'est le caractere grammatical d'une entite linguistique et definir ainsi la direction dans Iaquelle se dirige la grammaticalisiation. Pour faire un premier resume de ce que pourrait constituer 'le grammatical' au niveau de la fonction, on pourrait dire. que Ia grammaire transporte des concepts hautement conventionnalises, de nature plutöt abstraite. Tres souvent, il s'agit de fonetions metalinguistiques quimettent en jeu la situation comniunicative et le discours produit, bref, le processus de communication lui-m~me. Cependant, il faut insister sur le fait que ces elements ne sont ni reserves a la grammaire ni suffisants pour la decrire. I1 s'agit simplement de domaines d'application preferes pour les structures ou morphemes grammaticaux, autrement dit, il s'agit d'un certain genre de contenus potentiels qui ont une affinite particuliere avec la grammaire. Comme on sait, tout contenu exprime par voie grammaticale est aussi susceptible d'etre exprime par voie lexematique (comme dans l'exemple bien connu des fonctions illocutives, exprimees soit par la forme grammaticale de la phrase .soit par des tours du type je vous demande/prie/assure ... ).
3. Grammaticite et degre d'organisation et de complexite systematique
Comme on I' a deja fait remarquer, parrni les traits typiques des entites grammaticales, soulignes par Lehmann (1985, 1995), il y a le haut degre d'organisation paradigmatique, et une occurrence hautement automatisee, c'est-a-dire un usage qui ne depend que de maniere indirecte des intentions communicatives du locuteur. Plus concretement: tandis que l'usage d'un
Niveaux. de grammaticite : de lafonction primaire ... 69
eertain lexeme (eomme p. ex. male ou femeUe) depend direetement du ehoix du loeuteur en fonetion de ce qu'll veut dire, 1'usage d'une entite grammaticale" (comme p. ex. les morphemes du masculin ou du feminin) depend enpartie de ce que le systeme grammaticallui impose. Le degre d' organisation, qui consiste en la complexite paradigmatique et en le earactere obligatoire des regles applieables, constitue done une limitation de la liberte du locuteur au moment d'organiser son diseours. En meme temps, ces faeteurs augmentent l' efficacite du discours : alors que le haut degre d' obligation ou de conventionnalite peut faciliter le captage et le decodage du message, en assurant une structure hautement previsible, I' organisation paradigmatique mene a une economie syntagmatique eonsiderable, permettant de transmettre une grande quantite d'information (information parfois tres importante, cf. § 2) avec relativement peu de morphemes, qui, en plus, sont tres courts dans leur majorite13
• Ainsi, pour eommuniquer p. ex.1'information« sexe d'une personne dont on parle »,la eategorie du genre grammatical rend possible une construction bien plus simple et plus dense que s'll fallait transmettre la meme information par moyen de lexemes comme male, femelle, homme ou femme.
I1 "y a done deux relations de complementarite: D'un cöte la complementarite entre le cout paradigmatique (plus un systeme est flexionnel, plus il est complexe) et I' eeonomie syntagmatique (plus un systeme est flexionnel, plus la densite de l' information qui peut etre transmis par un seul morpheme est grande )14. De I' autre cöte, il y a la complementarite plus generale entre l' efficacite communicative du systeme et le degre de restrietions que celui-ci impose a ses usagers. Nous avons a faire Ja a un principe general qui earacterise tous les outils dont s' entoure l' etre humain pour resoudre ses problemes et ses taches quotidiens (les fameux « problem solving devices » : machines, logiciel, systemesd' organisation sociale): a vec la complexite de l' outil, le rendement augmente, proportionellement aux eontraintes que l' oritil impose a ses usagers.
L'essenee de la grammaire, le 'grammatical', reside donc dans ce earactere de complexite et d'abstraetion organisationnelle des systemes
13 Giv6n 1995 : 403 parle de la grammaire «as an automated, streamlined, speeded-up language processing system ».
14 Au dela encore de la flexivite, il y a l'irregularite morphologique et la suppletion, qui perinettent de maintenir une bonne distinctivite des fonnes d'un paradigme meme quand les morphemes sont tres courts (Werner 1988, Ronneberger-Sibold 1988). Ce n'est pas un hasard si a l'interieur de la conjugaison verbale, ce sont en general les verbes les plus frequents et les fonnes les plus usitees qui sont soumis a l'irregularite grammaticale, tandis que la regularite augmente avec la periphericit6 des verbes ou des categories temporelles ou modales en question.
·70 Daniel JACOB
partiels en question1S: organisation fixe de relations paradigmatiques,
regles et structures qui ne sont reliees qu'indirectement aux besoins communicatifs immediats que le· sujet parlant poursuit dans un discours concretl6
• .
Comme dans d'autres systemes techniques ou sociaux, la tendance de la grammaire a imposer sa propre logique aux depens des fonctions communicatives, donc la tendance a former un systeme autosuffisant (self-contained dans la terminologie de Croft 1995) peut aller jusqu'a I' emploi de regles, de categories ou de formes totaleinent exemptes de
. signification : ainsi, po ur la plupart des noms substantifs de Ja langue fran~aise Ja marque de genre ne constitue qu'un c1assificateur purement formel qui signale certaines proprietes morphQlogiques du substantif en question. Cette c1assification morphologique, meme si elle est purement formelle, ne manque cependant pas de fonction communicative : etant une des categories de base pour l'accord grammatical entre le substantif et d'autres constituantes (pronoms, adjectifs) elle sert par exemple a assurer des liens syntaxiques ou des references anaphoriques.
. Pour finir, il peut y avoir, dans une grammaire, des traits de « defonctionnalisation » totale17
, plus connus comme des cas de « servitude grammaticale », OU la grammaire impose des usages qui peuvent meme aller a l' encontre de I 'intuition seI)1antique, et meme du systeme grammatical abstrait. L'usage des modes apres certains verbes ou dans certaines constellations. syntaxiques en fran~ais (negation, tour$ hypothetiques), ou Ja concordance des temps en seraient des exemples. Tres souvent, ces cas rriontrent des tendances a l' elimination analogique, qui en elle-meme est un sym~töme de la defonctionnalisation totale des categories et regles concernees 8. ..
Rappeions que, suivant la logique de Giv6n (1979, chapitre 5), le degre d'organisation qu'implique une grammaire n'est pas une condition essentielle pour le fonctionnement de la langue. Ceci est demontre par
15 Comme je I'ai dit, je suis en ceci les idees de Giv6n (cf. en particulier 1979, chapitre 5; 1995, chapitres 2, 9).
16 Cf. Giv6n 1995: 62: «The greater the complexity of function, with higher and higher hierarchy levels, they more hierarchie and abstract is the structure ; and the less obvious ist the correlation between structure and function ».
17 Parlant d'une maniere provisoire. Cf. § 5 pour la remise en question d'une a-fonctionnalite absolue. .
18 Pour en rester a I'exemple du genre grammatical, on pourrait signaler un cas de I'allemand, Oll certains emprunts latins (Virus, Corpus), du moins dans la grammaire normative, maintiennent le genre neutre qu'ils ont en latin. Ceci etant en contradiction avec la regle (empruntee au latin mais integree dans le systeme allemand) que les mots en MUS sont masculins, nous assistons, en ce moment, a un remanie!TIent analogique qui tend a conferer le genre masculin aces mots (der Corpus, der Virus).
Niveaux de grammaticite : de la fonction primaire ... 71
certaines formes de discours pidginise (titres de journaux, style teIegraphique, joreigner talk, baby talk) ou certains systemes linguistiques moins grammaticalises (langue parlee, creoles et autres fonnes que Giv6n attribue au « pragmatical mode») faisant I' economie de certaines fonnes d' organisation grammaticale.
4. Degres de grammaticite/etapes de grammaticalisation.
Consequence de ce qui a ete dit dans le § precedent : le changement de fonctionnalite qu'un systeme partiel subit au cours de la grammaticalisation re suIte dans le degre croissant d' auto-reference et l' abstraction (non pas semantique mais structurelle) croissante des categories et des regles qui regissent le systeme. Pour donner un exemple, j' aurai recours a un sous-systeme, un peu plus complexe : le marquage des fonctions actantielles en franc;ais.
Comme on sait, dans le marquage des fonctions syntaxiques des groupes nominaux, qui ass ure en meme temps le marquage des röles semantiques, i1 y a interaction (ou, comme nous disions dans le § 1, coexistence) entre plusieurs strategies d'expression bien diverses: a cöte de la linearisation, qui marque le sujet et le COD quand il s'agit d'un substantif, il existe un sous-systeme d' organisation agglutinative, a savoir les prepositions. Enfin, on ades' residus de l' ancienne flexion casuelle du latin, qui subsiste encore' au niveau des pronoms, avec I'opposition entre qui et que, il, le et lui, elle, la et lui). Suivant ce que nous avons dit en § 3, ce n'est pas un hasard si Ie systeme flexionnel s 'est maintenu seulement pour Ies trois fonctions syntaxiques centrales et pour les pronoms, plus frequents que les substantifs dans le discours, c' esta-dire plus centraux au niveau ~e la parole. A cöte de ce cas surprenant de «survie grammaticale », i1 y a donc deux cas de grammaticalisation plus « classique »: le cas de la linearisation et celui des prepositions. La grammaticalisation des prepositions ne demande pas de description. Pour nos fins il suffit de constater le changement fondamental que les prepositions a et de ont sub i entre le latin et le franc;ais. Vues dans la perspecti ve des modeles exposes dans le § 2, ces deux formes sont deja pleinement grammaticalisees en latin : elles ont une signification extremement generique, qui s'accompagne d'une haute applicabilite et d'une frequence elevee. Pour etre generique, cette signification n'en est pas moins une signification qui revient, dans chaque cas, a la forme correspondante, comme propriete : il y a donc un lien direct entre signification et forme, sans l'intervention d' aucun aspect d'interaction systematique avec d'autres categories, ni d'aucun trait de complexite organisationnelle.
72 Daniel JACOB
Le lien immediat entre forme et fonction communicative est encore plus evident pour la linearisation: comme on l'a dit, les principes qui regissent la linearisation des constituants centraux de la phrase en latin (et, en partie, dans les langues romanes autres que le fran9ais) sont d'ordre informationnel, c'est-a-dire que la linearisation represente dans une large mesure la structure. theme-rheme, d'une maniere assez intuitive, « naturelle ». Il y a done une correlation approximative entre la position preverbale (qui va devenir la marque du sujet en fran9ais) et le theme de la phrase,et entre la position postverbale (future marque du DO) et le rhemel9
• .
En fran9ais, on l'a vu, les deux prepositions ainsi que les categories de linearisation ('position preverbale' et 'position postverbale') perdent ces liens immediats avee leurs fonctions communicatives respectives, pour s'integrer dans un sous-systeme qui accuse une organisation assez complexe : le marquage des constituants nominaux centraux de la phrase. Bien qu'il soit destine a representer et a transmettre une structure semantico-propositionnelle (plus precisement: les röles semantiques d'actance), ce sous-systeme obeit tout d'.abord a sa propre logique : airisi, dans une phrase comme Pierre s' occupe de Marie, I 'usage de la preposition ne depend pas direetement de la signification qu'il s'agit d' exprimer, mais de la valence du verbe occuper, son apport semantique (de marquer le röle semantique qui revient a l'actant Marie) se calcule donc en fonction d'autres elements, sur la base d'un inventaire de regles. No'us avons donc a faire a un systeme abstrait, plus complexe, qui suit d'abord ses propres regles internes, et qui n'a qu'un rapport indirect avec les interets communicatifs qu'il doit servir. Parfois, ces regles abstraites peuvent meme entrer en conflit avec les besoins eommunicatifs. Ainsi, la categorie syntaxique du sujet se caracterise, entre autres, par sa presence obligatoire, sans que eeci corresponde a un interet eommunieatif immediat. On saH bien les difficultes que les locuteurs ont en fran9ais pour se debarrasser d'un sujet grammatical quand celui-ci n'a pas de correspondant semantique : constructions passive ou pseudo-reflechie, pronoms vides ... La position fixe des constituants synuixiques peut poser des problemes elle aussi, quand elle va a l'encontre de la strueture informationnelle, problemes qui se manifestent par la frequence de constructions segmentees, de mises
19 Evidemment, I'ordre des mots en latin n'est pas !ibre ni de traits d'arbitrarite structurelle, ni d'interference avec d'autres facteurs qui pourraient influencer la linearisation (comme I'elimination de structures ambigues ou difficiles a decoder). La relation entre position lineaire et structure informationnelle est aussi compliquee par les interferences avec d'autres procedes de thematisation ou de rhematisation. Enfin, il est evident qu'il faut eliminer de la discussion les cas de linearisation hautement artificielle, donc stylistiquement marques, qu'on peut trouver dans les textes du latin classiqtie. Pour une discussion approfondie sur tous ces facteurs et leur impact sur I'ordre des mots en latin cf. Panhuis 1982.
Niveaux de grammaticite : de la fonction primaire ... 73
en relief ete. en fran~ais. La syntaxe des eonstituants nominaux eentraux de la phrase eonstitue done un systeme qui en partie suit ses propres regles, parfois meme en contradiction avee des besoins communicatifs; un systeme en partie autosuffisant.
Evidemment, la structure syntaxique est loin d' etre exempte de fonctions communicatives : si les eategories syntaxiques (eomme le sujet, l'objet direct, l'objet indirect ete.) aecusent certains traits de fonctionnement purement fonnels, elles servent tout de meme a realiser des fonctions semantiques, quoique de maniere indirecte. Si p. ex. les fonetions de sujet grammatical ou d' objet direct sont trop abstraites pour etre relationnees directement avee des röles actanciels semantiques determines, c'est-a-dire qu'elles n'ont pas de signification immediate, elles ont malgre tout une fonction distinctive par rapport aux röles prevus dans le cadre valenciel de chaque verbe, servant ainsi de maniere indirecte a marquer ces röles. On pourrait meme reconnaitre a ce systeme de categories syntaxiques abstraites une effieacite communicative particuliere: les regles et categories qui le constituent, a savoir les marques morphologiques,l'accord grammatical entre le sujet et le verbe ou les positions fixes du sujet et du COD, donnent a la phrase une univocite structurelle presque parfaite dans la representation de la structure propositionnelle qu'il s' agit de transporter. Les regles d'accessibilite pronominale et de 'eontröle', qui definissent le sujet grammatical, . assurent une bonne part des references transphrastiques ou inter-propositionnelles de maniere hautement economique. Cependant, le cout de ces avantages est eonsiderable : outre les contraintes deja esquissees que l'organisation syntaxique exerce sur les sujets parlants, les fonctions enumerees exigent un enorme appareil structurel : le systeme tout entier ne peut fonctionner que sur la base de la valence verbale, qui, pour chaque verbe singulier de la langue, requiert un plan de correspondanees entre structure syntaxique et strueture semantique. Je parle des cadres valenciels, deposes en tant que regles dans le lexique. A nouveau, nous constatons le rapport complementaire entre rendement au niveau de la parole et cout supplementaire au niveau du systeme, voire entre efficacite communicative et restrietions qu'un systeme auto-suffisant inflige a ses usagers. ..
Pour revenir a notre exemple : l' ordre des mots, en tant qu' objet linguistique dans le sens du § 1, s'est donc « syntactise », se transfonnant d'un element qui realise directement et immediatement une fonction eommunieative, de maniere intuitive et quasi-universelle, en un element tributaire d'un systeme abstrait, avec des fonctions apriori fonnelles, mais qui servent une fonetion eommunicative dans une maniere indireete et complexe, relevant d'une structure en partie arbitraire (ou au moins propre a une langue particuliere). De meme, les prepositions ad et de, d e signification individuelle, quoique generale, sont devenus des marques de
74 Daniel JACOB
categories syntaxiques abstraites, qui n'acquierent de signification referentielle qu' en vertude ce systeme complexe. Au lieu de transporter . ses propres significations, elles se contentent d'une fonction distinctive par rapport aux significations contenues dans le cadre valenciel' de chaque verbe.
Le systeme du marquage actancieI s'est donc renouvele, du latin au fran~ais, en integrant des elements divers (concrets comme les prepositions ou abstraits comme les positions lineaires), qui ont, par Hl, acquis un caractere plus grammatical. Il en resulte un sous-systeme coherent mais peu homogene en ce qu'il int~gre plusieurs strategies d'expression differentes.
Pour ce qui est de la defonctionnalisation totale, evoquee a la fin du § . 3, il n'est pas facile d'en trouver des traces dans le domaine de 1 'ordre des mots ou de l'usage des prepositions: Certes, le systemecasuel en tant que tel montre certaines structures arbitraires qui vont a l' encontre de 1 'intuition ou semblent contredire le systeme (qu'on pense ades collocations comme s'approcher de quelqu'un ou prendre quelque chose a quelqu'un). Mais ces formes ne sortent pas du principe fonctionnel general selon lequel c'est le cadre valenciel· de chaque verbe qui assure la correlation entre les röles semantiques et la forme casuelle (fiit-elle contre-intuitive).
Pour trouver un cas de defonctionnalisation totale concernant l' ordre des mots, il faut chercher dans d'autres domaines fonctionnels : dans les langues romanes, on le sait, l'adjectif qualificatif adnominal peut se trouver avant ou apres le substantif. Les principes qui regissent la position sont a peu pres les memes pour toutes les langues romanes: ils sont fondes sur des criteres d'ordre serriantique (caractere restrictif ou predicatif etc) et informationnel (focalisation), permettant certains subtilites de style et certains effets pragmatiques considerables20
• Or, en fnin~ais, contrairement aux autres langues, la tendance generale a la fixite dans I' ordre des mots affecte aussi les adjectifs : la position postnominale a tendance a devenir obligatoire, la position prenominale etant imposee pour un nombre tres. restreint d'adjectifs (grand, petit, haut ... ?I, proscrivant ainsi certaines positions parfaitement courantes dans les autres langues romanes actuelles et encore en fran~ais classique. Il ne me semble pas possible de trouver une explication fonctionnelle a ce figemene2
• Au contraire, le figement de la position de l'adjectif prive le fran~ais des effets semantiques Oll
pragmatiques que les autres langues peuvent obtenir par I' alternation de
20 Pour un aper9u general du probleme, v. Jacob 1999.
21 Weinrich 1966 a considere cette tendance a I'anteposition de quelques rares adjectifs comme un cas de grammaticalisation des adjectifs en question.
22 Le fait que c'est soit I'anteposition soit la postposition qui se figent em peche meme d'y voir I'effet de principes tels qu'i!s ont ete observes par la typologie positionnelle dans tradition de Greenberg.
Niveaux de grammaticite : de la fonction pnmaire ... 75
position. Nous avons donc a faire a une regle de syntaxe qui n'a d'autre explication qu' un principe purement formel de la grammaire fran~aise : I' ordre fixe des constituants de la phrase.
n nous reste encore a mentionner un autre stade possible dans le cycle de vie des entites ou sous-systemes grammaticaux : le declin. Comme nous l' avons VU, le destin le plus normal pour un morpheme, un paradigme, une categorie ou un sous-systeme est d'etre remplace par quelque chose qui se met a sa place. n y acependant des situations ou des sous-systemes ou des
. categories (qu'ilssoient remplaces par autre chose ou non) tombent en desuetude sans etre totalement elimines de la langue ou de la variete en question, hussant des vestiges qui subsistent parfois dans des fonctions tertiaires bien particulieres. Pour ce qui est du genre grammatical, il serait interessant d' etudier en detail, du point de vue de l' evolution grammaticale, les restes disperses du neutre dans les langues romanes : au premier abord, il semble y avoir quelques principes plus generaux (developpement de nouvelles fonctions dans le domaine « referentialite reduite », « reference abstraite », « reference distanciee/mepris »). En ce qui concerne l' exemple du marquage actanciel, nous avons vu que les restes de l' ancien systeme . casuel du latin ont servi de base a la construction d'un systeme nouveau, utilisant d' autres moyens d' expression appartenant a d' autres principes de construction. La discussion autour de l' effondrement du systeme casuel en protoroman et la fa~on d'interpreter ce qui en subsiste dans les langues romanes modernes par rapport a la flexion biCasuelle de l' ancien-fran~ais, loin d'etre close23
, pourrait egalement profiter de la perspective evolutive esquissee ici. La definition plus globale de ce que c' est que la grammaticite permet de considerer ces cas de desuetude et de desintegration d'un systeme comme des cas de degrammaticalisation. A mon avis, c'est une fa~on plus interessante, parce que plus realiste, d' envisager la question de 'degrammaticalisation" plutöt que de se demander, comme on le fait normalement, s'il peut y avoir une reversibilire du processus de grammaticalisation, a savoir des morphemes grammaticaux qui se re-transformeraient en lexemes.
5. Resume et considerations generales : defonctionnalisation et autonomie de la grammaire
En me pla~ant dans une perspective plus globalisante permettant des vues d' ensemble et des questions sur la coexistence concurrentielle ou cooperative de differents moyens d'expression, j'ai plaide pour appliquer le concept de 'grammaticalisation' non seulement a des morphemes ou des tours syntagmatiques, mais aussi ades objets linguistiques plus abstraits
23 Cf. p. ex. Dardelrwüest 1993.
76 Daniel JACOB
(categories, r~gles, proprietes de morphemes) et a des ensembles d'objets (paradigmes, sous-systemes), partant de la supposition que ces objets abstraits peuvent aussi evoluer d'un etat rhoins grammatical a un etat plus grammatical. A partir de plusieurs exemples, j'ai essaye d'illustrer differents degres de grammaticite, qu' on pourrait aussi considerer comme des stades ou des phases d'un cycle de grammaticalisation dans lequel evoluent les objets24
:
Fonction primaire : relation immediate 'entre l'objet linguistique et sa tache communicative (p. ex. : reference directe d'une preposition, effet topicalisant immediat de l'ordre des mots, relation directe entre sexe et genre en anglais).
Fonction indirecte, distinctive, n'operant qu'en vertu d'un systeme complexe au moyen de categories abstraites (p. ex. les fonctions syntaxiques qui marquent les röles semantiques en fonction de la valence verbale et les formes servant a son expression: prepositions, ordre des mots, flexion nominale).
Fonction formelle abstraite, servant a faire fonctionner le systeme en tant que tel (classes flexionnelles abstraites. accord grammatical).
Defonctionnalisation, arbitrarite (regles de servitude grammaticale : concordance des temps, emploi du subjonctif, classes flexionnelles sans impact commu'nicatif).
Desuetude/refonctionnalisation (perte des cas latins, categorie du neutre).
Cette systematique est basee sur l'idee que la particularite de la grammaire, comparee aux autres domaines de la langue, reside dans le degre d'organisation primordiale, c'est-a-dire le degre d'organisation au niveau du systeme, destine a augmenter le rendement communicatif (precision, univocite et densite de !'information encodee ou representee) au niveau de la parole. Ce degre d'organisation implique l'existence de categories, de structures et de finalites abstraites assurant le fonctionnement du systeme complexe. Dans la mesure Oll la complexite et le degre d'abstraction augmentent, le systeme tend a developper des structures de plus en plus tributaires du systeme lui-meme, et a soumettre son usager aux contraintes de celui-ci. '
C'est ainsi qu'il faut comprendre le probleme de «l'autonomie de la grammaire », tant discute entre les ecoles generativistes et fonctionnalistes25
: apriori, la grammaire est un systeme ou un ensemble
24 Je renonce a etablir une correspondance immediate entre ces stades et lesdifferentes fonctions postulees par Giv6n 1995 (<< iconicity », « meta:"iconicity», « arbitrariness/abstraction/convention/symbolic conventions », « excess structure» ; cf. en particulier p. 58ss., 435ss.), ce qui exigerait une discussion approfondie.
25 Cf. Croft 1995. Dans ce qui suit, je parle de ce que Croft appelle « autonomy of syntax ». POUT Ie probleme traite par Croft sous Ie terme «autonomy of grammar », a savoir la question de sensitivite de la grammaire pour des fonctions Iinguistiques 'externes', v. plus bas.
Niveaux de grammaticite : de lafonction primaire ... 77
de systemes au service de la communication, et en principe elle doit toute· sa constitution et son organisation aux exigences et a la dynamique de cette täche. Comme on a vu, c' est la nature de la grammaire, comme c' est la nature d' autres systemes sociaux, d' augmenter, au cours de son evolution, les principes d' autosuffisance. Evidemment, cette tendance vers l' abstraction organisationnelle, voire l' autonomie totale ne conceme jamais la grammaire en entier mais les differents sous-systemes destines a accomplir des tftches communicatives determinees. Comme il a ete dit et redit en theorie de grammaticalisation, il y a une tendance universelle et perpetuelle a reorganiser les sous-systemes qui ont atteint un degre trop grand d' abitrarite et d' autosuffisance, ou ales remplacer par de nouveaux systemes, plus iconiques, plus motives, plus immediatement relies donc aux contenus qu'ils sont destinesa realiser. C'est cette composante du processus de grammaticalisation qui fait que la grammaire en entier n'atteint jamais sa cible virtuelle, l'auto-referentialite ou autonomie totale (ce qui la rendrait, au fait, a-fonctionnelle).
Etant cible de l' evolution grammaticale, l' autonomie est donc la qualite propre qui defmit la grammaticite, tout en restant incomplete par principe,. etant donne que cela enleverait a la grammaire sa raison d' etre. La grammaire, donc, est autonome par definition, mais elle ne l' est jamais tout a fait en realite. Ce fait explique d' ailleurs pourquoi, en theorie grammaticale, la perspective diachronique, donc l' etude de la grammaticalisation, est particulierement importante pour comprendre la grammaire et sa nature. ..
Pour terminer, il me faut lever un malentendu auquel pourrait preter ma terminologie: si on parle du 'grammatical' et de l'autonomie comme une dejonctionnalisation, il faut d' abord rappeier que la plus grande part de l' evolution decrite ne consiste pas en une perte de fonction, mais en la perte du rapport immediat entre structure et fonction. Et si on decrit l'autonomie grammaticale comme une perte definitive de fonction, cela veut dire que les structures perdent leur fonctions de premier plan (c' est-a-dire cognitive et semiotique, servant a representer et a transmettre des contenus propositionnels et pragmatiques par une structure lineaire). n subsiste pourtant un effet important, deja mentionne plus haut: l' usage de formes vides et le respect de regles peu fonctionnelles peuvent servir a jormatiser le discours, c'est-a-dire a augmenter la reconnaissabilite des elements du discours, facilitant ainsi la perception de la chaine parIee~
Plus encore: dans la terminologie de Coseriu (1967 et passim), on pourrait dire que les structures d'autonomie ou de servitude grammaticale font partie de la norme (definie comme tout ce qui est regulier dans une langue, sans etre fonctionnel). Or, il est evident que l' existence et le respect de la norme linguistique, c'est-a-dire d'un ensemble de regles non-fonctionnelles, a ses propres 'fonctions' qui, bien sur, se situent sur un
78 Daniel JACOB
plan eompletement different: signaux de soumission bilaterale a une autorite tierce, signaux de respeet po ur I 'interloeuteur, signaux de eommunion' ou de distanee entre les eommunieants, done des fonetions phatiques ou des fonetions qui se situent sur le plan interhumain, soci ologi que.
Comme on l'a fait remarquer, la dynamique menant vers l'autonomie grammatieale eorrespond a un schema eommun des systemes sociaux en generaI26
• On pourrait comparer la defonetionnalisation en grammaire a d'autres faits de ritualisation. La distipetion, faite en soeiologie, ~ntre l' action productive et l' action rituelle peut s' appli q"uer aux deux poles . (fonetionnel et autonome) que nous avons etablis eomme eeux entre lesquels se meut la grammaire. Qu'on parle de la ritualisation de situations diseursives en forme de genres textuels, qu'on parle de preeeptes d'hygiene transformes en rites religieux, ou qu'on parle d'institutions soeiales eomme le mariage ou la nation ete., qui servent de eadre formel pour des fonetions eomme la procreation, le partage du travail et la vie commune des etres humains: nous tombons partout sur des symboles et _ des regles de eomportement qui evoluent entre la satisfaetion des fonetions vitales, primaires et le respeet de normes vides, en passant par une dynamique de eomplexite et d'autosuffisanee croissantes. De sorte que l'analogie etablie par Lehmann (1985 : 315) entre la grammatiealisation et l'evolution de La mode va bien plus loin que les remarques breves de Lehmann ne le laissent entendre.
Bibliographie
Daniel JACOB Cologne
BOREfZKY Norbert, ENNINGER Werner, STOU Thomas, (eds.,) 1988, Beiträge zum 3. Essener Kolloquium über Sprachwandel und seine bestimmenden Faktoren, Bochum : Brockmeyer.
BREAL Michel, 1897, Essai de semantique. Science de significations, Paris.
26 Ce qu'on vient de dire sur la grammaire et son 'autonomie', vu comme un' effet de son evolution, ades traits de I' autopoiesis et de l' auto-rejerentialite sur laquelle a insiste la 'Theorie des systemes' (Luhmann 1984, 30 la suite de MaturanaIV arela). Evidemment, cela n'est vrai que POUf l'aspect autonome de la grammaire, alors que l'aspect fonctionnel ne constitue justement pas un systeme dans la perspective de cette theorie. - Sans aucun doute, le 'grammatical', et par 130, Ia grammaticalisation, est un phenomene essentiellement sociologique. Si, tout le long de cet article, on a parle de I'evolution grammaticale, il s'agit, au mieux, d'une evolution qui se greife sur I'evolution biologique des etres humains et de Jeur intelligence. En aucun cas, il ne s'agit d'un phenomene comparable ou de nature anaJogue 30 I'evolution biologique, comme c'est suppose par Croft (2000).
Niveaux de grammaticite : de la.fonction primaire ... 79
BÜHLER Karl, 2[1934]1965, Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache, Stuttgart :' Fischer, reimpression de l'ed. Jena 1934.
B YBEE Joan, PAGLlUCA William, 1985, «Cross-linguistic comparison and the development of grammatical meanings », dans: Fisiak, Jacek (ed.) : Historical semantics and historical word formation, Berlin : De Gruyter.
CAREY Kathleen, 1990, «The Role of Conversational Implicature in the Early Grammaticalization of the English Perfect », BLS 16. 1,371-380.
COSERlU Eugenio, 21967, «Sistema, norma y habla », dans: id., Teoria dellenguaje y lingü{stica general, Madrid: Gredos ..
CROFT William, 1995, «Autonomy and Functionalist Linguistics », Language 71, 490-532.
CROFT William, 2000, Explaining Language Change. An Evolutionary Approach, Harlowe etc. : PearsonEducation.
DARDEL Robert de, WüEST Jakob, 1993, «Les systemes casuels duprotoroman. Les deux cycles de simplification », Vox Romanica 52, 25-65.
DETGES Ulrich, 1999, «Wie entsteht Grammatik? Kognitive und pragmatische Determinanten der Grammatikalisierung von Tempusmarkem », dans: Lang, Jürgen ; Neumann-Holzschuh, Ingrid (eds.) : Reanalyse und Grammatikalisierung in den romanischen Sprachen, Tübingen : Niemeyer, 31-52 .
. EHLlCH Konrad, 1991, «Funktional-pragmatische Kommunikationsanalyse - Ziele und Verfahren », dans: Flader, Dieter (ed.), Verbale Interaktion. Studien zur Empirie und Methodologie der Pragmatik, Stuttgart : Metzler, 127-143.
FLEISCHMAN Suzanne, 1983, « From pragmatics to grammar. Diachronic reflections on complex pasts and futures in Romance », Lingua 60, 183-214.
GABELENTZ Georg v. d., 1891, Die Sprachwissenschaft. Ihre Aufgaben, Methoden und bisherigen Ergebnisse, Leipzig: Weigel. .
Glv6N Talmy, 1976, «Topic, Pronoun, and Grammatical Agreement », dans: Li, Charles (ed.), Subject and Topic, New York etc., 149-188.
GIV6N Talmy, 1979, On understanding grammar, New York etc. : Academic Press. Glv6N Talmy, 1995, Functionalism and Grammar, AmsterdamlPhiladelphia:
Benjamins. HAGEoE Claude 1993, The Language Builder, AmsterdamlPhiladelphia : Benjamins. HEINE Bernd et al., 1991, Grammaticalization. A Conceptual Framework, Chicago:
Chicago UP. HOPPER Paul 1, 1979, «Aspect and foregrounding in discourse », dans: Giv6n, Talmy
(ed.), Discourse and Syntax, (Syntax and Semantics 12), New York: Academic Press 213-241.
HOPPER Paul J., 1991, «On some principles of gramaticization », dans: Traugott, Elizabeth Closs ; Heine, Bernd (eds.), Approaches to Grammaticalization, vol. II, AmsterdarnlPhiladelphia: Benjamins, 17-35.
HOPPER Paul, TRAUGOTT Elizabeth C., 1993, Grammaticalization, Cambridge : CUP .. JACOB Daniel, 1998, «Transitivität, Diathese und Perfekt: zur Entstehung der
romanischen haben-Periphrasen », dans: Geisler, Hans; Jacob, Daniel (eds.) : Transitivität und Diathese in romanischen Sprachen, Tübingen: Niemeyer, 105-126.
JACOB Daniel, 1999, «La posici6n deI adjetivo en espanol (yen las lenguas romanicas): aspectos varios y varias soluciones de un problema c1asico de
80 Daniel JACOB
gramatica », dans: Martfnez Gonzalez, Antonio (ed.), Estudios de filologfa hispdnica II, Granada: Univ. de Granada, 87-106.
KELLER Rudi, 1994, On Language Change: the Invisible Hand in Language, London : Routledge. .
KOCH Peter, OESTERREICHER Wulf, 1996, «Sprachwandel und expressive Mündlichkeit », Literaturwissenschaft und Linguistik 26,64-96.
LANGACKER Ronald, 1990, « Subjectification », dans: Cognitive Linguistics 1, 5-38.
LANGACKER Ronald W., 1999, « Losing control : grammaticization, subjectification, and transparency », dans: Blank/Koch (eds.), 147-175.
L E H MA N NChristian, [1982] 1995, Though!s on Grammaticalization, München/Newcastle : Lincom (reimpr. de : Arbeiten des Kölner UniversalienProjekts (AKUP) 48, 1982, lust. f. Sprachwiss., Univ. zu Köln).
LEHMANN Christian, 1985, « Grammatiealization : Synchronie Variation and Diachronie Change », Lingua e Stile 20/3303-318.
LÜDTKE Helmut, 1980, «Auf dem Weg zu einer Theorie des Sprachwandels », dans: id., Kommunikationstheoretische Grundlagen des Sprachwandels, Berlin : De Gruyter, 182-252.
LUHMANN Niklas, 1984, Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie, Frankfurt/M. : Suhrkamp. .
MAIR Walter N., 1992, Expressivität und Sprachwandel. Studien zur Rolle der « Subjektivität» in der Entwicklung der romanischen Sprachen. Frankfurt/M. ete.: Lang.
MATURANA Humberto F., V ARELA Franciseo F., 1987, Der Baum der Erkenntnis: Über biologische Wurzeln des Erkennnens, München.
MEILLET Antoine, [1912]1948, «L'evolution des formes grammatieales », dans: . Linguistique historique et linguistique generale, Paris, 21948: Klineksh~ck,
130-148 (reimpr. de Scientia 12/26,6, 1912). RONNEBERGER-SIBOLD EIke, 1987, «Verschiedene Wege zur Entstehung von
suppletiven Flexionsparadigmen. Deutsch gern -lieber - am liebsten », dans: Boretzky et al. (eds.), 243-264.
SWEETSER Eve, 1988, «Grammaticalization and semantie bleaching », dans: BLS (Proceedings of the Fourteenth Annual Meeting of the Berkeley Linguistie Society) 14,389-405.
TRAUGOTT Elizabeth Closs, 1982, «From propositional to textual and expressive meanings. Some semantic-pragmatic apeets of grammatiealization », dans: Lehmann Winfred P., Malkiel Yakov (eds.), Perspectives on Hisotrical Linguistics, Amsterdam: Benjamins, 245-271. .
TRAUGOTT Elizabeth Closs, 1988, « Pragrnatie strengthening and grammatiealization », BLS 14,406-416.
TRAUGOTT Elizabeth Closs, 1999, «The rhetorie of eounter-expectation in sernantic change: a study in subjectification », dans: Blank/Koch (eds.), 177-196.
TRAUGOTT Elizabeth C., HEINE Bernd, (eds.,) 1991a, Approaches to Grammaticalization. vol. 1 : Focus on theoretical and methodological issues, Amsterdam: Benjamins.
TRAUGOTT Elizabeth C., KÖNIG Ekkehard, 1991, «The semantics-pragrnatics of gramrnaticalization revisited », dans: Traugott/Heine (eds.), 189-218 ..
WEINRICH Harald, 1[1964]41985, Tempus. Besprochene und erzählte Welt, Stuttgart ete. : Kohlhammer.
Niveaux de grammaticite : de lafonctian primaire ... .81
WEINRICH Harald, 1966, «La place de l'adjectif en franr;ais », in : Vax Ramanica 25, 82-89.
WERNER Otmar, 1988, «Natürlichkeit und Nutzen morphologischer Irregularität », in : Boretzky et al. (eds.), 289-316.