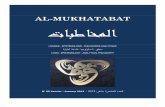"Los problemas matemáticos son como los temas gramaticales": logique, grammaire et arithmétique...
Transcript of "Los problemas matemáticos son como los temas gramaticales": logique, grammaire et arithmétique...
SOMMAIRE/CONTENTS
La Linguistique hispanique aujourd’hui
Jenny Brumme & Anne-Marie Chabrolle-CerretiniJudit FreixaHenri Boyer
Elvira Narvaja de Arnoux
Esteban T. Montoro del Arco
Jorge Leiva Rojo
annexeAnne-Marie Chabrolle-Cerretini
VariaJean Léo Léonard
Présentation
La néologie hispanique : analyse d’une éclosionSingularité(s) de la sociolinguistique du domaine catalan. Un repérage épistémologiqueLa primera gramática escolar “general” publicada en Buenos Aires en los años de la independencia: la Gramática Española o Principios de la Gramática General aplicados a la Lengua Castellana de Felipe Senillosa « Los problemas matemáticos son como los temas gramaticales » : logique, grammaire et arithmétique dans les traités d’analyse logique et grammaticale (XIXe siècle)
Fraseología, traducción y control de calidad: acerca de la (im)posibilidad de armonización de parámetros para la evaluación
La linguistique hispanique dans HEL
À quoi reconnaît-on la tagmémique ? Entre structuralisme périphérique et grammaire de texte : essai de modélisation épistémologique
5
9
2943
63
89
107
123
Lectures & critiques
Comptes rendusPierre-Yves Testenoire, Alejandro Diaz Villalba, Jean-Claude Chevalier, Bernard Pottier, Béatrice Godart-Wendling, Jack Feuillet
index du VoLume xxxiV
155
169
« LOS problEmas matEmáticos SON cOmO LOS tEmas GramaticalEs » : LOgIquE, gRAmmAIRE ET ARIThméTIquE dANS LES TRAITéS
d’ANALySE LOgIquE ET gRAmmATIcALE (XIXE SIècLE)
Esteban T. Montoro del ArcoUniversité de Granada
1. inTROdUCTiOn
La théorie sous-jacente à la pratique de l’analyse logique de la proposition plonge ses racines dans le lien qui, au XIXe siècle, s’établit entre le calcul mathématique et le langage, par le biais de la logique, entendue comme fondement de toute science. En vertu du lien logique entre grammaire et arithmétique (que l’on appelle aussi « calcul », etc.), on peut observer des similitudes quant aux concepts et aux termes employés dans les traités de ces deux disciplines qui furent publiés tout au long du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe. Certes, ces coïncidences ont une origine philosophique, mais elles se multiplient ensuite en empruntant une voie différente : elles sont le résultat de l’introduction de nos deux disciplines comme matières scolaires de base dans les nouveaux programmes élaborés en France dès la fin du XVIIIe siècle et en Espagne à partir de la deuxième moitié du XIXe.
RésuméCet article traite de la relation entre la grammaire et l’arithmétique, disciplines de base dans la formation de l’individu à partir du XIXe siècle. Nous abordons en premier lieu le lien logique que les Idéologues établissent, en France, entre la grammaire et l’arithmétique, ainsi que l’accueil que lui réservent, en Espagne, les premiers ouvrages de l’analyse logique et grammaticale. Ensuite, nous commentons l’introduction des termes complexe et incomplexe, dans les traités français ainsi que dans les traités espagnols, pour la classification des éléments de la proposition (sujet et attribut). Enfin, nous donnons un exemple de l’influence de l’arithmétique sur les représentations formelles de l’analyse dans certains manuels espagnols qui sont consacrés à cette pratique.
Mots clefsHistoire de la grammaire, analyse logique et grammaticale, arithmétique, idéologues, sujet
AbstractThis paper focuses on the relationship between Grammar and Arithmetic as basic school disciplines in the 19th century. First, it is our aim to describe the logical connection between Grammar and Arithmetic and how they were received in the early Spanish Logical and Grammatical Analysis treatises. After this first theoretical approach, and taking both French and Spanish treatises, we will follow with the study of the introduction of terms ‘complex’ and ‘uncomplex’ to classify the proposition elements (subject and attribute). We will conclude our article with an overview of the influence of Arithmetic in the formal representations of the Analysis in some Spanish manuals devoted to this practice.
KeywordsHistory of grammar, logical and grammatical analysis, arithmetic, ideologues, subject
Histoire Épistémologie Langage 34/II (2012) p. 63-87 © SHESL
64
En Espagne, notamment, Grammaire et, plus tard, Arithmétique apparaissent également dans les différentes épreuves objectives fixées pour la présentation aux concours de l’Administration, quel que soit le poste visé ; ainsi, la citation qui figure dans le titre du présent travail est tirée du traité Análisis gramatical: obra indispensable para maestros, opositores, normalistas, jefes de negociado, escribientes, periodistas, autores, etc. (1915) de José Ramón Palmí Pérez, auquel nous nous référons plus bas.
Nous présentons ci-après les fondements de la relation entre grammaire et arithmétique tel qu’elle a été établie par les Idéologues à propos de l’analyse logique ; ensuite, nous nous pencherons sur deux phénomènes qui découlent de cette relation et qui apparaissent dans la grammaire : a) l’introduction de la dichotomie complexe/incomplexe appliquée à l’analyse des éléments de la proposition (sujet et attribut) ; b) l’influence de l’arithmétique dans les représentations formelles de l’analyse présentes dans les manuels espagnols spécialisés.
2. LA PRáTiqUe de L’AnALyse LOgiqUe
On le sait, dans les idées issues de la Révolution française, l’enseignement acquiert une valeur cruciale et l’école devient le socle sur lequel pourra se forger une société nouvelle. Dans ce contexte, un groupe se constitue et prend de l’importance : ce sont les grammairiens-philosophes disciples de Condillac, baptisés « Idéologues ». Animés par Destutt de Tracy, les Idéologues inspirent le projet des Écoles centrales (enseignement secondaire) qui viennent remplacer l’enseignement traditionnel des Collèges de France supprimés après la Révolution : certains principes déjà présents chez les Encyclopédistes sont repris, parmi lesquels figurent, comme le signalent Delesalle & Chevalier (1986, p. 82), une grande liberté pédagogique, une place privilégiée accordée aux sciences sociales et aux sciences de la nature, une cohérence et un lien solidement établis entre les différentes disciplines scientifiques.
Pour les Idéologues, l’école repose sur deux piliers, la grammaire et les mathématiques, ces deux matières étant régies par la Logique, ou l’art d’analyser la pensée. La logique est vue comme la base du développement de toute science et son instrument est l’analyse, ou méthode analytique, c’est-à-dire un processus de décomposition du jugement en propositions et ces dernières en constituants ultérieurs. L’analyse est parée d’une double vertu : d’une part, elle constitue un procédé de formation de l’intellect car elle permet le développement de la capacité de raisonner ; d’autre part, elle possède une implication que l’on pourrait qualifier d’ « éthique », car elle aide à découvrir ce qu’il y a de vrai ou de faux dans tout jugement ou tout discours. La pratique de l’analyse répond, en définitive, à l’objectif visionnaire des Lumières : former des citoyens à la fois cultivés et responsables, capables de jouer un rôle significatif dans le devenir de la République :
Le but principal de cette méthode, c’est de former l’esprit en accoutumant les jeunes gens, sans qu’ils s’en aperçoivent, à mettre de l’ordre dans leurs pensées, à sentir les rapports naturels des idées, à démêler les équivoques, et à tout rapporter à de véritables principes ; ce qui donne dans la suite de la vie une justesse d’esprit, où il me semble que les méthodes ordinaires ne conduisent point (Du Marsais 1797, cité par Delesalle & Chevalier 1986, p. 89).
esTeBAn T. MOnTORO deL ARCO
65
Bien qu’au départ un seul type d’analyse soit considéré, l’analyse « logique », entendue comme « analyse de la proposition », la technique analytique se polarise peu à peu en deux volets différenciés : l’analyse logique et l’analyse grammaticale. La distinction est développée sous une forme pratique dans le système scolaire français par les grammairiens postérieurs à Condillac (cf. Delesalle & Chevalier 1989) : Destutt de Tracy, Domergue, l’abbé Sicard, Silvestre de Sacy, Lhomond, Thiébault, Letellier et Noël & Chapsal. L’analyse logique, dont la valeur est prétendue universelle, se focalise sur les rapports qui s’instaurent entre les idées et elle consiste à décomposer le discours en propositions et les propositions en unités plus petites selon leurs fonctions (dans un premier temps, sujet, copule et attribut), indépendamment du fait qu’elles coïncident ou non avec les classes traditionnelles des mots. Avec l’analyse grammaticale, on pénètre dans les structures particulières de chaque langue, dans les fonctions des mots eux-mêmes et dans les relations entre eux.1
Les exercices d’analyse logique et grammaticale se généralisent en France dans le premier quart du XXe siècle et arrivent en Espagne2 peu de temps après : cette pratique s’enracine au cours de la première moitié du XIXe siècle et elle va s’introduire petit à petit dans les programmes pour finalement s’institutionnaliser en tant que pratique scolaire, comme le montre García Folgado (sous presse). Selon cet auteur, la première mention dans un texte légal de analyse (sans plus de précisions) apparaît dans le Reglamento de Escuelas Públicas de Instrucción Primaria du 26 novembre 1838 ; en 1844, date du début de la « décennie modérée » sous Isabelle II (1844-1854), le vocable figure dans la Guía Lejislativa e inspectiva de instrucción primaria de Laureano Figuerola (1844, p. 103), où l’on ne se contente plus de proposer des exercices d’analyse, mais plus précisément des « exercices d’analyse grammaticale et logique » ; enfin, en 1857 est promulguée la Ley de instrucción pública, ou « Ley Moyano », qui préconise, pour la deuxième période de l’enseignement secondaire, des « Exercices d’analyse, traduction et composition latine et castillane » (Tit. II, art. 15).
Les premiers traités d’analyse font leur apparition en Espagne dans les années 40 du XIXe siècle. Un premier manuel indépendant avait été publié en Espagne, qui était la traduction, faite par un « Amant de la Jeunesse », d’un texte
1 C’est à Domergue que l’on attribue la première différenciation explicite entre ces deux niveaux possibles d’analyse de la proposition. C’est ce qu’affirme Chervel (2006, p. 248-249) : « Ni Beauzée, ni Lhomond ne la mentionnent comme un exercice de réflexion qu’on impose aux élèves. C’est Domergue qui ouvre la voie en 1778. […] Il propose alors, pour la même phrase (Le chantre immortel d’Énée était aussi simple dans ses mœurs que magnifique dans son style), deux analyses différentes : une « analyse logique » (en sujet, copule et attribut), et une « analyse grammaticale » qui décrit les relations que les mots entretiennent entre eux : « Le, modificatif de chantre. Chantre, sujet de la proposition. Inmortel, modificatif de chantre […] ». Son analyse grammaticale est calquée sur l’analyse logique. Alors que celle-ci a pour objet de dégager les trois composantes « logiques » de l’énoncé, l’analyse grammaticale vise non pas à classer les mots dans les différentes rubriques des parties du discours mais à préciser pour chacun d’entre eux son mode d’insertion dans la structure grammaticale de la proposition ».
2 Il convient de ne pas confondre la pratique française de l’analyse et l’« analyse » propre à l’enseignement du latin, depuis longtemps pratiquée comme exercice préalable à la traduction et destinée à l’identification des éléments grammaticaux et à leurs relations au sein de la phrase (cf. Montoro del Arco & García Folgado 2009, p. 143-144).
« LOs problemas matemáticos sOn COMO LOs temas gramaticales »
66
de Letellier qu’il avait intitulé Análisis gramatical y lógica de la lengua francesa (1830) ; en 1840 paraît le Tratado de la descomposición y composición de los periodos considerados por parte de los pensamientos que encierran: o sea del análisis y síntesis lógica de Julián González de Soto ; en 1843, soit quelques années plus tard, sont publiés les deux premiers ouvrages qui mentionnent explicitement ce concept dans leur titre : Análisis lógica y gramatical de la lengua española de Juan Calderón (cf. Calero 2008) et Principios de análisis lójico de Ramón Merino (cf. García Folgado & Montoro 2011). A partir de ce moment, comme l’indiquent les données statistiques fournies par Montoro (2010), le nombre des publications augmente peu à peu durant tout le XIXe siècle et se maintient jusqu’au milieu du XXe. Mais, à l’instar des formulations françaises, les formulations en Espagne ne sont pas homogènes, elles connaissent des variantes multiples, tant terminologiques que conceptuelles, dont certaines ont été mises en évidence par Sinner (2009) et Calero & Zamorano (2010).
3. Les fOndeMenTs MATHéMATiqUes de L’AnALyse LOgiqUe
Comme on l’a dit plus haut, la pratique de l’analyse en grammaire provient, directement ou indirectement, du lien établi entre la logique et les mathématiques. Si le lien entre arithmétique et grammaire était déjà établi depuis longtemps, c’est Thomas Hobbes (1588-1679) qui, le premier, en vient à affirmer que toute opération de notre esprit est calcul. En fait, Hobbes est cité par Destutt de Tracy comme un précurseur de la mise en parallèle du calcul et de la pensée, que d’autres poursuivront.3
Mais le concept de Logique lié à la structure de la pensée va surtout se développer avec Leibniz (1646-1716), pour qui la logique doit devenir, non seulement un ars demonstrandi (logique démonstrative), mais aussi un ars inveniendi, c’est-à-dire une logique inventive ou art combinatoire. Cette dernière, dont Leibniz commence à avoir un aperçu alors qu’il est encore très jeune, constitue une voie nouvelle pour parvenir à la vérité, consistant à décomposer progressivement la pensée en idées de plus en plus simples. C’est ce qu’affirme Velarde Lombraña (1989) :
La idea de esta lógica inventiva le sobrevino a Leibniz de muy joven, a sus 14 años, tras deleitarse leyendo a Zabarella, Rubio, Fonseca, Suárez le llamó la atención el hecho de que las categorías de Aristóteles sirven para clasificar los términos simples, y de aquí le vino la idea –que será el germen de toda su lógica– de preguntar a su profesor por qué no se clasificaban, asimismo, los términos complejos (las proposiciones). Y aunque no recibió satisfactoria respuesta, siguió meditando su idea de una clasificación de las proposiciones, llegando a la consideración de que todas las verdades pueden ser deducidas a partir de un pequeño número de verdades simples mediante el análisis de sus componentes y que, a su vez, todas las ideas pueden ser reducidas por
3 « Des hommes d’un excellent esprit ont saisi avidement la belle idée de Hobbès que calculer c’est raisonner. Ils ont surtout été charmés des beaux développements que Condillac a donnés à cette grande vue, et des rapprochements ingénieux qu’il a faits entre ces deux opérations intellectuelles » (Destutt de Tracy 1805, p. 367).
esTeBAn T. MOnTORO deL ARCO
67
descomposición a un pequeño número de ideas primitivas e indefinibles. La tarea consistirá, pues, en buscar la lista completa de esas ideas primitivas y simples, y luego combinarlas entre sí para obtener, progresivamente, mediante un procedimiento infalible, todas las ideas complejas. Esas ideas simples constituyen el alfabeto de los pensamientos humanos, porque son elementos que entran por combinación en todos los pensamientos (o ideas derivadas), como las letras del alfabeto entran por combinación en todas las palabras o frases del discurso (Velarde Lombraña 1989, p. 189).
Comme on le sait, Leibniz se fonde sur la logique inventive pour imaginer la création d’une langue universelle.4 Son premier projet de langue artificielle repose sur la représentation des idées simples par des nombres premiers, puis celle des idées composées d’idées simples par le produit des nombres premiers respectifs. Ainsi, les nombres premiers sont équivalents aux genres et les multiples des nombres premiers, plus complexes, aux espèces, comme le montre l’exemple suivant (Velarde Lombraña 1989, p. 194) :
6 (especie / n.º complejo) = 2 (género / n.º simple) x 3 (género / n.º simple)
Selon le même schéma, une vérité logique pourrait être représentée par des vérités arithmétiques (multiplication et division) : exprimé comme une proposition, le raisonnement serait composé d’un concept complexe pouvant être décomposé, à son tour, en la multiplication de deux concepts simples :
Verdad lógica: « el hombre es un animal racional »
Hombre (concepto complejo) = animal (concepto simple) x racional (concepto simple)5
L’analyse consiste donc à décomposer tous les concepts en éléments simples au moyen de leur définition. Par la synthèse, à l’inverse, on peut reconstruire tous les concepts en partant de ces éléments simples, grâce à l’art de la combinaison. Ainsi, analyse et synthèse constituent un même parcours aller-retour analogue à celui de la division et de la multiplication. Cette mathématique universelle, ou calculus ratiocinator, est pour Leibniz une méthode applicable à toutes les sciences et le fondement d’une science générale (cf. Couturat & Leau 1903).6
Comme l’indiquent Delesalle & Chevalier (1989, p. 100-103), l’analogie absolue entre le calcul rationnel et les langues naturelles est une idée que va
4 Ce n’est qu’une proposition de langue artificielle parmi les nombreuses initiatives de ce type qui se sont succédé au XVIIe siècle. Pour plus d’information à ce sujet, voir Couturat & Leau (1903, 1907) et Calero (1999).
5 Pour transformer ce calcul logique en une langue, il fallait assigner à chaque idée simple une représentation formelle : au départ, ce sont des chiffres, par exemple « 6 » symbolisant « homme » ; plus tard, ce seront des lettres, dont la combinaison permet de donner une forme linguistique aux idées complexes et d’élaborer un vocabulaire de base ou alphabet des pensées humaines. Le développement de cette technique de décomposition allait aboutir à l’Encyclopédie, en tant que recueil de toutes les connaissances. La recherche sur les calculs logiques a occupé Leibniz toute sa vie durant. Pour un exposé de l’évolution de sa théorie, consulter Velarde Lombraña (1989, p. 166-206).
6 Pour plus d’information sur la représentation de la langue universelle proposée par Leibniz, cf. Couturat & Leau (1903, p. 23-28).
« LOs problemas matemáticos sOn COMO LOs temas gramaticales »
68
développer Condillac (1715-1780), en particulier dans son ouvrage posthume La langue des calculs (1801). On y rencontre des affirmations telles que la suivante :
Qu’on emploie à la solution d’un problème mathématique des signes algébriques, ou des mots, l’opération est toujours la même. Or, si l’opération est mécanique dans un cas, pourquoi ne le seroit-elle pas dans l’autre ? et pourquoi ne le seroit-elle pas encore, lorsqu’on résout une question métaphysique?Certainement calculer c’est raisonner, et raisonner c’est calculer : si ce sont là deux noms, ce ne sont pas deux opérations. Avec des signes algébriques, le calcul et le raisonnement ne demandent presque point de mémoire : les signes sont sous les yeux, l’esprit conduit la plume, et la solution se trouve mécaniquement (Condillac 1801, p. 254).
Condillac établit un rapport d’analogie entre l’arithmétique et les opérations intellectuelles, qui peut se traduire en termes logiques, comme nous le montrons dans le tableau 1.7 L’opération mathématique de la multiplication est vue comme une espèce d’addition, l’opération de la division est interprétée comme une forme de soustraction, de sorte que les opérations se réduisent au nombre de trois :
ARiTHMéTiqUe ALgéBRiqUe
OPéRATiOns inTeLLeCTUeLLes
AnALOgUesC’esT-à-diRe… [AnALyse LOgiqUe]
Addition Conclure du particulier au général
« de plusieurs propositions particulières tirer une proposition générale »
Soustraction Conclure du général au particulier
« d’une proposition générale tirer une proposition particulière »
Substitution(/traduction d’expression)
Substituer des expressions équivalentes
« d’une proposition quelconque déduire d’autres propositions qui n’augmentent ni ne diminuent d’étendue »
Tableau 1. L’hypothèse de Condillac (1801), inspirée de Desttut de Tracy (1805)
Les disciples de Condillac ont repris et renforcé cette analogie, non sans montrer parfois leur désaccord. Ainsi, Destutt de Tracy déclare, dans ses Éléments d’idéologie (1801-1815, p. 368), que, même si calcul et raisonnement sont extrêmement proches, il n’existe pas entre eux de rapport exact ou spéculaire ; la science de la quantité est bien la plus parfaite et la plus précise, et elle est en grande partie applicable à l’analyse des opérations du langage ; mais, poursuit
7 Nous nous sommes appuyé sur la présentation que fait Destutt de Tracy des idées de Condillac, son maître : « En conséquence ils ont remarqué que la multiplication n’étant qu’une espèce d’addition, et la division une espèce de soustraction, on ne devait admettre dans l’arithmétique algébrique que trois opérations réellement distinctes, l’addition, la soustraction, et la substitution ou traduction d’expression ; et ils ont établi qu’il fallait reconnaitre dans le raisonnement trois opérations absolument analogues à celles-là, et qui leur répondaient exactement : savoir, 1º. Conclure du particulier au général, c’est-à-dire de plusieurs propositions particulières tirer une proposition générale, ce qu’ils appellent additionner ; 2º. Conclure du général au particulier, c’est-à-dire d’une proposition général tirer une proposition particulière, ce qu’ils nomment soustraire ; 3º. D'une proposition quelconque déduire d’autres propositions qui n’augmentent ni ne diminuent d’étendue, ce qui n’est autre chose, suivant ces auteurs, que traduire l’expression de la première proposition, et lui substituer des expressions équivalentes » (Destutt de Tracy 1805, p. 367-368).
esTeBAn T. MOnTORO deL ARCO
69
Destutt, le langage exprime aussi des valeurs ambiguës dont ne sauraient rendre compte les mathématiques.
Quoi qu’il en soit, dans le Programme d’études établi par Destutt pour les Écoles centrales (Rapport du 16 pluviôse an VIII), et au titre du lien intime qui relie la logique, la grammaire et les mathématiques, la place des mathématiques est parallèle à celle de la grammaire générale. Ces deux disciplines font partie de la troisième année d’études et elles sont conçues comme des instruments essentiels pour la compréhension de toute autre science et, en général, pour la découverte de la vérité :
Langues et belles-lettres
Sciences physiques et mathématiques
Sciences idéologiques, morales et politiques Années
Notions élémentaires de latin et de français
Notions élémentaires de calcul
1ère année
Suite des mêmes Notions élémentaires de géographie physique et d’histoire naturelle
Notions élémentaires de géographie politique et historique
2e année
Cours de latin et de grec
Cours de mathématiques pures
Cours de grammaire générale
3e année
Suite du même Suite du même Suite du même 4e annéeSuite du même Cours d’histoire naturelle et
de chimieCours de morale et législation
5e année
Tableau 2. Programme des études pour les Écoles centrales (repris de Delesalle & Chevalier 1986, p. 156)
Il en va de même en Espagne : ainsi, concernant la répartition des cours proposée par Laureano Figuerola dans Guía Legislativa e inspectiva de 1844, les deux disciplines constituent, à côté de la lecture et de l’écriture (ainsi que de la religion), les matières fondamentales de l’enseignement :
1ª división 2ª división 3ª división
Instrucción moral y religiosa
Oraciones. Historia Sagrada.Catecismo.
Catecismo. Historia sagrada. Nuevo Testamento
Lectura Alfabeto, sílabas y palabras usuales. Lectura de corrido. Lectura en impresos y
manuscritos.
Escritura En pizarras. En cartapacios. En papel blanco.
AritméticaContar de palabra, tablas de sumar y multiplicar, conocer los guarismos.
Numeración escrita. Tablas. Las cuatro reglas simples.
Fracciones comunes y decimales. Reglas de denominados. Pesos y medidas del Reino.
Gramática Pronunciación correcta. Ortografía teórica y práctica.
Analogía, sintaxis, análisis gramatical y lógico; composiciones.
Tableau 3. Guía Legislativa e Inspectiva de L. Figuerola (repris de García Folgado & Montoro 2011)
Mathématiques et grammaire convergent donc pour découvrir la vérité et la transmettre aux autres disciplines ; de cette rencontre surgit également une fonction « thérapeutique » : le lien entre les deux contribue à compenser les déficiences respectives, car les sciences, du fait de leur pratique continue au fil du temps, sont
« LOs problemas matemáticos sOn COMO LOs temas gramaticales »
70
susceptibles de développer leurs propres vices. De sorte que les deux disciplines ne sont pas seulement concordantes, elles sont nécessairement complémentaires en vue du perfectionnement de la science générale et de notre compréhension de la réalité ; un exemple nous en est donné par F. Lacroix, professeur de mathématiques à l’École centrale des Quatre Nations :
Chaque science ayant reçu de la nature de son objet, de son origine et de ses premiers développements, un mode de raisonnement souvent vicieux en quelque point et presque toujours trop particulier, ce n’est que dans leur ensemble qu’on peut espérer de trouver toutes les circonstances qui se rencontrent dans la conduite de nos méditations, et qui sont les matériaux nécessaires pour arriver, par abstraction, à la connaissance de la marche de notre entendement (S. F. Lacroix 1805 : Essais sur l’enseignement en général et sur celui des mathématiques en particulier, p. 28 ; cité par Delesalle & Chevalier, 1986, p. 117).
En conséquence, le transfert de concepts et de termes de la logique à la grammaire est particulièrement fécond au XIXe siècle ; il provoque une véritable révolution de la syntaxe, laquelle, d’abord entendue comme un ensemble de relations planes entre les mots (limitées aux concepts de régime et concordance), va progressivement être considérée sous l’angle pluridimensionnel, quand apparaissent les fonctions et leur hiérarchie ainsi que les relations supra-phrastiques (Calero 2008, p. 12). Nombreux sont les termes introduits alors qui se sont maintenus jusqu’à aujourd’hui et qui sont considérés comme des technicismes de la grammaire malgré leur origine « logique » : proposition, sujet, attribut, complément, propositions principales, incidentes, déterminatives, explicatives, subordonnées, etc.
Mais il y eut aussi une série de termes, issus des mathématiques et introduits dans la grammaire à travers le filtre logique, qui sont passés quasiment inaperçus. Par exemple, les concepts de « complexe » et « incomplexe », qui apparaissent presque systématiquement dans les traités d’analyse logique et grammaticale du XIXe siècle, constituent, comparés aux précédents, de véritables nécrologismes grammaticaux car ils sont tombés en désuétude.8
4. LA CLAssifiCATiOn des éLéMenTs de LA PROPOsiTiOn
4.1. Premières formulations dans les grammaires
Rappelons qu’avec l’introduction des concepts de la logique, le mot cesse d’être le centre de la description et les classes de mots deviennent des éléments
8 Les concepts de « nécrologisme » et « nécrologie » ont été récemment employés dans le cadre de la terminologie par certains auteurs : Dury & Drouin (2011), par exemple, les définissent comme suit : « We define necrology as the disappearance of a term, the disappearance of a part of term, a change in grammatical status, and/or the disappearance of a meaning over a given period of time. Neologisms which have failed to stabilize in a lexicon, and have thus disappeared from it are also considered as necrologisms. We also keep in mind that a term can disappear from a specialized lexicon over a given period of time, and is therefore considered, for the period involved, as a necrologism even if it may reappear in the same lexicon at a later time period, with a new or altered meaning » (Dury & Drouin 2011, p. 19).
esTeBAn T. MOnTORO deL ARCO
71
de la proposition relégués au dernier niveau de l’analyse linguistique, le niveau grammatical, précédé d’une analyse logique qui considère en premier lieu la phrase ou la proposition :
288. – Il y a dans une phrase autant de propositions qu’il y a de verbes à un mode personnel. Ainsi dans cette phrase : la défiance blesse l’amitié, le mépris la tue, il y a deux verbes à un mode personnel : blesse, tue, il y a conséquemment deux propositions. […]
289. – La proposition, considérée grammaticalement, a autant de parties qu’elle a de mots. Considerée logiquement, elle n’en contient que trois: le sujet, le verbe et l’attribut (Noël & Chapsal 381845, 94, c’est nous qui soulignons).
La division première de la phrase (proposition) en trois constituants (sujet/verbe/attribut) ou en deux (sujet/attribut) suppose, en définitive, de prendre en compte les unités plus grandes que le mot, lesquelles peuvent être complexes ou composées à leur tour d’autres unités. En poursuivant l’analyse logique particulière du sujet et de l’attribut, ces grammairiens font appel à une nouvelle opération de décomposition reposant sur deux oppositions : simple/composé et complexe/incomplexe.
Dans le chapitre IX de la Grammaire de Port Royal (Arnauld & Lancelot 1660), consacré aux relatifs (« Du pronom appellé Relatif »), les termes de la proposition (sujet et attribut) sont classés comme simples ou complexes, de la manière suivante :
On ne peut bien entrendre cecy, qu’on ne se souvienne de ce que nous avons dit dés le commencement de ce discours : qu’en toute proposition il y a un sujet, qui est ce dont on affirme quelque chose, et un attribut, qui est ce qu’on affirme de quelque chose. Mais ces deux termes peuvent être ou simples, comme quand je dis: Dieu est bon ; ou complexes, comme quand je dis : Un habile magistrat est un homme utile à la république. Car ce dont j’affirme n’est pas seulement un magistrat, mais un habile magistrat : et ce que j’affirme n’est pas seulement qu’il est homme, mais qu’il est homme utile à la république (Arnauld & Lancelot 1660, p. 67).
Et, dans la Logique, ou l’Art de penser (Arnauld 1662), publié deux ans plus tard, est rajouté aux deux autres le qualificatif composé. Dans la classification des propositions sont employés trois des quatre termes qui forment la double opposition : a) les propositions simples sont celles qui n’on qu’un sujet et qu’un attribut ; b) les propositions composées sont celles qui possèdent plus d’un sujet ou plus d’un attribut (par exemple, « Les biens et les maux viennent du Seigneur »9 ; enfin, c) les propositions complexes sont celles dont le sujet ou l’attribut sont un terme complexe qui renferme d’autres propositions ; on propose d’appeler ces dernières « incidentes » car elles ne sont qu’une partie du sujet ou de l’attribut auquel elles sont reliées par le pronom relatif « que » ou « qui » : par exemple, la séquence « Celuy qui fera la volonté de mon Père qui est dans le ciel entrera dans le
9 « Nous avons dit que toute proposition doit avoir au moins un sujet et un attribut; mais il ne s’ensuit pas de là qu’elle ne puisse avoir plus d’un sujet et plus d’un attribut. Celles donc qui n’ont qu’un sujet et qu’un attribut s’appellent simples, et celles qui ont plus d’un sujet ou plus d’un attribut s’appellent composées, comme quand je dis : Les biens et les maux, la vie et la mort, la pauvreté et les richesses viennent du Seigneur ; cet attribut venir du Seigneur, est affirmé, non d’un seul sujet, mais de plusieurs, savoir : des biens et des maux, etc. » (Arnauld 1662, p. 133).
« LOs problemas matemáticos sOn COMO LOs temas gramaticales »
72
royaume des cieux » (Arnauld 1662, p. 134), où le sujet de la proposition contient deux propositions introduites par « qui ».
Dans cette classification des propositions sont confondus deux critères : a) le nombre de sujets/attributs (entendu comme coordination de deux éléments) pour l’opposition simple/composé ; et b) l’existence d’un rapport de détermination, soit dans le sujet soit dans l’attribut, opposant les propositions complexes aux simples et aux composées. Cette opposition, présentée sur un même plan, devient exclusive (elle implique que les trois options sont en distribution complémentaire), ignorant la possibilité qu’une proposition soit composée et complexe en même temps.
Avec l’introduction de la notion de complément, créée par Du Marsais et développée ensuite par les Idéologues (notion qui vient remplacer celle de régime)10, on commence à appliquer ces concepts non plus seulement aux propositions mais aussi aux sujets et aux attributs. Du Marsais (1769, p. 229-235) établit quatre types de sujet : le concept de nombre n’est plus directement associé à la coordination de deux sujets ou de deux attributs comme dans la Logique de Port Royal, mais à la « quantité de mots » que contiennent chaque sujet ou chaque attribut11 :
TyPe exPLiCATiOn exeMPLes
Sujet simple
« tant au singulier qu’au pluriel ; énoncé en un seul mot »
Le soleil est levé.Les arbres brillent.
Sujet multiple
« C’est lorsque pour abréger, on donne un attribut commun à plusieurs objets différens »
La foi, l’espérance & la charité sont trois vertus théologales.
Sujet complexe
« Ce mot complexe vient du latin complexus, qui signifie embarassé, composé. Un sujet est complexe, lorsqu’il est accompagné de quelqu’adjectif ou de quelqu’autre modificatif »
Alexandre, fils de Philippe vainquit Darius.Alexandre, roi de Macédoine vainquit Darius.
Sujet énoncé par plusieurs mots qui forment un sens total, & qui sont équivalents à un nom
Différer de profiter de l’occasion, c’est souvent la laisser échapper sans retour.C’est un grand art, de cacher l’art.Bien vivre, est un moyen sûr de désarmer la médisance.Il vaut mieux être juste, que d’être riche ; être raisonnable, que d’être savant.
Tableau 4. Classification du sujet (Du Marsais 1769)
Le sujet simple est défini comme un sujet qui ne contient qu’un mot, car l’on considère que la présence d’un seul mot signifie l’existence d’un sujet unique ; le sujet multiple est défini comme celui qui se compose de plusieurs sujets
10 « Au cours des années 1780, le complément, qui est resté confidentiel après son invention par Dumarsais et son perfectionnement par Beauzée, pénètre grâce à Domergue dans l’enseignement grammatical, en association étroite avec la “ proposition” » (Chervel 2006, p. 231).
11 Afin de ne pas alourdir la démonstration, nous donnerons ci-dessous des exemples concernant le sujet, mais nos affirmations seront tout aussi applicables à l’attribut, sauf indication contraire. Les sujets des exemples figurent en italique.
esTeBAn T. MOnTORO deL ARCO
73
correspondant à un même prédicat (ce qui, traduit en termes logiques, suppose l’existence implicite de plusieurs propositions simples). Pour le sujet complexe, une confusion terminologique apparaît entre complexe et composé, qui sont considérés comme des synonymes : il consiste en un sujet simple qui toutefois s’accompagne d’un adjectif ou de tout autre déterminant (modificatif). La différence entre sujet multiple et sujet complexe repose sur l’existence respective d’un rapport d’identité (rapport d’identité, qui remplace le rapport de concordance) ou de détermination (rapport de détermination, qui remplace celui de régime) :
[…] Observez que lorsque le sujet est complexe, on dit que la proposition est complexe ou composée L’attribut peut aussi être complexe. Si je dis, qu’Alexandre vainquit Darius, roi de Perse, l’attribut est complexe : ainsi la proposition est composée par raport [sic] à l’attribut. Une proposition peut aussi être complexe, par raport [sic] au sujet, & par rapport à l’attribut (Du Marsais 1769, p. 231).
La référence à « plusieurs mots » pour définir un certain type de sujet apparaît dans la quatrième catégorie ; on ne donne pour exemples que les occurrences où le sujet est un infinitif lequel, à ce titre, comporte des compléments associés. Dans ce dernier cas, cette référence à plusieurs mots est un recours qui permet peut-être d’identifier un ensemble de mots sans pour autant identifier le sujet comme tel (le noyau, dans notre perspective actuelle).
Par conséquent, aux deux critères utilisés par la grammaire de Port Royal pour classer les propositions, – a) nombre de sujets/attributs, selon un rapport d’identité ; b) rapport de détermination à l’intérieur du sujet ou de l’attribut – vient maintenant s’en ajouter un autre : c) le nombre de mots qui les véhiculent (un/plusieurs).
C’est Beauzée (1767) qui, selon nos informations, semble avoir introduit le concept incomplexe (Chervel 2006, p. 226). Et il le fait, croyons-nous, pour résoudre l’opposition logique des deux critères qui, au fond, s’opposaient : l’existence d’un sujet unique et l’existence d’un rapport de détermination au sein du sujet. Dans le chapitre « Élémens de la Syntaxe » (p. 10 et suiv.) de sa Grammaire générale, ce grammairien critique précisément la terminologie employée par Du Marsais, qu’il admire par ailleurs :
Ce que j’appelle ici sujet composé, M. du Marsais le nomme sujet multiple ; & c’est, dit-il, lorsque, pour abréger, on donne un attribut commun & plusieurs objets différents.
Malgré l’exactitude ordinaire de ce savant grammairien, j’ose dire que l’assertion dont il s’agit est une définition fausse ou du moins hasardée puisqu’elle peut faire prendre pour sujet multiple ou composé un sujet réellement simple (Beauzée 1767, p. 11-12).
Pour Beauzée, la différence entre simple et composé ne repose pas nécessairement sur la présence formelle d’un ou de plusieurs mots, comme chez Du Marsais, mais sur l’existence d’une seule idée (simple) ou de plusieurs idées combinées (composé), indépendamment du nombre de mots qui les véhiculent :
Un sujet simple, dit-il [Du Marsais], est énoncé en un seul mot ; Le sOLeiL est levé, sujet simple au singulier ; Les AsTRes brillent, sujet simple au pluriel.
« LOs problemas matemáticos sOn COMO LOs temas gramaticales »
74
Au reste cette définition n’est pas plus exacte que celle du sujet multiple ou composé. Pour s’en convaincre, il ne faut que se rappeler les exemples que j’ai cités de sujets simples : aucun de ceux qui sont énoncés en plusieurs mots n’est destiné à réunir plusieurs objets différents sous un attribut commun, comme l’exige notre grammairien ; aucun d’eux n’est donc un sujet composé ou multiple, & chacun d’eux par conséquent est un sujet simple. C’est qu’en effet la simplicité du sujet dépend & doit dépendre, non de l’unité du mot qui l’exprime, mais de l’unité de l’idée qui le détermine (Beauzée 1767, 12).
Par cette précision, Beauzée semble opérer une distinction que connaît le domaine de l’arithmétique, plus précisément la théorie des nombres complexes, qui figure déjà fréquemment dans les cours et les traités mathématiques, tel le Cours de mathématique de M. Camus (1753) :
Les quatre Opérations de l’Aritmétique se font sur des nombres incomplexes, ou sur des nombres complexes.
Les nombres incomplexes sont ceux qui n’ont qu’une unité principale, comme la livre tournois, la toise & toute autre unité qui serait ou arbitraire ou établie par l’usage.
Les nombres complexes sont ceux qui ont plusieurs unités principales différentes, & qui devraient plutôt être appellés sommes que nombres, parce qu’un nombre est la collection de plusieurs unités égales.
Par exemple, la somme composée de 8 livres, de 8 sols & de 8 deniers, est un nombre complexe ; celle de 50 toises & de 5 pieds, est pareillement un nombre complexe, parce que ces deux sommes sont composées de nombres qui ont différentes unités principales (Camus 1753, p. 27-28).
Les nombres sont donc complexes parce qu’ils se composent d’unités qui correspondent à différentes unités de mesure, en l’occurrence de monnaie (la livre de Tours) ou de longueur (la toise). Il est essentiel que les termes de l’addition soient d’« espèces » différentes car ce n’est qu’à cette condition que l’on peut interpréter l’existence de plusieurs attributs dans l’explication logique :
On appelle nombre complexe tout nombre concret (nº 2) qui est décomposé en plusieurs parties rapportées respectivement à des unités différentes ; et par opposition, celui qui est rapporté à une seule espèce d’unité, s’appelle nombre incomplexe (Bourdon 1837, p. 93).
L’expression formelle d’un nombre en différents mots n’est qu’un corollaire des différentes espèces dans les termes de l’addition (ex. « 8 livres, 8 sols et 8 deniers »). Il en va de même du sujet, qui peut représenter une seule idée tout en étant composé formellement de plusieurs éléments. À cet égard, Beauzée s’efforce de donner une explication précise de la différence entre sujet incomplexe et sujet simple, car, bien qu’ils puissent figurer tous deux dans un même exemple, il existe une différence qui repose sur la distinction entre forme et contenu. Le sujet simple représente une idée unique, même si elle est exprimée par divers éléments coordonnés, tandis que le sujet incomplexe est formé d’une seule espèce de constituants :
En effet il [Du Marsais] définit de suite le sujet simple, le sujet multiple, que j’appelle composé, & le sujet complexe ; sans en opposer aucun à ce dernier. Il y a cependant une très-grande différence entre le sujet simple & l’incomplexe.
esTeBAn T. MOnTORO deL ARCO
75
Le sujet simple doit être déterminé par une idée unique, voilà son essence ; mais il peut être ou n’être pas incomplexe, parce que son essence est indépendante de l’expression, & que l’idée unique qui le détermine peut être ou n’être pas considérée comme le résultat de plusieurs idées subordonnées, ce qui donne indifféremment un ou plusieurs mots. Au contraire l’essence du sujet incomplexe tient tout à fait à l’expression ; puisqu’il ne doit être exprimé que par un mot. Il est vrai que le sujet incomplexe est nécessairement simple, parce qu’un mot n’exprime qu’une idée unique : mais cela n’est pas suffisant pour confondre l’une avec l’autre, parce qu’une idée unique pouvant s’exprimer par plusieurs mots, on ne peut pas dire réciproquement qu’un sujet simple soit nécessairement incomplexe (Beauzée 1767, p. 14).
En définitive, grâce à l’application, directe ou indirecte, de la théorie arithmétique des nombres complexes, nous nous trouvons devant un système de caractérisation logique du sujet (ainsi que de l’attribut) reposant sur deux critères distincts, qui perfectionne considérablement, en grammaire, l’analyse logique des éléments de la proposition (Tableau 5) :
siMPLe
Dieu est éternel.Les hommes sont mortels.La gloire qui vient de la vertu a un éclat immortel.Les preuves dont on appuye la vérité de la religion chrétienne sont invincibles. Croire à l’Évangile et vivre en païen est une extravagance inconcevable. [Sujet apparemment composé mais, au fond, simple puisqu’il représente une idée unique malgré le nombre de mots]
COMPOsé La foi, l’espérance, & la charité sont trois vertus théologales.
inCOMPLexe
Dieu est éternel.Les hommes sont mortels.Nous naissons pour mourir.Dormir est un temps perdu.
COMPLexe(rapport d’identité ou de détermination)
Les livres utiles sont en petit nombre.Les principes de la morale méritent attention.Vous qui connoissez ma conduite jugez-moi.Craindre Dieu est le commencement de la sagesse.
Tableau 5. Classification du sujet (Beauzée 1767)
Les éléments se caractérisent maintenant par la double opposition simple/composé, incomplexe/complexe. Dans le tableau suivant (6) nous présentons une analyse des mêmes exemples selon Du Marsais et selon Beauzée, afin de faire apparaître clairement la plus grande précision du second :
dU MARsAis BeAUzéeLe soleil est levé. simple simple incomplexeLa foi, l’espérance & la charitésont trois vertus théologales. multiple composé incomplexe
Alexandre, fils de Philippe, vainquit Darius. complexesimple complexe
C’est un grand art, de cacher l’art. énoncé par plusieurs mots […]
Tableau 6. Classifications du sujet (Du Marsais 1769 et Beauzée 1767)
« LOs problemas matemáticos sOn COMO LOs temas gramaticales »
76
Pour autant, le système proposé par Beauzée n’est pas exempt d’une certaine complexité théorique qui pourrait compliquer l’analyse. Arrêtons-nous, par exemple, sur l’énoncé « Croire à l’Évangile et vivre en païen est une extravagance inconcevable » (tableau 5). Le sujet consiste ici en deux structures phrastiques coordonnées, chacune d’elles possédant un complément. Beauzée y voit un sujet simple, puisque chacun des constituants de ce sujet, séparément, ne saurait s’accompagner du même attribut :
*Croire à l’Évangile est une extravagance inconcevable.
*Vivre en païen est une extravagance inconcevable.
Sachant qu’il existe un rapport de détermination dans chacune des deux parties (mais il en irait de même s’il n’existait que dans une partie), ce sujet devrait être considéré comme complexe (nous disons « devrait » parce qu’il ne l’est pas). Aussi est-il important de tenir compte de la fonction du complément :
Un terme ne devient donc pas complexe pour être ajouté à un autre, qui est nécessaire pour en déterminer la signification incertaine et vague par elle-même ; il ne devient complexe que quand on ajoute à ce terme même d’autres mots qui en changent ou qui en complettent la signification ; et c’est une addition de cette espèce que l’on appelle complément (Beauzée 1767, p. 18).
Toutefois, ce système, si exact en apparence, au sein duquel chaque combinaison est précisément identifiée (simple et incomplexe ; simple et complexe ; composé et incomplexe ; composé et complexe), ignore, en réalité, cette possibilité ainsi que d’autres nombreuses, pour lesquelles ces traités ne donnent aucune solution : par exemple, le sujet d’un énoncé tel que « Mirar y callar es lo único que tienes que hacer » devrait être considéré comme simple, dans la mesure où il se comporte comme « Croire à l’Évangile et vivre en païen », et incomplexe, puisqu’aucun de ses éléments ne possède de complément ; mais il est nettement différent du sujet de l’énoncé « Le soleil est levé », lui aussi caractérisé comme simple et incomplexe par Beauzée. Beauzée n’envisage pas non plus le cas où l’un des constituants d’un sujet composé serait incomplexe et l’autre complexe : « Mirar y callar prudentemente es lo único que tienes que hacer ».
En somme, la classification des éléments de la proposition n’est que le reflet d’une distinction mathématique ; mais les langues vont au-delà du schéma logique proposé. Les inconsistances théoriques comme celle-ci ont vraisemblablement soulevé des problèmes lorsqu’il a fallu les adapter plus tard aux dispositifs scolaires, tant chez les grammairiens français que chez les espagnols.
4.2. Distinction dans les traités d’analyse logique et grammaticale
Par la suite, les grammairiens français reprennent cette distinction tout naturellement. Par exemple, c’est ainsi que la présentent Noël & Chapsal, dont la Nouvelle Grammaire Française (1823) fut largement diffusée, si l’on en juge par le nombre d’éditions (un total de 80, cf. Calero 2008, p. 18 et Sinner 2009, p. 433) :
301. – Le sujet et l’attribut sont simples ou composés, incomplexes ou complexes.
302. – Le sujet est simple, quand il n’exprime qu’un seul être ou des êtres de même espèce pris collectivement : la vertu est préférable aux richesses, et cependant Les RiCHesses lui sont souvent préférées.
esTeBAn T. MOnTORO deL ARCO
77
303. – Le sujet est composé, quand il exprime des êtres que ne sont pas de la même espèce : La Foi, l’Espérance et la Charité sont des vertus théologales.
304. – L’attribut est simple, quand il n’exprime qu’une manière d’être du sujet : Le ciel est pur.
305. – L’attribut est composé, lorsqu’il exprime plusieurs manières d’être du sujet : Dieu est juste et tout-puissant.
306. – Le sujet et l’attribut sont incomplexes, quand ils ont par eux-mêmes une signification complète, c’est-à-dire, quand ils n’ont aucune espèce de complément : Le soleil est lumineux. – La terre tourne, c’est-à-dire, la terre est tournant.
307. – Le sujet et l’attribut son complexes, lorsqu’ils n’offrent une signification complète qu’à l’aide d’un ou de plusieurs compléments : Une mauvaise conscience n’est jamais tranquille. La gloire de l’homme consiste dans la vertu. Servir Dieu est le premier de nos devoirs. Dieu, qui est juste, récompensera les bons. Les honnêtes gens sont ceux qui sacrifient leur intérêt particulier à l’intérêt général (Noël & Chapsal 381845, p. 97-98).
On trouve déjà dans ce manuel de nombreux exercices d’entraînement à l’analyse de la proposition, mais, curieusement, presque tous les sujets donnés dans les exemples sont simples (incomplexes ou complexes), et l’on parle très peu des sujets composés. Une exception, cependant, que nous tenons à souligner : l’exercice III, seule occurrence destinée à identifier les quatre possibilités :
siMPLe inCOMPLexe L’oreille est le chemin du cœur.
siMPLe COMPLexe
La vrai courage est prudent.Le bonheur des honnêtes gens est pur et durable.Le désir de plaire est naturel.Celui de dominer est absurde.S’occuper est jouir.Agir avec réflexion est le fait du sage.Se glorifier de ses fautes est les aggraver.
COMPOsé inCOMPLexe La vertu et le génie assurent l’immortalité.
COMPOsé COMPLexeL’amour des richesses et la soif des honneurs éloignent l’homme de la vertu.La sagesse et la puissance infinies de Dieu excitent en nous la plus vive admiration.
Tableau 7. Classification du sujet (Noël & Chapsal 381845)
Reprenant le manuel de Lhomond (1780), Charles Constant Letellier (1805) l’adapte à l’enseignement secondaire. Dans la 12e édition de son ouvrage (1811), Letellier applique un plan plus méthodique et introduit des éléments nouveaux. Un auteur anonyme, qui se présente comme un « Amant de la Jeunesse », traduit ce traité vers l’espagnol, l’intitulant Análisis gramatical y lógica de la lengua francesa (1830). Il s’agit là, comme nous l’avons dit plus haut, du premier traité d’analyse logique et grammaticale dont nous ayons connaissance en Espagne. Consultant directement cette source, nous trouvons bien les concepts de « complexe » et « incomplexe ». Si l’ensemble des sujets donnés en exemples comporte des lacunes (il y manque les sujets composés complexes), il n’en va pas de même pour les attributs, ce qui montre que l’auteur connaît et applique la distinction :
« LOs problemas matemáticos sOn COMO LOs temas gramaticales »
78
eLeMenTO CLAsifiCACión eJeMPLOs
Sujetosimple
incomplejo Dios es justo.Los hombres son mortales.
complejoUna mala conciencia nunca está tranquila.Los males de que nos compadecemos alivian los nuestros.
compuesto El ejercicio y la dieta son útiles para la salud.
Atributosimple
incomplejo Estoy contento.
complejo Un infeliz llamaba todos los días [a] la muerte en su socorro.
compuestoincomplejo Sa taille était haute et majestueuse.complejo Son teint était encore frais et vermeil.
Tableau 8. Classification du sujet et de l’attribut (Anonyme 1830)
Que l’on sache, le manuel d’analyse suivant paraît dix ans plus tard : Tratado de la descomposición y composición de los periodos de González de Soto (1840). Et l’on y rencontre des affirmations surprenantes, telles que la suivante : « El sugeto y el atributo compuestos siempre son complecsos » (González de Soto 1840, p. 6), par laquelle est directement éliminée l’opposition incomplexe/complexe pour les sujets composés :
eLeMenTO CLAsifiCACión eJeMPLOs
Sujetosimple
incomplejoSalomón fue sabio.[Autres exemples : Zaragoza, El bosque, Tres negros, Mi Padre, Todo hombre, Cada bicho]
complecsoLos habitantes de las montañas de Cataluña son gente honrada.El hombre de bien.
compuesto complecso Dios y los hombres detestan al soberbio.
Atributo simple incomplecso La virtud es amable.complecso El niño obediente es querido de sus padres.
compuesto complecso Cristo murió por los buenos y por los malos.
Tableau 9. Classification du sujet et de l’attribut (González de Soto 1840)
On est donc en présence : soit d’une simplification, peut-être motivée par le caractère nettement scolaire de l’ouvrage comparé à d’autres, soit d’une confusion ou d’une erreur d’adaptation des sources consultées.
Dans la première édition de Análisis lójico de Ramón Merino (1843), seule figure l’opposition simple/composé (tant pour le sujet que pour l’attribut, et, par extension pour la proposition) ; on y trouve cependant mention des compléments, dont l’existence définit, comme on l’a vu, les sujets ou les attributs complexes (par opposition aux incomplexes) :
COMPLeMenTOs de sUgeTO y ATRiBUTO. Al decir: los habitantes perecieron, cualquiera que nos oiga podrá preguntarnos ¿qué habitantes perecieron? Esto prueba que no está completamente espresado el pensamiento, como efectivamente sucede, pues lo que tratamos de manifestar es: que los habitantes de Orihuela perecieron.
esTeBAn T. MOnTORO deL ARCO
79
Las palabras de Orihuela, que completan el sugeto los habitantes, forman un complemento del sugeto. Asi pues, se llama complemento del sugeto la palabra ó palabras que sirven para completar su sentido (Merino 1843, p. 18).
Cela nous conduit à supposer que l’auteur n’avait pas, à ce moment-là, connaissance de la traduction du traité de Letellier par l’anonyme « Amant de la Jeunesse » (« Amante de la Juventud »). En revanche, il applique la distinction dans la deuxième édition de son traité (1848) ; non pas toutefois dans le corps de l’ouvrage, mais directement dans les exercices d’analyse proposés et pour caractériser les propositions en général, mais non leurs éléments constituants (sujet et attribut).
Pour sa part, Calderón (1843) rappelle la différence entre complexe/incomplexe dans la partie doctrinale de son ouvrage et il propose des exemples au fil de ses explications. Mais il reprend le concept formel du nombre de mots, vu chez Du Marsais, pour rendre compte du sujet « incomplexo » (ainsi que la catégorie de sujet multiple du même auteur, qu’il désigne comme « múltiplo ») :
Cuando el sugeto ó el atributo se halla enunciado con una sola palabra, se llama incomplexo; mas si se halla expresado con muchas, que le explican ó le determinan, sin hacerle por eso múltiplo, se llama complexo. Hay que advertir que ni el simple artículo, que precede al nombre ó á la palabra que hace sus veces, ni el verbo ser, que precede al atributo, ni el verbo haber auxiliar, que acompaña al verbo, hacen al sugeto ó al atributo complexo. Así, la villa fue fundada, es una proposición con sugeto y atributo simples é incomplexos; pero en la proposición de Solís [« Esta villa, que empieza hoy á crecer al abrigo de vuestro gobierno, se ha fundado en tierra no conocida y de grande población »], sugeto y atributo, aunque simples, son complexos.
[…] Estas denominaciones han pasado también a la proposición, la cual toma el nombre de simple o compuesta, de complexa ó incomplexa, según que su sugeto o su atributo tiene alguna de estas cualidades (Calderón 1843, p. 27-28).
Par ailleurs, tous les exemples présentent des sujets simples (complexes ou incomplexes) et aucun ne comporte de sujets composés (il en va de même pour les attributs) :
eLeMenTO CLAsifiCACión eJeMPLO
Sujeto
simple12 incomplejo La envidia es vicio sin deleite.Los estados no se pueden recuperar sin ella.
simple complejo
Esta villa, que empieza hoy á crecer al abrigo de vuestro gobierno, se ha fundado en tierra no conocida y de grande población.Tan alta es esa virtud que aun los más altivos quieren levantarse con ella.
compuesto incomplejocompuesto complejo
Tableau 10. Classification du sujet (Calderón 1843)12
12 Calderón (1843, p. 27) donne un exemple dans lequel le sujet est simple bien qu’apparemment composé (« Prometer mucho y dar poco es cosa muy común »), comme le fait Beauzée (« Croire à l’Évangile et vivre en païen est une extravagance inconcevable », cf. tableau 5). L’exemple sert à illustrer le concept de sujet simple mais l’auteur ne le reprend pas pour illustrer l’opposition sujet incomplexe/complexe, de sorte que, comme chez Beauzée, nous ne savons pas quelle serait la caractérisation complète du sujet.
« LOs problemas matemáticos sOn COMO LOs temas gramaticales »
80
En résumé, la classification des éléments de la proposition obéit à un jeu de deux oppositions (simple/composé ; incomplexe/complexe) répondant cependant à trois critères : a) nombre de sujets/attributs (coordonnés) ; b) nombre de mots dans le sujet/attribut (un/plusieurs) ; c) existence d’une relation de détermination au sein du sujet ou de l’attribut. Si, d’un côté, ces oppositions présentent l’inconvénient d’être hyper-caractérisées (deux oppositions répondant à trois critères), d’un autre côté, le recours à des sources françaises diverses, l’éventuelle inconsistance théorique de ces oppositions, leur interprétation erronée, ou encore une simplification motivée par des questions didactiques, tout cela a provoqué une adaptation déficiente de ces concepts au cadre espagnol ; c’est cette mauvaise adaptation qui pourrait être à la base de l’abandon de ces oppositions par les grammairiens.
5. Les RePRésenTATiOns ARiTHMéTiqUes de L’AnALyse LOgiqUe Nous allons rapidement aborder un second point qui a influencé la grammaire espagnole du XIXe siècle grâce, en grande partie, au lien existant entre grammaire et arithmétique. L’un des aspects qui caractérise toutes les grammaires conçues pour l’analyse logique est, comme on l’a vu, la présence d’exercices liés aux éléments théoriques exposés. Même s’ils varient quant à l’espace consacré aux exercices ou au nombre d’exemples analysés, les premiers traités suivent un modèle commun : est d’abord présenté un texte qui doit être analysé (dont la longueur et la difficulté augmentent au fil des chapitres) ; puis, on tente de donner une « forme logique » au texte en question en ordonnant les propositions dont il se compose, en récupérant les verbes élidés, etc. ; ensuite, on détermine les relations entre ces propositions (selon qu’elles sont principales, incidentes, etc.) ; enfin, on délimite et on classe (comme on l’a vu ci-dessus) les constituants de chaque proposition, à savoir sujet et attribut.
Dans un premier temps, ce type d’analyse devait être représenté sous une forme expositive. Ainsi, « Ejercicio tercero y general de análisis lógica y análisis gramatical » de Juan Calderón (1843) propose, comme exemple pour l’analyse, une strophe de Calderón de la Barca (« Digamos á la otra parte/disculpas suyas, que es bien/Guardar el segundo oído/Para quien llega despues », p. 77) :
Proposición principal absoluta: oigamos á la otra parte disculpas suyas. Primera incidente determinativa: que guardar el segundo oído es bien. Segunda incidente id.: para quien llega despues.
(Nosotros), sugeto de la proposición principal, suprimido por elipsis: es simple é incomplexo, por no representar mas que un objeto único, y no venir acompañado de complemento alguno. Oigamos disculpas suyas á la otra parte, atributo de la misma: es simple, porque no anuncia mas que una sola modificacion del sugeto, la expresada por el verbo oir; y complexo, por estar acompañado del complemento objetivo, disculpas suyas, y del complemento indirecto, á la otra parte.
Guardar el segundo oído, sugeto de la primera proposicion incidente: es simple, porque no ofrece al entendimiento mas que un solo objeto, guardar, y complexo por hallarse con el complemento objetivo, el segundo oído. Es bien, atributo, simple é incomplexo.
esTeBAn T. MOnTORO deL ARCO
81
Quien, sugeto de la segunda proposicion incidente; es simple é incomplexo. Llega despues, atributo de la misma, simple por no anunciar mas que una sola modificacion del sugeto, y complexo, á causa de la determinacion que da al verbo llegar el adverbio despues (Calderón 1843, p. 78)13.
Cependant, il y eut des tentatives pour doter l’analyse d’une méthodologie particulière, par le biais d’un recours à l’équivalence entre éléments grammaticaux et nombres. Chez González de Soto (1840), on trouve déjà une première symbiose entre calcul et analyse syntaxique :
101. Para facilitar los siguientes análisis, los alumnos ordenarán primero la prosa gramaticalmente, supliendo las elipsis: luego calificarán las proposiciones sirviéndoles de guia el guarismo que sigue á cada verbo en esta forma: el 1, significa proposicion principal absoluta: el 2, principal relativa: el 3, accesoria determinativa: el 4 accesoria explicativa (González de Soto 1840, p. 21).
En fonction de ce qui précède, la forme logique d’un énoncé est représentée comme suit : 102. Las ciencias esclarecen 1 el espíritu, la literatura le adorna 2: aquellas le enriquecen 2, esta pule 2 y avalora 2 sus tesoros: las ciencias rectifican 1 el juicio, y le dan 2 ecsactitud y firmeza; la literatura le dá 2 discernimiento y gusto, le hermosea 2 y perfecciona 2. Estos oficios son 2 esclusivamente suyos; porque á su inmensa jurisdicción pertenece 2 cuanto tiene 3 (González de Soto 1840, p. 21).
Mais les exercices d’analyse ne se généralisent pas seulement comme pratique scolaire, ils vont faire partie de la préparation aux concours de l’enseignement14 et, plus tard, de la préparation aux concours de la fonction publique en général.15 Les épreuves objectives des concours combinent spécifiquement grammaire et arithmétique, deux disciplines considérées comme fondamentales tant dans la pratique enseignante16
13 Nous citons les paragraphes correspondant à l’analyse logique ; ensuite vient l’analyse grammaticale présentée comme suit : « (Nosotros). Pronombre personal de la primera persona, masculino y plural, suprimido por elipsis, sugeto de la oración […] » (Calderón 1843, p. 78).
14 En 1854 figure au Programa de oposiciones a escuelas vacantes (3 février 1855) l’analyse logique à côté de l’analyse grammaticale, en tant que partie d’un exercice oral consistant à « escribir en el encerado y hacer el análisis gramatical y lógico del período que dicte uno de los jueces » (Miquel & Reus 1855, p. 59) ; dans le Reglamento de maestros de primera enseñanza (15 juin 1864), l’exercice d’analyse figure toujours comme épreuce orale ; enfin, dans le Reglamento para la provisión de escuelas públicas de primera enseñanza de 1896 (Real Decreto 11.12.1896, cité par Cuesta Escudero 1994, p. 515) les exercices d’analyse logique et grammaticale apparaissent à l’écrit et non plus à l’oral (cf. García Folgado sous presse).
15 Après divers projets de loi est publié en 1866 le Reglamento Orgánico de las carreras civiles de la Administración Pública (projet O’Donell), du 4 mars 1866. On y met l’accent sur la nécessité d’épreuves objectives pour l’accès à des postes de l’Administration, et l’analyse fait partie de certaines de ces épreuves.
16 On donnera comme exemple de cette combinaison le Real Decreto de 11.12.1896 (cité par Cuesta Escudero 1994, p. 515) : « El ejercicio escrito se compondrá de tres partes: 1ª) Análisis lógico y gramatical de un periodo; 2ª) resolución razonada de un problema de aritmética y 3ª) disertación sobre una lección de Pedagogía. Cada parte se ejecutará a la vez por todos los opositores ».
« LOs problemas matemáticos sOn COMO LOs temas gramaticales »
82
qu’au sein de l’administration.17 Dès la fin du XIXe siècle et début du XXe sont publiés des manuels à l’usage des candidats aux concours, dans lesquels les deux disciplines sont associées. En voici quelques exemples : Elementos de aritmética, gramática, contabilidad, derecho mercantil, ferrocarriles y telégrafos / con arreglo al programa de examenes para ingreso en el personal administrativo y mercantil de las inspecciones de ferrocarriles de Urbina et Calatañazor (1887) ; Cuestionarios de gramática y aritmética. Preparación completa para el ingreso en el Cuerpo especial de Establecimientos Penales con arreglo al Programa oficial d’Antonio Bueno y Pérez (1892) ; Gramática y aritmética. Adaptados al programa para las Oposiciones á Secretarios de Ayuntamientos de Juan Molina et Luis Alcober (1906).
Ces manuels proposent des exercices semblables à ceux que les élèves rencontrent dans les épreuves officielles. Les « temas gramaticales » sont des textes aux difficultés variables, dont la structure doit être dégagée par l’analyse. Mais il y a un problème : au début du XXe siècle, la diversité des interprétations concernant la pratique de l’analyse est si grande, qu’elle rend difficile son application immédiate dans un exercice aussi contraignant, en termes d’espace et de temps, que le concours. C’est la raison pour laquelle José Ramón Palmí Pérez, directeur de l’enseignement secondaire, inspecteur et auteur des deux ouvrages Análisis gramatical (1915) et Análisis gramatical crítico (1916), propose sa « méthode mathématique » comme une solution à ce type de problèmes.18 Le caractère d’universalité que l’auteur confère à sa méthode n’est pas sans rappeler la logique ou science générale de Leibniz et ses développements ultérieurs que nous avons commentés plus haut. En même temps, l’auteur montre, implicitement, que le lien entre logique, mathématiques et grammaire n’est pas aussi évident :
El método por mí adaptado a la descomposición de oraciones, es el mismo que emplea el matemático en sus cálculos o análisis numéricos y algebraicos; es… el mismo que practica el químico en sus operaciones; es… el mismo que usa el agrónomo en la averiguación de los componentes térreos; e… la regla fija del análisis, el principio científico aplicado, la fórmula general que facilita la resolución de los infinitos casos particulares que puedan presentarse (Palmí Pérez 1915, p. 42).
L’ouvrage de 1915, en particulier, est articulé en 17 leçons, où Palmí Pérez introduit peu à peu une sorte de guide, informant le candidat de la démarche à suivre pour comprendre le modèle d’analyse qu’il propose. L’analogie de son analyse avec le calcul mathématique est un aspect que Palmí souligne contsamment tout au long de son ouvrage, dans l’intention de conférer à sa proposition une plus grande légitimité :
17 Un exemple, figurant dans la Real orden dictando reglas y aprobando programas para el ascenso é ingreso de los funcionarios de la Comisaría General de Seguros (Gaceta de Madrid n° 240, 27/08/1912, p. 462) : « Proyecto de programa. Sección administrativa-Grado primero. Ejercicio 1.º Escribir al dictado un trozo de literatura castellana y hacer después sus análisis gramatical y literario. Ejercicio 2.ª Resolver varios problemas de números concretos, para cuya solución baste el conocimiento de las cuatro reglas fundamentales, de los quebrados y ordinarios y decimales y de las razones y proporciones ».
18 Pour des raisons d’espace, nous ne pouvons donner trop de détails, ni sur les manuels à l’usage des candidats aux concours, ni sur les ouvrages de José Ramón Palmí Pérez ; nous consacrerons à ces deux sujets des travaux spécifiques, à paraître prochainement.
esTeBAn T. MOnTORO deL ARCO
83
Los problemas matemáticos son como los temas gramaticales. En aquéllos, los datos encierran, o no, según los casos, problemas parciales (oraciones compuestas) que es necesario analizar, cual si fueran todos y no partes. En los temas aparecen igualmente datos compuestos (oraciones regido-regentes) que precisa conocer y descomponer.
Si no se conoce la relación que existe entre los productos y factores de un problema (ya sean éstos simples o compuestos) es absolutamente imposible resolverlo bien.
Y si no se dividen bien, es imposible en absoluto dar al análisis método, unidad, fijeza, carácter científico. Y un análisis sin estas condiciones, es imposible poderlo enseñar bien e imposible también poderlo aprender (Palmí Pérez 1915, p. 44).
Elle lui sert, en outre, à faire la critique des manuels d’autres grammairiens, tels que celui de Rufino Blanco y Sánchez, son maître, auquel il adresse des reproches comme le suivant19 :
La relación existe entre las oraciones, lo mismo que entre las palabras (como existe entre las decenas y centenas, lo mismo que entre las décimas y unidades), o si no, ¿qué oficio representan las conjunciones?
Pues bien, el ilustre regente de la Superior olvida por completo esta relación o régimen de oraciones, tanto en el análisis gramatical como en el que denomina lógico, cometiendo una heregía con los medios de régimen (Palmí Pérez 1915, p. 46-47).
Aux yeux de Palmí, la relation entre les chiffres d’un nombre est de la même nature que celle que contractent les mots (analyse grammaticale) aussi bien que les propositions (analyse logique) par le biais du régime. Il développe cette analogie dans « l’exemple des quatre » (« ejemplo de los cuatros ») suivant :
Tomando cada 4 como una oración, el 44 representará dos oraciones: una regente (las decenas, porque abrazan unidades) y una regida (las unidades, porque no abrazan a entidad alguna de la numeración entera). El 444 representará la trama de tres oraciones: una regente, una regido-regente y una regida, las cuales estarán, respectivamente, representadas por el 4 de las centenas, por el 4 de las decenas y por el 4 de las unidades. El 4.444 representará en su complejidad, cuatro oraciones: la regente absoluta, el 4 de los millares; la regido-regente de 1.er grado, el 4 de las centenas; la regido-regente de 2.º grado, el 4 de las decenas, y la regida, el 4 de las unidades. En el núm. 4.444.444 habrá una oración regente (los millones), cinco regido-regentes (de 1.er grado, las centenas de millar; de 2.º grado, las decenas de millar; de 3.er grado, los millares; de 4.º grado, las centenas, y de 5.º grado, las decenas), y una regida, las unidades. Cada unidad rige directamente a su inmediata inferior, o es regida por su inmediata superior, aunque indirectamente estén todas ellas relacionadas.
He aquí, amigo mío, exactamente expresado, todo el mecanismo de las oraciones y palabras de nuestro idioma. El lenguaje es, en su aspecto científico, absolutamente lo mismo que un número, o un problema matemático.
19 Palmí fonde probablement sa critque sur l’ouvrage Lengua castellana. Tratado de análisis de Blanco (1896), car il affirme : « creo más conveniente coger un tratado de análisis, aquél cuyo autor goce de más prestigio y autoridad entre los maestros españoles, y hacer el análisis de su análisis en este punto » (Palmí 1915, p. 33, souligné par l’auteur). Mais Blanco est aussi l’auteur d’autres manuels où il parle de l’analyse, tels que Nociones de lengua castellana (Blanco 1905).
« LOs problemas matemáticos sOn COMO LOs temas gramaticales »
84
La relación que existe entre las cifras de un número, o entre los números de un problema, existe también entre las palabras de una oración y entre las oraciones de una cláusula.
La diferencia que media es accidental, no esencial; es la diferencia que existe entre un sistema de numeración binario, ternario, cuaternario, quinario, decimal o duodecimal, etc.; el mismo método racional de combinar, el mismo metro que mide cantidades mayores o menores (Palmí 1915, p. 59-60).
Et, pour représenter graphiquement les relations de régime entre les mots, il n’hésite pas à faire appel, à nouveau, aux nombres. Le 1 indique ce qu’il appelle « régime primaire », c’est-à-dire le mot « régent absolu » ; les mots marqués du nombre 2 seraient régis par le régent absolu, les mots 3 régis par les précédents, et ainsi de suite :
Exemple de représentation du régime (Palmí 1915, p. 75)
6. COnCLUsiOns
Le lien entre arithmétique (qu’on l’appelle calcul ou mathématiques, etc.) et grammaire était un présupposé évident pour les Idéologues ; les deux disciplines reposant sur la Logique, la science générale dont se nourrissaient toutes les disciplines scientifiques, elles pouvaient se partager une même méthode, la méthode analytique. Au-delà des fréquentes analogies entre calcul et pensée, et de leurs projections sur la grammaire, l’introduction dans l’enseignement scolaire de ces deux disciplines a entraîné leur enrichissement mutuel, ce qui eut, directement ou indirectement, des répercussions conceptuelles et terminologiques. Ainsi, sujet et attribut, noms logiques qui fut donné aux éléments de la proposition, ont été analysés et classés selon des oppositions fondées sur les mathématiques, comme pour la dichotomie complexe/incomplexe. Ces concepts furent systématisés par Beauzée, qui perfectionna la caractérisation du sujet et de l’attribut, et, par extension, celle de la proposition. Mais on a pu voir que leur application ultérieure
esTeBAn T. MOnTORO deL ARCO
85
posait problème, notamment dans le cadre espagnol, où la méthode, du moins dans les premiers traités, fut parfois interprétée de façon très variable.
Le lien entre grammaire et arithmétique s’est maintenu par-delà leur fondement logique commun : leur introduction dans l’enseignement comme matières fondamentales dans les premières années des écoles normales et leur présence ultérieure dans toutes sortes d’épreuves et d’exercices destinés aux concours de l’Administration ont eu pour conséquence la prolifération de propositions d’exercices et une évolution dans la façon de présenter les réponses. La recherche d’une méthode de représentation rationnelle et efficace des relations entre les mots et entre les propositions ou les phrases trouvait dans les nombres un puissant allié. On en donnera pour exemple la « méthode mathématique » proposée par José Ramón Palmí Pérez au début du XXe siècle.
RéféRenCes
Sources primaires« Amant de la Jeunesse » = Anónimo (1830). Análisis gramatical y lógica de la lengua
francesa, por un amante de la juventud, Madrid, Oficina de Moreno.Arnauld, Antoine (1662). La Logique ou l’Art de penser/Contenant, outres les regles
communes, plusieurs observations nouvelles propres à former le jugement, Paris, Iean de Launay.
Arnauld, Antoine & Lancelot, Claude (1660). Grammaire générale et raisonnée, Paris, Pierre le Petit.
Beauzée, Nicolas (1767). Grammaire générale, ou exposition raisonnée des éléments nécessaires du langage, pour servir de fondement à l’étude de toutes les langues, t. II. Paris, J. Barbou.
Blanco y Sánchez, Rufino (1896). Lengua castellana: Tratado de análisis, 3e éd., Madrid, El Magisterio Español.
Blanco y Sánchez, Rufino (1904). Nociones de lengua castellana: Gramática Análisis, composición oral, redacción, dictado, lectura, recitación, Rufino Blanco y Sánchez, 6e éd. corrigée et augmentée, Madrid, Imp. Revista de Archivos.
Bourdon, Pierre Louis Marie (151837). Élémens d’arithmétique, Paris, Bachelier.Bueno y Pérez, Antonio (1892). Cuestionarios de gramática y aritmética. Preparación
completa para el ingreso en el Cuerpo especial de Establecimientos Penales con arreglo al Programa oficial/por D. Antonio Bueno y Pérez/Ayudante del mismo Cuerpo, por oposición, y profesor de Primera enseñanza, Madrid, Imprenta de Infantería de Marina.
Calderón, Juan (1843). Análisis lógica y gramatical de la lengua española, Madrid, Carrera de San Jerónimo 43.
Calonge, Enrique (1902). Apuntes de Análisis Gramatical Arreglado para las oposiciones á ingreso en el cuerpo de Correos, [s. l.], Carlos Bérri.
Camus, M. [Charles-Étienne-Louis] (1753). Cours de mathématique. Première Partie. Éléments d’arithmétique, Paris, Imp. de Ballard.
Condillac, [Ettiene Bonnot de] (1801). La langue des calculs, ouvrage posthume et élémentaire, Imprimé sur les Manuscrits autographes de l’Auteur. Tome premier, Paris, Chez les Libraires Associés.
Destutt de Tracy, Antoine Louis Claude (1803). Élémens d’Idéologie. Seconde Partie : Grammaire, Paris, Courcier.
« LOs problemas matemáticos sOn COMO LOs temas gramaticales »
86
Destutt de Tracy, Antoine Louis Claude (1805). Élémens d’Idéologie. Troisiéme Partie : Logique, Paris, Courcier.
Du Marsais, M. [César Chesneau] (1769). Logique et principes de grammaire. Ouvrages posthumes en partie, & en partie extraits de plusieurs Traités qui ont déjà paru de cet Auteur, Paris, Chez Barrois.
Figuerola, Laureano (1841). Manual completo de enseñanza simultánea mútua y mixta, Madrid, Imprenta de Yenes.
Letellier, Charles-Constant (1805). Grammaire Françoise de Lhommond à l’usage des Lycées. Nouvelle Édition, revue, corrigée et augmentée par Charles-Constant Letellier, Paris, Le Prieur.
Lhomond, M. [Charles-François] (1780). Élémens de la grammaire Françoise, Paris, Chez Colas, Libraire.
Miquel y Rubert, Ignacio & Reus y García, José (1855). Boletín de la Revista general de legislación y jurisprudencia: periódico oficial del ilustre Colegio de abogados de Madrid, vol. 3, Madrid, Anselmo Santa Coloma.
Molina, Juan & Alcober, Luis (1906). Gramática y aritmética. Adaptados al programa para las Oposiciones á Secretarios de Ayuntamientos/Publicado por Real orden de 15 de Noviembre de 1906 por los Oficiales de Administración civil del Ministerio de la Gobernación, Madrid, Imp. y Est. de Antonio Gascón.
Noël François-Joseph-Michel & Chapsal, Charles-Pierre (1845). Nouvelle grammaire française sur un plan tres-méthodique, avec de nombreux exercices d’orthographe, de syntaxe et de ponctuation, tirés de nos meilleurs auteurs, et distribués dans l’ordre des règles, 38e éd., Paris, Vve. Nyon Jeune.
Palmí Pérez, José Ramón (1915). Análisis gramatical: obra indispensable para maestros, opositores, normalistas, jefe de negociado, escribientes, periodistas, autores, etc./por José Palmí Pérez, Valencia, [s.n.] (Impr. de Vicente Ferrandis).
Palmí Pérez, José Ramón (1916). Análisis gramatical crítico/por José Ramón Palmí Pérez/Obra indispensable para maestros, abogados, jefes de negociado, periodistas, autores, opositores, estudiantes, mecanógrafos y escribientes en general. Segunda parte, Valencia, Vicente Ferrandis.
Urbina, Julio & Calatañazor, Apolinar (1887). Elementos de aritmética, gramática, contabilidad, derecho mercantil, ferrocarriles y telégrafos/con arreglo al programa de examenes para ingreso en el personal administrativo y mercantil de las inspecciones de ferrocarriles/por Julio Urbina y Apolinar Calatañazor, Madrid, Manuel Minuesa de los Ríos.
Sources secondairesCalero Vaquera, M.ª Luisa (1999). Proyectos de lengua universal. La contribución española,
Córdoba, Universidad de Córdoba y Obra Social y Cultural Cajasur.Calero Vaquera, M.ª Luisa (2008). « Análisis lógico y análisis gramatical en la tradición
española: hacia una (r)evolución de la sintaxis », Gramma-Temas 3, 11-42.Calero Vaquera, M.ª Luisa & Zamorano Aguilar, Alfonso (2010). « El término análisis en
las gramáticas de la tradición hispánica - Estudio metalingüístico », Wieland, Katharina, Süselbeck, Kirsten & Eilers, Vera (éd.), Aspectos del desarrollo de la lingüística española a través de los siglos, Hamburg, Buske Verlag, 13-29. [Serie: Romanistik in Geschichte und Gegenwart, 18].
Couturat, Louis & Leau, Léopold (1903). Histoire de la langue universelle, Paris, Librairie Hachette et Cie.
Couturat, Louis & Leau, Léopold (1907). Les nouvelles langues internationales, Paris, Librairie Hachette et Cie.
Cuesta Escudero, Pedro (1994). La escuela en la reestructuración de la sociedad española (1900-1923), Madrid, Siglo XXI.
Delesalle, Simone & Chevalier, Jean-Claude (1986). La linguistique, la grammaire et l’école: 1750-1914, Paris, Armand Colin.
esTeBAn T. MOnTORO deL ARCO
87
Dury, Pascaline & Drouin, Patrick (2011). « When terms disappear from a specialized lexicon: A semi-automatic investigation into ‘necrology’ », Icame Journal 35, 19-23.
García Folgado, María José (en prensa). « Gramática y legislación educativa », Zamorano Aguilar, Alfonso (éd.), Lengua y reflexión lingüística en el siglo XIX. Marcos, panorama y nuevas aportaciones.
García Folgado, María José & Montoro del Arco, Esteban T. (2011). « Aproximaciones a la enseñanza del análisis: los Principios de análisis lójico de Ramón Merino (1848) », Hassler, Gerda (éd.), History of Linguistics 2008. Selected papers from the eleventh International Conference on the History of the Language Sciences (ICHoLS XI, 28 August-September 2008), Amsterdam, John Benjamins, 303-315.
Montoro del Arco, Esteban T. (2010). « Bases para el estudio variacionista de los corpus historiográficos: el caso del análisis lógico y gramatical », Revista argentina de historiografía lingüística (RAHL), II/2, 107-124. En ligne : <http://www.rahl.com.ar>.
Montoro del Arco, Esteban T. & García Folgado, María José (2009). « El análisis lógico y gramatical en los manuales escolares del siglo XIX (francés, castellano y latín) », Quaderni del CIRSIL 8, 143-159.
Sinner, Carsten (2009). « Las gramáticas francesas como fundamento, modelo e inspiración del análisis lógico y el análisis gramatical en España », Revue de Linguistique Romane 73, 427-460.
Velarde Lombraña, Julián (1989). Historia de la lógica, Oviedo, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo.
« LOs problemas matemáticos sOn COMO LOs temas gramaticales »
Histoire Épistémologie Langage 34/II (2012) p. 89-105 © SHESL
RésuméLa question de la qualité (et plus récemment, la manière de la mesurer) est devenue un sujet presque récurrent dans les Études sur la Traduction. Toutefois, quelques parcelles de ce domaine de la connaissance semblent avoir été laissées de côté par rapport à cette tendance. La traduction des unités phraséologiques est un de ces domaines, car les mentions faites à ce sujet sont rares et imprécises quand on analyse les procédures résultant de la traduction des unités phraséologiques.
L’objectif de ce travail est double : d’un côté, réunir les opinions les plus significatives des traductologues par rapport à la recherche de la qualité dans la traduction des unités phraséologiques, d’un autre côté, définir les paramètres nécessaires pour la classification des erreurs dans la traduction de phraséologie.
Mots clefsPhraséologie, traduction, qualité de traduction, paramètres de classification.
AbstractThe quality issue – and, more recently, the way of measuring it – has become a practically recurrent element in Translation Studies. However, some aspects belonging to this field seem to have been unaffected by this trend. One of these areas is the translation of phraseological units, as there are scarce and even imprecise works which analyze the procedures of translating this type of units.
The aim of this paper is dual: to gather the most significant opinions from Translation scholars regarding the search of quality within the rendering of phraseological units, and to define the parameters which classify the mistakes that are made during the translation of phraseological units.
KeywordsPhraseology, translation, translation quality, parameters for classification.
FRASEOLOgíA, TRAduccIóN y cONTROL dE cALIdAd:AcERcA dE LA (Im)POSIBILIdAd dE ARmONIzAcIóN dE PARámETROS
PARA LA EvALuAcIóN
Jorge Leiva RojoUniversidad de Málaga
1. inTROdUCCión: fRAseOLOgíA y TRAdUCCión
Han pasado ya unas cuantas décadas desde que la fraseología, rama del saber centrada en el estudio de las unidades fraseológicas, diera sus primeros frutos en el ámbito hispánico en forma de estudios teóricos. Lejos, pero igualmente presente, queda ya la herencia de autores de la talla de Alberto Zuluaga o Julio Casares, considerados precursores de esta disciplina en la lengua española. Tras ellos vendrían, entre otros, estudiosos como Jesús Cantera Ortiz de Urbina, Germán Conde Tarrío, Juan Martínez Marín, Antonio Pamies Bertrán, M.ª Inmaculada Penadés Martínez, Mario García-Page, Gerd y Barbara Wotjak y Gloria Corpas Pastor, autora que, con su Manual de fraseología española (1996), marcó un antes y un después en la fraseología española. De ella, precisamente, tomamos su taxonomía para las unidades fraseológicas y la definición que da para ellas, que es la que sigue:
90
[…] las unidades fraseológicas […] son unidades léxicas formadas por más de dos palabras gráficas en su límite inferior, cuyo límite superior se sitúa en el nivel de la oración compuesta. Dichas unidades se caracterizan por su alta frecuencia de uso y de coaparición de sus elementos integrantes; por su institucionalización, entendida en términos de fijación y especialización semántica; por su idiomaticidad y variación potenciales; así como por el grado en el cual se dan todos estos aspectos en los distintos tipos (Corpas Pastor 1996, p. 20).
Paralelamente a los trabajos de los autores señalados, es preciso indicar que también han ido surgiendo innumerables estudios que se centran en la traducción de unidades fraseológicas o en la fraseología contrastiva. No podríamos dejar de hacer referencia a los trabajos de, entre otros, Brumme (2008) o Mogorrón Huerta y Mejri (2009), así como tampoco a las aportaciones de Corpas Pastor (2000, 2001 y 2003), que en este trabajo nos han servido de base para el estudio de los procedimientos de traducción de unidades fraseológicas.
2. eL COnTROL de CALidAd en eL áMBiTO de LA TRAdUCCión
La preocupación por llevar a cabo procedimientos que garanticen la consecución de unos niveles de calidad preestablecidos a lo largo del proceso de traducción se ha convertido en una constante en los últimos años. En el ámbito internacional, algunos de sus precursores fueron House (1977, 1997), Schäffner (1998) o Newmark (1988, 2003), quien en su obra de 1988 da con una de las claves de la dificultad de este proceso:
[I]t should be easier to assess a translation than an original text, since it is an imitation. The difficulty lies not so much in knowing or recognising what a good translation is, as in generalising with trite definitions that are little short of truisms, since there are as many types of translations as there are of texts (Newmark 1988, p. 192).
En el caso del ámbito hispánico, aunque el interés por este campo parece haberse desarrollado más recientemente, ello no es impedimento para encontrarnos con autores como Arevalillo Doval (2004, 2010), Corpas Pastor (2006, 2007) o Peña Pollastri (2009), con buenos y exhaustivos trabajos relativos a la creación de normas de traducción y a su aplicación didáctica.
En otro orden de cosas, consideramos que la importancia creciente de la calidad en la cuestión de la traducción no debe verse solo como un reflejo de los tiempos, sino también como una señal inequívoca de la madurez que han alcanzado los Estudios de Traducción (Corpas Pastor 2006, p. 47). Una prueba de ello es el hecho de que el auge de la cuestión de la calidad no solo se advierte en el número de estudios teóricos que se ha dado a conocer en los últimos años, sino también en su mayor presencia y relevancia en el plano profesional, con la irrupción de determinadas normas de traducción a la cabeza: recientemente, hemos asistido a la aparición de una serie de normas que han intentado regular el proceso de traducción en aras de poder ofrecer un mejor producto al cliente. No obstante,
JORge LeivA ROJO
91
cuando hablamos de calidad debemos distinguir forzosamente dos vertientes esenciales (Díaz de Liaño 2010, p. 3):
a. Calidad subjetiva, percibida de manera personal y que está asociada a los servicios que ofrecemos a nuestros clientes. Se consigue ajustando la oferta a los requerimientos del cliente y anticipándose, en la medida de lo posible, a futuras demandas derivadas de la gestión de sus activos lingüísticos.
b. Calidad técnica de los productos y servicios, amparada por el cumplimiento de la norma ISO 9001:2008 y más concretamente en este sector, en la UNE-EN15038, que especifica para el proveedor de servicios de traducción (PST) los requisitos relativos a los recursos humanos y técnicos, la gestión de la calidad y de proyectos, el marco contractual y los procedimientos de servicio.
De las dos modalidades posibles de calidad, nos vamos a centrar en la segunda, esto es, en la calidad técnica, puesto que es la que nos ofrece mayores posibilidades de transposición al estudio de la traducción de unidades fraseológicas. De las dos normas mencionadas por Díaz de Liaño, igualmente, nos ocuparemos de la segunda de ellas, la UNE-EN 15038:2006, por haberse concebido de forma expresa para el control de calidad en la prestación de servicios de traducción. Dicha norma, cuya denominación completa es «Servicios de traducción. Requisitos para la prestación de servicios», pasó a formar parte del catálogo oficial de normas de AENOR el pasado 17 de septiembre de 2006, y se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 1 de diciembre del mismo año. Se trata de una norma de vital importancia para la traducción, pues regula todos los requisitos que habrán de cumplir las empresas para lograr la certificación. La importancia de esta norma, no obstante, no radica en que descubra la forma en que los traductores deben realizar su trabajo, sino que lo que propone es sancionar «los usos correctos que traductores y empresas llevaban desempeñando años y años» (Arevalillo Doval 2010, p. 9). En líneas muy similares se muestra Corpas Pastor (2007, p. 70) al afirmar que
[this] CEN [Comité Européen de Normalisation] standard has entailed a thorough review of the former initiative in a conscious attempt to learn from past experiences, keep any outstanding achievements, and eliminate any hindrance of restriction from translation quality management.
En definitiva, la norma UNE-EN 15038:2006 no propone unas normas de juego nuevas, sino que expone las ya existentes de forma explícita, con objeto de dejar claras tanto la definición de calidad en traducción como la forma de llegar a ella. Como resultado de todo ello, la norma referida establece entre otros aspectos el objeto y campo de aplicación de la norma, define los términos y las nociones básicas, determina las cuestiones esenciales de aplicación a la relación cliente-proveedor de servicios de traducción y fija la forma en que se ha de llevar a cabo el proceso de traducción. En líneas muy similares se muestra Bonnet (2006) al afirmar que las principales razones para crear una norma1 que regule los procesos de traducción son, entre otras: consecución de una mayor transparencia en la
1 Aunque Bonnet hace estas afirmaciones en relación con la norma ASTM F2575 – 06, que se verá más adelante, incluimos su parecer aquí por ser plenamente coincidente con el impacto de la norma UNE-EN 15038:2006.
fRAseOLOgíA, TRAdUCCión y COnTROL de CALidAd
92
provisión de servicios (el cliente sabe qué compra y el proveedor de servicios de traducción sabe qué debe ofrecer); obtención de una mayor calidad al contrastarlo con los términos, objetivos, de la norma; diferenciación en el mercado (al compararse los proveedores de servicios que siguen las normas con los que no); igualación de las normas de juego (tanto clientes como proveedores de servicios de traducción conocen en qué condiciones deben actuar); y obtención de un marchamo de calidad, ya que la certificación de acuerdo con una norma supondrá, a ojos del cliente, la garantía de que el servicio ofrecido cumple unos mínimos en lo que a calidad se refiere.
El auge de esta corriente, por lo demás, ha llevado a un afán por normalizar prácticamente todos los aspectos relacionados con el proceso de traducción –e, incluso, con la interpretación. En este sentido, afirma Arevalillo Doval (2010, p. 10) lo siguiente:
Existe actualmente una fiebre de normalización en el sector, porque a raíz de la europea –o en paralelo con ella– surgieron varias normas más: la ASTM estadounidense, la GB/T 19363 china y la CA/CSGB-131.10 canadiense. Además, la ISO se ha unido a este ritmo normalizador del sector y ya está trabajando en las siguientes normas: parámetros de traducción, evaluación de traducciones, métodos terminográficos y lexicográficos e interpretación comunitaria, por citar solo los relacionados con el sector.
3. COnTROL de CALidAd en LA TRAdUCCión de UnidAdes fRAseOLógiCAs
Al estudiar en profundidad las normas de traducción, es justo destacar uno de los elementos que más nos ha llamado la atención: a pesar del auge de la normalización y creación de procesos para el control de calidad de la traducción, algunos aspectos parecen haber quedado fuera de esta fiebre normalizadora. Uno de ellos es la traducción de unidades fraseológicas. A pesar de lo complejo de su proceso y de la visibilidad que la fraseología ha adquirido en los Estudios de Traducción actuales, sigue siendo una asignatura pendiente en la mayoría de normas que regulan la traducción. En primer lugar, veremos el tratamiento que dan a las unidades fraseológicas las distintas normas de traducción que han quedado obsoletas como consecuencia de la aparición de otras normas que las han sustituido. Una de ellas, la norma alemana (Deutschen Institut für Normung 1998, p. 3), considera que, de todas las competencias que se le debe presuponer al traductor, la competencia traductora es la que le permitirá verter el texto de origen en la lengua de destino con corrección en lo que respecta al idioma, el asunto y el estilo idiomático, elementos que tendrán que guardar relación con la función textual tanto del texto de origen como del de destino.
En lo que a las normas austriacas se refiere, una de ellas (Österreichisches Normungsinstitut 2000a, p. 4) hace referencia a la idiomaticity como uno de los cuatro elementos de los parámetros lingüísticos –junto con el léxico, la gramática y
JORge LeivA ROJO
93fRAseOLOgíA, TRAdUCCión y COnTROL de CALidAd
la sintaxis–, cuyas reglas y convenciones para la lengua de destino deben seguirse.2 La norma china (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine 2003), por su parte, si bien toma la norma alemana como referencia, no incluye ninguna indicación al respecto de la traducción de unidades fraseológicas, como sí hacía la norma alemana –aunque muy someramente–, ya que esta norma se centra más en aspectos organizativos y únicamente alude a cómo se debe llevar a cabo el proceso de traducción y qué se espera de sus distintos actores.
Esta situación de irrelevancia prácticamente absoluta de la fraseología, no obstante, va cambiando a medida que consultamos normas que están en vigor en la actualidad, puesto que las referencias a ella son más frecuentes, aunque sigue habiendo normas en las que ni siquiera se menciona este aspecto. A este último grupo pertenece la ASTM F2575 - 06 Standard Guide for Quality Assurance in Translation, norma para la provisión de servicios de traducción en los Estados Unidos, en la que no se mencionan las unidades fraseológicas3 como uno de los aspectos que deben analizarse a la hora de medir la calidad de una traducción. Si bien es cierto que la norma ASTM F2575 - 06 no es certificable, sino un documento de referencia o prácticas recomendadas y, además, únicamente establece los parámetros que afectan al proyecto de traducción, ello, consideramos, no debería ser impedimento para no incluir a la fraseología, ya que sí se alude, por ejemplo, a la coherencia terminológica como uno de los elementos que deben estar presentes en las traducciones sometidas al control de esta norma.
Contrariamente a la norma ASTM F527 - 06, en la UNE-EN 15038:2006 sí aparece una referencia a la traducción de unidades fraseológicas, puesto que cuando se define el proceso de traducción se indica que es preciso que el traductor preste especial atención a varios aspectos que se engloban en siete categorías, una de las cuales es «Léxico: cohesión, léxica y fraseología». (UNE-EN 15038:2006, 2006, p. 12). Igualmente, esta misma norma (UNE-EN 15038:2006, 2006, p. 16) incluye a las unidades fraseológicas como uno de los elementos que pueden formar parte del análisis de los elementos microestructurales del texto de origen, circunstancia esta que nos permite inferir su relevancia en el proceso de traducción.
Finalmente, en lo que respecta a algunas de las normas que se están elaborando actualmente, se observa cómo la fraseología va adquiriendo un peso mayor. Según información proporcionada por Arevalillo Doval, presidente del Comité Técnico de Normalización n.º 174 de AENOR, tanto en la norma de la ISO que regulará los servicios de traducción como en la que se normalizarán los proyectos de traducción aparecerán menciones a la fraseología similares a las que figuran en la norma UNE-EN 15038:2006. Más significativo es el caso de la futura norma ISO que regulará la evaluación y revisión de traducciones: en el borrador de dicha norma, el incorrecto uso de unidades fraseológicas aparece como uno de los elementos comprendidos en el error de coherencia (Arevalillo Doval, comunicación personal).
En definitiva, consideramos evidente que la traducción de unidades fraseológicas va adquiriendo un peso cada vez mayor a la hora de medir la calidad
2 La otra de las normas (Österreichisches Normungsinstitut 2000b), por su parte, no incluye alusiones a la fraseología, algo achacable a que se trata de una norma que determina los contratos que se celebrarán entre el cliente y el proveedor de servicios de traducción.
3 No obstante, sí aparece una mención a las colocaciones.
94
de los proveedores de servicios de traducción. Se ha pasado de la ausencia plena de alusiones a su inclusión en la definición de un error de traducción –aunque, recordemos, no de forma definitiva, ya que la norma ISO en la que aparecerá se encuentra en fase de elaboración. A lo largo de todo este proceso también se han dado situaciones intermedias en las que sí aparecía la fraseología, aunque mencionada de forma implícita e incompleta; de esta forma, encontramos alusiones metonímicas, en las que la parte –la colocación– se confunde con el todo –la unidad fraseológica–, al tiempo que también vemos cómo se asocian erróneamente las unidades fraseológicas con uno de sus rasgos definitorios, que no imprescindibles: la idiomaticidad.
Esta relación control de calidad-traducción de unidades fraseológicas, no obstante, no solo se da en las normas de calidad, sino que va a apareciendo –aunque tímidamente– en los estudios teóricos. Tal es el caso del trabajo de Lee-Jahnke (2001, p. 266-267), donde se considera que las colocaciones pertenecen, de entre los tres grandes parámetros que se deben juzgar en su modelo de evaluación sumativa de traducciones, al de la creatividad, parámetro este evaluable en su modelo con una calificación de entre cero y seis (siendo esta última cifra la puntuación más alta), de acuerdo con el sistema de calificaciones que, afirma Lee-Jahnke, se suele emplear en Suiza. A pesar de que en el modelo de Lee-Jahnke asistimos de nuevo a la misma situación de confusión que advertimos en las normas de traducción, este nos sirve, de una parte, para percatarnos de la toma de conciencia de que la traducción de unidades fraseológicas debe evaluarse y, de otra, para ver cómo la traducción de fraseología la considera Lee-Jahnke un elemento evaluable de forma gradual (esto es, del cero al seis), mientras que otros elementos, caso de las ambigüedades, las contradicciones, las omisiones o el seguimiento de instrucciones no deben obtener una valoración según una escala, sino que o son acertadas o no lo son, por lo que recibirían o un seis o un cero, según el caso. Paralelamente al trabajo de Lee-Jahnke, podemos apreciar cómo también aparece el componente fraseológico como elemento evaluable en los trabajos de Hansen (2009, p. 321) y Peña Pollastri (2009, p. 259), este último inspirado en el trabajo de Lee-Jahnke mencionado. Aunque las referencias no son más que meros apuntes, vemos cómo, poco a poco, la fraseología se va abriendo camino en la cuestión del control de calidad.
4. HACiA Un MOdeLO PARA LA evALUACión de UnidAdes fRAseOLógiCAs TRAdUCidAs
De nuestra somera exposición sobre la atención que las normas de calidad prestan a las unidades fraseológicas traducidas, y una vez analizadas las pocas referencias que hemos podido encontrar a este respecto en estudios teóricos, se desprende la necesidad de dar con un modelo que permita evaluar la traducción de unidades fraseológicas. Para ello, hemos tomado como punto de partida plantillas de revisión y corrección de carácter interno pertenecientes a proveedores de servicios de traducción, así como determinados juicios de valor incluidos en estudios que a este respecto han publicado autores como Campbell & Hale (2003), Newmark (2003) y
JORge LeivA ROJO
95
Dollerup (1994). La idea que subyace en el modelo que proponemos aquí es que el concepto de calidad en traducción ha de guardar relación con la equivalencia según la entiende House (House 2001, p. 247): «It is obvious that equivalence cannot be linked to formal, syntactic and lexical similarities alone because any two linguistic items in two different languages are multiply ambiguous, and because languages cut up reality in different ways». Se trata, en definitiva, de un tipo de equivalencia que guarda relación con el mantenimiento del significado en dos lenguas y culturas diferentes (House 2001, p. 247).
Una vez visto lo que los principales estudiosos han manifestado sobre la evaluación, revisión y corrección de evaluaciones, nos encontramos en condiciones de describir las distintas categorías de errores –y aciertos– que pensamos se deberían incluir en una plantilla de evaluación de traducciones en las que el elemento objeto de análisis es la traducción de unidades fraseológicas. De esta forma, siguiendo las plantillas de revisión y corrección de traducciones de algunas empresas de traducción y proveedores de servicios de traducción, el trabajo de Mossop (2001) y los modelos de evaluación de traducciones de Dollerup (1994) y Lee-Jahnke (2001), consideramos que, al evaluar la traducción de una unidad fraseológica, el revisor podrá otorgar las siguientes calificaciones:
a. Error grave. Equivalente al error grave (o major)4 de proveedores de servicios de traducción y Mossop (2001, p. 151), a la primera de las cinco categorías –identificada con un signo menos– de Dollerup (1994) y un valor de entre cero y uno en Lee-Jahnke (2001). Aplicable a aquellos procedimientos de traducción cuyo resultado afecta a la calidad general del texto o a su comprensión por parte del lector o presentan incorrecciones en cuanto a la lengua o la coherencia. Debemos mencionar a este respecto que el error grave es el que conllevará una penalización mayor para el traductor en este modelo de evaluación. No está presente, por tanto, el denominado error muy grave (o critical), que figura en determinadas plantillas de proveedores de servicios de traducción –y que supone en algunos casos que el revisor deje de realizar la revisión y remita de nuevo el trabajo al traductor para su enmienda–, puesto que en el modelo que ofrecemos prima la finalidad didáctica sobre cualquier otra.
b. Error leve. Se corresponde con el error leve (o minor), la segunda calificación en cuanto a puntuación y un valor de entre uno y dos en las plantillas de proveedores de servicios de traducción y Mossop (2001, p. 152); Dollerup; y Lee-Jahnke, respectivamente. Es de aplicación a aquellos errores que afectan en menor grado a la comprensión del texto o que comprometen la calidad del texto en menor medida que los errores graves.
c. Propuesta neutra. Relacionada, aunque de forma parcial, con los preferential changes de las plantillas de proveedores de servicios de traducción –esto es, cambios realizados por el revisor en propuestas de traducción adecuadas y gramaticalmente correctas; su único fin es el de la mejora en el estilo del texto– y con la calificación intermedia (Dollerup) y un valor de entre tres y cuatro (Lee-Jahnke). Es el valor intermedio de nuestro modelo de evaluación, indicativo de que la propuesta ofrecida por el traductor es satisfactoria y de que no afecta, ni negativa ni positivamente, a la calificación de la traducción.
d. Solución positiva. Como consecuencia de la motivación puramente didáctica de nuestro modelo, esta categoría y la siguiente suponen una
4 Se añade, entre paréntesis, la denominación inglesa.
fRAseOLOgíA, TRAdUCCión y COnTROL de CALidAd
96
diferencia con respecto a las plantillas de proveedores de servicios de traducción que hemos analizado, ya que en ellas no están presentes. Sí aparecen, por el contrario, en los modelos de Dollerup y Lee-Jahnke, en los que las soluciones positivas se corresponderían, respectivamente, con la cuarta categoría y un valor de entre cuatro y cinco. Se asignarán a aquellas propuestas de traducción que, además de ser correctas, suponen una demostración de la maestría del traductor. Igualmente, se otorgará esta distinción a aquellos casos en los que la traducción de la unidad fraseológica supusiera una dificultad añadida, bien por estar presente en el texto de destino un juego de palabras o una unidad fraseológica desautomatizada o bien por ser de difícil identificación –por tener una frecuencia de uso restringida o, incluso, por haberla empleado erróneamente el autor del texto de origen.e. Solución muy positiva, equivalente con los valores más altos de los modelos de Dollerup (quinta categoría, marcada con un signo positivo) y Lee-Jahnke (un valor de entre cinco y seis). La presente calificación, en esencia similar a la anterior, se diferencia de esta en que premia soluciones de traducción consideradas como excelentes u ofrecidas en condiciones especialmente adversas. Lo difuso del límite entre las soluciones positivas y muy positivas, por lo tanto, hará que el evaluador decida según su criterio qué calificación otorgar.
Una vez establecidas las calificaciones con que se valorarán las propuestas de traducción, veamos a continuación su aplicación según los procedimientos a los que ha recurrido el traductor, ya que ella diferirá en función del procedimiento empleado; al mismo tiempo, consideramos que habrá determinadas calificaciones que difícilmente se aplicarán a ciertos procedimientos de traducción. A continuación mostraremos, por lo tanto, los distintos procedimientos que se emplean en la traducción de unidades fraseológicas –y que aparecen identificados y descritos en Corpas Pastor (2003), quien se inspira, a su vez, en Vinay & Darbelnet (1995)– y se evaluará el grado de error o acierto presente en tales procedimientos. Ilustraremos las distintas calificaciones con ejemplos reales extraídos de encargos de traducción realizados por alumnos de segundo y tercer curso del Grado en Traducción e Interpretación de la Universidad de Málaga que cursaron respectivamente las asignaturas «Traducción general “BA-AB” (i) inglés-español/español-inglés» y «Traducción general “CA-AC” (i) inglés-español/español-inglés». Para los fines de este trabajo, ofrecemos ejemplos de cómo se ha traducido la paremia inglesa When in Rome, do as Romans do (‘adjust your habits to suit the customs of the place you are living in, or of the people you are living with’, OdCie),5 que en el texto de origen se emplea desautomatizada:6
TO1: When in Spain, do as the Spanish do: When it comes to domestic transportation, twice as many Spaniards choose to travel by bus than by train.
5 Para consultar la referencia completa de los repertorios lexicográficos que se citan en este trabajo, cf. el apartado «Repertorios lexicográficos citados de forma abreviada».
6 No obstante, con el fin de completar la ejemplificación de procedimientos y calificaciones posibles, hemos tenido que recurrir al análisis de dos unidades fraseológicas distintas de esta paremia: right off the bat (TO2) y The early bird gets the worm (TO3), que se explican en los apartados «Paráfrasis» y «Otros procedimientos», respectivamente.
JORge LeivA ROJO
97
4.1. Équivalence
La équivalence, el procedimiento de traducción de unidades fraseológicas más empleado (que consiste en sustituir la unidad fraseológica del texto de origen por una unidad fraseológica equivalente en el texto de destino), también es el más frecuente en los alumnos a la hora de traducir la paremia desautomatizada.7
Td1.A: Dónde fueres haz lo que vieres: en lo que concierne al transporte nacional, el doble de españoles prefieren viajar en autobús que en tren.8 [Error grave]Td1.B: Donde fueres, haz lo que vieres: cuando se trata de transportes nacionales la mayoría de los españoles prefieren viajar en autobús antes que en tren. [Solución positiva]Td1.C: Si a España fueres, haz lo que vieres: Cuando se trata de transporte dentro del país, el doble de españoles elige viajar en autobús que en tren. [Solución muy positiva]
El procedimiento de la équivalence es uno de los que más amplio rango de calificaciones ofrece, aunque, consideramos, debería reducir el empleo de la calificación «Propuesta neutra» a un mínimo y favorecer en su lugar la calificación «Solución positiva» en la medida de lo posible, por ser este procedimiento según algunos autores –caso de Roda Roberts (citado en Corpas Pastor 2000, p. 493)– el más acertado. Esa, pensamos, es la calificación que debería otorgársele al Td1.B, porque, aunque el alumno no haya sido capaz de mantener la desautomatización en su propuesta de traducción, ha dado con un equivalente adecuado, el refrán Donde fueres, haz lo que vieres (‘Refrán que advierte que cada uno debe acomodarse a los usos y estilos del país donde se halla’, ddR), y ha sabido insertarlo correctamente en el texto. Más lograda nos parece, por su parte, la propuesta de traducción que aparece en el Td1.C., a la que consideramos justo otorgarle la calificación de «Solución muy positiva». En su propuesta de traducción, que toma como base el mismo refrán del Td1.B, el alumno ha sabido conservar los vínculos contextuales que aparecen en el original inglés –aunque para ello haya tenido que adaptar la estructura de su paremia y sustituir el adverbio donde por la conjunción condicional si–, y el resultado es una nueva unidad fraseológica que evoca claramente el refrán de donde proviene.
En numerosas ocasiones, por otra parte, es probable que el traductor yerre a la hora de ofrecer un equivalente de la unidad fraseológica; ello puede deberse a que el traductor no haya identificado adecuadamente la unidad en el texto de origen, a que la haya identificado pero no haya sido capaz de interpretarla correctamente en el contexto o a que no haya sido capaz de dar con un equivalente adecuado. En el procedimiento en que nos encontramos –y salvo que el recurso a la équivalence haya sido fruto de la casualidad–, consideramos que el traductor podrá ofrecer
7 En los ejemplos que se muestran en las páginas que siguen, los fragmentos marcados con el código Td1.x (donde x corresponde a una letra del abecedario) son traducciones del fragmento del texto de origen identificado como to1 (vid. supra).
8 En aras de facilitar la lectura de las propuestas de traducción y para evitar marcar repetidamente estas con el adverbio sic, téngase en cuenta que, salvo el empleo del estilo negrita, el resto del texto es transcripción literal de las propuestas ofrecidas por los alumnos.
fRAseOLOgíA, TRAdUCCión y COnTROL de CALidAd
98
equivalentes defectuosos debidos a la tercera de las razones, ya que el empleo de este procedimiento denota de alguna forma competencia fraseológica por parte del traductor. Ejemplo de ello es la propuesta de traducción Td1.A, donde el alumno ha identificado la unidad fraseológica desautomatizada satisfactoriamente, la ha interpretado de forma adecuada y ha dado con su equivalente parcial pero no lo ha plasmado correctamente como resultado de una competencia lingüística defectuosa en su lengua materna: el empleo de dónde, adverbio interrogativo o exclamativo, no es correcto en este caso. Como consecuencia de esta falta de ortografía –uno de los errores que más penalización conlleva en las plantillas de traducción que hemos consultado para este trabajo–, la calificación asignada es «Error grave». Por último, consideramos posible emplear las calificaciones de «Error leve» en algunos casos en los que el traductor recurra a la équivalence.
4.2. Paráfrasis
La paráfrasis del contenido semántico-pragmático es probable que se dé por dos razones: debido a la dificultad por parte del traductor de encontrar unidades fraseológicas en la lengua de destino equivalentes a las de la lengua de origen o bien como consecuencia del desconocimiento o la escasa sensibilidad del traductor en lo que respecta a la traducción de unidades fraseológicas.
En los fragmentos que nos ocupan a continuación, resulta complicado averiguar qué ha llevado a los alumnos a recurrir a la paráfrasis; en cualquier caso, según nuestro juicio, es evidente que este procedimiento da resultados dispares en las distintas propuestas de traducción:
Td1.d: Cómo lo hacen los españoles: cuando se trata de transporte hasta casa, los españoles eligen viajar en autobús mejor que en tren. [Error grave]
Td1.e: Una vez en España, haga lo que los españoles hacen: cuando se trata de trayectos nacionales, muchos españoles prefieren, dos veces, viajar en autobús antes que en tren. [Error leve]
Td1.f: Cuando estés en España, haz lo que hacen los españoles: Cuando hablamos de transporte público, el doble de españoles prefieren viajar en autobús a hacerlo en tren. [Propuesta neutra]
Como puede verse, en la propuesta Td1.d el traductor no ha comprendido adecuadamente el significado del refrán desautomatizado, lo que origina que se pierda el valor imperativo del TO1, de ahí que haya recibido una calificación de «Error grave». Igualmente defectuosa, aunque en una escala menor –por lo tanto, su calificación es «Error leve»–, es la traducción que se ofrece en la propuesta Td1.e, ya que, aunque la paráfrasis es correcta en cuanto a la forma, se produce un error gramatical al omitir el participio en construcción absoluta (Una vez llegado a España) o el verbo en modo subjuntivo pospuesto a la locución conjuntiva una vez que (Una vez que hayas llegado a España). En cuanto a la tercera de las propuestas, la Td1.f, recibiría la calificación de «Propuesta neutra» por ofrecer un ejemplo de paráfrasis correcto desde el punto de vista semántico y gramatical. Por último, obsérvese cómo en estos tres ejemplos, cuanto mayor puntuación recibe la propuesta de traducción del refrán, mayor es también la calidad general del fragmento.
JORge LeivA ROJO
99
Aunque pensamos que será menos frecuente considerar la paráfrasis como solución positiva, no cabe duda de que puede darse el caso de que la propuesta en cuestión, ante la dificultad que suponga recurrir a la équivalence, sea merecedora de una calificación positiva. Tal es el caso del siguiente fragmento:
TO2: I decided to check out the new and improved Yankee Stadium to find out about its restaurants. The most exciting thing to me right off the bat was that all of the items up for sale at every concession stand no matter how big or small, were labeled with calories counts.
Td2.A: Me decidí a comprobar el nuevo y mejorado Yankee Stadium para conocer los detalles sobre sus restaurantes. Lo más apasionante que captó mi atención inmediatamente fueron los artículos en venta de cada puesto que sin importar su tamaño, estaban etiquetados por un recuento de calorías. [Solución positiva]
Right off the bat (‘[something that] happens immediately or at the very beginning of a process or event’, CCdi) es una locución adverbial de uso fundamentalmente estadounidense que se construye sobre una base figurativa muy marcada (el béisbol) y que, además, se actualiza en el fragmento anterior por localizarse precisamente en el entorno de ese deporte. Por lo tanto, consideramos que la calificación que habrá de recibir el alumno por esta traducción –sin entrar a considerar aquí otras cuestiones lingüísticas o de precisión del resto del texto– es la de «Solución positiva». No hemos encontrado en los textos objeto de nuestro estudio ejemplos merecedores de la calificación máxima, lo cual no es óbice de que no se pueda otorgar.
4.3. Omisión
No hay una única razón para que un traductor opte por la omisión como procedimiento de traducción, pudiendo ir desde motivaciones culturales hasta el interés del traductor por no ser redundante y pasando, por ejemplo, por ciertas indicaciones del cliente (cf. Dimitriu 2004). No obstante, consideramos que la mayoría de los casos de omisión que vamos a encontrar en traducciones realizadas por alumnos van a deberse bien a descuidos o bien a la dificultad que conlleve para el alumno la identificación, interpretación o traducción de la unidad fraseológica. Por alguna de estas razones, pensamos, no se ha ofrecido un equivalente para el refrán del TO1 en el siguiente fragmento, motivo por el cual la propuesta de traducción debería recibir una calificación de «Error leve».
Td1.g: Normalmente en España , un español prefiere dos veces más viajar en autobús que en tren, cuando escoge el transporte público nacional para viajar . [Error leve]
En función de la gravedad de la omisión, como es de esperar, se asignará una calificación más o menos grave. Aunque no hayamos encontrado ejemplos ilustrativos de ello, es posible que el evaluador se encuentre con casos de omisiones que no supongan grandes pérdidas para la comprensión o expresividad del texto, situación para la que se reservaría la calificación de «Propuesta Neutra». Finalmente para este procedimiento, se reservan las calificaciones « Solución positiva » y, menos frecuentemente, «Solución muy positiva» para el recurso a la omisión motivado por algunas de las razones expuestas por Dimitriu (2004).
fRAseOLOgíA, TRAdUCCión y COnTROL de CALidAd
100
4.4. Calco
El calco, consistente en «reexpresar libremente en el texto de llegada una palabra o los elementos de una expresión del texto de origen» (Delisle, Lee-Jahnke & Cormier 1999), es uno de los procedimientos más empleados en lo que respecta a la traducción de unidades fraseológicas. A pesar de los comentarios en contra que suele levantar el calco fraseológico en general, consideramos que no siempre es negativo y que, según las condiciones en que se produzca, este puede ser incluso beneficioso para la lengua de destino –téngase en cuenta, sin ir más lejos, que el calco es el responsable de los denominados universales o europeísmos fraseológicos–, por lo que en su evaluación podría asignarse cualquiera de las cinco calificaciones, de «Error grave» a «Solución muy positiva». A pesar de todo lo afirmado, en los textos analizados para el presente trabajo únicamente hemos encontrado casos en los que el calco supone una aportación negativa para el texto de destino, como ocurre con los siguientes fragmentos:
Td1.H: Cuando en España, hacen como el español hace: Cuando viajan en territorio nacional, son el doble de españoles los que eligen viajar en autobús que en tren. [Error grave]
Td1.i: Cuando en España queremos hacer lo que los españoles: En cuanto se refiere a un transporte doméstico, mayormente como muchos Spaniards eligen viajar en autobús en lugar del tren. [Error leve]
Como puede apreciarse, en las propuestas Td1.H y Td1.i (para consultar el fragmento original, TO.1, cf. «Équivalence»), el recurso al calco fraseológico en la traducción de When in Spain da como resultado una construcción agramatical en la lengua española. En estos casos, el nivel de gravedad viene determinado por la traducción de do as Spaniards do, con una interpretación comparativamente más defectuosa en el fragmento Td1.H. Nótese cómo, además, el recurso incorrecto al calco en ambas propuestas de traducción se corresponde con una calidad muy deficiente del fragmento en general.
4.5. Otros procedimientos
Además de los procedimientos de traducción que acabamos de analizar, existen otros procedimientos que, aunque también se dan en los textos que hemos sometido a estudio, tienen una frecuencia de uso mucho menor: nos estamos refiriendo al préstamo y a la pseudoéquivalence. No obstante, hay un único procedimiento, el de la compensación –mediante el que se introducen en el texto de destino unidades fraseológicas no presentes en el texto de origen–, que no aparece en los fragmentos analizados. Esto puede deberse, por un lado, a la tendencia general observada por Pedersen (1997, p. 105) de que los textos traducidos suelen tener menos unidades fraseológicas9 y, por otro, al hecho de que nos encontramos ante textos traducidos por estudiantes de los primeros años del Grado en Traducción e Interpretación que no han adquirido consciencia apenas sobre qué es una unidad fraseológica, por
9 A pesar de que Pedersen realizar esta afirmación en relación con los textos literarios, la incluimos aquí por considerarla igualmente válida para nuestro estudio.
JORge LeivA ROJO
101
lo que difícilmente recurrirán a la compensación a no ser que lo hagan de forma involuntaria. En cualquier caso, consideramos que, de aparecer compensaciones en una traducción que se ha de evaluar, las categorías empleadas serían «Error grave», «Error leve», «Propuesta neutra» y, ocasionalmente, «Solución positiva». No pensamos que se deba premiar el recurso a este procedimiento puesto que su abuso puede dar como resultado un texto de destino excesivamente alejado del texto de origen.
En lo que respecta al préstamo –entendido como la transferencia de signos de la lengua de origen a la lengua de destino–, solamente hemos encontrado un único caso reseñable en todos los textos: se trata de la traducción del refrán inglés The early bird catches the worm (‘the person who seizes the earliest opportunity of doing sth (eg getting up before others, reacting faster than others to a situation, etc) will get what he wants, be successful at the expense of others etc’, OdCie). En este caso, puede verse claramente que se da el préstamo no como un recurso creativo que aporte en el texto de destino el color de la lengua de origen (principal motivador del préstamo, según Vinay & Darbelnet [2004, p. 129]), sino que su empleo lo origina un error de comprensión del indicador metadiscursivo del texto de origen saying, razón por la que creemos que esta propuesta de traducción es merecedora de la calificación « Error leve ».
TO3: Lazy People Don’t Get RichI know everyone remembers the old saying “The early bird gets the worm.” That has proven to be true.
Td3.A: La gente perezosa no se enriqueceSe que todo el mundo recuerda la vieja canción «The early bird gets the worm», que ha demostrado ser cierta. [Error grave]
El resto de calificaciones que pensamos se podrían utilizar para este procedimiento son «Error leve», «Propuesta neutra» y «Solución positiva». Téngase en cuenta que el calco es uno de los procedimientos más empleados para los neologismos fraseológicos, por lo que no se debe coartar su empleo, aunque tampoco fomentarlo en exceso, motivo este último por el que se suprime la opción de otorgar la calificación de «Solución muy positiva».
El último de los procedimientos de traducción que se ha empleado es el de la pseudoéquivalence, consistente en ofrecer una secuencia de palabras con apariencia de unidad fraseológica, parcialmente similar a la unidad fraseológica del texto de origen y que guarda cierto parecido con algunas unidades fraseológicas de la lengua de destino. De todos los textos que hemos analizado, encontramos un único caso de pseudoéquivalence en la traducción de un fragmento del TO1:
Td1.J: En España, como en España: En lo que se refiere a viajar en el ámbito nacional, hay más del doble de españoles que eligen viajar en autobús que en tren. [Propuesta neutra]
En el caso que nos ocupa, vemos cómo el alumno, probablemente de forma involuntaria, ofrece una secuencia de palabras que podría haberse construido sobre la base de la paremia (aunque cercana a las fórmulas rutinarias) En casa, como en ningún sitio, que se emplea para resaltar las comodidades que se tienen en el entorno propio o del interlocutor o para expresar lamento por no tenerlas
fRAseOLOgíA, TRAdUCCión y COnTROL de CALidAd
102
cerca. En este caso, consideramos que la calificación que debería otorgársele a este fragmento es «Propuesta neutra», puesto que la ilusión de unidad fraseológica que crea es relativamente adecuada y, sobre todo, guarda relación con el sentido del refrán del texto de origen. En cuanto al resto de calificaciones posibles, consideramos que, en función de la situación, podría otorgarse cualquiera de las cinco enunciadas anteriormente, aunque se nos antoja complicado encontrar casos en los que la pueda darse una calificación de «Solución muy positiva».
5. COnCLUsiOnes
Como se ha visto en las páginas anteriores, en los últimos años hemos asistido a un auge en lo que al control de calidad en la traducción se refiere. De una parte, han surgido –y siguen surgiendo– normas que tienen por objeto determinar qué se entiende por calidad en el ámbito de la traducción y, sobre todo, qué procedimientos deben ponerse en práctica para conseguirla. De otra parte, son numerosos los estudiosos que se han encargado de analizar la calidad desde numerosas vertientes. En lo concerniente a la aplicación práctica de normas de calidad y estudios teóricos, una de las principales aportaciones son las plantillas para la evaluación, revisión y corrección de revisiones. Las dos últimas, orientadas al ámbito profesional de la traducción, nos han servido de modelo para elaborar una plantilla que pueda emplearse con el objeto de evaluar cómo abordan los alumnos la traducción de unidades fraseológicas. La motivación para este trabajo es doble: por una parte, se pretende combinar control de calidad y fraseología en un único estudio, ya que, salvo por referencias puntuales, esta ha permanecido tradicionalmente ajena a los estudios sobre la evaluación de traducciones. Por otra, nuestra intención, atendiendo a lo expresado por Campbell & Hale (2003, p. 205) y Bonnet (2006, p. 2), ha sido intentar utilizar las distintas normas de traducción como una herramienta educativa que permita que el alumno tenga conocimiento durante sus estudios de cómo se habrá de desarrollar su labor profesional en el futuro.
En lo que respecta al modelo para la evaluación de unidades fraseológicas que hemos presentado, a pesar de encontrarse aún en un estadio inicial, estamos en condiciones de concluir que es posible armonizar parámetros de evaluación para medir la calidad en la traducción de unidades fraseológicas, aunque, como se ha visto, no todas las categorías de errores o de soluciones positivas son de aplicación para todos los procedimientos de traducción. Igualmente, hemos observado una tendencia que nos resulta especialmente interesante: en líneas generales, el nivel de calidad obtenido por los alumnos en la traducción de unidades fraseológicas se corresponde con un nivel análogo en el resto de los fragmentos analizados. Esta observación, sobre la que es preciso seguir avanzando en estudios ulteriores, coincide con lo expresado por Ferro Ruibal (1996, p. 104), quien no duda en afirmar que «o dominio da fraseoloxía é o máis alto nivel de dominio de calquera lingua».
Igualmente, creemos necesario señalar que la perspectiva aplicada del trabajo que aquí presentamos debería ayudar a redefinir qué se considera bueno o aceptable o qué se considera malo o inaceptable –y por lo tanto censurable– en lo referente
JORge LeivA ROJO
103
a la búsqueda de equivalentes de unidades fraseológicas en otra lengua y, sobre todo, a los procedimientos de traducción que han de emplearse. Ello supone, por lo tanto, no solo seguir luchando contra la opinión, demasiado extendida, de que solo hay un procedimiento posible –según palabras de Corpas Pastor (2003, p. 264), «poco se ha avanzado desde las teorías clásicas de Vinay y Darbelnet (1995[1958]) y de Vázquez Ayora (1977) que concebían la équivalence como el procedimiento por excelencia para traducir la fraseología»–, sino también desterrar visiones simplistas en las que, aunque se reconozca la existencia de más de un procedimiento, estos se dividen en dos grupos –los positivos y los negativos–, entendidos como compartimentos estancos que, por lo demás, se oponen entre sí de manera frontal y tajante. Fijémonos, a modo de ejemplo, en el calco como procedimiento directo de traducción de unidades fraseológicas: aunque entendido y defendido por algunos autores desde hace incluso décadas (caso de Hervey, Higgins & Haywood [1995], p. 26-27 y, con matices, Vinay & Darbelnet [1995], p. 32-33), aún sigue siendo denostado por la mayoría de investigadores, hasta el punto de ser difícil encontrar estudios teóricos en los que se consienta su empleo. Ahí es donde interviene, según nuestro punto de vista, el modelo de evaluación que presentamos en este trabajo, ya que pretende desterrar los tópicos de que el recurso a la équivalence siempre arroja resultados positivos o de que la paráfrasis, la compensación, la omisión, el préstamo, el calco o la pseudoéquivalence son recursos de segunda fila que han de emplearse solamente cuando la équivalence no sea posible. Aunque el camino que queda por recorrer es largo aún, consideramos que este trabajo puede contribuir a allanarlo.
BiBLiOgRAfíA
Repertorios lexicográficos citados de forma abreviadaCCdi: Potter, Elizabeth et al. (eds.) (1995). Collins Cobuild Dictionary of Idioms, Londres,
CollinsCobuild.ddR: Campos, Juana G. & Barella, Ana (1975). Diccionario de refranes. Anejos del Boletín
de la Real Academia Española xxx, Madrid, Real Academia Española.OdCie: Cowie, A. P., Mackin, R. & McCaig, I. R. (1984). Oxford Dictionary of Current
Idiomatic English. Volume 2: Phrase, clause & sentence idioms, Oxford, Oxford University Press.
Obras consultadasAENOR (2006). Norma europea de calidad para servicios de traducción. Requisitos para
la prestación del servicio. UNE EN-15038:2006, Madrid, AENOR.Arevalillo Doval, Juan José (2004). «La norma europea de calidad para los servicios de
traducción», González, Luis & Hernúñez, Pollux (ed.), Las palabras del traductor: Actas del II Congreso « El español, lengua de traducción ». 20 y 21 de mayo, 2004. Toledo, Bruselas, Esletra, 89-100.
Arevalillo Doval, Juan José (2010). « Traducción y normalización: esa hermandad necesaria ». Donde Dice… 17 (enero-abril de 2010), 8-10.
ASTM International (2006). ASTM F-2575 – 06 Standard Guide for Quality Assurance in Translation, West Conshohocken (Pensilvania), ASTM International.
fRAseOLOgíA, TRAdUCCión y COnTROL de CALidAd
104
Boletín Oficial del Estado. (2006). «Resolución de 10 de octubre de 2006, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de septiembre de 2006», 287, 1 de diciembre de 2006, 42420.
Bonnet, Beatriz (2006). «So…Is There a Good Thing About Standards?» [en línea], <http://www.ata-divisions.org/LTD/article/2006%20July_Standards.pdf> (consulta: 9 de abril de 2012). Reimpresión del artículo aparecido en The ATA Chronicle 35(13).
Brumme, Jenny (2008). «La traducción de la frase hecha. El caso del castellano de Cataluña», González Rey, M.ª Isabel (ed.), A multilingual focus on contrastive phraseology and techniques for translation, Hamburgo, Dr. Kovac, 55-72.
Campbell, Stuart & Hale, Sandra (2003). «Translation and interpreting assessment in the context of educational measurement», Anderman, Gunilla M. & Rogers, Margaret (eds), Translation today: trends and perspectives, Clevedon, Multilingual Matters, 205-224.
Corpas Pastor, Gloria (1996). Manual de fraseología española, Madrid, Gredos.Corpas Pastor, Gloria (2000). «Acerca de la (in)traducibilidad de la fraseología», Corpas
Pastor, Gloria (ed.), Las lenguas de Europa: Estudios de fraseología, fraseografía y traducción, Granada, Comares, 483-522.
Corpas Pastor, Gloria (2001). «La traducción de unidades fraseológicas: técnicas y estrategias», de la Cruz Sabanillas, Isabel, Santamaría García, Carmen, Tejedor Martínez, Cristina & Valero Garcés, Carmen (eds.), La lingüística aplicada a finales del siglo XX. Ensayos y propuestas, 2 vols, Alcalá de Henares, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 779-787.
Corpas Pastor, Gloria (2003). Diez años de investigación en fraseología: análisis sintáctico-semántico, contrastivos y traductológicos, Madrid, Iberoamericana.
Corpas Pastor, Gloria (2006). «Translation Quality Standards in Europe: An Overview», Miyares Bermúdez, Eloína & Ruiz Miyares, Leonel (eds.), Linguistics in the Twenty First Century, Cambridge; Santiago de Cuba, Cambridge Scholars Press; Centro de Lingüística Aplicada, 47-57.
Corpas Pastor, Gloria (2007). «European Quality Standards for Translation Services», Multilingual 18(3), 65-72.
Delisle, Jean, Lee-Jahnke, Hannelore & Cormier, Monique C. (1999). Terminologie de la traduction, Ámsterdam, John Benjamins.
Deutschen Institut für Normung (1998). DIN 2345:1998: Übersetzungsaufträge, Berlín, Beuth.
Díaz de Liaño, Enrique (2010). «Las empresas de la industria de la lengua», Donde Dice… 17 (enero-abril de 2010), 1-3.
Dimitriu, Rodica (2004). «Omission in translation», Perspectives: Studies in Translatology, 12(3), 163-175.
Dollerup, Cay (1994). «Systematic feedback in teaching translation», Dollerup, Cay & Lindegaard, Annette (eds), Teaching translation and interpreting 2: insights, aims, visions, Ámsterdam, John Benjamins.
Ferro Ruibal, Xesús (1996). Cadaquén fala como quen é. Reflexións verbo da fraseoloxía enxebre, A Coruña, Real Academia Galega.
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of People’s Republic of China (2003). GB/T 19363. 1-2003. Specification for Translation Service – Part 1: Translation, Beijing, China Standardization Press.
Hervey, Sándor, Higgins, Ian & Haywood, Louise M. (1995). Thinking Spanish Translation. A Course in Translation Method: Spanish to English, Londres; Nueva York, Routledge.
House, Juliane (2001). «Translation quality assessment: Linguistic description versus social evaluation», Meta: Journal des Traducteurs 46 (2), 243-257.
House, Juliane (1977). A model for translation quality assessment, Tubinga, Gunter Narr.House, Juliane (1997). Translation quality assessment: A model revisited, Tubinga, Gunter Narr.Lee-Jahnke, Hannelore (2001). «Aspects pédagogiques de l’évaluation en traductions»,
Meta: Journal des Traducteurs 46 (2), 258-271.
JORge LeivA ROJO
105
Mogorrón Huerta, Pedro & Mejri, Salah (dirs.) (2009). Fijación, desautomatización y traducción. Figement, défigement et traduction, Alicante, Universidad.
Mossop, Brian (2001). Revising and Editing for Translators, Mánchester; Northampton, St. Jerome.
Newmark, Peter (2003). «No global communication without translation», Anderman, Gunilla M. & Rogers, Margaret (eds), Translation today: trends and perspectives, Clevedon, Multilingual Matters, 55-67.
Österreichisches Normungsinstitut (2000a). ÖNORM D 1200 Edition: 2000-12-01 - Translation and interpretation services. Translation services. Requirements for the service and the provision of the service, Viena, Österreichisches Normungsinstitut.
Österreichisches Normungsinstitut (2000b). ÖNORM D 1201 Edition: 2000-07-01 - Translation services. Translation contracts. Translation and interpretation services. Viena, Österreichisches Normungsinstitut.
Pedersen, Viggo Hjørnager (1997). «Description and criticism: Some approaches to the English translations of Hans Christian Andersen», Trosborg, Anna (ed.), Text typology and translation, Ámsterdam; Filadelfia, John Benjamins, 99-115.
Peña Pollastri, Ana Paulina (2009). «Evaluation criteria for the improvement of translation quality», Forstner, Martin & Lee-Jahnke, Hannelore (eds), CIUTI-Forum 2008: Enhancing translation quality: ways, means, methods, Berna; Berlín; Bruselas, Peter Lang, 239-260.
Schäffner, Christina (1998). Translation and Quality, Clevedon, Multilingual Matters.Vinay, Jean Paul & Darbelnet, Jean (1995). Comparative Stylistics of French and English: A
Methodology for Translation, Ámsterdam; Filadelfia, John Benjamins.Vinay, Jean-Paul & Darbelnet, Jean (2004). «A methodology for translation», Venuti,
Lawrence (ed.), The Translation Studies Reader. Second edition, Nueva York; Londres, Routledge, 128-137.
fRAseOLOgíA, TRAdUCCión y COnTROL de CALidAd
annexe
LA LINguISTIquE hISPANIquE dANS HEl
Anne-Marie Chabrolle-CerretiniUniversité de Lorraine, ATILF-UMR 7118
Cet article a comme objectif de proposer une vision d’ensemble raisonnée de la linguistique hispanique telle qu’elle se dégage des articles et des comptes rendus d’ouvrages publiés dans HEL et dans une moindre mesure celui de contextualiser ces connaissances en histoire et épistémologie de la linguistique hispanique dans l’hispanisme espagnol.
Ainsi après une rapide synthèse des données en jeu, nous traiterons les thèmes et les problématiques abordés dans HEL et la représentation de la linguistique hispanique qu’ils donnent à voir sur fond des études en cours en Espagne.
1. Les dOnnees
Le premier numéro de HEL paraît en 1979. À raison de deux volumes par an, la revue, liée à la S.H.E.S.L. née un an plus tôt, entend favoriser la circulation des connaissances en ce qui concerne l’histoire et l’épistémologie de l’ensemble des sciences du langage. Jusqu’en 1996 la revue a été pensée autour de numéros
AbstractThis paper analyses the different articles and reviews published in HEL about Spanish Linguistics. We will try to show how we can imagine this tradition through these texts.
KeywordsHistory of linguistics, Spanish linguistics, Journal, HEL
RésuméCet article propose une analyse des différents articles et compte rendus concernant la linguistique hispanique publiés dans HEL L’enjeu est d’essayer de dégager une représentation de cette tradition nationale aux travers de ces textes.
Mots clefsHistoriographie, linguistique hispanique, revue HEL
Histoire Épistémologie Langage 34/II (2012) p. 107-122 © SHESL
108 Anne-MARie CHABROLLe-CeRReTini
thématiques tout en introduisant rapidement un numéro hors thème tous les quatre volumes. À partir de 1996, la revue a aménagé des numéros varia ainsi que des nouvelles rubriques comme « idées et discussions », « archives et documents » et « lectures et critiques » qui, sans structurer systématiquement chacun des numéros, indiquent à la fois une réflexion nourrie sur le rôle d’une revue dans la constitution d’une discipline et le nombre croissant de spécialistes du domaine amenés à participer à ces échanges scientifiques.
Il est donc possible de livrer un premier chiffre qui tient compte de l’évolution de la formule éditoriale de HEL De 1976 à 1996, 13 articles renvoyant à la linguistique hispanique sont publiés dont 10 dans le tome 9 consacré à « La tradition espagnole d’analyse linguistique », paru en 1987. De 1996 à aujourd’hui 4 articles sont publiés et 14 comptes rendus dans la section « lectures et critiques ». Au total nous comptabilisons 17 articles et 14 comptes rendus.1 Ce chiffre appelle immédiatement des remarques sur l’option théorique et méthodologique qui a conduit à une telle collecte de textes, articles et comptes rendus confondus.
Mes premières observations portent sur ce qui est désigné par « linguistique hispanique ». La définition de l’adjectif « hispanique » renvoie à ce qui est « relatif à l’Espagne, à sa civilisation répandue en Amérique Latine.2». La première décision est claire : a été collecté tout ce qui a trait à l’espace géographique comprenant l’Espagne et l’Amérique latine sauf le Brésil.
La deuxième décision est peut-être plus discutable, mais elle est motivée. En effet sur ces territoires il a été et il est encore parlé bien d’autres langues que l’espagnol. C’est le cas de l’Amérique Latine. La plupart des langues amérindiennes ont commencé à être décrites à partir du XVIe siècle par des espagnols dans leur langue maternelle. Nous pouvons dès lors considérer que ce domaine descriptif entre dans la linguistique hispanique puisque largement développé par des hispanophones, conscients ou non d’un savoir de tradition romane qui allait devenir un pan caractéristique de la linguistique menée par les Espagnols. Reste que bien évidemment ces langues ne sont pas la propriété des missionnaires de la Renaissance ni des linguistes hispanophones contemporains. Il semblait légitime de se poser alors la question du traitement à réserver à un article écrit par un linguiste francophone sur R. Rask et la transcription des langues amérindiennes. Il a été finalement écarté pour les mêmes raisons qu’un compte rendu d’un livre de Lyle Campbell sur les langues de Méso-amérique. Le premier texte porte certes sur des langues amérindiennes, mais convoquées dans le cadre de la Grammaire comparée. Le compte rendu concerne ces mêmes langues, mais considérées dans le débat houleux des reconstitutions génétiques qui va du XIXe siècle à Greenberg et Ruhlen. Quatre comptes rendus d’ouvrages d’anglophones n’ont pas été retenus non plus. Ils constituent en effet les actes de colloques qui ont jalonné le « Oslo Project Missionary Linguistics » financé par la recherche norvégienne et concernent des langues d’ex-colonies espagnoles mais aussi des langues d’Asie, États-Unis, Canada, et du Brésil. Si ces textes n’entrent pas dans
1 Voir Appendice 1. Tous les articles et comptes rendus sont accessibles sur le site de la revue dans la rubrique « les archives d'HEL ». (À partir du tome 17 la numérotation se fait en chiffres romains).
2 Définition du CNRTL.
109LA LingUisTiqUe HisPAniqUe dAns Hel
notre corpus, ils sont intéressants en revanche pour le débat qu’ils ouvrent sur le statut disciplinaire de la « linguistique missionnaire » qu’ils cautionnent. Une telle reconnaissance aurait, me semble-t-il, entre autres conséquences celle de ne plus relier explicitement ces études aux linguistiques des pays européens ayant mené les conquêtes3et colonisations, mais les arguments scientifiques ne valident pas une telle revendication. Le plurilinguisme est aussi la réalité de l’Espagne. HEL n’a publié aucun texte sur le basque, ce qui nous a évité de nous poser la question de savoir si le seul fait d’être historiquement présent sur le territoire ibérique scelle une appartenance à la linguistique ibérique, ou plus exactement à tous les champs linguistiques hispaniques car dès lors que l’on inclut la sociolinguistique et les politiques linguistiques on parle alors bien évidemment de toutes les langues d’Espagne reconnues officiellement par la constitution de 1978. Enfin, s’est posée la question d’un article écrit par un hispanophone sur deux linguistes francophones qui finalement n’a pas été retenu, le critère du thème abordé (Meillet-Mounin) ayant prévalu sur le « regard hispanique » porté sur une linguistique générale qui dépasse les frontières linguistiques du pays d’origine.
En fait la nature des articles et des comptes rendus n’a pas fait l’objet d’un arbitrage trop épineux mais nous constatons que la question des limites d’une linguistique nationale et ses critères définitoires (territoire géographique et les langues parlées sur ce territoire, méthodes d’investigations, références théoriques etc.) devient assez rapidement un vrai débat complexe et souvent passionné.
Les textes et les comptes rendus ont été classés thématiquement à partir des seuls intitulés. En effet, il eut été intéressant de s’en remettre aux mots-clés mais ceux-ci ne précèdent les articles que depuis 1955. J’ai ainsi opéré les 10 regroupements suivants4 :
3 Comptes rendus rédigés par E. Bonvini, HEL, tome XXX, fasc. 2, 2008 et tome XXXII, fasc. 2, 2010.
4 Pour le détail, voir Appendice 2.
Nombre d’articles
Nombre de comptes rendus
Épistémologie de la linguistique espagnole 2 2Lexicographie 2Didactique de l’espagnol 2La Renaissance 3 5Le traitement des langues amérindiennes 3Le XVIIIe siècle 3 2La linguistique des XIXe et XXe siècles 1 1L’apprentissage du français en Espagne 1 2Le catalan 1Les grammaires latines en Espagne 1
17 articles 14 comptes rendus
110 Anne-MARie CHABROLLe-CeRReTini
2. Les THeMATiqUes d’Une LingUisTiqUe HisPAniqUe
Le numéro portant sur « la tradition espagnole d’analyse linguistique » dirigé par Ramón Sarmiento paraît en 1987, soit 8 ans après la création de la revue et fait suite à 2 numéros thématiques consacrés respectivement à la tradition arabe et à la réflexion linguistique des XVIIe et XVIIIe siècles en Grande-Bretagne. La constitution du numéro, comme sa date précoce de parution dans l’histoire éditoriale de HEL, témoigne, s’il en était besoin, de l’importance, la spécificité et de la richesse de la linguistique hispanique.
Dans le but de présenter la tradition espagnole comme « une façon d’agir et de penser qui se transmet de génération en génération5 », R. Sarmiento expose les différentes thématiques retenues : la lexicographie, la didactique des langues, les langues amérindiennes, la linguistique historique, les catégories grammaticales et le normativisme linguistique. Il convient avoir écarté volontairement des thématiques désormais connues autour de grands grammairiens comme Antonio de Nebrija et Franciscus Sanctius (Francisco Sánchez) ainsi que des sujets comme la Real Academia Española, « [des arbres] tellement hauts qu’ils finissent par cacher la forêt […]6 » et avoir donné la priorité à l’originalité.
À titre de comparaison, si nous consultons le programme des communications du premier congrès de la SEHL, l’équivalent espagnol de la SHESL, la Sociedad Española de Historiografía Lingüística qui se déroula à La Corogne en février 1997, nous observons que les thématiques choisies par R. Sarmiento sont représentatives des travaux et interrogations en cours : la grammatisation de l’espagnol – grammaires et dictionnaires – , histoire de la linguistique (thématique attendue en raison de la nouveauté disciplinaire en Espagne), grammaire en Amérique Latine, grammaire scolaire, le XVIIIe siècle. Si nous poursuivons le parallèle avec le second congrès qui se tint à León en mars 1999, nous retrouvons globalement ces mêmes thématiques, agencées et présentées différemment, il est question cette fois de lexicographie, de métalinguistique et terminologie, d’épistémologie, de variation linguistique et d’un nombre non négligeable de communications sur Antonio Nebrija et Wilhem von Humboldt (pour ses descriptions grammaticales de langues amérindiennes et sa linguistique générale).
Si maintenant nous projetons ces thématiques sur l’ensemble de notre corpus nous constatons qu’elles correspondent en grande partie à ce que nous pouvons lire dans la revue. Pour le vérifier il faut en fait croiser les thématiques avec les époques privilégiées ou encore avec les études portantes sur les œuvres de grammairiens-phares. Il convient aussi de tenir compte de la diversité des démarches intellectuelles, celles qui partent des objets pour aller vers le champ linguistique et celles qui privilégient la dynamique inverse. Nous lisons ainsi deux articles qui abordent les dictionnaires ou la lexicographie.7
Nous pouvons également reconnaître une réelle convergence entre des textes annonçant la description du castillan au XVe siècle, les idées linguistiques de
5 Sarmiento, « Introduction », HEL, tome 9, 1987, p. 8. 6 Sarmiento, « Introduction », HEL, tome 9, 1987, p. 8. 7 Hans-Josef Niederehe, « La lexicographie espagnole jusqu’à Covarrubias », HEL, tome 8,
fasc. 1, 1986. [p.9-19], Hans-Josef Niederehe, « Les dictionnaires franco-espagnols jusqu’à 1800 », HEL, tome 9, fasc. 2, 1987. [p.13-26].
111LA LingUisTiqUe HisPAniqUe dAns Hel
Nebrija et la Gramática castellana de Nebrija. De même nous pouvons repérer une certaine identité de contenu entre un intitulé qui annonce « la grammatisation des langues indigènes d’Amérique latine » et un autre « les langues amérindiennes à la Renaissance ». Ou encore voir un point commun entre des intitulés comme « la langue française en Espagne au XVIe », « les premières grammaires françaises en Espagne du XVIe au XVIIIe » et « l’enseignement du français en Espagne au XVIIIe dans ses grammaires ». En fait, les lignes forces de la linguistique hispanique sont abordées par de multiples facettes.
Nous trouvons majoritairement abordées les périodes correspondant à la Renaissance, le XVIIIe et plus récemment le traitement des XIXe et XXe. Celles-ci recoupent les différentes thématiques et problématiques les plus largement traitées: la grammatisation du vernaculaire castillan, la grammatisation des langues amérindiennes, les dictionnaires, les œuvres de Nebrija, S. Abril et L. Hervás, les problématiques liées à l’enseignement des langues, notamment le français et la question de la norme.
2.1 La Renaissance
Comme l’a fort bien synthétisé Luce Giard (Giard 1992, p. 206-225), à la Renaissance, toutes les nations de l’Europe sont confrontées à de semblables enjeux politiques, économiques, culturels et linguistiques et chacune y répondra diversement. Si toutes les nations se posent la question de la langue susceptible de les représenter, la normativisation de celle-ci, la distanciation à opérer par rapport au latin classique, langue dominante de l’écrit et de la circulation des savoirs, ce dernier défi est plus complexe à relever pour les nations de vernaculaires romans.
L’Espagne ne fait pas exception et c’est elle qui initie le processus de grammatisation des vernaculaires romans si l’on considère, comme l’indiquent Pierre Swiggers et Serge Vanvolsem8, que le traité grammatical sur le toscan de Leon Battista Alberti écrit vraisemblablement vers 1441 a très peu circulé dans la deuxième moitié du XVe siècle et n’a exercé pratiquement aucune influence sur les questions linguistiques de l’époque. En effet, c’est en 1492 qu’est imprimée la première grammaire du castillan dont la métalangue est en castillan, la Gramática de la lengua castellana de Nebrija. Cette date est hautement symbolique puisqu’elle coïncide à la fois, avec la prise de Grenade, le dernier royaume musulman à tomber marquant la fin de la Reconquête de la péninsule ibérique par les Rois Catholiques et la découverte de nouveaux territoires outre-atlantique. La grammaire a été commencée en fait quelques années auparavant mais avec Nebrija commencent deux traditions fortes, la tradition grammaticale et la tradition lexicographique car ce grammairien andalou est également l’auteur de deux dictionnaires, Diccionario latino-español (1492) et Diccionario español-latino (1495).
8 Pierre Swiggers et Serge Vanvolsem, « Les premières grammaires vernaculaires de l’italien, de l’espagnol et du portugais », HEL, tome 9, fasc. 1, 1987, p. 158.Attesté aussi par Alessandro Mosca, « De la volgar lingua de Fortunio à la lingua italiana de Ruscelli. L’identité linguistique en question dans les premières grammaires italiennes. », Revue des langues romanes, De la description des langues romanes : aperçu historique des définitions et des classifications, éd, Teddy Arnavielle et Anne-Marie Chabrolle-Cerretini, Montpellier, 2012.
112
L’œuvre de Nebrija, on s’en doute, a été abondamment traitée. Dans HEL, nous accédons à la diversité des études sous fond de débat méthodologique et épistémologique. Nous découvrons ainsi une approche strictement philologique développée par Miguel Ángel Esparza Torres9 qui se refuse à une lecture moderne par crainte d’anachronisme et restitue la posture grammaticale de Nebrija parmi les études grammaticales de son époque pour en souligner la précocité.
C’est au contraire une investigation interne à laquelle se livre Francis Tollis10 dont l’enjeu est de montrer la cohérence conceptuelle de l’ensemble de l’œuvre du grammairien. Quelle que soit l’optique choisie, sont développées les innovations théoriques de Nebrija comme par exemple les concepts de « boz » et « letra » qui préfigurent les propositions orthographiques régulatrices et en définitive l’écriture phonologique de l’espagnol. Le terme de « letra » désigne le graphème soit l’élément qui sert à représenter la « boz » ou dit encore autrement la « letra » est la représentation graphique du phonème. « Boz », synonyme de prononciation, renvoie au son et au mot prononcé. Cette différenciation de l’unité minimale sonore et graphique intègre une hiérarchie constituée successivement de la « palabra » (mot écrit), puis de la « dición », de la « parte de la oración » pour se terminer par la « oración ».
L’historiographie linguistique qui commence véritablement en Espagne dans les années 1980 est entrée dans une autre étape avec les moyens informatiques qui permettent d’interroger de façon plus systématique et différemment les textes (occurrences- synonymes-antonymes, contexte, etc.). Ce qui ressort très nettement de ces travaux est l’attention particulière portée à la constitution de bases bibliographiques. Cette préoccupation est presque indispensable face aux œuvres incontournables espagnoles mais elle révèle surtout un réel souci historiographique et une générosité scientifique. La base de Hans-Josef Niederehe et Miguel Ángel Esparza Torres11par exemple qui porte sur les œuvres de Nebrija recense toutes les éditions ainsi que tous les travaux critiques écrits jusqu’à aujourd’hui permettant ainsi un travail objectif sur la réception de ces ouvrages. À noter que le compte rendu sur la bibliographie complète avantageusement l’ouvrage qu’il recense.
La lexicographie espagnole, riche de grands noms, est représentée dans la revue par les travaux de Hans-Josef Niederehe12 qui sont des recensements et des analyses de tous les dictionnaires espagnols ou bilingues français-espagnol depuis
9 Compte rendu de Miguel Ángel Esparza Torres, Las ideas lingüísticas de Antonio de Nebrija, Münster, Nodus Publikationen, 1995, rédigé par Francis Tollis, 1997, HEL, tome XIX, fasc. 1.
10 Compte rendu de Francis Tollis, La description du castillan au XVe siècle : Nebrija et Villena. Sept études d’historiographie linguistique. Paris, 1998, rédigé par Brigitte Lépinette, 1999, HEL, tome XXI, fasc. 1.
11 Compte rendu de Miguel Ángel Esparza Torres, Hans-Josef Niederehe, Bibliografía nebrisense. Las obras completas del humanista Antonio de Nebrija desde 1481 hasta nuestros días, John Benjamins 1999, rédigé par Francis Tollis, 2000, HEL, tome XXII, fasc. 1.
12 Hans-Josef Niederehe, « La lexicographie espagnole jusqu’à Covarrubias », Dictionnaires, Grammaires, Catégories, Philosophie, Déchiffrement, tome 8, fasc. 1, 1986. [p.9-19] ; Hans-Josef Niederehe, « Les dictionnaires franco-espagnols jusqu’à 1800 », HEL, tome 9, fasc. 2. 1987. [p. 13-26]
Anne-MARie CHABROLLe-CeRReTini
113
Nebrija jusqu’au XVIIIe siècle. Ces ouvrages, à l’instar de la grammaire du castillan de Nebrija marquent non seulement l’histoire lexicographique de l’Espagne mais aussi celle des langues romanes car leur précocité, leur originalité souvent, en ont fait des modèles et des références toujours actuelles comme le Tesoro de las dos lenguas francesa y española (1603) de César Oudin, le dictionnaire bilingue latin-espagnol (1492) et le vocabulaire espagnol-latin (1495) de Nebrija célébrés pour leur nombre d’entrées longtemps inégalé ou encore le dictionnaire de F. Sobrino au XVIIIe siècle. On sait par ailleurs que cette tradition se prolonge par des ouvrages récents comme celui de Joan Corominas Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana édité à partir de 1956 puis sous une forme brève, ouvrage de consultation incontournable. Les productions de la Real Academia Española fondée en 1713, soutenue aujourd’hui par 22 académies de langue espagnole (ibéro-américaines), alimentent aussi cette tradition (en mai 2012, une cinquième révision du Diccionario de la lengua española de l’édition de 2001 enregistre 1697 modifications et la prochaine édition du dictionnaire est prévue en 2014). Cette institution intervient aussi dans les révisions orthographiques et grammaticales (dans l’esprit des propositions de Nebrija pour tendre vers une correspondance régulière entre phonèmes et graphèmes, en 2011, la RAE a pris la décision de modifier l’alphabet et d’en sortir -ch- et -ll-, considérées désormais comme des diagraphes, ou encore de ne retenir qu’un seul nom « uve » pour le -v- et non plus aussi « ve », etc.). À noter aussi que la RAE propose un accès gratuit à son dictionnaire en ligne et une base de consultation grammaticale.
Un autre aspect des discussions linguistiques dans les pays romans de la Renaissance concerne la filiation des langues. Chacune des nations a connu ses thèses fantaisistes, là encore l’Espagne ne déroge pas à la règle d’autant que la présence du basque aux origines mystérieuses et à la structure « étrange » a compliqué la recherche génétique des langues d’Espagne. Dans le compte rendu qui est fait du travail de Lucia Binotti13 sur les Discursos (1595-1601) de Gregorio López Madera nous découvrons la thèse du castillan primitif. Ces textes ont été rédigés après la découverte, à Grenade, en 1588, d’un parchemin et de livres de plomb, connus sous le nom d’apocryphes du Sacromonte, documents écrits en partie en castillan daté de l’époque de Néron. Ces textes dont il fut reconnu par la suite l’inauthenticité, très populaires14, ont été rédigés, en réalité, fin du XVIe par des Maures et des convertis pour tenter une réconciliation entre l’Islam et le christianisme en terre espagnole.
2.2 L’enseignement/apprentissage des langues
La problématique de l’enseignement/apprentissage des langues traverse les siècles depuis la Renaissance en se concentrant sur l’espagnol comme langue maternelle ou étrangère et le français. Ces orientations sont assez attendues. La possibilité
13 Compte rendu de Lucia Binotti, La teoría del « Castellano Primitivo » Nacionalismo y reflexión lingüística en el Renacimiento español, Münster, Nodus Publikationen, 1995, rédigé par Francis Tollis, 1996, tome XVIII, fasc. 2.
14 Le roman historique La mano de Fatima d'Ildefonso Falcones de Sierra (2009) faisant des livres de plomb la pierre angulaire de la vie du protagoniste principal, atteste de la popularité de ces textes dans la culture espagnole.
LA LingUisTiqUe HisPAniqUe dAns Hel
114
d’une unification linguistique du pays dès le XVIe siècle comme le passé colonial de l’Espagne marquent la réflexion didactique. Quant à l’intérêt d’apprendre le français pour les Espagnols ou d’enseigner l’espagnol aux Français, il est, de doute évidence, fondé sur les contacts diversifiés et constants entre les deux pays même s’ils sont parfois conflictuels. Sabina Collet-Sedola15 apporte un éclairage particulier sur la didactique de l’espagnol en France au XVIIe siècle en révélant le rôle tenu par les espagnols exilés qui devinrent par nécessité, parfois, maîtres de langue. La comparaison, recueils de petites histoires parfois bilingues, ouvrages d’idiotismes, aide-mémoires, grammaires, tous les moyens didactiques furent inventés et mis en œuvre, avec succès pour satisfaire les envies de la bourgeoisie et des commerçants.
Brigitte Lepinette16 nous propose le chemin inverse et analyse les grammaires du français en Espagne du XVIe au XVIIIe siècle. Le recensement et la typologie de ces ouvrages (grammaire aide-mémoire, grammaire formatrice, grammaire des observations et les Arts) nous montrent l’importance quantitative et l’originalité de cette production grammaticale. Ainsi la grammaire des observations qui s’intéresse à l’usage et aux contenus grammaticaux à mémoriser. Ce travail montre aussi les influences réciproques exercées, les modèles reconduits et les choix pédagogiques qui marquent notamment le XVIIIe siècle.
2.3. Le XVIIIe siècle
Le XVIIIe siècle espagnol n’est pas seulement remarquable pour la richesse de ses grammaires de langues étrangères, il l’est aussi pour ses réflexions plus théoriques dans le cadre de la description de l’espagnol. La bibliographie de Hans-Josef Niederehe17 est une nouvelle fois à noter pour l’ensemble des données rassemblées. Le grand linguiste espagnol Francisco Lázaro Carreter écrit dans l’introduction de la publication de sa thèse que le XVIIIe siècle n’a pas toujours été un objet d’étude alors que pour lui il s’agit bien du point de départ de la culture moderne :
« L’étude de la problématique de cette époque offre un intérêt évident, en premier lieu parce que nous y découvrons le germe de nombreux aspects de la linguistique à venir et aussi parce que, dans les solutions données aux problèmes, se reflète précisément l’esprit espagnol du siècle des lumières. La diffusion des idées françaises, l’invasion de l’idiome voisin, développent dans notre pays des activités très complexes; les hommes marquants de cette époque se débattent dans le problème posé dans la nécessité de vérifier la limite de ce qui est admissible, de savoir jusqu’où on peut céder pour que l’Espagne, ajustant son pas à l’Europe puisse maintenir son intégrité. Dans tous les problèmes que pose le langage nous trouvons ce point commun. » (Lázaro Carreter 1949, p. 13) (traduction AMCC).
15 Sabina Collet-Sedola, « L’origine de la didactique de l’espagnol en France. L’apport des grammairiens espagnols exilés (1600-1650) », Sciences du langage et outils linguistiques, HEL, tome 15, fasc. 2, 1993, [p.39-51].
16 Brigitte Lepinette, « Les premières grammaires du français (1565-1799) publiées en Espagne : modèles, sources et rôle de l’espagnol », L’esprit et le langage, HEL, tome XVIII, fasc. 2, 1996, [p. 149-177].
17 Compte-rendu de Hans-Josef Niederehe, Bibliografía cronológica de la lingüística, la gramática y la lexicografia del español (BICRES III): desde el año 1701 hasta el año 1800, Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins, 2005, rédigé par Brigitte Lépinette 2006.
Anne-MARie CHABROLLe-CeRReTini
115
La pertinence de cette grille d’analyse pour le XVIIIe siècle espagnol peut se vérifier dans les deux articles de José Francisco Val-Alvaro18 sur la notion de langue dans l’oeuvre de Lorenzo Hervás y Panduro et dans celui d’Elvira Arnoux19 sur, selon ses propres termes, l’étude de la « reformulation » de la grammaire de Condillac.
Le Catálogo de las lenguas de las naciones conocidas, y numeración, divisón y clases de estas según la diversidad de sus idiomas y dialectos de Lorenzo Hervás y Panduro publié à la fin du siècle est constitué de six volumes. Le titre complet indique l’enjeu d’une reconstitution de l’histoire généalogique des peuples par le biais de la langue comme moyen d’investigation. L’œuvre est non seulement un état des lieux typologisé de la diversité linguistique mais aussi une méthode. Les principes directeurs de l’ouvrage révèlent la langue comme une propriété du peuple et dans le même temps comme présentant des ressemblances avec d’autres langues. Les langues se distinguent selon le lexique, le mode de construction (morphosyntaxe et configuration des idées-la pensée comme organisatrice de la construction morphosyntaxique). Les langues sont ensuite réparties entre deux classes, les langues « matrices », celles qui ne viennent pas d’autres langues et les « dialectes » qui sont des variations accidentelles de la langue matrice. Cette dernière catégorie est subdivisée en dialectes « principaux » et dialectes « subalternes ». Nous percevons aisément combien cet ouvrage s’inscrit dans la problématique de la compréhension de la diversité linguistique caractéristique du XVIIIe siècle. À cet égard il n’est pas étonnant que Wilhelm von Humboldt travaillant à la compréhension des causes de la diversité et à celle des rapports entre la langue et la nation y fasse allusion puisqu’il lui doit aussi de nombreux exemples pour ses textes sur le duel et sur le kavi. Humboldt a en effet rencontré à Rome entre le 25 novembre 1802 et la fin de l’année 1808 ce jésuite espagnol, bibliothécaire pontifical au palais du Quirinal, qui pour les besoins de son Catálogo avait constitué un vaste corpus rassemblant des documents sur les langues du monde entier et particulièrement d’Amérique amassés par ses compatriotes et des Italiens, souvent d’anciens missionnaires.
L’article d’Elvira Arnoux nous donne un aperçu de la réception de Condillac en Espagne dans le contexte global de l’évolution et de la diversification des grammaires dans le monde qui peuvent se répartir en trois grands types, les grammaires générales, les grammaires des Etats et les grammaires particulières. En Espagne, la grammaire générale n’apparaît qu’à la fin du XVIIIe siècle grâce à Gaspar Melchor Jovellanos qui propose une adaptation de Condillac dans son Curso de Humanidades Castellanas (1795). Son ouvrage est conçu pour l’enseignement et semble illustrer les propos de Lázaro Carreter. Jovellanos, en effet, fait le choix intellectuel de reprendre les thèses de Condillac en tenant compte des possibilités réelles du moment pour installer durablement des idées nouvelles sur la langue et l’éducation dans un climat très conservateur qu’entretient la monarchie espagnole en contrôlant par exemple la circulation des livres français sur son territoire et
18 José Francisco Val-Alvaro, « La notion de langue dans le Catálogo de las lenguas », HEL, tome 9, fasc.2, 1987, [p. 99-115].
19 Elvira Narvaja de Arnoux, « La reformulación de la Grammaire de Condillac en el Curso de Humanidades castellanas de Jovellanos, orientaciones pedagógicas y teóricas », Le traitement automatique des langues, HEL, tome XXIII, fasc. 1, 2001. [p.127-151].
LA LingUisTiqUe HisPAniqUe dAns Hel
116
scrutant avec inquiétude les changements politiques au delà des Pyrénées. C’est sous cet angle que l’auteure de l’article analyse la reformulation des idées condillaciennes.
COnCLUsiOn
Si le nombre de contributions est relativement réduit, les sujets abordés sont assez représentatifs des problématiques, des époques et des textes étudiés que l’on relie habituellement à la linguistique espagnole. De la lecture des 17 articles et 14 comptes rendus, nous pouvons dégager assez fidèlement les étapes clés, les linguistes incontournables et les problématisations privilégiées qui fondent l’histoire de la linguistique hispanique.
RÉfÉRenCesGiard, Luce (1992). « L’entrée en lice des vernaculaires », Auroux, Silvain, Histoire des
idées linguistiques, tome 2, Liège, Mardaga, 206-225.Glessgen, Martin (2005). « La place de la linguistique romane dans le BSL », Bulletin de la
Société de Linguistique de Paris, tome C, 121-181.Lázaro Carreter, Fernando (1949). Las ideas lingüísticas en España durante el siglo XVIII,
Revista de filología española XLVIII, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas.
Anne-MARie CHABROLLe-CeRReTini
117
APPENdIcE 1
LisTe CHROnOLOgiqUe des ARTiCLes eT COMPTes RendUs PARUs dAns LA RevUe Hel COnCeRnAnT LA LingUisTiqUe esPAgnOLe
(entre crochets les textes écartés)
[Rousseau, Jean, « R. Rask (1787-1832) et la transcription des langues amérindiennes une lettre inédite à J. Pickering », De la grammaire à la linguistique, HEL, tome 3, fasc. 2, 1981.]
Art. 1. Niederehe, Hans-Josef, « La lexicographie espagnole jusqu’à Covarrubias », Dictionnaires, Grammaires, Catégories, Philosophie, Déchiffrement, HEL, tome 8, fasc. 1, 1986, 9-19.
Art. 2. Swiggers, Pierre & Vanvolsem, Serge, « Les premières grammaires vernaculaires de l’italien, de l’espagnol et du portugais », Les premières grammaires des vernaculaires européens, HEL, tome 9, fasc. 1, 1987, 157-181.
Art. 3. Sarmiento, Ramón, « Introduction », La tradition espagnole d’analyse linguistique, HEL, tome 9, fasc. 2, 1987, 7-12.
Art. 4. Niederehe, Hans-Josef, « Les dictionnaires franco-espagnols jusqu’à 1800 », La tradition espagnole d’analyse linguistique, HEL, tome 9, fasc. 2, 1987, 13-26.
Art. 5. Breva-Claramonte, Manuel, « Teaching Materials in Pedro Simon Abril (1530-1600) », La tradition espagnole d’analyse linguistique, HEL, tome 9, fasc. 2, 1987, 27-39.
Art. 6. Sánchez, Aquilino, « Renaissance methodologies for teaching Spanish as a foreign langage », La tradition espagnole d’analyse linguistique, HEL, tome 9, fasc. 2, 1987, 41-60.
Art. 7. Esparza Torre, Miguel Ángel, « Three Physicians of the Spanish Renaissance on language », La tradition espagnole d’analyse linguistique, HEL, tome 9, fasc. 2, 1987, 61-73.
Art. 8. Bustamente, Jesús, « Las lenguas amerindias: una tradición española olvidada », La tradition espagnole d’analyse linguistique, HEL, tome 9, fasc. 2, 1987, 75-97.
Art. 9. Val-Alvaro, José Francisco, « La notion de langue dans le Catálogo de las lenguas », La tradition espagnole d’analyse linguistique, HEL, tome 9, fasc. 2, 1987, 99-115.
Art. 10. Gómez Asencio, José Jesús, « Naissance et développement de la notion de phrase composée dans les grammaires espagnoles » (1771-1851), La tradition espagnole d’analyse linguistique, HEL, tome 9, fasc. 2, 1987, 117-132.
Art. 11. Garrido, Antonio, « La contribution de R. J. Cuervo (1844-1911) a la norma hispánica », La tradition espagnole d’analyse linguistique, HEL, tome 9, fasc. 2, 1987, 133-147.
Art. 12. Gutierrez-Cuadrado, Juan, « L’introduction de la philologie comparée dans les universités espagnoles (1857-1900) », La tradition espagnole d’analyse linguistique, HEL, tome 9, fasc. 2, 1987, 149-168.
Art. 13. Collet-Sedola, Sabina, « L’origine de la didactique de l’espagnol en France. L’apport des grammairiens espagnols exilés (1600-1650) », Sciences du langage et outils linguistiques, HEL, tome 15, fasc. 2, 1993, 39-51.
Art. 14. Lépinette, Brigitte, « Les premières grammaires du français (1565-1799) publiées en Espagne : modèles, sources et rôle de l’espagnol », HEL, L’esprit et le langage, tome XVIII, fasc. 2, 1996, 149-177.
LA LingUisTiqUe HisPAniqUe dAns Hel
118
CR. 1. Binotti, Lucia, La teoría del « Castellano Primitivo » Nacionalismo y reflexión lingüística en el Renacimiento español, Münster, Nodus Publikationen, 1995. [Rédigé par Francis Tollis, 1996, HEL, tome XVIII, fasc. 2].
CR. 2. Esparza Torres, Miguel Ángel, Las ideas lingüísticas de Antonio de Nebrija, Münster, Nodus Publikationen, 1995. [Rédigé par Francis Tollis, 1997, HEL, tome XIX, fasc. 1].
CR. 3. Tollis, Francis, La description du castillan au XVe siècle : Nebrija et Villena. Sept études d’historiographie linguistique, Paris, L'Harmattan, 1998. [Rédigé par Brigitte Lépinette. 1999, HEL, tome XXI, fasc. 1].
[CR. Campbell, Lyle, American Indian Languages. The Historical Linguistics of Native America, New York/Oxford, Oxford University Press, 1997. [Rédigé par Michel Launey, 1999, HEL, tome XXI, fasc. 2].]
CR. 4. Brumme, Jenny, Spanische im 19. Jarhundert Srachliches Wissen, Norm und Sprachveränderungen, Münster, Nodus Publikationen, 1997. [Rédigé par Jacques-Philippe Saint-Gérand, 1999, HEL, tome XXI, fasc. 2].
CR. 5. Esparza Torres, Miguel Ángel & Niederehe, Hans-Josef, Bibliografía nebrisense. Las obras completas del humanista Antonio de Nebrija desde 1481 hasta nuestros días, Amsterdam/Philadelphie, John Benjamins, 1999. [Rédigé par Francis Tollis, 2000, HEL, tome XXII, fasc. 1].
Art. 15. Narvaja de Arnoux, Elvira, « La reformulación de la Grammaire de Condillac en el Curso de Humanidades castellanas de Jovellanos, orientaciones pedagógicas y teóricas », Le traitement automatique des langues, HEL, tome XXIII, fasc. 1, 2001, 127-151.
CR. 6. Petit y Aguilar, Joan, Gramática catalana, Barcelone, edición de Jordi Ginebra, Barcelona institut, 1998. [Rédigé par Francis Tollis, 2001, HEL, tome XXIII, fasc. 1].
CR. 7. Lépinette, Brigitte, L’enseignement du français en Espagne au XVIIIe siècle dans ses grammaires. Concepts linguistiques et pédagogie, Münster, Nodus Publikationen, 2000. [Rédigé par Jacques-Philippe Saint-Gérand, 2001, HEL, tome XXIII, fasc. 2].
CR. 8. Niederehe, Hans-Josef, Bibliografía cronológica de la linguistica, la gramatica y la lexicografía. Desde el anno 1601 hasta el año 1700, Amsterdam/Philadelphie, Benjamins, 1999. [Rédigé par Francis Tollis, 2001, HEL, tome XXIII, fasc. 2].
CR. 9. Calvo Fernandez, Vicente, Grammatica Proverbiandi, Estudio de la Gramática Latina en la Baja Edad Media Espanõla, Tübingen, Nodus Publikationen, 2000. [Rédigé par Jacques-Philippe Saint Gérand, 2001, HEL, tome XXIII, fasc. 2].
CR. 10. Corcuera Manso, J. Fidel & Gaspar Galán, Antonio, La lengua francesa en España en el siglo XVI; Estudio y edición del « Vocabulario de los vocablos » de Jacques de Liaño (Alcalá de Henares, 1565), Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1999.[Rédigé par BrigitteLépinette, 2002, HEL, tome XXIV, fasc. 2].
CR. 11. Etienvre, Françoise, Rhétorique et patrie dans l’Espagne des Lumières. L’œuvre linguistique d’Antonio de Capmany (1742-1813), Paris, Honoré Champion, 2001. [Rédigé par J. Guilhaumou, 2003, HEL, tome XXV, fasc. 2].
[Art. Cano López, Pablo, « George Mounin y Antoine Meillet: observaciones críticas sobre una semblanza », L’autonymie, HEL, tome XXVII, fasc. 1, 2005, 153-197.]
CR. 12. Niederehe, Hans-Josef, Bibliografía cronológica de la lingüística, la gramática y la lexicografia del español (BICRES III):desde el año 1701 hasta el año 1800, Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins, 2005. [Rédigé par Brigitte Lépinette, 2006, HEL, tome XXVIII, fasc. 1].
CR. 13. Koerner, E. F. Konrad & Niederehe, Hans-Josef (éd.), History of Linguistics in Spain, vol. II, Amsterdam/Philadelphie, John Benjamins, 2001. [Rédigé par Francis Tollis, 2006, HEL, tome XXVIII, fasc. 1].
Anne-MARie CHABROLLe-CeRReTini
119
Art. 16. Breva-Claramonte, Manuel, « Grammatization of indigenous languages in Spanish America : themental language, language origin and cultural factors », Les langues du monde à la Renaissance, HEL, tome XXX, fasc. 2, 2008, 11-24.
Art. 17. Rodriguez-Alcala, Carolina & Horta Nunes, José, « Langues amérindiennes à la Renaissance : norme et exemples dans les escriptins du tupi et du guarani », Les langues du monde à la Renaissance, HEL, tome XXX, fasc. 2, 2008, 25-74.
[CR. Zwartjes, Otto & Hovdhaugen, Even, Missionary Linguistics/Linguistica misionera, Amsterdam/Philadelphie, John Benjamins, 2004. [Rédigé par Emilio Bonvini, 2008, HEL, tome XXX, fasc. 2].]
[CR. Zwartjes, Otto & Hovdhaugen, Even, Missionary Linguistics/Linguistica misionera, Amsterdam/Philadelphie, John Benjamins, 2005. [Rédigé par Emilio Bonvini, 2008, HEL, tome XXX, fasc. 2].]
[CR. Zwartjes, Otto & Hovdhaugen, Even, Missionary Linguistics/Linguistica misionera, Amsterdam/Philadelphie, John Benjamins, 2007. [Rédigé par Emilio Bonvini, 2008, HEL, tome XXX, fasc. 2].]
[CR. Zwartjes, Otto & Hovdhaugen, Even, Missionary Linguistics/Linguistica misionera, Amsterdam/Philadelphie, John Benjamins, 2009. [Rédigé par Emilio Bonvini, 2010, HEL, tome XXXII, fasc. 2].]
CR. 14. Pellen, René & Tollis, Francis, La Gramática castellana d’Antonio de Nebrija, tomes 1 et 2, Limoges, Lambert et Lucas, 2011. [Rédigé par Alejandro Díaz Villalba, 2011, HEL, tome XXXIII, fasc. 2].
LA LingUisTiqUe HisPAniqUe dAns Hel
120
APPENdIcE 2
ARTiCLes eT COMPTe RendUs CLAssésCHROnOLOgiqUeMenT PAR PROBLéMATiqUe
1. La situation épistémologique de la linguistique espagnoleArt. 3. Sarmiento, Ramón, « Introduction », La tradition espagnole d’analyse linguistique,
HEL, tome 9, fasc. 2, 1987, 7-12.Art. 12. Gutierrez-Cuadrado, Juan, « L’introduction de la philologie comparée dans les
universités espagnoles (1857-1900) », La tradition espagnole d’analyse linguistique, HEL, tome 9, fasc. 2, 1987, 149-168.
CR. 8. Niederehe, Hans-Josef, Bibliografía cronológica de la linguistica, la gramatica y la lexicografía. Desde el anno 1601 hasta el año 1700, Amsterdam/Philadelphie, Benjamins, 1999. [Rédigé par Francis Tollis, 2001, HEL, tome XXIII, fasc. 2].
CR. 13. Koerner, E. F. Konrad & Niederehe, Hans-Josef (éd.), History of Linguistics in Spain, vol. II, Amsterdam/Philadelphie, John Benjamins, 2001. [Rédigé par Francis Tollis, 2006, HEL, tome XXVIII, fasc. 1].
2. La lexicographieArt. 1. Niederehe, Hans-Josef, « La lexicographie espagnole jusqu’à Covarrubias »,
Dictionnaires, Grammaires, Catégories, Philosophie, Déchiffrement, HEL, tome 8, fasc. 1, 1986, 9-19.
Art. 4. Niederehe, Hans-Josef, « Les dictionnaires franco-espagnols jusqu’à 1800 », La tradition espagnole d’analyse linguistique, HEL, tome 9, fasc. 2, 1987, 13-26.
3. La didactique de l’espagnolArt. 6. Sánchez, Aquilino, « Renaissance methodologies for teaching Spanish as a foreign
langage », La tradition espagnole d’analyse linguistique, HEL, tome 9, fasc. 2, 1987, 41-60.Art. 13. Collet-Sedola, Sabina, « L’origine de la didactique de l’espagnol en France.
L’apport des grammairiens espagnols exilés (1600-1650) », Sciences du langage et outils linguistiques, HEL, tome 15, fasc. 2, 1993, 39-51.
4. La RenaissanceArt. 2. Swiggers, Pierre & Vanvolsem, Serge, « Les premières grammaires vernaculaires de
l’italien, de l’espagnol et du portugais », Les premières grammaires des vernaculaires européens, HEL, tome 9, fasc. 1, 1987, 157-181.
Art. 5. Breva-Claramonte, Manuel, « Teaching Materials in Pedro Simon Abril (1530-1600) », La tradition espagnole d’analyse linguistique, HEL, tome 9, fasc. 2, 1987, 27-39.
Art. 7. Esparza Torre, Miguel Ángel, « Three Physicians of the Spanish Renaissance on language », La tradition espagnole d’analyse linguistique, HEL, tome 9, fasc. 2, 1987, 61-73.
CR. 1. Binotti, Lucia, La teoría del « Castellano Primitivo » Nacionalismo y reflexión lingüística en el Renacimiento español, Münster, Nodus Publikationen, 1995. [Rédigé par Francis Tollis, 1996, HEL, tome XVIII, fasc. 2].
Anne-MARie CHABROLLe-CeRReTini
121
CR. 2. Esparza Torres, Miguel Ángel, Las ideas lingüísticas de Antonio de Nebrija, Münster, Nodus Publikationen, 1995. [Rédigé par Francis Tollis, 1997, HEL, tome XIX, fasc. 1].
CR. 3. Tollis, Francis, La description du castillan au XVe siècle : Nebrija et Villena. Sept études d’historiographie linguistique, Paris, L'Harmattan, 1998. [Rédigé par Brigitte Lépinette. 1999, HEL, tome XXI, fasc. 1].
CR. 5. Esparza Torres, Miguel Ángel & Niederehe, Hans-Josef, Bibliografía nebrisense. Las obras completas del humanista Antonio de Nebrija desde 1481 hasta nuestros días, Amsterdam/Philadelphie, John Benjamins, 1999. [Rédigé par Francis Tollis, 2000, HEL, tome XXII, fasc. 1].
CR. 14. Pellen, René & Tollis, Francis, La Gramática castellana d’Antonio de Nebrija, tomes 1 et 2, Limoges, Lambert et Lucas, 2011. [Rédigé par Alejandro Díaz Villalba, 2011, HEL, tome XXXIII, fasc. 2].
5. Le traitement des langues amérindiennesArt. 8. Bustamente, Jesús, « Las lenguas amerindias: una tradición española olvidada », La
tradition espagnole d’analyse linguistique, HEL, tome 9, fasc. 2, 1987, 75-97.Art. 16. Breva-Claramonte, Manuel, « Grammatization of indigenous languages in Spanish
America : themental language, language origin and cultural factors », Les langues du monde à la Renaissance, HEL, tome XXX, fasc. 2, 2008, 11-24.
Art. 17. Rodriguez-Alcala, Carolina & Horta Nunes, José, « Langues amérindiennes à la Renaissance : norme et exemples dans les escriptins du tupi et du guarani », Les langues du monde à la Renaissance, HEL, tome XXX, fasc. 2, 2008, 25-74.
6. Le XVIII e siècle. Concepts. GrammairesArt. 9. Val-Alvaro, José Francisco, « La notion de langue dans le Catálogo de las lenguas »,
La tradition espagnole d’analyse linguistique, HEL, tome 9, fasc. 2, 1987, 99-115.Art. 10. Gómez Asencio, José Jesús, « Naissance et développement de la notion de phrase
composée dans les grammaires espagnoles » (1771-1851), La tradition espagnole d’analyse linguistique, HEL, tome 9, fasc. 2, 1987, 117-132.
Art. 15. Narvaja de Arnoux, Elvira, « La reformulación de la Grammaire de Condillac en el Curso de Humanidades castellanas de Jovellanos, orientaciones pedagógicas y teóricas », Le traitement automatique des langues, HEL, tome XXIII, fasc. 1, 2001, 127-151.
CR. 11. Etienvre, Françoise, Rhétorique et patrie dans l’Espagne des Lumières. L’œuvre linguistique d’Antonio de Capmany (1742-1813), Paris, Honoré Champion, 2001. [Rédigé par J. Guilhaumou, 2003, HEL, tome XXV, fasc. 2].
CR. 12. Niederehe, Hans-Josef, Bibliografía cronológica de la lingüística, la gramática y la lexicografia del español (BICRES III):desde el año 1701 hasta el año 1800, Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins, 2005. [Rédigé par Brigitte Lépinette, 2006, HEL, tome XXVIII, fasc. 1].
7. La linguistique des XIXe et XXe sièclesArt. 11. Garrido, Antonio, « La contribution de R. J. Cuervo (1844-1911) a la norma
hispánica », La tradition espagnole d’analyse linguistique, HEL, tome 9, fasc. 2, 1987, 133-147.
CR. 4. Brumme, Jenny, Spanische im 19. Jarhundert Srachliches Wissen, Norm und Sprachveränderungen, Münster, Nodus Publikationen, 1997. [Rédigé par Jacques-Philippe Saint-Gérand, 1999, HEL, tome XXI, fasc. 2].
LA LingUisTiqUe HisPAniqUe dAns Hel
122
8. Le français et son apprentissage en EspagneArt. 14. Lépinette, Brigitte, « Les premières grammaires du français (1565-1799) publiées
en Espagne : modèles, sources et rôle de l’espagnol », HEL, L’esprit et le langage, tome XVIII, fasc. 2, 1996, 149-177.
CR. 7. Lépinette, Brigitte, L’enseignement du français en Espagne au XVIIIe siècle dans ses grammaires. Concepts linguistiques et pédagogie, Münster, Nodus Publikationen, 2000. [Rédigé par Jacques-Philippe Saint-Gérand, 2001, HEL, tome XXIII, fasc. 2].
CR. 10. Corcuera Manso, J. Fidel & Gaspar Galán, Antonio, La lengua francesa en España en el siglo XVI; Estudio y edición del « Vocabulario de los vocablos » de Jacques de Liaño (Alcalá de Henares, 1565), Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1999.[Rédigé par BrigitteLépinette, 2002, HEL, tome XXIV, fasc. 2].
9. Le catalanCR. 6. Petit y Aguilar, Joan, Gramática catalana, Barcelone, edición de Jordi Ginebra,
Barcelona institut, 1998. [Rédigé par Francis Tollis, 2001, HEL, tome XXIII, fasc. 1].
10. La grammaire latine en EspagneCR. 9. Calvo Fernandez, Vicente, Grammatica Proverbiandi, Estudio de la Gramática
Latina en la Baja Edad Media Espanõla, Tübingen, Nodus Publikationen, 2000. [Rédigé par Jacques-Philippe Saint Gérand, 2001, HEL, tome XXIII, fasc. 2].
Anne-MARie CHABROLLe-CeRReTini
123123 VARIA
À quOI REcONNAîT-ON LA TAgmémIquE ? ENTRE STRucTuRALISmE PéRIPhéRIquE ET gRAmmAIRE dE TEXTE :
ESSAI dE mOdéLISATION éPISTémOLOgIquE
Jean Léo Léonard IUF & UMR 7018/Labex EFL (7EM2)
Histoire Épistémologie Langage 34/II (2012) p. 123-154 © SHESL
RésuméDans quelle mesure la tagmémique est bien un paradigme qu’on pourrait situer dans la continuité du structuralisme descriptiviste nord-américain, de Sapir & Boas à Bloomfield ? Nous poserons cette question en utilisant une grille de seize critères permettant de définir la tagmémique en termes de méthodes et de doctrine, auxquels s’ajouteront sept critères suggérés par Gilles Deleuze pour caractériser le structuralisme sous ses différentes formes. Nous verrons que la tagmémique s’avère être une forme paradoxale de fonctionalisme. D’une part, la typologie des langues et la linguistique computationnelle doivent beaucoup à ses données et à ses outils d’analyse ; d’autre part, elle fait figure de parent oublié de la linguistique moderne. Cet article explore la tagmémique à travers quelques textes fondateurs de Kenneth Pike et de Robert Longacre, et accorde également une attention particulière à des faits de langues mazatec. En effet, le mixtec et le mazatec sont deux langues otomangues qui eurent une influence décisive sur les conceptions théoriques de ces deux linguistes, distingués représentants de la tagmémique. Cette étude de cas permet de rappeler combien l’empirisme structuraliste a pu marquer la linguistique moderne bien après le structuralisme nord-américain classique, mais aussi combien les faits peuvent tirer la théorie, plutôt que l’inverse. De ce point de vue, la tagmémique constitue une sorte de laboratoire pour l’observation des interactions entre données et construits dans la formation des théories linguistiques.
Mots clefs
Tagmémique, structuralisme, épistémologie, empirisme, données, construit, typologie, morphologie, fonctionalisme, modélisation, discours, mazatec, mixtec.
AbstractHow Tagmemics is consistent with the main features of structuralism? How does it differ from more well known forms of structuralism, such as the Sapir-Boas or Bloomfieldian paradigms of empirical linguistics? We shall address this question through a model of sixteen criteria proper to tagmemics, and through an array of seven additional criteria suggested by Gilles Deleuze about how to define structuralism. Tagmemics turns out to be a fairly paradoxical form of functionalism. As a matter of facts, modern typological and computer linguistics are highly indebted to its data and models, though Tagmemic is hardly considered nowadays as a leading trend in modern linguistics. This paper revisits Tagmemics through some programmatic texts by Kenneth Pike and Robert Longacre, with special attention to Mazatec data. Mazatec and Mixtec happen to be language which strongly induced some characteristics of the theoretical framework of Tagmemics. This case study shows that not only should some currents of 20th Century structuralism be defined by a strong commitment to empiricism, but empirical data from specific languages provided modern linguistics with a bulk of fundamental intuitions and insights. As Tagmemics may not be the only case of strongly data-driven paradigm feeding linguistic typology, this trend should be investigated further, in order to disentangle historical sources of empirical linguistics.
KeywordsTagmemics, structuralism, epistemology, empiricism, data, construct, typology, morphology, functionalism, modelling, discourse, Mazatec, Mixtec.
124
La línea consta de un número infinito de puntos; el plano, de un número infinito de planos; el volumen, de un un número infinito de planos, el hipervolumen, de un número infinito de volúmenes... No, decididamente no es éste, more geometrico, el mejor modo de iniciar mi relato. Afirmar que es verídico es ahora una convención de todo relato fantástico; el mío, sin embargo, es verídico [Jorge Luis Borges, El libro de Arena].
1. OBJeCTifs
Notre principal objectif sera de répondre à la question « en quoi la tagmémique est-elle un paradigme structuraliste de linguistique théorique et descriptive ? ».1 Pour ce faire, nous procéderons en trois temps : d’abord en confrontant la tagmémique à ses référents et anti-référents sur le plan de la tekhnè ou de la modélisation des grammaires, en termes de tendances, tropismes, praxis et doctrines ; ensuite en confrontant la grille d’analyse épistémologique de Gilles Deleuze (1967) sur les critères qui définissent la démarche structuraliste avec les concepts et modes opératoires de la tagmémique en matière de modélisation et de description des faits de langues. Enfin, à titre de preuve, nous donnerons à l’issue de ce parcours quelques exemples des apories et des contradictions mais aussi des propositions heuristiques de la tagmémique. Nous tenterons de mettre en valeur l’apport empirique et théorique de ce paradigme fonctionnaliste à partir de l’application qui en a été faite sur une langue qui s’est avérée décisive dans son processus de formation : le mazatec (ethnonyme endogène : énnà = « notre langue »).
1 Cet article reprend et développe une communication présentée le 2 avril 2011 au séminaire Histoire comparée des structuralismes, organisé par Sylvie Archaimbault (HTL, UMR 7597, CNRS/Univ. Paris Diderot) et Christian Puech (HTL, Paris 3 Sorbonne Nouvelle). La communication initiale était davantage centrée sur l’apport de la tagmémique à la description du mazatec, langue otomangue parlée par près de 250 000 locuteurs dans l'État de Oaxaca, classée « langue vulnérable » par l’UNESCO. La présente version de cette synthèse effectue un recentrage sur le paradigme de la tagmémique, à la demande de la rédaction de la revue, sans pour autant renoncer à une illustration des applications de la tagmémique à cette langue, qui a revêtu une grande importance dans l’élaboration du paradigme. Cette recherche n’aurait pas été possible sans le soutien de l’Institut Universitaire de France, qui finance les recherches de l’auteur sur les langues de Mésoamérique, principalement otomangues et mayas (projet MamP 2009-2013, cf. http://lpp.univ-paris3.fr/productions/contrats.htm#MamPMPMA). Par ailleurs, l’auteur tient à remercier les relecteurs anonymes pour leur lecture attentive de ce texte et leurs suggestions pertinentes. Il s’est avéré difficile de rendre plus pédagogique la présentation des données du §5, qui doivent être lues avec la clé de lecture suivante : comment la description des données par les tagmémiciens mais aussi leur éclectisme méthodologique (concessions à la phonologie générative et au modèle des règles ordonnées) ont permis à l’auteur de désembrouiller l’écheveau de la morphologie d’une langue aussi complexe, de prime abord, que le mazatec. Il y a donc dans cette partie du texte une dimension d’exploration empirique qui perdrait, dans l’intention de l’auteur, à être simplifiée. Une démarche que Kenneth Pike lui-même n’aurait pas désavouée, et qui correspond d’ailleurs à son approche de l’écriture en linguistique théorique et descriptive.
JeAn LéO LéOnARd
125
À quoi reconnaît-on la tagmémique ? pourrait-on dire, en paraphrasant le titre d’une contribution de Gilles Deleuze à la définition du structuralisme (op. cit.). Dans les grandes lignes, nous répondrons à cette question en disant que la tagmémique se caractérise essentiellement par un ancrage et une finalité pragmatique (décrire et apprendre les langues) et par la notion de tagmème. Mais la tagmémique est aussi à la fois un paradigme continuateur du structuralisme descriptiviste américain d’E. Sapir, F. Boas, L. Bloomfield2, un paradigme mobilisateur dans un cadre positiviste et évangéliste en plein essor dans le Tiers-Monde de l’après deuxième guerre mondiale, un important courant quasiment souterrain, face à l’hégémonie théorique de la GGT à partir des années 1960, la tagmémique alimente aujourd’hui par ses données les grands projets typologiques sur les langues du monde comme le WALS (Haspelmath et al. 2005), de manière paradoxale puisque l’impact empirique de ce paradigme dépasse de loin son incidence et sa visibilité théorique. On voit donc qu’on ne peut guère se contenter de définir la tagmémique purement en termes de modèle grammatical. Ce paradigme doit être mis en perspective dans un contexte plus large, aussi bien sur le plan des méthodes et des postulats théoriques sur la structure des langues et le fonctionnement du langage que du point de vue de la sociologie des sciences (Latour 1989) et de l’impact de son action sur les communautés linguistiques où des linguistes évangélistes en ont fait usage, aussi bien à des fins de description que de grammatisation et de médiation prosélytique3.
2. CARACTéRisATiOn dU PARAdigMe
Il s’agira dans ce qui va suivre, d’une part d’évaluer la dimension pragmatique dans la sociologie des sciences, au-delà des questions de positionnement théorique et institutionnel (cf. Auroux 2007), d’autre part de rappeler combien les données peuvent induire les construits théoriques – la question de la dépendance empirique des théories linguistiques. Notre préoccupation sera davantage celle d’un linguiste descriptiviste et d’un typologue, qui cherche à atteindre la langue à travers et au-delà des apories et des avancées d’un modèle afin d’analyser les données qu’il recueille, que d’un épistémologue. Si le point de vue crée l’objet, lui donne forme et contenu, au-delà de la pure substance de ce que l’observateur entend, annote, décrit, publie ou lit d’une langue qu’il explore, il s’ensuit en retour que l’objet a pour sa part une incidence forte sur la théorie. La tagmémique offre un exemple très concret de cette dialectique d’interaction entre données et construction théorique : la tagmémique ne serait pas ce qu’elle est ou n’aurait pas été ce qu’elle a été sans l’étonnement de Kenneth Pike devant les structures morphosyntaxiques et tonales du mixtec et du mazatec, au sud-est du Mexique, langues otomangues qu’il aborda et décrivit de front dans les années 1930-40 (le premier terrain de
2 Ces noms sont les plus souvent cités, mais il serait bon d’évoquer également des contributeurs comme Frachtenberg, Bogoras, Thalbitzer, Goddard, et tant d’autres linguistes et anthropologues ayant contribué au grand projet descriptiviste du structuralisme nord-américain du début du siècle passé.
3 Attitude dont l’auteur de ces lignes tient à se démarquer.
à qUOi ReCOnnAîT-On LA TAgMéMiqUe ?
126
K. Pike en terres mixtèques date de 1935, cf. Kaye 1994, p. 293), sans chercher initialement à passer par le truchement de l’espagnol. Les structures de ces langues ont laissé une empreinte profonde dans l’architecture théorique de ce courant doté d’une Unheimlichkeit (ou inquiétante étrangeté, selon les termes de S. Freud) au sein de la linguistique moderne.4
Le tagmème, qui donne son nom au modèle, apparaît comme une unité portemanteau définie par ses quatre composantes que sont a) la position (ou slot), b) le rôle ou la fonction, c) la classe qui qualifie l’unité fonctionnelle et d) sa cohésion au sein d’une structure holographique (du mot à la phrase et au paragraphe, du discours au texte).5 Le terme provient originellement de Bloomfield6 : il est formé sur la famille de lexèmes qui, en grec, signifient « arrangement » ou « arranger », « disposition » ou « disposer » (tagma, tassein) ou connotent à la fois l’ordre et la classe (taxis), avec le suffixe -eme pour indiquer une unité minimale. Le tagmème correspond, en gros, au morphème, voire au monème des fonctionnalistes : c’est l’unité sens-forme minimale, susceptible d’entrer dans des combinaisons de divers ordres de grandeur. Mais surtout, c’est à la fois une unité positionnelle (syntagmatique) et catégorielle (paradigmatique) : non seulement le tagmème est configuré selon des contraintes strictes, mais il est doté de propriétés de classe. C’est autant un concept topologique que taxinomique (approche que j’appellerai plus loin synergique), pour fonder une grammaire descriptive générale, apte à décrire n’importe quel régime de collocation d’unités morphémiques dans les langues du monde. Les propriétés qui fondent les classes sont universelles, selon ce modèle – nous en verrons l’inventaire succinct dans le tableau 3, infra – : le modèle est résolument aprioristique et universaliste. Le tagmème, en tant qu’unité minimale configurée et sous-catégorisante, connaît des expansions sur diverses échelles menant au paragraphe et au texte, en passant par le syntagmème – autrement dit, le syntagme, envisagé comme complexe doté des mêmes propriétés synergiques que le tagmème. Le tableau 5 infra est une matrice qui rend compte de manière sommaire de l’étagement holographique du modèle.
Les enjeux de la tagmémique pour l’histoire des idées linguistiques tiennent, selon moi, en 12 points, représentés dans la matrice du tableau 1. Nous délimiterons par une première grille les principales orientations qui définissent le champ de forces
4 On lira avec intérêt le préambule à Pike 1995 par Luc Bouquiaux (op. cit. p. 9-16), qui rend bien compte du caractère paradoxalement marginal de la tagmémique dans les ouvrages de référence en linguistique, notamment en France.
5 D’après Randal 2002, remanié.6 Comme le rappelle l’un des relecteurs anonymes du present article, Kenneth Pike
reconnaissait cette dette envers Bloomfield : « Some of my recent research has been the introduction of a tagmeme unit into linguistic theory, on a par with the phoneme and the morpheme. (The term itself is given to us by Bloomfield, although his particular attempt to define, describe, or isolate such a unit has not been fruitful and has not entered into current linguistic theory or practice » (Pike 1972, p. 131). Le même relecteur rappelle, avec raison, que « Pike était élève de Bloomfield, [si bien que] la tagmémique fait partie intégrante du structuralisme américain hérité de Boas, Sapir et Bloomfield (cf. entretien avec Alan Kaye, référencé en note 11 infra). Pike a joué un rôle important au sein de la Linguistic Society of America, et a publié dans Language et International Journal of American Linguistics, organes des Bloomfildiens ».
JeAn LéO LéOnARd
127
de la tagmémique, en tant que paradigme empirique en linguistique, répondant de manière matricielle à la question deleuzienne « à quoi reconnaît-on… ? ». Les séries A-D, E-H, I-L, M-P se regroupent en tendances (A-D), en tropismes (E-H), en praxis (I-L). Les caractéristiques de A à B relèvent des attitudes de recherche : continuité avec le structuralisme descriptiviste amérindianiste ; déclarativité et attitude axiomatique de la tagmémique ; sa convergence ou sa confluence avec le distributionnalisme harrisien et avec l’analyse de discours ; le parti pris paradoxal contre la constituance ou du moins, la constituance telle que l’entendait le structuralisme bloomfieldien, davantage en termes de topologie que de relations fonctionnelles selon les tenants de la tagmémique. Les critères de E à H se réfèrent à la manière épistémologique, autrement dit, au mode opératoire, dans son centre (critères E et G) ou dans sa périphérie (critères F et H) : l’intégration dans des lignes de pensée telles que le behaviorisme (E), la complémentarité avec la GGT7 (F), le holisme (G) et le physicisme (H). La série qui va de I à L définit l’incidence sur les objets d’étude, en termes d’élaboration des corpus (au sens klossien8 du terme), d’implication sur le terrain et de protagonisme ou d’innovations technologiques, dont le T.A.L. (Traitement Automatique des Langues) est aujourd’hui héritier à des degrés divers.
Enfin, la série qui va de M à P énumère les doctrines génériques : empirisme (M), positivisme (N), indigénisme (O), évangélisme (P).9 Nous allons reprendre dans l’argumentaire chacun de ces points, le plus souvent entre crochets, en précisant la nature des séries dans un premier temps, puis en détaillant le contenu de chacune des cellules de la matrice dans un deuxième temps.
7 Grammaire Générative Transformationnelle.8 Le sociolinguiste Heinz Kloss (1904-1987) distingue l’élaboration du corpus de la langue
(correspondant, en gros, à la grammatisation, mais résolument associée à un processus d’aménagement linguistique) de la valorisation du statut (que les sociolinguistes catalans appellent la normalisation). Pour le S.I.L. (Summer Institute of Linguistics, dont la tagmémique était le modèle de référence), cette élaboration se faisait toujours de manière si dépendante de la « langue-toit » – autre concept Klossien, qui désigne la langue de référence servant de modèle à la grammatisation de langues minoritaires ou en situation de dépendance glottopolitique, comme l’espagnol face aux langues vernaculaires amérindiennes de Mésoamérique – que toutes les graphies conçues dans le cadre de la codification par le S.I.L. ont ensuite connu d’importantes retouches afin d’aligner la tekhnè sur des principes d’univocité graphémique (un signe = un phonème). Il n’en reste pas moins qu’on doit au S.I.L. une vaste opération de modernisation des graphies postcoloniales des langues vernaculaires, entre les années 40 et 80 du siècle passé.
9 La tagmémique, comme nous le verrons, a été la principale théorie utilisée par le Summer Institute of Linguistics, une institution évangéliste missionnaire fondée, tout comme la Wycliffe Bible Translators, par William Cameron Townsend (1896-1982) à partir d’une première école d’été pour la formation de linguistes missionnaires, au camp Wycliffe, en Arkansas, en 1934. Kenneth Pike rejoindra ce noyau initial l’année suivante, et fera ses premières enquêtes linguistiques sur le mixtec, dans la ville de Mexico, dans le cadre de cette formation. Il rejoindra par la suite sur le terrain, dans la région des hautes terres mazatèques, sa sœur Eunice, et les linguistes de l’équipe de George Cowan, qui publiera la Bible en mazatec de Huautla (1960). K. Pike dirigea le S.I.L. pendant trente ans. Pour tout détail biographique complémentaire, lire la très intéressante interview de K. Pike par Alan Kaye, publiée en ligne sur http://www.sil.org/klp/kayeint.htm.
à qUOi ReCOnnAîT-On LA TAgMéMiqUe ?
128
ACOnTinUiTé
BdéCLARATiviTé
CCOnveRgenCe
dACOnsTiTUAnCe
eBeHAviORisMe
fCOMPLeMenTARiTé
ggT
gHOLisMe
HPHysiCisMe
igRAMMATisATiOn
JiMPLiCATiOn
KPROTAgOnisMe
LAPPLiCATiOns
TeCHnOLOgiqUesM
ACqUis eMPiRiqUen
POsiTivisMeO
indigénisMeP
évAngéLisMe
Tableau 1. La tagmémique : tendances, tropismes, praxis et doctrines.
Par sa continuité avec le structuralisme américain, indiquée en [A] dans la matrice du tableau 1, la tagmémique est probablement le principal paradigme héritier de la linguistique descriptive de Sapir, Boas, Bloomfield, Hockett, Z. Harris. Elle partage avec ce courant le travail empirique auprès des populations indigènes à travers l’étude de corpora oraux, un ancrage dans le discours et la narrativité, qui sert de plate-forme pour l’édification de grammaires descriptives, voire pour toute forme d’accès aux structures de la langue. Par sa déclarativité (point [B] du tableau 1), la tagmémique ne cesse de reprendre à son compte et de reformuler les axiomes de la linguistique structuraliste, tout en cherchant à les épurer. C’est un paradigme résolument empirique et méthodologique, singulièrement axiomatique et déclaratif – il se fonde sur des postulats, sur des statements explicites énoncés par ses principaux concepteurs (Kenneth Pike 197210 ; Robert Longacre 1965).
Paradoxalement, la tagmémique frappe par sa convergence [C] avec son antithèse ou ce mouvement antagoniste qu’est le générativisme, qui tiendra un rôle hégémonique sur le plan des théories du langage et des théories linguistiques à partir des années soixante du siècle passé. Alors qu’elle tente de se démarquer du générativisme, pour des raisons de doctrine métalinguistique autant que politique, elle ne peut en éviter la force d’attraction, d’autant plus qu’aussi bien sa source historique (le distributionnalisme et l’analyse de discours de Zellig Harris) que la recherche de la constituance en grammaire fondent ces deux paradigmes sur une méthodologie a priori analogue. La notion de constituance tient lieu de frontière, mais c’est une frontière poreuse, ou rendue impossible par la force des impératifs descriptifs – il faut bien délimiter des domaines distributionnels aussi bien au niveau phonologique que morphosyntaxique, afin d’appréhender et de grammatiser des langues encore peu connues ou mal décrites. La tagmémique réagit aux choix structuralistes du générativisme par un contournement des notions de la constituance11
10 La note de bas de page dans Pike 1964, p. 82 mentionne comme cadre théorique légitime de la pragmatique à ce moment donné de l’évolution du paradigme des monographies ou des manuels de Kenneth Pike, Velma Pickett, Eugene A. Nida, Benjamin Elson & Velma Pickett. Il est impossible de détailler plus avant ces références annexes ou connexes. Une historiographie de la tagmémique et de ses territorialisations empiriques à travers les langues de Mésoamérique et d’Afrique reste à faire. Le présent article se veut une modeste contribution en ce sens, mais vise davantage à la synthèse qu’à une analyse détaillée (cf. note 1 du présent article sur les limites rédactionnelles requises pour ce survol).
11 Contournement paradoxal car en grande partie intenable dans la praxis descriptive d’un modèle dont l’unité de base, le tagmème, est à la fois une position syntagmatique et une
JeAn LéO LéOnARd
129
et de la dépendance en grammaire [D] (avec des attitudes plus ou moins radicales, entre les déclarations de K. Pike et celles de R. Longacre par ex.), énoncé comme l’aconstituance proclamée de la tagmémique, vécue à la fois comme un vœu pieux et comme nœud d’un programme fonctionnaliste. La tagmémique est manifestement une forme de structuralisme fonctionnaliste, résolument behavioriste – autre ligne de division avec le générativisme –, signalée en [E] (Behaviorisme) dans la matrice du tableau 1. Dans un article programmatique, quoique destiné à des enseignants d’anglais, sur l’art de la composition, Kenneth Pike énonce ce principe qui parcourt son œuvre : « La langue doit être analysée en termes de comportement social. La parole est action. Bien qu’elle implique un code ou des symboles, le langage se définit avant tout comme comportement symbolique et communicatif, qu’on ne saurait abstraire de l’action » (Pike 1964, p. 88).12
Des linguistes du SIL auront recours aux méthodes de la GGT (Grammaire Générative-Transformationnelle), comme Brian Bull (Bull 1984), dans son article sur les processus morphonologiques dans la flexion verbale en mazatec de San Jerónimo [F]. C’est principalement en phonologie et pour résoudre des problèmes de morphonologie que les linguistes du S.I.L. utiliseront des outils et des concepts de la GGT. Cette complémentarité entre les deux paradigmes est d’autant plus intéressante que la tagmémique ne cesse de s’interroger sur les processus de compactage et décompactage qui vont de la langue à la parole, pour aller de la parole à l’écriture de la langue. Par ailleurs, il y a un caractère holistique dans la tagmémique [G] – un holisme nettement divergent des formes de holisme du générativisme, qu’on pourrait qualifier sommairement de holisme behavioriste, dans la mesure où le langage est conçu dans cette approche comme à la fois une grammaire et une pratique sociale déterminée par le milieu et les situations de communication, dont toutes les dimensions intéressent le modèle (cf. Pike 1954) . La tagmémique s’intéresse à l’intercompréhension au sein des réseaux dialectaux (Casad 1974 ; Kirk 1970) : des éléments les plus particulaires ou atomisés aux séquences les plus développées et les plus intégrées aux différents paliers du système, autant en termes de production que de réception des messages.
classe qui sous-catégorise d’autres tagmèmes. Le titre même d’un des plus célèbres articles de Kenneth Pike et de sa sœur (Pike & Pike 1947), Immediate constituents of Mazatec Syllables, reprend à la linguistique structurale la notion de « constituants immédiats ». Cet article est souvent cité comme précurseur de la théorie de la constituance syllabique en phonologie générative : le modèle Attaque-Rime – la rime se subdivisant elle-même en noyau et coda (on notera que les termes onset et coda sont ultérieurs : ils ne figurent pas dans l’article de Pike & Pike 1947). Les deux auteurs parlent d’unités principales et de « subordinate members » de groupes consonantiques dans les marges ou de chaînes vocaliques dans les noyaux syllabiques. Même si la constituance syllabique est au centre de leur article, les deux auteurs ne cessent d’avoir recours à des euphémismes pour décrire les constituants syllabiques sous d’autres termes. Par exemple, sur le plan phonétique, la syllabe est constituée pour eux de « chest pulses » – au lieu de constituants, ils posent là des domaines relevant de la physique de la parole : les « phases de souffle ». Par ailleurs, ils décrivent moins les groupes consonantiques des attaques complexes du mazatec en termes de constituants syllabiques qu’en emboîtements tête-dépendances (cf. Golston & Kehrein 1998 pour une discussion de ce modèle modèle et un retour sur les données de Pike & Pike).
12 « Language must be analyzed as social behavior. Speech is an act. Although code or symbol is involved, language is communicative, symbolic behavior, not a total abstraction from action ».
à qUOi ReCOnnAîT-On LA TAgMéMiqUe ?
130
Sur le plan du holisme syntaxique, Robert Longacre affirme : Nous reprenons à notre compte des definitions non bloomfildiennes des concepts de mot, syntagme et énoncé. Un mot n’est pas seulement « une forme libre minimale » (Bloomfield, p. 178). Il n’est rien sans une structure syntagmatique (bien qu’un simple morphème puisse apparaître comme mot minimal, pourvu qu’il soit associé à des affixes). Un syntagme n’est pas seulement un groupe de deux mots ou plus ; d’ailleurs, une phrase minimale peut être constituée d’un seul mot, pourvu que celui-ci soit associé avec d’autres mots dans un syntagme. Un énoncé n’est pas seulement une « forme linguistique autonome » (Bloomfield, p. 170), dans la mesure où il peut être partie intégrante d’un paragraphe. En outre, on gagnerait à distinguer énoncé et phrase, même si nombre d’énoncés ne contiennent qu’une seule phrase13 (op. cit. p. 74, note 20).
On voit là l’illustration de la logique en séries-gigogne annoncée plus haut, lors de l’examen de la grille du tableau 2.2. On voit également comment le signe en tagmémique se dissout en syntagmatique fonctionnelle.
Il y a une forte récursivité interne de l’objet – ce qui rappelle la créativité chomskyenne, mais d’un point de vue moins individualiste et idéaliste. La récursivité en tagmémique est conçue comme un holisme davantage mécaniste, les unités de la langue étant envisagées sur différents paliers en structures gigogne, par la traversée, la remontée et la descente des unités et des parenthésages au sein de matrices comme celle du tableau 5 infra. La métaphore physiciste du langage et des langues comme systèmes intégrés, de la particule au champ, coordonné et intégré sous forme d’ondes (physicisme : [H]), rend compte de la récursivité des formes, tout en évitant le recours aux cycles des mécaniques transformationnelles du générativisme, ainsi que toute orientation mentaliste. La métaphore de la particule, de l’onde et du champ (particule, wave & field), chère à Kenneth Pike, résume la vision holiste du modèle. Elle pourrait être réduite à un triangle plus explicite ayant court à la même époque (milieu du siècle passé) dans le structuralisme : le modèle isolates, sets & patterns, repris notamment en anthropologie culturelle par Edward T. Hall (Hall 1981, p. 100) à la théorie de l’information des années 1950. Dans un tel modèle, par exemple les sons se décrivent comme des éléments ou des atomes, les mots comme des ensembles (sets), les phrases comme des structures ou des constructions (patterns). La tagmémique étend cette vision du phonème (particule) au texte (field), en passant par le paragraphe (wawe) mais, récursivement, la métaphore s’applique de l’allophone au mot, en passant par la syllabe. Une idée centrale dans cette métaphore physiciste est que, comme en physique nucéaire, a relation de tout atome au champ, est que son onde peut fusionner – nous verrons combien cette vision est utile pour comprendre le fonctionnement d’un système comme celui du mazatec
13 « Non-Bloomfieldian definitions of word, phrase and sentence are assumed. A word is not simply ‘a minimum free form’ (Bloomfield 178), but is required to have syntagmemic structure (although a single morpheme may be a minimal word provided that it also occurs with affixes). A phrase is not required to be a group of two or more words; rather a minimal phrase may be manifested by a single word provided it also occurs with other words in a phrase. A sentence is not altogether an ‘independent linguistic form’ (Bloomfield 170), for it may figure in the structure of a paragraph. Furthermore, sentence and clause may be fruitfully distinguished, even though there are many one-clause sentences. »
JeAn LéO LéOnARd
131
et de sa préverbation TAMV-personne, pas seulement en termes diachroniques de fusion d’éléments initialement en relation analytique, mais comme permettant un jeu d’hypothèses pour l’élucidation de structures (patterns).
Par ailleurs, au-delà de son programme théorique, la tagmémique est également une linguistique appliquée : une praxis de la grammatisation [I], qui produit des manuels d’alphabétisation, élabore des graphies (codification), diagnostique l’intercompréhension au sein des réseaux dialectaux méso-américains (cf. les travaux de Eugene H. Casad), afin de standardiser les langues – même s’il s’agit d’évangéliser les populations, en fonction d’un a priori prosélyte. On lui doit à ce titre une dynamique d’éducation populaire – une forme d’implication [J], qui a laissé des traces encore sensibles dans les populations visitées durant des décennies. Au Mexique le SIL a contribué au développement de communautés de pratiques d’éducation « bilingue et interculturelle » avant la lettre, relevant plutôt de la « doctrine de l’incorporation » (assimilationnisme) et de l’indigénisme comme forme de gouvernance et d’utopie paternaliste14 que d’une politique d’éducation populaire philantropique. Il conviendrait, sur le plan historiographique, de comparer cette démarche avec celle préconisée et mise en action dans ce qu’on peut appeler le projet éducatif de Morris Swadesh, qui a précédé celui du SIL (cf. Beltrán 1983, p. 291-313). La tagmémique est un paradigme résolument empiriste, mais aussi protagoniste résolument engagé dans une action positiviste de « développement » (dans la grille, K et N respectivement). Au Mexique en particulier, le SIL a participé aux opérations d’expertise et de « sauvetage » de l’héritage culturel méso-américain, en collaboration avec les instances d’aménagement du territoire (cf. projet Temascal dans la région mazatèque, 1946-62), selon la logique que connurent bien les archéologues, qui voulait que les instances étatiques leur confiaient pour un laps de temps souvent dérisoire l’exploration d’un territoire condamné à une disparition proche dans le cadre de grands projets d’aménagement d’infrastructures, comme les complexes hydroélectriques. Le SIL a été l’une des chevilles ouvrières de la politique indigéniste (cf. Townsend 1965). L’institution a été invitée par le président Lázaro Cárdenas (1934-1940), qui mena une politique réformiste volontariste dans les domaines agraire et éducatif15, à coopérer dans le cadre de l’indigénisme de l'État mexicain [O], en partenariat avec l’Institut National Indigéniste (INI). Il a contribué à former les anthropologues et les linguistes ou « ethnolinguistes » travaillant dans le cadre institutionnel de l’INI et d’autres instances des « affaires indigènes ». En termes de protagonisme (K), outre une personnalité comme W. C. Townsend, une figure majeure du SIL, Kenneth Pike, se distingue comme un pédagogue passionné, créatif et généreux.16 Une partie importante de ses travaux est constituée de manuels d’initiation à la linguistique
14 Afin de relativiser et contextualiser historiquement ce jugement, v. Caso et al. 1954. Le terme « paternaliste » est ici employé dans le sens de critique constructive des utopies proposé par Yona Friedman (1975, p. 21-40).
15 Le fondateur de la Wycliffe Bible Translation et du SIL International, William Cameron Townsend, écrira une biographie du président Cárdenas (Townsend [1952] 1976).
16 Cette appréciation concerne l’activité de pédagogue et la production de manuels de Kenneth Pike et de ses collaborateurs, mais ne saurait porter sur l’ensemble des ses activités et de celles du SIL notamment en matière de prosélytisme religieux, qui relativise la posture altruiste des intéressés.
à qUOi ReCOnnAîT-On LA TAgMéMiqUe ?
132
théorique et descriptive (cf. Pike & Pike 1995 ; Pike 1975 ; Pike 1954 ; 1957). Dans le champ des applications technologiques [L], au-delà de la métaphore du modèle « atome, ondes et champ de force », mais aussi grâce à la rationalisation de cette perspective en dimensions-gigognes sous forme d’architecture logicielle, on doit à la tagmémique des outils de description des langues comme Shoebox et Toolbox. On reconnaît plus fréquemment l’apport générativiste, cependant, la contribution de la tagmémique est d’une grande importance dans les secteurs les plus descriptifs du TAL, notamment par l’usage, désormais très répandu, de ces deux outils17. Enfin, des synthèses empiriques de la typologie linguistique à échelle mondiale comme le WALS (Haspelmath et al. 2005) s’alimentent pour la plupart des langues peu représentées (de moins de 300 000 locuteurs) aux données du SIL, collectées et analysées selon les méthodes de la tagmémique [M]18, en filiation directe avec le structuralisme américain – alors que le générativisme n’a jamais eu ni ne pouvait avoir, pour des raisons de positionnement théorique et idéologique [P], de projet de collecte et de description empirique des langues du monde.
3. en qUOi LA TAgMéMiqUe esT-eLLe sTRUCTURALisTe ?
Nous utiliserons un tamis conceptuel emprunté à Gilles Deleuze quant aux critères propres à définir ou identifier le structuralisme (Deleuze 1967)19. Cet auteur propose une taxinomie du structuralisme fondée sur sept critères répondant à la question « à quoi reconnaît-on le structuralisme ? » : 1) le symbolique, 2) local ou de position, 3) le différentiel et le singulier, 4) le différenciant et la différenciation, 5) sériel, 6) la case vide, 7) du sujet à la pratique. Ces critères sont repris et coordonnés dans la matrice du tableau 2.1 ci-dessous.
17 Cf. http://www.sil.org/computing/catalog/show_software.asp?id=79.18 Le critère [M] dans la grille demande à être explicité : pourquoi « acquis empirique » au
lieu d’empirisme, tout simplement. La caractérisation « acquis empirique » est entendue ici comme contribution décisive à la constitution d’un corpus de données. Le présent article ayant davantage une finalité d’histoire des idées linguistiques que philosophique à proprement parler, nous avons voulu, dans cette étape de la présentation de la tagmémique, limiter la référence à l’empirisme de ce courant à l’héritage qu’il a laissé à la linguistique moderne, tel qu’il apparaît notamment dans l’utilisation que les grands projets de typologie actuelle, comme le WALS (Haspelmath et al. 2005-08), qui se fonde sur les données rassemblées et publiées par les linguistes du SIL au cours de la deuxième moitié du siècle passé. Il va de soi que, d’un point de vue plus général, l’empirisme dépasse de loin la seule mise à disposition de données (cf. Deleuze 1953). Une lecture davantage centrée en philosophie du langage, qui ferait remplacer en [M] « acquis empirique » par « empirisme » tout court, risquerait de porter à confusion : la tagmémique fut à la fois un modèle de linguistique théorique et formelle et un paradigme de recherche hautement empirique, orienté vers la description des langues.
19 La Logique du Sens, du même auteur, publiée deux ans plus tard, (Deleuze 1969) reprend point par point ce programme de description taxinomique de ce qu’est le structuralisme, par un art de la transversalité propre à ce philosophe : à l’aide d’une vaste hyperbole qui va des stoïciens à cet envers de la structure, cet au-delà du miroir de la structure qu’est le non-sens, chez Lewis Carroll et les Marx Brothers.
JeAn LéO LéOnARd
133
qsyMBOLiqUe
RTOPOLOgie
sdiffeRenTiALiTevs. singULARiTe
TdiffeRenCiAnT
& diffeRenCiATiOn
UseRiALiTe
vCAse vide
WdU sUJeT
A LA PRAxis
Tableau 2.1. Taxinomie pour une caractérisation du structuralisme selon Deleuze 1967
En résumé, les sept critères de Deleuze se définissent de la manière suivante pour le linguiste20 : 1) le symbolique comme un ordre de représentation et de figuration distinct du réel aussi bien que de l’imaginaire, autrement dit, la dimension sémiotique du signe en linguistique, 2) la topologie des positions, qui fonde et justifie le distributionalisme dans tous les domaines de la structure linguistique, et qui a tout à voir avec la constituance, 3) la pertinence et la distinctivité (par ex. la théorie des traits distinctifs chez Jakobson, reprise par SPE (l’ouvrage fondateur de la phonologie générative, Sound Pattern of English, Chomsky & Halle 1968), qui construit le tout par l’opposition de parties ou de propriétés partielles), 4) les rapports différentiels entre le tout et ses parties, qu’on peut transposer en phonologie par exemple comme la relation qu’entretient la représentation virtuelle (les structures profondes ou représentations lexicales, qui fondent une unité dans sa totalité) avec ses réalisations, 5) les paradigmes ou les axe des simultanéités, selon Roman Jakobson, 6) la catégorie zéro, 7) l’ordre des contradictions structurelles et de leur résorption.21
20 Gilles Deleuze, qui fut à sa manière un grand sémiologue et sémioticien, outre son génie philosophique, ne maîtrisait les concepts de la linguistique que de manière limitée. Dans son article de 1967, il emprunte surtout ses exemples à une lecture attentive de Levi-Strauss, de Foucault et de Ricœur. Nous avons donc transposé ses catégories, qui me semblent heuristiques pour l’épistémologie des sciences du langage, malgré les limites du concepteur dans ce domaine. Cependant, en filtrant les concepts deleuzien à des fins purement métalinguistiques, on perd aussi bien des dimensions que de la substance : par case vide (cellule [V] de la matrice), Deleuze entend bien plus que simplement la marque zéro (cf. Lemaréchal 1997 pour une critique de la notion de « case vide » en linguistique) des linguistes descriptivistes, dans les gloses grammaticales (le signe Ø). Il entend davantage « case vide » comme asymétrie dans un système : la case vide est à la fois un principe structurant et déstructurant, essentiel au dynamisme de la structure par ses effets en chaîne de déplacements et restructuration – à la manière des cases vides dans l’économie des changements phonétiques d’André Martinet, déclenchant des chaînes de traction (vowel & consonant shifts).
21 Le concept en [W] (du sujet à la praxis) est lié à l’analyse clinique chez Deleuze, transcendant la seule perspective anthropologique et linguistique, dans son analyse du structuralisme. Afin de recentrer sur la transposition que l’on peut faire de ces concepts à la linguistique, en les projetant sur la tagmémique, c’est toute la théorie de Kenneth Pike du langage en relation avec une théorie unifiée de la structure du comportement humain, (cf. Pike, 1954) qui est concernée par cette transition qui va de la pratique subjective de la langue, par les locuteurs, à la complexité des interactions humaines en contexte. Kenneth Pike avait coutume de dire que, après s’être lassé de la phonologie des langues, il s’était plongé dans la théorie de la grammaire, pour finir par s’intéresser à la manière dont les gens communiquent en prenant leur petit déjeuner : pour lui, la langue et ses tagmèmes sont des éléments aussi bien formels du langage, que des outils d’analyse de toute praxis sociale.
à qUOi ReCOnnAîT-On LA TAgMéMiqUe ?
134
La grille de Deleuze fera fonction de filtre (tableau 2.2 infra) pour caractériser la forme de structuralisme que constitue la tagmémique, à partir d’un article programmatique publié à une date charnière par un éminent spécialiste de mixtec22 : Robert Longacre. Dans cette matrice, les critères de Gilles Deleuze sont accompagnés de catégories ou d’axes convergents avec la tagmémique, indiqués en italiques.
q’SymBOLIquE
Particules et ondes
R’TOPOLOgIE
Intégration stratifiée, du tagmème au champ en
passant par le syntagmème
S’dIFFéRENTIALITévS. SINguLARITé
Syntagmème
T’dIFFéRENcIANT
& dIFFéRENcIATIONAllophonie et allomorphie
u’SéRIALITE
Tagmèmes et collocation
v’cASE vIdE
?
W’du SujET
À LA PRAXISHiérarchie tripartite
(particule, onde et champ)de la structure linguistique et
du comportement humain
Tableau 2.2. Filtrage de l’axiomatique d’un article de Pike (1964)par la grille analytique de Deleuze 1967.
Cette caractérisation, qui est davantage une hypothèse de travail qu’une mise en correspondance systématique, répartit les concepts de la tagmémique entre cellules de la matrice deleuzienne. Cette mise en regard fait apparaître la relative irréductibilité du modèle à la grille deleuzienne ; d’une part, elle fait apparaître les écarts pertinents, comme l’absence de la case vide et des zéros dans grammaire tagmémicienne (critère [V’]), ainsi que le caractère éminemment syntagmatique
22 Une série de remarques au sujet de l’effet boule-de-neige de la confrontation empirique du linguiste avec des langues particulières : alors que l’auteur de ces lignes expliquait à un groupe d’instituteurs bilingues mazatecs à quel point leur langue avait eu un impact de première importance sur les théories linguistiques modernes, notamment phonologie, lors d’un atelier de formation à la linguistique historique et comparative otomangue, à Huautla de Jiménez , en août 2010, une participante mixtec de San Juan Coatzospán, village à l’entrée de la Cañada – zone de contact mixtec-cuicatec-mazatec – nous fit remarquer que le mixtec aussi avait joué un rôle comparable (cf. Léonard 2010). La lecture de Pike (1944, 1948, 1972, p. 32-50, 74-84) suggère en effet à quel point cette remarque de l’institutrice mixtèque était pertinente. C’est au milieu des années 1960 que paraissent les articles les plus programmatiques de la tagmémique, après les grandes monographies relevant de la tagmémique (Pike 1948) et une série d’articles marquants sur le mazatec dans les domaines de la phonologie et de la tonologie (Pike & Pike 1947, Pike E. 1956), et du comparatisme otomangue (Gudschinsky 1958a), notamment sur le mixtec (Longacre 1957). La période 1940-59 est marquée par une activité empirique intense, suivie de l’élaboration et de la mise en forme d’un corps théorique, d’une axiomatique, dans les années 1960-75 (cf. Pike 1972 pour une chrestomathie couvrant les deux périodes, ainsi que Pike 1970, 1975).
JeAn LéO LéOnARd
135
du signe – davantage poupée-gigogne que double-face saussurienne (signifiant/signifié) ou triangle sémiotique stoïcien (signifiant/signifié/référent). En synthèse, comme nous le verrons, elle suggère une polarisation du modèle sur essentiellement deux critères ([R’] et [U’] : topologie et sérialité. Les critères [S’] (différentialité vs. singularité) et [T’] (différenciant & différenciation) sont le produit actif de l’interaction constante entre ces deux pôles (R’ et U’).
4. COnTinUiTé eT RUPTURes
Pour Longacre, la tagmémique est avant tout une grammaire des relations entre unités fonctionnelles : « Le but de l’analyse tagmémique n’est pas de se contenter d’identifier des constituants, mais de mettre en valeur des relations »23 (op. cit.). Dans la note 5 de cet article programmatique sur les perspectives de la tagmémique, il s’inscrit en faux contre le malendendu de Postal, selon lequel « la modélisation tagmémique semble passer à côté de la dimension relationnelle de traits grammaticaux comme “sujet”, “objet”, “prédicat”, confondant ceux-ci avec des constituants »24 (Longacre 1965, p. 66). Or, pour Longacre, rien n’est plus étranger à la tagmémique que cette confusion : il affirme, contre ses détracteurs, « la tagmémique se définit comme la réassertion de la fonction dans un contexte structuraliste »25 (op. cit., p. 67). La fonction en tagmémique prime sur la constituance, qui se résume à une question de topologie superficielle (gérée par les slots ou positions, conformément au critère [R] de Deleuze). La sérialité (critère [U] de la grille deleuzienne), du point de vue de la tagmémique, traverse l’ensemble des unités constitutives non pas seulement du lexème, mais en partant du syntagme, du paragraphe comme unité rhétorique et discursive, pour aller jusqu’au discours (cette traversée de la forme procède de [R] à [U] dans la grille du tableau 2.2.
Les tenants du modèle tagmémique se réclament implicitement, comme Noam Chomsky à ses débuts, du structuralisme de Zellig Harris : ils assument et revendiquent un recentrage sur l’analyse de discours, les textes oraux et les corpus discursifs, dans la tradition du structuralisme américain de Sapir et de Boas26 – tradition par ailleurs oblitérés dans la GGT. Longacre critique trois erreurs de la linguistique descriptive structuraliste postbloomfieldienne, à partir d’un ouvrage d’Eleanor Harz Jorden.27 Les deux premières erreurs ont tout à voir avec la
23 « The goal of tagmemic analysis is not simply to isolate constituents but to reveal relations ».24 « The tagmemic characterization thus seems to miss the relational aspect of grammatical
features like ‘subject’, ‘object’, ‘predicate’, and confuses these with constituents. »25 « Tagmemics is a reaffirmation of function in a structuralist context » (Postal, cité par
R. Longacre 1965, p. 66).26 Cf. le mazatec a été l’objet de trois contributions exemplaires d’une approche descriptive
allant du lexème au discours : Gudschinsky 1959a, b. et Pike E. 1967.27 Syntax of modern colloquial Japanese, 1955, Language Dissertation 52. Les critiques ciblent
d’autant plus des monographies descriptives comme celle d’Eleanor Harz Jorden, plutôt que des essais théoriques, que la tagmémique se veut une science pratique – une méthodologie descriptive –, davantage qu’une théorie formelle des langues et du langage.
à qUOi ReCOnnAîT-On LA TAgMéMiqUe ?
136
case [S] (Différentialité vs. Singularité) de la matrice deleuzienne du tableau 2. La troisième erreur relève de l’interaction ou de l’interdépendance ; voire de la hiérarchisation entre les cases [R] (Topologie) et [U] (Sérialité). On retrouve dans la désignation des « erreurs » du structuralisme postbloomfildien par Longacre toute la déclarativité de la tagmémique (cf. le critère [B] du tableau 1 supra).
Erreur 1 : la sur-différentiation fonctionelle (« the distinguishing of constructions that are functionally identical »), ou surspécification. Erreur 2 : la sous-différentiation fonctionelle (« failure to distinguish constructions that are functionally different »), qui relève du réductionnisme.Erreur 3 : la fragmentation fonctionnelle (« the horizontal dissection of what is properly one construction into separate (so-called) constructions ») : autrement dit, l’atomisme.L’argumentation de Longacre contre la constituance telle qu’elle est envisagée
dans la linguistique structuraliste de son époque permet de comprendre en quoi la topologie tagmémique (critère [R] de la grille deleuzienne) n’est pas une simple dimension configurationnelle, ou du moins, que les configurations de surface ne jouent qu’un rôle très secondaire dans la topologie tagmémique, dans la mesure où celle-ci se veut avant tout fonctionnelle. À ce titre, Longacre rappelle qu’il ne faut pas confondre permutation et transformation. Par ex. en latin, l’ordre libre des mots est un simple procédé de permutation : « l’enfant aime la fille » peut bien se dire puer amat puellam, amat puer puellam, puellam amat puer, puer puellam amat, amat puellam puer, puellam puer amat : il faut n’y voir qu’un simple réagencement de structure, sans aucun changement de fonction, et donc sans aucune incidence topologique puisqu’il n’y a de différenciation (cf. critère [T’] de la grille du tableau 2.2.) et de différenciation topologique ([R’]) que fonctionnelle en tagmémique. D’où l’importance de ces signes sériels et essentiellement topologique que sont les tagmèmes, qui sont des catégories fonctionnelles telles qu’elles apparaissent sous forme d’abréviations en minuscules dans le tableau 3, et des parties du discours ou des catégories lexicales (abréviations en majuscule dans le tableau 3). Ces tagmèmes se combinent en syntagmèmes dans l’ordre-gigogne supérieur qui mène de la particule (phonèmes, syllabes, morphèmes, mots-outils plus ou moins motivés) au champ (l’énoncé, le paragraphe, le discours). Cette topologie dynamique des inclusions et des déterminations en boucle par effets syntagmatiques de collocation, fondée sur la fonction, fonde les séries (case [U] dans la grille du tableau 2.2.), ou sets, qui relèvent de classes fonctionnelles telles que les identifieurs (les déterminants), les numéraux, les déictiques d’une part ; les têtes, les adjectifs et autres catégories lexicales, d’autre part. On retrouve l’opposition entre systèmes fermés (closed sets) et systèmes ouverts (open sets), mais dans un tel modèle, cette dichotomie ne recoupe pas l’équipollence entre têtes fonctionnelles et têtes lexicales de la GGT. En tagmémique, toutes les unités n’ont de raison d’être que fonctionnelle. Le lexique n’est qu’un épiphénomène de cette omnifonctionnalité qui traverse de part en part le modèle et l’ordonnancement systémique entre systèmes fermés et systèmes ouverts, en termes de finitude.28
28 Dans la mesure où aucun dispositif formel, aucune totalité logique et valencielle n’est proposée par les tenants du modèle, à la différence de la modélisation algébrique de la glossématique ou des corps de règles ordonnées ou cycliques de la GGT des débuts (qui
JeAn LéO LéOnARd
137
Set = class TagmemesClosed sets i identifiers
q numeralsd deictics
Open sets H heads (NP…)A adjectives
Tableau 3. Classes tagmémiques selon Longacre 1965, p. 70.
Dans un tel modèle omnitopologique (où tout est déterminé par la position fonctionnelle), omnifonctionnel (toute unité est nécessairement fonctionnellement déterminée par la collocation) et omnisériel (toute unité est supposée former un tagmème relevant de classes topologiques déterminées), deux questions se posent, qui découlent de la grille deleuzienne : comment délimiter les unités et comment les différencier (case [S] de la différentialité versus singularité et case [T] du différenciant et de la différenciation). On notera par ailleurs que la grille du tableau 2.2 révèle l’existence d’un parent pauvre – ou un laissé pour compte épistémologique – la case vide (cellule [V] de la matrice). Selon nous, la tagmémique n’a d’autre réponse que la métaphore physiciste de la langue comme particule, comme onde et comme champ de force, pour remplir les espaces définitoires de [S’] et de [T’] de la matrice du tableau 2.2. Elle a d’autant moins de réponse en termes de propriétés catégorielles qu’elle rejette ou élude la constituance (qui fonde des catégories fonctionnelles et lexicales sur des propriétés dépendencielles prédictibles29 plutôt qu’exclusivement sur des fonctions et des collocations) et la case vide (qui altère ou réagence la structure du signe et des séries de signes par le jeu des asymétries entre formes pleines et marquées et absence de marque ou absence de forme).
Le tagmème s’avère donc une notion syntagmatique par trop générique et sujette aux oscillations et aux transformations du mouvement qui emporte la particule dans des dynamiques concaténatives (les ondes) et dans des espaces discursifs (les champs). Il restait à trouver des niveaux supérieurs pour assurer une sérialité en poupée-gigogne, qui devient un feuilletage à quatre niveaux, comme le montre le tableau 4, repris de Longacre (op. cit. p. 74).
sera suivie des complexes modulaires du Gouvernement et du Liage entre théories X-barre, des thêta-rôles, du liage, etc.), la tagmémique fait abondamment usage d’une gamme de schémas représentant des systèmes relationnels et des systèmes d’inclusion (théorie des ensembles), cf. Pike 1972, p. 89, 92, 94, 96-99, 175 et Pike 1976, p. 70 ou de matrices (Pike 1972, p. 263-297, 1970). Il importe cependant de signaler que c’est dans cette dernière approche, matricielle, que l’effort de mise en cohérence logique est la plus grande. Les schémas et les taxinomies arborescentes abondent également dans Pike & Pike 1995, depuis le diagramme ou organigramme qui analyse un récit biblique aux relations de rôles dans un récit mythique, selon Sterner, Suharno & Pike (ibid. tabl. 1.1. et 10.3). Une analyse ultérieure de la modélisation en tagmémique devra établir une typologie de ces représentations schématiques et matricielles, qui composent une riche théorie des graphes en grammaire. La créativité graphique et la vivacité de la pensée sérielle et réticulaire atteint chez Kenneth Pike des sommets borgesiens. On peut à ce titre comparer Pike à Borges, et dire de la tagmémique qu’elle est aussi la linguistique des sentiers qui bifurquent, aussi bien qu’un Aleph métalinguistique.
29 Cf. la notion de sous-catégorisation en GGT.
à qUOi ReCOnnAîT-On LA TAgMéMiqUe ?
138
Tagmeme syntagmeme level hierarchy___ ___ ____ ___ ___ ___ __
. __________ ----------- ------------
Tableau 4. Analogie géométrique des concepts fondamentaux de la tagmémique selon Longacre.
Le deuxième niveau topologique – plutôt que hiérarchique, contrairement à la GGT, constituancielle et dépendencielle – est le syntagmème. Tout comme le structuralisme hjelmslevien, la tagmémique a recours à la dérivation grecque en -mèmes30 pour générer des unités d’ordre sériel étagées.
Selon Longacre (op. cit. p. 70), le syntagmème doit optimalement remplir les conditions suivantes (requirements 1, 2, 3) :
Prérequis 1 : une délimitation et cohérence interne (« closure and internal coherence »). Prérequis 2 : une structure minimale susceptible de s’étendre en une périphérie optionnelle (autrement dit, c’est une tête31).Prérequis 3 : contraste, variantes et distribution, autrement dit, les conditions d’allomorphie au sens large.On voit donc que les critères [S] et [T] de différentialité vs. singularité et
de différenciant & différenciation respectivement, sont assumés en tagmémique à un niveau syntagmatique supérieur, qui est celui du syntagmème. Le premier complexe différentiel est assumé par le prérequis 1, tandis que le deuxième est pris en charge par le prérequis 3. Qu’en est-il du prérequis 2, qui correspond en partie à la notion de tête de la GGT ? On dira qu’il est co-extensif aux critères [R] (topologie) et au critère [S] (différentialité vs. singularité), voire qu’il se range dans ce dernier complexe taxinomique (le critère [S]).
Par ailleurs, les syntagmèmes sont caractérisés le plus souvent par une stratification interne (internal layering) et des intégrations multiples (multiple nesting), à différents paliers de la structure linguistique, du mot au discours. Les niveaux de hiérarchie tagmème/syntagmème sont les suivants, selon Longacre (op. cit., p. 76) : T = Tagmeme ; W = Word ; P = Phrase ; C = Clause ; S = Sentence ; ¶ = paragraphe ; D = Discourse ; M = Morpheme.
30 La glossématique hjelmslevienne développe également une modélisation hautement stratifiée du langage, à la même époque, sur des bases bien moins empiriques que la tagmémique, sous une forme cependant bien plus contrainte, grâce à une dimension algébrique qui lui permet d’envisager un formalisme autre que simplement schématique (Hjelmslev 1954). Ces deux courants structuralistes périphériques que sont la tagmémique et la glossématique – l’un plongé dans l’empirisme descriptiviste en Amérique, l’autre d’ambition formaliste et théorique au nord de l’Europe, sur des bases empiriques plus conventionnelles – gagneraient d’ailleurs à être comparés (cf. notamment Pike 1972, p. 263-297, article co-signé avec Ivan Lowe sur la référence pronominale en conversation et dans le discours en anglais, dont la modélisation algébrique demanderait à être revisitée dans une perspective glossématique).
31 Pour la GGT du Gouvernement & Liage, ce serait la tête d’une projection syntagmatique.
JeAn LéO LéOnARd
139
Level-skipping3
Level-skipping2
Level-skipping1
Hierarchical Recursive Back-Looping1
Back-Looping3
T¶ W P C S ¶ DTS M W P C S ¶ DTc M W P C S ¶TP M W P C STw M W P C
Tableau 5. Matrice d’intégration des niveaux (syn)tagmémiques : Longacre (op. cit. 76).
Les unités ont le choix entre sauter des paliers (hyperbole, ou skipping) ou revenir en boucle (récursivité, de deux types : simple – itérative – ou en boucle rétroactive – backlooping). Robert Longacre donne l’exemple de l’énoncé « une grosse grenouille verte assise au revers d’une souche sur le bord d’un étang » pour illustrer la récursivité (« a great big green frog is sitting on the back of a log on the bank of a pound »), séquence qui fournit un exemple de tagmème à trois syntagmes (clause = phrase en GGT) : Syntagme sujet S = frog, syntagme prédicatif P = is sitting, syntagme locatif L = pound. Un exemple d’énoncé (sentence) intégré dans un syntagme est « when heads-I-win-tails-you-lose is the order of the day »32, que l’auteur définit comme récursivité du premier degré (first-order backlooping).
Le tagmème « His heads-I-win-tails-you-lose attitude »33 fournit un exemple de récursivité ou bouclage de second degree (second-order backlooping) : on a alors un énoncé (sentence) intégré dans un groupe nominal (phase).
Ces exemples de l’enchâssement phrastique et énonciatif, opportunément tirés de l’anglais (alors que des aspects plus morphologiques et lexicaux sont tirés de langues otomangues ou mayas, moins connues du grand public), servent d’illustration de la matrice de récursivité reproduite dans le tableau 5 supra. Une manière simple d’expliciter ce tableau consisterait à dire que pour chaque série T, TS, TC, TP, TW, qui hiérarchise différentes extensions de tagmèmes (au niveau phrastique : TP, au niveau du mot : TW, etc.), les opérations décrites dans les ordres du tableau font jouer des relations d’inclusion et d’intégration syntagmatique avec des unités telles que le mot (W), la phrase (P), le syntagme (C), mais aussi le paragraphe (¶) ou discours (D). Ce type de dispositif servait à K. Pike pour pratiquer des exercices de syntaxe expérimentale : par exemple, certaines langues ont moins recours à des adpositions qu’à des permutations de phrases pour exprimer des relations adverbiales : « John went to the movies after he came home », versus « Coming home and eating supper, he went to the movies. », comme l’explique K. Pike dans un entretien (cf. note 11 supra).
Cette structuration en poupée gigogne garantit pour les tagmémiciens la cohésion entre tagmèmes dans le flux des unités coordonnées ou fusionnées : des groupes et des niveaux fonctionnels de partout plutôt que des constituants. Cette approche permet de considérer la notion de système de manière holographique et de rendre compte des processus de fusion, de télescopage entre niveaux et entre formes des unités, comme nous l’explique Kenneth Pike :
32 « Quand l’ordre du jour n’est autre que “pile-je-gagne-face-tu-perds” ».33 « Son attitude à la “pile-je-gagne-face-tu-perds” ».
à qUOi ReCOnnAîT-On LA TAgMéMiqUe ?
140
Si l’on considère la langue en termes de système, nous devons alors envisager cette question en termes de champ de force. Tout comme nous l’avons signalé pour l’approche en termes d’ondes de la parole, du point de vue du champ de forces également les particules autonomes disparaissent ou entrent en fusion […]. On notera une différence de taille, cependant. Au lieu de considérer le langage comme une série de vagues se déployant à la surface comme une suite d’ondes simples, la vision du langage gagne alors « en profondeur ». Un mot n’est plus analysé comme membre d’une séquence en soi, mais comme partie d’une classe entière de mots qui, pour n’être pas prononcés à ce moment précis, n’en restent pas moins potentiellement partie intégrante d’un champ comportemental potentiel […]. Un mot est considéré comme faisant partie d’un système dans sa totalité.34 (Pike 1972, p. 140).
On voit que la métaphore (ou la parabole) physiciste de la vague et du champ décrit et embrasse le grand flux de relais fonctionnels qui garantit la cohésion des parties avec le tout. La tagmémique assume bel et bien son programme structuraliste totalisant35.
Pike explique que la stratification tripartite du langage et des langues en particule, onde et champ de forces est un remède efficace contre l’erreur 1 (sur-différenciation, cf. problématiques des cases [S] et [T] dans le tableau 2.2. supra) que dénonçait plus haut Longacre : « Cette approche en termes de champ de force est un antidote salutaire contre la tendance à la sursegmentation, qui prend pour unique objet d’étude des fragments et tronçons d’une relation séquentielle particulière ou d’un acte de langage »36 (Pike, ibidem, p. 140).
Le « champ » (field) est ce qui intègre les niveaux ou paliers subséquents : c’est là que les unités fusionnent. Plus que des chaînes monotones, les « ondes » (waves) sont donc des flux d’intégration. Le système de la langue est envisagé comme une totalité, mais dont les parties ne sont pas tranchées, ni segmentées de manière transparente. C’est au niveau des ondes que surviennent les coalescences, les ajustements morphonologiques et tous les facteurs d’opacification des limites entre morphèmes ou entre parties du discours que le jeu – et la puissance vitaliste – des collocations ont généré dans la chaîne parlée. La dialectique du différenciant et de la différenciation (les conditions d’allomorphie : cellule [T] de la grille deleuzienne) est troublée par la dynamique de télescopage et de compression des particules sur le palier des ondes. Alors que dans le structuralisme saussurien, cette
34 « Reference to system, however, forces us to turn to the discussion of a field view of language. As with the wave view of speech, so within this view separate particles as such disappear and melt into one another (…). There is one major difference, however. Instead of looking at language as a sequence of waves in a single flat wave train, language is viewed somehow in « depth ». A word is seen not as a part of a sequence alone, but as part of a whole class of words which are not being uttered at that particular time but are parts of the total potential behavioral field (…). A word is seen as part of a total language system ».
35 Cf. Sériot 1999 sur la relation entre la partie et le tout dans le structuralisme pragois, mais aussi sur le plan idéologique et épistémologique. Lorsqu’on récapitule les critères du tableau 1, de [A] à [P], de la continuité avec le structuralisme nord-américain à la posture et à l’action évangéliste, en passant par le behaviorisme [E] et le positivisme [N], on mesure à quel point la problématique critique des prémisses idéologiques mise à jour par Patrick Sériot pour le structuralisme centre-européen s’avère tout aussi pertinente pour la dimension ou la posture totalisante de la tagmémique.
36 « This field view is a necessary antidote to an over-segmentation which treats as the only object of study the particular bits and pieces in a particular sequential relation or event ».
JeAn LéO LéOnARd
141
dialectique suit une trajectoire qui va de la langue à la parole, ou que dans la GGT, elle s’articule entre représentations lexicales et représentations postlexicales, entre formes lexicales et réalisations, dans la tagmémique, langue et parole coïncident ou coexistent non pas sur un même plan, mais dans la pâte d’un feuilletage qui constitue la totalité de la langue, qui va de la particule au champ de force en passant par l’onde. Si le « champ » permet d’éviter l’atomisme descriptif, et de dépasser le niveau de la simple occurrence, il n’est autre que l’espace des réalisations, où s’accomplit le tour de force permanent qui consiste à maintenir la cohésion d’éléments qui ne cessent de s’interpoler, de se contracter ou de se dilater dans la multiplicité des échanges et des interactions entre syntagmèmes mais aussi entre locuteurs, dans le champ des tous de parole (les paragraphes de la conversation) et dans le discours (les textes et récits mythiques ou historiques composant des corpora analysables en extension plutôt que dissécables en chunks ou blocs et fragments). Cette vision de la complexité intégrée de la langue et de la parole sous forme d’un hologramme à géométrie variable est patente dès les premières analyses du mixtec par Kenneth Pike (Pike 1944). Elle traverse tout la tagmémique, et fait de son approche holistique (critère [G]) le versant vertical de la trinité que forme cet angle d’approche avec la topologie (critère [R]) et la sérialité (critère [U]).
5. À L’éPReUve des fAiTs de LAngUe : MAzATeC
À travers cette contribution, l’auteur du présent article cherche davantage à comprendre la nature et les limites d’un des paradigmes de linguistique descriptive qui a le plus produit de données sur les langues qui relèvent de son champ d’observation : la Mésoamérique. Le détour par le questionnement épistémologique s’impose afin de comprendre la nature des données, en termes de construits, que des linguistes tagmémiciens ou comparatistes formés à l’école de la tagmémique (Gudschinsky, Kirk) ont produit sur une langue en particulier : le mazatec. Face à la complexité des faits de langue en domaine otomangue, à l’impression d’irréductibilité des structures d’une langue comme le mazatec à une description simple, étant donné la richesse en allomorphes et en supplétions qui contribuent à rendre son système verbal hautement complexe (cf. Jamieson 1982, Léonard & Kihm 2010), un retour sur les prémisses théoriques en amont était nécessaire. D’autant plus que, sur le terrain, en situation de collecte systématique de données nouvelles sur la variation dialectale du mazatec, ce sont les données fournies par les linguistes du SIL qui servent à la fois de base, de boussole et d’éventail d’hypothèses.37 Le retour sur les données implique un retour sur les méthodes et sur les hypothèses qui ont permis aux descripteurs d’aboutir aux sommes de données mises à disposition. On mesure alors l’efficacité de la tagmémique. On repère en connaissance de cause, pour se retrouver à arpenter le même terrain un demi-siècle plus tard, les écueils que les descripteurs ont su contourner, la pertinence de certaines hypothèses, les apories de certains choix. Mais dans l’ensemble, le bilan force l’admiration en termes de pertinence descriptive et de fiabilité des données.
37 L’auteur de ces lignes tient à exprimer sa reconnaissance à ses collègues et informateurs mazatecs de San Felipe Jalapa de Díaz, Nuevo Pescadito de Abajo Segundo, Huautla de Jiménez et San Jerónimo Tecoatl, qui l’ont accueilli avec tant de générosité depuis l’été 2010.
à qUOi ReCOnnAîT-On LA TAgMéMiqUe ?
142
Par ailleurs – et c’est là tout le sel de l’histoire des idées en grammaire –, les limites et les facteurs opacifiants du modèle, ainsi que les brèches, les failles et les fausses pistes, apparaissent avec d’autant plus d’acuité, en regard des trouvailles et des intuitions justes. Autrement dit, la description d’une langue ne procède pas d’un parcours balisé par un protocole aprioristique, mais plutôt d’un jeu de piste. En tant que praxis, la description des langues ne se limite pas à une projection de catégories grammaticales gréco-latines, mais à la construction de matrices de collocations entre tagmèmes discrets. Les matrices sont d’autant plus à géométrie variable qu’elles sont sous-spécifiées en amont, laissant la voie ouverte à de multiples constructions, reconstructions, déconstructions et descriptions. En tagmémique, ce n’est pas la théorie qui se régénère à travers un circuit de contraintes modulaires comme dans la GGT, de manière hypothético-déductive, mais plutôt la démarche inductive qui confère aux faits de langue des formes multiples, ou les matrices de collocations de fonctions élémentaires, qui démultiplient les anamorphoses d’un auteur à l’autre, d’un dialecte à l’autre, au fil d’une praxis centrée sur l’apprentissage et la traduction. Nous allons illustrer cette dialectique de découvertes et d’apories à travers un bref survol de l’apport de linguistes du SIL sur des questions de grammaire de deux variétés de mazatec des hautes terres (San Jerónimo et Huautla).
En quoi la tagmémique est-elle particulièrement opérante pour analyser les données du mazatec ? L’approche en termes de tagmèmes, unités définies par leur topologie et leurs propriétés de classe, a permis à Kenneth Pike de rendre intelligible les mécanismes de fonctionnement de la flexion du verbe mazatec, a priori déroutants : dans cette langue, la préfixation TAMV (Temps, Aspect, Mode, Voix) peut varier selon la personne (verbe causatif síxá « il/elle travaille », siixáa « je travaille », mais xái « tu travailles », nìxáo « vous travaillez » ; en revanche, à l’inaccompli, le radical flexionnel retenu pour toutes les personnes est siixá-). Ce mécanisme se laisse décrire par deux explications différentes en termes de prémisses, mais compatibles, qui seront données successivement au cours de la modélisation proposée par des linguistes du S.I.L (Pike 1948, puis Jamieson 1982) : d’une part, les allomorphes de préfixes causatifs sí-, nì- et sii- ne sont autres que des verbes légers dont l’allomorphie s’explique par un mécanisme résiduel de flexion de personne/aspect, d’autre part, on peut aussi bien les considérer comme des préverbes faisant partie intégrante du radical, assignant à chaque verbe une classe flexionnelle. Les deux théories sont vraies à parts égales, et elles n’ont rien de contradictoire dans un modèle qui fait du tagmème à la fois une position et une propriété de classe grammaticale. Cette souplesse du modèle lui permet d’analyser un même objet tantôt comme relevant de formes composés ou analytiques (Pike, 1948), tantôt en tant que formes synthétiques dotées de propriétés de classes flexionnelles. Cette souplesse du modèle, non pas aléatoire, mais fondée sur la définition du tagmème comme position et comme propriété classificatoire est compatible avec des modèles récents en morphologie flexionnelle (cf. Léonard & Kihm, 2010). Les prémisses de la tagmémique, qui stipulent qu’un morphème prend sa valeur fonctionnelle en fonction de sa collocation, et active ses propriétés de classe sur la chaîne qui lui est associée, s’avèrent très heuristiques pour des langues qui, comme le mazatec, construisent leur lexique sur des bases ou des racines polyvalentes (ou acatégorielles).
JeAn LéO LéOnARd
143
5.1. Morphologie flexionnelle (le verbe)
Le tableau ci-dessous reprend à un important article de Brian Bull quelques paradigmes de la flexion verbale du mazatec (popolocan, otomangue oriental, Mexique) de San Jerónimo Tecoatl – un parler des hautes terres nord-occidentales38 (Bull 1984).
neUTRe(PRésenT)
inACCOMPLi
(fUTUR)ACCOMPLi
(PAssé)
1 Se marier 3sg. bixan kixan tsixan
2 Se marier 1sg. bixan kixan
3 Se marier 2sg. bixain kixain
4 Balayer 3sg. botícha kotícha
5 Balayer 1sg. botícha kotícha
6 Balayer 2sg. botíchi kotíchi
7 Brûler TR. 3sg. boká kokà
8 Brûler TR. 1sg. boká koka
9 Brûler TR. 2sg. bokai kokai
10 Cuire TR. 3sg. bjañan kjoañan
11 Cuire TR. 1sg. bjañan kjoañan
12 Cuire TR. 2sg. chjañin chjañin
13 Tenir TR. 3sg. tsobà jtsoba
14 Tenir TR. 1sg. tsobà jtsobà
15 Tenir TR. 2sg. ntobì kintobi
16 Ecrire 3sg. kji skí kiski
17 Ecrire 1sg. kjia skia
18 Ecrire 2sg. chji chjí kichji
19 Attendre 3sg. koñan skóñan kiskoñan
20 Attendre 1sg. koñan skoñan
21 Attendre 2sg. chiñin jchíñin kichiñin
22 Couper 3sg. bote kote
23 Couper 1sg. bote kote
24 Couper 2sg. bichì kichí
25 Danser 3sg. tè jté kitè
26 Danser 1sg. tè jtè kichì
27 Danser 2sg. chì jchi
Tableau 6.1. Paradigmes de la flexion verbale de San Jerónimo Tecoatl transposés en graphie mazatèque standard39, Bull 1984, p. 112-115.
38 Au sujet de la classification des dialectes mazatecs, cf. Gudschinsky 1958b, et les données dans Kirk 1966. Cf. aussi l’importante étude sur l’intelligibilité dans le réseau dialectal mazatec (Kirk 1970).
39 Les conventions graphiques sont reprises à l’espagnol en tant que langue-toit : <ch> = /č/, <j> = /h/, etc., ainsi qu’à l’espagnol colonial : <x> = /š/. L’occlusion glottale est notée par une apostrophe ou saltillo (k’, a’a). La notation des tons suit les conventions suivantes : accent aigu pour le ton haut (á), grave pour le ton mi-haut (à), aucun diacritique pour le ton moyen (a), et un soulignement pour le ton bas (a).
à qUOi ReCOnnAîT-On LA TAgMéMiqUe ?
144
Le tableau 6.1. (ci-contre) présente un ensemble de données caractéristiques du genre de problèmes qui se posaient aux tagmémiciens : un riche complexe de préverbes aspectuels (bi-, ki-, tsi- en [1]), dont il fallait définir la relation avec des jeux préfixaux analogues (bo-, ko-/ko-), comme en [4]-[6] et [7]-[9], ou avec des jeux préfixaux supplétifs (comparer les préfixes bja-, kjoa- de [9] et [10] à la forme syncrétique chja- en [12]). Quelle est la relation de la fricative glottale j- dans jtso- en [13] contre tso- ? Identique à celle de la fricative dans bja- et kjoa- que nous venons de voir en [9] et [10] ? Quelle est la valeur signifiante de ces éléments fricatifs ? Comment expliquer des jeux comme en [13] et [15], où tso- et jtso- s’opposent à nto-/nto- ? Que vient faire le préfixe s- en [19] dans la paire ko-/skó- ? Pourquoi, en [22] et [23] le jeu bo-/ko-, ko- s’oppose en [24] à bi- et ki- ? Enfin, les séries [25] à [27], outre la supplétion en [27] laissent à penser que la fricative glottale est un préfixe au même titre que s- en [16] et [19].
La tagmémique répond en partie à ces questions – notamment sur le plan de la formation des thèmes morphologiques à partir d’une théorie compositionnelle de la collocation –, en partie elle s’avère inopérante – pour la description ou l’explication des phénomènes d’allomorphie préfixale. Comme nous l’avons vu plus haut, au chapitre 8 de son ouvrage sur les tons, consacré à la morphologie verbale du mazatec, Kenneth Pike eut la perspicacité d’identifier dans la plupart de ces préfixes d’aspect et de personne des verbes légers ou des auxiliaires (ou des co-verbes), expliquant ainsi à la fois les jeux d’alternances et les supplétions. L’approche par collocation morphémique s’est avérée payante dans ce cas précis. Mais c’est seulement à l’aide d’un modèle génératif, près de quarante ans plus tard, à l’aide de la phonologie cyclique et des règles ordonnées que Brian Bull, pourtant linguiste du SIL, a pu présenter une explication plausible du mode de formation des allomorphies comme dans le tableau 6.2. Les unités réduites, contractées ou effacées sont signalées en caractères grisés.
On voit ici se croiser deux critères : la complémentarité avec la GGT en [F] du tableau 1, puisque Brian Bull, issu de l’école tagmémique, a recours aux règles ordonnées de la phonologie générative pour décrire et expliquer les mécanismes flexionnels du mazatec de San Jerónimo Tecoatl, et l’aporie au niveau [T] du différenciant et de la différenciation du tableau 2.2, car les données du tableau 6.1 sont pauvres en contrastes tonaux entre 1Sg. et les autres personnes – Bull ne semble pas avoir suivi les leçons de Pike sur les classes tonales (Pike, 1948, p. 111-115). Le syntagmème Aux.+√+Arguments identifié par Kenneth Pike en 1948 s’étant condensé en tagmème a donné un thème flexionnel réanalysable, d’une grande valeur à la fois descriptive et explicative pour la compréhension du système verbal mazatec, que décrira par la suite une autre linguiste du SIL, Carole Ann Jamieson, à l’aide d’un système de classes flexionnelles d’une grande élégance et robustesse (Jamieson 1982)40, ou de manière purement descriptive et didactique dans une grammaire de référence de la variété de Chuiquihuitlán41 (Jamieson 1988). Cependant, la tagmémique ne pouvait à elle seule
40 Pour une réanalyse expérimentale de cette classification, v. Léonard & Kihm 2010. 41 Ce dialecte mazatec est sans conteste le plus abondamment décrit, par Carole Jamieson.
Or, il s’agit d’une variété les plus menacées (faible population, position excentrique, au fond de la Cañada), des plus périphériques, probablement le moins intelligible par les autres communautés (cf. résultats des tests d’intercompréhension de Kirk 1970). Il a fait l’objet d’une description bien plus exhaustive que les dialectes de Huautla ou de Jalapa, pourtant bien plus centraux dans leur aire et de poids démographique incomparablement supérieur.
JeAn LéO LéOnARd
145
Règle de Bull
PROcESSuS Séquences Exemple
R1 Réduction des géminées (geM.Red.)*
CiCi > Ci s-k-koñans- k -kjoe
R2 Effacement de k-(K-deL.)
k-C-√w- ; k-ˀN > Ø k-ts-wixan
R3 Effacement de w-(W-deL.)
k-ts-√w- > kts ts-wixan
R4 Lénition de ts-(Ts-WeAK.)
k-ts-√k- > ks-√k- k-ts-koñan
R5 Effacement de ts-(Ts-deL.)
k-ts-√h- > k-√h- k-ts-chiñin
R6 Epenthèse -i-(i-ePenTH.)
k-√C- > ki-√C- k-i-chiñin
R7 Harmonie vocalique(vOW.HARM.)
√Vi-Vj > Vj-Vj tsi-wotjo > tso-wotjo
R8 Effacement de s-(s-deL.)
sk-√C- sk-kjnoin > sk-chiñin
R9 Syllabation w-(W-syLL.)
(C)C-√w- > (C)-C-√V- sk’wi > sk’oi
R10 Effacement de n-(n-deL.)
C-√N- s’nin > s’in
R11 Lénition de k-(K-WeAK.)
k-√ch- > h-√ch- k-chiñin >hchiñin
R12 Effacement de h- 1(H-deL. 1)
sk-√Cj > sk√C sk-kjoe > skjoe > skoe
R13 Effacement de h- 2(H-deL. 2)
j√ch- > √ch- jchjoi > chjoi
R14 Effacement de h- 3(H-deL. 3)
j√i- > √i- k-ts-wjito > jito >ito
R15 Remontée laryngale(LAR. fROnT.)
√CV’Vn CVj’V > √Cj’V sk-wj’i > koj’i > kj’oisk-w’a > ko’a > k’oa
R16 Modification de o-(O-MOdif.)
√jo- > √ja- k-ts-wjote > jote > jate
R17 Effacement de o-(O-deL.)
√VV > V sk-wjote > kjoote > kjote ;
sk-wjito > kjoito > kjito
Tableau 6.2. Récapitulatif des règles ordonnées de Bull. *Nous maintenons les abréviations des règles de Bull en anglais : ex. s-DEL. = s-deletion, etc.
Bel exemple, au sein même du SIL, d’entreprise de grammatisation pure, indépendamment d’objectifs prosélytiques : les cellules [I] (grammatisation) et [O] (indigénisme) du tableau 1 entrent en contradiction, au bénéfice de l’empirisme pur (case [M] du même tableau). Ce paradoxe de la grammatisation étendue d’un dialecte périphérique revêt, selon nous, un grand intérêt du point de vue de la sociologie des sciences : on peut y voir un cas de séréndipité empirique. La linguistique peut être tout autant reconnaissante à Jamieson qu’à Kenneth ou Eunice Pike pour sa contribution à l’exploration et à la connaissance d’une langue aussi exemplaire, en complexité structurale, que le mazatec.
à qUOi ReCOnnAîT-On LA TAgMéMiqUe ?
146
rendre compte de la complexité des phénomènes. Il fallait faire jouer le paramètre [F] pour restituer, selon le modèle de la phonologie cyclique et des règles ordonnées, d’ordre transformationaliste, des morphèmes sous-jacents, concaténés de manière prévisible, dans des paradigmes aspectuels : {k-} inaccompli, ainsi qu’un augment préfixal ambivalent {ts-}. Le premier réduit les attaques approximantes des préverbes bi- et ba- (en 1-3, en 7 et en 24), le deuxième se réduit pour s’associer à un préfixe vélaire (16, 19). La simple métaphore du jeu de la particule et de l’onde ne suffisait pas à rendre compte de tels phénomènes : encore fallait-il déterminer les contraintes pesant sur le différenciant et la différenciation (critère [T] du tableau 2).
5.2. Grammaire de texte, la grammaire par l’analyse de discours. L’approche lexicaliste et discursive de George Cowan
Un deuxième tableau de données illustrera l’apport – et les apories – de la tagmémique. Dans A Mazatec Historical Text, importante monographie qu’on peut considérer comme un essai experimental de grammaire de texte de la variété de Huautla (Hautes terres centrales, principal centre urbain mazatec), l’anthropologue et linguiste du SIL George Cowan analyse un texte d’histoire orale, à partir d’une étude sérielle des collocations. Les extraits de formes verbales du tableau 7 sont référencés dans la deuxième colonne par page et par paragraphe (p. 107:4 = page 107, paragraphe n° 4). Les formes mazatèques ont été réécrites selon les conventions graphiques modernes dans la troisième colonne. La quatrième colonne reproduit les gloses de G. Cowan, et la dernière colonne donne la traduction anglaise de la forme verbale. Le récit raconte comment les révolutionnaires vinrent à Huautla, au début du 20ème siècle, en laissant derrière eux le souvenir d’exactions, en particulier de vol de bétail. Un groupe d’habitants spoliés se constitue en milice et collecte de l’argent pour acheter des armes afin de défendre leurs intérêts. La trame narrative est rendue complexe par un recours à des procédés médiatifs légitimants (« les anciens m’ont dit/enseigné… ») et une volonté du narrateur de souligner les contradictions politiques et socioéconomiques des acteurs du drame (des pauvres volant des pauvres).42
La structure de ces gloses est le plus souvent un préfixe aspectuel associé par deux points à une tête lexicale, suivie d’un argument oblique ou d’une adposition. La segmentation paraît si souvent aléatoire, dans la deuxième colonne, qu’elle en deviendrait superflue, s’il n’était hautement probable que les tirets désignent en réalité non pas des affixes, mais des clitiques. En somme, c’est toute la logique syntagmatique, qui transcende l’analyse morphémique ou affixale pour ne retenir que des chaînes clitiques et des amalgames compositionnels qui est illustrée ici par ces formes dans tous leurs états (segmentation en colonne 3, gloses en colonne 4, traduction en colonne 5). Si le lecteur retient les articulations discursives et la chronologie relative des événements (la coordination et la cohésion TAMV), la numérotation des paragraphes sert alors de jalon pour comprendre les jeux de contrastes entre préfixes aspecto-temporels pour différents états grammaticaux
42 Ces considérations historiques sur les événements de la révolution mexicaine n’engagent que l’informateur, et le transcripteur, George Cowan.
JeAn LéO LéOnARd
147
d’une narration au passé. En somme, au-delà de son aspect brouillon, voire aléatoire, la segmentation et l’analyse lexico-grammaticale de ce texte font sens dans une perspective tagmémique – pourvu qu’on en ait les clés et que l’on procède à une lecture des formes qui relève moins d’une analyse morphémique que d’une mise en configuration d’unités syntagmatiques en relation de cohésion discursive.
Nous avons retenu quatre séries, afin de faire jouer la sérialité (critère [U]), en prenant deux angles d’approche : les séries des tableaux 7.1 et 7.2 relèvent du complexe TAMV (Temps, Aspect, Mode, Voix) en partant de catégories exogènes (propres à la grammaire gréco-latine), qui sont celles retenues par Cowan (past et future, respectivement) dans son analyse du texte oral. La deuxième série se veut davantage exemplaire de catégories endogènes du mazatec : jeux d’auxiliaires de mouvement ja’a-, fi- dans le tableau 7.3., procédés de prédication et d’attribution dans le tableau 7.4. Nous verrons en quoi les gloses de George Cowan sont représentatives de la doctrine tagmémique, et constituent un modèle hybride entre grammaire gréco-latine, traduction littérale et micromodélisation des données en accord avec les principes énoncés plus haut. Il est frappant de constater que chaque glose constitue davantage un énoncé (sentence) qu’un syntagme (clause en tagmémique, phrase en GGT). Chaque glose est en réalité un microcosme morphosyntaxique, mais aussi énonciatif. Cette charge énonciative permet de contourner la description catégorielle (et donc la spécification de constituance) : en 7.1.[1] ki-tsòya-na est glosé past-teach-to:me:they et traduit par « they taught (to) me ». La description est parfaitement lexicaliste, puisque « enseigner » est exprimé ici par tsòya-, composé de tsò = dire et -ya- adposition avec sème locatif « dans ». George Cowan le sait, mais ne juge pas utile de décomposer afin de ne pas sursegmenter, fidèle aux principes d’économie énoncés plus haut par Robert Longacre. Ce choix est légitime pour un lexème complexe. Nous allons voir qu’il s’étend à la notion même de préfixe ou de proclitique de passé ou d’accompli et d’inaccompli passé (imparfait) – sans aucune spécification aspectuelle, pourtant si importante en mazatec, et qui sera d’ailleurs utilisée par d’autres descripteurs du SIL, notamment Pike, Jamieson, Kirk, Bull, etc. Ainsi, past- est la glose utilisée aussi bien pour ki-nz’oe-lèe : past-listen-to:them:I (« I listened to them ») en 7.1.[2] que pour tsa-k’è-jna past-is:present:he « he became (president) » en 7.1.[5]. Il en va de même pour l’allomorphe k’i- de k’íts’ia-ni : past:begin-origin:it pour « (the trouble) began » en 7.1.[4], dont rien ne nous explique la glottalisation. Aucune spécification de glose ne distingue le préfixe ji- de passé dans jichòka-xó-ni : pst:arrive-quoted-instr:it « (the day) arrived (when…) » en 7.1.[8] du préfixe ki- en 7.1.[1, 2, 7, 9] – il s’agit en réalité simplement d’une sous-catégorisation de classe préfixale TAMV variable selon la structure lexicale du verbe. Rien non plus ne permet d’identifier un morphème de passé dans 7.1.[10], où la forme b’ena, glosée make-to:me:they, est traduite au passé par « they made to me (this observation) ». Or, rien de tout ceci n’est mal conçu à proprement parler : on y verra seulement l’application des principes énoncés plus haut de réticence à la surspécification des gloses, l’a priori pour une description syntagmatique et quasi littérale des faits de langue. Cette mise en syntagme en cette énonciation à double entrée (les gloses et la traduction) ne manque pas de systématicité : l’ordre de ce qu’on est bien obligé d’appeler a posteriori des constituants morphosyntaxiques est régulier (les séquences Temps-Verbe-(Modal)-Personne & Rôles sémantiques sont d’une grande régularité).
à qUOi ReCOnnAîT-On LA TAgMéMiqUe ?
148
Référence MHT Segmentation Glose Traduction
1 p. 107:4 ki-tsòya-na past-teach-to:me:they they taught (to) me2 p. 107:5 ki-nz’oe-lèe past-listen-to:them:I I listened to them
3 p. 107:5 (ki…)tsak’ìnyan’ióan (past)-am:taught:thoroughly:I
I thoroughly absorbed (their talk)
4 p. 107:6 k’íts’ia-ni past:begin-origin:it (the trouble) began5 p. 108:6 tsa-k’è-jna past-is:present:he he became (president)6 p. 109:9 tsa-k’èjna pst-is:present:he he lived (in San Antonio)7 p. 111:17 ki-s’in-ni pst-do-origin:they (thus) he did8 p. 113:22 jichòka-xó-ni pst:arrive-quoted-instr:it (the day) arrived (when…)9 p. 112:21 ki-k’ìn pst-is:named:he is named
10 p. 108:8 b’ena make-to:me:they they made to me (this observation)
Tableau 7.1. Série Preterit. MHT, Cowan (1965).
On retrouve la même logique de segmentation dans les données du tableau 7.2., qui présente des formes verbales au « futur » (inaccompli, en termes de grammaire mazatèque). Des formes comme 7.2.[1, 2, 3] comme k’oè : fut:throw:we « we(‘ll) give (money) » ou k’oè-ñà : fut:collect:we « we(‘ll) collect (money) » et kointá : fut:buy:we « we’ll buy (guns) » ne détaillent aucunement les formes, dans lesquelles le morphème d’inaccompli préfixal k- s’est en effet amalgamé conformément aux règles de Bull examinées plus haut. Il fait corps avec les racines lexicales, qui ne sont plus restituables (cependant, une analyse aussi bien Pikienne que Bullienne les rend disponibles pour une analyse sursegmentée : k-√we+à > k’oè en 7.2.[1, 2], où √ note une racine lexicale et à un suffixe1Pl.Inclusif). Il en va de même avec le causatif si-, allomorphe de la forme lexicale ou radicale √s’í – dans les dialectes des basses terres, √ ts(i)’í. Dans sijé-leè : fut:ask-of:it:we « we’ll ask » et sikjankoà : fut:fight:with:we « we’ll fight with » ou síchjé-ná chota : steal-from:us:they « they rob us (those people) » en 7.2.[4-6], le futur est davantage elliptique, sur le plan énonciatif, qu’actualisé par un préfixe.
Une forme comme sikjankoà s’analyserait si- + kjan + ko=à : DoiMPf.iRR .+ Against + With=Appl. 1Pl.Incl. (littéralement : « faire+contre+avec+nous » pour « nous nous battrons contre »), à savoir comme un verbe composé avec causatif si- avec ton bas marquant l’aspect inaccompli, associé à deux racines adpositionnelles de valeur adversative (kjan) et associative (kao, forme forte, versus ko- comme ici, forme faible). La personne oblique nous, inclusive, est marquée par -à, avec ton haut abaissé, en harmonie métatonique avec le marquage aspectuel intoné du préfixe. Rien d’étonnant à ce que George Cowan se contente d’une glose fut:fight:with:we, par ailleurs exacte sur le plan lexical. Cette complexité illustre le concept d’ondes (wave) de Kenneth Pike : le jeu des interpolations de marque dans le passage de la langue à la parole, ou plutôt, en bonne logique tagmémique, de la langue au discours et à l’énonciation. Il en va de même avec les formes en 7.2.[7] s’e-síni-ná fut:become-to:us (in order to) get (strength), à comparer aux précédentes avec préfixe en si-, ou en 7.2.[8-9] koisótjeèn : fut:arise:we « (that) we’ll rise », koiyotoán : fut:fight:we « we’ll fight ». Le préfixe d’inaccompli est
JeAn LéO LéOnARd
149
ici transparent : c’est koi- (kui- dans les dialectes des basses terres) : les thèmes radicaux sont donc sótjen et yoto, mais cette fois, ce sont les marques de personne 1Pl. inclusives qui sont variables (koisótjeèn vs. koiyotoán). Par ailleurs, les préfixes aspectuels koi- suivent eux-mêmes des contraintes de collocation dépendantes des radicaux lexicaux sótje et yoto. Enfin, la forme 7.2.[10] koiyotjenki-le chota : fut:chase:after-to:them:we people « we’ll pursue after (the people who come to rob us) » donne un bel exemple de productivité lexicale, puisque le radical de ce verbe, -yotjenki, est une recombinatoire des éléments adpositionnels : comparer -sótjen- « se soulever » et -yoto- « se battre » avec -yotjenki- = « traquer », où -nki est une racine adpositionnelle sublative (« aller sous, dessous »). Le dualisme des gloses et des traductions de Cowan rend compte à peu de frais, mais de manière régulière et relativement cohérente, de cette complexité, ou du moins, permet à quiconque se plonge dans l’apprentissage de la langue de trouver des repères et d’accéder à des niveaux implicites de segmentation. On touche là à un paradoxe de la tagmémique, lié au critère [P] du tableau 1 (évangélisme) : la description vise plus à donner des outils de repérage des structures de la langue, qui serviront aux traducteurs de la Bible, ou à des locuteurs prosélytes associés à ce projet, qu’à fournir des données immédiatement analysables pour le linguiste. Ce n’est pas le moindre des paradoxes de constater à quel point ces données, présentées selon cette logique de sténographie métalinguistique, sont aujourd’hui engrangées dans de grandes bases de données et alimentent massivement des régions entières de la cartographie typologique des langues (en particulier le WALS).
Référence MHT Segmentation Glose Traduction
1 p. 113:24 k’oè fut:throw:we we(‘ll) give (money)2 p. 113:24 k’oè-ñà fut:collect:we we(‘ll) collect (money)3 p. 114:26 kointá fut:buy:we we’ll buy (guns)4 p. 114:26 sijé-leè fut:ask-of:it:we we’ll ask5 p. 114:27 sikjankoà fut:fight:with:we we’ll fight with6 p. 113:23 síchjé-ná chota steal-from:us:they they rob us (those people)7 p. 114:26 s’e-síni-ná fut:become-to:us (in order to) get (strength)8 p. 115:29 koisótjeèn fut:arise:we (that) we’ll rise9 p. 115:29 koiyotoán fut:fight:we we’ll fight
10 p. 114:27 koiyotjenki-le chota fut:chase:after-to:them:we people
we’ll pursue after (the people who come to rob us)
12 p. 113:24 a-tsì koan Interr-not fut:become will it not be?
Tableau 7.2. séRie fUTUR. Extraits de MHT Cowan (1965).
Les formes en 7.3.[2-6] illustrent la componentialité des gloses, qui analysent les formes verbales comme des formes composées potentielles : en 7.3.[4] ja’aisíchjé-xo-ná = (they said) « he came to rob (our town) », on trouve un verbe causatif (faire+vol : sí+chjé) déjà rencontré auparavant, associé avec l’auxiliaire de mouvement ja’ai, qui apparaît clairement en 7.3.[1] avec le sens lexical d’« arriver ». Rien d’autre que l’allomorphie lexicale ne permet d’expliquer les oppositions aspecto-temporelles – ja’ai :arrived:it « it came, it arrived », fa’aisíchjé-ná : arrive:to:steal-from:us:they « (the people) who come
à qUOi ReCOnnAîT-On LA TAgMéMiqUe ?
150
to steal from us ». L’alternance j-/f- de l’attaque initiale s’explique là encore par des effets de sérialité (classes TAMV ou sets), qu’on peut considérer comme lexicalisés dans ce paradigme : aspect neutre fa’ai « il/elle vient » versus accompli ja’ai « il/elle vint ». En 7.3.[6], fa’aisíma-ná : arrive:to:make:poor-to:us:they « (they did it to) make us poor » est une forme contractée lexicalisée transposable par venir+faire+pauvre=à nous, avec contraction de yoma « pauvre » en un thème flexionnel síma, signifiant « rendre pauvre », « appauvrir », avec un procédé de formation compositionnel, courant en mazatec, assurant une grande richesse lexicale à la langue. L’identité de l’auxiliaire ja’ai-/fa’ai- « venir », « arriver » apparaît bien en contraste avec l’auxiliaire « aller », bi-/fi- en 7.3.[7] fìkao- goes:with-quoted:he « they say he went with them (the cows) », dont on reconnaîtra les éléments adpositionnels (-kao-, forme pleine de l’adpositionnel associatif) et médiatifs (enclitique =xó).
Référence MHT Segmentation Glose Traduction
1 p. 108:7 ja’ai arrived:it it came, it arrived
2 p. 110:14 fa’aik’á arrives:to:carry:away:he he came to take them (the cows) away
3 p. 111:20 ja’aitsjen-le pst:remember-to:him he was recalled
4 p. 109:9 ja’aisíchjé-xo-ná pst:arrive:to:steal-quoted-remote:he
(they said) he came to rob (our town)
5 p. 113:23 fa’aisíchjé-ná arrive:to:steal-from:us:they
(the people) who come to steal from us
6 p. 115:30 fa’aisíma-ná arrive:to:make:poor-to:us:they
(they did it to) make us poor
7 p. 110:15 fìkao-xó goes:with-quoted:he they say he went with them (the cows)
Tableau 7.3. Série Verbe Mouvement, exemples Cowan (1965).
La série 7.4 de constructions prédicatives et de prédication négative est intéressante par les constructions à expériencieur, qui font appel à des enclitiques applicatifs (=le) ou à des déictiques de spatialisation (=be). Ces structures, très différentes des tours de la grammaire gréco-latine, sont glosées de manière littérale par le transcripteur, avec suffisamment de transparence pour permettre d’identifier les prédicats et les contrastes tonaux dans les chaînes de clitiques proniominaux: comparer tsìn-le = is:not-to:them « they do not have », soit Préd.nég.-3Obl. (Sg. et Pl.), avec ton bas dans le pronom oblique le versus mi-leè = is:named-to:them:we, soit Nom-3Obl.-1Pl.Incl. « what we refer to as (guns) », où le porte un ton bas (soulignement) et l’allorphe -è de suffixe 1Pl.inclusif porte un ton mi-haut (accent grave) – cf. note 42 supra au sujet de la notation des tons.
Le survol des données et des gloses de George Cowan aura permis de constater à quel point la notation tagmémique des éléments métalinguistiques est fidèle aux principes d’omnisyntagmaticité des unités linguistiques prôné par les tenants du modèle. On est face à une sorte de sténographie énonciative des valeurs et des
JeAn LéO LéOnARd
151
Référence MHT Segmentation Glose Traduction
1 p. 110:16 ní are:they they are (poor)2 p. 110:15 mì-be is:named-there (he) is named there as L.S.3 p. 111:17 mi-leè is:named-to:them:we what we refer to as (guns)
4 p. 109:11, 12 ; 110:13 tsìn is:not there were no (such
cows here)5 p. 112:21 tjín-le is-to:him (who) was (president)6 p. 110:16 tsìn-le is:not-to:them they do not have7 p. 113:25 a-tsì tjín-ná Interr-not is-to:us do we have (manliness)?
Tableau 7.4. Série Predicats, aspect neutre (présent habituel) . Cowan (1965).
fonctions grammaticales, qui fait usage d’un inventaire très limité de catégories fonctionnelles, conformément au tableau 3 des principales classes tagmémiques de Longacre. Ce n’est qu’en plongeant dans des données traitées à l’aide de ce dispositif qu’on peut en mesurer les avantages mais aussi les limites. Surtout, on en mesurera les implications dans la praxis : aussi bien pour transcrire des textes et des discours que pour en baliser les relais fonctionnels permettant de revenir ensuite à l’analyse par degrés et couches successives, puisque non seulement l’analyse que nous révèlent les gloses de Cowan est une notation synoptique, mais elle s’alimente en arrière-plan des analyses aussi précises que décomponentialisées – ou sursegmentées, selon les termes de Longacre – réalisées par Kenneth Pike en 1948 dans le chapitre 8 de son manuel de tonologie, qui s’avère être une exploration magistrale à la fois des procédés de formation lexicale du mazatec et de l’ensemble de ses procédés de flexion. Tout se passe comme si Cowan avait opté en 1965 pour limiter sa notation au niveau des ondes, tandis que Kenneth Pike avait entrepris de détecter les particules dans son travail pionnier de 1948. C’est dans cette optique de flexibilité des niveaux d’analyse qu’il faut considérer les descriptions des tagmémiciens : un vaste atelier modulaire, avec des secteurs et des zones de traitement spécialisées, qui explorent les structures linguistiques en prenant la métaphore physiciste de Pike avec le plus grand sérieux, dans un souci constant de faciliter une double praxis : une praxis d’exploration (description) et une praxis de médiation (traduction, didactique).
6. COnCLUsiOn
Nous pouvons donc désormais répondre à la question que pose le titre même de cette contribution, en paraphrasant le titre de l’article de Gilles Deleuze intitulé « à quoi reconnaît-on le structuralisme ? » en transposant à la tagmémique. On reconnaît d’abord la tagmémiquepar ses tendances, tropismes, praxis et doctrines qui figurent dans le tableau 1, mais rien ne la caractérise davantage que les saturations et les lacunes, les concentrations et les interactions heuristiques entre modules du tableau 2, aussi bien que les apories. Surtout, on reconnaît la tagmémique à la taxinomie des catégories linguistiques induite par la topologie fonctionnelle. On la reconnaît aux conséquences du programme analytique
à qUOi ReCOnnAîT-On LA TAgMéMiqUe ?
152
particule/onde/champ, qui recherche les fonctions et les classes à travers des échelles analytiques variables, et, de manière plus décisive encore, qui explore les conditions de transparence et d’opacité des morphèmes dans les langues à travers les discours. On la reconnaît à ce tour de force qui consiste, par la métaphore physiciste qui sert de motto à Kenneth Pike, à rassembler langue et parole saussuriennes dans un grand sac, pour créer un seul monde (une monade) traversé par les particules et les ondes, maintenues en gravitation dans l’espace discursif par le champ. On la reconnaît également à ses triangulaisons, qui contrastent avec les dualismes et le binarisme des autres structuralismes. Mais on la reconnaît encore et toujours, à travers la matrice deleuzienne, comme une forme originale de structuralisme, orientée vers la praxis descriptive pure, sans renoncer pour autant à revendiquer un corps de doctrine. Cependant, la circularité dans un triangle taxinomique sérialité/topologie/fonction empêche le modèle de déployer un système de contraintes logiques propice à l’édification d’un formalisme crédible pour les autres structuralismes et les mouvements concurrents La prochaine question serait donc « que reste-t-il de la tagmémique ? » Or, paradoxalement, la réponse est « énormément », aussi bien dans le traitement automatique des corpora et dans l’ingénierie logicielle, que dans les ressources empiriques pour ce nouveau comparatisme qu’est la typologie linguistique. Des sommes empiriques de la typologie linguistique à échelle mondiale comme le WALS (Haspelmath et al. 2005) s’alimentent pour la plupart des langues peu représentées (de moins de 300 000 locuteurs) aux données du S.I.L, collectées et analysées selon les méthodes de la tagmémique, en filiation directe avec le structuralisme américain – alors que le générativisme n’a jamais eu ni ne pouvait avoir, pour des raisons de positionnement théorique, de projet de collecte et de description empirique des langues du monde. En ce qui concerne une langue aussi particulière que le mazatec et la plupart des langues otomangues (sauf le zapotec et le mixtec, qui ont fait l’objet de recherches originales hors-S.I.L. par Terrence Kaufman, Tomas Smith-Stark et Kathryn Josserand), la tagmémique s’est révélée un instrument performant et flexible, à proprement parler, heuristique. Le bilan est globalement très positif, et la transversalité avec le générativisme est appréciable. Du point de vue de l’histoire sociale des sciences, les relations entre structuralisme américain, tagmémique et générativisme constituent un observatoire d’un très grand intérêt aussi bien sur le plan théorique (qui alimente qui en données ? Qui se réapproprie les méthodes de qui, comment et pourquoi ?) que sur le plan pratique (les langues en danger attestées surtout par les travaux descriptifs du S.I.L.).
Enfin, et surtout, on reconnaît la tagmémique à sa posture déclarative, à la multiplicité de ses ressources graphiques et matricielles, sa modularité, ses tuilages matriciels et sériels, ses chaînes de collocations extensibles ou compactées, son refus des cases vides, des morphèmes zéros, des structures sous-jacentes – à moins de les déléguer à la GGT des cycles morphonologiques et des règles ordonnées –, à son goût du comparatisme et des séries de cognats, à ses gloses holographiques. Son apport empirique en typologie linguistique est tel qu’on ne saurait lire les données et les synthèses à grande échelle sur la diversité des langues qui font usage de faits de langues passés dans les grilles et les matrices de la tagmémique sans chercher à comprendre les prémisses de ce paradigme (post)structuraliste. Afin de
JeAn LéO LéOnARd
153
connaître la nature et la texture du grain qui sort du moulin sous forme de pâte ou de farine qu’on transformera en pain, faute d’aller soi-même le récolter, il importe de connaître les rouages, le poids, la texture et la forme du bois dont est faite la meule, par où est passé ce grain.
ReféRenCes
Siglaisons
GGT : Grammaire Générative et transformationnelleINI (Institut National Indigéniste) SIL : Summer Institue of Linguistics SPE : Sound Pattern of English (Chomsky & Halle, 1968)TAMV: Temps, Aspect, Mode, Voix WALS : World Atlas of Language Structures (Haspelmath et al. [2005]-2008)
Auroux, Sylvain (2007). La question de l’origine des langues, suivi de L’historicité des sciences, Paris, PUF.
Beltrán, Aguirre Gonzalo (1983). Lenguas vernáculas. Su uso y desuso en la enseñanza: La experiencia en México, México, CIESAS.
Casad, Eugene (1974). Dialect intelligibility testing, Norman, University of Oklahoma, Summer Institute of Linguistics.
Caso Alfonso, Zavala Silvio, Miranda José & González Navarros Moisés (1954). La política indigenista en México, México, D.F, INI.
Chomsky, Noam & Halle, Morris, (1968). The Sound Pattern of English,Cambridge, The MIT Press.
Cowan, George (1965). Some Aspects of the Lexical Structure of a Mazatec Historical Text, México D.F., Summer Institute of Linguistics.
Deleuze, Gilles (1953). Empirisme et subjectivité. Essai sur la nature humaine selon Hume, Paris, PUF.
Deleuze, Gilles (1967). « À quoi reconnaît-on le structuralisme ? », Châtelet, François (éd.), 1973, Histoire de la philosophie, VIII. Le XXe siècle, Paris, Hachette. [En ligne] <http://www.structuralisme.fr/>.
Deleuze, Gilles (1969). Logique du sens, Paris, Minuit.Friedman, Yona (1975). Utopies réalisables, Paris, Christian Bourgois.Golston, Chris & Kehrein, Wolfgang (1998). « Mazatec onsets and nuclei », International
Journal of American Linguistics 64(4), 311-337.Gudschinsky, Sarah (1958a). Proto-Popotecan. A Comparative Study of Popolocan and
Mixtecan, IJAL, 25(2). Gudschinsky, Sarah C. (1958b). « Mazatec dialect history », Language 34, 469-481.Gudschinsky, Sarah (1959a). « Mazatec Kernel Constructions and Transformations »,
IJAL 25 (2), 81-89. Gudschinsky, Sarah (1959b). « Discourse Analysis of a Mazatec Text », IJAL 25-3, 139-146.Hall, Edward, T. [1959] (1981). The Silent Language, NY, Anchor.Haspelmath Martin, Dryer Matthew, Gil David & Comrie, Bernard (eds) ([2005]-2008).
The World Atlas of Language Structures Online, Munich, Max Planck Digital Library. [En ligne] <http://wals.info/feature/>.
Hjelmslev, Louis (1954). « La stratification du langage », Hjelmslev, Louis, 1971, Essais linguistiques, Paris, Minuit, 45-77.
à qUOi ReCOnnAîT-On LA TAgMéMiqUe ?
154
Jamieson, Carole Ann (1982). « Conflated subsystems marking person and aspect in Chiquihuitlán Mazatec verb », IJAL 48-2, 139-167.
Jamieson, Carole Ann (1988). Gramática mazateca del Municipio de Chuiquihuitlan, Oaxaca, Mexico, Instituto Lingüístico de Verano, A.C.
Kaye, Alan (1994). « An Interview with Kenneth Pike », Current Anthropology 35-3, 291-298.Kirk, Paul Livingston (1966). Proto-Mazatec phonology, PhD dissertation, Washington,
University of Washington.Kirk, Paul Livingston (1970). « Intelligibility Testing: The Mazatec Study », IJAL 363,
205-211.Latour, Bruno 1989. La science en action. Introduction à la sociologie des sciences, trad.
Michel Biezunski, Paris, La Découverte.Lemaréchal, Alain, 1997. Zéro(s), Paris, PUF.Léonard, Jean Léo 2010. « Enquêtes exploratoires pour l’ALMaz (Atlas Lingüístico
Mazateco). Élicitation croisée, entre typologie et codification d’une langue otomangue », Géolinguistique 12, 59-109.
Léonard, Jean Léo & Kihm, Alain (2010). « Verb inflection in Chiquihuitlán Mazatec: a fragment and a PFM approach », Müller, Stefan (ed.), Proceedings of the HPSG10 Conference, Stanford, CSLI Publications. [En ligne] <http://csli-publications.stanford.edu/>.
Longacre, Ronald E. (1957). Proto-Mixtecan, IJAL 23-4. Longacre, Robert (1965). « Some Fundamental Insights of Tagmemics », Language 41-1, 65-76. Pike, Eunice (1967). « Huautla de Jiménez Mazatec », McQown, Norman A. (ed.),
Handbook of Middle American Indians, 5, Linguistics, Austin, TX, The University of Texas Press, 311-330.
Pike, Eunice (1956). « Tonally Differentiated Allomorphs in Soyaltepec Mazatec », IJAL 22(1), 57-71.
Pike, Kenneth (1944). « Analysis of a Mixteco Text », IJAL 10(4), 113-138.Pike, Kenneth (1948). Tone Languages. A Technique for Determining the Number and Types
of Pitch Contrasts in a Language, with Studies in Tonemic Substitution and Fusion, Ann Arbor, University of Michingan Press.
Pike Kenneth ([1950] 1957). Axioms and procedures for reconstructions in comparative linguistics – an experimental syllabus, Santa Ana, S.I.L.
Pike Kenneth (1954). Languages in Relation to a Unified Theory of the Structure of Human Behavior, Glendale, SIL.
Pike Kenneth (1964). « Linguistic Contribution to Composition: A Hypothesis », National Council of Teachers of English, International Conference on College Composition and Communication 15(2), 82-88.
Pike Kenneth (1970). Tagmemic and Matrix Linguistics Applied to Selected African Languages, Norman, University of Oklahoma, S.I.L.
Pike, Kenneth (ed. Bred, Ruth) 1972. Selected Writings, Paris ; The Hague, Mouton.Pike Kenneth (1975). Phonemics. A Technique for Reducing Languages to Writing, Ann
Arbor, The University of Michingan Press.Pike, Kenneth & Pike, Evelyn (1995). L’analyse grammaticale. Introduction à la tagmémique,
(trad. Française de Laurence Bouquiaux & Pierre Dauby), Louvain, Peeters. Pike, Kenneth L. & Pike, Eunice (1947). « Immediate constituents of Mazatec Syllables »,
IJAL 13, 78-91.Randal, Allison (2002). « Tagmemics. An Introduction to Linguistics for Perl Developers or
“Wouldn’t know a tagmeme if it bit me on the parse” ». [Power point en ligne] <http://blob.perl.org/tpc/2002/sessions/randal_tagmemics.pdf>.
Sériot, Patrick (1999). Structure et totalité, Paris, PUF.Townsend, William ([1952] 1976). Lázaro Cárdenas: demócrata mexicano. 4th ed.
Barcelona; Buenos Aires; Mexico, D.F., Editorial Grijalbo.Townsend, William (1965). « El papel de la lingüística en la obra indigenista », Caso, Alfonso
et al. (eds), Homenaje a Juan Comas en su 65 aniversario, vol. 1, México, Imprenta Nuevo Mundo, 173-176.
JeAn LéO LéOnARd
155
Histoire Épistémologie Langage 34/II (2012) p. 155-168 © SHESL
Bravo, Federico, Anagrammes ; sur une hypothèse de Ferdinand de
Saussure, Limoges, Lambert-Lucas, 2011, 280 p., ISBN 978-2-35935-036-4.
Cet ouvrage se présente comme un hommage à Ferdinand de Saussure. Célébrant les cent ans environ de ses recherches d’anagrammes, il paraît quarante ans après la publication des Mots sous les Mots, le livre de Jean Starobinski qui les fit connaître et que les éditions Lambert-Lucas ont eu l’heureuse idée de récemment rééditer. L’ambition d’Anagrammes est à la fois rétrospective et prospective : l’auteur se propose de revenir sur quarante ans de lectures de ces travaux à l’aune des connaissances actuelles et d’un dialogue pluridisciplinaire vivifié. L’ouvrage est divisé en quatre parties, de tailles presqu’égales, correspondant à autant d’approches destinées à mettre en évidence la productivité de l’hypothèse saussurienne. Au biais linguistique, succèdent les biais neuroscientifique, psychanalytique et sémiotique. Ces quatre approches, développées tour à tour, sont sous-tendues par une thèse qui assure la cohérence de l’ouvrage : selon l’auteur, l’hypothèse des anagrammes porterait en germe les linéaments d’une théorie de la lecture.
Le premier chapitre, intitulé « Le dispositif entre foi et loi », revient sur le parcours de recherche de Ferdinand de Saussure. À partir
des documents publiés par Jean Starobinski et par Francis Gandon, l’auteur aborde les principaux problèmes posés par la démarche du linguiste : validité de son hypothèse sur la métrique saturnienne à l’origine de la recherche, fiabilité de ses techniques de lecture anagrammatique, problème de la preuve de son postulat d’une tradition occulte. L’auteur montre tout d’abord que l’intuition saussurienne d’une diffusion phonique du nom à l’œuvre dans les poésies anciennes se vérifie dans différentes pièces poétiques espagnoles et françaises. Après un exposé de l’explication de la métrique des vers saturniens dont il conclut, après Françoise Desbordes, au caractère invérifiable, l’auteur s’intéresse à la technicité des décryptages pratiqués par Saussure. L’analyse détaillée de quelques pages extraites de cahiers sur Lucrèce le conduit à ramener les règles convoquées pour l’analyse anagrammatique à deux grands principes : un principe de « mouvance textuelle » (modification de l’agencement syntagmatique des éléments utiles à l’anagramme) et un principe de « saillance textuelle » (sélection des éléments utiles ou étrangers à l’anagramme). C’est dans l’articulation de ces deux principes et dans l’absence de critère discriminant pour le principe de saillance textuelle que l’auteur situe la propension de Saussure à trouver des anagrammes dans tous les textes qu’il examine. L’étude de la méthode
LECTURES & CRITIQUES
Comptes rendus
156 LeCTURes & CRiTiqUes
se poursuit par une analyse fine des stratégies argumentatives mises en œuvre dans les manuscrits d’anagrammes, toujours observées à partir de cahiers sur Lucrèce. Est alors bien mise en évidence la tension entre loi et foi au cœur de la recherche : tension entre « l’effort objectivant », perceptible dans l’inflation réglementaire qui préside aux décryptages anagrammatiques et la subjectivité de l’argumentation qui les accompagnent. La fin du chapitre est consacrée à une comparaison entre la démarche de Saussure et celle de Tzara au sujet de la poésie de François Villon. Si les deux quêtes anagrammatiques présentent autant de points communs, c’est qu’elles mettent en place, selon l’auteur, des dispositifs épistémologiques semblables alimentant à l’infini la démonstration de leur hypothèse.
Le deuxième chapitre, « Ferdinand de Saussure à l’épreuve des neurosciences », est sans doute la partie la plus novatrice de l’ouvrage. L’auteur se propose de croiser l’hypothèse des anagrammes avec les acquis actuels des neurosciences et des théories cognitives de la lecture. Les découvertes récentes de certains mécanismes neuronaux confirmeraient le modèle de lecture qu’implique la théorie des anagrammes. Ainsi le parcours des textes effectué dans les cahiers d’anagrammes, procédant par sauts, régressions et métathèses, rencontrerait ce que les recherches cognitives ont mis au jour au sujet du processus de lecture : son caractère non linéaire, quasi tabulaire. D’autres découvertes récentes entrent en résonnance avec certains fondements de la théorie des anagrammes. L’hypothèse dite du « neurone bigramme » formulée par Stanislas Dehaene, dans Les Neurones de la lecture (2007), c’est-à-dire l’hypothèse d’un traitement visuel du texte fondé sur la reconnaissance de jonctions binaires de lettres, fait écho au choix du « diphone » comme élément minimal de reconstitution de l’anagramme dans le système de Saussure. Quant aux expériences qui montrent qu’un texte dont les lettres sont mélangées reste lisible dès lors que les lettres initiales et finales de mots sont conservées, elles justifient l’importance accordée aux limites de mots dans la recherche saussurienne, à travers le concept de complexe-mannequin. L’auteur s’intéresse ensuite à la tension, non
résolue, entre lettre et son, vue et audition dans la recherche poétique de Saussure. Convoquant la réponse du linguiste au questionnaire d’Édouard Claparède sur la synesthésie (1893) ou un texte sur le stab (1907), il pointe la prégnance du modèle graphique dans la pensée phonologique de Saussure.
Le troisième chapitre, dont le titre « Là où Saussure attend Freud » emprunte à Lacan, est centré sur le problème le plus débattu de la réception des anagrammes : l’inconscient dans le langage. Il invite sur cette question à un dialogue entre linguistique et psychanalyse. L’auteur souligne l’analogie entre l’anagramme saussurien et diverses manifestations incontestées de l’inconscient dans le langage. Avec les phénomènes de Tip of Tongue, c’est la même problématique de l’accès au lexique qui se trouve posée. Les mécanismes à l’œuvre dans la remémoration du mot manquant et dans la mise au jour du mot-thème accordent une importance similaire aux frontières de mots. Les syllabes initiales et finales de mots jouent, dans les deux cas, le rôle d’amorce. Avec les lapsus, entendus au sens large – c’est-à-dire incluant les phénomènes d’étymologie populaire et les mots valises –, l’anagramme partage l’usage de la métathèse et l’affranchissement de la linéarité. L’auteur met en évidence les points communs des approches saussuriennes et freudiennes : intérêt pour le nom propre, appréhension discontinue de la matière phonique, importance du niveau syllabique dans leurs analyses respectives. La lecture pratiquée par Saussure dans les cahiers d’anagrammes lui semble en cela comparable à l’écoute de l’analyste. Cette « lecture flottante », non linéaire et attentive aux sonorités, s’opère aussi selon un point de vue commun privilégié : le signifiant onomastique. Car, comme l’écrit l’auteur, « lire n’est autre chose que d’élire un point de vue : ici un nom propre » (p. 201). Le chapitre s’achève sur des considérations relatives au mode d’écriture du linguiste genevois. Cette écriture fragmentaire, criblée de blancs, est mise en relation avec son constat des insuffisances du métalangage. À la suite d’exégètes d’orientation psychanalytique – Claudia Mejía Quijano, Izabel Vilela, Olivier Flournoy –, la recherche des anagrammes est interprétée comme un moyen d’échapper à l’indicible sur la langue.
157LeCTURes & CRiTiqUes
Le dernier chapitre, « Pour une sémiologie des figures sonores », part de la formule de Jean-Claude Milner, selon laquelle les anagrammes de Saussure « touchent à un réel : celui de l’homophonie ». L’approche des anagrammes serait, de ce point de vue, à inclure dans l’étude des figures sonores, aux cotés de l’allitération ou de la paronomase. L’auteur cherche alors à montrer que de telles itérations phoniques se rencontrent dans toutes les productions langagières, des littéraires aux plus courantes, et qu’elles ne peuvent par conséquent fonder, comme le veut Roman Jakobson, la distinction entre un discours ordinaire et un discours poétique. À cette occasion, les anagrammes sont mises en relations avec d’autres figures sonores, dont certaines – les étymologies d’Isidore de Séville ou des gloses de Michel Leiris – participent pourtant d’une tradition herméneutique distincte. La lecture cratyléenne des anagrammes ainsi développée ne nous paraît pas fondée car le phénomène tel que le décrit Saussure ne suppose, il faut le rappeler, aucune motivation. Est ensuite abordé le problème, soulevé par l’hypothèse saussurienne, de l’intentionnalité auctoriale. L’auteur observe des points de convergence entre les anagrammes et les phénomènes subliminaux : ils font s’interpénétrer conscience et inconscient, activité du producteur et activité du récepteur dans l’élaboration du message. Ces points de convergence lui semblent dessiner des voies de dépassement, dans la lignée des analyses de Julia Kristeva, de l’aporie de l’intentionnalité rencontrée par Saussure. Enfin, l’auteur s’intéresse aux implications de l’automatisme du phénomène anagrammatique défini, dans un des manuscrits, comme une « sociation psychologique ». Il souligne, avec raison, l’intérêt de l’idée développée par Saussure selon laquelle certains lexèmes, dans les discours, en draineraient d’autres phonétiquement similaires (chez les Latins, Xerxes appellerait exercitus, Lysimachus, magnus…). Creusant cette hypothèse des collocations lexicales, l’auteur se demande « s’il n’y a pas toujours, à des degrés divers mais cependant toujours, “du” paradigmatique dans du syntagmatique, ces deux incompossibles que la linguistique générale met au nombre des dichotomies fondamentales » (p. 249). D’une façon paradoxale, il rejoint ainsi la projection du
principe d’équivalence de l’axe de la sélection sur l’axe de la combinaison propre à la fonction poétique jakobsonienne qu’il a précédemment rejetée. Dans sa conclusion, l’auteur écrit que si la recherche saussurienne pose plus de questions qu’elle n’apporte de réponse, « ce doute généralisé, que Saussure institue quasiment en méthode, prend à [ses] yeux l’allure d’une conquête intellectuelle » (p. 260).
En définitive, Anagrammes offre un parcours de lecture clair et stimulant. L’ouvrage, certes, n’ajoute rien à ce qui était déjà connu quant à la documentation des anagrammes ou à la démarche du savant. Il contient même quelques approximations dans l’exposé de la pensée saussurienne et de ses données factuelles ; la plus récurrente est la datation de la recherche sur quatre ans, au lieu des trois (1906-1909) avérés. En revanche, les principaux débats suscités, depuis une quarantaine d’années, par la question des anagrammes sont brillamment abordés à la lumière des recherches contemporaines en neuroscience, sémiotique et psychanalyse. C’est en se plaçant du point de vue, non plus de la production du texte, comme Julia Kristeva ou Michael Riffaterre, mais de sa réception, que l’auteur renouvelle l’approche des anagrammes. L’hypothèse de Saussure, participant ici à une définition de la littérarité comme « production du texte et […] production de l’écoute » (p. 230), démontre, après plus d’un siècle, sa puissance suggestive.
Pierre-Yves TesTenOiReUniversité de la Sorbonne Nouvelle – Paris 3/
UMR 7597 HTL
158
Esparza Torres, Miguel Angel & Hans-J. Niederehe, Bibliografía
cronológica de la lingüística, la gramática y la lexicografía del español (BICRES IV) Amsterdam, John Benjamins, 2012, coll.: Studies in the History of the Language Sciences, 118, v, 696 p., ISBN 978 90 272 7486 1.
La parution du quatrième volume de BICRES dans la série Studies in the History of the Language Sciences représente l’accomplissement d’un projet qui a commencé à prendre forme il y a une vingtaine d’années : offrir un répertoire critique des ouvrages de linguistique de la tradition hispanique. Celle-ci étant entendue comme l’ensemble des textes qui prennent l’espagnol, soit comme langue objet, soit comme métalangue.
La tâche a été réalisée en quatre étapes formant autant de volumes de l’œuvre. Dans les trois premiers volumes, Hans-Josef Niederehe fait l’inventaire de l’activité grammaticographique hispanisante jusqu’en 1800. Le premier1, paru en 1994, réunit la production métalinguistique antérieure à 1600. Le deuxième, publié en 1999, englobe la production du XVIIe siècle2. Le troisième3, qui voit le jour en 2005, en fait autant pour le XVIIIe siècle. Et, enfin, le quatrième volume, signé par Miguel Ángel Esparza Torres et Hans-Josef Niederehe lui-même, en collaboration avec quatre autres chercheurs4, couvre les soixante premières années du XIXe siècle (de 1801 à 1860).
1 Hans-Josef Niederehe (1994). Bibliografía cronológica de la lingüística, la gramática y la lexicografía del español. Desde los principios hasta el año 1600, Amsterdam; Philadelphia, John Benjamins Publishing Company.
2 Hans-Josef Niederehe (1999). Bibliografía cronológica de la lingüística, la gramática y la lexicografía del español. Desde el año 1601 hasta el año 1700, Amsterdam; Philadelphia, John Benjamins Publishing Company. Vid. le compte-rendu de Francis Tollis dans Histoire Épistémologie Langage, 23/II, 2001, p. 177-178.
3 Hans-Josef Niederehe (2005). Bibliografía cronológica de la lingüística, la gramática y la lexicografía del español. Desde el año 1701 hasta el año 1800, Amsterdam; Philadelphia, John Benjamins Publishing Company. Vid. le compte-rendu de Brigitte Lépinette dans Histoire Épistémologie Langage, 28/I, 2006, p. 174-177.
4 Adrián Álvarez Fernández, Elena Battaner Moro, Vicente Calvo Fernández, Lamia Haouet, Susana Rodríguez Barcia.
La livraison du dernier volume de ce travail bibliographique est cruciale du point de vue programmatique dans la mesure où BICRES, dès sa première édition, se donnait explicitement pour mission de compléter l’entreprise historiographique du Comte de la Viñaza5, ouvrage vieux de plus d’un siècle mais outil cependant toujours précieux pour les chercheurs en histoire de la langue espagnole et en histoire des idées linguistiques dans le domaine hispanique.
Avec le quatrième volume, la tranche chronologique couverte égale pratiquement celle de la Biblioteca de l’érudit espagnol du XIXe siècle. Toutefois, le nouveau répertoire du BICRES est beaucoup plus qu’un simple développement de cet ouvrage. En effet, en ce qui concerne son propre siècle, La Viñaza, comme il le signale d’ailleurs en introduction (1893, VIII), n’accorde pas une place très importante dans son texte à l’activité métalinguistique de l’époque, en raison de l’objectif historiographique poursuivi : « Quizá podremos ser tachados de prolijos en detalles bibliográficos ; pero creemos será perdonada nuestra falta, si tal es, en razón de la ya indicada rareza de los más de los libros que se registran en este estudio. En cambio sólo apuntaremos los títulos de los trabajos impresos en el presente siglo, ó de los que por ser epítomes, compendios ó resúmenes más ó menos felices de otras obras importantes, ó por razón de sus escaso valor histórico ó científico, no exigen ser extractados ni analizados »6. Or, c’est l’abondance de ces épitomés, résumés et compendiums qui donne une coloration particulière à la grammaticographie de l’époque. Sans doute, la lecture de l’introduction de la Biblioteca de La Viñaza fait ressortir la spécificité d’un
5 Cipriano Muñoz y Manzano, Conde de la Viñaza (1893). Biblioteca histórica de la filología castellana, Madrid, Imprenta y Fundición de Manuel Tello.
6 « On pourra peut-être nous reprocher la prolixité des détails bibliographiques ; mais nous pensons que notre faute – si elle en est une – sera pardonnée, en raison de la rareté, déjà signalée, des livres qui ont été enregistrés dans cette étude. Par contre, nous ne ferons que noter les titres des travaux imprimés en ce siècle ; il en va de même pour tous ceux qui, en leur qualité d’épitomés, de compendiums ou de résumés plus ou moins heureux d’autres œuvres importantes, ou en raison de leur maigre valeur historique ou scientifique, n’exigent pas d’être relevés ni analysés. » Nous traduisons.
LeCTURes & CRiTiqUes
159LeCTURes & CRiTiqUes
siècle que les auteurs de BICRES IV, Esparza et Niederehe, présentent sous forme de fiches bibliographiques. Chez La Viñaza, on est plus proche d’un discours qui exalte l’histoire de l’espagnol et qui motive dans son passé glorieux la recherche érudite des sources grammaticales, lexicographiques et des discours variés sur la langue – les trois domaines qui constituent les parties de sa Biblioteca.
De nos jours, le problème des sources et des travaux critiques se pose de façon très différente : il ne s’agit pas uniquement de présenter leur localisation et leur découverte, mais de conférer également de la maniabilité et de la représentativité aux grands répertoires. En ce sens, l’histoire de la linguistique espagnole s’est donnée un instrument de recherche très appréciable avec cette bibliographie, puisqu’elle fait le point des différents catalogues des bibliothèques, des libraires et d’autres bases des données bibliographiques.
En ce qui concerne le critère de sélection retenu, BICRES englobe les ouvrages qui traitent un quelconque aspect de description de l’espagnol mais aussi la production grammaticographique d’autres langues en espagnol, deux critères sans doute complémentaires. Ce n’est, en outre, pas un cas isolé : cette vaste bibliographie s’apparente par là à d’autres outils mis à disposition de l’historien. Citons par exemple Historiografia gramatical de Simão Cardoso7, projet semblable dans le monde lusophone. De moindre envergure, ce dernier a cependant l’avantage de présenter un classement fondé sur les langues envisagées. Il est vrai que ce choix n’est pas toujours pertinent pour le chercheur en histoire des idées grammaticales car les frontières entre les différents objets linguistiques ne sont pas homogènes : la description de la métalangue peut avoir un poids important dans tel ou tel ouvrage et les idées d’une époque ne se cantonnent pas dans une tradition descriptive (i.e. une langue objet).
Quant à la méthode bibliographique suivie, BICRES IV maintient le même
7 Simão Cardoso (1994). Historiografia gramatical (1500-1920), Língua Portuguesa – Autores Portugueses, (Anexo VII da Revista de Faculdade de Letras, “Línguas e Literaturas”), Porto, Faculdade de Letras do Porto, 324 p.
protocole de travail et de présentation que les éditions précédentes, ce qui procure continuité et homogénéité dans le traitement. Ainsi, le quatrième volume présente la même structure interne à laquelle Hans-Josef Niederehe nous a accoutumés : deux regroupements bibliographiques et quatre index.
Le gros du travail est constitué par les informations bibliographiques concernant les sources (« BiBLiOgRAfíA i. La lingüística española desde 1801 hasta 1860 ») présentées par ordre chronologique. Cet ensemble a augmenté considérablement par rapport aux autres volumes (on compte 985 références en BICRES I, 1275 en II, 1550 en III, 3279 dans le quatrième volume). Face à un corpus aussi étendu, comme les auteurs eux-mêmes le déclarent dans les notes d’introduction, un travail collectif s’imposait. En effet, la tâche de vérification des références représente un travail ardu. La présentation strictement chronologique amplifie l’impression d’une production « touffue » propre à la période.
Comme nous l’avons déjà suggéré, quand bien même le classement thématique pourrait être utile pour certaines recherches bibliographiques, il serait irrémédiablement réducteur dans la mesure où la diversification thématique, l’apparition de sous-domaines linguistiques nouveaux et les ouvrages hybrides gagnent à être perçus sans cloisonnements arbitraires.
La deuxième partie du répertoire est tout aussi essentielle (« BiBLiOgRAfíA ii. Fuentes bibliográficas consultadas y estudios »). Elle est constituée des références secondaires traitant différents aspects de la linguistique du XIXe siècle. Il s’agit principalement d’études générales sur l’époque ainsi que de quelques travaux sur les auteurs les plus représentatifs. En ce qui concerne la littérature secondaire, BICRES trouve un complément fondamental dans la Bibliografía temática de historiografía lingüística española (BiTe)8, dans laquelle Esparza Torres a de même travaillé.
Quatre index font suite à ces deux recueils bibliographiques. Le premier index (« Índice
8 Miguel Ángel Esparza Torres, Elena Battaner Moro, Vicente Calvo, Adrián Álvarez Fernández, Susana Rodríguez Barcia (2008). Bibliografía temática de historiografía lingüística española, 2 vol., Hamburg, Helmut Buske Verlag, 1 069 p.
160 LeCTURes & CRiTiqUes
de títulos abreviados ») fournit la liste de tous les titres de la BiBLiOgRAfíA i par ordre alphabétique. Il s’agit de références abrégées, contenant les noms des auteurs et les dates des éditions. La lecture et le classement de ces titres procurent en soi un matériau illustratif de la diversité générique de l’époque : nombreuses sont les étiquettes représentées par plus d’un ouvrage : arte, cartilla, compendio, curso, cuadernillo, diccionario, elementos, gramática, lecciones, manual, método, observaciones, prontuario, rudimentos, suma, tesoro, tratado, vocabulario). Ainsi apprend-on que la spécialisation de cartilla comme terme générique pour premier livre des lectures est encore naissante. Les noms des ouvrages sont également le lieu où de nouveaux formats se laissent saisir. C’est le cas du livre de poche, formule que l’on retrouve uniquement pour le dictionnaire, qui est de bolsillo ou portátil9 – l’on découvre également des désignations délicieusement surannées (le diccionario de faltriquera10, avec trois références). Parfois, les titres nous renseignent tout autant sur le renouveau pédagogique que sur le pari des maisons d’édition (par exemple, la méthode d’apprentissage d’Ollendorff11 qui arrive en Espagne, au vu des références inventoriées, dans les années 1850). Le succès de certains ouvrages se lit même dans l’antonomase affichée par quelques titres, les cas les plus spectaculaires étant le Chantreau et le Nouveau Sobrino, devenus synonymes de « grammaire française ».
Il est beaucoup plus difficile de repérer un objet de prédilection ou une thématique privilégiée pour l’époque. On pense à d’autres
9 « de poche », « portatif ».10 Faltriquera est un synonyme désuet de bolsillo
(« poche », « petit sac »). 11 Heinrich Gottfried Ollendorff (1803-1865),
grammairien et pédagogue allemand, met à point la méthode d’apprentissage des langues pour adultes connue comme Méthode Ollendorff, l’une des plus célèbres au XIXe siècle. Son premier manuel a été crée pour l’enseignement de l’allemand (Nouvelle méthode pour apprendre à lire, à écrire et à parler une langue en 6 mois, appliqué à l’allemand, Paris, chez l’auteur, 1835), très vite adapté à d’autres langues dans des éditions autorisées par Ollendorff lui-même. En Espagne, Eduardo Benot l’adapte à l’enseignement du français (1851), de l’anglais (1851), de l’italien (1852), de l’allemand (1853). Il existe également des méthodes d’espagnol suivant ses principes publiées dans d’autres langues européennes.
répertoires tels que Les Grammaires françaises12, d’André Chervel, qui fournit un ensemble de titres dans lesquels on peut compter plus d’une centaine de références traitant le participe (i.e. un problème d’orthographe). Certes, les critères de sélection d’Esparza et de Niederehe sont plus larges que ceux employés par Chervel à l’époque de son recensement : visant un public francophone, les œuvres du répertoire chronologique des grammaires françaises sont à même de nous livrer aisément une image de la grammaire scolaire française et de l’un de ses fétiches. Pourtant, on ne peut qu’émettre des considérations plus générales pour l’Espagne : il y a dans BICRES une représentation très importante (quantitativement) de la grammaire scolaire castillane – on n’est pas si éloigné des intérêts de la grammaire française – mais aussi des œuvres pour l’apprentissage du latin et surtout du français.
Le troisième index (« Índice de editoriales y lugares de publicación ») contient la liste des maisons d’éditions et les lieux de publication. Le quatrième index (« Índice de lugares de publicación y editoriales ») offre ces mêmes informations en inversant les entrées : lieux de publication et maisons d’éditions. Autant d’outils incontournables pour quiconque veut étudier l’histoire de la linguistique espagnole du point de vue éditorial.
Enfin, l’index des auteurs (« Índice de autores ») offre le complément indispensable aux références bibliographiques chronologiques, qui ne permettent pas de parcourir la production de chaque linguiste dans sa linéarité. Quelques noms connaissent un nombre remarquable d’éditions ; par exemple, les grandes figures linguistiques telles que les grammairiens Bello et Salvá. Le succès éditorial appartient aussi aux ouvrages à finalité pédagogique (les Chantreau, que nous avons déjà cités, traversent toute la période bien au-delà de la disparition du grammairien Pierre-Nicolas Chantreau (1808) ; certaines années en connaissant jusqu’à trois impressions).
12 André Chervel (2000). Les Grammaires françaises : 1800-1914, répertoire chronologique, 2e édition revue et augmentée, Paris, Institut National de Recherche Pédagogique. On dispose de la base des données numérisée grâce à la mise en ligne réalisée par Jacques-Philippe Saint-Gérand et Russon Wooldridge : http://projects.chass.utoronto.ca/langueXIX/chervel
161
Sans doute, ce volume ainsi que les trois autres qui l’on précédé constituent de par la nature du projet un événement marquant dans l’étude historique de la linguistique espagnole. La série répond largement aux besoins bibliographiques des historiens : fiabilité, maniabilité et exhaustivité sont de mise. Ces quatre recueils donnent une image juste d’une discipline qui connaît dans le domaine espagnol un intérêt croissant et cumule déjà d’importants travaux dans le même champ. Il faut noter que cette grande entreprise aboutie par le BICRES s’insère dans un mouvement plus vaste que connaît l’historiographie linguistique hispanique. En effet, la consolidation des études historiques se reflète dans l’élaboration d’outils sûrs, généralistes, d’élaboration collective. Ainsi ne peut-on pas oublier un autre projet historiographique qui montre également la vitalité de ce mouvement : la série tripartite dirigée par José J. Gómez Asencio El castellano y su codificación gramatical13, qui couvre jusqu’à présent l’histoire de la linguistique espagnole dès ses premiers pas jusqu’en 1835, c’est-à-dire qu’elle s’arrête vingt-cinq ans plus tôt que BICRES. On peut ajouter à cette série, la Bibliografía temática (BiTe) parue en 2008, que nous avons déjà mentionnée14. Ce sont des travaux complémentaires pour les chercheurs.
La réalisation du travail par tranches chronologiques imposait la publication en volumes séparés, ce qui n’empêche pas de considérer la série comme un instrument complexe de 2 099 pages. Face à ce vaste ensemble de références, l’accès à une version informatisée qui permettrait la mise à jour de la bibliographie quand cela s’avérerait nécessaire, notamment pour la bibliographie secondaire, serait un projet certainement très utile. En ce sens, les auteurs de cette Bibliografía cronológica expriment le souhait de pouvoir un jour mettre à disposition des chercheurs leur base de données (BICRES IV : 7)15. Nous ne pouvons qu’adhérer à ce dessein profitable. Cependant, cette aspiration future
13 José J. Gómez Asencio (2006-2011). El castellano y su codificación gramatical, 3 vol., Burgos, Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.
14 Vid. Note 8.15 Les notices bibliographiques contiennent un numéro
d’identification renvoyant à cette base de données.
LeCTURes & CRiTiqUes
ne devrait affaiblir en rien la satisfaction et l’enthousiasme avec lesquels la communauté des chercheurs en linguistique espagnole accueillera ce dernier tome qui voit le jour.
Alejandro diAz viLLALBAUniversité Paris 3-Sorbonne Nouvelle
Evans, Nicholas, Ces mots qui meurent. Les langues menacées et ce qu’elles ont à nous dire, publié par Wiley-Blackwell,
en 2010 : Dying Words. Endangered Languages and what They Have to Tell Us. Traduction française par Marc Saint-Upery, Paris, Éditions de la Découverte, 390 p., 2012, ISBN 978-2-7071-6884-9.
Nicholas Evans est un linguiste australien qui s’est fait une spécialité d’enquêter chez les aborigènes du nord de l’Australie. Il évoque ses entretiens avec des enquêtés survivants comme Pat Gabori, un des derniers parleurs du Kayardild. Travail exécuté soigneusement, car Evans est un excellent linguiste, mais dans l’urgence : tous les quinze jours une langue disparaît, riche pourtant de l’expérience d’un groupe social et trésor pour l’enquêteur. Chaque langue est dotée d’une morphologie et de phonèmes spécifiques, d’un jeu d’intonations et de gestualité qui nous éclaire sur le fonctionnement social du groupe. Et réclame donc un inventaire complet.
À l’inverse des temps modernes, la multiplicité est tenue ici pour une valeur parce qu’elle définit « l’appartenance de chacun ». La langue est un passeport qui identifie le parleur. Elle est comme un droit de propriété. Beaucoup des indigènes sont polyglottes par nécessité première, puisqu’ils sont obligés de se marier en dehors du clan. Par ailleurs, le désir d’unification est un phénomène récent. La Nouvelle-Guinée compte encore 1 150 langues pour 10 000 locuteurs, Vanuatu 105 pour 200 000 habitants. À la veille du Néolithique, on devait compter au moins de 3 000 à 5 000 langues pour dix millions d’habitants. Il faudra attendre des sociétés centralisées pour que ce nombre diminue. Phénomène qui se répand même dans la Papouasie-Nouvelle Guinée grâce à un créole
162 LeCTURes & CRiTiqUes
très répandu, le tok pisin ; ou à Vanuatu, avec le créole bislama.
Cette diversité obligée marque l’adaptation de petites langues à des écologies locales et suppose donc un réseau structuré, lieu d’incessantes métamorphoses. Ce réseau « repose sur une interaction intense entre notre matériel, à savoir nos gênes et notre physiologie et notre logiciel, à savoir notre langue et notre culture ». Plus le système agricole est complexe, plus on compte de langues. En outre, la scission entre les clans produit des variables linguistiques supplémentaires. Interviennent enfin des modifications « saugrenues » par souci de distinction. Bref, l’autarcie est triomphante et réservoir d’adaptabilité.
Phénomène universel qu’on repère aussi bien en Italie que dans le Pacifique. Dans l’Italie préromaine circulent de douze à quinze langues appartenant à dix branches de quatre familles : langues celtiques, italiques, helléniques, de type indo-européen et étrusque ; le latin ne s’impose que lentement pendant que s’éteignent osque, ombrien et étrusque. L’Afrique offre un tableau identique. Aujourd’hui, à l’inverse, une douzaine de langues ont plus de cent millions de locuteurs, européennes ou austronésiennes, qu’écrase le rouleau compresseur anglais.
Et de nombreux états intermédiaires : « 4000 ans d’apprentissage », dit Evans. D’abord l’invention des écritures, à partir de symboles pictographiques, suivie à distance par les premières grammaires : Apollonius Dyscole ou Panini. Puis les rencontres de langues pour raisons religieuses ou commerciales et les traductions, en Espagne, par exemple : la Bible est confrontée à l’arabe des envahisseurs et à l’hébreu, aussi au grec. Modèle pour les missionnaires qui vont débarquer en Amérique et sont confrontés à la multiplicité des langues locales : maya, nahuatl, etc. Une imprimerie fondée à Mexico en 1534 produit 21 grammaires des langues indigènes ; véhiculant un matériel conceptuel nouveau : causatifs, applicatifs, incorporation nominale, etc. Savoir diffusé par un franciscain, le Frère Bernardino de Sahagun de qui l’Histoire générale des choses de la nouvelle Espagne est interdite par l’Inquisition. Suivront des compilations comme le célèbre Mithridate ou les enquêtes
diligentées par l’impératrice Catherine de Russie. Jusqu’à Boas et Whorf.
Une Partie 2 décrit ce grand « Festin des Langues ». La description de la multiplicité des langues, de leur spécificité conduit à une critique des simplifications du chomskysme. Chaque langue n’utilise qu’une partie, étrange parfois, des 1 500 phonèmes possibles ; dont témoignent les dizaines de langues caucasiennes. En exemple l’oubykh, incroyablement compliquée, qui présente, par exemple, des dentales à la fois voisées et pharyngalisées ou des accumulations de consonnes. En Amérique, le navajo est si complexe qu’il a pu servi de code secret pendant la guerre contre le Japon. Des carcans conduisant à la conclusion : « Les langues ne diffèrent pas tant en vertu de ce qu’on peut y dire qu’en fonction de ce qu’on doit y dire ». Analyses conduisant à une carte socio-cognitive centrée sur « l’acte de parole ». Souvent, dit Evans, « nous signifions plus que nous ne saurions dire ». Et tourne ainsi autour de l’« implicature » de Grice.
La partie 3 remonte dans le temps et aborde avec prudence le problème des filiations et influences. Les rapprochements sont pourtant instructifs : ainsi quand on voit que l’eyak confirme le lien entre les langues sibériennes (ienisseiennes) et les langues indiennes comme les langues na-dene. Permettant d’établir des hypothèses sur les migrations d’Ouest en Est via le détroit de Behring. Cas privilégié. L’expansion certaine des langues bantoues (swahili, zoulou, etc.) est plus difficile à suivre sinon à l’état de traces dans la dénomination des plantes cultivées, ce qui exige de l’enquêteur des compétences particulières. Plus spectaculaires les recherches dans la famille austronésienne, bien connue de l’auteur. On peut suivre les trajets de diffusion depuis le continent asiatique jusqu’à Taiwan. Puis une grande expansion, il y a 4 000 ans, vers les Philippines marquée par la création de près de 200 langues. Une branche s’établit vers Bornéo, l’Afrique de l’Est, puis Madagascar, confirmée par des preuves génétiques, sans doute au huitième siècle ; une autre branche se dirige à travers les Moluques vers la Nouvelle-Guinée qu’on peut suivre par les marqueurs génétiques des rats et souris qui accompagnaient ces aventuriers. Atteinte des îles Fidji vers l’an 1000. Une
163LeCTURes & CRiTiqUes
grande aventure, des familles entières jetées en avant par l’invention du catamaran explorant cet immense Océan et touchant Samoa, Tonga, Hawai, etc. avec armes et bagages, aujourd’hui identifiables. Renonçant aux simplifications du célèbre Greenberg, Adams souligne plutôt l’incroyable diversité de ces aventuriers qui se retrouvera dans la diversification américaine. Doublée d’une multiplicité de langues et de modes d’expression : ainsi l’identification des lieux et des trajets varie selon les groupes.
Reste, pour s’orienter, à déchiffrer ces langues souvent opaques. Quelles clés ? En premier, retrouver des inscriptions, phénomène parfois tardif, comme ces manuscrits en langue tibéto-birmane découverts en 1908. Puis, pour les déchiffrer, percer le mystère d’écritures oubliées. Souvent on commence par les noms propres. Ou on utilise des langues parallèles déjà connues, comme fit Champollion en recourant au copte pour déchiffrer les hiéroglyphes. Ou on privilégie la numération, comme on fit pour les calendriers mayas. Ou, tout simplement, par confrontation, on se sert des langues modernes. Certaines zones sont de véritables Babels aux langues enchevêtrées, comme les langues caucasiennes, paradis des phonologues, dotées des plus étranges variations. Donnant une idée des temps primitifs comme le fait la mosaïque des langues de l’isthme méso-américain.
Toutes survivances qui donnent une idée de l’extrême plasticité de l’expérience humaine. Chaque nouvelle génération met en cause l’héritage et l’adapte aux temps nouveaux selon une harmonie établie entre innovation culturelle et évolution génétique, entre langue quotidienne et langages sacrés, entre discours d’action et langues poétiques. « Le processus d’apprentissage linguistique est parallèle à la construction d’un univers de pensée scientifique et de la trame omniprésente de pratiques culturelles intégrées qui l’accompagne » (p. 274).
Evans insiste sur les arts de mémoire qui expliquent comment ces langues se perpétuent, même dans des sociétés sans écriture, grâce à la mémoire stupéfiante des bardes. Il peut parler d’« Homères papous » qui exploitent des milliers de vers sans la moindre note ; parler aussi des capacités de contraction de certains langages, p. ex. dans l’île de Mornington :
« Par une combinaison de raisonnements sémantiques hautement abstraits, de longues chaînes de tropes, de paraphrases et de signes virtuels auxiliaires, des milliers d’unités lexicales du lardil ordinaire sont réduites à un volume de deux cents mots en damin. » (p. 302).
Ces multiples combinaisons fascinent l’auteur parce qu’elles perpétuent des modes de civilisation et nous instruisent sur l’histoire de l’humanité. Il aime les connaître et les pratiquer, si bizarres soient-elles. Il use même du français, avec facilité, comme le montre l’entretien qu’il a accordé à Antoine Perraud sur France-Culture. Avec un grand bonheur d’expression.
Jean-Claude CHevALieRUMR7597 HTL, Université Paris-Diderot
Lazard, Gilbert, Études de linguistique générale II. La
linguistique pure, Louvain, Peeters, 2012, coll. : Linguistique de la Société de linguistique de Paris, 98, xvi, 325 p., ISBN 978-90-429-2638-7.
Nous avions rendu compte ici même, en 2009, du volume de G. Lazard intitulé La quête des invariants interlangues. La linguistique est-elle une science ? (Champion, 2006, 338 p.), qui constituait une réflexion cohérente sur les grands principes de l’analyse linguistique, dans la lignée de Saussure et de Benveniste. La recherche des « invariants » conduisait à des structures fondamentales susceptibles d’être utilisées en typologie, domaine privilégié par G.L.
Ce nouveau livre a des caractéristiques tout autres. Il s’agit de dix articles publiés récemment, plusieurs d’entre eux dans le BSL, dont les deux les plus polémiques : Pour une linguistique pure (2009) et La linguistique cognitive n’existe pas (2011). Un « Devoirs de vacance », inédit (p. 189-246), passe en revue une vingtaine de thèmes centraux de l’analyse syntaxique et permet à l’auteur d’actualiser ses points de vue.
Irrité de voir publiés de nombreux travaux sur des particularités des discours sans que la connaissance de la langue s’en trouve enrichie,
164
G.L. veut se concentrer sur celle-ci, dans sa définition saussurienne la plus stricte. Voici ce point de départ largement explicité (p. 248) :
Les phénomènes langagiers forment un ensemble très complexe. Ils intéressent à la fois le fonctionnement psychique, l’activité cérébrale et neurale, la vie sociale, les mouvements de l’histoire, etc. Cet ensemble est trop complexe pour se prêter tel quel à un traitement scientifique. On en extrait (abstrait) un objet, dit langue, consistant en un système synchronique, posé par abstraction comme identique chez tous les locuteurs en un moment donné. C’est un système fermé, considéré en lui-même, indépendamment de toutes les déterminations auxquelles il peut être ou avoir été soumis et des conditions dans lesquelles il est mis en œuvre dans le discours. Le linguiste, en tant que spécialiste de la langue, celui que j’appelle le « linguiste pur », n’a pas à s’intéresser aux conditions psychiques, sociales, etc., de l’exercice du langage.
G.L. fait allusion à « la vieille idée selon laquelle le langage est l’instrument d’expression de la pensée » (p. 259) et ne reconnaît celle-ci qu’à travers des formes : « les études qui se disent de sémantique s’appliquent non à des pensées en elles-mêmes, mais à des signifiés, c’est-à-dire des pensées modelées par des formes » (p. 193). Il est dit également que le signe a une face phonique et une autre tournée « vers la représentation du monde » (p. 248). On retrouve cette expression lors de la caractérisation des cadres conceptuels intuitifs (CCI) dont le contenu « peut être emprunté à la représentation du monde » (p. 35) et servir de repère pour une démarche onomasiologique (la plus délicate mais la plus intéressante selon nous) comme celle conduisant à l’action prototypique.
G.L. est méfiant vis-à-vis des universaux : « il n’y a pas de catégories interlangues. Cette vérité s’applique en particulier aux catégories grammaticales traditionnelles, comme nom, verbe, adjectif, sujet, objet, etc.» (p. 249). La sémantique grammaticale offre cependant, selon nous, de nombreux domaines qui semblent inévitables dans les langues comme le temps, l’espace, la personne, la quantification, la modalisation..., même si les moyens de les exprimer peut grandement varier.
L’auteur présente de longs développements critiques sur des écrits de linguistes américains, formalistes ou fonctionnalistes, et c’est pour lui l’occasion de conforter ses points de vue. Il en résulte pour le lecteur un sentiment de
redites dû à la juxtaposition de travaux de ces dix dernières années.
On ne peut qu’admirer la vaste réflexion théorique de G.L. relative aux différents courants de la linguistique contemporaine. Mais il reste une objection centrale : existe-t-il au monde quelqu’un susceptible de parler « purement » ? Comment expliquer l’évolution constante des langues sans se référer à tous les facteurs de l’environnement ? Problème complexe, certes, mais que le linguiste ne peut repousser en se limitant à ce qui pour un médecin serait le squelette. La chair fait l’homme comme le psycho-social façonne la langue. Il est certes de bonne méthode de tenter de dégager un noyau central, dur (plus que pur), et d’esquisser des modèles de fonctionnement, abstraits des expériences de l’analyse des langues, et susceptibles de servir de référence pour une démarche onomasiologique. Mais c’est bien celle-ci qui est essentielle pour expliciter les mécanismes rendant compte de micro-systèmes, comme les parcours déictiques du centre (moi-ici-maintenant-ainsi...) à la périphérie, l’échelle diathétique (d’où les sous-systèmes de cas et de voix), la chronologie des événements (interne et externe, aspect et temps), les degrés de participation subjective des interlocuteurs (les modes et prises en charge de l’énonciation). En fait, nous pensons que les conceptualisations qui sous-tendent ces mécanismes sont en nombre réduit et à vocation universelle.
Livre polémique, passionné, d’un auteur qui aime écrire pour convaincre.
Bernard POTTieRUniversité Paris-Sorbonne
Soulez, Antonia (sld.), Manifeste du Cercle de Vienne et autres écrits.
Carnap, Hahn, Neurath, Schlick, Waissman sur Wittgenstein, traduction de l'allemand par Barbara Cassin, Christiane Chauviré, Anne Guitard, Jan Sebestik, Antonia Soulez, Ludovic Soutif et John Vickers, Paris, Vrin, 2010, 352 p., ISBN 978-2-7116-2271-9.
Bien que cette nouvelle édition affiche très clairement un lien de continuité avec la
LeCTURes & CRiTiqUes
165
première parution de cet ouvrage au PUF en 1985, puisque l’ancienne pagination y est même indiquée dans les marges, deux modifications importantes méritent cependant d’être relevées.
Tout d’abord – et ce point est perceptible dans le choix d’inscrire sur la couverture « Waismann sur Wittgenstein », et non plus « Waismann – Wittgenstein » – le chapitre anciennement consacré aux notes que le mathématicien Friedrich Waismann prit en 1929 lors des séances où Ludwig Wittgenstein accepta de se rendre chez Moritz Schlick pour commenter certains passages du Tractatus Logico-Philosophicus (1922), a été remplacé par un autre article de Waismann peu connu et qui correspond au fragment d’une conférence de 1930 explicitant la conception wittgensteinienne des mathématiques. Si la cause de ce changement est due à la parution en 1991 des notes de Waismann dans la passionnante collection que les éditions T.E.R. (Trans-Europ-Repress) consacrent à Wittgenstein (une vingtaine d’ouvrages en français sont ainsi disponibles), il reste que la décision de porter à la connaissance du public cette conférence de Waismann, intitulée « De l’essence des mathématiques [ : le point de vue de Wittgenstein] » (traduite par Ludovic Soutif), s’avère particulièrement judicieuse et ce, même pour un linguiste, car elle permet d’appréhender la continuité de pensée qui structure l’œuvre de Wittgenstein en mettant en évidence que la signification des concepts mathématiques était déjà conçue dans les années 20 en termes d’« usage » (cf. p. 225).
Enfin, ce volume propose une réactualisation très conséquente de la bibliographie sous la forme de deux suppléments indiquant les parutions et événements depuis 1985, ainsi que toutes les traductions récentes en français des livres et articles des membres du Cercle de Vienne. Si ce travail, effectué par Ludovic Soutif, mérite d’être salué, puisque les trente-quatre pages ainsi ajoutées sont en soi un outil précieux qui permet, de plus, de prendre conscience de l’intense activité scientifique qui émane encore de nos jours des réflexions du Cercle de Vienne, il faut cependant déplorer le choix typographique de l’éditeur qui, en n’inscrivant
pas en gras – contrairement à l’ancienne édition depuis longtemps épuisée – les titres des sept sous-parties de cette bibliographie, rend mal aisée son utilisation. De plus, étant donné que la bibliographie est répartie en plusieurs sous-sections, répondant pour certaines à un critère chronologique, il aurait été utile de préciser dans le corps du texte l'année de parution des livres et articles cités.
Béatrice gOdART-WendLingUMR 7597 HTL, CNRS,Université Paris Diderot
Thomas, Paul-Louis & Vladimir Osipov, Grammaire du bosniaque, croate, monténégrin,
serbe, Paris, Institut d’Études Slaves, 2012, 621 p., ISBN 978-2-7204-0490-0.
Cela fait exactement soixante ans qu’est parue la seconde édition de Meillet & Vaillant, Grammaire de la langue serbo-croate (la 1ère édition date de 1924). Il est inutile de dire que les slavistes francophones attendaient avec impatience un nouvel ouvrage sur cette langue. Ils ne seront pas déçus par cette nouvelle grammaire qui est remarquable par sa richesse, sa pédagogie et son ampleur qui laisse très peu de choses de côté. Le seul regret que l’on puisse exprimer est que les auteurs n’ont pas traité la formation des mots en arguant du fait qu’elle nécessiterait un ouvrage entier. Certes, mais on pourrait en dire autant du système verbal ou de la subordination. Il eût été possible d’en présenter un aperçu, car en supprimant des exemples d’illustration (souvent trop nombreux), on aurait pu acquérir la place nécessaire. Mais hormis cette réserve, on saluera le désir d’exhaustivité qui fera de cette grammaire une référence indispensable.
On n'arrêterait pas de faire des compliments si la tâche du recenseur n’était pas aussi de montrer les imperfections ou d’indiquer les points de désaccord. Mais avant toute chose, il faut souligner l’excellence de l’introduction (p. 23-48) qui donne une image très claire de la situation linguistique dans l’ex-Yougoslavie, en particulier le choix des initiales BCMs (bien mises en évidence sur la couverture) qui remplacent de plus en plus le terme serbo-
LeCTURes & CRiTiqUes
166
croate employé jusqu’ici. Il ne s’agit pas seulement de ne pas heurter les susceptibilités toujours promptes à se manifester des quatre républiques, mais il s’agit aussi de montrer l’existence de variantes qui, cependant, n’entravent jamais l’intercompréhension. La conclusion des auteurs est nette : « On a affaire à un système linguistique unique avec des différences régionales ». Ils en profitent au passage pour tenter d’extirper des préjugés qui, par définition, ont la vie dure. Par exemple, l’idée que le serbe s’écrit uniquement en caractères cyrilliques, alors qu’il utilise conjointement les alphabets latin et cyrillique, ou que le serbe serait uniquement ekavien et les autres « langues » jekaviennes : en réalité, les Serbes qui habitent hors de la Serbie utilisent le jekavien. S’il est vrai que le serbe utilise plus souvent la périphrase da + verbe conjugué à la place de l’infinitif, il ne faut pas considérer cet emploi comme emblématique de la différence entre serbe et croate, car l’infinitif n’a pas disparu en serbe. Toutes les particularités dialectales sont bien expliquées, et une carte en couleurs à la fin de cette première partie donne une idée complète de la localisation des divers parlers.
Le livre, en dehors de l’introduction, est divisé en trois grandes parties : 1) Écriture, phonétique et phonologie (51-67) ; 2) Morphologie-Syntaxe (71-446) ; 3) Syntaxe (447-574). C’est une division inhabituelle et contestable dans son principe. La morphologie-syntaxe se distingue de la syntaxe par le fait que cette dernière étudie la syntaxe des cas, la coordination et la subordination, tandis que tout le reste appartient à la première. Mais la morphologie est en fait inséparable de la syntaxe dans cette dernière partie. Les auteurs ont eu la louable intention de rompre avec la tradition grammaticale qui est de séparer morphologie et syntaxe, mais il fallait aller au bout de cette logique au lieu d’adopter une position difficilement défendable sur le plan de l’organisation de la matière.
La partie sur la phonétique, la phonologie et l’écriture est complète et irréprochable. C’est donc sur le reste que va porter la discussion. Tout ce qui est morphologie proprement dite est excellemment traité, et on suivra les auteurs – entre autres – dans leur classement des verbes. Comme toutes les langues slaves
qui ont conservé les déclinaisons, le BCMs présente de nombreux écueils formels, bien mis en évidence, qui ne facilitent pas l’apprentissage de la langue. Parfois, on sent les auteurs gênés quand il s’agit de préciser la catégorie à laquelle appartient tel ou tel mot : pronom, adjectif, adverbe ? Ces difficultés sont inhérentes à l’analyse en parties du discours, et c’est pourquoi il semble préférable de partir des unités supérieures et d’étudier ensuite leurs constituants. Il est dommage que déterminants n’apparaisse pas dans le texte : cela aurait évité la dénomination hybride de pronom-adjectif ou de considérer malo « peu » et mnogo « beaucoup » uniquement comme des adverbes à cause de leur invariabilité, même quand ils apparaissent dans un groupe nominal.
Les numéraux avaient été oubliés par les grammairiens antiques, mais ce n’est pas le cas ici. On a en effet une description très complète de ce système fort complexe, comme dans la majorité des langues slaves, et une particularité du BCMs n’est pas omise : il est en effet impossible dans cette langue de traduire littéralement une phrase comme « Elle a donné de l’argent à ses trois enfants » (p. 242). Mais on notera sur le plan des principes que les auteurs ont renoncé à traiter les numéraux comme une seule partie du discours, puisqu’à côté des cardinaux (dont le statut n’est pas le même pour tous), on trouve les ordinaux, les collectifs et plusieurs types de substantifs, comme quoi l’unité sémantique ne recouvre pas la diversité morphosyntaxique.
Les auteurs sont beaucoup plus gênés quand il s’agit de rendre compte des éléments invariables. Si l’on peut isoler les marquants de relation comme les prépositions et les conjonctions, les difficultés commencent avec les adverbes et les particules. Ce dernier terme est très mal défini, mais on considère généralement comme particules les petits mots, normalement inaccentués, qui ne modifient pas les relations syntaxiques existantes. Or, il est impossible de considérer comme particules de modalité des mots comme naravno « bien entendu, naturellement », sigurno « sûrement, certainement », možda « peut-être », valjsa « probablement » ou vjerojatno « probablement » et de le mettre dans la même catégorie que les marquants d’interrogation ou les réponses comme « oui » ou « non »
LeCTURes & CRiTiqUes
167
qui forment des énoncés autonomes. Il faut bien distinguer les adverbes modalisateurs qui expriment un jugement du locuteur sur le dictum des marquants énonciatifs et des vraies « particules » expressives trahissant l’état d’esprit du locuteur que les auteurs ne traitent pas en tant que telles en dehors de ma qui n’est pas à rattacher aux particules de mise en valeur. Certes, il n’est pas simple de doter certains mots invariables d’un statut précis (par exemple, si l’on peut considérer zašto comme un adverbe de cause, on n’en fera pas de même avec zato qui est une articulation de discours), mais il ne faut pas malgré tout regrouper des éléments hétérogènes sans essayer auparavant de structurer la matière.
Le système verbal du BCMs n’est pas aussi simple qu’on pourrait le penser, et il fait l’objet de toute l’attention des auteurs. La fameuse opposition aspectuelle imperfectif/perfectif est bien définie et richement illustrée. Chaque temps, aux deux aspects, fait l’objet d’un long développement à chaque fois nourri de nombreux exemples, mais le danger, auquel les auteurs n’échappent pas, est de produire des répétitions. On regrette aussi que les auteurs en soient restés à une étude atomistique, c’est-à-dire qu’ils n’aient pas tenté d’établir des systèmes et sous-systèmes d’oppositions. Mais on comprend aussi qu’ils n’aient pas osé rompre avec une tradition profondément ancrée dans les grammaires descriptives. On notera une idée originale : avoir traité après les formes vivantes, qu’elles soient personnelles ou impersonnelles, les formes qui sont soit archaïques soit soumises à des restrictions d’emploi. Il s’agit de l’aoriste, de l’imparfait et du plus-que-parfait. L’aoriste, en dehors de ses valeurs habituelles (temps dynamique du récit), a la particularité dans la langue parlée d’exprimer une action qui vient de s’accomplir avec une nuance de subjectivité. C’est exactement le contraire dans les langues qui ont conservé vivante l’opposition aoriste/parfait, sans doute parce qu’en BCMs, l’aoriste est la forme marquée. Il convient également de noter que l’aoriste a une valeur de futur proche – qui se retrouve dans les autres langues balkaniques – et qu’il connaît un renouveau dans les SMS à cause de sa plus grande concision.
On exprimera un dernier regret en ce qui concerne la présentation de la syntaxe. En
étudiant les cas (avec et sans préposition) un par un, les auteurs livrent un catalogue de valeurs qui occultent les relations fonctionnelles. Il aurait fallu distinguer fonctions adverbales et adnominales, subdiviser les premières en fonctions actancielles et circonstancielles avec établissement de systèmes et de sous-systèmes et classer enfin les verbes selon le principe de saturation de la valence. Là encore, les auteurs ont préféré s’en tenir à une tradition séculaire plutôt qu’innover dans la présentation. Quoi qu’on fasse, une liste, qu’elle soit alphabétique ou non, n’aura jamais les mêmes vertus qu’une structuration rigoureuse de la matière.
La subordination bénéficie également d’un traitement exhaustif. Le trait frappant est l’extension de da comme introducteur de complétive. Il peut entrer en concurrence avec što et les nuances sont très subtiles. Les auteurs disent que što introduit une action comme certaine, réalisée, avec une nuance de cause, tandis que da introduit une action qui n’est qu’envisagée, ce qui correspondrait à l’opposition bulgare entre če (complétive « indicative ») et da (complétive « subjonctive »). Mais certains exemples donnés par les auteurs ne peuvent s’expliquer ainsi : Kažem ti da nisam gladan! « Je te dis que je n’ai pas faim », L[ij]epo ti kažem da sam jeo, « Je te répète que j’ai mangé » indiquent une action certaine. Il faut sans doute voir les prémices d’une modification du système conduisant à un remplacement progressif de što par da.
On ne peut entrer dans tous les détails de la subordination, mais deux points méritent une attention particulière.
– Les auteurs parlent de complétives qui seraient compléments d’objet indirect. Cette analyse n’est pas recevable, car le propre des complétives est de toujours avoir une forme unique, quelle que soit la rection du verbe principal (génitif, datif, instrumental ou préposition), ce qui n’empêche évidemment pas d’avoir un corrélatif dans la principale. La fonction de la complétive est celle d’objet sans autre précision.
– Diviser les temporelles selon le rapport simultanéité/antériorité/postériorité n’est pas suffisant sous peine de ne pas rendre justice aux faits : le point de départ (« depuis que ») et le point d’arrivée (« jusqu’à ce que ») s’intègrent mal dans ce schéma.
LeCTURes & CRiTiqUes
168
L’Institut d’Études Slaves modernise sa collection de grammaires. Il reste à souhaiter que cette voie continue d’être productive. Il manque en effet de nouvelles grammaires du polonais et du tchèque, et la syntaxe du russe n’est toujours pas publiée. Et pour couvrir toute la slavistique, il faudrait rédiger des grammaires du slovène, du macédonien, du sorabe, de l’ukrainien et du biélorusse qui ne bénéficient d’aucune description. Les besoins restent importants.
Jack feUiLLeTProfesseur émérite à l’INALCO
Mais ces différences dans l’appréhension des faits linguistiques ne sauraient masquer l’excellence de cette grammaire et l’impression très positive que l’on éprouve à sa lecture. On est pratiquement sûr de trouver ce que l’on recherche grâce à un index très détaillé. Les slavistes et les typologues seront particulièrement intéressés par des traits (assez rares) du BCMs : la conservation de l’opposition déterminé/indéterminé dans l’adjectif, l’emploi du conditionnel pour exprimer la répétition dans le passé, l’existence d’un futur II qui peut avoir des valeurs différentes de celles d’un futur accompli, la coexistence (et donc la concurrence) de formes archaïques et de formes courantes.
LeCTURes & CRiTiqUes
INDEX DU VOLUME XXXIV
Analyse logique et grammaticale, 34/2, 79-102Cadre, 34/1, 115-154Catégories, 34/1, 41-62, 34/1, 63-95Cognition située, 34/1, 63-95Cognition sociale, 34/1, 97-114Conflit linguistique, 34/2, 45-57Contexte, 34/1, 97-114Couleurs, 34/1, 63-95Diglossie, 34/2, 45-57Discours, 34/1, 63-95Données / construit, 34/2, 121-153Empirisme, 34/2, 121-153Externalisme, 34/1, 97-114Fonctionnalisme, 34/2, 121-153Gramática española, 34/2, 59-77Grammaire de texte, 34/2, 121-153Grammaire et arithmétique, 34/2, 79-102Grammaire générale, 34/2, 59-77Grammaire scolaire, 34/2, 59-77Grammaire transformationnelle, 34/1, 115-154Histoire Épistémologie Langage (revue), 34/2, 9-24Idéologues, 34/2, 79-102Internalisme, 34/1, 97-114Lexique, 34/1, 63-95Linguistique cognitive, 34/1, 19-40, 34/1, 41-
62, 34/1, 97-114, 34/1, 115-154
Linguistique hispanique, 34/2, 9-24, 34/2, 25-44Localisme, 34/1, 115-154Métaphore, 34/1, 115-154Méthodologie de la recherche, 34/2, 25-44Mind-body problem, 34/1, 97-114Modélisation, 34/2, 121-153Néologie, 34/2, 25-44Normalisation linguistique, 34/2, 45-57Norme, 34/2, 103-119Phraséologie, 34/2, 103-119Politique linguistique, 34/2, 45-57, 34/2, 59-77Prototype, 34/1, 115-154, 34/1, 41-62Psychomécanique du langage, 34/1, 41-62Qualité de la traduction, 34/2, 103-119Réalité, 34/1, 97-114Relativisme linguistique, 34/1, 19-40Sémantique, 34/1, 19-40Sémantique cognitive, 34/1, 63-95Sémantique du prototype, 34/1, 41-62Sémantique générative, 34/1, 115-154Signifié de puissance, 34/1, 41-62Sociolinguistique, 34/2, 45-57Structuralisme, 34/1, 19-40Structuralisme, 34/2, 121-153Tagmémique, 34/2, 121-153Traduction, 34/2, 103-119
Histoire Épistémologie Langage 34/II (2012) © SHESL
Achard-Bayle, Guy, 34/1, 97-114Boyer, Henri, 34/2, 45-57Cance, Caroline, 34/1, 63-95Chabrolle-Cerretini, Anne-Marie, 34/2, 9-24Dubois, Danièle, 34/1, 63-95Elffers, Els, 34/1, 19-40Fortis, Jean-Michel, 34/1, 115-154Freixa, Judit, 34/2, 25-44
Gautier, Antoine, 34/1, 41-62Leiva Rojo, Jorge, 34/2, 103-119Léonard, Jean-Léo, 34/2, 121-153Montoro del Arco, Esteban T., 34/2, 79-102Narvaja de Arnoux, Elvira, 34/2, 59-77Paveau, Marie-Anne, 34/1, 97-114Verjans, Thomas, 34/1, 41-62
Index des auteurs d’articles/Index of contributors
Index des matières/Index of subjects
170
Saussure, F. de, 34/1, 19-40 Senillosa, Felipe, 34/2, 59-77
index dU vOLUMe xxxiv
Index des noms propres/Index of names
Categories, 34/1, 41-62, 34/1, 63-95Cognitive linguistics, 34/1, 19-40, 34/1, 41-62,
34/1, 97-114, 34/1, 115-154Cognitive semantics, 34/1, 63-95Colours, 34/1, 63-95Context, 34/1, 97-114Data / Construct, 34/2, 121-153Diglossia, 34/2, 45-57Discourse, 34/1, 63-95Empiricism, 34/2, 121-153Externalism, 34/1, 97-114Frame, 34/1, 115-154Functionalism, 34/2, 121-153Generative semantics, 34/1, 115-154Gramática española, 34/2, 59-77Grammaire générale, 34/2, 59-77Grammar and arithmetics, 34/2, 79-102Histoire Épistémologie Langage (journal), 34/2, 9-24Ideologues, 34/2, 79-102Internalism, 34/1, 97-114Lexicon, 34/1, 63-95Linguistic conflict, 34/2, 45-57Linguistic normalization, 34/2, 45-57Linguistic policy, 34/2, 45-57, 34/2, 59-77Linguistic relativism, 34/1, 19-40Localism, 34/1, 115-154
Logic and grammatical analysis, 34/2, 79-102Metaphor, 34/1, 115-154Mind-body problem, 34/1, 97-114Modelling, 34/2, 121-153Neology, 34/2, 25-44Norm, 34/2, 103-119Phraseology, 34/2, 103-119Potential significate, 34/1, 41-62Prototype, 34/1, 41-62, 34/1, 115-154Prototype Theory, 34/1, 41-62Psychomechanics of language, 34/1, 41-62Reality, 34/1, 97-114Research methodology, 34/2, 25-44School grammar, 34/2, 59-77Semantics, 34/1, 19-40Situated cognition, 34/1, 63-95Social cognition, 34/1, 97-114Sociolinguistics, 34/2, 45-57Spanish linguistics, 34/2, 9-24, 34/2, 25-44Structuralism, 34/1, 19-40, 34/2, 121-153Tagmemics, 34/2, 121-153Text grammar, 34/2, 121-153Transformational grammar, 34/1, 115-154Translation, 34/2, 103-119Translation quality, 34/2, 103-119
Index des langues / Index of languagesCatalan, 34/2, 45-57Espagnol, 34/2, 59-77Mazatec, 34/2, 121-153
Mixtec, 34/2, 121-153Miztec, 34/2, 121-153Spanish, 34/2, 59-77
Index des noms géographiques/Index of geographical termsArgentine, 34/2, 59-77Espagne, 34/2, 25-44, 34/2, 45-57, 34/2, 79-
102, 34/2, 103-119
Argentina, 34/2, 59-77Spain, 34/2, 25-44, 34/2, 45-57, 34/2, 79-102,
34/2, 103-119
XIXe siècle, 34/1, 19-40, 34/2, 59-77, 34/2, 79-102
XXe siècle, 34/1, 19-40, 34/1, 97-114, 34/1, 115-154, 34/2, 45-57
19th century, 34/1, 19-40, 34/1, 115-154, 34/2, 59-77, 34/2, 79-102
20th century, 34/1, 19-40, 34/1, 97-114, 34/2, 45-57
Index des périodes étudiées / Chronological index
171
HEL publie des numéros thématiques et des recueils d’articles hors thème. Chaque numéro comprend environ 400 000 signes. La revue existe à la fois en version papier et en version en ligne toutefois les articles ne sont pas en libre accès sur l’internet avant un délai de 3 ans après parution. Les auteurs s'engagent à autoriser la publication de leur article via le portail Persée après ce délai. Le comité de rédaction choisit les projets thématiques après rapport d’au moins un membre du comité de lecture spécialiste de la question. Les projets de numéro thématique doivent comporter une synthèse indiquant l’orientation générale, une liste des articles prévus (auteurs et longueur), avec pour chacun un bref descriptif et le nom de l’auteur. Les articles hors thème sont choisis sur la base de deux rapports de lecture selon le protocole du double anonymat.
Le comité de rédaction prend en considération la publication de manuscrits anciens suffisamment courts, et celle de traductions de documents rédigés dans des langues d’accès difficile. Les langues de la revue sont le français et l’anglais, mais aucun numéro ne peut être entièrement en anglais. La revue accepte également des articles dans les principales autres langues européennes, mais ceux-ci ne peuvent occuper plus de 20% de la pagination. Les manuscrits non retenus ne sont pas retournés.
Les articles, ou projets thématiques, sont à remettre sous forme imprimée et électronique à la rédaction :
Université Paris Diderot Paris 7Revue Histoire , Épistémologie, Langage
UFR de linguistique - Case 70345 rue Thomas Mann 75205 Paris cedex 13
mail : [email protected]
Les articles doivent être précédés de deux résumés de 120 mots, en anglais et en français, ainsi que de mots clefs dans ces deux langues. Il est recommandé aux auteurs de ne pas dépasser 50 000 signes par article, espaces, notes et bibliographie compris.
Nous recommandons vivement le support informatique pour le traitement de l'iconographie (format EPS, 600 ppp minimum, Photoshop et/ou Illustrator). Les illustrations ne seront pas intégrées dans le texte et livrées indépendamment dans des fichiers à part.
Les références se donnent en mentionnant le nom de l’auteur, la date de parution et la page (ex. : Stéfanini 1976, p. 26 ou Stéfanini 1976, p. 26-30). Les noms propres sont en minuscules dans le texte, les références et les citations. Pour la bibliographie on se conformera aux normes suivantes :
Sources primaires
Chiflet, Laurent (1659). Essay d’vne parfaite grammaire de la langve francoise où le lecteur trouuera, en bel ordre, tout ce qui est de plus necessaire, de plus curieux, & de plus elegant, en la pureté, en l’orthographe, & en la prononciation de cette langue, [par le R. P. Lavrent Chiflet, de la compagnie de IESVS], chez Van Meurs, Jacques, Anvers. [Nouvelle édition sous le titre Nouvelle et parfaite grammaire française (1669). Paris, Gabriel Quinet]
Palsgrave, John (1530). Lesclarcissement de la langue francoyse, London, John Haukyns. [Fac-simile reprint : Genève, Slaktine, 1972.]
INFORMATIONS POUR LES AUTEURS
172
Palsgrave, John (2003). L’éclaircissement de la langue française (1530), Texte anglais original, Traduction et notes de Susan Baddeley, Paris, Honoré Champion (Textes de la Renaissance 69, série Traités sur la langue française).
Sources secondaires
Aarsleff, Hans (1971). « Guillaume de Humboldt et la pensée linguistique des idéologues », Joly, André et Stéfanini, Jean (éd.), La Grammaire générale des modistes aux idéologues, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires de Lille, 217-241.
Chomarat, Jacques (1981). Grammaire et rhétorique chez Érasme, Paris, Les Belles-Lettres, 2 vol.Heath, Terrence (1971). « Logical Grammar, Grammatical Logic and Humanism in Three German
Universities », Studies in the Renaissance 18, 9-64.Joly, André et Stéfanini, Jean (éd.) (1977). La Grammaire générale des modistes aux idéologues,
Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires de Lille.
173
HEL publishes thematic issues and open issues. Each issue is about 400 000 signs in length. The journal is published simultaneously on paper and electronically but the electronic version is freely available on the internet only after a delay of 3 years (moving wall principle). The authors authorize the publication of their article via the Web portal Persée after this deadline. Projects for thematic issues are read by at least one member of the Reading Committee specialized in the intended topic and are selected by the Editorial Board on the basis of his or her report. Such projects, when submitted, must include a synthetic description of their general orientation, a list of the papers considered and a short synopsis of each paper (with an indication of each author’s name and of the intended length of his or her paper). The papers submitted for an open issue are selected on the basis of two independent reports (doubly anonymously) by members of the Reading Committee.
The Editorial Board may occasionally accept to publish editions of reasonably short Ms source material or translations of documents written in languages not usually known to the journal’s readers. The languages of the journal are French and English, but no issue can be entirely in English. Articles written in the other european languages are also accepted. Unpublished manuscripts will not be returned.
Articles, or thematic projects, should be submitted both in printed and electronic form:
Université Paris Diderot Paris 7Revue Histoire , Épistémologie, Langage
UFR de linguistique - Case 70345 rue Thomas Mann 75205 Paris cedex 13
mail : [email protected]
Papers should be accompanied by two 120 words abstracts, one in English and one in French and by a list of keywords.
We recommend that the iconography should be furnished on numeric support (EPS format, 600 dpi minimum, Photoshop or Illustrator). The illustrations are not included in the text and are delivered independently in separate files.
Citations (references) must be given by mentioning the name of the author, the publication date and the page (e.g. Stéfanini 1976, p. 26 or Stéfanini 1976, p. 26-30). Proper names appear in lower case throughout (in the text and in the citations as well as in the reference section).The reference section (bibliography) must be consistent with the following examples :
Primary Sources
Chiflet, Laurent (1659). Essay d’vne parfaite grammaire de la langve francoise où le lec-teur trouuera, en bel ordre, tout ce qui est de plus necessaire, de plus curieux, & de plus elegant, en la pureté, en l’orthographe, & en la prononciation de cette langue, [par le R. P. Lavrent Chiflet, de la compagnie de IESVS], chez Van Meurs, Jacques, Anvers. [Nouvelle édition sous le titre Nouvelle et parfaite grammaire française (1669). Paris, Gabriel Quinet]
INFORMATION NOTE FOR AUTHORS
174
Palsgrave, John (1530). Lesclarcissement de la langue francoyse, London, John Haukyns. Fac-simile reprint : Genève, Slaktine, 1972.
Palsgrave, John (2003). L’éclaircissement de la langue française (1530), Texte anglais original, Traduction et notes de Susan Baddeley, Paris, Honoré Champion (Textes de la Renaissance 69, série Traités sur la langue française).
Secondary Sources
Aarsleff, Hans (1971). « Guillaume de Humboldt et la pensée linguistique des idéologues », Joly, André et Stéfanini, Jean (éd.), La Grammaire générale des modistes aux idéologues, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires de Lille, 217-241.
Chomarat, Jacques (1981). Grammaire et rhétorique chez Érasme, Paris, Les Belles-Lettres, 2 vol.Heath, Terrence (1971). « Logical Grammar, Grammatical Logic and Humanism in Three
German Universities », Studies in the Renaissance 18, 9-64.Joly, André et Stéfanini, Jean (éd.) (1977). La Grammaire générale des modistes aux idéologues,
Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires de Lille.
175
La revue de la SHESL est publiée deux fois par an en version papier et en version en ligne (avec un « moving wall » de 3 ans). Les langues utilisées sont principalement le français et l’anglais. Les articles sont répertoriés dans Linguistic Abstracts et Sociological Abstracts.Des renseignements sur la SHESL sont disponibles sur « http://www.shesl.org/ ».Les sommaires des numéros et les résumés des articles sont consultables sur « http://htl.linguist.jussieu.fr/HEL0.html ». Les numéros qui sont en dehors du « moving wall » sont disponibles sur le portail Persée à l’URL « http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/hel »On peut se procurer les numéros disponiblesPar courrier : SHESL, Université de Paris 7 - UFR de Linguistique, Case 7034, 5 rue Thomas Mann - 75205 PARIS cedex 13Courriel : [email protected] Tél. 01 57 27 57 83Sur place : Université Paris 7, UMR 7597 (HTL), UFR de Linguistique 175 rue du Chevaleret, 75013 Paris
DISPONIBILITÉ DES NUMÉROS
1,I (1979) Sciences du langage et métalangage (épuisé) 1,II (1979) Ellipse et grammaire (épuisé)2,I (1980) Histoire de la tradition linguistique arabe (épuisé)2,II (1980) Répertoire bibliographique 1978 (suite)/1979 La coupure saussurienne. La grammaire de Montague 5 €3,I (1981) Sémantiques médiévales (épuisé)3,II (1981) De la grammaire à la linguistique (avec des inédits de Court de Gébelin et Rask) (épuisé)4,I (1982) Les Idéologues et les sciences du langage (épuisé)4,II (1982) Statut des langues/Approches des langues à la Renaissance 5 €5,I (1983) L’ellipse grammaticale (épuisé)5,II (1983) La sémantique logique (épuisé)6,I (1984) Logique et grammaire (épuisé)6,II (1984) Genèse du comparatisme indo-européen 5 €7,I (1985) Études sur les grammairiens grecs 5 €7,II (1985) La réflexion linguistique en Grande-Bretagne, XVIIe-XVIIIe siècles 5 €8,I (1986) Dictionnaires, grammaires, catégories, philosophie, déchiffrement (épuisé)8,II (1986) Histoire des conceptions de l’énonciation (épuisé)9,I (1987) Les premières grammaires des vernaculaires européens (épuisé)9,II (1987) La tradition espagnole d’analyse linguistique 5 €10,I (1988) Stratégies théoriques 5 €10,II (1988) Antoine Meillet et la linguistique de son temps 5 €11,I (1989) Sciences du langage et recherches cognitives (épuisé)11,II (1989) Extension et limites des théories du langage 5 €12,I (1990) Progrès et révisions 5 €12,II (1990) Grammaires médiévales 5 €13,I (1991) Épistémologie de la linguistique 5 €13,II (1991) Théories et données 5 €14,I (1992) L’adjectif : perspectives historique et typologique 5 €14,II (1992) Théories linguistiques et opérations mentales 5 €15,I (1993) Histoire de la sémantique 5 €15,II (1993) Sciences du langage et outils linguistiques 5 €16,I (1994) Actualité de Peirce 5 €16,II (1994) La grammaire des Dames 5 €XVII,1 (1995) Théories du langage et enseignement/apprentissage des langues (fin du XIXe siècle/début du XXe siècle) 5 €
HISTOIRE ÉPISTÉMOLOGIE LANGAGE
176
XVII,2 (1995) Une familière étrangeté : la linguistique russe et soviétique 5 €XVIII,1 (1996) La linguistique de l’hébreu et des langues juives 5 €XVIII,2 (1996) L’esprit et le langage 5 €XIX,1 (1997) Construction des théories du son (Première partie) 5 €XIX,2 (1997) Construction des théories du son (Deuxième partie) 5 €XX,1 (1998) Les grammaires indiennes 5 €XX,2 (1998) Théories des cas 5 €XXI,1 (1999) Linguistique des langues slaves 5 €XXI,2 (1999) Constitution de la syntaxe 5 €XXII,1 (2000) Horizons de la grammaire Alexandrine (I) 5 €XXII,2 (2000) Horizons de la grammaire Alexandrine (II) 5 €XXIII,1 (2001) Le traitement automatique des langues 5 €XXIII, 2 (2001) Dix siècles de linguistique sémitique 5 €XXIV,1 (2002) Grammaire et entités lexicales 5 €XXIV,2 (2002) Politiques linguistiques 1/2 5 €XXV,1 (2003) Politiques linguistiques 2/2 5 €XXV,2 (2003) Les syncatégorèmes 5 €XXVI,1 (2004) Langue et espace : Retours sur l’approche cognitive 5 €XXVI,2 (2004) La linguistique baltique 5 €XXVII,1 (2005) L’autonymie 5 €XXVII,2 (2005) Autour du De Adverbio de Priscien 5 €XXVIII,1 (2006) Histoire des idées linguistiques et horizons de rétrospection 28 € XXVIII,2 (2006) Hyperlangues et fabriques de langues 28 €XXIX,1 (2007) Histoire des théories du son 28 €XXIX,2 (2007) Le naturalisme linguistique et ses désordres 28 €XXX, 1 (2008) Grammaire et mathématiques en Grèce et à Rome 28 €XXX, 2 (2008) Les langues du monde à la Renaissance 28 €XXXI, 1 (2009) Mathématisation du langage au 20e siècle 28 €XXXI, 2 (2009) La nomination des langues dans l’histoire 28 €XXXII, 1 (2010) Catherine II et les langues 32 €xxxii, 2 (2010) Sciences du langage et psychologie
à la charnière des 19e et 20e siècles 32 €xxxiii, 1 (2011) Linguistique appliquée et disciplinarisation 32 €xxxiii, 2 (2011) Histoire des idées linguistiques et horizons de rétrospection (II) 32 €XXXIV, 1 (2012) La linguistique cognitive : histoire et épistémologie.XXXIV, 2 (2012) La linguistique hispanique aujourd’hui 32 €
En préparation :
XXXIV, 2 (2012) Aux origines du modèle de grammatisation arabe : Al Xalil 32 €
































































































































![Thomas d'Aquin et la place des mots en logique (Philosophia perennis 1 [1994], 35-66)](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6318b243e9c87e0c090fca9d/thomas-daquin-et-la-place-des-mots-en-logique-philosophia-perennis-1-1994-35-66.jpg)