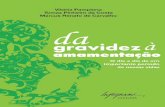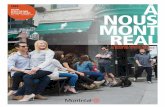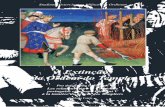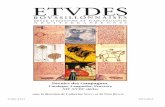De l'autonomie à l'intégration les temples d'Egypte face à la couronne des Saïtes aux...
-
Upload
univ-rennes2 -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of De l'autonomie à l'intégration les temples d'Egypte face à la couronne des Saïtes aux...
Comité d’honneur (au 01.01.2015) :Jean Andreau, Alexandre Farnoux, Ian Morris, Georges Rougemont, Catherine Virlouvet
Comité de Rédaction (au 01.01.2015) :Marie-Françoise Boussac, Roland Étienne, Jean-François Salles, Laurianne martinez-sève, Jean-Baptiste Yon
Responsable de la Rédaction : Marie-Françoise Boussac
Adjoint : Jean-Baptiste Yon
Maison de l’Orient et de la Méditerranée — Jean Pouilloux7 rue Raulin, F-69365 LYon
www.topoi.mom.frwww.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/topoi
Diffusion : De Boccard Édition-Diffusion, 11 rue de Médicis, 75006 Paris
Topoi. Orient-Occident 19, Lyon (2014)ISSN : 1161-9473
Illustration de couverture : Tête masculine, Hatra (photo © Henri Stierlin).Illustration du dos : Temple de Maran, Hatra (photo © Henri Stierlin).
Ouvrage publié avec le concours
de la Société des Amis de la Bibliothèque Salomon Reinach
Topoi 19 (2014)p. 5-7
SOMMAIRE
Fascicule 1
Sommaire 5-7
Index des auteurs 9-10
Les sanctuaires autochtones et le roi dans l’Orient hellénistiquePh. ClanCier et J. Monerie, « Avant-propos » 11-15D. agut-labordère et G. gorre, « De l’autonomie à l’intégration. Les temples égyptiens face à la couronne des Saïtes aux Ptolémées » 17-55L. graslin-thoMé, « De Jérusalem à Babylone. Les relations entre le temple de Jérusalem et les souverains achéménides et hellénistiques » 57-100C. apiCella, « Du roi phénicien au roi hellénistique » 101-121G. tolini, « Les sanctuaires de Babylonie à l’époque achéménide. Entre légitimation, soumission et révoltes » 123-180Ph. ClanCier et J. Monerie, « Les sanctuaires babyloniens à l’époque hellénistique. Évolution d’un relais de pouvoir » 181-237L. Martinez-sève, « Les sanctuaires autochtones dans le monde iranien d’époque hellénistique » 239-277
Les CycladesR. étienne, « Les Cyclades : une expression géographique ? » 279-290Cl. hasenohr, « Le bas quartier du théâtre à Délos à l’époque impériale » 291-308H. WurMser, « L’habitat dans les Cyclades à l’époque impériale » 309-323Ch. papageorgiadou-banis, « Monnayage et société dans les Cyclades pendant la période impériale » 325-333M.-Th. le dinahet, « Les nécropoles cycladiques du ier au iiie s. apr. J.-C. » 335-399C. bouras, « Les ports des Cyclades à l’époque impériale » 401-415A. peignard-giros, « La céramique d’époque impériale dans les Cyclades : l’exemple de Délos » 417-433M. galli, « Les réalités associatives dans les Cyclades à l’époque impériale. Le bâtiment à l’intérieur de l’Agora des Déliens et le “Portique des Mystae” de Mélos » 435-455E. le Quéré, « Fortunes et “stratégies” sociales dans l’espace cycladique : le rôle des évergètes sous l’Empire » 457-476
6 sommaire
SOMMAIRE
Fascicule 2
Sommaire 481-482
De la Grèce à RomeR. Bouchon, « Démophilos de Doliché, Paul-Émile et les conséquences de la troisième guerre de Macédoine à Gonnoi » 484-513É. Prioux et E. santin, « Des écrits sur l’art aux signatures d’artiste : l’école de Pasitélès, uncasd’étudesurlanotiondefiliationartistique» 515-546
Méditerranée hellénistiqueP. schneider, « Savoirs lettrés et savoirs pratiques. Denys d’Alexandrie etlesmarchandsalexandrins» 547-563S. Élaigne et S. lemaître, « De la vaisselle et du vin chypriote au Létôon deXanthosàl’époqueromaine» 565-593
Proche-OrientJ. seigne, « Des portiques du naos de Zeus Olympien aux entrées des thermes de l’évêquePlaccus.Empruntsetrecyclagesd’élémentsarchitecturauxàGérasa» 595-627C. saliou,«Àproposdequelqueséglisesd’Antiochesurl’Oronte» 629-661
Comptes rendusS. Fachard, St. Elden, The Birth of Territory(2013) 663-670J. ZurBach, D.W. Jones, Economic Theory and the Ancient Mediterranean(2014) 671-673J. ZurBach, F. de Angelis, Regionalism and Globalism in Antiquity(2013) 675-678H. Broise, S.K. Lucore, M. Trümper (éds), Greek Baths and Bathing Culture(2013) 679-686J.-Cl. david, N. Ergin (éd.), Bathing Culture of Anatolian Civilizations(2011) 687-703r. nouet, Fl. Gherchanoc et V. Huet (dir.), Vêtements antiques. S’habiller, se déshabiller dans les mondes anciens (2012) 705-708P. Pomey, J.-M. Kowalski, Navigation et géographie dans l’Antiquité gréco- romaine (2012) ; J. Beresford, The Ancient Sailing Season(2013) 709-713S. amigues, A. Giesecke, The Mythology of Plants (2014) 715-717Chr. Feyel, J. Marcillet-Jaubert, A.-M. Vérilhac et Cl. Vial, Index du Bulletin épigraphique 1978-1984(2007) 719-733Orient ancien, époques archaïque et classiqueS. gondet, J. Álvarez-Mon & M.B. Garrison (éds), Elam and Persia (2011) 735-740
sommaire 7
H. Le meaux, M.C. Belarte, R. Plana-Mallart (éds), Le paysage périurbain en Méditerranée occidentale (2012) ; P. Darcque et al. (éds), Proasteion (2014) 741-746A. sartre-Fauriat, A.-M. Guimier-Sorbets et Y. Morizot (éds), L’enfant et la mort dans l’Antiquité I (2010) 747-748B. HoLtzmann, a. Papanikolaou, Η αποκατάσταση του Ερεχθείου (2012) 749-759Époque hellénistique et romaineG. Frija, M. Horster et A. Klöckner (éds), Cities and Priests. Cult Personnel in Asia Minor and the Aegean Islands (2013) 761-763Fr. Prost, V. Platt, Facing the Gods (2011) 765-768P. scHneider, S. Guédon, Le voyage dans l’Afrique romaine (2010) 769-773P. scHneider, St. Guédon (dir.), Entre Afrique et Égypte : relations et échanges entre les espaces au sud de la Méditerranée à l’époque romaine (2012) 775-779V. dasen, J. Mander, Portraits of Children on Roman Funerary Monuments (2012) 781-784J.-B. Yon, M. Blömer, E. Winter (éds), Iuppiter Dolichenus. Vom Lokalkult zur Reichsreligion (2012) 785-791R. raja, N. Andrade, Syrian Identity in the Greco-Roman World (2013) 793-796A. Vokaer, A. Schmidt-Colinet et W. al-As‘ad, Palmyras Reichtum durch weltweiten Handel, 2 vol. (2013) 797-800L. tHoLbecq, J.S. McKenzie et al., The Nabataean Temple at Khirbet et-Tannur, 2 vol. (2013) 801-811P.-L. Gatier, « Princes clients du Proche-Orient hellénisé » ; à propos de T. Kaizer et M. Facella (éds), Kingdoms and Principalities (2010) ; A.J.M. Kropp, Images and Monuments of Near Eastern Dynasts (2013) ; G. Vörös, Machaerus I. History, Archaeology and Architecture (2013) » 813-827Égypte et Orient de l’époque hellénistique à l’islamTh. FaucHer, R. et D. Klemm, Gold and Gold Mining in Ancient Egypt and Nubia (2013) 829-836L. martinez-sèVe, r. Boucharlat, e. Haerinck, Tombes d’époque parthe (2011) 837-840L. martinez-sèVe, G.M. Cohen, The Hellenistic Settlements in the East from Armenia and Mesopotamia to Bactria and India (2013) 841-849Fr. de caLLataÿ, F. Sinisi, Sylloge Nummorum Parthicorum VII, Vologases I – Pacorus II (2012) 851-855Ch. LerouGe-coHen, L. Dirven (éd.), Hatra (2013) 857-865Arabie, Inde, océan IndienA. aVanzini, M. Mouton et J. Schiettecatte, In the desert margins. The Settlement Process in Ancient South and East Arabia (2014) 867-874O. boPearacHcHi, I. Strauch (éd.), Foreign Sailors on Socotra (2012) 875-879J. Pons, G. Ducœur (éd.), Autour de Bāmiyān, De la Bactriane hellénisée à l’Inde Bouddhique (2012) 881-892
Topoi 19 (2014)p. 17-55
DE L’AutOnOMIE à L’IntéGRAtIOn LES tEMPLES D’éGyPtE FACE à LA COuROnnE
DES SAïtES Aux PtOLéMéES (vIe-IIIe SIèCLE Av. J.-C.) 1
Les invasions assyriennes de la première moitié du viie siècle constituent sans doute l’un des moments les plus importants de l’histoire de l’Égypte ancienne. Non seulement les armées venues d’Asie s’emparèrent de Memphis, mais elles poussèrent jusqu’à Thèbes obligeant les Nubiens du roi Tantamani à se replier sur Napata au centre de l’actuel Soudan 2.Ce fut, enmême temps, lafinde ladomination koushite sur l’Égypte et le début de la période dite saïte (la XXVIe dynastie manéthonienne). Saïte car les Assyriens choisirent Psammétique Ier de Saïs, lefilsdeNéchaoIer, un roitelet égyptien allié, pour occuper le trône de l’Égypte 3. Avec ce roi d’abord vassal commence une longue période de stabilité politique que l’historiographie nommera la « Renaissance saïte » 4. Durant presque un siècle, le trône d’Égypte fut en effet occupé par une même lignée dont la succession ne sera interrompue qu’en 570 par le coup d’État du général Amasis contre le pharaon Apriès 5. L’avènement du premier roi saïte constitue le point de départ de notre réflexion,sansquenoussoyonsconvaincusdelapertinencedecechoix.Peut-êtreles spécialistes des périodes libyennes et éthiopiennes distingueront-ils, dans leur champ d’études respectif, les prémisses du mouvement décrit ici.
Des Saïtes aux Ptolémées, la structure de l’État 6 égyptien subit une modification extrêmement profonde qui déséquilibra le rapport entre les deux
1. NB : Toutes les dates se situent avant Jésus-Christ, sauf mention du contraire.
2. Sur ces événements on se reportera à la synthèse de naunton 2010.
3. perdu 2002.
4. agut-labordère 2013.
5. leahY 1988.
6. Le mot « État » est ici pris au sens large de « forme de gouvernement ».
18 d. agut-labordère, g. gorre
principaux ensembles institutionnels dont il était constitué – la Couronne et les temples : la première se rendit progressivement maître des seconds. Il importe ici de rappeler brièvement le cadre idéologique dans lequel s’inscrivait la relation entre le pharaon et les institutions religieuses. Bernard Mathieu a très récemment insisté à juste titre sur la nécessité pour l’historien de l’Égypte ancienne de recourir en permanence à la catégorie du « politico-religieux » 7. Le pharaon fut en effet un roi-prêtre. Les sanctuaires 8 constituaient donc de véritables « monuments du pouvoir » 9 et les clergés égyptiens agissaient en vertu d’une forme de délégation de compétence de la part du roi 10. Cette réalité idéologique ne se traduisait pourtant qu’incomplètement au niveau institutionnel. En effet, la nécessité pour les temples de disposer de biens pour que s’accomplisse le service divin conduisit le roi à leur allouer terres, ressources et revenus. Ce patrimoine était regroupé au sein d’un domaine-pr, dont le contenu 11 était réputé inaliénable 12. Pour administrer son domaine, le temple disposait donc de ses propres services, totalement indépendants de ceux de la Couronne.
Nous emprunterons au travail de Laurent Capdetrey, conduit dans le prolongement de celui de John Ma 13, l’outillage conceptuel et le vocabulaire nécessairesàlaréflexionquenousentendonsmenerici14.
«L’ensembleduterritoireroyalséleucideétaiteneffetunifiéparlasoumissionà une souveraineté commune incarnée par le roi, mais dans le cadre de cette souveraineté, selon les entités et les circonstances et dans le souci d’efficacité
7. mathieu 2010, p. 77.
8. Tout au long de ce travail, nous distinguerons les « temples », les institutions religieuses, des « sanctuaires », les bâtiments cultuels.
9. derchain 1997, p. 232.
10. Sur ce rôle et la légitimité du pharaon comme roi-prêtre, derchain 1962.
11. L’ensemble des biens et des ressources constituant la propriété de l’institution étaient énumérés dans un document de fondation appelé ἰmy.t-pr (litt.« ce qu’il y a dans le domaine »).
12. grandet 1994, p. 5, note 9 : « Dans le P. Harris I (et dans le cadre de la civilisation pharaonique en général), le terme pr désigne fondamentalement toute institution assurant le culte d’une divinité, la subsistance d’un personne ou d’un groupe de personnes sur terre ou dans l’au-delà, la conservation d’une structure sociale. À la traduction “maison” on doit, dans pratiquement tous les cas, préférer celle de “domaine (économique)”, “propriété”. »
13. ma 2004.
14. capdetreY 2007, p. 87-89 (« Souveraineté, domination, assujettissement »), et l’ensemble du très riche chapitre V de la deuxième partie.
de l’autonomie à l’intégration 19
politique, coexistaient nécessairement plusieurs modes de domination débouchant à leur tour sur différents degrés d’assujettissement au pouvoir royal. » 15
Ce cadre suppose que le pouvoir n’est pas univoque. La manière dont il s’applique est conduite à se transformer en fonction des interlocuteurs et des circonstances. Ainsi, sera-t-il ici question de l’évolution du niveau d’assujettissement des temples à l’égard de la Couronne du viie siècle au iie siècle.
1. Le temps de l’autonomie des temples : la défense du domaine royal par les pharaons saïtes
L’autonomie des temples à l’égard du pouvoir royal se manifeste d’abord dans leur statut. Elle se retrouve aussi dans un certain nombre de droits qui apparentent les temples égyptiens de cette époque aux cités autonomes séleucides 16 : « capacité à négocier et à recevoir des avantages », la maîtrise de ses revenus et la garantie des émissions en métaux précieux 17. L’autonomie des temples n’était toutefois pas sans danger pour le pouvoir royal. Pour comprendre la nature du risque encouru, il convient de faire un petit détour par la sociologie. C’est en effet à travers le prisme de la « société paysanne » décrite par H. Mendras que nous proposons d’examiner la société égyptienne du premier millénaire 18. Les communautés villageoises, que l’on hésite à qualifier d’urbainesmême pour les plus importantes, constituaienten effet l’unité de base de la société égyptienne à cette époque 19. Nous manquons malheureusement de documents nous renseignant directement sur la vie de ces groupes 20, mais de nombreux proverbes conservés dans les recueils de maximes permettent de deviner le fonctionnement de ce cadre villageois marqué par
15. capdetreY 2007, p. 89. C’est l’auteur qui souligne.
16. capdetreY 2007, p. 210.
17. À l’époque perse par exemple, le temple de Ptah de Memphis est associé à la production de lingots d’argent et, plus tard, émet des « statères » : cf. Ostracon d’Ayn Manâwir 7547, an 14 de Darius II (411-410), découvert en novembre 2010. Ce document est maintenant consultable sur www.achemenet.com.
18. La description la plus achevée de cet idéaltype se trouve dans mendras 1995, p. 13-17 : « Qu’est-ce qu’un paysan ? ».
19. moreno garcía 2011 auquel on peut ajouter cardoso 1986.
20. Les presque 500 ostraca d’époque perse découverts à Ayn Manâwir et transcrits par Michel Chauveau permettront de remédier quelque peu à cette lacune (www.achemenet.com).
20 d. agut-labordère, g. gorre
la fermeture 21. À la tête de ces groupes, se trouvait une « micro-élite » dont les membres appartenaient au clergé local.
1.1. Le roi lésé : la logique des donations royales
La Pétition de Pétéisé (P. Rylands IX) 22 est un document irremplaçable pour comprendre la manière dont s’articulaient les relations entre un temple local et la Couronne. Rédigée en écriture démotique par un certain Pétéisé (III), ayant vécu à Téoudjoï (actuellement El-Hibeh en Moyenne Égypte) sous le règne de Darius Ier (522-486), ce texte vise d’abord à dénoncer les violences dont son auteur fut victime de la part des autres prêtres du temple local d’Amon et, implicitement, à revendiquer une meilleure place dans la hiérarchie sacerdotale. Pour appuyer sa requête, Pétéisé relata l’histoire de sa famille en remontant au début de la période saïte, lorsque son trisaïeul, Pétéisé Ier, vint s’établir là sous le règne de Psammétique Ier (664-610). À l’époque, Pétéisé Ier travaillait pour un administrateur de très haut rang, le Grand de la FlottePétéiséfilsdeChasheshonk.C’est au cours d’une tournée d’inspection effectuée dans le cadre de ses fonctions qu’il aurait découvert le temple d’Amon de Téoudjoï quasiment abandonné.
P. Rylands 9, 6.9-18 (Chapitre 6 23) : «Pétéisé fils d’Itorou arriva àTéoudjoï, il alla vers le temple et il inspecta
chaque pièce du temple de (6,10) Téoudjoï. Il trouva que le temple de Téoudjoï avaitl’aspectd’untrèsgrandédifice,saufqu’ilmanquaitd’hommes.Ilnetrouvaen effet personne dans le temple à l’exception d’un prêtre âgé et d’un sacristain. Pétéiséfitamenerleprêtreetluidit:
— Puisque tu n’es plus tout jeune, dis-moi donc de quelle manière on a déserté cette ville.
Le prêtre lui répondit :— Cela est arrivé ainsi : personne (d’autre) n’était prêtre ici à part les prêtres
d’Amonrêsonter, c’étaient vos (sic) ancêtres qui étaient prêtres ici et qui firentresplendir ce temple en tout. C’était un domaine divin opulent (6,15) attribué à AmondeTéoudjoï,c’étaitcetédificedontondisaitquec’étaitlapremièreplaced’Amonrêsonter.Maisvintcettepériodenéfaste:onfitpayerunimpôtauxgrandstemples d’Égypte et on greva alors cette ville d’un impôt excessif. Ils ne purent pas payer l’impôt dont on les avait grevés, ils s’en allèrent et, alors même que les grands temples d’Égypte furent désormais exemptés, on continua à venir vers nous en disant : “Versez l’impôt !” jusqu’à aujourd’hui. »
21. agut-labordère 2012.
22. L’édition de référence est vittmann 1998. On en trouvera une traduction française dans agut-labordère et chauveau 2011, p. 145-200. Certains éléments du commentaire qui va suivre sont repris dans agut-labordère 2013, p. 1010-1016.
23. La division en chapitre n’existait pas dans le texte d’origine.
de l’autonomie à l’intégration 21
Revenu auprès de son supérieur à Hérakléopolis, Pétéisé Ier aurait fait consulter les registres de l’impôt et réalisé que le temple de Téoudjoï était en réalité exempté des charges qui avaient provoqué sa ruine. Pétéisé entreprit d’en informer le Grand de la Flotte qui accepta de rembourser aux prêtres la somme indûment perçue.
P. Rylands 9, 7.5-13 (Chapitre 6) : « Le Grand de la Flotte dit alors à Pétéisé (Ier)filsd’Itorou:— Va et fais que l’on dresse un état des rentrées en provenance de Téoudjoï
depuis que l’on a exempté les grands temples du pays du Sud, et fais qu’il soit rendu aux prêtres d’Amon de Téoudjoï.
Pétéiséfilsd’ItorouallaàTéoudjoï.Ilfitalorsamenerlesartisans,illeurdonnadeux cents dében d’argent fondu et vingt dében d’or [= 1,8 kg],illeurenfitfairedelavaisselled’argentetd’orpourAmon.Puisilfitfairelachapelled’Amon-le-supérieur-de-la-Grande-Place,ilfitamenerlesprêtres,lessacristainsetlescorporationsquirelèvent du temple à Téoudjoï. Même si certains étaient allés jusqu’à Thèbes, il les fittousamener.Ilfitrendreledomainedivinqu’iltrouvaattribuéàAmon,(7,10)ilfitajoutermillearoures[=250 ha] de champs pour le domaine divin d’Amon et il fitdéposerdesoffrandesetdutissudevantAmonetdevantOsirisdeTaoudja.C’estainsiqu’ilfitresplendirTéoudjoïcommel’undesgrandstemplesdupaysduSud.»
Il est ici très important de faire remarquer que le montant déboursé par le trésor royal ne fut pas remis aux mains des membres du clergé d’Amon de Téoudjoï, mais dans celles de Pétéisé Ier. On comprend alors mieux l’insistance avec laquelle le texte de la Pétition souligne l’abandon du sanctuaire. Cette désertion permettait à Pétéisé Ier de s’auto-instituer gestionnaire de cette somme et de contrôler la distribution des bienfaits suscités par son zèle pour le moins intéressé. Cette manœuvre lui permit de prendre le contrôle du temple et d’installer sa famille à sa tête.
P. Rylands 9, 7.5-13 (Chapitre 6) : «Ilplaçasesenfantscommeprêtresd’AmondeTéoudjoïetilfitconstruireune
maison faisant quarante coudées divines sur quarante [C’est-à-dire incluse dans un carré de 21 m de côté, soit environ 441 m2] et ayant un schoene [Il doit s’agir d’une superficiedecentcoudéescarrées,soitenviron2750m2]decourautourd’elle,ilfitenfinconstruiresonlogisdansletemple.»
Soucieux de pérenniser cette position fraîchement acquise face aux revendications des notables locaux, Pétéisé Ier prit soin de rappeler l’ensemble des bienfaits qu’il avait accomplis pour le temple d’Amon de Téoudjoï en les faisant inscrire dans une pierre dure. Nous connaissons le texte de cette stèle grâce à la copiequ’enfitPétéiséIIIàlafindelapétition.
P. Rylands 9, 21.11-22.7 (Appendice I) :« Copie de la stèle en pierre d’Éléphantine qui est dans le dromos d’Amon, —
détail :
22 d. agut-labordère, g. gorre
Année 1[4], troisième mois de la saison akhet [= avril 651], sous la majesté de l’Horus Grand-de-coeur, Celui des deux Maîtresses Maître du bras, l’Horus d’or Victorieux, le Roi de Haute et de Basse Égypte Ouahibrê, le Fils de Rê Psammétique [Ier], vivant éternellement comme Rê.
Alors que Sa Majesté réjouissait le pays en réprimant ses ennemis et en approvisionnant tous les temples de Haute et de Basse Égypte, on vint à dire devant le premier serviteur divin de Hérishef-Roi-des-deux-terres, le serviteur divin d’Osiris-de-Naref-sur-son-trône, le chef des serviteurs divins (21,15) de Sobek de Shéded, le serviteur divin d’Amon-Rê-Grand-de-clameur et de son ennéade, le Grandde laFlottedupays tout entier,PétéiséfilsdeChasheshonk: “Le templed’Amon-Grand-de-clameur est tombé en ruines à cause de l’impôt pesant sur lui.”
Le dignitaire attaché (à ce temple) et résidant dans cette ville, Pétéisé filsd’ItorouetdeTadébehneithfitensortequ’ill’apprenne,etcedignitaire(= Pétéisé fils d’Itorou) s’étendit sur le sol en disant: “Si tu supprimes l’impôt du templed’Amon-Grand-de-clameur, alors (22,1) cette ville dans sa totalité te servira, débarrassée de son mal.”
Cedignitairesefixacommeobjectifd’établirsoninfluencesurcetteville.Alorsce responsable se mit à discuter de cet impôt avec tous les scribes de chaque ville concernée, tous les agents et leurs semblables. Alors (ils) dirent : “Cela ne se faisait pas à l’origine.”
Alors il semit en colère à causede cela, alors ce général (=Pétéiséfils deChasheshonk) envoya vers le sud son subordonné qui résidait dans cette ville, Pétéiséfilsd’Itorou,endisant:“Quel’onnedonneplusd’impôtdanscetempled’Amon-Grand-de-clameur pour l’éternité à jamais car cela ne se faisait pas à l’origine. Tous les prêtres et tous les serfs seront protégés et exemptés d’impôt à jamais de la part de tout dignitaire, de tout envoyé, de tout agent, de tout policier. Il afaitcelapourexemptercetempleetceuxquis’ytrouvent,afinqu’ilsagissentpourlui (comme) génisses aux (22,5) champs. Quant à celui qui respectera ce décret, il seradanslesfaveursdubabienfaisant,sonnomperpétué,sonfils(installé)àsaplace, sa maison stable sur ses fondations. Quant à celui qui détruira cette stèle, il sera pour l’épouvante et le malheur dans le grand tribunal qui est à Héracléopolis, ilserapourlecouteaudeHenebquirésideàNaref,sonfilsseraécarté,samaisonn’existera plus, son corps étant conduit au feu, il sera pour le brasier de l’Œil de Rê qui réside à la Butte-des-Ricins, son nom ne sera plus parmi les vivants pour l’éternité.” »
Ce récit diverge légèrement par rapport à celui que donne Pétéisé III dans la pétitiondémotique.Cedernieraffirmeeneffetquesonancêtreétaitvenus’établirà Téoudjoï après la réfection du sanctuaire. Or, le texte de la stèle précise – par deux fois – que Pétéisé Ier y résidait et avant que le temple ne soit restauré. Si ce détail n’avait plus aucune importance à l’époque où Pétéisé III écrivait, on comprend tout l’intérêt qu’avait son ancêtre à affirmer l’ancienneté de son implantation,il est donc très probable que le texte de la stèle soit, sur ce point très précis, mensonger.Àl’inverse,letextedelastèleestcertainementplusfiablequecelui
de l’autonomie à l’intégration 23
delapétitionlorsqu’ildonneàPétéiséfilsdeChasheshonklerôleprincipaldanstoute l’affaire. En effet, seul le Grand de la Flotte avait la possibilité de prélever sur le trésor royal la somme qui permit à Pétéisé Ier de s’imposer à Téoudjoï. C’est cet élément de l’histoire familiale qui semble avoir le plus embarrassé PétéiséIII.Pourdiminuerencorel’importancedePétéiséfilsdeChasheshonk,ilfut en effet conduit à inventer une petite histoire dans laquelle son ancêtre aurait finiparsuccéderàcedernieraprèssondécèstoutenpartageantsafonctionaveclefilsdedéfunt,Semataouytefnakht24. Or, aucun témoignage autre que celui de la PétitiondePétéisénevientconfirmerlefaitqu’unPétéiséfilsd’Itorou(ils’agitlà du nom complet de Pétéisé Ier) ait occupé un jour cette fonction éminente, alors quelefaitquePétéiséfilsdeChasheshonketsonfilsaientétéGrand de la Flotte est attesté par l’épigraphie 25. Amoindrir le rôle du Grand de la Flotte permettait à Pétéisé III d’accroître d’autant le rôle de sa famille dans la remise en ordre du temple d’Amon.
C’est donc en confrontant les deux versions de cette histoire que l’on parvient à mieux comprendre la manière dont Pétéisé Ier prit la tête de cette institution et de la ville elle-même. Sur ce point, c’est ici encore le texte de la stèle qui se révèle le plus intéressant. Au détour du récit, le but de l’action de Pétéisé Ier à Téoudjoï est dûmentexplicité:«Cedignitairesefixacommeobjectifd’établirsoninfluencesurcette ville » (Littéralement, « … de placer cette ville sur son eau ») 26. Cette phrase illumine l’ensemble de l’opération en nous livrant son but ultime : Chasheshonk filsdePétéisé autilisé sapositiondans l’administration royalepour imposer àla têtedu templed’AmondeTéoudjoïundesesaffidés,PétéiséIer, dans le but avoué que ce dernier prenne la tête de la ville elle-même. En utilisant le prétexte d’uneerreurfiscale,ilapuisédansletrésorroyalpourpermettreàcesubordonnéd’acheter cette première place en rénovant le sanctuaire tout en accordant au temple une exemption de charge. En échange, les prêtres de Téoudjoï ont accepté de confier la direction de l’institution au féal de leur bienfaiteur. À Téoudjoïmême,onimaginequelamanœuvrenefitpasquedesheureux,mais,encemilieudu viie siècle, le rapport de force devait être nettement favorable au nouveau venu tant son protecteur était puissant. Si les familles écartées par l’arrivée de Pétéisé Ier n’avaient plus qu’à ronger leur frein, une majorité des prêtres avait dû trouver un intérêt direct à l’opération et notamment au fait que l’accroissement du domaine agricole du temple couplé à l’exemption fiscale entraînait l’augmentation desrevenus liés à leurs charges.
Ainsi, sous les Saïtes, les membres les plus élevés de l’administration royale servaient le roi et se servaient de lui, ou plutôt de ses biens, pour renforcer leur influencerégionale.LapérennitédupouvoirdePétéiséIer sur Téoudjoï dépendait
24. agut-labordère et chauveau 2011, p. 168-170.
25. vittmann 1998, p. 711.
26. Cette métaphore est fréquente dans les textes de la Basse Époque (vittmann 1998).
24 d. agut-labordère, g. gorre
donc très étroitement de celui de son maître. Ainsi relue, l’histoire de Pétéisé fournit l’un des arrière-plans possibles au phénomène des donations tant royales que privées, phénomène pour lequel nous disposons d’un très grand nombre de stèles mentionnant des transferts de biens d’un domaine du roi vers celui d’un dieu. Il s’agit dans la plupart des cas de terres, mais parfois, comme à Téoudjoï, la donation pouvait être multiple et aboutir à une refondation du domaine du dieu comme le montre un autre texte « biographique » (on aurait envie de dire évergétique), celui de Peftuaneith conservé sur la statue Louvre A 93. Ce haut administrateur, ayant vécu sous Apriès et Amasis, y détaille son action en faveur du temple de Khentamenti à Abydos 27. Certains auteurs, comme Dimitri Meeks 28, ont vu dans les donations royales aux temples la volonté de la part du souverain de « maintenir l’activité économique dont ils [=les temples] étaient le centre ». Sans nier cette possibilité, la Pétition de Pétéisé nous conduit à proposer une lecture différente de cette pratique dans laquelle les aspects institutionnel et sociologique prennent le pas sur l’économie. Il n’est en effet absolument pas certain que les donations dites « royales » aient toujours été décidées par les rois eux-mêmes. Le plus souvent, comme nous le voyons dans la Pétition, le transfert de bien ou l’octroi d’un privilègerésultaitd’unaccordlocalpasséaubénéficedel’administrationroyaleet de ses agents et au détriment du domaine royal. Toutefois, cela ne présageait en rien des éventuels avantages politiques que la Couronne pouvait tirer de ces manœuvres. Ainsi, et dans le cas très précis de Téoudjoï au début de la période saïte, l’arrivée d’un homme du Grand de la Flotte à la tête de cette ville contribuait à faire remonter l’aire de domination saïte vers le sud et à la rapprocher de la Haute-Égypte, encore tenue à ce moment-là par les grandes familles thébaines.
1. 2. Une administration pour protéger les biens du roi
Ilestévidemmenttrèsdifficiledeconnaîtrelamanièredontlessouverainssaïtes perçurent les accords locaux passés entre leurs agents et les temples. Toujours est-il que l’histoire de l’administrative égyptienne de cette période est marquée par le développement de fonctions de contrôle des propriétés du roi et de celle des temples. Ainsi, la charge de Préposé au partage des offrandes (ἰmἰ-rȜ wpw ḥtp-ntr) consacrée au contrôle de l’administration des domaines des dieux 29 est attestée, pour l’époque saïte, par au moins deux personnages contemporains
27. On trouvera une traduction en anglais dans lichtheim 1980, p. 33-36. Pour la date de ce monument, leahY 1984.
28. meeks 1979a, p. 652. On pourra aussi lire l’analyse très stimulante proposée par spencer 2010. En s’appuyant sur le corpus des inscriptions « biographiques », cet auteur propose à juste titre de voir des initiatives individuelles à l’origine de certains travaux effectués dans les temples.
29. valloggia 1976, p. 35.
de l’autonomie à l’intégration 25
de Psammétique Ier, tous deux étaient des Thébains et portaient le titre principal de tjaty (ṯȜty, parfois appelé « vizir »). Nespakachouty est connu par sa tombe (TT 312) tandis que son collègue Harsiésé nous a laissé une statue (Phil. Univ. Mus. E 16025) 30. Ne disposant que du titre, il est impossible de cerner le rôle de ces haut-administrateurs. Ce n’est heureusement pas le cas pour deux autres agents du pouvoir royal : le directeur des champs et le senti.
RevenonsàlaPétitiondePétéisé.Àlafindelapériodesaïte,souslerègned’Amasis (569-526), le pouvoir royal intervint cette fois-ci directement – et brutalement – dans les affaires des prêtres du temple de Téoudjoï. Un personnage relevant de l’administration royale, portant le titre de directeur des champs (mr Ȝḥ), arriva sur place et constata deux irrégularités concernant la gestion foncière. Il convient cependant de préciser que l’inspection conduite par le directeur de champs n’était pas uniquement mue par des motivations de service. Pétéisé III nous apprend en effet que ce dernier entendait chercher dans le nome héracléopolite (où se trouvait Téoudjoï) des éléments qui lui permettraient de s’attaquer aux intérêts d’uncertainHormakhoroufilsdePtahortais,personnagepuissantquipossédaitdes intérêts dans plusieurs nomes et qui appartenait probablement lui aussi à l’administration royale. Il s’agit là, très certainement, du nouveau protecteur que les prêtres d’Amon de Téoudjoï se sont trouvés entretemps. Comme ses prédécesseurs, Hormakhorou ne semble pas avoir ménagé les intérêts locaux du roi. Ainsi, sous couvert du culte royal, a-t-il fait attribuer 120 aroures (env. 33 ha) de terre prélevées sur le domaine royal à la statue du pharaon Amasis installée à Téoudjoï dont il s’était, dans le même temps, fait bombarder serviteur divin. Cette double opération lui permit d’être le principal – si ce n’est l’unique – bénéficiairedurevenudupetitdomaineagricoleainsiconstitué.Souscouvertduculte royal, c’était à un véritable détournement des biens de la Couronne à son profitques’estlivréHormakhorou.Ledirecteur des champs a donc beau jeu de souligner le caractère frauduleux d’une telle donation en s’appuyant sur le cas de l’érection d’une statue identique dans le temple d’Hérakléopolis qui n’avait pas été accompagnée d’une telle faveur (16,8-9). L’enquête conduite par le directeur des champs à Téoudjoï dévoila une autre malversation. Les prêtres du temple d’Amon de Téoudjoï s’étaient en effet attribués indûment une île de 255 ha apparue en face de leur ville à la faveur d’une faible crue. Le directeur procéda donc à la confiscationdesterresetdudomainede33haattribuéfrauduleusementàlastatueainsi que de 4 000 sacs de céréale issus des moissons des terres détenues au mépris du droit par le temple d’Amon de Téoudjoï. Il est intéressant de lire sur ce point le discours qu’il aurait tenu au roi Amasis :
P. Rylands 9, 17.12-17 (Chapitre 6) :«–Mon grand seigneur! J’ai trouvé une île aumilieu du fleuve en face de
Téoudjoï. Les scribes du nome m’ont dit qu’elle devait contenir mille aroures de champs, mais quand je l’ai fait mesurer, elle a compté (en réalité) 929 aroures de
30. de meulenaere 1982.
26 d. agut-labordère, g. gorre
champs. Par le visage de Pharaon ! Il ne convient pas de la donner au domaine divin d’un dieu ou d’une déesse, c’est à Pharaon qu’elle convient ! Elle doit bien rapporter vingt sacs de grain (17,15) mesurés avec le boisseau de 40 hin pour une aroure de champs. J’ai interrogé les scribes en disant : “Est-elle attribuée à Amon de Téoudjoï ? ” Ils me répondirent : “Il y a en elle 484,5 aroures de champs attribuées àAmon.”J’aiditalorsauxprêtresd’Amon:“Venezafinquejefassequ’onvousles rende du côté de votre domaine divin situé dans la campagne de la terre ferme de Téoudjoï.” »
Le directeur des champs était chargé de veiller à préserver l’intégrité foncière des domaines de la Couronne 31. L’existence d’un tel office impliquaitcelle d’une cadastration des terres 32. Nous avons conservé la trace d’une vaste opération de ce type sur un ostracon d’époque ptolémaïque découvert à Karnak (O. Karnak LS 462.4). C’est en l’an 28 de Psammétique Ier (637-638) que, suite aux bouleversements liés à une crue exceptionnellement forte, le roi ordonna de mettreàjourlecadastredupays.Cedocumentexceptionnelabénéficiéd’unetrèsimportante nouvelle édition de la part de M. Chauveau 33.
O. Karnak LS 462.4« L’inventaire du bien domanial. L’inventaire (qui) a été ordonné pour
l’imposer. On a écrit pour informer le senti Peftaoukhonsfils dePnikek, en l’an28, mois de Thôt, du Pharaon Psammétique, alors que Pharaon était sur les … de Ta-ampanehes,etqu’ilsedirigeaitverslepaysdeSyrie,afind’envoyersesscribeset ses représentants des …, depuis Éléphantine jusqu’à Séma-Béhédet, pour qu’ils dressent dans chaque district – 39 nomes (en tout) – l’état de leurs changements, alors qu’on s’en était plaint, l’eau qui avait déplacé (ou débordé) les digues et les champs les ayant inondés… »
L’envoi des scribes chargés d’établir le nouveau document de référence se serait effectué sous la houlette d’un haut fonctionnaire qui porte le titre de senti bien connu pour l’époque ptolémaïque, mais qui n’est pourtant attesté pour lapremièrefoisparl’épigraphiequ’àlatoutefindurègned’Amasis.Faut-ilenconclure que le senti existait dès le viie siècle ? Mieux vaut supposer qu’il s’agit là d’une réinterprétation ptolémaïque d’un titre plus ancien. En effet, le senti est absentdelapartiedelaPétitiondePétéisésedéroulantàlafindelapériodesaïte.Iln’apparaît dans ce texte que sous le règne de Darius Ier (522-486). C’est en effet la
31. Pour la période perse, nous disposons d’une liste de mr-Ȝḥ provenant de Saqqara publiée par martin et smith 2009, p. 116-117 (Fco 424). Aucun nom iranien ne s’y trouve.
32. YoYotte 1989, p. 75.
33. chauveau 2011.
de l’autonomie à l’intégration 27
période où vécurent les plus anciens senti attestés par l’épigraphie 34:Horoudjafilsde Tesnakht 35etHorfilsd’Udjahorresnet36. C’est dans la généalogie de ce dernier personnage qu’est mentionné le plus ancien senti connu par l’épigraphie, son bisaïeul Horkheby, qui aurait donc exercé ses fonctions sous Amasis. Le contenu de la mission dévolue au sentiestdifficileàétablir.Onpourraitextrapoleràpartirde ce que nous savons du senti hellénistique. L’exercice serait cependant périlleux et risquerait de verser dans l’anachronisme. Il est donc préférable de s’en tenir à la documentation contemporaine. Ainsi, pouvons-nous examiner le rôle joué par le personnage occupant cette charge dans la première partie du P. Rylands 9. C’est auprès du senti que Pétéisé III va porter plainte pour les violences dont il a été victime de la part des prêtres d’Amon de Téoudjoï et c’est à lui qu’est adressé le long second rapport retraçant toute l’histoire de sa famille. Il est toutefois très probablequecerôled’arbitredansunconflitauseind’untemplenesoitenréalitéqu’un accident. Il faut, pour comprendre cela, revenir au début de la Pétition. En juillet513,uncertainAmasisfilsdePédjéhorempêvintàTéoudjoïpourtoucherle revenu d’une prébende de serviteur divin qui lui avait été attribuée par un senti dont le nom demeure inconnu. Ce dernier, comme le Grand de la Flotte avant lui, disposait d’une prêtrise relevant du clergé d’Amon de Téoudjoï qu’il pouvait octroyeràl’undesesaffidés.C’estAmasisfilsdePédjéhorempêqui,s’entendantrépondre que le temple n’était plus en état de lui verser son revenu, fit uneenquête sur le fonctionnement de l’institution et trouva en Pétéisé III son principal informateur. Ce dernier, dont la famille avait depuis longtemps perdu tout pouvoir, enprofitapourdénoncerlamauvaisegestiondutemple.Lavengeancedesprêtresd’Amonnesefitpasattendre.PétéiséIIIfutrouédecoupsetlaissépourmort.Ce n’est qu’à la suite de cela qu’il se décida à porter plainte auprès du senti. Rien n’indique toutefois qu’il se soit adressé à lui en raison de ses compétences en matière de justice. Il se peut tout aussi bien que Pétéisé III se soit tourné vers luidufaitquecedernierétaitleprotecteurd’AmasisfilsdePédjéhorempêàquila malheureuse victime avait rendu service en devenant son informateur local. Mieuxvautdoncse teniràunedéfinition restreintedu rôledusenti saïte, haut administrateurapparaissantàlafindelapériodesaïteetenchargeaumoins de la gestion des institutions religieuses.
À la fin, l’histoire administrative de l’Égypte saïte paraît marquée par unaccroissement des instances de défense du domaine royal particulièrement perceptible
34. Sans que l’on puisse déterminer avec certitude s’ils œuvrèrent sous Amasis ou sous les Perses, vittmann 2009, p. 100-101.
35. Statue de Cleveland 1920.1978. bothmer 1960, p. 72-73, n° 61, pl. 58 ; berman et Bohač 1999, p. 422-423, n° 316.
36. Connu par deux stèles provenant du Serapeum de Saqqarah, Louvre C 317 et IM 4018. YoYotte 1989, p. 79-80, il s’agit du personnage B dans l’appendice de la page 87. Voir aussi vittmann 2009, p. 101, note 64.
28 d. agut-labordère, g. gorre
àlafindelapériode.L’irruptionen526,d’untroisièmeacteur,enlapersonnedupouvoir impérial perse, vient accélérer ce mouvement.
2. Le temps de la soumission : les temples sujets (de Darius Ier à la xxxème dynastie)
Les Perses vont donner à cet effort de défense du domaine royal une dimension nouvelle.
2. 1. Une réduction drastique du volume des donations royales sous les Perses
La logique de préservation du patrimoine du roi face aux appétits des temples trouve sous le règne égyptien de Cambyse (526/525-522) sa traduction la plus netteetlaplusbrutaledansundécretprisparlefilsdeCyrus.Deuxpapyrusnousont conservé deux sélections d’articles de ce texte 37.
P. Bn. Égypte 215, verso« Les mesures qui sont à sélectionner dans la loi des temples qui est dans le
tribunal.Les bois de construction navale, les bois (à) brûler, le lin et les pièces de bois que
l’on donnait aux temples des dieux autrefois à l’époque du pharaon v. p. s. Amasis, à l’exception du temple de Memphis, d’Ounkhem et du Serapeum (?), (aux) temples, Cambyse a ordonné cela : “Qu’on ne les leur donne plus du tout”. … “Qu’on leur donne cela : des emplacements parmi les bosquets de la Haute-Égypte et qu’ils produisent pour eux du bois de construction et du bois à brûler en sorte qu’ils les fournissent à leurs dieux.” (Quant aux) bosquets des trois sanctuaires susnommés, Cambyse a ordonné cela : “Qu’on leur donne cela comme s’était auparavant.”
(Quant aux) bovidés que l’on donnait aux temples autrefois à l’époque du pharaon v.p.s. Amasis v.p.s., à l’exception des trois sanctuaires susnommés, Cambyse ordonna cela : “La moitié est ce qu’on leur donnera”. Ceux (= les bovidés) qui leur étaient donnés – aux sanctuaires susnommés –, on ordonna cela : “Qu’on les leur donne encore”.
Les volailles que l’on donnait aux temples autrefois, au temps du pharaon v.p.s.
Amasis v.p.s., à l’exception des trois temples <susnommés>, Cambyse a ordonné cela : “Qu’on ne les leur donne plus ! (Ce sont) les prêtres qui élèveront pour eux des volailles et ils les offriront eux-mêmes à leurs dieux”.
37. agut-labordère 2005a. Une autre sélection d’articles du décret nous a été conservée sur un papyrus de Tebtynis d’époque romaine traduit (mais non édité) dans bresciani 1996, p. 105-107.
de l’autonomie à l’intégration 29
Les pièces de monnaies, les bovidés, les volailles, les semences 38 (et) toutes les autres choses qu’on donnait aux temples autrefois à l’époque du pharaon v.p.s. Amasis v.p.s., Cambyse ordonna cela : “Ne les donnez pas aux dieux”. »
L’approvisionnement en bois d’œuvre, structurellement rare en Égypte, devait poser des problèmes récurrents aux temples. Lorsque le besoin de grosses pièces de bois de charpente ou pour la construction navale se faisait sentir, les prêtres devaient recourir à une matière première nécessairement chère car le plus souvent importée. Le Décret de Saïs pris par Nektanébo Ier (380-362), en novembre 380, montrequeleboisd’origineétrangèreaffluaitdansledomaineduroideThônis39 installé à l’embouchure de la Canopique 40. C’est là que le pharaon pouvait prélever unepartiedutraficpourenfairecadeauauxtemples.SiCambyseafaitsupprimerles donations en bois d’œuvre c’est donc qu’il a décidé de conserver pour lui la totalité des pièces de bois captées par la douane de mer de la Méditerranée obligeant les temples à recourir aux marchands. On aura aussi noté que Cambyse leur accorda le droit d’aller tirer du bois des štȝwy.w, des « bosquets », situés en Haute Égypte, très certainement des zones couvertes par des broussailles et des épineux qui devaient se trouver en lisière du désert. L’exploitation de ces taillis ne pouvait évidemment pas compenser l’arrêt des donations en bois d’œuvre. Les dons en tissu (l. 2-7), en volailles (l. 10-12), en semence et en argent (l. 12-14) furent eux aussi purement et simplement supprimés (l. 2-7). Ceux en bétail sont réduits de moitié 41 (l. 7-9). Comme les animaux d’élevage, le tissu et les semences étaient produits localement par les temples, l’arrêt des donations royales n’était pas ici déterminant.
La stèle Caire JE 36861, dite de la fondation memphite de Taharqa, nous aide à nous représenter les effets concrets du décret. Ce document exceptionnel rassemble une série de décisions prises par le pharaon Taharqa (690-664) visant à restaurer un petit temple d’Amon à Memphis 42. Le roi accorda à sa fondation plusieurs revenus tirés de ses domaines qui ne sont pas sans rappeler ceux évoqués dans le Décret de Cambyse 43. Il établit ainsi un revenu en argent prélevé sur les
38. L’emploi du terme pr.t renverrait plutôt à des semences qu’à des céréales directement destinées à l’alimentation.
39. YoYotte 2001.
40. Dans la Stèle de Naukratis (lichtheim 1976), aux lignes 8 et 9, on distingue ḫt, « pièce de bois », du mḏḥt, certainement le bois ouvragé, et le ḫt nb, « toute pièce de bois ». Tous les deux proviennent de la Méditerranée (pr m Wȝḏ-wr).
41. Bien que sur ce point le texte soit confus puisque à la ligne 12 les donations en bétail sont supprimées.
42. meeks 1979a.
43. Le versement d’un revenu sous la forme de bovins n’est pas documenté dans la stèle de la fondation memphite de Taharqa, il est en revanche attesté sur une inscription
30 d. agut-labordère, g. gorre
pêcheurs de Memphis (l. 10-11). Une localité voisine nommée le Canal de la troupe devra également livrer régulièrement au temple du tissu, de l’« encens » 44 et du miel (l. 11-12), une offrande alimentaire en pain et en viande sera aussi verséepourlecultedesstatuesroyales(l.13-14).Enfinuntroupeauetunebasse-cour appartenant au roi seront prêtés à la nouvelle institution (l. 19-20). C’est très certainement ce genre de réseau local de donations que le Décret de Cambyse contribua à défaire. Dans le cadre de la fondation memphite de Taharqa (à supposer que le contenu de celle-ci n’ait pas étémodifié par la suite), le troupeau et labasse-cour de la couronne durent réintégrer le domaine royal d’où ils avaient été prélevés. Est-ce que les revenus versés aux prêtres assurant les cultes des statues des pharaons furent eux aussi supprimés ? Le texte du décret ne semble prévoir aucune exemption de ce type. Que devinrent l’impôt en argent prélevé sur les pêcheurs de Memphis et les produits livrés par le village ? Dans la mesure où les deux communautés concernées furent assujetties à ces nouveaux impôts par le roi, on peut être certain qu’elles relevaient de son domaine. Si leurs contributions ont étémaintenues,cefutauprofitdelaCouronne.Àlafin,lepetittemplememphitenepouvaitdoncpluscompterquesursondomaineagricoledontlasuperficieétait,à l’époque de Taharqa, d’au moins 467,5 aroures (= env. 115 ha). On peut donc supposer que la vie économique de ce type d’institution dut être durement affectée par les mesures de restriction prises par Cambyse. Il leur fallut compter avant tout sur leurs propres ressources 45. Les Achéménides ont donc poursuivi la politique de défense du domaine royal entamée sous les derniers Saïtes en lui donnant un caractère systématique. Ce faisant, les Perses contrevenaient à l’inaliénabilité des donations royales. Le droit de la lance permit donc aux conquérants de violer cet interdit qui protégeait les biens des institutions religieuses.
Si le Décret de Cambyse, tout du moins tel qu’il nous apparaît à travers les deux versions qui nous sont parvenues, ne comporte pas de volet évoquant les donations foncières, on doit toutefois faire remarquer que la série des stèles de donation s’interrompt brutalement sous son règne et ce, pour toute la durée de la période perse 46. La fin des largesses royales porta donc aussi atteinte aufoncier des temples. Par ailleurs, cesmesures immédiatement bénéfiques pourlaprospéritédudomaineroyalmodifiaientàcourtouàmoyentermelarelation
du bloc Caire JE 39410 transcrite dans jansen-Winklen 2007, p. 4-7 [15]. Pour alimenter l’offrande à Harsaphès sous le règne de Shéshonq Ier, le roi exige que plusieurs villages du nome héracléopolite s’associent pour donner tous les ans un certain nombre de bœufs.
44. Le sntr désigne des substances servant à faire des fumigations, pas nécessairement de l’encens en tant que tel.
45. agut-labordère 2005b.
46. Ce qui n’a pas empêché Darius Ier ou Darius II d’effectuer des donations foncières au temple d’Horus à Edfou, meeks 1972, p. 134-135 (§. 5).
de l’autonomie à l’intégration 31
entre les pharaons achéménides et les temples. En effet, en interrompant ou en restreignantbrusquementleflotdesdonations,leGrandRoifermaitlaportedestemples égyptiens aux membres de l’administration royale, ce qui conduisait à limiter l’influence de celle-ci à l’intérieur des temples.Mieuxqu’un sentimentnationaliste égyptien pour le moins anachronique, ce nouvel état de fait rend mieux compte de la difficulté qu’eurent les Perses à tenir fermement l’Égyptejusqu’àlafinduve siècle.
2. 2. Une cure d’austérité sous la XXXe dynastie
On aurait tort de croire que cette politique d’austérité fut strictement le fait desPerses.Eneffet, lanécessitédefinancer l’effortdeguerrepourseprotégerdes multiples tentatives d’invasions imposa aux pharaons indépendants de prendre desmesuresfiscalesexceptionnellesdontlestemples(maisaussilesparticuliers)furent les victimes 47. La radicalité de celles-ci irrita certaines fractions du clergé au point qu’un texte oraculaire appelé Chronique démotique (recto du P. Bn. Égypte 215) explique l’incapacité des rois de cette période à se maintenir durablement sur le trône en raison de leur politique à l’égard des temples48. Ainsi, les règnes de Néphéritès Ier (400-395),celuidesonfils,maisaussiceluideNektanéboIer (380-362) furent unanimement dénoncés :
P. Bn. Égypte 215 4. 4« C’est (pour) celui qui est souverain aujourd’hui qu’il (= l’oracle) dit cela,
c’est-à-dire Nektanébo Ier v.p.s., (pour) ce qui a été fait aux biens d’Égypte et de tous les temples pour faire advenir de l’argent. »UneréformefinancièreconduiteparunNektanébideaétédécritedansune
notice de l’Économique II. 25a 49.[Mesure 1] 25.a. « Le roi d’Égypte Tachôs manquait d’argent pour une
campagne qu’il voulait entreprendre ; Chabrias d’Athènes lui conseilla de dire aux prêtres qu’il était indispensable pour subvenir aux frais de la guerre de supprimer un certain nombre de temples et la majorité des prêtres. À ces paroles, parce qu’ils voulaient que leur temple (ἱερόν) fût maintenu, et que chacun d’eux pour sa part désirait garder ses revenus propres 50, les prêtres (ἱερεῖς) lui proposèrent de l’argent. »
L’auteur poursuit…
47. Ce chapitre constitue un développement de agut-labordère 2011.
48. spiegelberg 1914.
49. Will 1960. Pour la traduction, nous utilisons celle de B.A. Van Groningen et A. Wartelle, Aristote. Économique, Paris, Les Belles Lettres (1968).
50. Sur cette proposition de traduction, agut-labordère 2011, p. 633.
32 d. agut-labordère, g. gorre
[Mesure 2] « Après avoir pris à tous cet argent, le roi, toujours à l’instigation de Chabrias, leur donna l’ordre de ne plus faire désormais, pour l’entretien de leur temple et pour leur propre subsistance, que le dixième de la dépense qu’ils faisaient jusque-là, et de lui prêter le reste. »
La première mesure royale à l’encontre du clergé [1] n’a, dans le contexte égyptien, aucun sens. Comme nous l’avons vu à travers la stèle de la fondation memphite de Taharqa, les temples disposaient de revenus liés à l’exploitation de leur domaine 51 que le roi ne saurait interrompre aussi aisément. Plus probablement, dans le sens de ce que suggéra Will 52,TachôsdutmenacerdemettrefinàcequeCambyse avait laissé subsister du régime des donations royales si les prêtres ne s’acquittaient pas d’un impôt exceptionnel en argent. Plus tard, après l’invasion macédonienne, toujours selon le même Pseudo-Aristote (II. 33. f), il semble que Cléomène de Naucratis ait eu recours au même expédient :
«Uneautre fois il convoqua lesprêtres et leurfitobserverqu’on faisaitdesdépenses considérables pour les temples et la majorité des prêtres. Ceux-ci crurent qu’il allait réellement faire ce qu’il disait et, individuellement aussi bien que collectivement, lui offrirent de l’argent et des trésors sacrés, car chacun tenait à conserversonbénéfice(ἱερόν) en l’état et à en demeurer le prêtre. »
La seconde mesure [2] montre que le roi fut en mesure de mettre la main sur 90 % des biens consacrés au service des dieux et d’imposer aux temples un emprunt forcé. Chose qui n’était possible que si le souverain disposait d’une connaissance et demoyens de contrôle sur la gestion financière des domainesde dieu, rendue possible par la présence d’administrateurs royaux en leur sein. L’entrée de l’administration royale dans les temples constitua en effet le fait majeur d’une période qui courut du règne de Darius Ier à Nektanébo II.
2. 3. De la nomination du lésônis à l’apparition des scribes royaux comptables
En effet, la réduction brutale des largesses royales sous les Perses et les pharaons dits « indigènes » s’accompagna d’une autre mesure d’importance. Sous le règne de Darius Ier, le satrape, représentant du Grand Roi en Égypte, se mêla très directement de la nomination du lésônis au moins pour les principaux temples. Cet administrateur désigné parmi les prêtres faisait office d’intendantde l’institution religieuse 53. À partir de là, l’emprise royale sur les temples
51. La seule donnée globale dont nous disposons provient de Diodore de Sicile (I.11) et date donc a priori du ier siècle av. J.-C. Au commencement mythique de l’histoire égyptienne, Isis aurait donné un tiers des terres du pays aux prêtres.
52. Will 1960, p. 259-260.
53. Cette fonction a fait l’objet d’une thèse récemment soutenue à l’EPHE-IV par Marie-Pierre Chaufray, La fonction du lésônis dans les temples égyptiens de l’époque saïte à l’époque romaine.
de l’autonomie à l’intégration 33
changea de nature. Il ne s’agissait plus d’une politique visant à défendre les biens du roi, mais d’une intervention de l’administration royale (achéménide) dans le fonctionnement interne des domaines des dieux 54. Après la remise en question de l’inaliénabilité des donations royales, les souverains achéménides portèrent atteinte à l’autonomie administrative des temples égyptiens. Pour la période perse, un très important dossier de papyrus démotiques provenant d’Éléphantine contient deux lettres mentionnant l’intervention du satrape Phérendatès dans les affaires du temple local de Khnoum. La chronologie de cette correspondance a été rétablie par M. Chauveau qui a rendu à cet échange toute sa cohérence 55.
– entre le 22 juillet et le 20 août 493, les prêtres du temple de Khnoum désignent Eskhnoumpemet comme lésônis.
– le 25 ou le 26 décembre 493, ils écrivent au satrape pour l’informer de cette décision (P. Berlin 13539 = C3 56)
– le 21 avril, le satrape répond (P. Berlin 13540 = C1)– le 7 juin 492 (P. Berlin 13572 = C2), un reçu pour de l’argent témoigne
qu’Eskhnoumpemet porte effectivement le titre de lésônis à cette date.Le document le plus intéressant pour notre propos est la réponse du satrape
à l’annonce de la nomination du nouveau lésônis.P. Berlin 13540
(Au recto) « Phérendatès,àquil’Égypteestconfiée,déclareauxprêtres-pursdeKhnoum, le maître d’Éléphantine.
« Maintenant, Phérendatès est celui qui déclare : “Il y a des prêtres-purs que le phritob 57 a présentés devant moi en disant : « Laisse-les devenir lésônis ! », alors que l’un de ces prêtres-purs (= l’un des deux candidats), qui était parti, l’ordre avait été donné de le rechercher ; (et l’autre), était au service d’un autre homme. Ceux-ci ne conviennent pas pour faire un lésônis.
Maintenant, le prêtre-pur qui convient pour faire un lésônis est un notable qui sera à même de remplir ses fonctions, qui ne laissera rien à l’abandon et qui sera choisi conformément à ce que le pharaon Darius a ordonné. Celui-là convient pour faire un lésônis.
Maintenant le prêtre-pur qui sera choisi pour être un lésônis est ainsi. Celui qui sera choisi (par les prêtres), il devra être présenté (au satrape) conformément à ce que (le) pharaon Darius a ordonné. Le prêtre-pur qui laisserait à l’abandon quelque
54. capdetreY 2007, p. 216 : « Quel que fût leur degré d’intégration, toutes les cités soumises à la souveraineté séleucide étaient susceptibles de voir le roi ou son administration intervenir dans leur fonctionnement interne ou dans leur diplomatie. »
55. chauveau 1999a.
56. La référence commençant par un C renvoie à martin 1996.
57. Lecture rétablie par chauveau 1999a, p. 270, note 7.
34 d. agut-labordère, g. gorre
affaire, celui qui sert un autre homme, ou quiconque de semblable à ceux-là, qu’on ne me les présente pas pour être lésônis ! Tiens le toi pour dit. »
Satibar a connaissance de cet ordre.Peftuaneith est celui qui a dicté cette lettre. Scribe : Wahibré.En l’an 30, mois de Khoiak, jour 29 (= 21 avril 492).(Au verso) [Une lettre à] tous les prêtres-purs de Khnoum [maître d’Éléph] antine,
delapartdePhérendatès,àquil’Égypteestconfiée.»Ce document capital montre que des ordres ont été donnés au satrape
d’Égypte pour contrôler très étroitement la nomination du lésônis du temple de Khnoum. Si le collège des prêtres-purs était libre de proposer son candidat 58, ilappartenaitausatrapede ratifiercettedécision59.Souscouvertdeconfier lesaffairesfinancièredestemplesàdesgestionnairesconvenables,ils’agitlàd’uneincursion inédite dans le fonctionnement interne du domaine des dieux. Une autre lettre provenant du dossier d’Éléphantine nous renseigne sur la nature du lien hiérarchique qui unissait le lésônis et le pouvoir royal. Elle fut rédigée par un certain Khnoumprès dont nous ne connaissons pas le titre précis, mais qui agit sur ordre d’un haut fonctionnaire qui porte le titre de phritob (ḥry-ἰbd = « Chef des terrains riverains ») qui, à l’époque ptolémaïque, aurait joué le même rôle que le directeur des champs saïte 60. Nous allons voir cependant que la compétence de ces deux administrateurs diffère.
P. Berlin 13536(Au recto) « Khnoumprès salue les prêtres de Khnoum d’Éléphantine, le lésônis,
les scribes du temple. Que Neith prolonge leur durée de vie !Je vous ai écrit récemment en disant qu’on m’a écrit de la part du phritob :
qu’on amène les prêtres de Khnoum, le lésônis, les scribes du temple dans le bureau où je me trouve dans un délai de 10 jours (à partir du 16 Mecheir de l’an 24. Vous n’êtes pas venus à Edfou dans le bureau où se trouve le phritob à ce jour. Dès que cette lettre vous atteindra, venez au bureau où je me trouve tandis que l’examen du temple est écrit pour vous : 3 livres avec le compte du domaine divin de Khnoum (au verso) pour l’an 22, l’an 23 et l’an 24. Et venez au lieu où se trouve le phritob. Ne laissez pas passer le délai que je vous écris de la part du phritob.
Écrit par Pétoubastis (?) en l’an 24, 6 de Phamenoth. Khnoumprès salue les prêtres de Khnoum d’Éléphantine, le lésônis, les scribes du temple d’Éléphantine. »
58. Sur l’élection du lésônis, de cenival 1972, p. 154-159.
59. Cette pratique s’est maintenue à l’époque ptolémaïque. Le P. Berlin 13543 conserve une lettre dont l’expéditeur prie le Supérieur du district du sud (pȜ-tȜ-št-rsy) de transmettre un rapport au Thébarque (pȜ ḥry Nw.t) afin de s’assurer que celui-cidonne son accord à son élection au poste de lésônis du temple de Khnoum pour laquelle il lui a déjà envoyé de l’argent (5 débens) ainsi qu’au Thébarque (20 débens), zauzich 1978.
60. YoYotte 1988, p. 75-76 ; inconnu-bocQuillon 1989 ; Quaegebeur 1989.
de l’autonomie à l’intégration 35
Le phritob, installé à Edfou, a convoqué l’ensemble des responsables du temple de Khnoum pour contrôler les livres de compte de l’institution religieuse. À la différence du directeur des champs, responsable du foncier, le phritob semble donc chargé de l’examen de la gestion des biens. On imagine que c’est lui qui devait renseigner le satrape lorsque ce dernier avait à statuer la nomination d’un lésônis.Entouslescas,lesfinancesdestemplesétaientdésormaisrégulièrementviséesparunagentduroi;lafraudefiscaleoul’accaparementdesterresroyalesdevenaient donc de plus en plus difficiles. C’est très certainement à la faveurdece renforcementducontrôle internedesfinancesdes templespar le roiquel’artabe, unité perse d’évaluation des volumes (env. 30 l.), s’imposa et supplanta totalement le khar (le « sac » d’environ 75 l. au Nouvel Empire) en usage depuis l’Ancien Empire 61. L’artabe demeura en usage tout au long des périodes grecque puis romaine. Ce point, dont l’importance est rarement soulignée, montre que les Perses étaient parvenus à imposer aux Égyptiens leurs normes comptables. On peut aussi supposer que, à l’intérieur même des temples, les lésônis choisis par le satrape furent les agents de cette transformation et adaptèrent la gestion des temples aux règles comptables perses. C’est dire la profondeur de l’intrusion du pouvoir royal dans la gestion des temples. Ce mouvement se poursuivit durant la période d’indépendance. Sous la XXXe dynastie, l’on vit apparaître dans les temples un personnel d’un type nouveau relevant tout à la fois de l’administration fiscale royale et de celle du temple: le scribe royal comptable 62. Ainsi, à Hermopolis, le père du lésônis Pétosiris – sur lequel nous reviendrons – fut nommé scribe royal comptable par le roi qui le chargea de superviser lesfinances destemples de la ville, fonction qui l’apparentait au Superviseur du temple (pȜ rmt nty šn, en grec épistatès tou hiérou) connu par la documentation ptolémaïque. Le vivier dans lequel le roi puisât pour pourvoir cette fonction était avant tout constitué des scribes comptables du temple, c’est-à-dire par des hommes issus de l’administrationfinancièredesinstitutionsreligieuses63. Mais, très rapidement, a dû se constituer un milieu de scribes comptables du roi spécialisés dans ce type de fonction. Ainsi, dans l’inscription, les liens entre le père de Pétosiris et les temples d’Hermopolis ne sont pas précisés. Il est donc loin d’être certain qu’il ait fait préalablement partie de l’administration de l’un de ces temples. Quoiqu’il en
61. vleeming 1981.
62. de meulenaere 1997, p. 22, note que les scribes royaux « se manifestent pour la première fois dans la documentation sous la 30e dynastie et leur soudaine apparition esttrèsprobablementliéeauxréformesfiscalesdeNectanéboIer dont nous percevons quelques échos dans la célèbre stèle de Naukratis ». De même, YoYotte 1989, p. 76, souligne que le titre de « scribe comptant toutes choses de la maison du roi » est une « formule reprenant la locution qui, à la même époque, dans le Décret de Naucratis définitlesprélèvementsfiscauxopérésparlacouronnesurlesimportationsetlesfabrications ».
63. chauveau 1999b, p. 27.
36 d. agut-labordère, g. gorre
soit, le fait que des scribes royaux comptables aient été chargés de travailler dans des institutions religieuses montre l’accroissement de l’effort d’encadrement des temples par l’administration royale. Du contrôle administratif des nominations au poste de lésônis,nouspassonslààunesupervisionadministrativedesfinancesdestemples par la Couronne.
3. Le temps de l’intégration (de la xxxe dynastie à la période lagide)
Ce que nous nommons intégration est le contrôle direct des temples par des agents royaux 64. Dans cette perspective, la période lagide apparaît comme le point d’aboutissement d’un long processus qui a débuté avec les Saïtes. À la fin du iie siècle, les temples égyptiens furent en effet dirigés par des membres de l’administration ou de l’armée royale. Il serait cependant simpliste de voir en cela le fruit d’un processus continu d’évolution. Tout au contraire, le début de la période macédonienne montre le caractère précaire de la mainmise de l’autorité royale sur les temples.
3.1. La parenthèse des premières décennies macédoniennes
Les sources concernant la deuxième occupation perse sont rares. Elles témoignent de tensions 65 malgré des exemples d’entente entre l’autorité perse et certaines des élites égyptiennes 66. Étant donnée la très courte durée de cette période, il apparaît comme peu probable qu’ait pu se mettre en place une réforme profonde de l’administration du pays. Au contraire, on observe un maintien du personnel nommé par les Nectanébides. Le phénomène peut être illustré par l’exemple d’Hermopolis où Pétosiris succéda à son père qui, en tant que scribe royal comptable de toutes choses, avait été placé à la tête de divers temples par un roi de la XXXedynastie.Pétosirisprofitadesévénementspolitiquespourusurperdes prérogatives royales liées au culte et à l’entretien des sanctuaires. Son exemple montre donc qu’il y eut un coup d’arrêt, dû aux circonstances exceptionnelles liées à la conquête macédonienne, du mouvement de contrôle royal sur les temples. Pétosiris a succédé à son père et à son frère à la tête du temple d’Hermopolis. Dans la chapelle funéraire qu’il s’est faite construire, plusieurs inscriptions « biographiques » ont été gravées, relatant sa carrière et celle de ses parents 67.
64. capdetreY 2007, p. 217-218.
65. chauveau et thiers 2006.
66. huss 1997.
67. L’édition de référence est leFebvre 1924. La traduction présentée ici est quelque peu modifiée.
de l’autonomie à l’intégration 37
La différence majeure entre ces trois cursus réside dans l’importance des liens entretenus par ces différents personnages avec le souverain.
Nomination et carrière de Pétosiris (l. 25-29)« Il (= le dieu Thot) m’a choisi pour administrer son temple, car il savait que
sa crainte était dans mon cœur ; je passai sept ans comme lésônis de ce dieu, administrant ses biens, sans que fût trouvée de faute dans ma gestion, alors que le chef des Étrangers (ḥqȜ ḫȜswt) était en puissance sur l’Égypte et qu’il n’y avait plus rien qui ne fût en sa place des anciens jours. »
Aux lignes 33 à 46, c’est en tant que lésônis que Pétosiris remet en état le temple. En conclusion (l. 83-92), et après la récompense octroyée par Thot :
« Je fus l’objet des faveurs du chef (ḥqȜ) de l’Égypte et j’acquis l’amour de ses courtisans. »
Carrière de Sishou (père de Pétosiris) (l. 10-13)« (…) J’ai passé des années à administrer son temple, sans qu’on trouvât de
faute dans ma gestion de sorte que je fus l’objet des faveurs du roi (nswt), et j’acquis l’amour de (ma) ville. J’ai parlé avec le roi (nswt) seul à seul, je lui ai exposé mes pensées véritables, (12) sans dire de mensonges. Et voici ce qui m’arriva : c’est d’un anneau d’or qu’il me récompensa, (le titre de) supérieur de cette terre y était mentionné avec (le titre de) scribe royal comptable de tous les biens dans le temple d’Hermopolis selon les ordres de mon maître Thot. Délégué de sa majesté (ḥm) pour administrer le temple de Thot maître d’Hermopolis, faisant toutes les choses pour lesquelles sa majesté (ḥm) l’a envoyé. »
Carrière de Djedthotefanch (frère aîné et prédécesseur de Pétosiris) (l. 14-16)« Avisé pour conseiller sa ville, le grand de louange dans son nome, le grand
d’amour auprès de chacun ; choisi par le roi (nswt) de préférence à tous ses pairs pour administrer le temple de Thot seigneur d’Hermopolis (…) comme on faisait jadis, quand le roi (nswt) était (encore) dans le palais. »
Pétosiris s’octroie dans ses inscriptions une place normalement dévolue au seul pharaon 68, il entretient donc avec le pouvoir des relations différentes de celles de son père et de son frère. Cette attitude s’explique par la tradition familiale et les circonstances dans lesquelles il a exercé ses charges. Pétosiris est en effet issu d’une lignée qui doit sa fortune à sa proximité avec les souverains de la XXXe
68. leFebvre 1924, p. 45 et p. 139, « Pétosiris s’était fait représenter, sur la façade du tombeau, célébrant les rites et cérémonies qui, partout ailleurs et à toutes les époques, sont le privilège exclusif des rois, et (…) il n’hésitait pas à faire suivre son nom de l’épithète royale ‘vie, santé, force’ ». Pour devauchelle 1995, p. 78-79 : « Pétosiris s’arrogea des prérogatives royales auxquelles il n’avait pas droit et justifia cetteaction par un discours autobiographique insistant sur sa loyauté envers son dieu (…). Il faut remarquer les connaissances littéraires des rédacteurs des inscriptions qui, sur des thèmes bien connus des autobiographies et des sagesses égyptiennes, ontdéveloppéunimportantethabilediscourspourjustifieruneattitudeanormaledupoint de vue indigène ».
38 d. agut-labordère, g. gorre
dynastie. D’après l’inscription 138 et 102 (de Djedthotefanch) et celle 90 (de Sishou), son frère et son père avaient leurs entrées à la Cour. Sishou se présente comme un courtisan proche de son souverain (inscription 69, l. 10-12), que le roi récompense (inscription 69, l. 12-14) et honore (inscription 90, l. 2). C’est à lui que ces hommes doivent leurs postes. Sishou a reçu la direction du temple de Thot par ordre royal et Djedthotefanch a été par la suite avalisé comme successeur de son père. Toutefois, l’origine du pouvoir de Pétosiris diffère de celle de son père et de sonfrère.Cen’estpasleroiquileconfirmeàsonpostemaisledieu.Cetartificerhétorique s’explique très certainement par le fait que cette nomination a eu lieu pendant l’occupation perse. Il s’agissait pour Pétosiris, qui ne pouvait prétendre devoir son poste à un roi égyptien, de faire oublier les bons rapports qu’il avait pu entretenir avec l’autorité perse. Les liens de Sishou et de Djedthotefanch avec la XXXe dynastie expliquent la nostalgie de Pétosiris pour l’époque où « le roi étaitdanssonpalais».Maisilestdifficiledesavoircommentcetteattitudeapuêtre perçue par Ptolémée et son entourage. En effet, puisque Pétosiris accepte le satrape macédonien comme « Machthaber und Landesherr » 69 et qu’il entretient sans doute des contacts avec son entourage, il ne représente aucun danger pour la nouvelle autorité qui lui laisse une grande liberté d’action. Grâce à cette loyauté sur le plan strictement temporel, Pétosiris peut en toute impunité se faire représenter en train d’accomplir les actes rituels normalement réservés au pharaon.
Le cas de Pétosiris n’est pas isolé : son contemporain Téôs dit « Le Sauveur » est également au service exclusif de sa divinité et ne semble avoir entretenu que peu de liens avec le pouvoir. Ce personnage est connu par plusieurs statues élevées de son vivant et après sa mort 70. Ces monuments témoignent de sa popularité. Il est devenu un « saint » local, tout comme Pétosiris dont le tombeau faisait l’objet d’un pèlerinage. La renommée de ces deux hommes semble pouvoir s’expliquer par leur rôle de protecteur des temples et de leurs concitoyens lors des troubles causés par la succession des dominations perses et macédoniennes.
Téôs soustrait les offrandes aux appétits des Perses…(l. 130, dessus du socle) « (…) celui qui fait des offrandes au faucon et qui lutte
afinqu’ellessoientcachéesauxAsiatiques(…)»… reconnaît le pouvoir des Macédoniens…(l. 132, dessus du socle) « Que vive le dieu parfait, Seigneur des deux Terres
(cartoucheanépigraphe),filsdeRê,Philippe,vivantéternellement,aimédeHor-Khenty-Khety, Seigneur du nome athribite. »
… protège le temple de la soldatesque.(l. 24, devant du socle) « J’ai trouvé de nombreuses demeures de soldats à
l’intérieur de cette enceinte. J’ai indemnisé leurs propriétaires, il (leur) a donné en
69. rössler-köhler 1991, p. 291.
70. Statue et socle CGC 4634, jélinkova-reYmond 1956 ; statue Caire 4/6/9/1, vernus 1978, p. 193-195, n° 161 ; base de statue Chicago OIC 10589, sherman 1981, p. 82-102.
de l’autonomie à l’intégration 39
remboursement (en terrain, qui ont été situés) à l’Est du temple de Iat-Mat. Ils ont bâti (leurs) maisons à nouveau (de façon) encore plus manifeste que cela ne l’était auparavant. Je les ai fait démolir et je les ai fait emporter vers la rivière au sud du district Athribite. »
L’épisode de l’expulsion des soldats est révélateur des limites du pouvoir de Téôs circonscrit aux seuls temples de la ville d’Athribis. L’absence d’autorité royale ne lui laisse qu’une seule arme : la négociation. Il doit toutefois s’y reprendre à deux fois pour obtenir le départ des soldats. Le roi n’est toutefois pas absent des épigraphes liés à Téôs. On trouve en effet de nombreuses références à sa personne soit directement, en le nommant, soit indirectement en précisant que des travaux ont été réalisés en son nom. La titulature de Philippe Arrhidée apparaît à deux reprises dans les inscriptions de la statue du Caire qui fut érigée dans le temple, c’est-à-dire celle destinée à avoir la plus grande publicité. Les cartouches y ont été gravés à l’endroit le plus visible, autour du petit bassin qui recueillait l’eau lustrale. Toutefois, la titulature royale est incomplète 71. De fait, l’élaboration d’un protocole royal pour Philippe Arrhidée n’a pas abouti à un résultat uniforme : le nom de couronnement en usage à Thèbes est différent de celui qui est attesté dans le reste du pays 72.
PétosirisetTéôsillustrentlapériode«d’entredeux»quicaractériselafindu ive siècle. Leur attitude s’explique par l’absence d’une politique générale des Macédoniens envers les élites égyptiennes et les institutions qui les représentent, les temples. Le seul document connu à ce sujet est la Stèle du satrape 73, souvent considérée comme la preuve de l’intérêt du premier Ptolémée pour les temples. Son analyse montre, en réalité, le caractère purement conjoncturel de l’intervention du pouvoir royal qui y est rapportée. Le monument se présente sous une forme très classique de décret sacerdotal avec, pourtant, une particularité majeure : dans la scène cultuelle, présente sur le cintre de la stèle, le souverain n’est pas nommé, les cartouches étant vides. Ce roi anonyme devrait être Alexandre IV qui n’est évoqué qu’une fois dans la date (311). L’acteur principal du récit est en fait Ptolémée satrape. Après la narration d’expéditions militaires se trouve rapporté un échange entre le pharaon Khababash, qui tenta entre 338 et 336 de redonner son indépendance à l’Égypte, et les prêtres du temple de Bouto dans le Delta occidental.
« Le domaine bordant le lac, qu’on appelle Patanout, le roi Khababash en a fait don aux divinités de Bouto, lorsque sa majesté [désignation du seul Khababash par opposition au satrape Ptolémée] se rendit à Bouto pour visiter la région bordant le
71. jélinkova-reYmond 1956, p.66, note 2, affirme que ces cartouches vides sontl’indice que la statue a été terminée au tout début du règne de Philippe Arrhidée.
72. de meulenaere 1994, p. 54.
73. En dernier lieu, schäFer 2011.
40 d. agut-labordère, g. gorre
lac, qui se trouvait comprise dans son domaine, pour pénétrer dans les marécages et apprendreàconnaîtretouslesbrasduNilquidébouchentdanslamer,afinquelaflotteasiatiquefuttenueàl’écartdel’Égypte.
Alors sa majesté dit :Qu’on me fasse connaître ce domaine bordant le lac.Et ils [= les prêtres de Bouto] parlèrent ainsi devant sa majesté :Le domaine bordant le lac (qu’on appelle Patanout) était de temps immémorial
la propriété des divinités de Bouto. Mais l’ennemi Xerxès changea l’état des choses.Alors sa majesté dit :Que l’on m’amène les prêtres et les magistrats de Bouto.Et on les lui présenta en toute diligence. Alors sa majesté dit :Je veux savoir quelle importance ont ces divinités, et ce qu’elles ont fait à
l’ennemi héréditaire, en retour de l’attentat qu’il avait commis contre elles, car on dit que l’ennemi Xerxès avait fait tort à Bouto.
Ils répondirent à sa majesté :Le roi notre maître, Horus, le roi d’Égypte, a expulsé le sacrilège Xerxès de son
palaisavecsonfilsaîné.»Instruit par ce récit, Ptolémée satrape s’empressa de restituer les terres.
Sa générosité connaissait les mêmes motivations que celles de Khababash : il s’agissait de s’assurer le contrôle militaire du centre du Delta pour se protéger d’une invasion par la mer, de la part des Achéménides pour Khababash, ou des Antigonides pour Ptolémée. Bouto, la plus importante localité à proximité de la mer de la branche sébennytique, était en effet un site stratégique. Toutefois, du fait même de son isolement, ce document ne saurait être tenu pour le témoignage d’une politique générale envers les temples de la part du satrape Ptolémée. Cependant le discours des prêtres à son égard témoigne des dispositions favorables au nouveau pouvoir de la part du clergé de cette ville. Les prêtres indiquent tout d’abord que laconfirmationdeleursprivilèges,notammentceuxliésauxdonationsdeterresest le préalable nécessaire à l’établissement de bonnes relations avec la Couronne. D’autre part, l’évocation de la figure deXerxèsmontre que le clergé égyptienavait compris, au moins en partie, le cadre de représentation helléno-macédonien. En effet, si Xerxès est l’incarnation du « mauvais » Grand Roi pour les Grecs, il n’en est pas de même pour les Égyptiens où ce rôle serait, a priori, tenu par Cambyse. L’évocation de Xerxès permet de grandir Ptolémée en l’inscrivant dans lecontextede la lutteséculairecontre lesPerses. Ilestdifficiledediresices bonnes dispositions ont été perçues par les Grecs. Quoi qu’il en soit, l’aide matérielle des temples par le roi en échange d’un soutien actif du clergé à la dynastie constitua le fondement des relations du clergé égyptien et de la couronne lagide. Si leurs prémices apparaissent avec la stèle du satrape, ces relations ne sont institutionnellement formalisées qu’au cours du règne de Ptolémée II (282-256).
de l’autonomie à l’intégration 41
3.2. La mise en place d’une tutelle royale sur les temples au iiie siècle
Pendant toute l’époque ptolémaïque, une même famille, connue par une documentation riche et continue 74, contrôle la charge de Grand-prêtre de Ptah. En deux générations, elle acquit des prérogatives qui la placent à la tête de l’ensemble destemplesetdesclergésdupays.Ellelesconserverajusqu’àlafindel’époquelagide.
Inscription du premier Grand-Prêtre de Ptah, Ésisout-Pétobastis 75 (l. 10-14)« Il n’a pas été trouvé de faute dans ma fonction quand je dirigeais les travaux
dans le temple de Ptah pendant 23 ans en tant qu’élu par le roi lui-même avec ses courtisans.
Monmaîtreme favorisadenouveau, ilfitdemoi […] leGrandgouverneurdans Memphis.
Mon maître me favorisa de nouveau, il me chargea d’être prophète de la sœur duroi,delafilleduroiPhilotéra.
Mon maître me favorisa de nouveau en me donnant son sceau pour la grande fonctiondeprophètedelafillederoi,sœurderoi,épousederoi,filled’Amon-Rê,la maîtresse des Deux-Terres Arsinoé, la déesse Philadelphe, l’Isis la mère d’Apis.
IlfitdemoilesupérieurdessecretsdansledomainedePtahentantqu’éludeceuxquisontdansMemphis;monmaîtrefitdemoi,auparavant,lesupérieurdessecrets dans Rout-Isout.
Monmaîtremefavorisadenouveau,ilfitdemoileGrand-des-artisansdansledomaine de la maîtresse du sycomore.
Je fus favorisé par le roi, il transmit ma fonction à mes successeurs après moi. »L’origine et la nature du pouvoir d’Ésisout-Pétobastis apparaît très
clairement dans le texte. C’est au souverain qu’il doit l’accroissement progressif de ses responsabilités dans le temple. Les inscriptions permettent de retracer la carrière du personnage et d’établir ainsi l’origine et la nature de son pouvoir. Le texte indique la chronologie des évènements, chaque séquence commençant par la formule « mon maître me favorisa de nouveau ». Le premier champ de responsabilité est la gestion du temporel des temples de Memphis. Au début du passage relatant son ascension, à la ligne 11, apparaît, après une lacune, le titre de Grand gouverneur. Le fait qu’Ésisout-Pétobastis ait occupé cette fonction explique le rôle qu’il joua dans la supervision des travaux de construction et de restauration. À cette première mission se greffe un second ensemble de fonctions, cultuelles celles-là. Ésisout-Pétobastis est en effet prophète de Philotéra, fonction
74. maYstre 1992 ; reYmond 1981 avec le compte-rendu de devauchelle 1983, p. 137-138 ; une étude des sources relatives aux grand-prêtres de Ptah sur la base de nouvelles photographies est actuellement en préparation par Maxim Panov (Novosibirsk).
75. Stèle BM 379, reYmond 1981, p. 60-70 et p. 112-115, et devauchelle 1983, p. 137-138.
42 d. agut-labordère, g. gorre
suivie de celle de prophète de la déesse Philadelphe.Après lui avoir confié laresponsabilité du culte dynastique, le roi conforte sa position en faisant de lui un directeur des secrets.Enfin,Ésisout-PétobastisdevientGrand Prêtre de Ptah. Cettecharge,mentionnéeàlafindel’énumération,constituelecouronnementdesa carrière. À ce titre, il est responsable de l’installation du culte dynastique qui estàl’originedel’intensificationdesrelationsentrelesPtoléméesetlepersonneldes temples.
Ces diverses fonctions ne semblent pas être directement héréditaires : il est en effet précisé que ce sont les rois qui en ont assuré la transmission aux descendants d’Ésisout pendant près de trois siècles. Les inscriptions de ses deux premiers successeurs,sonfilsAnnôsetsonpetit-filsTéôs,permettentdecompléterletableaudes compétences des Grands prêtres de Ptah. Annôs porte une série de titres de scribe comptable royalquifontdeluileresponsablefinancierduculted’ArsinoéII.À la différence de son père, il apparaît donc lié à l’administration de l’apomoira, la taxesurlesvignesetvergersreverséeauxtemplespourlefinancementdececulteroyal. À cette fonction s’ajoute celle de Directeur des prophètes de tous les dieux et déesses de Haute et Basse Égypte. Avec la réapparition de cet ancien titre apparu lapremièrefoisauNouvel-Empire,sonautorités’étenddoncofficiellementsurl’ensemble des clergés du pays dans un contexte général de reprise en main des temples par la Couronne. Le fils d’Annôs, Téôs, développe encore, dans soninscription funéraire 76, les responsabilités incombant à un Grand-prêtre de Ptah (l. 4-8) :
[Il est] « celui qui conduit tous ceux qui entrent vers le saint des saints (…) il entre dans la maison du roi à (toutes) ses fêtes devant tous les prêtres et tous les prophètes des temples de Haute et de Basse-Égypte. Il est le premier à être convoqué (par le roi) parmi ses grands dignitaires d’Égypte. »
Téôs est donc responsable de l’intronisation des prêtres qui accèdent à la statue divine. Le titre de Directeur des prophètes de tous les dieux et déesses attesté depuis son père indique que cette autorité s’étend sur l’ensemble des temples égyptiens. Le Grand Prêtre de Ptah supervise la nomination de l’ensemble des prophètes du pays quoique ce rôle revienne en réalité au responsable local du temple comme en témoignent les inscriptions d’un Grand prêtre de Tanis, dans le Delta 77. La proximité du Grand Prêtre de Ptah avec le roi est mentionnée à deux reprises dans les inscriptions. Lors des fêtes religieuses lorsqu’il est convoqué par le souverain, Téôs a la prééminence sur les autres membres du clergé et sur les autres « grands dignitaires d’Égypte ». Ces derniers désignent des Égyptiens qui ont autorité sur les temples. Téôs, comme son grand-père Esisout-Pétobastis, n’est toutefois pas un ami du roi, un philos, membre du groupe constitué par l’entourage gréco-macédonien qui contrôle l’administration et l’armée. Quoiqu’il en soit, le
76. Stèle Vienne 154, reYmond 1981, p. 87-91, et devauchelle 1983, p. 138.
77. gorre 2009, p. 406-407.
de l’autonomie à l’intégration 43
dossier constitué autour de la famille des Grands prêtres de Ptah montre que, pour la première fois dans l’histoire égyptienne, les clergés locaux étaient placés sous l’autorité d’un responsable religieux unique tant sur le plan des nominations que sur celui des crédits alloués.
Localement, l’utilisation de membres du clergé pour assurer un contrôle royal sur les temples se voit illustrée par une famille thébaine dont l’activité est attestée sur deux générations. Le père, Smendès, est connu par une inscription qui témoigne de son élection par le roi. Il est en effet celui que
« le roi a distingué au-dessus de ses hommes, celui que Sa Majesté elle-même a choisi parmi les habitants de Thèbes. » 78
D’après les titres attribués à son père, Smendès est issu d’une lignée de prêtres de rang subalterne tant d’un point de vue cultuel qu’administratif. Le fait d’être « choisi » par le roi n’a pas de conséquence sur sa position sur le plan religieux. En revanche, il devient le deuxième administrateur du sanctuaire et se voit intégré dans le collège des « Anciens » qui gouverne le temple 79. Smendès n’est pas le seul exemple de l’élévation par la volonté royale de personnages secondaires qui se trouvent ainsi propulsés aux plus hautes instances, au détriment des grandes famillessacerdotalesenplace.Lacarrièred’Amasis,filsdeSmendès,estconnuegrâce à l’inscription particulièrement développée de sa statue, dont nous donnons ici uniquement la traduction des passages biographiques (les autres colonnes sont consacrées à ses très nombreux titres) 80.
« (4) Il dit : “Je suis allé à la Résidence, j’ai navigué en remontant le courant vers Hermopolis, en emportant un ordre royal avec moi. J’ai détruit le (mauvais) travail de leurs prophètes et de leurs prêtres 81. J’ai fait du bien à leurs citoyens. J’ai été récompensé de tout cela par Tatenen et Thot, ils ont fait que j’atteigne Thèbes en tant que bienheureux (…)”
(7) Il dit : “J’ai inscrit le portail de Chonsou dans Thèbes [la porte de Ptolémée III] (…) j’ai accru sa renommée. J’ai gravé les parois de son parvis, il m’a récompensé en prolongeant ma durée de vie dans l’état de bienheureux.” »
La composition des inscriptions met en valeur la colonne centrale (4) qui rapporte le fait le plus marquant de la carrière d’Amasis : le Thébain s’est rendu à la « Résidence (royale) » qui, à l’époque de Ptolémée III, ne pouvait être situé qu’à Alexandrie. Il y reçut directement un ordre du souverain. Amasis a tenu à placer cet épisode au cœur de son inscription funéraire vraisemblablement
78. Quaegebeur 1995, p. 147-150.
79. de cénival 1972, p. 153.
80. Caire JE 37075, Fairman 1934, p. 1-4.
81. Parmi ces derniers pourraient se trouver des descendants de Pétosiris. Pour leFebvre 1924,p.12:«lepetit-filsdePétosiris,Pétoukem(filsdeTéôs),acertainementconnule règne de Ptolémée III Évergète ».
44 d. agut-labordère, g. gorre
pour commémorer sa distinction et son élévation par le pouvoir royal. Le lieu et la teneur de sa mission apparaissent dans l’inscription : il s’agit de remettre au pas le clergé hermopolitain. Cette mission explique le titre de Gouverneur des temples du nome du Lièvre 82, qui lui donne toute autorité sur l’ensemble des temples hermopolitains. Est-il possible de reconstituer la chronologie de la carrière d’Amasis ? Une lecture continue de l’inscription indiquerait que l’épisode hermopolitain est à placer avant la direction du chantier de la porte d’Évergète à Karnak. Cependant, trois éléments incitent à situer cette direction avant la remise en ordre des temples d’Hermopolis. La composition des inscriptions est rarement chronologique, à moins que cela soit explicite comme chez le Grand Prêtre de Ptah. Toutefois, l’habileté à diriger un chantier est très souvent l’occasion pour le personnel religieux de se faire remarquer par le pouvoir. En résumé, les exemples d’Amasis et de son père Smendès témoignent du choix fait par la couronne de prêtres appartenant à un rang secondaire de la hiérarchie religieuse pour devenir les représentants des intérêts royaux dans les temples sans, comme à l’époque saïte, passer par l’entremise d’un haut administrateur royal implanté localement. Le cas d’Amasis montre de surcroît qu’un prêtre pouvait être employé aussi bien dans son sanctuaire d’origine que dans un temple qui est lui était complètement étranger.Pourautant,ceshommesnepeuventêtreidentifiésàdesagentsroyaux.Ilsneportentaucuntitreéquivalentàuntitregrecetnesontfinalementquelesreprésentants de la couronne à l’intérieur des temples.
3.3. La fin du processus : l’administration des temples est directement subordonnée à celle du roi (iie siècle)
La subordination de l’administration des temples à celle du roi apparaît, pour la première moitié du iie siècle, dans le dossier lié au fonctionnement des temples memphites. Ce dernier est constitué par une documentation tant égyptienne que grecque trouvée, pour l’essentiel, au cours des fouilles dans la zone du Sérapéum aux xixe et xxe siècles. Il s’agit du seul ensemble documentaire illustrant le versement des revenus alloués par la Couronne au personnel du temple. Un des agents en charge de cette opération était un certain Achomarrès 83. L’intérêt de ce personnage est double. Tout d’abord, il a la particularité de se présenter aussi bien comme un prêtre ayant rang de Prophète que comme un agent de la Couronne chargé du versement de la syntaxis (revenus versés par la couronne pour l’entretien des prêtres et les offrandes aux dieux) (UPZ I, 42.23-24). Son exemple permet ainsid’affirmerquelepersonnelcontrôlantlesfinancesdestemplesestlui-même
82. C’est-à-dire le XVe nome de Haute-Égypte, l’Hermopolite, selon la géographie religieuse qui ne correspond que partiellement avec la réalité du découpage administratif civil.
83. gorre 2009, p. 245-248, n° 49.
Localement, les agents du roi tiennent les finances des temples.
de l’autonomie à l’intégration 45
issu du clergé 84. Mais Achomarrès est aussi un membre de l’administration royale chargé de surveiller les temples dont les supérieurs ne sont pas des prêtres. Ces hommes qui portent le titre de prostatès (« agent du roi ») sont les représentants du pouvoir royal 85. Ainsi, prennent-ils directement leurs ordres auprès de l’administrationroyaledesfinances.Entantquetels,ilssontsupérieursaupersonneldu temple exerçant la fonction de lésônis, épistate ou économe (Achomarrès cumule ces trois fonctions). Cette hiérarchie se retrouve, notamment, dans le décret de Canope.
Parallèlement à cela, c’est – toujours – au cours du iie siècle que l’on repère un phénomène très net d’absorption du personnel des temples par l’administration. Il revêt deux aspects qui peuvent paraître, à première vue, contradictoires. On observe en effet simultanément un détachement des prêtres quittant le service des dieux pour passer à celui de la Couronne et l’arrivée d’administrateurs royaux à un niveau très élevé dans les temples. Le passage du service des temples à celui de l’administration royale peut être illustré par une famille thébaine 86 connue par un dossier postérieur au iiie siècle 87. L’évolution des charges exercées par ses membres sur trois générations est la suivante :
pachnoumis
prêtre d’Amon 88
scribe royal comptable d’Amonpatous
prêtre d’Amonscribe royal du district de Thèbes
phibis
prêtre (?)scribe royal du district de Thèbes, scribe royal du district de Memphis
Cette lignée de scribes comptables connaît une double évolution dans l’exercice de ses fonctions. Elle passe ainsi du service du trésor d’Amon de Thèbes à celui de l’administration territoriale royale. Phibis est rattaché par ses titresàThèbesetàMemphis.Ilestdifficiled’imaginerqu’ilaitexercécesdeuxcharges en même temps. Étant d’origine thébaine et le district de Memphis étant plus important que celui de Thèbes, on peut en conclure logiquement qu’il fut
84. Plus généralement, l’existence même de la syntaxis est analysée comme un signe de la soumission des temples à la Couronne, manning 2003, p. 237, et manning 2009, p. 128.
85. de cenival 1972, p. 166.
86. Caire JE 37456 et JE 38004, de meulenaere, 1997.
87. de meulenaere 1997, p. 21.
88. D’après l’iconographie de la statue.
46 d. agut-labordère, g. gorre
en poste d’abord à Thèbes puis à Memphis, ce qui correspond à la promotion évoquée dans l’inscription de sa statue : « J’ai été promu sur ordre du roi de Haute et Basse-Égypte. » En passant au service de la Couronne, ces scribes du temple d’Amon se détachaient de leur institution d’origine : ils étaient en quelque sorte « sécularisés ». Ce phénomène a été mis en valeur par H. de Meulenaere qui note que « les liens qui unissent la famille (aux cultes thébains) paraissent assez faibles. Si lui-même évoque le “roi des dieux” dans le seul titre dont il (= le dédicataire de lastatueétudiée)se réclame,sonfilset sonpetit-fils (sur leursmonuments)l’omettent entièrement, tout en lui adressant une prière dans laquelle il semble le remercier pour un bienfait qui leur est arrivé par ordre royal. On n’échappe pas à l’impression qu’ils ont obtenu une promotion qui les a détachés du temporel d’Amon pour les transférer à l’administration civile. » 89 Ce passage du service des dieux à celui du roi pour faire carrière se retrouve dans d’autres familles 90.
Ce mouvement pouvait aussi se faire dans l’autre sens : le service de la Couronne donnait également la possibilité d’acquérir des charges importantes dans les temples. Comme nous l’avons observé dans la première partie de ce travail, servir le roi est une source de prestige et de pouvoir. Dans la mesure où les notables locaux étaient intégrés au(x) temple(s), un agent royal pouvait trouver une place dans une institution religieuse située dans une localité différente de celle dont il est issu. Toutefois cette place est bien plus importante que celle occupée à l’origine. Le statut d’agent royal est un facteur de promotion au sein de la hiérarchie sacerdotale. Ce phénomène peut être étudié à travers les exemples de Téôs et Oteuris 91. Bien que leurs titres indiquent une activité dans le Delta, ces deux scribes sont originaires de Memphis. Le père de Téôs fut prophète de Thot à Saqqara. Oteuris porte deux titres de scribe qui le rattachent à Ptah et le nom théonyme de son père, formé à partir d’Apis, indique une origine memphite. Issus d’un milieu sacerdotal modeste, Téôs et Oteuris ont connu une promotion en s’installant dans le Delta où ils occupaient des places importantes en tant que scribes territoriaux, attachés à l’armée dans le cas de Téôs (scribe de l’armée dans le district de Sébennytos)etauxfinancesdansceluid’Oteuris(scribe royal comptable des districts de Bousiris et Mostai). Ces fonctions séculières sont à relier aux prébendes dont ils disposaient au sein de temples locaux 92. En effet,
89. de meulenaere, 1997, p. 22.
90. gorre 2009, p. 586-599.
91. gorre 2009, p. 258-262, n° 52 et 53.
92. En parallèle aux exemples de Téôs et Oteuris, se constitue, à l’époque ptolémaïque, un groupe de scribes royaux d’origine égyptienne dont la fonction principale est d’être au service de la couronne. Leurs éventuelles charges dans les temples sont sans liens directs avec leurs charges civiles. Voir l’exemple du dioicète d’origine égyptienne Dioscouridès qui est aussi prophète d’un culte égyptien, gorre 2007, p. 239-250, et gorre 2009, p. 598-600 ; pour le cas d’un autre dioicète, voir klotz
de l’autonomie à l’intégration 47
l’ensemble des titres religieux qu’ils portent sont situés au sein de leur district administratif et les cultes desservis n’ont aucun lien avec les prêtrises exercées par leurs parents. Seul le passage au service de la couronne peut leur avoir permis de faire carrière dans les temples où ils occupaient des fonctions beaucoup plus prestigieuses que celle de leurs pères.
Le double mouvement de transfert du personnel des temples vers le service de la Couronne et vice versa (et cela indépendamment de ses origines) 93 fait, qu’au cours du iie siècle, le personnel religieux et les agents royaux sont de plus en plus imbriqués. La difficulté d’établir une frontière nette entre les deux sphères semanifesteclairementàlafinduiie siècle avec l’apparition d’un nouveau type de monument élevé dans les temples. Il s’agit de statue dont l’appellation anglaise de «stridingdrapedmalefigure»94 s’est imposée. La statuaire des prêtres égyptiens répond à des impératifs bien précis reflétant les prescriptions rituelles. Cetteiconographie connaît donc une très grande continuité en Égypte, d’autant plus que depuis la période saïte (vie siècle) s’est développé un goût pour l’archaïsme qui acontribuéàfigerl’imageduprêtre.Or,àpartirde125,cetteimagedesprêtresou, plus précisément, celle des dirigeants des temples, change complètement avec l’apparition d’un nouveau genre de statue. Nous proposons de comparer ce nouveautypeaveclemodèletraditionneletdevoirqueltypedemodificationdel’identité des dirigeants des sanctuaires implique cette transformation. Pour cela, deux exemples peuvent être pris : la statue du prêtre thébain Amasis, contemporain de Ptolémée III déjà évoqué, et celle d’un dénommé Hôros 95. Ces deux monuments diffèrent sur plusieurs points : le vêtement, l’aspect physique, la disposition des inscriptions. Commençons par Amasis.
Le vêtement : Amasis est vêtu du pagne traditionnel des responsables du culte. C’est à l’origine celui qui est porté par le pharaon dont les prêtres se ceignaient à leur tour en tant que délégué du souverain dans les temples. Une autre tenue est possible pour les prêtres égyptiens : une tunique-fourreau nouée sous les pectoraux.
2009,p.281-310.Ladifficultédel’étudedetelspersonnagesrésidedanslaréunionde leurs deux identités (religieuse et séculière).
93. Cela est également vrai pour le stratège grec Hérodès en poste à Syène et qui est introduit par le clergé local dans le temple de Philae, gorre 2009, p. 5-9, n° 1 ; pFeiFFer 2011.
94. Le « père » de cette dénomination est r. Bianchi (bianchi 1976 ; 1978 ; 1992). Voir également kaiser 1999.
95. CGC 697, voir en dernier lieu la description de corteggiani 1998, p. 173 ; pour l’inscription et son interprétation voir jansen-Winkeln 1998, p. 227-235 et particulièrement p. 234-235 (sur la situation économique du temple favorisé par Hôros).
48 d. agut-labordère, g. gorre
L’aspect physique : Amasis a le crâne rasé conformément à l’une des obligations de pureté physique suivies par les prêtres égyptiens 96. En fait, tout le corps doit être rasé ou épilé, toute pilosité étant considérée comme impure et interdisant de se tenir face aux dieux.
Les inscriptions : la statue est littéralement couverte d’écriture. La principale d’entre elles est celle du dos du pilier dorsal. Celles situées sur les côtés de la statue la résument. Ce n’est pas le cas ici, mais, souvent, l’inscription du pilier dorsal est répétée sur les côtés et le devant de la base de la statue : ce type de monument étant usuellement adossé à un pilier ou à un mur il faut que l’inscription soit lisible de tous. Les différences entre la statue d’Amasis et d’Hôros apparaissent au premier regard. Leur seul point commun évident est la posture, celle de la marche, qui a pour intérêt d’assurer la stabilité du monument.
Le vêtement : le vêtement d’Hôros est composite. Il y a d’une part une tunique à manche courte et une jupe (peu visible ici). Ces deux vêtements peuvent être rattachésàdeshabitségyptienstraditionnelsmaisnonspécifiquesauxprêtres.
Le dernier élément de cette tenue est, lui, étranger à la tradition égyptienne : il s’agitduchâlefrangéportésurl’épaulegauche.Cetypedevêtementestidentifiéaugtn connu par plusieurs textes. Pour W. Clarysse, ce terme gtn est apparenté au grec chitôn. Il ne s’agit pas pour autant d’un emprunt de l’égyptien au grec, mais le mot dans ces deux langues dérive d’un même vocable d’origine sémitique 97. Il s’agirait donc d’un type de vêtement perse, adopté par les Égyptiens au cours de l’époque ptolémaïque. Une de ses plus anciennes illustrations se trouve dans le tombeau de Pétosiris où les scribes qui « dirigent les travaux » portent un tel châle 98. Il s’agirait donc là d’un symbole de l’exercice d’une autorité.
L’aspect physique : Hôros arbore une chevelure bouclée. Celle-ci ne peut être confondue avec les perruques que les prêtres égyptiens portent comme le montre un début de calvitie visible au niveau des péninsules. Il s’agit donc d’une chevelure naturelle totalement contraire aux règles de pureté rituelle mentionnées précédemment. Si ce portrait d’Hôros reflète une influence grecque99, on peut s’interroger sur le respect d’une autre règle de pureté, celle de la circoncision fortement critiquée dans la culture hellénistique comme en témoigne le deuxième livre des Macchabées.
Un dernier élément s’éloigne des pratiques rituelles égyptiennes : le port même du gtn/chitôn. Le plissé épais de ce dernier semble indiquer qu’il est en laine. Or,
96. Ces conditions de pureté rituelle sont connues par des sources éparses avant l’époque ptolémaïque. À l’époque romaine, elles font l’objet d’une recension minutieuse en vue de contrôler l’accès aux sacerdoces, colin 2002, p. 41-122.
97. clarYsse 1987, p. 11.
98. leFebvre 1924, t. III, pl. VIII.
99. Pour certains auteurs, comme kaiser 1999, les faces de ce type de statue seraient influencéesparl’artduportraitromain.
de l’autonomie à l’intégration 49
les prêtres égyptiens avaient interdiction d’être en contact avec tout produit animal sous peine de souillure.
L’iconographie de la statue de Hôros est donc totalement étrangère à celle d’Amasis.Cetteévolutionreflètetrèsprobablementcelledel’identitédupersonnelqui se trouvait à la tête des sanctuaires. Ce changement d’identité est aussi perceptible dans les attributs des personnages représentés : le gtn/chitôn d’une part et, d’autre part, le bandeau qui, même si ce n’est pas le cas pour Hôros, enserre très souvent la tête des personnages. Ces deux emblèmes sont connus par les textes et sont ceux des plus importants des agents de la Couronne. Le bandeau, mitra en grec, est l’élément le mieux documenté. Il apparaît dans l’inscription funéraire grecque d’un certain Apollônios, résidant à Apollinopolis Magna, moderne Edfou, mortàl’extrêmefinduiie siècle :
«Je suisApollônios, le fils de l’illustre Ptolémaios, celui que les Évergètesont illustré du bandeau, honneur sacré de la gloire des parents du Roi ; (son) dévouement en effet, l’a conduit à l’intérieur des terres jusqu’à leur extrémité et jusqu’à l’Océan 100. »
Le bandeau apparaît ici comme l’emblème des « parents du roi », syngéneis, c’est à dire de ceux qui appartiennent à la classe la plus élevée de la hiérarchie aulique. Ptolémaios, le père d’Apollônios, est par ailleurs connu comme étant un des principaux prêtres et administrateurs du sanctuaire d’Edfou. L’inscription grecque montre cependant clairement que c’est à ses fonctions dans l’armée qu’il doit sa qualité de syngénès. Ce type de récompense est connu uniquement à l’époque lagide et atteste l’existence d’une relation entre le souverain et la personne qui la reçoit. Le gtn/chitôn est moins présent dans les textes. Cependant, le lien, certes non systématique comme le montre l’exemple d’Hôros, qui existe entre le bandeau et le chitôn apparaît dans le P. Claude 2, étudié par M. Chauveau, dans lequel ces deuxélémentsfontpartiedelarécompenseoctroyéeàlafind’unecampagne101. On ignore si le personnage du papyrus est lié par ailleurs aux temples, mais le contexte dans lequel il reçoit ces récompenses est clairement civil et non pas religieux. Ainsi, touttendàprouverqueles«stridingdrapedmalefigures»représententdeshommesqui sont des agents du roi avant d’être des prêtres, quelle que soit la place occupée par eux dans les institutions religieuses auxquelles ils étaient rattachés. Un dernier élément permet de mettre en valeur la préséance de la qualité d’agent royal sur celle deprêtre:lesinscriptionsdesstatues.Surles«stridingdrapedmalefigures»,ellessont réduites et se cantonnent exclusivement au pilier dorsal de la statue. Plusieurs de ces monuments sont anépigraphes tout en étant apparemment achevés. D’un point de vue égyptien, c’est incompréhensible : un monument anépigraphe n’ayant aucun
100. CGC 9205, clarYsse 1989, p. 84-88.
101. chauveau 2002, p. 53 : « le stratège en personne, chef de l’expédition militaire, a remis un chitôn royal et une couronne d’or à un certain Hôros [distinct du personnage représenté par la statue CGC 697] ».
50 d. agut-labordère, g. gorre
intérêt puisque ce sont les inscriptions qui permettent justement de « personnaliser » le monument. Lorsqu’elles existent, les inscriptions du pilier dorsal sont d’une facture relativement classique. Le personnage représenté apparaît bien comme un prêtre si ce n’est que les charges religieuses occupent une place réduite (elles concernent en général un tiers des titres présents) face aux titres auliques, militaires et civils (chez Amasis la proportion était 5/7 pour les titres religieux et 2/7 en relation avec la Couronne). La structure générale de ces inscriptions est la suivante :
– Mention du lien avec le roi, mélangeant la phraséologie pharaonique traditionnelle et la transcription phonétique ou la traduction de titres civils, militaires, auliques grecs.
– Énumération des districts territoriaux sous l’autorité du personnage et de la naturedesonautorité:militaireetfinancièreleplussouvent.
– Liste de prêtrises réparties dans l’ensemble des sanctuaires des districts précités.
Cette inscription n’était toutefois pas destinée à recevoir une grande publicité. Le personnel capable de lire les hiéroglyphes devenait rare et, surtout, le monument étant le plus souvent accolé à un mur, le texte n’était en réalité lisible que par les dieux. Il existe un deuxième type d’inscription. Il s’agit de pancartes, plaques de pierre inscrites et encastrées sur le devant du socle. Plusieurs exemples de ces documents sont connus 102. L’inscription est alors en démotique et/ou en grec. Or, dans ces inscriptions, lisibles par toutes personnes passant devant la statue, ce sont quasiment exclusivement les titres royaux qui sont mentionnés. Ainsi, à partir de 125, les prêtres expriment dans les monuments censés rendre témoignage de leur vie de leur qualité d’hommes du roi 103.
Conclusion
Àlafindecettelonguehistoired’unpeuplusdecinqsiècles,laphysionomiepolitique de l’Égypte s’est très profondément transformée. Au iie siècle, le processus d’intégration des temples à la couronne est achevé : ces derniers sont passés sous le contrôle d’agents du roi 104. La période perse constitue le tournant de cette évolution avec, d’abord, une remise en question générale des donations royales mais aussi – et surtout – par la supervision par le pouvoir royal de la nomination des lésônis. Il ne faudrait pas voir dans cette politique une des inventions du pouvoir achéménide. En
102. gorre 2009, p. 35-41, n° 9 et 10.
103. gorre 2009, p. 535-540. Sur la prépondérance du représentant de la couronne sur le prêtre, moYer 2011.
104. capdetreY 2007, p. 217 : « Les cités sujettes n’étaient pas contrôlées directement par des agents royaux. C’était en revanche le cas de certaines cités que nous nommerons les citées intégrées ».
de l’autonomie à l’intégration 51
effet, la politique de contrôle des biens des temples avait été préparée par les Saïtes à travers la mise en place d’une administration d’encadrement sophistiquée et c’est aveclesNectanébidesquedesagentsroyauxfirentpourlapremièrefoisleurentréedans l’administration des sanctuaires. Il est, dans ce cas, parfaitement inopérant d’opposer les Perses impies aux Égyptiens attachés à leurs traditions. Du fait du droit de la lance, les pharaons venus d’Iran ont eu simplement une plus grande latitude que leurs homologues égyptiens pour briser l’autonomie des temples. Comme nousl’avonsvu,l’indépendanceretrouvéeàlatoutefinduve siècle ne constitue en rien un retour à l’équilibre institutionnel antérieur. La preuve en est la Chronique démotique où les rois impies châtiés par les dieux sont exclusivement membres des dynasties locales. Au fond, ce n’est qu’avec l’arrivée des Macédoniens que l’étreinte royale semble s’être relâchée l’espace de quelques décennies, pour reprendre de plus belle ensuite. Les Ptolémées ont en effet utilisé les mêmes méthodes que les pharaons perses et égyptiens : faire entrer un peu plus des agents royaux dans les temples en jouant sur le besoin qu’avaient les communautés locales d’avoir des protecteurs dans l’administration royale, imposer un contrôle économique accru, ici, grâce au versement du produit d’un impôt dévolu aux sanctuaires en rétribution de l’organisation du culte royal. Mais la grande innovation lagide est ailleurs. Elle réside dans le « chapeautage » de l’ensemble des temples par les Grands Prêtres de Ptah. C’est cette mesure qui, croyons-nous, couronne l’ensemble du mouvement ; il s’agit ni plus, ni moins que de la création d’une administration royale des temples où les prêtres rémunérés par le roi étaient intégrés à une administration couvrant l’ensemble du territoire égyptien. Du point de vue de l’histoire institutionnelle de l’Égypte ancienne, il s’agissait là d’une véritable révolution qui fut rendue possible par la remise en question de l’inaliénabilité des donations royales par les Perses, protection liée à l’autonomie institutionnelle dont jouissaient les temples face à la Couronne. L’équilibre était dès lors définitivement rompu. Il ne restait plus auxLagides qu’à achever le travail et à faire des temples des instruments entre les mains du roi 105. Cela aboutit à transformer de manière tout à fait fondamentale l’État pharaonique. L’intégration des temples à l’administration royale mettait définitivementfinàlastructurepolitiquedualeauseindelaquellelestemplesetlamonarchie étaient jusque-là très étroitement associés.
Damien agut-labordère CNRS / ArScan-HAROC
Gilles gorre Université de Rennes II / ArScan-HAROC
105. Cette intégration complète des temples à l’État lagide diffère des relations établies entre les Séleucides et les cités grecques d’Asie Mineure qui restent indépendantes et qui ne sont donc qu’indirectement sous l’autorité de l’administration royale, ma 2004, p. 135.
52 d. agut-labordère, g. gorre
Bibliographie
agut-labordère D. 2005a, « Le titre du Décret de Cambyse », RdÉ 56, p. 45-53.agut-labordère d. 2005b, « Le sens du Décret de Cambyse », in J. élaYi (éd.), Actes
du VIe Colloque international « La Transeuphratène à l’époque perse : Pouvoirs, sociétés et religions », Paris, 6-8 novembre 2003 = Transeuphratène 29, p. 9-15.
agut-labordère D. 2011, « L’oracle et l’hoplite : les élites sacerdotales et l’effort de guerre sous les dynasties égyptiennes indigènes », JESHO 54, p. 627-645.
agut-labordère d. 2012, « “Les petites citadelles” : la sociabilité du tmy ville/village à travers les sagesses démotiques », in G. gorre et P. kossmann (éds), Espaces et territoires de l’Égypte gréco-romaine. Cahier de l’Atelier Aigyptos I (juin 2008), Hautes Études du monde gréco-romain 47, Genève-Paris, p. 107-122.
agut-labordère d. 2013, « The Saite Period : The Emergence of a Mediterranean Power », in J.C. moreno garcía (éd.), Ancient Egyptian Administration, HdO 104, Leyde – Boston, p. 965-1027.
agut-labordère d. et M. chauveau 2011, Héros, magiciens et sages oubliés de l’Égypte ancienne. Une anthologie de la littérature égyptienne démotique, La Roue à livres, Paris.
berman L.M. et K.J. Bohač (éds) 1999, The Cleveland Museum of Art. Catalogue of Egyptian Art, New York.
bianchi r. 1976, The Striding Draped Male Figure of Ptolemaic Egypt, Ph.D., New York.bianchi r. 1978, « The Striding Male Figure of Ptolemaic Egypt », in h. maehler,
v.m. strocka (éds), Das ptolemäische Ägypten, Mayence, p. 95-102.bianchi r. 1992, « The Cultural Transformation of Egypt as Suggested by a Group of
Enthroned Male Figures from the Fayum », in J.h. johnson (éd.), Life in a Multi-Cultural Society. Egypt from Cambyses to Constantine and Beyond, Chicago, p. 15-39.
bothmer b. 1960, Egyptian Sculpture of the Late Period. 700 B.C. to A.D. 100, New York.bresciani e. 1996, « Cambyse, Darius I et le droit des temples égyptiens », Méditerranées
6, p. 103-113.capdetreY l. 2007, Le pouvoir séleucide. Territoire, administration, finances d’un royaume
hellénistique (312-129 avant J.-C.), Rennes.cardoso c.F. 1986, « Les communautés villageoises dans l’Égypte ancienne », DHA 12,
p. 9-31.de cenival Fr. 1972, Les Associations religieuses, Le Caire.chauveau m. 1999a, « La chronologie de la correspondance dite “de Phérendatès” », RdE
50, p. 269-271.chauveau m. 1999b, « Bilinguisme et traduction », in d. valbelle et j. leclant (éds), Le
décret de Memphis. Colloque de la fondation Singer-Polignac à l’occasion de la célébration du bicentenaire de la découverte de la Pierre de Rosette, Paris, p. 25-39.
chauveau m. 2002, «Nouveaux documents des archives de Pétéharsemtheus fils dePanebchounis », in K. rYholt (éd), Acts of the Seventh International Conference of Demotic Studies, Copenhague, p. 45-57.
de l’autonomie à l’intégration 53
chauveau m. 2011, « Le saut dans le temps d’un document historique : des Ptolémées aux Saïtes », in D. devauchelle (éd.), La XXVIe dynastie continuité et rupture. Promenade avec Jean Yoyotte, Paris, p. 39-45.
chauveau m. et Chr. thiers 2006, « L’Égypte en transition », in Fr. joannès et p. briant (éds), La transition entre l’empire achéménide et les royaumes hellénistiques, Persika 9, Paris, p. 375-404.
clarYsse W. 1987, « Greek Loan-Words in Demotic », in s.p.vleeming (éd.), Aspects of Demotic Lexicography, Studia Demotica I, Louvain, p. 9-33.
clarYsse W. 1989,«TheEpitaphoftheOfficerApollonios»,in e. van’t dack, W. clarYsse, g. cohen, j. Quaegebeur, j.k. Winnicki (éds), The Judean-Syrian-Egyptian Conflict of 103-101 B.C. A Multilingual Dossier concerning a « War of Sceptres », Bruxelles, p. 84-88.
colin F. 2002, « Les prêtresses indigènes dans l’Égypte hellénistique et romaine : une question à la croisée des sources grecques et égyptiennes », in h. melaerts, l. mooren (éds), Le rôle et le statut de la femme en Égypte hellénistique, romaine et byzantine, Studia Hellenistica 37, Louvain, p. 41-122.
corteggiani j.-p. 1998, in J.-Y. empereur (éd.), La gloire d’Alexandrie. Exposition, Musée du Petit Palais (Paris, France) 7 Mai–26 Juillet 1998, Paris.
derchain Ph. 1962, « Le rôle du roi d’Égypte dans le maintien de l’ordre cosmique », in l. de heusch et alii (éds), Le pouvoir et le Sacré, Bruxelles, p. 61-73.
derchain Ph. 1997, « La différence abolie : Dieu et Pharaon dans les scènes rituelles ptolémaïques », in P. gundlach et C. raedler (éds), Selbstverständnis und Realität, Akten des Symposiums zur ägyptischen Königsideologie in Mainz 15-17.-.1995, Wiesbaden, Harrassowitz, AÄT 36/1, p. 215-232.
derchain Ph. 2000, Les impondérables de l’hellénisation, Monographie Reine Elisabeth 7, Turnhout.
devauchelle d. 1983, Compte-rendu de reYmond 1981, CdÉ 58, p. 137-138.devauchelle D. 1995, « Le sentiment anti-perse chez les anciens Égyptiens »,
Transeuphratène 9, p. 67-90.Fairman h.W. 1934, « A Statue from the Karnak Cache », JEA 20, p. 1-4.gorre g. 2007, « Identités et représentation dans l’Égypte ptolémaïque », Ktèma 32, p. 239-250.gorre g. 2009, Les relations du clergé égyptien et des Lagides, Studia Hellenistica 41,
Louvain.grandet p. 1994, Le Papyrus Harris I (BM 9999), Le Caire.huss W. 1997, « Ägyptische Kollaborateure in persischer Zeit », Tyche 12, p. 131-143.inconnu-bocQuillon d. 1989, « Les titres ḥry ἰbd et ḥry wḏb dans les inscriptions des
temples gréco-romains », RdÉ 40, p. 67-89.jansen-Winkeln k. 1998, « Die Inschrift der Porträtstatue des Hor », MDAIK 34, p. 227-
235.jansen-Winkeln k. 2007, Inschriften der Spätzeit. Teil II : Die 22.-24. Dynastie, Wiesbaden.jélinkova-reYmond e. 1956, La statue guérisseuse de Djed-Her, Le Caire.kaiser W. 1999, « Zur Datierung realistischer Rundbildnisse ptolemäisch-römischer Zeit »,
MDAIK 55, p. 237-263.
54 d. agut-labordère, g. gorre
klotz d. 2009, « The Statue of the dioikêtês Harchebi/Archibios Nelson Atkins Museum of Art 47-12 », BIFAO 109, p. 281-310.
leahY a. 1984, « The Date of Louvre A. 93 », Göttinger Miszellen 70, p. 45-58.leahY a. 1988, « The earliest dated Monument of Amasis and the End of the Reign of
Apries », JEA 74, p. 183-199.leFebvre G. 1924, Le tombeau de Pétosiris, Le Caire.lichtheim m. 1976, « The Naucratis Stela Once Again », in J.H. johnson et e.F. Wente
(éds), Studies in Honor of George R. Hughes, SAOC 39, Chicago, p. 139-146.lichtheim m. 1980, Ancient Egyptian Literature III, Berkeley – Los Angeles – Londres.ma J. 2004, Antiochos III et les cités de l’Asie Mineure occidentale, Paris (trad. française
par S. Bardet de Antiochos III and the cities of Western Asia Minor, Oxford [2000]).manning J. 2003, Land and Power in Ptolemaic Egypt. The Structure of Land Tenure, New
York.manning J. 2009, The Last Pharaohs. Egypt under the Ptolemies 304-30, Princeton.martin C.J. 1996, « Demotic Texts », in B. porten et alii (éds), The Elephantine Papyri in
English. Three Millennia of Cross-Cultural Continuity and Change, Leyde – New York – Cologne, p. 277-385.
martin C.J. et H.S. smith 2009, « Demotic Papyri from the Sacred Animal Necropolis of North Saqqara », in P. briant et M. chauveau (éds), Organisation des pouvoirs et contacts culturels dans les pays de l’empire achéménide, Persika 14, Paris, p. 116-117.
mathieu b. 2010, « Mais qui est donc Osiris ? Ou la politique sous le linceul de la religion (Enquêtes sur les Textes des Pyramides, 3) », ENiM 3, p. 77-107.
maYstre c. 1992, Les grands prêtres de Ptah de Memphis, OBO 113, Fribourg.meeks D. 1972, Le grand texte des donations au temple d’Edfou, BdE 59, Le Caire.meeks D. 1979a, « Les donations aux temples dans l’Égypte du Premier millénaire avant
J.-C. », in E. Lipiński (éd), State and Temple Economy in the Ancient Near East II. Proceedings of the International Conference organized by the Katholieke Universiteit Leuven from 10th to the 14th April 1978, OLA 6, Louvain, p. 606-685.
meeks D. 1979b, « Une fondation memphite de Taharqa (stèle du Caire JE 36861) », in Hommages à la mémoire de Serge Sauneron I, Le Caire, p. 221-259.
mendras h. 1995, Les sociétés paysannes, Folio Histoire, Paris.de meulenaere H. 1982, « La statue d’un vizir thébain. Philadelphia, University Museum
E. 16025 » JEA 68, p. 139-144, pl. 14.de meulenaere H. 1994, « Le protocole royal de Philippe Arrhidée », CRIPEL 13, p. 53-58.de meulenaere H. 1997, « La statuette du scribe du roi Pakhnoum », CdÉ 72, p. 17-24.moreno garcía j.c. 2011, « Village », in E. Frood, W. Wendrich (éds), UCLA Encyclopedia
of Egyptology, Los Angeles. http://digital2.library.ucla.edu/viewItem.do ? ark=21198/zz0026vtgm
moYer i.s. 2011, « Court, Chora and culture in Late Ptolemaic Egypt », AJP 132, p. 15-44.naunton C. 2010, « Libyans and Nubians », in A.B. lloYd (éd.), A Companion to Ancient
Egyptian History I, Malden – Oxford, p. 120-139.perdu o. 2002, « De Stéphinatès à Néchao ou les débuts de la XXVIe dynastie », CRAI,
p. 1215-1244.
de l’autonomie à l’intégration 55
pFeiFFer s. 2011, « Die Politik Ptolemaios’ VI. und VIII. Im Kataraktgebiet : die ‘ruhigen’ Jahre von 163 bis 132 v. Chr. », in a. jördens, j.-F. Quack (éds), Ägypten zwischen innerem Zwist und äußerem Druck. Die Zeit Ptolemaios’ VI. bis VIII., Wiesbaden, p. 235-254.
Quaegebeur J. 1989, « Phritob comme titre d’un haut fonctionnaire ptolémaïque », Ancient Society 20, p.159-168
Quaegebeur j. 1995, « À la recherche du haut clergé thébain à l’époque gréco-romaine », in S.P. vleeming (éd.), Hundred-Gated Thebes, P.L.Bat XXVII, Leyde, p. 147-150.
reYmond e. 1981, From the Records of a Priestly Family from Memphis, ÄA 38, Wiesbaden.rössler-köhler u. 1991, Individuelle Haltungen zum ägyptischen Königtum der Spätzeit,
GOF 21, Göttingen.schäFer d. 2011, Makedonische Pharaonen und hieroglyphische Stelen Historische
Untersuchungen zur Satrapenstele und verwandten Denkmälern, Studia Hellenistica 50, Louvain.
sherman e. 1981, « Djedhor the Saviour Statue Base OI 10589 », JEA 67, p. 82-102.spencer n. 2010, « Sustaining Egyptian Culture ? Non-royal initiatives in Late Period
Temple Building », in L. bareš et alii (éds), Egypt in Transition. Social and Religious Development of Egypt in the First Millennium BCE, Prague, p. 441-490.
spiegelberg W. 1914, Die Sogennante demotische Chronik des Pap. 215 der Bibliothèque Nationale zu Paris, Leipzig.
valloggia m. 1976, Recherche sur les ‘messagers’ (wpwtyw) dans les sources égyptiennes profanes, Genève – Paris.
vernus p. 1978, Athribis. Textes et documents relatifs à la géographie, aux cultes et à l’histoire d’une ville du Delta égyptien à l’époque pharaonique, Le Caire.
vittmann g. 1999, Altägyptische Wegmetaphorik, Vienne.vittmann g. 1998, Der demotische Papyrus Rylands IX, ÄAT 38, Wiesbaden.vittmann g. 2009,«RuptureandContinuityonPriestsandOfficialsinEgyptduringthe
Persian Period », in P. briant et M. chauveau (éds), Organisation des pouvoirs et contacts culturels dans les pays de l’empire achéménide, Persika 14, Paris, p. 89-121.
vleeming s. 1981, « The Artaba, and Egyptian Grain-measures », in R. bagnall et alii (éds), Proceedings of the Sixteenth International Congress of Papyrology, Chico, p. 537-545.
Will Éd. 1960,«ChabriasetlesfinancesdeTachos»,REA 62, p. 254-275.YoYotte j. 1989, « Le nom égyptien du ministre de l’économie de Saïs à Méroé », CRAI,
p. 73-90.YoYotte j. 2001,«Lesecondaffichagedudécretdel’an2deNekhtnebefetladécouverte
de Thônis-Héracléion », Égypte, Afrique, Orient 24, p. 24-34.zauzich K.-Th. 1978, Papyrus von der Insel Elephantine, Berlin.