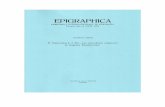[Article] Soins et lien social : à propos du Patchwork des Noms
Le respect de l'autonomie et de la confidentialité, entre « normes éthiques » et « moralités...
Transcript of Le respect de l'autonomie et de la confidentialité, entre « normes éthiques » et « moralités...
119
Journal international de bioéthique et d’éthique des sciences, 2015, vol. 26, n° 2
Chapitre 6
Le respectde L’autonomie
et de La confidentiaLité,entre « normes éthiques »et « moraLités LocaLes »
anaLyse anthropoLogiquedes éthiques de soins
à sainte-Lucie1
Marie Meudec*
1 Pour citer cet article : Meudec, M. Le respect de l’autonomie et de la confidentialité, entre« normes éthiques » et « moralités locales ». Analyse anthropologique des éthiques de soins àSainte-Lucie, JIB / IJB, 2015, vol. 26, n° 2, pp. 119-134.
* Ph.D in anthropologySSHRC postdoctoral fellowship (University of Toronto Scarborough, Centre for Ethnography)[email protected]
119-134 Chapitre 6 Meudec_015- Chapitre 1 Le Coz 10/11/15 14:04 Page119
Cet article propose une réflexion sur la difficulté d’appliquer des normeséthiques dans le cadre d’une recherche anthropologique portant sur les
moralités et l’éthique des pratiques de soins à Sainte-Lucie (Caraïbe), dans uncontexte de pluralisme moral et médical. Pour ce faire, les concepts éthiquesd’autonomie et de confidentialité y seront analysés au regard des moralitéslocales. Cet exercice permet la mise à jour des nuisances potentielles provoquéespar l’application de ces principes de bienfaisance et de respect de la personnedans le cadre d’une recherche de terrain. Cette réflexion se base sur lesévaluations morales entourant l’obeah, conçu localement comme un ensemble depratiques magico-religieuses et sorcellaires de gestion de la maladie et del’infortune à Sainte-Lucie. Dans ce contexte, nous verrons que les idiomesmoraux locaux que sont la discrétion et l’autosuffisance, que l’on peut renvoyerrespectivement aux concepts d’autonomie et de confidentialité, sont, de façonparadoxale, à la fois valorisés et susceptibles d’être associés à une moralitédouteuse. Le fait de postuler ces principes dans toute relation ethnographique, etnotamment lorsque la recherche porte sur un objet jugé moralement illégitime parles populations étudiées, peut nuire aux interlocuteurs en augmentant, commedans le cas de Sainte-Lucie, le risque d’accusations sorcellaires et d’attributionsmorales dépréciatives. Par conséquent, l’expérience de terrain anthropologiqueprésentée ici remet en question les principes de bienfaisance et de respect de lapersonne tels que définis dans le domaine de l’éthique de la recherche. Elle metaussi en avant la nécessité d’agir avec prudence lors de l’application intégrale desprincipes et des concepts de l’éthique de la recherche. Afin d’éviter des situationsoù leur application peut provoquer des effets nuisibles, il importe de réfléchir à lapossibilité de les adapter en fonction des représentations locales, ce qui conduit àprôner une éthique pragmatique et émergente de la recherche/pratiqueanthropologique. Ce texte invite le lecteur à saisir tout d’abord les dimensionsplurielles de l’obeah, pour ensuite comprendre les enjeux associés auxévaluations morales à son égard, à partir de la description des idiomes morauxsollicités dans ces évaluations. Y seront détaillés les idiomes de l’autosuffisance(associé à l’autonomie) et du secret et de la discrétion (reliés à la notion deconfidentialité).
1. L’obeah comme pratique thérapeutique,magico-reLigieuse et moraLe
L’objet de ma recherche porte sur l’obeah à Sainte-Lucie. Comme mentionnéplus haut, il est compris comme un ensemble de pratiques de gestion magico-religieuse de la maladie et de l’infortune. Ces dernières, nommées de façon
120
119-134 Chapitre 6 Meudec_015- Chapitre 1 Le Coz 10/11/15 14:04 Page120
similaire dans d’autres îles anglophones de la Caraïbe, sont souvent associées àla sorcellerie. Ce terme fait aussi référence à un idiome d’explication de lamaladie, à un recours thérapeutique associé à la magie et à un sort. Outre cettedéfinition descriptive – renvoyant aux dimensions classiques associées auxensembles spirituels, thérapeutiques, magiques et sorcellaires de la Caraïbe –, laperspective adoptée ici vise à concevoir l’obeah comme lieu d’émergence dediscours moraux. Car ce terme soulève localement de nombreux enjeux moraux,constituant dès lors une pratique moralement significative. En effet, l’attributiond’une origine non naturelle de la maladie contient souvent un contenu moral,invitant à qualifier localement l’infortune en question de « mauvaise maladie ».La désignation des pratiques de/associées à l’obeah suppose l’énonciation devaleurs morales, attribuées aux infortunes et à leur étiologie (empoisonnement,possession, maladies sexuellement transmissibles, échecs socioprofessionnels...),aux pratiques (prières, protections, divination, possession de livres...) ou auxpersonnes. Ce constat peut être interprété en termes de signification double del’obeah et des termes associés, contenant, d’une part, une valeur descriptive, pourles définir de façon pragmatique, et d’autre part, une valeur morale, posant par làun jugement moral sur l’origine de la maladie, sur la personne malade ou sur lepraticien auquel on a recours. Ces accusations morales et sorcellaires donnentaccès aux représentations et aux moralités locales à l’œuvre à Sainte-Lucie, lesdiscours de/sur l’obeah constituant ainsi des « commentaires moraux » sur lasociété st-lucienne (Massé, 2008), mis à jour par les processus de moralisationentourant ces pratiques. Dans cette recherche anthropologique, il n’est pasquestion d’analyser la « croyance » en la sorcellerie ou l’efficacité de tellespratiques. Sans pour autant nier l’existence des pratiques de sorcellerie ou dessorciers, il est ici admis que l’emploi du terme « obeah » renvoie moins à un typespécifique de pratiques ou de connaissances particulières qu’à un jugementmoral, à la désignation de ce qui est moralement reprochable, en s’inspirantnotamment des travaux de Lambek (1993) ou de Ciekawy (2001).
2. évaLuations moraLes entourant L’obeah
La réflexion présentée ici sur l’application de l’éthique médicale dans uncontexte de pluralisme moral et médical se base sur une étude des processuséthiques de légitimation des praticiens de/associés à l’obeah2 à Sainte-Lucie.
121
2 En employant le terme « praticiens de/associés à l’obeah », j’entends toutes les personnes quidonnent des remèdes thérapeutiques et qui se revendiquent ou qui sont accusés d’obeah. Jeparlerai dans cet article de « praticiens ».
119-134 Chapitre 6 Meudec_015- Chapitre 1 Le Coz 10/11/15 14:04 Page121
Cette position répond ainsi à l’appel de plusieurs chercheurs dans les années1990 (Lieban 1990 ; Fabrega 1990 ; Kunstadter 1980) qui souhaitaient que desrecherches se fassent sur les ethnoéthiques des thérapeutiques, afin de chercherà comprendre la construction socioculturelle des discours moraux et desquestionnements éthiques élaborés par, et sur, les médecines « traditionnelles »locales. Dans cette perspective, les éthiques de l’obeah se construisentnotamment sur la base des discours d’autolégitimation des praticiensde/associés à l’obeah à l’égard de leur façon de faire, discours permettant lacirconscription de leur identité morale. Il est possible de constater que lespraticiens de/associés à l’obeah possèdent un statut moralement ambigu dans lasociété sainte-lucienne, et qu’ils tentent de composer avec les accusations(avérées ou potentielles) à leur égard, en fonction de leurs propres valeursmorales. Il revient alors d’analyser les discours et pratiques tels qu’ils sontvécus et utilisés par les personnes visées par les jugements moraux négatifs. Laconstruction de la personnalité morale des praticiens de/associés à l’obeahs’effectue en réaction constante aux risques potentiels de bouleversement deleur moralité, le terme de « statut moral » mettant l’accent sur l’importance duprocessus d’attribution de qualités morales (désignation externe) tout autantque sur le processus d’identification personnelle (autolégitimation) mené par lepraticien. En ce sens, les discours de l’obeah interagissent avec les discoursproduits sur l’obeah.
L’accès aux évaluations morales et aux processus éthiques entourantl’obeah passe par une perspective tridimensionnelle, telle que développée parLaguerre (1987). Celle-ci prend en compte les discours des praticiensconcernant la légitimation éthique de leur pratique tout d’abord, les évaluationsmorales à l’égard des praticiens et de leurs traitements par la société et lesmalades ensuite, et enfin les processus globaux d’évaluation morale au sein dela société, autrement dit les processus de moralisation permettant decomprendre les représentations générales envers ces pratiques et les personnesqui y sont associées. Cette perspective se traduit par une analyse à troisniveaux, existant en interaction dialectique : les valeurs morales locales, lesdiscours d’autolégitimation des praticiens, et les discours de désignationexterne de la population à l’égard de ces mêmes personnes. Il s’agit doncd’étudier les discours moraux produits par, et sur, les guérisseurs et leurspratiques, provenant des malades, des praticiens eux-mêmes ou d’autrespraticiens, des membres des communautés religieuses, des médecins ou de lapopulation en général.
Le premier niveau d’analyse porte sur les valeurs morales saintes-luciennessollicitées dans les évaluations portant sur l’obeah. De façon globale, la société
122
119-134 Chapitre 6 Meudec_015- Chapitre 1 Le Coz 10/11/15 14:04 Page122
sainte-lucienne est polarisée, pour des questions linguistiques (créole/anglais),spatiales (ville/campagne), générationnelles (jeunes/personnes âgées) et genrées(homme/femme). Cette polarisation aide à comprendre certains des critères surlesquels se fondent les discours d’autolégitimation des praticiens et les signesd’accusation sorcellaire. En effet, le fait d’être une personne âgée, créolophone,vivant seule – d’autant plus si on est une femme – à la campagne peut favoriserl’accusation sorcellaire. De l’ensemble de ces discours, ressortent des figures del’altérité (Étranger, Blanc, Martiniquais, Africain, Haïtien), construites et misesen forme sur la base de tels critères de disqualification, et intervenant au sein desdiscours produits par/à l’égard des praticiens de/associés à l’obeah. Ces figurespermettent par exemple d’expliquer le phénomène d’inversion symbolique (lefait d’attribuer un pouvoir thérapeutique plus fort à des personnes marginaliséessocialement), et on pourra ainsi chercher à – ou éviter de – consulter un praticienayant voyagé en Haïti, ou dont la clientèle est étrangère. En outre, l’analyse desvaleurs morales locales permet de voir en quoi les représentations de l’Églisecatholique et des nouvelles Églises à l’égard des pratiques de/associées à l’obeahcontribuent fortement à la délégitimation de celles-ci. Parmi les idiomes morauxsollicités dans les accusations, retenons le cas du respect, de la réciprocité, de laconfiance, de la discrétion et de l’autosuffisance, ces deux derniers étant l’objetde cet article.
Les deuxième et troisième niveaux d’analyse portent sur les rapportsréciproques entre le discours d’autolégitimation des praticiens de/associés àl’obeah – lesquels revendiquent pour la plupart une bonne moralité – à travers desvaleurs comme la solidarité, la bienfaisance, l’autosuffisance et le secret – et ladésignation externe à leur endroit. Ainsi, à travers ce que les praticiens disent deleur propre pratique, à propos de l’origine de leurs pouvoirs thérapeutiques ou desconditions morales nécessaires au maintien de ce pouvoir par exemple, et àtravers les principes moraux sollicités pour justifier certains de leurscomportements ou ceux d’autres praticiens, apparaissent de nombreuses réponses(en réaction ou à l’avance) aux attaques les concernant. Apparaissent ici dessignes de l’engagement chez les personnes accusées de sorcellerie, se basant surdes caractéristiques physiques, matérielles, comportementales, relationnelles,mais aussi des critères socio-économiques ou ethnoculturels. Ces signestémoignent des conditions d’attribution de valeurs morales associées à lasorcellerie et certains d’entre eux font état d’une moralisation négative decaractéristiques qui sont pourtant valorisées dans d’autres contextes. Tel est le casde l’autosuffisance (autonomie) et de la discrétion (confidentialité), valeurssollicitées dans certains cas pour préserver un statut moralement bon et dansd’autres pour attribuer des qualités morales négatives à des personnes dont onsoupçonne qu’elles pratiquent la sorcellerie.
123
119-134 Chapitre 6 Meudec_015- Chapitre 1 Le Coz 10/11/15 14:04 Page123
3. idiomes moraux Locaux
Voici donc quelques-unes des implications des questions morales et éthiquesde cette recherche en anthropologie, apparaissant lors de l’analyse de certainsidiomes moraux liés aux pratiques de soins à Sainte-Lucie. Il s’agit des idiomesdu secret et de l’autosuffisance, idiomes locaux pouvant être associés aux normeséthiques de la recherche en sciences sociales – inspirées du contexte biomédical– que sont la confidentialité et l’autonomie.
3.1. conception locale de l’autonomie : l’autosuffisance
Dans le domaine de l’éthique de la recherche, beaucoup de critiques ont étéfaites à propos du concept d’autonomie et de son application, dans la mesure oùil constituerait un concept abstrait éloigné de l’expérience quotidienne empirique(Kleinman, 1995), et une réflexion sur ce concept se révèle également nécessairedans le contexte d’une recherche sur la sorcellerie à Sainte-Lucie.
Conceptions locales de l’autonomie
Localement, on ne parle pas d’autonomie, mais plutôt d’autosuffisance. Ils’agit de revendiquer une indépendance matérielle, financière et affective, uneabsence de recours aux autres pour satisfaire ses besoins, et donc une démarcationpar rapport à la cupidité ou, pour coller davantage au terme créole local, à la« voracité (vowasité) ». « Ne rien demander aux gens », « se débrouiller toutseul »3 est revendiqué afin de s’assurer une certaine respectabilité. L’indé -pendance et l’autosuffisance impliquent de « laisser-vivre », de ne pas s’immiscerdans la vie privée d’autrui, de ne pas demander ce dont on pourrait avoir besoinpour éviter d’être jugé, et aussi de ne pas juger les autres. Ce type d’attitude peutconduire à ne pas se préoccuper des autres et des éventuelles rumeurs à son égard,et la valorisation de l’autosuffisance peut ainsi devenir la source de réactionsnégatives, d’accusations d’ordre moral ou sorcellaire.
Au niveau des discours d’autolégitimation des praticiens, l’autosuffisanceapparaît lorsque des praticiens attribuent leurs pouvoirs thérapeutiques au faitd’être autodidactes et indépendants. Souvent, les praticiens manifestent leurautosuffisance à travers la gratuité des soins prodigués, plus précisément par lefait qu’ils « ne demandent pas d’argent pour ça », l’argent venant tacher le
124
3 Les expressions entre guillemets renvoient à des citations d’entrevues dans le cadre de monterrain à Ste-Lucie.
119-134 Chapitre 6 Meudec_015- Chapitre 1 Le Coz 10/11/15 14:04 Page124
praticien de mercantilisme et d’une moralité douteuse. Ne pas demander supposetoutefois de façon implicite que la réciprocité est bienvenue, et les cadeaux offertsviennent justifier une bonne moralité (Meudec, 2009). Si les malades guéris nedonnent rien en retour, les praticiens parleront alors des sacrifices quotidiens,associés à la générosité, à la solidarité et au pardon. Toutefois, certainsdemandent une rétribution financière, et justifient ce comportement par la preuvede l’efficacité du traitement ou parce qu’il s’agit d’une règle imposée del’extérieur, par l’entourage ou les forces surnaturelles guidant leur pratiquethérapeutique et/ou magico-sorcellaire. Toutefois, lorsque la rétributionmonétaire est demandée, c’est souvent indirectement. La demande explicite estmarginale chez les praticiens, entre autres parce qu’elle engendre unaccroissement de leur réputation, c’est-à-dire le fait que « ton nom va êtreconnu ». Pour les praticiens, le rapport à l’indépendance financière soulève desenjeux moraux, et l’analyse de discours révèle une gradation entre l’absence dedemande, l’acceptation d’une compensation (non)financière, la demanded’argent pour l’achat des produits, avant le traitement ou suite au constatd’efficacité du remède. À tous ces niveaux surviennent des justifications morales,dans un contexte global où la voracité et le mercantilisme sont très mal jugés parla population.
L’autosuffisance comme source potentielle d’accusation morale
et sorcellaire
Cette autosuffisance ou indépendance constitue une source potentielled’accusation morale et sorcellaire. En effet, le fait de « travailler à son compte »et d’être indépendant est un point avancé par plusieurs pour montrer que ce quiest perçu comme une force de travail devient aussi parfois le lieu de jugementsmoraux émanant de personnes jalouses. En outre, cette indépendance financièrepeut conduire à des interprétations sorcellaires, compte tenu des représentationsà l’égard de l’accès à une réussite professionnelle et/ou financière. Ceci se traduitdans l’ambiguïté de l’expression « tu te tiens tout seul (ou bon pou kò’w) » quiqualifie une certaine autonomie en même temps qu’elle engendre de la suspicion,voire une accusation de sorcellerie. Ainsi, l’autosuffisance, compréhension localede l’autonomie, constitue un idiome à la fois valorisé et susceptible d’associationà une moralité douteuse.
On peut donc voir que cette conception de l’autonomie, et plus précisémentde l’autosuffisance, diffère d’une conception qui focaliserait sur l’individu. Eneffet, l’autosuffisance ne renvoie pas seulement à une capacité individuelle maisbien à un positionnement moral qui se construit par rapport aux autres, et donc à
125
119-134 Chapitre 6 Meudec_015- Chapitre 1 Le Coz 10/11/15 14:04 Page125
une conception collective. L’individu n’est donc pas la seule « unité » du discoursmoral, au sens où les autres membres de la société et les processusinterpersonnels deviennent les entités centrales. La conception d’une autonomieindividuelle (principe fondamental de la bioéthique) est questionnée en termesd’individualisme, et par rapport à son absence de prise en compte des dimensionsmorales et donc collectives qu’une telle conception implique au niveau local. Onentrevoit alors aisément le risque ethnocentrique d’imposition d’un modèle del’autonomie, car le fait de supposer d’emblée une autonomie des interlocuteurspeut empêcher de chercher à comprendre la signification locale et les usages dece terme. Une recherche anthropologique – en Amérique du Nord et dans les paysoù ce type de recherche fait l’objet d’évaluations par des comités d’éthique de larecherche – fait intervenir cette question d’autonomie personnelle lorsqu’oncherche à obtenir le consentement éclairé des interlocuteurs. Mais ni l’autonomieni le consentement éclairé ne sont si évidents, lors d’une recherche en contextede sorcellerie invitant à se questionner sur les points suivants : À quoi exactementl’interlocuteur consent dans la relation avec l’anthropologue ? Consent-il auxdifférents jugements qui pourront être portés à son égard suite à cette rencontreavec le chercheur ? Ces décalages de signification peuvent nuire aux relationsentre le chercheur et l’interlocuteur, à la recherche, et ils peuvent avoir desconséquences néfastes et à long terme pour l’interlocuteur. Il convient dès lors des’interroger sur le présupposé selon lequel l’autonomie est un concept forcémentpositif, étant donné que les représentations associées à l’autonomie – et dans cecontexte précis à l’autosuffisance – peuvent être négatives.
3.2. Le secret et de la discrétion comme expressions localesde la confidentialité
au niveau du contexte et des valeurs morales locales
Quelques travaux et articles qui traitent de l’obeah sont disponibles dans ledomaine public, mais pourtant, dans la vie quotidienne à Sainte-Lucie, ce sujetconstitue un tabou, un phénomène moralement indicible. L’intériorisation decette règle implicite est relativement partagée par l’ensemble de la population, etles gens « n’aiment pas en parler ». La pratique se fait donc souvent dans lesecret, ce qui conduit des personnes à considérer que « tu peux être dans unemaison et ne pas savoir que ta sœur pratique ou que ton frère pratique ».L’invisibilité des pratiques de l’obeah se manifeste aussi dans le temps de lapratique (la nuit, dit-on) et les espaces physiques qui y sont associés, comme lescimetières, les maisons en retrait, les pièces fermées à clef, ou encore des lieux
126
119-134 Chapitre 6 Meudec_015- Chapitre 1 Le Coz 10/11/15 14:04 Page126
associés à la marginalité (un bar à danseuses). Souvent, le secret sert à protégersa réputation, à éviter que des informations soient diffusées à son endroit,d’autant plus dans un contexte d’observation réciproque et d’interconnaissanceoù l’on dit que « tout le monde regarde, observe ce que les autres font ». Laquestion de la confidentialité est très importante aux yeux des malades, et l’onentend souvent parler du très faible niveau de confidentialité de certainsprofessionnels de santé. Pour s’éviter une mauvaise réputation, les maladesutilisent certaines stratégies, comme la non-divulgation ou l’éloignement durecours en cas de maladie ou d’infortune, lorsque des personnes maladesconsultent des médecins éloignés de leur lieu de vie afin que le diagnostic ou lerecours thérapeutique ne fasse pas l’objet de rumeurs, comme dans le cas d’unemaladie sexuellement transmissible. La pratique de l’obeah et le recours à despraticiens qui y sont associés s’effectuent souvent dans la discrétion.
Le contexte historique et culturel permet en partie de comprendre cetteillégitimité morale, le passé colonial et le statut légal de l’obeah fournissant deséléments d’interprétation du secret entourant ces pratiques. En effet, les cultes etles pratiques culturelles des esclaves ont été interdits au cours de la périodecoloniale, et la criminalisation de l’obeah – toujours actuelle dans certains paysde la Caraïbe – s’est jumelée à une moralisation négative de ce phénomène, ce àquoi Paton (2009) fait référence lorsqu’elle parle de « construction coloniale del’obeah ». Au plan des représentations locales, on évoque aussi comme trace dupassé colonial le fait que la « culture anglaise » (le pays ayant été tour à tour sousle joug colonial français et anglais) ait imprégné les mentalités, et cette soi-disantréserve « anglaise » pourrait avoir conditionné le rapport des St-Luciens auxpratiques magico-sorcellaires. D’autres raisons sont avancées pour expliquer cesecret, comme le poids des Églises chrétiennes (catholiques et protestantes), etl’influence des conceptions occidentales et biomédicales liées à une pensée« rationnelle ». Ces influences historiques, culturelles et religieuses semblentaller en faveur d’une décrédibilisation des pratiques magico-sorcellaires et d’unedélégitimation de l’obeah. En outre, la peur d’éventuelles représailles (sorts) dela part des praticiens est aussi sollicitée pour expliquer le secret, ce dernieragissant comme une forme de protection4. Toutefois, le fait que des pratiquesassociées à la sorcellerie soient cachées n’est pas un phénomène particulier à
127
4 Mantz (2007a) constate dans le même sens que, à la Dominique, les discussions publiques surl’occulte sont exceptionnelles, en partie parce que l’on considère que l’expression d’une telle« croyance en l’occulte » va donner davantage de force à ce pouvoir. Et c’est par la volonté dese protéger de la force magique de l’obeah qu’il explique le déni courant de toute implicationdans ces pratiques : « The power of the occult ends with the denial of its “existence” » (2007a :24).
119-134 Chapitre 6 Meudec_015- Chapitre 1 Le Coz 10/11/15 14:04 Page127
Sainte-Lucie, le secret constituant un principe inhérent aux pratiques magico-sorcellaires en général.
Des explications morales peuvent permettre de comprendre ce secret, car c’est« honteux d’aller voir les gadè » et de pratiquer l’obeah, le dévoilement pouvantentraîner une dévalorisation de la part de l’entourage. Tel est le cas de maladesdisposant d’un statut social valorisé, comme des biomédecins ou des politiciensqui consultent des praticiens. L’obeah serait donc caché en partie pour éviter desaccusations d’ordre moral, une mauvaise réputation et une certainemarginalisation associée aux précédentes accusations. Le secret entourantl’obeah constitue dès lors une forme de protection morale, car les gens ont « peurd’être socialement attaqués », et « c’est pour éviter cela qu’ils le gardent secret »entend-on, d’autant plus qu’une mauvaise réputation voyage vite à Sainte-Lucie.Le recours à l’obeah constitue un « paradoxe apparent » (Shore, 1990) dans lesens où beaucoup de personnes consultent des praticiens tout en pensant que c’est« une mauvaise chose ».
De façon générale, la discrétion est souvent de mise dans les relationsquotidiennes, et on entend que « les gens ne veulent pas parler de leurs affaires,ils ne veulent pas que les gens sachent leurs affaires ». Le fait d’être discret,décent, de se contenir – émotionnellement parlant –, de ne pas troubler l’ordre etd’étaler des informations privées dans un lieu public est valorisé, et ce d’autantplus si l’on est une femme. Réserve et discrétion sont préconisées dans la viequotidienne, invitant au respect et à la confiance. L’idée de confidentialité ressortsouvent lors d’entrevues avec des interlocuteurs à Sainte-Lucie et, compte tenude l’objet de ma recherche et du contexte saint-lucien, elle semble être unprérequis indispensable à l’obtention d’informations (Meudec, 2010).
autolégitimation morale des praticiens et contraintes professionnelles
Le recours à la médecine dite « traditionnelle » se fait dans l’illégalité, mêmes’il s’inscrit dans la quotidienneté des personnes qui n’ont pas toujours recours àla biomédecine pour des questions culturelles, géographiques et économiques.Malgré la décriminalisation de l’obeah à Sainte-Lucie depuis 2004 – mais pas dela pratique illégale de la médecine –, la population envisage malgré tout lespratiques de/associées à l’obeah comme quelque chose d’illégal et d’illégitime.Cela peut en partie expliquer la réticence de certains praticiens à parler, associantma recherche à des démarches du Gouvernement saint-lucien pour criminaliserl’exercice non officiel des thérapeutes. Cela s’exprime également par la demanded’une démonstration de la légalité de mes recherches à travers des documentsofficiels. Pour les praticiens, le risque d’une condamnation judiciaire est minime
128
119-134 Chapitre 6 Meudec_015- Chapitre 1 Le Coz 10/11/15 14:04 Page128
(les recours judiciaires les visant étant rares, voire inexistants), mais laréprobation et la condamnation morale sont des phénomènes fréquents. Cettepossibilité de recours judiciaire invite tout de même des praticiens à invoquer laprudence et la discrétion : « Ne dis pas tes affaires à tout le monde ! Les Saint-Luciens parlent, et puis ils te mettraient le gouvernement sur le dos avec toutesces histoires-là », déclare l’un d’eux. Peu de praticiens revendiquent un statut desorcier et la plupart développent des stratégies de préservation de leur statutmoral afin de se protéger d’éventuelles accusations : s’enquérir des précédentsrecours des malades, ne pas faire « des choses pour les gens » pour éviter d’êtreconnu, ne pas exiger de rétribution monétaire... Une des contraintes que lespraticiens se donnent est le secret, pour chercher à conserver le don ou lesconnaissances, mais aussi pour se protéger d’une éventuelle condamnationmorale.
De façon générale, les praticiens mettent en avant le principe de non-malfaisance, même si certains rappellent leurs capacités à « faire du mal ».Plusieurs raisons sont avancées pour justifier la non-malfaisance, dont la crainted’un retour de bâton (« si tu fais du Mal tu auras du Mal en retour ») ou lacapacité de discernement. Mais il s’agit avant tout d’une posture morale quiassocie le praticien au Bien, et cette énonciation permet de légitimer – au moinsauprès de l’anthropologue – leur pratique. Cette volonté d’éviter d’être associé auMal s’explique par le stigmate et les possibles conséquences fâcheuses associéesà l’accusation d’obeah. Pour toutes ces raisons, poser des questions à propos del’obeah à un praticien, c’est quasiment l’insulter, en sous-entendant qu’il saitquelque chose à ce propos, ou en prêtant aux accusations des autres davantage decrédit qu’à ses propres paroles. C’est la raison pour laquelle plusieurs praticiensrépondent de façon assez brutale à mes interrogations à ce sujet. Lorsque jedemande à des praticiens s’ils font des remèdes « pour toutes sortes deproblèmes » (c’est une des expressions consacrées), ils répondent par la négativeet entrent souvent dans un long discours défensif de justification.
Désignation externe : le secret comme moteur d’accusation morale
et sorcellaire
L’existence d’un secret peut provoquer des suspicions à l’égard des personnesqui cultivent – ou sont accusées de cultiver – ce secret, et ces doutes peuventdonner lieu à des accusations d’obeah en même temps qu’ils vont agir commefacteur attractif chez certains. Lorsqu’un praticien « ne donne jamaisd’informations » ou sélectionnent les informations données, on peut lesoupçonner d’en savoir plus, de cacher ses affaires. Comme le dit un
129
119-134 Chapitre 6 Meudec_015- Chapitre 1 Le Coz 10/11/15 14:04 Page129
interlocuteur, « souvent les gens, à partir du moment où il y a un secret, ils vontdire que c’est quelque chose de démoniaque ». On constate un certain scepticismepar rapport aux discours des praticiens ou interlocuteurs associés à l’obeah, etcela rend difficile tout jugement définitif sur telle personne. Ainsi, si on nie, si onne veut pas en parler ou si on revendique la pratique, on peut être accusé desorcellerie, d’être un menteur ou un charlatan, d’autres facteurs entrant égalementen ligne de compte, mais, presque à chaque fois, un doute persistera tout de mêmesur d’éventuelles capacités sorcellaires. Et c’est le même processus pour lespersonnes qui pourraient avoir recours à l’obeah, dans la mesure où le processusd’éloignement du recours visant à conserver cette démarche confidentielle fait ensorte que les malades pourront être accusés de recourir à l’obeah ou de vouloir lepratiquer.
De façon apparemment paradoxale, le secret inspire le respect et la confiance,mais aussi dans certains contextes la méfiance, tout secret supposant peut-êtrel’existence de pratiques occultes. Le secret est donc ambigu dans la mesure où ilfonctionne à double sens en inspirant d’une part la confiance, ce qui le rapprochealors de la confidentialité, et d’autre part la méfiance, en donnant lieu à dessoupçons et des doutes sur ce qui se passerait en réalité. En outre, si la discrétionest à la fois valorisée et moteur d’accusation sorcellaire, le comportementinverse5, associé à l’arrogance, peut lui aussi valoir d’être accusé d’obeah oud’une mauvaise moralité. Ainsi, il semble difficile pour les interlocuteurs detrouver un juste milieu entre la discrétion et le secret total car, d’une part, commele rappelle Bougerol (1997 : 20), il existe des « tiraillements entre le désir demontrer et la nécessité de cacher », et d’autre part, si l’exubérance peut êtrecritiquée, l’excès de réserve rend suspicieux et peut provoquer de la méfiance.
On voit donc que la question de confidentialité ne peut être comprise qu’enrelation à d’autres valeurs, telles que la honte, la réputation ou la confiance...L’ambiguïté morale de certaines valeurs ressort au quotidien et il s’agit donc deconcevoir les idiomes moraux en termes de pôles, allant du pôle négatif au pôlepositif, dont les extrémités peuvent toutes deux donner lieu à des accusationsmorales et sorcellaires. Tel est le cas des pôles discrétion / arrogance, franchise /secret, autosuffisance / voracité. En effet, même si une valeur est généralementestimée par la population, elle peut être source, dans certains contextes et selonles individus à qui elle est attribuée, d’évaluations morales négatives en termesd’affiliation sorcellaire. Cela rend donc difficile l’adoption de comportements ou
130
5 Cela vaut aussi pour la voracité, comportement opposé à l’autosuffisance (précédemmentanalysée), qui va être relié à la présence de jalousie et d’intentions maléfiques, et donc la sourcepotentielle d’accusation.
119-134 Chapitre 6 Meudec_015- Chapitre 1 Le Coz 10/11/15 14:04 Page130
de valeurs garantissant une bonne moralité. Pour toutes les raisons évoquées plustôt, proposer la confidentialité aux interlocuteurs à Sainte-Lucie peut conduire àdes effets non désirés, en instaurant par exemple le doute sur nos objectifs réels(faire de l’argent, devenir sorcier...), en suscitant des soupçons à notre égard, maisaussi surtout en rendant les interlocuteurs rencontrés vulnérables à desaccusations morales et sorcellaires.
concLusion
Face au développement d’une éthique formelle de la recherche, guidée par descomités d’éthique, l’idée est ici de rappeler la nécessaire prise en compte d’uneéthique pragmatique de la pratique anthropologique, une éthique émergente, oùla notion de négociation est importante et où l’autoresponsabilisation duchercheur est primordiale (Bourgeault, 2010), même si la question de laresponsabilité n’est pas si simple (Fassin, 2008). L’analyse des dimensionsmorales passe en outre par l’étude des comportements des chercheurs eux-mêmes, l’ethnographe se devant de clarifier au préalable sa position morale ausein des mondes vécus (Meudec et Marin, 2007). Ainsi, l’éthique de la rechercheinspirée du modèle de la recherche biomédicale est basée entres autres sur lesprincipes de bienfaisance et de respect de la personne, mais aussi deconfidentialité et d’autonomie. Toutefois, en posant ces principes comme base àla relation entre l’anthropologue et les interlocuteurs, on peut leur nuire,notamment dans le contexte de cette recherche en augmentant le risque qu’ilssoient accusés de sorcellerie et donc moralement stigmatisés. Ayant connaissancedes possibles suspicions entourant la revendication de confidentialité, commentest-il possible de respecter cette règle éthique et d’assister aux conséquencesfâcheuses de ses interprétations au niveau local ? En pensant faire du Bien –proposer la confidentialité ou supposer l’autonomie –, on peut finalement nuireaux personnes rencontrées. Le principe de non-malfaisance est ici mis à mal, carcomment s’assurer d’une bienfaisance absolue sans connaître les principesmoraux qui guident les personnes rencontrées ? Cet effet pervers montre lanécessaire prudence éthique et le besoin d’adaptation des principes éthiques auxréalités locales. En outre, il revient aussi de s’interroger sur les effets delégitimation suscités par une recherche portant sur un objet moralementillégitime. En effet, quelles sont les instrumentalisations possibles d’une étudedes éthiques de praticiens jugés malfaisants, en termes de légitimationnotamment ?
En anthropologie, certains contextes de recherche font apparaître des enjeuxéthiques qui ne peuvent pas toujours être prévus à l’avance, notamment lorsque
131
119-134 Chapitre 6 Meudec_015- Chapitre 1 Le Coz 10/11/15 14:04 Page131
l’étude porte sur un objet moralement illégitime. Comme je l’ai déjà montréailleurs à propos de la notion de consentement éclairé (Meudec, 2010), lanormalisation éthique – via les exigences des comités d’éthique – peut en outreconstituer des obstacles à la recherche. Cet aspect transparaît également dans cetarticle, à propos des questions d’autonomie et de confidentialité, et lespossibilités de nuisance se répercutant sur les interlocuteurs font écho à ce queFassin (2008 : 119) nomme la « double inadéquation – par excès et par défaut –des procédures actuelles de normalisation éthique ». Ce questionnement supposede réfléchir aux valeurs auxquelles l’anthropologue peut faire référence, auniveau personnel, professionnel et culturel. Il s’agit donc d’être attentif aucontexte idéologique plus général dans lequel l’anthropologue se situe et qui leconditionne insidieusement (Ghasarian, 1997), ce qui constitue d’après Thomas(1993) une sorte d’ « obligation éthique », et ce, au risque de se voir l’initiateurd’un impérialisme culturel et éthique dans l’application des standards éthiquesoccidentaux à d’autres réalités socioculturelles. Ce questionnement s’imposedans le contexte actuel de la recherche en sciences sociales, dans la mesure oùl’éthique a tendance à être « extériorisée dans des autorités sociales comme lescomités d’éthique » (Stoczkowski, 2008 : 352), là où l’on observe unaccroissement d’ « éthiques de l’anthropologie objectivées » (Lambek, 2011 :11), la responsabilité de la réflexion éthique étant déléguée à une entitéextérieure. Il y a sans doute là matière à réflexion au sein de la disciplineanthropologique, à travers des réflexions portant sur les liens entre éthique de larecherche et anthropologie des moralités et de l’éthique.
132
Pour prolonger la réflexion sur l’éthique de la recherche, vous pouvez lire :
Meudec (2010), Fassin (2008), ou encore Desclaux A., 2008, « Les lieux du« véritable travail éthique » en anthropologie de la santé : terrain, comités, espacesde réflexion ? », ethnographiques.org, 17 [en ligne].http://www.ethnographiques.org/2008/Desclaux.html et Olivier de Sardan J.P.,2008, La rigueur du qualitatif. Les contraintes empiriques de l’interprétationsocio-anthropologique. Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant.
119-134 Chapitre 6 Meudec_015- Chapitre 1 Le Coz 10/11/15 14:04 Page132
BiBLiographie
Bourgeault G., 2010, « À la recherche d’un contrôle illusoire », in Trudel P &M.S. Jean, La malréglementation. une éthique de la recherche est-elle possible et àquelles conditions ? : 21-34. Les Presses de l’Université de Montréal.
Bougerol C., 1997, une ethnographie des conflits aux Antilles : jalousie,commérages, sorcellerie. Paris, Presses Universitaires de France.
Ciekawy D.M., 2001, « Utsai as Ethical Discourse. A Critique of Power fromMijikenda in Coastal Kenya », in Bond G.C. & Ciekawy D.M., Witchcraft dialogues,Anthropological and Philosophical exchanges : 158-189. Ohio University, Center forInternational Studies.
Ghasarian C., 1997, « Les désarrois de l’ethnographe », L’Homme, 143: 189-198.
Fabrega H.J.R, 1990, « An Ethnomedical Perspective of Medical Ethics », TheJournal of Medicine and Philosophy, 15 : 593-625. Kluwer Academic Publishers.
Fassin D., 2008, « L’éthique, au-delà de la règle. Réflexions autour d’une enquêteethnographique sur les pratiques de soins en Afrique du Sud », Sociétéscontemporaines, 71 : 117-136.
Kleinman A., 1995, « Anthropology of Bioethics », in Kleinman A., Writing atThe Margins : discourse Between Anthropology and Medicine : 41-67. Berkeley,University of California Press.
Kundstater P., 1980, « Medical Ethics in Cross-Cultural and MulticulturalPerspective », in Social Science and Medicine, 14B:289-296.
Laguerre M., 1987, Afro-caribbean Folk Medicine. The Reproduction andPractice of Healing. South Hadley, Bergin and Garvey Publishers.
Lieban R.W., 1990, « Medical Anthropology and The Comparative Study ofMedical Ethics », in Weisz G., Social Science Perspectives on Medical ethics : 221-239. Kluwer Academic Publishers.
Lambek M., 2011 (dir.), Ordinary ethics. Anthropology, Language, and Action.New York, Fordham University Press.
Lambek M, 1993, Knowledge and Practice in Mayotte. Local discourse of Islam,Sorcery and Spirit Possession. Toronto, University of Toronto Press.
Meudec M., 2010, « Éthique pragmatique de la recherche anthropologique, le casd’une étude de l’obeah à Ste-Lucie », cahiers de Recherches Sociologiques, 48 :155-174. Numéro spécial sur l’éthique de la recherche. Université du Québec àMontréal.
Meudec M., 2009, « Une anthropologie des moralités de l’obeah à Ste-Lucie.Notes de recherche », Anthropologie et Sociétés. Numéro intitulé « Del’Anthropologie des moralités à l’ethnoéthique » (Dir. Raymond Massé), 33, 3 : 175-191.
133
119-134 Chapitre 6 Meudec_015- Chapitre 1 Le Coz 10/11/15 14:04 Page133
Meudec M. & A. Marin, 2007 « Moralités, éthiques et bioéthique : quelquesréflexions Anthropologiques », in Éléments d’anthropologie : 145-206. Chisinau,Presses d’Université d’État de Moldavie.
Paton D., 2009, « Obeah Acts : Producing and Policing the Boundaries ofReligion in the Caribbean », Small Axe, 28 : 1-18.
Shore B., 1990, « Human Ambivalence and The Structuring of Moral Values »,ethos, 18, 2 : 165-180.
Stoczkowski W., 2008, « The ‘fourth aim’ of anthropology : Between knowledgeand ethics », Anthropological Theory, 8 : 345-356.
Thomas J., 1993, doing critical ethnography. Newbury Park, Sage Publications.
134
119-134 Chapitre 6 Meudec_015- Chapitre 1 Le Coz 10/11/15 14:04 Page134
Mais la conduite de la recherche en santé mondiale dans les pays du sud soulèveaussi des défis éthiques considérables. Une étude pilote auprès de chercheurs auBénin a permis d’explorer l’expérience des chercheurs sur les défis éthiques enrecherche en santé mondiale, notamment en rapport avec l’asymétrie de pouvoirdans la conduite de la recherche. L’étude met en lumière la complexité ducontexte social d’où émergent l’asymétrie de pouvoir et les processus à partirdesquels ils se manifestent. En outre, elle révèle la vulnérabilité des chercheursévoluant dans un environnement où ils restent exposés à des situationssusceptibles d’altérer la conduite de la recherche ou mettre en péril les valeursmorales qu’ils portent. Enfin ces résultats suggèrent l’existence d’une démarchenovatrice à travers des initiatives destinées à faire face aux contraintes de terrain.
Mots-clés : Recherche biomédicale, Bénin, Comité d’éthique de la recherche,Allocation de ressource.
power asymmetry in gloBal health research, what are the ethical staKes? a pilot study with researchersin Benin
Global health research constitutes a driving force to achieve health justice andhealth equity in several countries around the world and more specifically inglobal South. However, these research raise significant ethical challenges. Wehave conducted a pilot study with researchers from Benin to better understandchallenges associated with power asymmetry in global health research. the studyhighlights the complexity of the social context in which power asymmetry arisesand the way it evolves. Moreover, it reveals the vulnerability of researchers whoare working in such environments, where they are exposed to critical conditionsthat could affect the research process and jeopardize their moral values. finally,these results suggest that there are innovative approaches coming fromresearchers facing these constraints.
Keywords: Biomedical research, Bénin, research ethics committees, resourceallocation.
— Marie MEudEC
Le respect de L’autonoMie et de La confidentiaLité,entre « norMes éthiques » et « MoraLités LocaLes ».anaLyse anthropoLogique des éthiques de soinsà sainte-Lucie
Cet article propose une réflexion sur la difficulté d’appliquer des normes éthiquesdans le cadre d’une recherche anthropologique portant sur les moralités etl’éthique des pratiques de soins à Sainte-Lucie (Caraïbe). Cette réflexion se basesur les évaluations morales entourant l’obeah, conçu localement comme un
168
163-171 Résumés_Résumés 12/11/15 14:09 Page168
ensemble de pratiques magico-religieuses et sorcellaires de gestion de la maladieet de l’infortune. À travers l’analyse des conceptions locales entourant lesnotions éthiques d’autonomie et de confidentialité, sont mises à jour lesnuisances potentielles provoquées par l’application des principes de bienfaisanceet de respect de la personne. En effet, les idiomes moraux locaux que sont ladiscrétion et l’autosuffisance, que l’on peut renvoyer respectivement auxconcepts d’autonomie et de confidentialité, sont, de façon paradoxale, à la foisvalorisés et susceptibles d’être associés à une moralité douteuse. Il sera démontréque le fait de postuler ces principes dans toute relation ethnographique peut nuireaux interlocuteurs en augmentant, dans le cas de Sainte-Lucie, le risqued’accusations sorcellaires et d’attributions morales dépréciatives. L’expériencede terrain anthropologique présentée ici questionne les principes de bienfaisanceet de respect de la personne tels que définis dans le domaine de l’éthique de larecherche et elle impose la nécessité de réfléchir à leur adaptation en fonction desreprésentations locales. Cela conduit à recommander une éthique pragmatique etémergente de la recherche/pratique anthropologique.
Mots-clés : Autonomie, Confidentialité, Caraïbes, Ethno-anthropologie,Pratique culturelle, Analyse éthique.
respect for autonomy and confidentiality, Between“ethical norms” and “local morality”. an anthropologicalanalysis of ethics of care in st lucia
this article considers the difficulty of applying ethical norms as part of ananthropological research on moralities and ethics of healing practices in St.Lucia (Caribbean). this reflection is based on the moral evaluations related toobeah, locally conceived as a set of magical, religious and witchcraft practicesthat helps to manage disease and misfortune. through the analysis of localconceptions surrounding the ethical notions of autonomy and confidentiality, icall attention to potential nuisance caused by the application of principles ofbeneficence and respect for the individual. indeed, local idioms that are moraldiscretion and self-sufficiency, which can respectively refer to the concepts ofautonomy and confidentiality, are, paradoxically, both valued and likely to beassociated with dubious morality. i will demonstrate that the fact of applyingthese principles in all ethnographic relationship may harm interlocutors byincreasing, in the case of St. Lucia, the risk of witchcraft accusations andderogatory moral attributions. the anthropological field experience presentedhere questions the principles of beneficence and respect for the individual asdefined in the field of research ethics; it also imposes the need to think abouttheir adaptation to suit local representations. this leads to recommend apragmatic and emerging ethics of anthropological research/practice.
Keywords: Autonomy, Confidentiality, Caribbean, Ethno-anthropology, Culturalpractices, Ethical analysis.
169
163-171 Résumés_Résumés 12/11/15 14:09 Page169



















![[Article] Soins et lien social : à propos du Patchwork des Noms](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6314f5a83ed465f0570b5e93/article-soins-et-lien-social-a-propos-du-patchwork-des-noms.jpg)