La notion de Liberté dans la philosophie : de l'eleutheria des antiques à l'autonomie moderne
-
Upload
univ-toulouse -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of La notion de Liberté dans la philosophie : de l'eleutheria des antiques à l'autonomie moderne
T o u l o u s e -‐ F a c u l t é d e P h i l o s o p h i e
« La notion de Liberté dans la philosophie : de l'eleutheria des antiques à l'autonomie moderne » De l'individualisme au fonctionnalisme : jeu d'échelles et "émergence".
27 & 28 Février 2015 ECH14 THOMAZO Mathilde
Mathilde THOMAZO M2 ECH ⏐6 & 7 Février 2015
2
Image en creux de la tradition, la modernité subsume une multiplicité de "modes"1,
facettes hétéroclites dont elle est la composition. Comportements, mentalités, disciplines,
courants artistiques et de pensée, objets même : l'adjectif "moderne" décrit une réalité
plurielle, polymorphe, changeante, dont la seule unité semble tenir à l'opposition symétrique
au folklore classique. Opposition qui procède notamment par éclatement, dispersion,
atomisation des pratiques et des idées, mouvement incessant tendu vers la nouveauté, contre
la stabilité séculaire de la coutume. En tant qu'elle caractérise une civilisation, la modernité
figure une unité paradoxale donc, unité que la synthèse travestit plutôt qu'elle ne l'élucide.
Et pour cause : appliqué à la société, c'est-à-dire à la culture telle qu'elle se diffuse de
l'épicentre européen, le terme se donne pour quasi synonyme celui d'"individualisme",
substantif oxymorique ("société individualiste") en lequel est précisément consacrée cette
impropriété à se réduire en un concept, en un modèle simple et intelligible, à portée de
compréhension, comme l'ont été les sociétés traditionnelles2. De fait, construit sur le double
principe d'un individuum préexistant identifié et de sa quantité numérique, l'individualisme se
charge des présupposés liés à leurs déterminations respectives, elles-mêmes non figées. En
témoigne l'historiographie de la notion dressée par Joël Roucloux3, le terme évolue avec les
écoles de pensées qui le théorisent, le contexte disciplinaire dans lequel il est convoqué, la
vision même de celui qui y fait allusion comme de celui qui le reçoit. Le consensus s'effectue
ainsi sur le mode de la confusion, intégrant "les notions les plus hétérogènes que l'on puisse
imaginer"4 sous un vocable trompeusement singulier, lequel semble escamoter qu'il existe en
définitive autant de formes d'individualismes qu'il y a d'individus.
Or, parce qu'il intervient comme la modalité de la modernité, son effectuation
pratique, l'individualisme focalise les regards des anthropologues, sociologues, psychologues,
philosophes et autres spécialistes de l'humain qui entendent expliciter l'être de cet homo
novus 5 , qui, plus que jamais, s'autoproduit et s'autodétermine et transforme ainsi
profondément les dynamiques des sociétés en lesquelles il se constitue. Comment, en effet,
lire cette humanité polymorphe ? A quelle échelle sa condition s'élucide-t-elle ? A l'heure de
1 cf étymologie latine du terme : modernus, être en vogue ; dérivé (tardivement) de modus, la mesure, et par extension, le mode, la manière d'être. 2 Voir par exemple les travaux d'anthropologie sur l'Inde de Louis Dumont, dans lesquels sont analysés les systèmes de caste, Une sous-‐caste de l’Inde du Sud, (1964) et surtout Homo hierarchicus, (1967). 3 Roucloux Joël, "Les cinq périodes de l'individualisme savant" L'histoire des idées et le débat sur l'individualisme, in Revue du MAUSS, 2006/1 (no27) pp. 185-‐211. 4 cf le sociologue et philosophe Max Weber, dans L'Éthique protestante et l'esprit du capitalisme (1905). 5 cf la définition de Jean-‐Jacques Salomon, "La fabrique de l'homme nouveau", in Journal français de psychiatrie 3/2002 (no17) pp. 41-‐44.
Mathilde THOMAZO M2 ECH ⏐6 & 7 Février 2015
3
la modernité avérée, voire redoublée dans la postmodernité, quel "mode" d'existence
l'individualisme produit-il?
En tant que forme caractéristique de l'ethos moderne, l'individualisme décrit un
ensemble de tendances, un mouvement culturel6 qui se croque à grands traits (I). La structure
ainsi mise à jour permet alors une lecture circonstanciée de la condition humaine à l'échelle
collective : elle offre une élucidation possible de la modernité sous son jour anthropologique
(II), à partir de laquelle se dessine en filigrane un ethos véritablement individuel : la
modernité comme ontologie (III).
Concept contesté et réalité irrécusée, l'individualisme, à cause de sa nature à la fois
singulière et plurielle, se prête mal à la théorisation systématique. En tant que fait social
cependant, c'est-à-dire collectif, il cristallise un ensemble de caractéristiques qui, à défaut de
l'élucider, l'identifient et en permettent un premier détourage. C'est ce à quoi s'attache
notamment Louis Dumont dans ses Essais sur l’individualisme (1983)7, recueil d'articles paru
dans la lignée initiée par d'Homo aequalis (1977) et construit sur la perspective de son
exploration de la société indienne, paradigmatique du type "traditionnel".
Critiquées pour leur dimension jugée excessivement théorique, les analyses de Louis
Dumont ont en effet le mérite de proposer un regard synoptique et distancié du phénomène de
l'individualisme, qui ouvre de fait une compréhension novatrice du motif de la société
occidentale. Compréhension par construction ("prise avec") : celle-ci se nourrit d'une
première "saisie" de la modalité traditionnelle, conçue comme l'anti-modèle de l'ethos
occidental, et est donc à même de mettre à jour des traits que l'étude historique avait
jusqu'alors ignorés. Compréhension par définition également, dans la mesure où la
Modernité, et avec elle l'individualisme qui en est le canevas, s'institue contre la Tradition, à
rebours de ses séculaires coutumes. Impossible alors de faire l'économie d'une "anthropologie
apophatique" qui s'élabore en creux de l'anté-moderne. C'est donc par l'intelligence des
formes civilisationnelles de l'image en négatif de l'Occident, l'Inde des castes, que L. Dumont
commence l'enquête qui aboutira aux Essais sur l'individualisme. A partir d'une monographie
6 Dans son examen de la société moderne, Louis Dumont analyse l'individualisme comme le fond sur lequel celle-‐ci se construit, son linéament culturel, soulignant ainsi à la fois son omniprésence et l'impensé dont il est l'objet. Cf Louis Dumont, Homo aequalis : genèse et épanouissement de l'idéologie économique, Paris : Gallimard, 1977. 7 Louis Dumont, Essais sur l’individualisme, Une perspective anthropologique sur l'idéologie moderne. Paris : Le Seuil, 1983.
Mathilde THOMAZO M2 ECH ⏐6 & 7 Février 2015
4
des Pramalai Kallar (ethnie de l'Inde du Sud)8, il dégage en effet sous les particularismes
régionaux les caractéristiques de la société traditionnelle par excellence : celle-ci s'organise
selon trois principes moteurs, la séparation (ou opposition, c'est-à-dire antagonisme pur-
impur), la hiérarchie et l'interdépendance des groupes. La première catalyse la répartition
ordonnée du tout social : "L’exécution des tâches impures par les uns est nécessaire au
maintien de la pureté chez les autres. Les deux pôles sont également nécessaires, quoique
inégaux [...]. La conclusion, c’est que la réalité sociale est une totalité faite de deux moitiés
inégales mais complémentaires."9 Sur le modèle de l'opposition Varna-Intouchables10, qui,
simultanément, sépare et lie les sous-parties du tout en cela qu'elle en institutionnalise les
rôles (processus de l'"englobement du contraire"11), la stratification sociale assigne ainsi à
chaque groupe son quanta de pouvoir relativement aux autres, c'est-à-dire à terme, son statut
hiérarchique. Les castes cristallisent alors une structuration "fonctionnaliste" de la société,
par ordres hiérarchisés, où chaque individu est un point de la matrice, à la fois défini par son
statut au sein du collectif et subordonné au tout de la société-communauté12. Il ne se
détermine pas lui-même, mais au contraire, par différenciation et intégration, soit
relativement. Cependant, si L. Dumont entend décrire la modalité de structuration de la
société indienne, il n'en élucide pas encore le moteur : "Nous ne prétendons pas que
l’opposition fondamentale soit la cause de toutes les distinctions de caste, nous prétendons
qu’elle en est la forme."13 Qu'elle en soit la forme ne manque pourtant pas d'être révélateur :
en effet, la répartition du pouvoir (dimension du temporel) qui établit la hiérarchie des castes,
parce qu'elle opère selon la modalité du religieux (pur-impur), suit et réalise l'ordre spirituel
(dimension du sacré) qui en est la légitimation14. Sa stabilité, assurée par la reconduction de
la stratification, répétition du Même, manifeste ainsi le schème mystique ou mythique qui le
fonde : elle traduit un modèle réincarnationniste, où la fatalité du présent est sublimée par la
8 L. Dumont, Une sous-‐caste de l'Inde du sud. Organisation sociale et religion des Pramalai Kallar., La Haye-‐Paris : Mouton, 1964. 9 L. Dumont, Homo hierarchicus. Le système des castes et ses implications, Paris : Gallimard, 1979 (rééd. coll., complétée de la postface : "Vers une théorie de la hiérarchie") [1967] 10 Les varna, ou "classes" rassemblent les groupes constitutifs de la société indienne selon leur degré de pureté : Brāhmana, Ksatriya, Vaiśya, et Śūdra (par ordre décroissant de pureté). Les Intouchables, par opposition, sont caractérisés en tant que caste par leur radicale impureté. 11 Ibid. p. 397. 12 Quoique non reprise par L. Dumont, nous appuyons ici sur la distinction effectuée par Ferdinand Tönnies pour souligner le caractère spontané de l'organisation et de la dynamique des castes. cf Ferdinand Tönnies Communauté et Société : catégories fondamentales de la sociologie, introduction et trad. de J. Leif, Paris, PUF, 1944 [1887]. 13 L. Dumont, Homo hierarchicus. Le système des castes et ses implications, Paris : Gallimard, 1979 (rééd. coll., complétée de la postface : "Vers une théorie de la hiérarchie") [1967] p. 67. C'est l'auteur qui souligne. 14 Cette répartition est d'ailleurs notifiée dans le Rig-‐Véda (X, 90, 12). cf Robert Deliège, Le système indien des castes, Presses universitaires du Septentrion, 2006
Mathilde THOMAZO M2 ECH ⏐6 & 7 Février 2015
5
perspective de l'éternel retour, la condition temporelle dépassée par l'immortalité de l'âme. La
temporalité cyclique garantit de fait la sauvegarde de l'ordre, elle neutralise l'irrationalité du
devenir, incertain par essence, dans la palingenèse qui anéantit la mort et donc l'inconcevable.
Or le schéma traditionnel mis à jour par L. Dumont dans son analyse des castes se
vérifie également dans l'Antiquité et le Moyen-Âge occidental. Quoique non identifiés
expressément, les éléments structurants des sociétés médiévales et antiques s'organisent en
effet selon le même modèle de distinction-complémentarité : le tout social est divisé en sous-
groupes fonctionnels qui assurent ensemble la pérennité collective. Dans l'Europe pré-
moderne, les rôles sont ainsi partagés entre les oratores - ceux qui prient -, laboratores -
ceux qui travaillent - et bellatores - ceux qui combattent -, chaque individu étant à la fois
indispensable en tant que fonction, interchangeable en tant que support (hypokeimenon)15. De
même, l'Antiquité théorise une cité idéale, bâtie sur cette tripartition : "L'État nous a paru
juste, parce que chacun des trois ordres de citoyens qui le composent, remplit les fonctions
qui lui sont propres." 16 Symptomatique d'une conception cyclique du temps, cette
organisation va de pair avec une préemption du spirituel17 sur le politique qui garantit la
stabilité de la structure et en assure le contrôle à toutes les échelles (individuelle,
communautaire et de l'ensemble). C'est donc sur la même base "holiste", opposée par
construction à "l'individualisme", que nait cette nouvelle forme d'ethos collectif que Tönnies
reconnait comme une véritable "société" (distinguée de la "communauté"). De fait, elle
correspond à une transformation profonde du rapport entre l'individu et le monde, catalysée
par le christianisme. Dans ses Essais sur l’individualisme (1983), L. Dumont décrit en effet la
rupture induite par la proclamation d'un royaume hors-le-monde, miroir négatif de la
permanence matérielle que sous-tendaient les doctrines réincarnationniste (répétition du
Même) : en instituant un "royaume éternel" hiérarchiquement supérieur (et même
incommensurable) à la dimension de la mondanéité, le christianisme renverse l'ordre des
pouvoirs. Il opère d'abord sur l'auto-conscience de l'individu : celui-ci, soumis à la seule loi
divine (puisqu'il est un "individu-en-relation-à-Dieu"), se suffit à lui-même et devient le
centre de son propre monde. Il est un "individu-hors-du-monde" (à l'image des Renonçants
indiens), affranchi du joug identitaire imposé par son statut social et mis sur un pied d'égalité
avec ses pairs, c'est-à-dire tout membre du tout social. Il est ainsi remis à lui-même, condition
15 cf le modèle des fonctions tripartites indo-‐européennes mis en évidence par George Dumézil dans Mythe et Épopée I. II. & III., Paris : Gallimard, 1995. 16 Platon, La République (livre IV) trad. V. Cousin, 435b. 17 Le spirituel ne signifie pas nécessairement le religieux : ici il désigne l'ensemble des croyances qui assument une âme immortelle, candidate à la métempsychose, transmigration et autres modes de palingenèse.
Mathilde THOMAZO M2 ECH ⏐6 & 7 Février 2015
6
nécessaire et suffisante de son autodétermination, quoique cette égalité et cette liberté
constitutives ne soient encore effectives que devant Dieu. Intervient alors le second moment
de la genèse de l'individualisme : le retour au monde. Avec la subordination du pouvoir
temporel à la papauté sous le pontificat de Gélase (vers 500) d'abord, bientôt étendu aux
principautés italiennes, le spirituel intervient comme une puissance politique, investie dans
les affaires mondaines et temporelles. Avec la Réforme ensuite (1536), l'individu reprend sa
place dans le monde : il se fait acteur de la cité chrétienne terrestre, cherchant dans le succès
matériel sa justification devant Dieu. "L'individu-hors-du-monde" rendu à la Cité terrestre
initie alors un mode d'existence inédit qui caractérisera bientôt la modernité.
C'est à partir de l'"individu-dans-le-monde" chrétien que se diffusent en effet les
valeurs qui sous-tendent l'"idéologie moderne", c'est-à-dire l'"ensemble social de
représentations, d'idées et de valeurs communes dans une société"18 qui participent de son
identité. Au lieu de l'idéologie symptomatique de la configuration holiste, soit "un ensemble
social de représentations qui valorisent la totalité sociale et négligent ou subordonnent
l’individu humain"19, se compose progressivement à partir du ferment des valeurs chrétiennes
un mode de vie collectif dans lequel prime "l’individu humain en tant qu’être moral,
indépendant, autonome, et ainsi essentiellement non social"20. La dynamique propre à
l'individualisme constitue donc un véritable renversement par rapport à son antécédent
holiste. Elle marque un déplacement des valeurs, qui suivent (ou causent?) l'évolution de la
relation de l'individu au monde : originairement placées dans le tout, indispensable à la survie
de chacun, celles-ci se projettent hors le monde pour s'attacher à la seule Cité de Dieu, dont
chaque membre vaut en soi et pour soi, puis réinvestissent la dimension de la matière en
conservant la localisation de l'absolu dans l'individu, désormais précieux au delà de son statut
communautaire, de sa fonction dans le tout collectif. Avec le retour au monde cependant, la
valeur prend la modalité du temporel : elle s'incarne dans le pouvoir21. L'être se signifie dans
l'avoir. L'individu-valeur (et valeur finale) instruit ainsi un nouveau rapport à son monde,
rapport de domination-possession22 manifesté par la technique. Renversement des valeurs qui
opère également directement sur le plan politique : la "communauté" telle que décrite par 18 Louis Dumont, Essais sur l’individualisme, Une perspective anthropologique sur l'idéologie moderne. Paris : Le Seuil, 1983, p. 263. 19 Ibid. p. 26. 20 Ibid. pp. 27-‐28. 21 L. Dumont analyse à ce sujet l'influence de Machiavel (Le Prince, 1513) sur la séparation des puissances temporelle et spirituelle et le développement d'une science du pouvoir politique, c'est-‐à-‐dire justifiée par sa seule dimension terrestre. (la nécessité pratique). 22 Rapport dont l'élan est d'ailleurs -‐ abusivement -‐ attribué à René Descartes, qui préconise l'usage des sciences et des techniques pour se rendre "comme maitre et possesseur de la nature". Cf le Discours de la méthode (partie VI), (1637).
Mathilde THOMAZO M2 ECH ⏐6 & 7 Février 2015
7
Tönnies laisse là la place à une "société" au sens plein. Plutôt qu'un regroupement spontané,
fondé sur la "volonté organique" de ses membres et motivé par l'impératif de la survie, le
rassemblement des individus modernes s'officialise dans le contrat social23, "convention
collective" et manifestation de "la volonté réfléchie" du grand nombre, coordonnée par la
recherche du bonheur24. Chacun est ainsi titulaire de droits individuels, universels, qui le
libèrent des structures nécessairement contraignantes instituées par les rapports
communautaires et instituent l'égalité. La distribution terrestre des pouvoirs ne répond plus à
une logique surnaturelle qui la justifie absolument, mais se conçoit comme un accident
remédiable, dont il appartient à chaque membre du tout social de se faire l'arbitre et le
démiurge. L'Etat n'est plus alors que le garant de cette égalité de principe, le point d'appui de
l'agir individuel. La pensée, dimension intérieure au sujet - et donc dissimulée à l'analyse
anthropologique de L. Dumont qui se focalise sur les motifs extérieurs de l'ethos collectif, sa
modalité pratique -, devient alors l'instrument de son mode de vie, le lieu d'où il se crée en
tant qu'individu25. La révolution copernicienne engagée par Descartes avec la formulation du
cogito concentre un long mouvement de déploiement de l'identité intime, catalysée par
l'influence des Lumières, pour lesquelles la Raison doit se faire individuelle26 et ouvre
l'espace intérieur à sa propre réflexion (aux sens physique et mental). Espace dans lequel se
développe alors la vie du "je", élément nodal d'une modernité plurielle et polymorphe.
L'anthropologie comparative (L. Dumont), complétée de la perspective historique (C.
Taylor) permet ainsi de mettre à jour les grands traits de l'"individualisme moderne" en tant
qu'ethos collectif et de dépasser ainsi la dichotomie entre "individualisme méthodologique",
qui prône une lecture purement nominaliste de la société (il la conçoit comme une collection
d'éléments unitaires indépendants)27, et nouvel "holisme", qui considère le tout plutôt que
l'individu. Cependant, si ses caractéristiques structurelles et son histoire assurent un
détourage du phénomène individualiste, elles n'en élucident pas encore le fond, c'est-à-dire la
23 Nous faisons ici allusion aux théories du contrat social initiées par Grotius et principalement conduites par Hobbes (1651), Locke (1690) [non cité par L. Dumont], Rousseau (1762), et dont L. Dumont lit l'aboutissement dans la Déclaration Des Droits de l'Homme et du Citoyen (1789). Pour l'anthropologue, les racines de cette métamorphose politique sont à attribuer à la plenitudio potestatis proclamée par Innocent III (XIIIème siècle) et à la doctrine occamienne qui contredit la hiérarchie des droits établie par St Thomas (XIVème siècle). 24 Comparaison entre "communauté" et "société" dressée par Ferdinand Tönnies, Communauté et Société : catégories fondamentales de la sociologie, introduction et trad. de J. Leif, Paris, PUF, 1944 [1887]. 25 Pour F. Tönnies, "La volonté réfléchie est un produit de la pensée", cette dernière en est donc la condition nécessaire et suffisante. 26 cf Charles Taylor, Les sources du moi, la formation de l'identité moderne. Paris, Le Seuil, 1998 [1989]. 27 Querelle notamment explicitée par Vincent Descombes dans "Les individus collectifs", Revue du MAUSS, 2001/2 (No 18), p. 305-‐337.
Mathilde THOMAZO M2 ECH ⏐6 & 7 Février 2015
8
condition sociale du moderne. Munie des concepts de la sociologie et de l'anthropologie, "la
philosophie d’aujourd’hui a-t-elle le moyen de faire la différence entre une collection et un
tout, et par là de fournir un statut métaphysiquement satisfaisant aux individus collectifs?"28
La société née de la "contamination" individualiste initiée par les valeurs chrétiennes
révèle de fait un mode d'existence collective profondément transformé par rapport à sa
prédécessrice holiste et donc unifiée sous une volonté organique, en un tout structuré pour sa
conservation. Première dynamique remarquable, l'uniformisation trahit un processus
paradoxal à l'œuvre dans la société individualiste. Les valeurs de liberté et d'égalité,
désormais universelles (ou à vocation de l'être), agissent en effet comme des forces
"niveleuses"29, qui, loin de faire éclater la société, conduisent à la standardisation des modes
de vie, c'est-à-dire à la généralisation d'un ethos unifié de fait, homogène, "habitus social"
total parce qu'universel (en tant qu'il s'adosse à une définition unique de l'être humain). Et
pour cause, à l'heure où le pouvoir se distribue horizontalement selon la règle de l'égalité, ses
formes d'exercice tendent à reproduire le même possible, polarisé par la recherche du
bonheur qui en détermine la réalisation. Or ce pouvoir opère dans une société de marché
catalysée par le progrès technique (lui-même résultant du renversement des valeurs constitutif
à la modernité30), où il se manifeste dans la possession, comme l'extension matérielle de
l'identité individuelle. Chacun tend ainsi à maximiser son capital, trouvant dans la propriété,
l'expression de son existence propre dans le tout social. La consommation de masse
concrétise alors une logique inhérente aux valeurs de l'individualisme : elle marque
l'avènement d'une véritable "culture", motif régulier de l'agir, qui, contre le principe
hiérarchique indissociable du holisme (qui de découpent en communautés agissantes),
reconstruit le tout à partir des comportements individuels qui sont le fondement de sa
structure. De sorte que, loin de se disséminer en micro-trajectoires inintelligibles
collectivement, la modernité assiste donc plutôt à l'émergence de nouvelles composées,
éléments empiriques qui se subsument sous la "société de masse" (connotation péjorative
mise à part), dans laquelle chaque individu se produisant soi-même participe d'un macro-agir
constaté. L'uniformisation se caractérise ainsi par une agrégation paradoxale car opérée à
partir d'un ensemble d'éléments indépendants, atomisés, motivés par leurs intérêts personnels
au regard desquels les liens communautaires - stables - disparaissent au profit de connexions
28 Ibid. p. 320. 29 Allusion aux Niveleurs anglais du XVIIème siècle, qui revendiquaient l'égalité devant la loi et la liberté dans l'activité économique. 30 cf Karl Polanyi, La Grande Transformation, Aux origines politiques et économiques de notre temps, Gallimard, 1983 (1944), (nous évoquons ici la synthèse historique dressée dans les premiers chapitres).
Mathilde THOMAZO M2 ECH ⏐6 & 7 Février 2015
9
ponctuelles, décomposées et recomposées par la concurrence, agrégation pourtant homogène.
La masse, ou "la foule", distinguée par Gustave Le Bon de la simple "agglomération
d'hommes" comme du "super-individu"31, témoigne d'une "unité mentale" non volontaire et
cependant véritablement opératoire : privée de la loi hiérarchique, elle est régie par la norme,
règle tacite qui institue un référentiel contraignant aux actions particulières. Le visage de la
société moderne se laisse alors saisir à l'échelle de la totalité, comme le résultat empirique de
l'impression des valeurs individuelles dans les comportements. Mécanisme qui, selon L.
Dumont, contient en germe les ingrédients du totalitarisme, "maladie de la société
moderne"32, et figure extrême, caractéristique de son énigmatique mais irréductible unité.
Or "la guerre est le fait social total à travers lequel peuvent être appréhendées les
totalités sociales, elle fournit un « point de vue de l’ensemble »"33, d'autant plus probant qu'il
s'agit précisément de comprendre les conditions de recréation de cet ensemble. Si le
totalitarisme est une forme déficiente de la société individualiste, s'il en "exprime de manière
dramatique"34 les traits et exagère inévitablement sa réalité, il en donc met en lumière les
motifs essentiels et permet ainsi une capture plus pénétrante de l'ethos moderne. De fait, la
dissémination des valeurs chrétiennes qui aboutit à l'individualisme contemporain ne procède
pas selon une physique simpliste modélisable par un phénomène de propagation uniforme en
milieu neutre. En effet, l'appareil de significations qui produit l'individu s'affronte
nécessairement avec l'idéologie traditionnelle-holiste en place, de sorte qu'il n'y a pas de
société purement moderne, mais seulement "des acculturations modernes, rencontres à
chaque fois spécifiques entre l’idéologie moderne et des traits non modernes"35. Or, ce que
ces combinaisons particulières ont en commun réside précisément dans le phénomène du
métissage, par lequel ces valeurs antagonistes s'interpénètrent et se transforment
mutuellement. Les "représentations hybrides" qui en résultent constituent ainsi le "fait
massif"36 de la modernité, dans laquelle "l’individualisme est d’une part tout puissant et de
l’autre perpétuellement et irrémédiablement hanté par son contraire" 37 . Le cas du
31 Gustave Le Bon, Psychologie des foules, Alcan, Paris, 1895. 32 Louis Dumont, L’idéologie allemande: France-‐Allemagne et retour, Paris : Gallimard, 1991, p. 26-‐28. 33 cf les analyses de V. Descombes dans "Pour elle un Français doit mourir", Critique, (No366), 1977, pp. 998-‐1027 (art. cit., p. 1023.), reprises ici par P. de Lara., "Anthropologie du totalitarisme" Lectures de Vincent Descombes et Louis Dumont, Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2008/2 (No63), p. 353-‐375. (art. cit. p. 359) 34 Louis Dumont, L’idéologie allemande: France-‐Allemagne et retour, Paris : Gallimard, 1991, p. 28. 35 de Lara Philippe, "Anthropologie du totalitarisme" Lectures de Vincent Descombes et Louis Dumont, Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2008/2 (No63), p. 353-‐375. (art. cit. p. 355) C'est l'auteur qui souligne. 36 Louis Dumont Essais sur l’individualisme, Une perspective anthropologique sur l'idéologie moderne. Paris : Le Seuil, 1983, p. 30. 37 Ibid., p. 28.
Mathilde THOMAZO M2 ECH ⏐6 & 7 Février 2015
10
totalitarisme en est alors une illustration éloquente : "le totalitarisme est un régime hybride,
l’exacerbation de l’hybridation propre à la société moderne, la tentative de restaurer la
communauté holiste sur des prémisses individualistes."38 La problématique que soulève cette
utopique reconstitution se déplace là du "comment?" au "pourquoi?", car la subordination
particulière au tout qui découle de l'enracinement holiste tacite (et inconscient) des sociétés
individualistes n'est pas encore suffisante à expliciter la convergence des volontés, libres, en
une foi fantastique telle que "dans un régime totalitaire parfait [...] tous les hommes sont
devenus Un Homme"39. La démesure totalitaire révèle en effet, sous le caractère hybride du
tout social, une dynamique puissante qui imprime à la norme sa force et en élucide
l'effectivité : le principe religieux. Que cette religion soit "séculière" ou proprement
"théologale", qu'elle soit, enfin, privée de terme téléologique, importe finalement peu au
regard de sa portée pratique, la dimension véritablement mobilisatrice qui la caractérise. De
fait, la modernité correspond à un mode inédit de religiosité, une "religion de la personne"40
selon l'expression durkheimienne, qui exhausse au rang de sacré les valeurs démocratiques, et
dont l'unité s'explique donc par la forme même de ces valeurs. L'idéologie explicitement
religieuse des sociétés traditionnelles cède là la place à une pensée délibérément "anti-
religieuse" ou areligieuse dont le fondement est lui-même implicitement religieux41. Plutôt
qu'une traduction obvie du sacré dans l'organisation sociale, la "foi" moderne opère
tacitement, dans le filigrane de la pensée individuelle et comme le linéament sur lequel elle
s'appuie. Le totalitarisme n'est ainsi qu'un retour en règle exprès du principe religieux sous la
forme de "l’adéquation pleine et entière de la société à une vérité depuis toujours
prédéterminée"42, dramatiquement incompatible avec le système démocratique.
Retour au religieux donc, dans le sens où celui-ci s'incarne dans une "foi" pratique,
mais non pas retour à l'eschatologie. La croyance des individus modernes, avertie par l'échec
des idéologies (au sens usuel) politiques du XXème siècle renonce en effet à leur visée
38 de Lara Philippe, "Anthropologie du totalitarisme" Lectures de Vincent Descombes et Louis Dumont, Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2008/2 (No63), p. 353-‐375. (art. cit. p. 365). L'auteur reprend ici une hypothèse de L. Dumont, formulée dans Homo aequalis. (p. 21-‐22) : "le totalitarisme résulte de la tentative, dans une société où l’individualisme est profondément enraciné, et prédominant, de le subordonner à la primauté de la société comme totalité." 39 Hannah Arendt, Le système totalitaire, Paris : Le Seuil, 2005 [1972] p. 213-‐214. 40 Emile Durkheim interroge en effet l'ethos collectif comme le fait du religieux, il traduit "la religion qui soutient l’État moderne dans la société industrielle." (repris par V. Descombes, dans "Pour elle un Français doit mourir", Critique, (No366), 1977, pp. 998-‐1027) 41 Marcel Gauchet, "Religion et politique : état des lieux", Les chemins de la connaissance, France Culture, 2002. Disponible en ligne : http://gauchet.blogspot.fr/2006/08/religion-‐et-‐politique-‐tat-‐des-‐lieux.html [Consulté le 12/04/15] 42 Marcel Gauchet, La condition politique, Paris : Gallimard, 2005, p. 331-‐332.
Mathilde THOMAZO M2 ECH ⏐6 & 7 Février 2015
11
téléologique : c'est "la fin de l'histoire finie"43. L'analogie totalitaire atteint là la limite de sa
pertinence : à l'heure où l'histoire renonce à produire le sens, la sacralisation ne s'applique
plus à un but commun (transcendant l'individu), vecteur de l'agrégation sociale en un tout,
mais "retombe" dans les normes (immanentes), ciment de l'assemblée humaine. Si
l'interprétation religieuse éclaire le modus operandi de la cohésion sociale, il faut donc la
comprendre dans un registre tout différent de celui qui fédérait la communauté traditionnelle
ou transformait la société en son pendant holiste monstrueux (le totalitarisme). Celle-ci doit
plutôt s'attacher à constater les conséquences de la mise au centre du lien social les valeurs
individualistes elles-mêmes, valeurs dorénavant "normatives", placées au-dessus de la loi44.
La normativité du religieux (actualisée par la transcendance) se reporte là sur les valeurs de
l'individualisme (liberté-égalité). Dans un tel paradigme, l'action collective n'est plus dirigée
par un but, mais se déploie dans un référentiel nécessaire qui en garantit la pérennité.
L'uniformisation observée, catalysée et régionalisée par le reliquat de holisme intériorisé par
les sociétés individualistes, correspond ainsi à un "dressage" autonome de chacun par lui-
même pour coïncider avec le vis-à-vis collectif, vis-à-vis incarné dans la figure de
personnalités publiques notoires45. L'agir, orienté vers l'intérêt particulier (sens subjectif), est
cependant déterminé par le jugement tacite de la "masse", mesuré à l'aune des valeurs
intériorisées traduites par la norme46. Du point de vue de l'ensemble, les comportements
individuels s'agencent donc par "groupes de statut", sous-ensembles liés par l'égalité de
niveau de prestige, qui reproduisent l'identité fonctionnelle des éléments des hiérarchies anté-
modernes47. Paradoxalement, l'autocréation de soi régénère la distribution par rôles des
acteurs de la société, à la différence que l'architecte est cette fois immanent, sa voix intérieure
à chacun et déplacée en amont de la conscience, exprimée finalement par la liberté
individuelle. Le cas du progrès illustre précisément cette dynamique : plutôt que de situer
dans l'horizon de l'action un telos identifié et désirable, celui-ci opère à sa source, la justifiant
totalement sans déporter sa légitimation sur son but. L'habitus techniciste s'autoalimente, la
seule possibilité d'agir suffisant à en motiver la réalisation dans le cadre ouvert par la
structure normative de l'individualisme. Le sens, l'orientation communautaire, les "grands 43 Marcel Gauchet, "Religion et politique : état des lieux", Les chemins de la connaissance, France Culture, 2002. 44 Maesschalck M., Pariente-‐Butterlin, I., Renault, E. et alii., "Philosophie des normes", in Multitudes (No34), Automne 2008. Disponible en ligne : http://www.multitudes.net/category/l-‐edition-‐papier-‐en-‐ligne/multitudes-‐34-‐automne-‐2008/mineure-‐philosophie-‐des-‐normes/ [Consulté le 13/04/15] 45 Nous nous appuyons ici sur la lecture de la "culture postmoderne" de Peter Sloterdijk, Règles pour le parc humain. Une lettre en réponse à la Lettre sur l'Humanisme de Heidegger, (trad. par O. Mannoni), Paris, Éditions Mille et Une nuits, "La petite collection", 2000. 46 Max Weber, Économie et Société, Les catégories de la sociologie Pocket, 1995 (posth. 1921), p. 4 47 Ibid., p. 935 et 938.
Mathilde THOMAZO M2 ECH ⏐6 & 7 Février 2015
12
récits"48 à la fois régulateurs et moteurs, sont finalement caducs. La rupture des la tension
assurée par l'idéal mythologique (dans le sens élargi d'"objet d'espoir") aboutit alors à un
profond et paradoxal retournement de la perspective initiée par le christianisme : alors que le
Royaume des cieux instituait un bien transcendant qui justifiait en lui-même les efforts
déployés pour l'atteindre, l'agir moderne se situe dans un temps clos, aneschatologique, pris
dans un présent éternel qui reproduit la temporalité cyclique des société traditionnelles.
A l'échelle collective donc, l'individualisme prend la figure d'une unité paradoxale,
un tout macroscopiquement uniforme fondé sur la norme qui structure l'apparente anomie
moderne. Le totalitarisme, né de l'exacerbation de ces héritages holistes dans le substrat
atomisé de la société en constitue la caricature : il met à jour de façon explicite la force
idéologique des normes, leur modalité "religieuse" et leur conséquence sur l'organisation
sociale qui s'achemine vers une forme de fonctionnalisme empirique. Cette particularité de la
modernité conduit alors à une véritable décompression temporelle : privé de sa référence
eschatologique, le temps se replie sur lui-même, comprimé soudain dans un présent
permanent qui imite la cyclicité des systèmes palingénésiques. L'anthropologie de la
modernité en fournit donc une représentation paradoxale, à la lumière de laquelle celle-ci
semblerait à terme marquer un retour aux modes traditionnels d'organisation, de
temporalisation et de structuration de l'ensemble social.
A l'échelle individuelle pourtant, le "fait moderne", tel que détouré par la sociologie
durkheimienne et l'anthropologie comparative de L. Dumont, s'envisage sous un jour plus
profondément philosophique dans le sens où il se conçoit dans la perspective de l'homme-
sujet, comme un "mode d'existence" subjectif et singulier, non soumis à l'incertitude de
principe qui contrarie l'analyse des sciences humaines 49 . Sous la régularité des
comportements et les traits collectifs, la vie se déploie en effet d'abord dans le for intérieur du
"je", à partir de laquelle s'extériorisent les manifestations individuelles qui confluent et
s'interpénètrent pour dessiner les motifs de l'ensemble. C'est donc dès l'intime de ce sujet que
doivent s'envisager les logiques apparemment contradictoires de l'individualisme, qui atomise
pour uniformiser, égalise pour stratifier, et impose à la liberté, sous la forme de la norme, un
joug tacite implacable. De fait, du reste, l'individualisme concerne le sujet en premier chef et
dernier recours : il lui assigne la totalité de la valeur, faisant de l'ego l'acteur et la finalité de
48 Jean-‐François Lyotard, La Condition postmoderne, éd. Minuit, 1994 [1979]. 49 A ce sujet, voir notamment les critiques formulées à l'égard de L. Dumont par V. Descombes ("Les individus collectifs") et Fransisco Vergara ("Les erreurs et confusions de Louis Dumont", L'Économie +politique 3/2001 (No11), pp. 76-‐98).
Mathilde THOMAZO M2 ECH ⏐6 & 7 Février 2015
13
l'existence collective. Caractérisé par la pénétration et contamination des valeurs d'égalité et
de liberté dans la communauté humaine, le processus d'autonomisation de l'individu aboutit
en effet à la cristallisation de la valeur dans l'individu lui-même, il devient le centre de son
monde. La renonciation à la transcendance symbolisée par "la mort de Dieu"50, c'est-à-dire du
motif traditionnel du religieux qui justifiait les existences particulières dans le canevas
immuable du collectif, reporte ainsi sur chacun la charge de sa propre vie. La "religion de la
personne" institue chacun en motif absolu de son agir, charge que n'atténuent qu'à peine les
résidus holistes intégrés accidentellement, et qui, en regard du "progrès" toujours à venir font
figure de reliques obsolètes51. Le repli sur soi de la temporalité ne traduit donc pas
simplement la mécanique l'habitus moderne, mais met à jour un malaise plus profond que la
perspective ontologique élucide seule : la confrontation, soudain directe et inéluctable, de la
vie égologique avec sa fin. Confrontation rendue inévitable par le rejet des eschatologies
religieuses et la faillite des "idéologies historiques"52, qui libèrent l'espace intérieur pour la
pensée. Confrontation, , qu'exaspère la modalité de la vie moderne ; de fait, élevé au rang de
sa propre divinité, le sujet supporte d'autant plus mal l'évidence de sa mort, indépassable et
absurde. Comme le remarque Martin Heidegger, si l'humanisme et ses variantes ont tenu à
distance la mission principale de l'homme, leur échec ouvre en effet l'intériorité de l'ego,
"l'éclaircie de l'Être" (Lichtung : percée lumineuse), à la dilatation de sa "tonalité
fondamentale" (Grundstimmung : présence à soi), dans laquelle sa condition se révèle et
s'impose à lui simultanément dans toute sa radicalité : " l'essence de l'homme repose dans son
ek-sistence"53. C'est-à-dire qu'il expérimente, en même temps que sa grandeur (il est "le
Berger de l'Etre"), son absolue impuissance vis-à-vis de sa position d'"être-jeté", placé là d'où
il peut accomplir sa tâche ontologique propre : "garder l'Être et correspondre à l'Être"54. Or
cette fatalité invincible de l'"être-là" se situe de fait en tension vis-à-vis de sa fin, enserrant
l'ego dans l'étroitesse d'une vie qui s'achemine inexorablement vers son terme : par la liberté
même qui le dispose face à la Vérité de l'Être, il est livré à l'angoisse (die Angst : la peur,
reprise du vocabulaire kierkegaardien).
50 Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, Un livre pour tous et pour personne, Société du Mercure de France, Paris, 1903, [1885] p. 11. 51 Voir à ce sujet la critique de la modernisation par Walter Benjamin, qui voit dans l'incommunicabilité de l'expérience (Erfahrung), symptôme terminal de l'atomisation de la vie sociale, la tombée en désuétude de la mémoire et du passé. 52 Marcel Gauchet, "Religion et politique : état des lieux", Les chemins de la connaissance, France Culture, 2002. 53 Martin Heidegger, Lettre sur l'humanisme-‐Über den Humanismus, (trad. R. Munier) Aubier éditions Montaigne, Paris, coll. bilingue, 1970. (p. 81) 54 Ibid., p. 26
Mathilde THOMAZO M2 ECH ⏐6 & 7 Février 2015
14
Expression dramatique de sa condition, cette coloration intérieure du sujet, parce
qu'elle coïncide avec le triomphe de la liberté qui sous-tend l'individualisme, marque un
changement profond dans la vie égologique. Loin d'être inexistante dans les communautés
traditionnelles, celle-ci se déploie cependant dans le sens de l'éternel retour assuré par la
palingenèse et qui neutralise la perspective de la mort comme fin. L'irruption du
christianisme ne rompt pas encore avec cette conception du trépas comme un "passage" qui
fonde le sens de l'existence toute entière : au contraire, avec la promesse du Royaume céleste,
c'est le monde lui-même qui est relativisé55 au profit de l'horizon béatifique ouvert par la
révélation. Et le retour au monde, précipité par l'intervention de l'Eglise dans le pouvoir
temporel, ne constitue pas encore une rupture de l'eschatologie chrétienne, mais correspond à
son incarnation ; chacun conduit alors sa vie à la lumière du Salut annoncé, vie tendue par
l'espérance qui fournit à la liberté individuelle un référentiel absolu, une structure intérieure.
La "mort de Dieu" et la renonciation aux idéaux politiques anéantit précisément cette
espérance et lui substitue de fait l'angoisse, la pesanteur d'être, la "charge" de la vie56 que
chacun doit porter pour lui-même, individuellement. La "libération de la liberté"57, c'est-à-
dire la liberté privée de telos communautaire, remise à elle-même, se reçoit ainsi finalement
comme un poids, la tâche autrefois déléguée au tout social de s'accomplir désormais soi-
même, individuellement. Le cadre moral, politique, spirituel de chacun n'est plus donné par le
groupe mais doit être construit par lui, assemblé par ses choix et ajusté sans cesse. A l'heure
où les valeurs de liberté et d'égalité prévalent et placent l'individu à l'épicentre de sa propre
vie, l'histoire change de forme. Elle n'est plus que "ce que nous en faisons avec nos pauvres
moyens humains"58, tramée dans les décisions personnelles et portée à mains d'homme. Or
cette assignation implacable, péremptoire et absolue de se construire soi-même et, par
extension, de produire l'histoire, exige de l'individu une énergie formidable et constante. Sans
relâche, il doit dessiner sa propre identité, jamais échue, toujours à conquérir et à défendre.
Energie qui, à force d'exercice, s'amenuise et s'épuise, le confrontant alors à "la fatigue d'être
soi"59. "Le déclin de la tradition se paye en difficulté d’être soi. La société d’après la religion
55 Louis Dumont Essais sur l’individualisme, Une perspective anthropologique sur l'idéologie moderne. Paris : Le Seuil, 1983 56 cf Michel Henry : "La culture est l'ensemble des entreprises et des pratiques dans lesquelles s'exprime la surabondance de la vie, toutes elles ont pour motivation la « charge », le « trop » qui dispose intérieurement la subjectivité vivante comme une force prête à se prodiguer et contrainte, sous la charge, de le faire.", La Barbarie, Grasset, Paris, 1987, p. 172 57 Marcel Gauchet, "Religion et politique : état des lieux", Les chemins de la connaissance, France Culture, 2002. 58 Ibid. 59 cf Ouvrage éponyme du psychiatre Alain Ehrenberg, sous-‐titrée Dépression et société, Paris, Odile Jacob, 1998. Troisième tome d'une vaste enquête sur les modalités psychologiques de l'individualisme, ses
Mathilde THOMAZO M2 ECH ⏐6 & 7 Février 2015
15
[...] est une société psychiquement épuisante pour les individus, où rien ne les secourt ni ne
les appuie plus face à la question qui leur est retournée de toutes parts en permanence :
pourquoi moi ? Pourquoi naître maintenant quand personne ne m’attendait ? Que veut-on ?
Que faire de ma vie quand je suis seul à la décider ?"60
Cette difficulté inédite à se dresser pour soi-même au devant de soi même et du
monde aboutit alors à des comportements apparemment paradoxaux. Soucieux de mettre en
perspective les traits majeurs de la modernité, A. Ehrenberg confronte des pratiques
censément incompatibles avec l'atomisation sociale : d'une part, il constate la
"spectacularisation" généralisée de la vie, mise en scène et largement partagée, dynamique
catalysée par les Nouvelles Technologies de l'Information et des Communications (NTIC) ;
d'autre part, il souligne la généralisation des tendances addictives, qui mettent à jour la quête
de sensations et de (con)fusion de soi avec le collectif. Or, ces deux aspects convergent dans
une recherche du divertissement, de la légèreté caractéristique de l'in-souci-ance ; ils
manifestent une volonté de neutraliser l'angoisse par l'oubli de soi et la pesanteur par l'activité
permanente, la stimulation incessante. Divertissement pascalien au sens plein : celui-ci
éconduit la pensée pour la préserver de considérer sa propre fin, il prévient l'entrée en soi-
même de l'ego où la vie se reçoit dans sa pleine gravité. Contre "l'esprit de sérieux", la
légèreté. Caractère superficiel qui ne satisfait pas cependant à une représentation fidèle de la
modernité, à laquelle Nietzsche reprochait précisément son "esprit de lourdeur"61. De fait,
l'exténuation de la morale religieuse explicite pour l'avènement des "droits inaliénables" de
l'individu laisse la place à une construction de soi qui s'effectue désormais dans le vis-à-vis
social, c'est-à-dire à partir de normes. Or ces normes, uniformisantes et orientées par
l'intégration inconsciente d'héritages holistes à l'échelle collective, sont, à l'échelle
individuelle, le symptôme d'un besoin : elles manifestent la nécessité pour la constitution
identitaire d'une structure de référence, d'un arsenal de valeurs extérieur à soi, dans lequel la
liberté trouve la matière de ses choix. Le visage singulier se compose ainsi selon le motif des
normes qu'il élit, contribuant par construction à en renforcer l'emprise. De sorte qu'au lieu des
principes moraux inspirés par la transcendance et maintenus par le sacré dans les
communautés traditionnelles, la société moderne institue malgré elle des lois tacites
arbitraires, sans justification sinon l'adhésion du grand nombre, et investie du pouvoir qui s'y
conséquences sur la santé psychique des personnes, La fatigue d'être soi analyse la dépression comme la maladie de la modernité, causée par le surcroît de choix offerts à chacun et l'impératif reconduit sans cesse de son initiative. 60 Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde, Paris : Gallimard, 1985, p. 302. 61 Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, Un livre pour tous et pour personne, Société du Mercure de France, Paris, 1903, [1885] p. 277.
Mathilde THOMAZO M2 ECH ⏐6 & 7 Février 2015
16
attache. L'accablante pesanteur des structures anté-modernes se reporte finalement dans la
modernité avec d'autant plus d'efficacité que leur système de valeurs est implicite, immanent,
inséré dans le filigrane même de la genèse identitaire. Lourdeur qui réactualise alors
l'impératif cathartique de formes désinvoltes et vénielles de vivre, image mimétique de la
"superficialité par profondeur"62 des Antiques qui dans les Dionysiaques et Apollonides,
manifestaient leur conscience aigue du tragique de leur condition, de l'absurdité de la vie
humaine. La légèreté moderne cependant, parce qu'elle réagit à l'angoisse, c'est-à-dire au
"poids le plus lourd" de l'exigence de sens, que chacun, chargé qu'il est de s'accomplir lui-
même, s'efforce malgré lui de satisfaire, cette légèreté revisitée s'exacerbe dans des modes
d'existence nouveaux, déchirés entre la volonté de nier l'étau de l'angoisse et le besoin de
produire du sens. En miroir de la désinvolture volontaire, la réalisation de soi permanente
engendre en effet des formes collectives inédites, agrégées autours de nouveaux "grands
récits" dans lesquels la transcendance est produite par l'homme et dont la science est
l'expression cultuelle. D'un coté comme de l'autre, le temps est à la fois précieux et
inquiétant, riche en possibles et gros de la menace de la mort. Il devient ainsi l'ennemi à
vaincre : dans la science, il est rationalisé, découpé en tronçons invariant pour être maitrisé ;
dans la vie, il est accéléré, rentabilisé, dilaté en un présent perpétuel qui reconduit les mêmes
possibles. Contre la temporalité linéaire qui s'achemine inexorablement vers la fin de la vie,
l'homme moderne déroule son existence dans la répétition de l'instant présent, réinstaurant
ainsi le paradigme de la cyclicité du temps des sociétés traditionnelles : "La tradition vivait
de continuité et de transcendance réelle. La modernité, ayant inauguré la rupture et le
discontinu, s'est refermée sur un nouveau cycle."63
La modernité inaugurée par l'individualisme, alors qu'elle s'inscrit en rupture par
rapport à la tradition et se définit précisément dans cette désagrégation du modèle holiste qui
la caractérise, se compose un visage paradoxalement unifié. Esquissée à gros traits par
l'analyse synoptique que propose l'anthropologie comparative de L. Dumont, celle-ci apparait
d'abord comme le résultat d'un bouleversement effectif : l'irruption dans l'histoire humaine de
l'idéologie chrétienne. Brisant la boucle du temps qui assurait la stabilité des communautés
archaïques, le christianisme substitue à la palingenèse la perspective eschatologique du salut,
et convertit ainsi le chemin (ex-hodos) de la vie humaine en une véritable progression vers,
62 Friedrich Nietzsche, Le Gai savoir, Avant-‐Propos, Paris : Société du Mercure de France, 1901 [1885] p.15 : "Diese Griechen waren oberflächlich -‐ aus Tiefe !" 63 Jean Baudrillard, Alain Brunn, Jacinto Lageira, "Modernité", in Encyclopædia Universalis, Disponible en ligne : http://www.universalis.fr/encyclopedie/modernite/ [consulté le 13/03/15]
Mathilde THOMAZO M2 ECH ⏐6 & 7 Février 2015
17
une montée continue et acyclique jusqu'au Royaume céleste. La vie terrestre est ainsi
reléguée à une place secondaire. Avec le retour dans le monde du chrétien cependant, la
dimension matérielle est restaurée, elle se fait le préambule nécessaire du paradis promis qui
en instruit et en motive les modalités. Cependant, le renoncement aux idéologies soutenues
par la transcendance divine, d'abord, puis historique, aboutit à une rupture de tension de la
ligne du temps. Renonçant à l'idée d'un telos commun, l'individu, éclairé par sa raison,
s'institue alors comme la valeur finale, c'est l'avènement de l'ego. A l'échelle collective,
pourtant, l'individualisme ne provoque pas l'éclatement du tout en une multitude de
trajectoires singulières. Au contraire, se dessinent dans le grand nombre des comportements
individuels des ensembles réguliers, uniformes, des "masses", qui manifestent le "fait social"
d'une culture et dont le totalitarisme est la caricature monstrueuse. Celles-ci mettent ainsi à
jour l'hybridation des valeurs individualistes avec les héritages holistes régionaux,
hybridation qui influence la détermination des pratiques particulières cristallisées dans les
normes. Or ces normes tirent leur normativité d'une "foi" tacite, intériorisée, qui les rend
directement opératoires, c'est-à-dire contraignantes. Elles constituent finalement, dans le
paysage affranchi de la transcendance, le motif suffisant de l'agir, le référentiel immanent
dans lequel la vie s'effectue, soudain retournée sur elle-même, située dans un temps clos.
Temporalité que vérifie la tentative d'élucidation ontologique de l'individualisme : la
perspective individuelle qui complète la lecture anthropologique de la modernité conduit
également à un renversement du renversement. De fait, la remise à soi de la vie que provoque
la libération de l'individu impose à l'ego une confrontation avec sa propre fin dans laquelle se
noue l'angoisse de l'ek-sistence. La vie échoit alors comme une charge, fardeau porté seul et
sans interruption, responsabilité éreintante de devenir soi à la force de son propre poignet.
Ecrasé par la pesanteur d'une vie qui doit se justifier elle-même, l'individu se réfugie dans le
divertissement, la légèreté amnésique qui le fond dans la vie collective. Forcé cependant de
se réaliser, il se fait lui-même producteur et acteur de la transcendance, sous la forme de
nouveaux mythes catalysés par l'appareil normatif à partir duquel il se construit. Le temps est
alors maitrisé, réabouché avec lui-même dans l'éternel présent que restituent l'immédiateté et
la rentabilité selon lesquelles le sujet se vit. De sorte que la modernité, sous une variante
individualiste, réactualise par l'abandon de l'eschatologie chrétienne le modèle palingénésique
contre lequel elle s'est formée.






















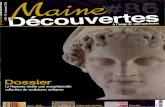












![11/2016 "Liberté, égalité, transfert. Passages et resémantisations de savoirs civiques dans l'espace franco-romand" [L'Harmattan]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6315b38485333559270d3fc7/112016-liberte-egalite-transfert-passages-et-resemantisations-de-savoirs.jpg)


