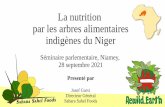Oueslati 2013 : Analyse ichtyoarchéologique de la place du poisson de mer dans les pratiques...
-
Upload
univ-lille -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Oueslati 2013 : Analyse ichtyoarchéologique de la place du poisson de mer dans les pratiques...
BAR International Series 25702013
Anciens peuplements littoraux et relations Homme/Milieu sur les côtes
de l’Europe atlantique
Ancient Maritime Communities and the Relationship between People and
Environment along the European Atlantic Coasts
Sous la direction de / Edited by
Marie-Yvane Daire, Catherine Dupont, Anna Baudry, Cyrille Billard, Jean-Marc Large, Laurent Lespez, Eric Normand and Chris Scarre
Avec la collaboration de / With the collaboration of
Francis Bertin, Chloé Martin et Kate Sharpe
Published by
ArchaeopressPublishers of British Archaeological ReportsGordon House276 Banbury RoadOxford OX2 [email protected]
BAR S2570
Anciens peuplements littoraux et relations Homme/Milieu sur les côtes de l’Europe Atlantique / Ancient Maritime Communities and the Relationship between People and Environment along the European Atlantic Coasts
© Archaeopress and the individual authors 2013
ISBN 978 1 4073 1191 3
pour citer ce volume / how to cite:
Daire M.Y., Dupont C., Baudry A., Billard C., Large J.M., Lespez L., Normand E., Scarre C. (dir.), 2013. Ancient Maritime Communities and the Relationship between People and Environment along the European Atlantic Coasts / Anciens peuplements littoraux et relations Home/Milieu sur les côtes de l’Europe atlantique. Proceedings of the HOMER 2011 Conference, Vannes (France), 28/09-1/10/2011. British Archaeological Reports, International Series 2570, Oxford: Archaeopress.
Printed in England by Information Press, Oxford
All BAR titles are available from:
Hadrian Books Ltd122 Banbury RoadOxfordOX2 7BPEnglandwww.hadrianbooks.co.uk
The current BAR catalogue with details of all titles in print, prices and means of payment is available free from Hadrian Books or may be downloaded from www.archaeopress.com
535
Il n’échappe à personne que la consommation des mollusques marins moules et huîtres en tête fait partie des innovations caractéristiques des pratiques locales à l’époque romaine (Oueslati 2008, 263). L’apparition de nouveaux ustensiles de cuisines, souvent importés (Batigne-Vallet 2001 ; Batigne et Desbat 1996 ; Bats 1988 ;
ingrédients, l’importation d’épices suggèrent une nouvelle perception de l’alimentation et probablement l’apparition d’une cuisine (Flandrin 1996) plus élaborée dans le choix des ingrédients, le mode de cuisson, l’originalité de l’assaisonnement et la présentation de la nourriture dans un vaisselier romain (Evans 1993), le tout contrastant avec la cuisine ordinaire. Les circonstances de ces changements peuvent se trouver dans l’amélioration des techniques agricoles romaines et la constitution de surplus alimentaires (Matterne 2001 ; Oueslati 2006) favorisant l’élaboration d’une haute cuisine (Goody 1982, 105). Les sites les plus aisés de Lutèce, par exemple, attestent d’une évolution des
(Mennell 1987, 27). La reproduction partielle de ce comportement par les Parisii de statut socio-économique inférieur matérialise une quête de promotion sociale au travers de l’adoption de pratiques d’élites (Mennell 1987, 32). Ainsi toutes les strates socio-économiques sont concernées par un changement probablement initié par les élites. On peut donc considérer que la compétition entre groupes sociaux est à l’origine de la dynamique culturelle observée à la période gallo-romaine. L’existence d’une
alimentaires est probablement un facteur sous-jacent à la
alors d’un processus structuré de changement (Mennell 1987, 31). Si le rôle des oiseaux de basse-cour, du gibier à plumes, du gibier à poils ou encore du cheval et du chien sont également bien connus dans le cadre de cette mutation
poisson (Ferdière et al., 2006, 130). Cependant l’existence
l’intérieur des terres étant avérée par la présence des huîtres et des moules, il devient légitime de s’interroger sur la place du poisson dans ces échanges avec le littoral. En effet
sous forme de garum de fabrication locale. En réalité, les os de poissons sont fugaces dans le registre archéologique
amont l’activité halieutique ? Est-ce que l’irrégularité de
toute dynamique commerciale autour de ces produits ?
évaluer le rôle des pratiques archéologiques et notamment
imposent cette perception faussée du statut de la pêche à l’époque romaine. C’est au travers de découvertes récentes de restes de poisson dans le Nord de la Gaule que ces questions sont abordées. Des contextes urbains, ruraux, cultuels et funéraires nous éclaireront sur autant de facettes de l’acquisition et de la consommation des ressources halieutiques.
POISSON FRAIS, POISSON SALÉ OU POISSON CONDIMENT ?
Les études portant sur l’époque médiévale nous renseignent sur les mécanismes d’approvisionnement en poisson frais
de la marée entre le port et les villes à l’intérieur des terres,
de l’époque médiévale sur ce type de commerce. À titre d’exemple, les sources écrites sur Fécamp témoignent au 15ème siècle ap. J.-C. de l’arrêt de tout chalutage au mois
l’acheminement du poisson frais à l’intérieur des terres avec des routes impraticables (Musset 1957, 513). Ainsi la possibilité d’atteindre les principaux marchés urbains dont Paris conditionnait plus en amont le fonctionnement des pêcheries. La corruption du poisson constitue une autre contrainte rencontrée avec une réglementation stricte des marchés de poissons frais (Bourlet 1995, 10). La présence de 12 plies entières au fond d’une fosse de l’époque romaine à Liberchies atteste les pertes corollaires au commerce du poisson frais (Van Neer et al., 2009, 48). En tout état de cause, la marée ne constituait qu’une petite partie du poisson consommé aux périodes médiévales et il en était probablement ainsi aux périodes plus anciennes à l’intérieur des terres. Ce constat s’appuie sur l’abondance saisonnière de certaines ressources dont le hareng, le maquereau ou le cabillaud et les gros volumes de capture qui ont incité à la transformation de ces prises par les saleurs et les saurisseurs. Dans une démarche régressive il est nécessaire d’éclaircir l’ampleur de ce type de pratiques au Haut Moyen Âge puis à l’époque romaine. Durant l’antiquité, l’importation de poissons sous forme de salsamenta méditerranéenne est documentée notamment
ANALYSE ICHTYOARCHÉOLOGIQUE DE LA PLACE DU POISSON DE MER DANS LES PRATIQUES ALIMENTAIRES ROMAINES
DU NORD DE LA FRANCE.
Tarek OUESLATI, HALMA-IPEL (Histoire, Archéologie, Littératures des Mondes Anciens - Institut de Papyrologie et d’Égyptologie de
Lille), Domaine Universitaire du Pont de Bois, B.P. 60149 Villeneuve d’Ascq, France, email : [email protected]
536
HOMER : ANCIENS PEUPLEMENTS LITTORAUX / ANCIENT MARITIME COMMUNITIES
par le contenu d’amphores Dressel 7 et 9 de l’épave Sud Perduto II datée du 1er siècle AD avec comme seul poisson salé le maquereau espagnol (Desse-Berset et Desse 2000, 76). Ces mêmes auteurs témoignent du salage d’autres espèces dont le chinchard pour l’épave Saint Gervais 3 (Fos-sur-Mer). Les poissons salés laissent dans le registre archéologique des os bien conservés parfois en connexion anatomique contrairement aux restes issus du processus de fermentation, le garum et le hallec. Au nord de la France, aucune mention de maquereau espagnol n’a été reportée pourtant, plus à l’Est, ses vertèbres sont présentes dans des contextes datant surtout du 1er siècle AD en Belgique, en Allemagne et aux Pays Bas (Van Neer et al., 2010, 168). Au-delà du début du 2ème siècle AD cette forme de conserve n’est plus attestée. Les témoignages ostéologiques du commerce de sauces de poissons sont par contre inexistants. Ce sont, les découvertes dans le Nord de la Gaule d’amphores à garum importées d’Italie, de Tarraconaise, de Bétique, de Lusitanie, de Narbonaise ou de Lyonnaise qui indiquent l’acheminement de ces
est documenté à la période du 3ème-4ème siècle AD (Laubenheimer et Marlière 2010, 55). Il faut préciser que le transport du vin en tonneaux est attesté après
à Garum au-delà du 1er siècle soit lié à l’utilisation du contenant en bois. L’absence d’associations entre amphore et résidu osseux peut s’expliquer par la fragilisation des petits os de sardines et d’anchois mentionnée plus haut. On peut également évoquer la qualité même des sauces
contenants comme cela est documenté à Lyon constituent une explication supplémentaire à l’absence de ces résidus sur les sites de consommation (Piquès et al., 2008, 257). Simultanément à la raréfaction des amphores qui ont servi à l’importation de ce condiment, certains sites de Belgique ont livré des concentrations d’os de petits poissons qui ont été interprétées comme les témoignages d’une production locale de garum à base de hareng de sprats et d’autres espèces fréquentant les eaux septentrionales dont la Manche et la mer du Nord. La production de ces sauces de poissons locales ne reposait pas seulement sur une matière première pêchée en mer, puisqu’à Tongres (2ème siècle AD) l’utilisation éventuelle de petits poissons d’eau douce est suggérée (Van Neer et al., 2010, 184), ce qui souligne le rôle économique de ces produits transformés. S’agissant de cyprinidés de la zone à Barbeau, ces auteurs font une distinction entre les productions côtières à base de poisson de mer et cette production à base de poissons d’eau douce issus d’une pêche plus en amont à Tongres. Le poisson frais, le poisson salé et le poisson condiment constituent donc autant de formes caractéristiques du commerce et de la consommation de cette ressource à l’époque romaine. Ainsi la présence de restes ichtyques sur un site archéologique donné ne peut se passer de la détermination du mode de consommation.
MATÉRIEL ET MÉTHODES
Maintenant que la problématique est posée, nous aborderons ce sujet au travers des sites funéraires de
Nempont-Saint-Firmin, Marck « Zac des Pins » (Blondeau 2011), la tombe de Cantin (Loridant et al., 2011) et celle de Wervicq-Sud (Denimal 2011) ainsi que le sanctuaire d’Authevernes « Les-Mureaux » (Michel et al., à paraître) (Figure 1). Nous mentionnerons également une série de sites qui ont été fouillés par la société Archéopole et pour lesquels des tamisages ont été réalisés. Une partie de ces opérations archéologiques n’a pas livré de restes ichtyques. Ces témoignages négatifs contribuent à la compréhension des pratiques régionales. Le site de la Turquerie à Marck a fait l’objet d’un diagnostic par Cap’Calaisis (Bouche et
l’Odéon » à Paris a été réalisée conjointement par l’INRAP (Institut National des Recherches Archéologiques Préventives) et la Commission du Vieux Paris (Celly 2007), tandis que les autres sites de Lutèce mentionnés ici ont été fouillés par la Commission du Vieux Paris. D’autres témoignages des pratiques locales sont exploités ainsi que les données publiées par d’autres auteurs. Du point de vue méthodologique, les restes ichtyques ont été étudiés grâce à la collection de référence du laboratoire HALMA-IPEL UMR 8164 du CNRSI (Histoire, Archéologie, Littératures des Mondes Anciens - Institut de Papyrologie
des pleuronectidés repose sur les travaux de Wouters (et al., 2007). La détermination de la taille des poissons a
Fréthun Marck
Etaples
Cantin
Arras
Amiens
Noyelles-sur-Mer
Nempont-Saint-Firmin
Sains-en-Gohelle
Hardifort
Wervicq-Sud
Bavay
Meaux
Paris
Authevernes
Marenla
1/3 000 000eAtlas de Belgique et de Germanie (HALMA-IPEL)
chef-lieu de civitasvoies romaines
sites mentionnés dans le texete
Figure 1. Emplacement des sites d’où proviennent les assemblages de poissons étudiés et principales voies romaines (Atlas de Belgique et de Germanie HALMA-IPEL - Histoire, Archéologie, Littératures des Mondes Anciens - Institut de Papyrologie et d’Égyptologie de Lille).
537
RESSOURCES - RESOURCES, OUESLATI ; ANALYSE ICHTYOARCHÉOLOGIQUE DE LA PLACE DU POISSON DE MER...
été faite par comparaison avec des séries de référence à
saisons de capture repose sur la lecture des anneaux de croissance des vertèbres. Pour cela l’épaisseur de l’avant dernière cerne de croissance est divisée en trois segments égaux correspondant chacun à une durée de deux mois. La mesure de la dernière phase de croissance permet d’établir de manière comparative où l’on se situe dans les six mois de croissance rapide de l’individu entre avril et septembre. La ligne d’arrêt de croissance trop mince n’a pas été subdivisée. Pour minimiser les erreurs de lecture, les vertèbres archéologiques ont été systématiquement comparées à des spécimens de référence dont l’âge, la taille et la saison de capture sont déterminés. Malgré ces précautions, les résultats obtenus ne constituent que des
inhérentes à cette technique (Van Neer et al., 2004, 469).
DESCRIPTION DES ASSEMBLAGES
Le sanctuaire d’Authevernes « Les Mureaux » (Haute-Normandie)
Ce sanctuaire romain est situé à près de 90km du trait de côte actuel de Haute-Normandie. L’ensemble des contextes fouillés et ayant livré des restes de poissons est associé aux cultes et au déroulement de banquets. L’analyse archéozoologique de ce sanctuaire a révélé la présence de
avec une forte demande pour le gibier à plumes, le lièvre, les poissons et les mollusques. Au total 121 restes de poissons ont été comptabilisés parmi lesquels 51 ont pu
Ils sont issus de 14 contextes datés pour l’essentiel entre
190 et 220 AD. Les restes de poissons les plus anciens sont issus d’un contexte daté sans précision de 40/45 à 120/140 AD et consistent en cinq restes de brochet et un reste de pleuronectidé. Avec huit espèces différentes, les
aux sites contemporains situés à l’intérieur des terres mais deux taxons dominent, les huîtres et les moules. Sur le plan chronologique l’huître fait son apparition dès la première
de Tibère soit avant même que le fanum romain ne soit érigé. Leur consommation perdure tout au long de l’occupation. Dans le cas particulier de la fosse 1350, une association
des restes de daurade grise et de congre avec des huîtres et des moules a été mise en évidence. Cela implique que ces poissons et ces bivalves marins ont pu être consommés à l’occasion d’un seul banquet voire transportés dans un même convoi commercial. La compréhension du mode d’approvisionnement du site demeure toutefois délicate. On peut envisager que ces exigences alimentaires soient à l’origine d’un commerce régulier avec le sanctuaire mais un circuit court, contrôlé par ces consommateurs avec un approvisionnement direct de la côte ou de Rouen ne peut être exclu. Pour mieux cerner cette question, trois indices nous renseignent sur le dynamisme du commerce dans les environs du site. Il s’agit de la présence du rat et de l’escargot de bourgogne (Helix pomatia) II ainsi que la permanence de l’approvisionnement en huître qui nous font pencher pour la première hypothèse. Au-delà des arguments archéozoologiques, la position du site au sud de la voie antique Paris-Rouen (Figure 1) et les témoignages des provenances des céramiques convergent vers cette hypothèse (Michel 2011). Il ressort de cette étude de cas que l’existence d’une demande en ressources marines peut-être suivie d’un commerce régulier en produits frais à partir de la côte. Ce site permet de déduire également que la distance de 45km de Rouen ou de 90km du trait de côte actuel rendait possible l’acheminement de poissons frais à cette époque.
Les contextes funéraires
À Wervicq « Les près de la Lys », un dépôt de crémation en ossuaire daté de 80-60 à 20-10 av. J.-C. a livré une vertèbre précaudale issue d’un hareng dont la longueur totale a été estimée à 25cm (Denimal 2011). Ce contexte funéraire précoce est le seul témoignage que nous ayons de l’implication du poisson de mer dans les rituels funéraires avant le changement d’ère.La tombe de Cantin a fourni un abondant matériel
2ème siècle. L’architecture ainsi que le mobilier métallique et al.,
2011). À l’échelle de la tombe (Figure 3), le tamisage du contenu de la patère en céramique dorée 11 a livré des écailles de perche et d’un cyprinidé, tandis que des os
été retrouvés à cheval entre les assiettes en terra-rubra 8 et 10. Ces spécimens ont pu être pêchés dans une zone à barbeau telles qu’elles sont connues aujourd’hui dans
deux taxons. L’association avec d’autres offrandes dont le porc, le coq et les baies de raisin, témoigne peut-être de composantes prisées au sein de l’alimentation quotidienne. Ce contexte témoigne de l’absence de poissons marins et l’utilisation des produits d’une pêche de proximité.Pour le site côtier de Marcq « Zac des Pins », il convient de distinguer entre deux types de contextes de découverte des vestiges de poissons. Tout d’abord, deux tombes à résidu de crémation sur quatre ont livré des restes de poissons
l’occupation du site de la deuxième moitié du 1er siècle
des témoins de la consommation de poisson (Blondeau rapport en cours d’élaboration). Dans les amas cinéraires
Taxon NR anguille Anguilla anguilla 26 cyprinidé Cyprinidae 9 brochet Esox lucius 5 alose feinte Alosa fallax 1 daurade grise Spondyliosoma cantharus 6 congre Conger conger 1 pleuronectidé Pleuronectidae 2 cabillaud Gadus morhua 1 poisson indéterminé 70
total 121 Figure 2. Inventaire des restes de poissons issus du sanctuaire d’Authevernes.
538
HOMER : ANCIENS PEUPLEMENTS LITTORAUX / ANCIENT MARITIME COMMUNITIES
du 3ème siècle AD, les vestiges exposés à de fortes températures appartiennent à des restes de poissons et de coq incinérés. La comparaison avec l’état de calcination des restes humains évoque une exposition à des températures équivalentes et rien ne permet d’évaluer des différences dans la durée de cette combustion. De surcroît, la fouille anthropologique de l’amas par couche et par cadran a permis de constater un enchevêtrement des restes de poissons et des esquilles d’os du défunt, ce qui laisse
ce dernier. Du point de vue taxonomique, la tombe 1006
d’un chinchard (Trachurus sp) dont la longueur totale a été estimée à 40cm et d’une esquille d’une autre vertèbre
les restes de poissons sont plus nombreux avec un total de 131 fragments calcinés sauf dans le cas d’une vertèbre précaudale de pleuronectidé et d’une autre de hareng qui
pleuronectidés sans qu’il ne soit possible de distinguer
attestés suggérant la consécration de spécimens entiers, les vertèbres constituent tout de même les éléments les mieux représentés. L’examen des stries de croissance sur les vertèbres calcinées de pleuronectidés a permis de relever trois périodes différentes de capture. L’absence de toute déformation par le feu et les précautions prises dans l’interprétation des stries de croissance permettent
d’envisager deux hypothèses. Une visite des tombes après la cérémonie peut constituer une première explication mais cette pratique n’est pas habituelle à cette époque et un conduit à libation est prévu pour les rituels de ce genre. De même, la position stratigraphique de ces découvertes exclut cette solution. La seconde explication consiste en l’offrande, au moins en partie, de poissons salés ou fumés pêchés à différentes époques de l’année. L’association avec les os humains calcinés impose cette seconde hypothèse qui
crémation avec le défunt. Au-delà de ces enseignements sur l’aspect cérémoniel des funérailles, cette sépulture témoigne de la transformation sur le littoral de la Manche d’une partie des captures de pleuronectidés en conserves. Comme cela a été énoncé dans la partie méthodologique, la lecture des cernes de croissance est entachée d’incertitudes notamment par rapport à la variabilité de la chronologie
de l’espèce augmente la marge d’erreur. Les recherches à venir tenteront de trouver de nouvelles méthodes pour approcher la question de la production des conserves. Par ailleurs, les données relatives à l’exploitation des poissons dans les autres contextes du site sont discrètes durant la seconde moitié 1er siècle AD avec la présence exclusive de restes de pleuronectidés. On voit apparaître des restes de raie à la seconde moitié du 2ème siècle AD période à
avec une prédominance du hareng. La présence d’anguille et d’épinoche évoque l’exploitation d’un milieu estuarien tandis que le hareng, la plie de taille adulte et la raie constituent des prises de pêche côtière. Ainsi l’importance du poisson dans la vie quotidienne des habitants de ce site transparaît aussi bien au travers des pratiques funéraires que dans les reliefs de repas de tous les jours. Du point de vue chronologique l’activité de la pêcherie semble s’accroître aux 2ème et 3ème siècles. La transformation d’une partie des captures de pleuronectidés en vue d’une consommation différée dans le temps ou dans l’espace est suggérée par le contenu d’un amas cinéraire. Toutefois la mise en évidence d’une production locale de salsamenta au début du 3ème siècle AD nécessitera d’être appuyée par d’autres arguments.À Nempont-Saint-Firmin la typologie des offrandes animales est basée sur 43 tombes à inhumation ayant livré des dépôts d’animaux. Le dépôt le plus commun est celui du coq ce qui constitue une pratique très répandue à cette époque. Les restes de poissons sont attestés dans un quart de ces tombes. On les retrouve le plus souvent associés aux restes de volatiles. Des restes de mammifères s’ajoutent dans certains cas à cette dernière combinaison. La présence exclusive de restes de poissons n’est avérée que dans deux cas. Du point de vue taxonomique les pleuronectidés sont dominants (Figure 4). Un grand salmonidé dont la longueur totale estimée à un mètre est attesté dans la sépulture 46. Il s’agit d’une darne comprenant une vertèbre et demi (Figure
de dépeçage. Cette portion évoque le partage d’un poisson de grande taille entre le défunt et les personnes impliquées
caractéristique du rituel funéraire romain et vise selon les
43 2
5
62412
17
18
23
108
9 13
15
1621
1
711
142019
22
0 1m
argile verte
blocs de grès
N
baie de raisin carbonisée
ossements d’un crâne de porc
partie supérieure d’un jambon de porc
os de barbeau
écailles de perche et d'un cyprinidé
aile de poule
Figure 3. Plan de la tombe de Cantin avec illustration de et al.,
2011).
539
RESSOURCES - RESOURCES, OUESLATI ; ANALYSE ICHTYOARCHÉOLOGIQUE DE LA PLACE DU POISSON DE MER...
la mort comme cela est décrit dans le déroulement des funérailles (Lepetz et Van Andringa 2004). Par ailleurs, la sépulture 37 a livré dans une même assiette un mélange de plie, de hareng et d’un salmonidé suggérant une préparation culinaire associant plusieurs poissons. Il s’agit là d’un fait marquant de cette nécropole où une récurrence d’imbrications de tronçons de poissons et de poulets est également attestée. La répétition de ces associations suggère l’offrande de plats cuisinés combinant volaille et poisson. De même la cuisson d’une épaule d’un très jeune porcelet, de côtes de porc adulte et d’un pleuronectidé
ouvre une fenêtre sur un autre mode de combinaison des viandes.
Les occurrences ponctuelles de poissons de mer et leur absence
Les occupations de La Tène et de l’époque romaine de Marck « Haute Maison » renseignent à partir de quelques restes collectés à vue sur la consommation du cabillaud (Boisson 2009). Parmi les sites régionaux n’ayant pas livré des restes de poissons de mer, malgré le tamisage, on peut citer par exemple l’établissement rural de Fréthun situé à moins de cinq kilomètres du trait de côte actuel. Les mollusques marins y sont présents, tandis que les seuls poissons issus du tamisage sont des cyprinidés pêchés en eau douce (Meurisse 2011). Dans cette perspective, les tamisages réalisés sur le site côtier de La Turquerie, à Marck n’ont livré qu’un seul reste de pleuronectidé soulignant la rareté du poisson tandis que sur le même site les niveaux du Haut Moyen Âge révèlent une occurrence relativement fréquente. À Lutèce, malgré une abondance des restes de poissons issus du tamisage des puits du Théâtre de l’Odéon, seuls des restes de poissons pêchés dans la Seine sont attestés avec une prédominance de l’anguille et des cyprinidés (Celly 2007). Sur ce même contexte urbain, la collecte à vue sur les autres fouilles de niveaux gallo-romains de Lutèce a révélé l’occurrence de pleuronectidés sur plusieurs sites, mais ces poissons
été mis en évidence dans un contexte romain du site de la Rue Monsieur-Le-Prince à Paris. En l’absence de poissons de mer, ce témoignage isolé pourrait correspondre à un poisson salé sous forme d’un individu étêté comme en témoigne la découpe de l’os. Il faut préciser que l’existence de légères différences anatomiques avec le chinchard commun (Trachurus trachurus) pourraient suggérer une origine Méditerranéenne de ce spécimen. Cependant ce
entre les différents taxons du genre Trachurus.
Les données bibliographiques sur les occurrences de poissons de mer
D’autres auteurs ont souligné l’implication de poissons de mer dans les rites funéraires. La nécropole du Bas-Empire de Marenla située à une dizaine de kilomètres de Nempont-Saint-Firmin témoigne du dépôt d’un pleuronectidé dans la tombe à inhumation 6 (Piton 2006, 12). À Noyelles-sur-Mer, sur un total de 31 tombes du 4ème siècle AD, six d’entre elles sont dotées d’offrandes alimentaires. Dans cinq de ces sépultures, des restes d’un pleuronectidé ont
Marchand 1978, 203). Par ailleurs, les fouilles anciennes de Gustave Souquet à Étaples ont mis au jour des tombes à inhumation où certaines céramiques contenaient « des ossements animaux tels que poules, lapins etc. et des arêtes de poissons […] » (Souquet 1865, 272). Les contextes urbains d’Amiens (Lepetz 2010) et d’Arras (Jacques et al., 2008) ont livré des restes de poissons de mer (Figure 6). Les Grondins et le turbot pourraient correspondre à du poisson commercialisé frais car ils ne sont pas concernés à des périodes plus récentes par des mentions de salage ou de
Ple
uron
ectid
ae
plie
Ple
uron
ecte
s pl
ates
sa
flet P
latic
hthy
s fle
sus
Mug
ilidae
Sal
mon
idae
hare
ng C
lupe
a ha
reng
us
05 +30 +47 +60 ++ + inv26 +46 + + +40 +32 +++28 ++ +44 ++37 + + +
sépulture
taxo
n
Figure 4. Inventaire des offrandes de poisson de Nempont-Saint-Firmin. Chaque signe (+) correspond à un individu. L’occurrence
10mmFigure 5. Illustration des restes d’une darne issue d’un grand salmonidé déposée avec les autres offrandes funéraires de la sépulture 46 de Nempont-Saint-Firmin.
540
HOMER : ANCIENS PEUPLEMENTS LITTORAUX / ANCIENT MARITIME COMMUNITIES
saurissage. La plie et le maquereau voir même la daurade auraient pu être commercialisés sous formes variées. Précisons que dans le cas des scombridés et à l’instar des découvertes de salsamenta importées en Belgique, il pourrait s’agir de tronçons acheminés en amphore à partir de la Méditerranée ou de l’Atlantique.
L’EXPLOITATION DU POISSON DANS LE NORD DE LA GAULE
Certains sites côtiers témoignent de l’exploitation des produits de la pêche en mer. La fréquence d’occurrence des poissons notamment dans les tombes du Bas Empire
ces poissons. Au-delà de ce constat, les sites funéraires étudiés offrent des données précieuses sur l’association dans un même plat de poulet et de poisson ou de porc et de poisson ou encore de plusieurs tronçons de poissons différents. Il s’agit d’autant d’instantanés des modes de cuisson, de préparation et de présentation des repas de ces populations côtières. Il est important de souligner que, le soin apporté lors de la fouille de ces contextes funéraires ainsi que la disposition de poissons dans des plats ont été des facteurs décisifs dans leur mise au jour et cela dès le milieu du 19ème siècle AD. Il faut également préciser qu’il a été plus facile sur ces sites de mettre en évidence les restes de poissons dans les tombes que dans les structures d’habitat voisines évoquant par comparaison avec les périodes plus récentes une consommation moins fréquente de ces ressources. Ce même contraste entre les contextes funéraires et les contextes d’habitat d’un même site a été soulevé sur la façade atlantique à l’Houmeau avec une plus grande diversité des restes de poissons parmi les offrandes
qu’au sein des rejets de consommation. Ces témoignages du littoral renseignent aussi sur les techniques de pêche. Une prédominance des prises côtières ou en estuaire est caractérisée. On en déduit une exploitation de faible envergure des stocks de poissons capturés à la ligne
barrages à poisson. De petites embarcations naviguaient dans les estuaires et non loin des côtes où la plie et le
Marck « Zac des Pins » suggère la salaison de ces poissons plats pêchés en abondance. Leur commercialisation à l’intérieur des terres pouvait se faire ainsi sous formes fraîche ou en conserve. L’acheminement de poissons de mer frais à l’intérieur des terres est avéré pour les sites d’Authevernes, d’Amiens et d’Arras. Ces occupations localisées à une distance maximale de 90km de la côte pourraient indiquer la limite de diffusion du poisson frais à l’arrière pays mais certaines nuances sont à apporter en fonction de la topographie, de la nature des voies de commerce ainsi que de l’emplacement du trait de côte à l’époque romaine. Il faut également considérer que dans le cas d’Authervernes, par exemple, des agglomérations intermédiaires comme Rouen auraient pu servir de point d’approvisionnement aux consommateurs. En effet, si sur ce sanctuaire, la présence du rat, de l’escargot de Bourgogne et la permanence de l’apport de mollusques marins sont à mettre en rapport avec un commerce actif dans les environs du site, il faut tout de même envisager la possibilité d’un approvisionnement hors de tout négoce. La multiplication des tamisages renvoie souvent à des résultats négatifs comme sur le site littoral de Fréthun soulignant que les produits de la pêche en mer ne sont pas abondamment distribués même à faible distance des côtes où dans le cas de Fréthun on se limitait aux ressources capturées dans un cours d’eau voisin. À Marck (La Turquerie) malgré la proximité immédiate de la mer et la multiplication des tamisages, la présence d’une seule vertèbre de pleuronectidé appuie ce constat. Ces résultats contrastent avec la situation prévalant sur le littoral de La
pêche et l’extension des milieux exploités avec l’avènement de la pêche en haute mer comme le suggère l’abondance
de grande taille sur le site de « Saint-Georges-sur-l’Aa, Parc des Rives de l’Aa l’Enfer » (Delauney 2012) ou celle du cabillaud à Barreau-Saint-Georges (Herbin et Oueslati sous presse). À cette époque, le poisson de mer est largement diffusé dans l’arrière-pays et révélé de manière quasi systématique par le tamisage (Clavel 2001). L’examen de la nature des occupations livrant du poisson de mer loin des côtes notamment dans les cas d’Authevernes et d’Arras, renvoie vers des contextes cultuels avec des banquets riches qui ont généré ces témoins si rares à l’époque romaine. Ainsi faut-il considérer que l’accès à ce type de denrées était restreint à une élite et était loin d’être généralisé pour les populations antiques éloignées du littoral ? Une demande limitée aux consommateurs les plus privilégiés pourrait expliquer des circuits courts d’approvisionnement et trahissent des pêcheries peu actives. Dans cette optique l’exemple du dépotoir du Théâtre de l’Odéon à Lutèce
effet, ces populations ichtyophages se contentaient de
Figure 6. Attribution taxonomique des restes de poissons issus du tamisage en contexte urbain à Amiens et à Arras.
AmiensLepetz 2010
ArrasJacques et al 2008
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Pleuronectidae
plie (Pleuronectes platessa)
hareng (Clupea harengus)
grondin (Trigla sp)
maquereau (Scomber sp.)
grande alose (Alosa alosa)
Mugillidae
Sparidae
flet (Platichthys flesus)
turbot (Scophthalmus maximus)
541
RESSOURCES - RESOURCES, OUESLATI ; ANALYSE ICHTYOARCHÉOLOGIQUE DE LA PLACE DU POISSON DE MER...
exclusive de ces ressources ou à cause d’un accès sélectif aux produits marins en raison de la distance séparant Paris du littoral. Même à l’époque médiévale, le poids des facteurs socio-économiques dans l’acquisition du poisson frais est souligné à Paris avec une marée réservée à une frange privilégiée de la population (Bourlet 1995 ; Clavel 2001).Dans les siècles qui suivent l’époque romaine c’est
Fish Event décrit en Angleterre autour de l’an mille (Barrett et al., 2004, 621) se produit sur la côte entre Dunkerque et Calais avec le développement d’une pêche hauturière attestée au Barreau-Saint-Georges par exemple au 10ème-11ème siècle (Herbin et Oueslati, sous presse). Simultanément, on constate à cette même période un essor du commerce du hareng ou des pleuronectidés sur des sites ruraux à l’intérieur des terres comme à Sains-en-Gohelle (Assémat 2010, 368) ou à Hardifort (Duvivier 2011). C’est ce contraste entre l’Antiquité et le Haut Moyen Âge
par rapport au rôle économique de la pêche en mer. La perception des changements des modes d’exploitation du poisson par les peuplements anciens n’est possible que dans la longue durée. Dans cette optique, les sites de Bretagne ayant livré des restes de poissons sont rares aussi bien à l’Âge du Fer qu’à l’époque romaine avec respectivement 2% et 7% de sites livrant ces vestiges. Cette différence de fréquence témoigne d’un intérêt moindre pour les poissons à l’Âge du Fer (Dobney et Ervynck 2007). Ces auteurs ont même avancé un éventuel tabou sur leur consommation. En Gaule, les restes de poissons sont très rares à l’Âge du Fer (Méniel 2001, 16) en dehors de quelques exceptions comme à Acy-Romance par exemple (Méniel 1998, 49). Dans l’état actuel de la recherche dans le Nord de la France, il est possible d’avancer une fréquence d’occurrence légèrement supérieure de poissons sur les sites de l’époque romaine relativement à l’Âge du Fer mais seule l’intégration d’un plus grand nombre de sites permettra de renforcer ce constat.
CONCLUSIONS
Ce sont les analyses de vestiges cérémoniels qui renseignent au mieux aujourd’hui sur la consommation de poisson dans le Nord de la Gaule. Au-delà des aspects relatifs aux constructions rituelles, ces restes témoignent de la place des poissons dans la vie quotidienne. Sur la côte
mulet, les raies et les salmonidés qui sont consommés et à l’intérieur des terres daurade grise, congre, turbot, mulets, poissons plats et grondins agrémentent les banquets de consommateurs privilégiés. En tout état de cause, l’époque romaine se caractérise par une exploitation côtière du poisson de mer et une commercialisation de spécimens frais limitées. Au terme de ce travail il est possible de revenir sur l’aspect élaboré de la cuisine romaine et en compléter les caractéristiques avec tout d’abord l’utilisation de condiments à base de poisson. Après l’introduction d’un garum importé le succès de cette innovation a abouti à des formes de productions locales attestées en Belgique. L’acquisition du poisson de mer frais à l’intérieur des
terres est avérée dans le cas de consommateurs privilégiés et il est possible que le reste de la population dans une tentative d’imitation se soit contentée d’une salsamenta locale à base de poissons plats ou de poissons gras ainsi que des prises en eau douce contribuant ainsi à une hausse de la fréquence des poissons après la conquête. On peut voir dans cette évolution un retour progressif du poisson dans l’alimentation carnée suite à la déprise spectaculaire de l’exploitation des ressources marines après la néolithisation. Ce phénomène nécessite d’être documenté plus amplement mais il pourrait être à l’origine d’une évolution aboutissant plusieurs siècles plus tard au renouement avec une consommation régulière de
carolingienne. Cette hypothèse nécessite la mise en évidence d’une accrétion progressive de la demande sur les marchés et l’adaptation de l’activité halieutique à cet appel. L’augmentation des effectifs des pêcheurs,
techniques de capture de poisson peuvent être proposées.
NOTES I - http://perso.univ-lille3.fr/~toueslati/IMG/pdf/collection_poissons.pdfII - Ces deux taxons ne sont pas endémiques et sont introduits au nord de la Gaule après la conquête notamment par
BIBLIOGRAPHIE
Assémat, H. 2010. Sains-en-Gohelle (Pas-de-Calais) « Rue Lamartine » Tranches 1 et 2. Rapport d’opération archéologique préventive, Archéopole, Service Régional de l’Archéologie Nord - Pas-de-Calais.
Barrett, J. H., Locker, A. M. et Roberts, C. M. 2004. ‘Dark
evidence AD 600-1600. Antiquity 78 (301), 618-636.
Batigne-Vallet, C. 2001. Question de méthode concernant la céramique à feu : apports et limites de son étude. Le cas de Lugdunum. Rei Cretariae Romanae Fautorum acta 37, 37-44.
Batigne, C. et Desbat, A. 1996. Un type particulier de « cruche » : les bouilloires en céramique d’époque romaine (Ier-IIIème siècles). In L. Rivet (éd.), Actes du congrès de Dijon, Société française d’Étude de la Céramique Antique en Gaule, 381-394. Marseille, Société Française d’Étude de la Céramique Antique en Gaule.
Bats, M. 1988. Vaisselle et alimentation à Olbia de Provence v. 350- v. 50 av. J.-C. : modèles culturels et catégories céramiques. Paris, Centre National de
Narbonnaise, Supplément 18.
Blondeau, R. (dir.) 2011. « Marck Zac des Pins (Pas-de-Calais) »
542
HOMER : ANCIENS PEUPLEMENTS LITTORAUX / ANCIENT MARITIME COMMUNITIES
archéologique, Archéopole, Service régional de l’Archéologie du Nord - Pas-de-Calais.
Boisson, J. (dir.) 2009. Marck « La Haute-Maison ».
Archéopole, Service Régional de l’Archéologie du Nord - Pas-de-Calais.
Bouche, K. et Lhommel, P. 2011. Zone d’aménagement concerté La Turquerie « secteur C » Marck/Calais (Pas-de-Calais)diagnostic archéologique, Cap’Calaisis, Service Régional de l’Archéologie du Nord - Pas-de-Calais.
Bourlet, C. 1995. L’approvisionnement de Paris en poisson de mer aux 14ème et 15ème siècles, d’après les sources normatives. Franco-British Studies 20, 5-22.
Celly, P. (dir.) 2007. Paris « Théâtre National de l’Odéon », 1 place Paul Claudel (Paris VIe). Rapport
National de Recherches Archéologiques Préventives - Commission du Vieux Paris, Service régional de l’Archéologie d’Ile-de-France.
Clavel, B. 2001. L’animal dans l’alimentation médiévale et moderne en France du Nord (XIIIe - XVIIe siècles). Amiens, Revue Archéologique de Picardie, numéro spécial 19.
Cool, H. E. M. et Baxter, M. J. 2002. Exploring Romano-British Find Assemblages. Oxford Journal of Archaeology 21 (4), 365-380.
Delauney, A. (dir.) 2012. Saint-Georges-Sur-l’Aa. Rapport
Denimal, C. (dir.) 2011. Wervicq-Sud « Zac des Près de Lys »archéologique, Archéopole, Service régional de l’Archéologie Nord - Pas-de-Calais.
Desse-Berset, N. et Desse, J. 2000. Salsamenta, garum et autres préparations de poissons. Ce qu’en disent les os. Mélanges de l’École française de Rome. Antiquité 112 (112-1), 73-97.
consumption during the Iron Age around the North Sea. In C. Haselgrove and T. Moore (dir.), The Later Iron Age in Britain and Beyond, 403-418. Oxford, Oxbow Books.
Duvivier, H. (dir.) 2011. Hardifort (Nord) « Meulen Veld ». Rapport d’opération archéologique préventive, Archéopole, Service Régionale d’Archéologie Nord - Pas-de-Calais.
Evans, J. 1993. north. Journal of Roman pottery studies 6, 95-118.
Ferdière, A., Malrain, F., Matterne, V., Méniel, P. et
Jaubert, A. N. 2006. Histoire de l’agriculture en Gaule 500 av. J.-C. - 1000 apr. J.-C. Paris, Errance.
Flandrin, J. L. 1996. De la diététique à la gastronomie, ou la libération de la gourmandise. In J. L. Flandrin et M. Montanari (dir), Histoire de l’alimentation, 683-704. Paris, Fayard.
Goody, J. 1982. Cooking, cuisine, and class: a study in comparative sociology. Cambridge, Cambridge University Press.
Herbin, M. et Oueslati, T. sous presse. « Barreau Saint-Georges » - Desserte ferroviaire. Une occupation de
sur-l’Aa (Nord). In L. Verslype (dir.), Les cultures des littoraux. Cadres et modes de vie dans l’espace maritime Manche-Mer du Nord du 3ème au 10ème siècle. Table ronde internationale, Boulogne-sur-Mer, 31 mars - 2 avril 2010. Villeneuve d’Ascq, Revue du Nord.
Jacques, A., Lepetz, S., Andringa, W. V., Matterne, V. et Tuffreau-Libre, M. 2008. Vestiges de repas et
Nemetacum (Gaule Belgique). In S. Lepetz, et W. V. Andringa (dir.), romaine : Rituels et pratiques alimentaires. Actes de la table ronde tenue au Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, octobre 2002, 237-252. Montagnac, Monique Mergoil, Archéologie des plantes et des animaux 2.
Laubenheimer, F. et Marlière, E. 2010. Échanges et vie économique dans le Nord-Ouest des Gaules. Le témoignage des amphores du IIe siècle av. J.-C. au IVe siècle ap. J.-C. Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté.
Lepetz, S. 2010. Pratiques alimentaires dans un quartier d’Amiens au 1er siècle - les restes osseux animaux du « Palais des Sports ». In É. Binet (dir.), Évolution d’une insula de Samarobriva : les fouilles du « Palais des Sports/Coliseum » à Amiens (Somme), 409-422. Amiens, Revue Archéologique de Picardie, numéro spécial 27.
Lepetz, S. et Van Andringa, W. 2004. Caractériser les rituels alimentaires dans les nécropoles gallo-romaines : l’apport conjoint des os et des textes. In L. Barray (dir.), Archéologie des pratiques funéraires : approches critiques. Actes de la table ronde, Glux-en-Glenne, 7-9 juin 2001, 161-170. Glux-en-Glenne, Bibracte Centre Archéologique Européen.
Loridant, F., Herbin, P., Oueslati, T. et Bollard-Raineau, I. 2011. Découvertes archéologiques à Canton (Nord) : parcellaire et caveaux gallo-romains, occupation carolingienne. Revue du Nord 93 (393), 233-260.
Matterne, M. 2001. Agriculture et alimentation végétale durant l’Âge du Fer et l’époque gallo-romaine en France septentrionale. Millau, Monique Mergoil.
543
RESSOURCES - RESOURCES, OUESLATI ; ANALYSE ICHTYOARCHÉOLOGIQUE DE LA PLACE DU POISSON DE MER...
Méniel, P. 1998. Le site protohistorique d’Acy-Romance (Ardennes) - Les animaux et l’Histoire d’un village gaulois (fouilles 1989-1997). Reims, Société Archéologique Champenoise, Mémoire de la société champenoise 14.
Méniel, P. 2001. Les Gaulois et les animaux. Élevage, . Paris, Errance.
Mennell, S. 1987. Français et Anglais à table du moyen âge à nos jours. Paris, Flammarion.
Meurisse, L. (dir.) 2011. Fréthun, « Rue Parenty » (62).
Archéopole, Service Régional de l’Archéologie Nord - Pas-de-Calais.
Michel, M. (dir.) 2011. Authevernes « Les Mureaux » Haute-Normandie / Eure (27). Rapport de fouille archéologique préventive, Service Régional de l’Archéologie de Haute-Normandie, Le Petit-Quévilly.
Michel, M. avec les contributions de Adrian, Y. M., Doyen, J. M., Hanotte, A., Oueslati, T., Roudié, N. et la collaboration de Demarest, M., Lebis, F., Malette, C. à paraître. Au cœur du fait religieux en Gaule Romaine : le sanctuaire d’Authevernes « Les Mureaux » (Eure).
Musset, R. 1957. Notes sur Fécamp. Norois 16, 510-513.
Oueslati, T. 2006. Approche archéozoologique des modes d’acquisition, de transformation et de consommation des ressources animales dans le contexte urbain gallo-romain de Lutèce (Paris, France). Oxford, Archaeopress, British Archaeological Reports, International Series 1479.
Lutèce et à Berytos. In C. Bobas, C. Evangelidis, T. Milioni et A. Muller (eds.), Croyances populaires, rites et représentations en Méditerranée orientale. Actes du colloque de Lille (2-4 décembre 2004), 2e colloque interuniversitaire des universités Capodistrais d’Athènes et Charles-de-Gaulle - Lille 3, XXVIIIe Colloque international d’Histoire, Archéologie, Littératures des Mondes Anciens, Unité Mixte de Recherche 8142, 261-269. Athènes, Université Nationale et Capodistrienne d’Athènes.
Piquès, G., Hänni, C. et Silvino, T. 2008. L’approvisionnement de Lugdunum en poisson au 3ème siècle AD : les données de la fouille du Parc Saint-Georges (Lyon, France). In P. Béarez, S. Grouard, et B. Clavel (dir.), Archéologie du Poisson, 30 ans d’archéo-ichtyologie au Centre National de la
et Nathalie Desse-Berset. Actes de la 28e Rencontre Internationale d’archéologie et d’histoire d’Antibes, et 14th International Council for Archaeozoology
20 octobre 2007, 255-268. Antibes, Association pour la Promotion et la Diffusion des Connaissances Archéologiques.
Piton, D. et Marchand, H. 1978. Une nécropole du IVe siècle à Noyelles-sur-Mer. Cahiers archéologiques de Picardie 5, 199-229.
Piton, D. avec la collaboration de Blondiaux, J., Delmaire, R., Dilly, G., Dubois, S. et Lepetz, S. 2006. Une nécropole du Bas-Empire à Marenla (Le But de Marles). In D. Piton et G. Dilly, Sept nécropoles du Bas-Empire dans le Pas-de-Calais, 7-58. Berck-sur-Mer, Centre de Recherches Archéologiques et de Diffusion Culturelle, Nord-Ouest Archéologie 14.
siècle. In L. Rivet (dir.), Productions régionales et importations en Aquitaine : Actualité des recherches céramiques. Actes du congrès de la Société Française d’Étude de la Céramique Antique en Gaule, Libourne, 1-4 juin 2000, 367-386. Marseille, Société Française d’Étude de la Céramique Antique en Gaule.
Souquet, G. 1865. Rapport des fouilles faites au château d’Etaples en 1864. Bulletin de la Commission des Antiquités départementales du Pas-de-Calais 2, 270-274.
Van Neer, W., Ervynck, A., Bolle, L. J. and Millner, R. S. 2004. Seasonality only Works in Certain Parts of the year: the Reconstruction of Fishing Seasons through Otolith Analysis. International journal of osteoarchaeology 14 (6), 457-474.
Van Neer, W., Wouters, W., Vilvorder, F. et Demanet, J. C. 2009. Pont-à-Celles/Luttre : importation de poissons marins dans le vicus des « Bons-Villers » à Liberchies. Chronique de l’Archéologie wallonne 16, 46-48.
Van Neer, W., Ervynck, A. et Monsieur, P. 2010. Fish bones and amphorae: evidence for the production
Mediterranean region. Journal of Roman Archaeology 23, 161-195.
Wouters, W., Muylaert, L. et Van Neer, W. 2007. The distinction of isolated bones from plaice (Pleuronectes platessa ) and dab (Limanda limanda): a description of the diagnostic characters. Archaeofauna 16, 33-95.
544
HOMER : ANCIENS PEUPLEMENTS LITTORAUX / ANCIENT MARITIME COMMUNITIES
ANALYSE ICHTYOARCHÉOLOGIQUE DE LA PLACE DU POISSON DE MER DANS LES PRATIQUES ALIMENTAIRES ROMAINES DU NORD DE LA FRANCE.
Tarek OUESLATI
MOTS-CLÉS : Gallo-romain, pêche, poisson, commerce, consommation, nécropole, offrande, ville, campagne, sanctuaire, banquet, statut.
RÉSUMÉ :Malgré l’adoption de pratiques d’échantillonnage et de tamisage, la découverte de restes de poissons demeure peu fréquente dans les contextes romains du Nord de la Gaule. Ce travail repose sur des données inédites issues de sanctuaires, de sites d’habitat ou de nécropoles ainsi que sur des données publiées pour proposer les premiers éléments d’une synthèse sur l’acquisition, le commerce ainsi que sur les différentes formes de consommation du poisson à l’époque romaine. Il en ressort une place relativement importante du poisson dans l’alimentation quotidienne des peuplements côtiers notamment dans le cadre des pratiques funéraires. La comparaison avec l’époque médiévale permet toutefois de relativiser l’importance de la pêche en mer. Le spectre de poissons suggère que les pêcheries de la Manche et de la mer du Nord étaient peu actives avec une zone d’exploitation halieutique se limitant aux estuaires et à la côte. À l’intérieur
sous forme de convois appointés par des institutions ou des consommateurs privilégiés. Une distinction nette apparaît ainsi entre une exploitation courante des huîtres et des moules d’un côté et un approvisionnement ponctuel en poissons
même titre que les oiseaux de basse-cour ou les ressources cynégétiques.
ICHTYOARCHEOLOGICAL ANALYSIS OF THE IMPORTANCE OF SEA FISH IN ROMAN FOOD PRACTICES IN THE NORTH OF FRANCE.
Tarek OUESLATI
KEY-WORDS:
ABSTRACT:
Roman contexts of the North of Gaul. The present study is based on unpublished data and literature sources concerning sanctuaries, dwelling sites and necropolises, and proposes a preliminary synthesis on the acquisition, trading and various
diet of coastal settlements, particularly in the context of funerary practices. However, a comparison with medieval times
of the English Channel and North Sea were not very active, with the zone of exploitation being limited to the estuaries
any trading, arriving as convoys paid by privileged institutions or consumers. A clear distinction thus appears between