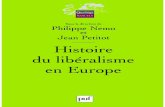La réception de l'Histoire de la folie chez les historiens et les géographes : l'exemple anglo-saxon
Les titulaires de la réparation d'un préjudice de l'histoire: le cas italien
-
Upload
univ-tlse1 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Les titulaires de la réparation d'un préjudice de l'histoire: le cas italien
1
X. Philippe (dir. par), La justice face aux réparations des préjudices de l’histoire, Paris, LGDJ, 2013, pp. 117-149
LES TITULAIRES DE LA RÉPARATION D’UN PRÉJUDICE DE L’HISTOIRE : LE
CAS ITALIEN
Nicoletta PERLO Maître de conférences
Université Toulouse I Capitole
Se pencher sur la question des titulaires de la réparation d’un préjudice de l’histoire implique de donner une définition de la notion de « victime ». Cette notion complexe et polymorphe ne peut être saisie pleinement qu’ayant recours en même temps au langage commun, au droit, et à la politique. Le droit intègre, en effet, assez tardivement la notion de « victime », bien qu’elle soit un phénomène religieux, social, psychologique et anthropologique qui traverse les cultures du monde entier depuis l’âge ancien. Face aux préjudices de l’histoire, toutefois, les instruments juridiques sont souvent limités et nécessitent l’intervention du politique. La notion de « victime » titulaire d’un droit à réparation change alors souvent en fonction d’une lecture du passé qui est au service des exigences politiques du présent (I).
Après l’analyse théorique, l’étude du cas italien permet d’observer comment, concrètement, la notion de victime évolue et se construit dans le temps. La période de la deuxième guerre mondiale et les réparations auxquelles elle a donné lieu en Italie montrent tout d’abord les facteurs et les modalités de l’évolution de la notion de victime. En outre, elles manifestent avec force à quel point, après des événements tragiques, la définition des victimes et la réparation des préjudices soient des éléments cruciaux pour la réussite de la transition démocratique d’un pays (II).
I. La définition de la « victime »
« Victime » vient du mot latin « Victima », qui signifie « créature vivante offerte en
sacrifice à la divinité »1. L’abandon des sacrifices païens suite à l’affirmation du christianisme transforme le concept de victime : le Christ devient la victime unique, la seule qui soit acceptable par Dieu. En même temps, le Christianisme sacralise l’amour du prochain et rend insupportable la détresse. L’image du bon Samaritain promeut la charité et fait du déshérité l’indispensable agent du salut individuel2. La victime acquiert ainsi une fonction et un statut au sein de la société : comme pour l’Islam3, la salvation passe au travers de l’aumône et des bonnes œuvres. Dans la période médiévale la société d’ordre renforce et renferme les victimes dans leur propre statut. La victime, pour accomplir son rôle d’intermédiaire de la salvation, doit supporter le malheur avec patience et accepter l’aumône avec reconnaissance4. La condition de pauvreté, toute forme confondue, est considérée comme la raison essentielle du malheur et de l’état de victime. À partir des grandes crises économiques et sanitaires du milieu du XIVe siècle, la considération sociale de la victime se transforme progressivement.
1 V. V. STANCIU, Les droits de la victime, Paris, PUF, 1985, p. 9. 2 G. GUYON, « La victime propitiatoire : questions sur un héritage chrétien et sa valeur pénale », in J. HOAREAU-DODINAU, G. METAIRIE, P. TEXIER, La Victime. Définitions et statut, Limoges, PULIM, 2008, pp. 17-22. 3 N. BACCOUCHE, « L’évolution de la condition juridique de la victime en droit tunisien », in Idem, pp. 181-184. 4 J. HOAREAU-DODINAU et P. TEXIER, « Avant-propos », in Idem, p. 9.
2
Les causes de la pauvreté et du malheur commencent à être étudiées et des distinctions entre les différentes situations sont opérées. Ainsi, le point focal se déplace « de la pauvreté comme conséquence du malheur vers la situation de victime qui en serait la cause »5. La victime est désormais « une personne qui souffre du fait de quelqu’un, qui subit la méchanceté, l’injustice, la haine de quelqu’un » ou bien « une personne qui subit les conséquences fâcheuses ou funestes de quelque chose, des événements, des agissements d’autrui »6. Dans le langage courant le mot victime renvoie plus spécifiquement à celui qui se sacrifie pour une cause supérieure, spécialement d’ordre patriotique ou religieux ; celui qui est sacrifié aux intérêts, aux passions d’autrui ou même à ses propres passions ; celui qui a été tué ou blessé dans un accident, dans un crime, dans une épidémie, dans une catastrophe7.
L’état de victime renvoie donc maintenant à trois notions : la souffrance, l’injustice et la responsabilité. La victime est une personne souffrant d’une injustice qui, toutefois, n’est pas nécessairement illégale. L’histoire montre bien que la loi peut légitimer des actions injustes, et d’ailleurs, comme le dit Antoine Garapon, « une des caractéristiques du crime contre l’humanité est d’être la plupart du temps commis non contre la loi, mais avec l’assentiment de la loi »8. La victime peut en outre aller consciemment à l’encontre de cette souffrance, se sacrifiant au nom d’un idéal, d’un projet politique, d’une foi, ou bien subir passivement la violence d’autrui et de l’histoire. Une distinction existe ainsi entre les « victimes volontaires », typiquement les combattants – soldats, résistants, rebelles – et les « vittime inconsapevoli » – « victimes inconscientes » –, selon le terme utilisé par Primo Levi9, typiquement les civils.
La notion de victime d’un préjudice de l’histoire peut être plus ou moins large selon qu’on se réfère, suivant la distinction opérée par Antoine Garapon, à un préjudice circonscrit dans le temps et dans l’espace, « isolable du reste de l’histoire », ou bien « d’une constellation d’événements diffus (…) qui a profondément transformé la situation jusqu’à devenir constitutive de la communauté politique »10. Dans les deux cas, la définition implique la recherche des responsables du préjudice.
Et c’est justement cette recherche qui a conduit le droit, au début du XIXe siècle, à intégrer progressivement la notion de victime au travers de la reconnaissance d’un droit à réparation du préjudice subi (A). Le droit est toutefois très limité dans la détermination de la victime d’un préjudice de l’histoire. Si le cas du préjudice « dans l’histoire » est plus facilement « appréhendable par la justice parce que ses effets sont limités », le préjudice « de l’histoire » semble relever plus du politique, puisqu’il peut remettre en cause « l’histoire même »11. Dans les deux cas, le droit et le politique se croisent sans cesse et parfois le politique assume le rôle de protagoniste (B).
A. La définition juridique de la victime
L’article 1382 du Code civil français établit en 1804 un principe général de réparation,
conférant une créance à la personne qui a subi un préjudice. La victime reçoit ainsi une première reconnaissance juridique, bien que de façon indirecte : la victime existe puisqu’elle a le droit d’obtenir la juste réparation de son préjudice.
5 Ibidem. 6 Le Trésor de la langue française. 7 Ibidem. 8 A. GARAPON, Peut-on réparer l’histoire ?, Paris, Odile Jacob, 2008, p. 34. 9 P. LEVI, “Bozza di testo per l’interno del Block italiano ad Auschwitz”, in Eventi, Memorial, Progetto per il Memorial di Auschwitz: scritti per l’opuscolo, bozze, 1978-1979, A03,05,10/8, Fondo Aned. 10 A. GARAPON, Peut-on réparer l’histoire ?, op. cit., p. 155. 11 Idem, p. 156.
3
La véritable intégration du terme « victime » dans le droit ne remonte toutefois qu’au début du XXe siècle. Notamment, la victime fait son apparition dans les textes de droit pénal – la victime d’un crime –, de droit du travail et de la sécurité sociale – les victimes d’accidents, de la guerre, de calamités naturelles – et de droit international – la victime de la violation des droits de l’homme –. Le développement de l’État-Providence conduit en effet à l’affirmation d’un droit au bonheur dont tous les citoyens seraient titulaires. La souffrance apparaît alors comme une condition inacceptable et injuste, ainsi que la marque d’une défaillance de l’État, garant de ce droit. Lorsqu’un préjudice injuste survient, les pouvoirs publics doivent se charger de reconnaître la condition de victime de la personne et assurer son indemnisation12. La mutation profonde qui intervient ainsi dans les droits pénal, social et international au début du XXe siècle consiste, d’une part, dans la reconnaissance aux individus de la capacité de revendiquer la réparation d’un droit devant l’État, d’autre part, dans la consécration d’une responsabilité objective à la charge de l’État pour les sacrifices des individus provoqués par des politiques publiques de risque13.
En Europe, la législation en matière de sécurité sociale se renforce et se complexifie prévoyant les pensions de guerre pour les invalides, l’assurance obligatoire pour les incidents de travail et toutes les autres mesures de la solidarité sociale contemporaine.
Le droit pénal, de son côté, se renouvelle dans les années Quarante grâce à la naissance d’une nouvelle science : la victimologie. La criminologie, jusqu’alors exclusivement centrée sur l’analyse du délinquant, commence à s’intéresser à la victime du délit14. Si dans un premier temps cette science s’interroge sur le rôle de la victime dans la commission du crime, elle passe ensuite à étudier comment aider et dédommager les victimes, contribuant au développement des droits des victimes15. La nouvelle sensibilité produit trois ordres d’effets : tout d’abord, au niveau du droit positif, le législateur promeut des interventions protégeant directement la victime et renforçant ses pouvoirs processuels16 ; ensuite, sous le profil herméneutique, la perspective interprétative du droit pénal intègre la personne qui a subi le préjudice dans l’étude du crime, alors qu’auparavant étaient exclusivement pris en compte l’acteur de l’infraction et du bien juridique protégé17 ; enfin, la réparation du préjudice acquiert une place centrale dans le procès pénal18.
Le recentrage aussi bien du droit de fond que du droit processuel sur la victime conduit à une nouvelle conception de la justice pénale. Si traditionnellement, selon la notion rétributive de la justice, les objectifs du procès pénal sont la recherche de la vérité et la détermination 12 J. MOULY, « Regards sur la « victimisation » du droit contemporain de la responsabilité civile et pénale », in J. HOAREAU-DODINAU, G. METAIRIE, P. TEXIER, La Victime. Définitions et statut, op. cit., p. 300. 13 G. D’AMICO, « Le « vittime » : tra storia e diritto », Contemporanea, a. XIV, n°3, juill. 2011, pp. 503-504 ; J. LUTHER, « Riparare equamente : una storia dei diritti delle vittime », Contemporanea, a. XIV, n°3, juill. 2011, pp. 507-509. 14 L’ouvrage de von Hentig, The Criminal and his Victim, New Haven (Connecticut), 1948, est considéré comme fondateur de la victimologie en tant que science empirique. V. J.-A. WEMMERS, « A Short History of Victimology », in O. HAGEMANN (dir. par), Victimology, Victim Assistance and Criminal Justice Perspectives, Monchengladbach, Monchengladbach Niederrhein University – Kiel University, 2009, p. 33. 15 R. GASSIN, Criminologie, Paris, Dalloz, 3e éd., n°511; O. S. LIWERANT, « Représentation de la souffrance sur la scène du droit étatique… », in G. GIUDICELLI-DELAGE, C. LAZERGES, La victime sur la scène pénale en Europe, Paris, PUF, 2008, pp. 216-218. 16 Pour la France v. notamment le par. II de l’article préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi que l’art. 707, al. 2 du même Code. V. également : H. HENRION, « L’article préliminaire du code de procédure pénale : vers une « théorie législative » du procès pénal ? », Arch. pol. crim., 2001, n°23, p. 13 et J. MOULY, « Regards sur la « victimisation » du droit contemporain de la responsabilité civile et pénale », cit., pp. 311-318. Pour une analyse de la législation pénale italienne en faveur des victimes v. : V. DEL TUFO, « Vittima del reato », Enc. Giur., pp. 999-1002. 17 G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Bologna, Zanichelli, 2005, pp. 152-153. 18 R. GASSIN, « Considérations sur les buts de la procédure pénale », Mélanges J. Pradel, Paris, Cujas, 2006, p. 109.
4
d’une sanction adaptée au coupable, le procès centré sur la victime tente désormais prioritairement à satisfaire les droits de la personne ayant subi le préjudice, et notamment son droit à réparation. La justice restauratrice permettrait, plus que la justice fondée sur l’infliction d’une sanction au coupable, de restaurer le lien social brisé par la commission de l’infraction19. Cela est d’autant plus vrai dans le cas de procès concernant les préjudices de l’histoire. La restorative justice adopte le point de vue des victimes et poursuit comme finalité principale la réconciliation entre les factions opposées d’une nation divisée par des expériences tragiques. L’objet de la mémoire sociale de l’Occident passe ainsi de la « mémoire du mal infligé » à la « mémoire du mal souffert »20.
La justice restauratrice poursuit son but ayant recours à des règlements alternatifs, voire la décriminalisation de certains comportements. L’indemnisation civile du préjudice tend à remplacer la sanction pénale, puisqu’elle est perçue comme « socialement plus utile » et « fonctionnelle aux exigences des victimes »21. La tendance à la « victimisation » comporte ainsi la privatisation du droit répressif et une contractualisation de la procédure pénale : « la justice négociée tend à prendre le pas sur la justice imposée »22. D’ailleurs, selon Antoine Garapon, l’action civile répond mieux à l’exigence de reconnaissance des victimes, permettant de réparer « au déni, au mépris d’humanité », caractérisant le préjudice de l’histoire23. En effet, avec la mort de l’accusé l’action publique s’éteint. En revanche, sur le plan civil les actions en réparation n’ont pas les mêmes contraintes temporelles : « l’action n’est plus liée à la vie d’un suspect mais à celle des victimes potentielles, qui peuvent s’étaler sur des générations »24. La souffrance des victimes est au centre de l’action. Tant que cette souffrance est actuelle, le crime ne se prescrit pas et les victimes peuvent faire valoir en justice leurs créances25. Notamment, l’action civile, comme une action de bottom up, donne la possibilité aux victimes de prendre en main leur sort directement26. La victime n’est plus seulement « celle qui subit, mais aussi celle qui agit, celle qui se venge »27.
Mais qui sont-elles plus précisément les personnes qu’au titre de victimes peuvent agir en justice pour faire valoir leur droit à réparation ?
Pour ce qui est du droit pénal, deux catégories de victimes sont à distinguer : d’une part, la personne lésée par l’infraction, qui est titulaire du bien juridique protégé par la norme pénale, et d’autre part l’endommagé, c’est-à-dire la personne qui subit un dommage patrimonial ou non patrimonial en conséquence de l’infraction et qui peut se constituer partie civile dans le procès pénal pour obtenir réparation28. Les conditions pour la constitution de partie civile en droit français et italien déterminent les titulaires de l’action en justice : la plainte avec constitution de partie civile doit émaner d’une personne ayant subi un dommage réel dérivant de la commission du délit ou du crime poursuivi dans un procès donné. La victime peut en outre être physique ou morale. La « victime physique » est celle qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction29. La « victime 19 L. WALGRAVE, « La justice restauratrice : à la recherche d’une théorie, d’un programme », Criminologie, vol. 32, n° 1 (1999), p. 6. 20 P. P. PORTINARO, I conti con il passato, Milano, Feltrinelli, 2011, p. 27. 21 DEL TUFO, « Vittima del reato », cit., p. 1006. 22 J. MOULY, « Regards sur la « victimisation » du droit contemporain de la responsabilité civile et pénale », cit., p. 318. 23 A. GARAPON, Peut-on réparer l’histoire ? , op. cit., p. 126. 24 Idem, p. 169. 25 Idem, p. 171. 26 Idem, pp. 103-104. 27 F. ALT-MAES, « Le concept de victime en droit civil et pénal », Rev. sc. crim., 1994, p. 35. 28 Dans le cas d’un homicide, par exemple, l’assassiné est la personne lésée par le crime et les personnes de la famille sont les endommagées. V.: G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, op. cit., p. 150; J. PRADEL, Manuel de droit pénal général, Paris, Cujas, 2008, p. 382. 29 Art. 2, Code procédure pénale français; art. 185, Code procédure pénale italien.
5
morale » est une association qui, régulièrement constituée, peut exercer les droits reconnus à la partie civile30.
En droit civil, la notion de victime est contenue dans les articles du code civil relatifs à la responsabilité extracontractuelle 31 , qui impliquent l’existence d’une faute causant un dommage physique, matériel ou moral à une personne. La « victime » est donc celle qui subit un dommage « injuste », et pour cela est titulaire d’un droit à réparation.
Dans le cadre d’un préjudice de l’histoire, les titulaires de la réparation changent en fonction du moment historique de l’injustice subie. Plus le moment historique est ancien, plus les titulaires de l’action en justice relèvent de la sphère du collectif et non pas de celle de l’individuel32. Ainsi, les victimes de l’Holocauste ont un droit individuel à la réparation, bien qu’elles aient souvent agit en justice par le biais d’actions collectives33. En revanche, les descendants des esclaves capturés et emmenés en Amérique pendant les XVIe et XVIIe siècle peuvent plus raisonnablement vanter un droit collectif, demandant aux communautés qui ont bénéficié des avantages des crimes commis par l’exploitation coloniale de transférer une partie de leurs bénéfices à la « communauté-victime »34.
Le droit international a également connu une évolution favorable aux victimes et, dans le temps, il a largement contribué à sensibiliser les États à leur égard.
La reconnaissance de l’état de victime est posée par deux textes de référence : la Déclaration des Nations Unies des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir adoptée par l’Assemblée générale le 29 novembre 198535 et la décision-cadre du Conseil de l’Europe du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales 36 . La première entend par « victimes » des personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice physique, matériel ou moral en raison d’actes enfreignant les lois pénales. « Le terme victime inclut aussi la famille proche ou les personnes à la charge de la victime directe et les personnes qui ont subi un préjudice en intervenant pour venir en aide aux victimes en détresse ou pour empêcher la victimisation ». La décision du Conseil de l’Europe définit la victime comme « la personne physique qui a subi un préjudice physique, moral ou matériel directement causé par des actes ou des omissions enfreignant la législation pénale d’un État membre ».
Si en droit international les victimes peuvent donc compter sur une large reconnaissance, leur droit d’action en justice demeure encore limité. Depuis le Traité de Versailles, l’accès des victimes à la justice internationale a pourtant connu des évolutions importantes. Le Traité de 1919, inspiré par la reconnaissance française d’un droit individuel à la réparation des dommages37, déclare la responsabilité de l’Allemagne et de ses alliés « pour toutes les pertes et tous les dommages soufferts par les gouvernements et les citoyens des États à cause de la guerre imposée par leur agression ». Ce principe dépasse largement le droit traditionnel des 30 Ibidem. 31 Art. 1382, Code civil français ; art. 2043, Code civil italien. 32 P. P. PORTINARO, I conti con il passato, op. cit., p. 174. 33 V. A. GARAPON, G. HELLERINGER, “La réparation des préjudices de l’Histoire”, in F. EWALD, A. GARAPON, G. MARTIN et al., Les limites de la réparation du préjudice, Paris, Dalloz, 2009, pp. 211-225 et pp. 261-271. 34 P. P. PORTINARO, I conti con il passato, op. cit., p. 175. 35 Déclaration A/RES/40/34. 36 Cette décision a été précédée par la résolution du 28 septembre 1977, n° 27 sur le dédommagement des victimes d'infractions pénales ; la Convention européenne du 24 novembre 1983 relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes ; la recommandation du 28 juin 1985, n° R 11 sur la position de la victime dans le cadre du droit pénal et de la procédure pénale ; la recommandation du 17 septembre 1987, n° R 21 sur l’assistance aux victimes et sur la prévention de la victimisation. 37 La loi du 26 décembre 1914 a établi le droit à réparation pour les personnes lésées par la guerre, et la loi du 17 avril 1919 précisa que la réparation serait intégrale.
6
vainqueurs d’imposer aux vaincus le remboursement des dépenses de guerre soutenues et ouvre des nouvelles brèches en matière de réparation des préjudices subis par les civils. En 1950, la Convention européenne des droits de l’homme reconnaît le droit de recours à un juge international à tous ceux qui se déclarent victimes d’une violation de leurs propres droits de la part d’un État, afin d’obtenir une « juste satisfaction »38. Pendant les années quatre-vingt, le Alien Tort Statute américain de 1789 est redécouvert et valorisé. Il permet à des étrangers d’obtenir une réparation des dommages subis par la violation du ius cogens international. En outre, la Cour pénale internationale est dotée de procédures et « principes applicables à des formes de réparation telles que la restitution, l’indemnisation ou la réhabilitation … »39. Enfin, en 2005, l’Assemblée générale de l’ONU adopte les Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law40. La résolution interprète le droit des victimes à une réparation comme le droit d’accéder à la justice et aux informations pour obtenir « restitution, compensation, rehabilitation, satisfaction and guarantees of non-repetition »41.
Toutefois, le droit d’une victime d’agir à l’encontre d’un État étranger est limité par le principe de l’immunité de juridiction d’un État devant les tribunaux d’un autre État. Cette question s’est posée avec force très récemment, suite à un arrêt de la Cour internationale de justice du 3 février 201242. Cette décision a tranché un différend entre l’Italie et l’Allemagne relatif à la réparation des préjudices subis par les victimes civiles italiennes et grecques des massacres nazis effectués entre 1943 et 1945 sur les sols italien et grec. Nous traiterons de l’arrêt dans la seconde partie de notre article, consacrée au cas italien. Ici, nous nous limitons à souligner que cette décision marque un coup d’arrêt important pour le développement d’un droit international protecteur des droits des victimes. La Cour confirme son adhésion au droit international traditionnel, selon lequel la souveraineté étatique est centrale et les réparations font l’objet de revendication entre les États. Les citoyens-victimes n’ont donc pas le droit de saisir les organes juridictionnels nationaux contre les États étrangers qui ont violé les principes fondamentaux du droit humanitaire, bien qu’ils n’aient jamais obtenu réparation pour les préjudices subis43.
À l’état actuel, le droit international offre des garanties exclusivement ponctuelles d’une State Responsability, et non pas une protection générale et uniforme dans toutes les régions du monde. Les États signataires des pactes internationaux doivent indemniser seulement les violations de la liberté personnelle et les erreurs judiciaires. Toute protection ultérieure est rendue inefficace par l’immunité des États44. Ainsi, la reconnaissance et l’indemnisation des victimes d’un préjudice de l’histoire sont remises tout d’abord à la volonté politique des États. Dans ces cas, le droit et la justice sont dépassés et souvent pliés au service d’objectifs de politique interne et internationale.
La notion de « victime » d’un préjudice de l’histoire, tout comme l’idée de réparation45, ne peut donc être définie que par le droit. L’évolution politique contribue de façon
38 Art. 41, CEDH. 39 Art. 75 du Statut de la CPI. 40 Résolution n° 60/147 du 16 décembre 2005. 41 V. : http://www2.ohchr.org/english/law/remedy.htm 42 CIJ, arrêt du 3 février 2012, n° 143, Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce intervenant). 43 T. VAN BOVEN, « Victim’s Rights to a Remedy and Reparation. The New United Nations Principles and Guidelines », in C. FERSTMAN, M. GOETZ, A. STEPHENS (dir. par), Reparations for Victims of Genocide, War Crimes and Crimes against Humanity, Leiden-Boston, Martinus Nijhoff, 2009, p. 19. 44 C. TOMUSCHAT, Human Rights. Between Idealism and Realism, Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 293. 45 A. GARAPON, Peut-on réparer l’histoire ? , op. cit., p. 50.
7
déterminante à préciser son contenu. Si le droit donne des repères stables pour identifier les titulaires du droit à la réparation, la politique rend mouvante la notion de victime, dans la tentative de composer la « raison d’État », les exigences de réconciliation et la nécessité de réintégrer les droits des personnes ayant subi un préjudice.
B. La définition politique de victime
Dans le cadre des préjudices de l’histoire, les États déterminent et font évoluer la notion de victime au grès des exigences de construction d’une mémoire publique46 du passé. La transformation de la conception politique de victime au cours du XXe siècle montre clairement le processus de reconstruction identitaire de la nation au travers d’une lecture changeante de l’histoire.
Traditionnellement, la victime de la guerre est le soldat. Suite au premier conflit mondial, la célébration de la victime-soldat permet à l’État de construire une mémoire collective fondée sur la justification rationnelle de la perte des vies humaines : des hommes ont été sacrifiés pour garantir un futur meilleur au pays. Leur mort n’a donc pas été vaine, elle a un sens, une raison, une justification47. L’État se concentre ainsi sur la réparation des préjudices subis par les invalides, les veuves et les orphelins au travers d’indemnisations économiques, d’aides visant leur réintégration dans la société active, et surtout à travers la glorification des héros de la Nation. L’État célèbre ses martyres.
La deuxième guerre mondiale change sensiblement la perspective politique. Ce conflit est en effet une « guerre de peuple »48. Les civils et les vies des civils deviennent des objectifs directs et parfois centraux de la stratégie militaire49. Par conséquent, si dans l’immédiat après guerre l’exigence de recréer une identité commune amène les différents pays européens à se rassembler autour des combattants – soldats et résistants –50, à partir des années soixante-dix les civils prennent enfin la place du soldat dans l’image de la victime de guerre51. La focalisation de l’attention mondiale sur la tragédie de l’Holocauste, refoulée pendant vingt ans afin de reconstruire et pacifier l’Europe de l’après guerre, contribue sensiblement à la construction politique de la victime « inconsapevole »52. La victime civile inconsciente et innocente témoigne de son sacrifice sans qu’aucun argument ne puisse être fourni pour donner un sens, une raison à la perte, à la souffrance53. L’État se trouve face à des personnes qui demandent la reconnaissance et la réparation de l’injustice subie comme la condition de leur réintégration dans la société. À la différence des combattants morts ou blessés pour une
46 La mémoire publique est une sorte de « pacte », contenant un accord sur les événements du passé à retenir et ceux à oublier. L’arbre généalogique d’une nation se construit sur ces événements. Il s’agit des piliers qui fondent les programmes des écoles, les lieux de mémoire, les critères d’exposition dans les musées, les calendriers des jours fériés, bref tous les choix publics qui orientent les sentiments des citoyens vis-à-vis du passé collectif. Les fondements de ce pacte changent selon les différentes phases du processus historique d’une nation. G. DE LUNA, La Repubblica del dolore, Milano, Feltrinelli, 2011, p. 13. 47 J. WINTER, « La memoria della violenza. Il mutamento dell’idea di vittima tra i due conflitti mondiali », in L. BALDISSARA, P. PEZZINO (dir. par), Crimini e memorie di guerra, Napoli, L’ancora del Mediterraneo, 2004, p. 138. 48 E. J. HOBSBAWM, L’Âge des extrêmes : Le court Vingtième Siècle 1914-1991, Paris, Éditions Complexe, 1999, p. 58. 49 Idem, p. 65. 50 Sur la politique allemande vis-à-vis des victimes du nazisme v. : C. GOSCHLER, « La Wiedergutmachung in Germania », Contemporanea, a. XIV, n° 3, juill. 2011, pp. 514-519. 51 O. S. LIWERANT, « Représentation de la souffrance sur la scène du droit étatique… », cit., pp. 214-215. 52 Selon l’expression utilisée par Primo Levi. Id., “Bozza di testo per l’interno del Block italiano ad Auschwitz”, cit. 53 J. WINTER, « La memoria della violenza. Il mutamento dell’idea di vittima tra i due conflitti mondiali », cit., p. 138.
8
cause tout de moins apparente, les victimes civiles sont en quête d’une reconnaissance capable de donner si non un sens au moins une explication à la tragédie qui les a frappées. Ainsi, à la place des cérémonies célébrant les héros, les pouvoirs publics rendent justice aux victimes inconsapevoli établissant la vérité sur les faits criminels, recherchant les coupables, créant des lieux de mémoire et indemnisant financièrement les personnes lésées et leurs descendants. La justice et la vérité sont les instruments pour « réduire politiquement le sentiment d’éloignement de la cité politique à laquelle les victimes appartiennent »54, apaiser les sentiments de vengeance et encourager la reprise de la vie sociale et politique du pays.
En outre, les indemnisations financières acquièrent une signification différente. La reconnaissance qu’attendent les victimes d’injustices historiques concerne leur existence même, au-delà de la compensation financière qu’ils réclament55. Pour qu’elle puisse atteindre son but, l’indemnisation doit donc être accompagnée d’un rituel politique capable de lui donner un sens56.
La modification des rituels de commémoration, portant désormais sur les victimes civiles et non plus sur les héros, a deux conséquences principales. À partir des années quatre-vingt, la lecture de l’histoire se fait « à travers les yeux des victimes »57. Ainsi, un nouveau rapport au temps se développe et les actions en justice des victimes ainsi que les actions étatiques de reconnaissance et d’indemnisation pour réparer les blessures du passé se multiplient. Cela conduit à la seconde conséquence. L’État ne répond pas de la même façon aux sollicitations des différentes catégories de victimes. Les pouvoirs publics privilégient un groupe ou un autre sur la base de choix d’opportunité politique prenant en compte les contingences historiques, le pouvoir de pression de chaque groupe, la médiatisation des requêtes et, bien sûr, la gravité du préjudice subi. Se développe ainsi le phénomène de la concurrence des victimes et entre les victimes58. Dans un contexte d’individualisation des sociétés, la quête de reconnaissance des différents groupes semble faire craindre l’ouverture de nouvelles fractures et divisions et l’ascension d’une nouvelle trauma industry de la victimisation, qui pourrait marquer le « collapse du futur » sous une « avalanche d’histoire »59 .
Afin de limiter ce risque, un important balancement entre la rule of law et la rule of politics doit être opérée. Les réparations des préjudices de l’histoire, en raison de la nature des crimes commis, du nombre souvent important des victimes et du temps passé entre les faits et les revendications en justice, exigent inévitablement des évaluations politiques. Le droit est donc souvent dépassé. Il est « un moyen de mobilisation politique »60 : même si les arrêts n’ont que peu d’effets, les conséquences politiques peuvent être très importantes atteignant le but de reconnaissance recherché par les victimes. Toutefois, les réparations peuvent être contestées et créer des fortes divisions si le droit cède excessivement le pas au politique. Souvent la sélection des victimes « dignes » d’une réparation est opérée suivant la logique du vainqueur qui règle son compte avec le passé affirmant sa propre justice historique61. Le droit
54 A. GARAPON, Peut-on réparer l’histoire ?, op. cit., p. 20. 55 Idem, p. 214. 56 Idem, p. 224. 57 Idem, p. 60. 58 V. à ce sujet : J.-M. CHAUMONT, La concurrence des victimes, Paris, La Découverte, 1997 ; G. DE LUNA, La Repubblica del dolore, op. cit., pp. 96-103. 59 J. TORPEY, « An Avalanche of History. The « Collapse of the Future » and the Rise of Reparations Politics », in M. BERG, B. SCHAFER (dir. par), Historical Justice in International Perspective, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 2009, p. 24. 60 A. GARAPON, Peut-on réparer l’histoire ?, op. cit., p. 237. 61 A. VON WAHL, « The Politics of Reparation. Why, When and How Democratic Governments Get Involved in Historical Justice in International Perspective », in M. BERG, B. SCHAFER (dir. par), Historical Justice in International Perspective, op. cit., p. 39.
9
est alors un instrument vidé de toute force contraignante autonome, une simple couverture donnant une apparence de légitimité à l’action politique.
II. Le cas italien Le cas italien constitue un exemple intéressant pour saisir la complexité de la notion de
victime du préjudice de l’histoire et pour observer, concrètement, à quel point le droit et le politique s’entrelacent, façonnant sans cesse la forme et la substance de ce concept mouvant.
Le deuxième conflit mondial, tout particulièrement, constitue une période cruciale non seulement parce que les victimes sont multiples et les actions de réparation sont nombreuses, mais aussi puisque, à partir de la reconnaissance des victimes, se construit le paradigme identitaire national. Cela n’est pas propre qu’à l’Italie. Presque tous les pays européens resurgissent du conflit se dotant d’une nouvelle mémoire publique fondée sur la célébration de leurs morts62. Toutefois, l’Italie, en raison des rôles différents qu’elle a joué dans le conflit, interprète la notion de victime de façon très articulée. L’actualité jurisprudentielle, en outre, voit l’Italie protagoniste d’un contentieux international avec l’Allemagne qui aura des reflets importants sur l’évolution future des droits des victimes.
Afin de déterminer les titulaires des réparations du préjudice de l’histoire en Italie, dans le deuxième conflit mondial (B), nous présenterons brièvement les principaux événements qui ont conduit à une telle multiplicité de victimes et qui ont fait obstacle à l’élaboration d’une mémoire publique partagée à la fin de la guerre (A).
A. La période fasciste et le second conflit mondial : victimes et responsables en Italie
Suite à un coup d’État et grâce à l’appui de la monarchie italienne, le 29 octobre 1922
Benito Mussolini, leader d’un parti minoritaire, forme son premier gouvernement. Commence ainsi l’expérience de l’autoritarisme fasciste italien qui dure jusqu’au 25 juillet 1943.
À partir de 1936, isolée au niveau international à cause de la politique coloniale, l’Italie instaure une relation solide de coopération économique et militaire avec l’Allemagne nazie63. L’ « axe Rome-Berlin » conduit à la signature en mai 1939 du « pacte d’acier » entre Mussolini et Hitler, établissant l’alliance entre les deux pays64. Ainsi, quand l’Allemagne, le 3 septembre 1939, entre en guerre contre la France et le Royaume-Uni, Mussolini sait qu’il doit soutenir son allié s’il ne veut pas risquer, une fois le conflit terminé, de « passer dans la catégorie B des puissances européennes »65. Il attend donc la victorieuse avancée allemande en France au printemps 1940 pour déclarer la guerre à ce pays désormais battu, le 10 juin 1940.
Le conflit armé contre la France ne dure que trois jours, avant que l’armistice entre les deux pays soit signé le 24 juin. Mussolini essaie ensuite de conduire une politique militaire en soutien de l’allié allemand, tout en préservant une certaine autonomie dans l’élaboration de la stratégie militaire. Toutefois, l’armée italienne, mal équipée et complètement impréparée au conflit, ne connaît que des défaites, en Égypte et en Éthiopie contre les anglais, en Grèce, en Albanie et en Russie66. Mussolini est alors obligé à se soumettre aux projets stratégiques de son allié, sous le contrôle étroit des commandements militaires allemands.
62 P. PEZZINO, « Guerra ai civili. Le stragi fra storia e memoria », in L. BALDISSARA, P. PEZZINO, Crimini e memorie di guerra, op. cit., pp. 24-27. 63 L. SALVATORELLI, G. MIRA, Storia d’Italia nel periodo fascista, Torino, Einaudi, pp. 885-1007. 64 Idem, pp. 1008-1010. 65 Selon l’expression utilisée par le ministre des affaires étrangères Galeazzo Ciano. Cité in P. ORTOLEVA, M. REVELLI, L’età contemporanea, Milano, Mondadori, 1998, p. 367. 66 L. SALVATORELLI, G. MIRA, Storia d’Italia nel periodo fascista, op. cit., pp. 1046-1079.
10
De toute évidence, comme Winston Churchill l’affirmait, l’Italie est le « ventre mou de l’Axe »67. Ainsi, les forces anglo-américaines, afin de s’assurer le contrôle de la Méditerranée, débarquent en Sicile les 9 et 10 juillet 1943, sans que l’armée italienne n’oppose une résistance significative. Suite à ces événements, ainsi qu’aux grèves répétées et diffusées dans tout le pays, le Grand conseil du fascisme, le 25 juillet 1943, vote une motion de censure contre Mussolini. Le roi confie le gouvernement au général Pietro Badoglio et ordonne l’arrestation de Mussolini68. Si dans un premier temps Badoglio affirme de vouloir continuer la guerre aux côtés de l’allié allemand, le 8 septembre 1943, suite à des négociations secrètes avec les forces anglo-américaines, l’Italie signe l’armistice avec ces dernières69. L’Italie s’engage à cesser toute hostilité, à terminer la collaboration avec les allemands et à permettre aux anglo-américains d’utiliser son territoire pour les opérations militaires. En outre, il est établi qu’elle ne fasse pas partie du cercle des Alliés et elle acquiert le statut ambigu de « cobelligérant ». La réponse allemande est immédiate : l’armée d’Hitler envahit et occupe l’Italie du Nord et du centre, déporte les militaires italiens et le 12 septembre Mussolini, emprisonné sur le Gran Sasso, est libéré par des parachutistes allemands. Mussolini retourne alors en Italie et proclame la constitution de la République sociale italienne, avec la nomination d’un nouveau gouvernement ayant son siège à Salò, en Lombardie. Une armée est également constituée, la Guardia nazionale repubblicana, et les jeunes italiens qui refusent de s’enrôler sont condamnés à mort70.
En même temps, le 9 septembre 1943, à l’initiative des principaux partis antifascistes, est fondé le Comité national de libération, auquel font référence toutes les bandes de résistants, qui, dans le Nord et dans le centre de l’Italie, organisent la lutte armée contre l’occupation allemande et la République de Salò. En 1945 les résistants sont 130 00071. Il s’agit d’une véritable armée, structurée et organisée en brigades et divisions, en formations hiérarchiquement encadrées et disciplinées. Toutefois, la Résistance en Italie a une importance et une signification davantage politique72. Dans un pays dominé pendant vingt ans par un régime dictatorial, la guerre de libération est une expérience fondamentale de participation civile, où le peuple joue un rôle majeur, contribuant à l’avancée de la démocratie dans l’après guerre. Cela a été possible non seulement parce que dans la Résistance s’étaient renforcés, acquérant plus de légitimité, les partis politiques de masse qui guideront la République italienne par la suite, mais aussi puisque dans la lutte armée a émergé et s’est exprimé une « autonomie » des masses subalternes, une capacité d’initiative collective sociale qui étaient manquées dans le processus d’unification nationale du Risorgimento. La guerre des partigiani – les maquis – a été une véritable « guerre civile, une guerre idéologique et politique, une guerre destinée (…) à mettre les bases pour un nouvel ordre politique et social », bref « une révolution démocratique »73.
Pour résumer, entre 1943 et 1945, l’Italie se trouve dans la situation suivante : le Sud et les parties du pays libérées sont administrés par les forces anglo-américaines et le gouvernement italien « d’unité nationale », formé par tous les partis du Comité national de libération74 ; le Nord est occupé par les allemands et gouverné par la Repubblica sociale de Mussolini jusqu’en avril 1945. L’Italie vit donc une expérience particulière, dans laquelle se croisent trois types de guerres différents : la guerre de libération nationale contre l’occupant 67 Cité par P. ORTOLEVA, M. REVELLI, L’età contemporanea, op. cit., p. 369. 68 P. GINSBORG, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, Torino, Einaudi, 1989, p. 7. 69 S. COLARIZI, La seconda guerra mondiale e la Repubblica, Torino, Einaudi, 1984, pp. 212-219. 70 L. SALVATORELLI, G. MIRA, Storia d’Italia nel periodo fascista, op. cit., pp. 1114-1121. 71 G. QUAZZA, Resistenza e storia d’Italia, Milano, Feltrinelli, 1976, p. 202. 72 P. ORTOLEVA, M. REVELLI, L’età contemporanea, op. cit., p. 377. 73 Dante Livio BIANCO, résistant et avocat, cité par Ibidem. 74 L’avancée des troupes alliées est fortement ralentie en 1944. Arrivés jusqu’aux Apennines situés entre la Toscane et l’Émilie-Romagne, les alliés s’arrêtent jusqu’au printemps 1945.
11
allemand ; la guerre civile contre les fascistes pour un nouvel État démocratique ; et enfin la guerre de classe pour un nouveau modèle d’organisation sociale. La première guerre, patriotique et traditionnelle, connaît une pleine réussite. La guerre civile, en revanche, ne réussit que partiellement. La République italienne naît sur les bases d’une Constitution nettement démocratique, fondée sur les valeurs de la Résistance, mais la structure profonde de l’État et sa classe dirigeante gardent une forte continuité avec le passé. Enfin, la troisième guerre, celle de classe, subi une forte défaite75.
Dans ce contexte historique complexe, les victimes sont multiples ainsi que les responsables des préjudices.
Les principaux coupables des crimes de guerre et contre l’humanité sont les autorités fascistes entre 1922 et 1943, les fascistes de la Repubblica sociale italiana entre 1943 et 1945, les nazis pendant l’occupation et les forces alliées libératrices.
Parmi les victimes il faut distinguer entre les victimes italiennes et les victimes étrangères. Les victimes italiennes sont les juifs, qui, à partir des lois raciales de 193876, sont tout d’abord discriminés, persécutés, exclus de la vie social et civil du pays, pour ensuite être déportés dans les camps de concentration allemands pendant la guerre. 40 000 juifs italiens sont morts77 dans les lagers allemands, souvent avec la collaboration des autorités fascistes, qui avaient d’ailleurs organisé des camps de transit en Italie78.
Les opposants politiques sont également des victimes du régime fasciste. Torturés, assassinés, emprisonnés79, isolés80, les antifascistes résistent au régime dans la clandestinité, créant des groupes basés souvent à l’étranger81.
Les résistants sont les victimes des armées nazie-fascistes. 30 000 maquis ont perdu la vie dans le conflit82. Ils ont été torturés, souvent assassinés et ensuite exposés sur la voie publique, afin de montrer l’exemple à la population et aux autres partigiani.
Après l’armistice, en outre, 700 000 soldats italiens ont été internés dans les camps allemands pour avoir refusé d’adhérer à la République de Salò 83. 50.000 sont morts dans les camps d’internement, d’autres ont été tués sur le champ, malgré qu’ils se fussent rendus84.
D’autres victimes du nazi-fascisme sont les 50.000 civils internés dans des camps de travail allemands avant et pendant la guerre85.
75 C. PAVONE, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della Resistenza, Torino, Bollati Boringhieri, 2006. 76 Décret-loi royal (R.D.L.) n° 1390, du 5 septembre 1938; R.D.L. n° 1381 du 7 septembre 1938; R.D.L. n° 1630 du 23 septembre 1938; Déclaration sur la race votée par le Grand Conseil du Fascisme le 6 octobre 1938; R.D.L. n° 1779 du 15 novembre 1938; R.D.L. n° 1728 du 17 novembre 1938; R.D.L. n° 1054 du 29 juin 1939. V. : L. SALVATORELLI, G. MIRA, Storia d’Italia nel periodo fascista, op. cit., pp. 979-983 et 993-998. 77 P. ORTOLEVA, M. REVELLI, L’età contemporanea, op. cit., p. 373. 78 V. : S. ZUCCOTTI, The Italians and the Holocaust, London, Peter Halban, 1987 ; C. DI SANTE (dir. par), I campi di concentramento in Italia. Dall’internamento alla deportazione (1940-1945), Milano, Franco Angeli, 2001. 79 2 300 opposants politiques sont internés dans des camps de concentration italiens. G. D’AMICO, Quando l’eccezione diventa norma, Torino, Bollati Boringhieri, 2006, p. 19. 80 17 000 opposants politiques ont été envoyés au confino, c’est-à-dire dans des endroits isolés, les coupant de toutes leurs attaches et les empêchant d’exercer toute activité. L. GANAPINO, « Antifascismo », in E. COLLOTTI, R. SANDRI, F. SESSI (dir. par), Dizionario della Resistenza, vol. I, Torino, Einaudi, 2000 ; C. S. CAPOGRECO, « Confino, colonie di confino », in Idem, vol. II. 81 V. : L. SALVATORELLI, G. MIRA, Storia d’Italia nel periodo fascista, op. cit., pp. 586-689. 82 P. ORTOLEVA, M. REVELLI, L’età contemporanea, op. cit., p. 373. 83 V. BELLINI (dir. par), La prova – Militari italiani nei Lager nazisti, Monza, Viennepierre, 1991. 84 M. FILIPPINI, La tragedia di Cefalonia. Una verità scomoda, Roma, IBN, 2004. Pour une analyse de l’ensemble des massacres de soldats italiens effectués par les allemands en dehors de toute règle militaire, v.: F. GIUSTOLISI, L’armadio della vergogna, Roma, Nutrimenti, 2004, pp. 253-286. 85 L. RICCIOTTI, Gli schiavi di Hitler, Milano, Mondadori, 1996, pp. 5-32.
12
Enfin, entre 1943 et 1945, 20 000 civils sont tués par les armées nazie et fasciste86. Les massacres ont souvent deux finalités : la représailles sur la population civile suite à des actions des résistants et la punition des civils accusés de soutenir les maquis. La violence gratuite et la politique de la terreur dépendent également des sentiments de rancune ou vengeance des soldats, dus à une situation de difficulté militaire, notamment lors de la retraite, ou à l’hostilité manifeste de la population87.
Les forces libératrices se sont tâchées également de crimes atroces contre la population civile. Tout particulièrement, les soldats marocains de l’armée française se sont livrés, à plusieurs reprises, à des viols de masse, dans les régions du centre de l’Italie. 60 000 femmes ont été violées, ainsi que des hommes et des enfants88.
Les victimes étrangères sont essentiellement les États libyen et éthiopien et les civils de ces pays tués dans la période coloniale, ainsi que la Grèce et la Slovénie et les citoyens morts pendant l’occupation italienne89.
Jusqu’aux années soixante, le silence était maintenu sur les crimes, les massacres et les génocides commis pendant la période coloniale italienne en Afrique90. À l’heure actuelle, les études historiques91 ont désormais décrit et repéré les épisodes et les faits considérables comme des « crimes de guerre ». Il s’agit, notamment, de l’utilisation d’armes chimiques lors de la reconquête de la Libye (1923-1932) et pendant l’agression de l’Éthiopie entre 1935 et 193692 ; de la construction de camps de concentration en Cyrénaïque et du maintien de la population civile dans ces camps pendant et après la répression de la résistance anticoloniale (1931-1933)93 ; et de la réaction violente et disproportionnée de la police coloniale suite à l’attentat à Graziani à Addis Abeba le 19 février 193794. L’hypothèse d’actes génocidaires a en outre été avancée dans deux cas : le traitement des populations de la Cyrénaïque et la lutte italienne à la résistance éthiopienne après la conquête du pays95.
En Grèce, dans la période où l’armée italienne exerçait les pouvoirs d’occupation sur les deux tiers de la péninsule (1941-1943), l’Italie s’est rendue responsable de graves violations des lois de la guerre et du droit international humanitaire96. Les violences contre les civils ont été répétées et très graves, souvent au titre de représailles contre les actions des résistants grecs. Dans le camp de concentration de Larissa, construit en août 1941, les italiens ont eu recours à la torture et ont tué plus de 1 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées inculpés d’avoir soutenu le combat des « rebelles »97. Entre 1942 et 1943, 86 V. : F. GIUSTOLISI, L’armadio della vergogna, op. cit., pp. 97-242; T. MATTA (dir. par), Un percorso della memoria. Guida ai luoghi della violenza nazista e fascista in Italia, Milano, Electa, 1996. 87 P. PEZZINO, « Guerra ai civili. Le stragi fra storia e memoria », cit., pp. 20-21 et pp. 53-58. 88 Il s’agit des « marocchinate ». La magistrature française est intervenue en 1945 mettant sous procès 360 soldats marocains. V. FERRETTI, Kesselring, Milano, Mursia, 2009, p. 97. 89 E. COLLOTTI, « Sulla politica di repressione dell’Italia nei Balcani », in L. PAGGI (dir. par), La memoria del nazismo nell’Europa di oggi, Firenze, La Nuova Italia, 1997. 90 A. DEL BOCA, « Le conseguenze per l’Italia del mancato dibattito sul colonialismo », Studi piacentini, 5, 1989. 91 V. tout particulièrement : A. DEL BOCA, Gli italiani in Africa Orientale, 4 vol., Roma-Bari, Laterza, 1976-1984. 92 A. DEL BOCA, I gas di Mussolini, Roma, Ed. Riuniti, 1996. 93 G. OTTOLENGHI, Gli italiani e il colonialismo. I campi di detenzione italiani in Africa, Milano, SugarCo, 1997. 94 G. ROCHAT, « L’attentato a Graziani e la repressione italiana in Etiopia 1936-1937 », Italia contemporanea, 118, 1975. 95 V. : G. ROCHAT, « Il genocidio cirenaico », Belfagor, 4, XXXV, 1980 ; E. SALERNO, Genocidio in Libia. Le atrocità nascoste dell’avventura coloniale (1911-1931), Milano, SugarCo, 1979. 96 G. ROCHAT, « La guerra di Grecia », in M. ISNENGHI (dir. par), I luoghi della memoria. Strutture ed eventi dell'Italia unita, Roma-Bari, Laterza, 1997, pp. 345-363. 97 ONHCG, Les atrocités des quatre envahisseurs de la Grèce. Allemands Italiens Bulgares Albanais, Athènes, 1946.
13
l’Italie adopte une véritable « politique du massacre » qui conduit à la destruction partielle ou intégrale de plus de 400 villages grecs98.
Enfin dans l’actuelle Slovénie, après l’invasion et l’occupation de l’armée italienne, Mussolini confie le maintien de l’ordre public à l’armée qui, pour faire face à la lutte des maquis slovènes, met en place une stratégie consistant dans la destruction de villages, dans les enlèvements arbitraires, dans l’exécution d’otages et dans la réclusion brutale de civils et résistants dans des camps d’internement99.
B. Le long chemin de la reconnaissance des victimes
Dans l’après guerre le chemin de la reconnaissance des victimes et de la réparation des préjudices a été très long et fortement marqué par, à la fois, l’agenda politique de la nouvelle République italienne et celle des pays vainqueurs. Afin de montrer comment les instances de ces multiples victimes ont été prises en compte par les autorités italiennes et d’analyser les raisons de traitements si différents, nous avons identifié trois catégories de victimes. Chaque catégorie est élaborée en fonction du degré de reconnaissance obtenue et de l’importance des réparations reçues. Les victimes de « catégories A » ont joui d’une reconnaissance et de réparations immédiates, accédant à la pleine réintégration dans la nouvelle société démocratique italienne (1). Les victimes de « catégorie B » ont bénéficié, en revanche, d’une reconnaissance et d’une réparation moindres (2). Les victimes de « catégorie C », enfin, sont doublement victimes : d’une part, elles ont subi un préjudice sous le fascisme et pendant la guerre et, d’autre part, elles ont été « victimes du silence »100 dans l’après guerre. Elles accèdent en effet très tardivement à une reconnaissance et les formes de réparation politiques et judiciaires sont fortement insuffisantes (3).
1. Les victimes de « catégorie A » : les victimes de la Repubblica Sociale Italiana Dans l’après guerre, la nouvelle république essaie de se reconstruire sur la base d’une
mémoire officielle qui tend à exalter la guerre de Libération combattue contre le nazi-fascisme entre 1943 et 1945 et à refouler la période du régime fasciste. La guerre combattue jusqu’en septembre 1943 est transformée en guerre imposée par le régime à la nation. Les martyres et les héros de la guerre sont ceux qui ont pris partie à la lutte contre l’occupant nazi et contre le régime de Salò. Les victimes de la Repubblica Sociale Italiana, et notamment les résistants, les soldats italiens qui ont choisi de combattre aux côtés des alliés après l’armistice de 1943, les prisonniers de guerre qui ont refusé d’adhérer à la République de Mussolini, et les déportés politiques et raciales après 1943, bénéficient ainsi de mesures de réparation privilégiées par rapport aux autres victimes.
En 1946, la loi n° 372 indemnise les persécutés de Salo pour les « dommages physiques » qui ont diminué leur capacité de travail. La loi exclut toutefois la responsabilité directe de l’État pour les événements qui ont produit les dommages, lui attribuant une sorte de responsabilité objective101. Ce qui est réparé est le « préjudice de la guerre »102. La faute de l’État et, plus précisément, le comportement fautif de ces dirigeants ne sont pas mis en cause. L’Italie veut repartir sur des nouvelles bases démocratiques et le nouveau gouvernement
98 L. SANTARELLI, “La violenza taciuta. I crimini degli italiani nella Grecia occupata”, BALDISSARA (L.), PEZZINO (P.) (a cura di), Crimini e memorie di guerra, op. cit., pp. 286-288. 99 E. COLLOTTI, « Sulla politica di repressione dell’Italia nei Balcani », in L. PAGGI (dir. par), La memoria del nazismo nell’Europa di oggi, Firenze, La Nuova Italia, 1997 ; H. J. BURGWYN, « Le divergenze tra i « professionisti » della controguerriglia italiana in Slovenia e Dalmazia », in Idem, pp. 247-249. 100 D. BIACCHESI, Il paese della vergogna, Milano, Chiarelettere, 2007, p. 12. 101 G. D’AMICO, « Le « vittime » tra storia e diritto », cit., p. 504. 102 Ibid.
14
alimente la fiction de la transformation totale des institutions et de l’administration, alors que la continuité avec le régime fasciste est très forte.
La réintégration des victimes dans la vie civile et politique du pays passe davantage au travers du travail103. Ce moyen de réparation répond en effet à la nouvelle conception sociale de l’État-Providence italien, selon lequel l’Italie est une « République fondée sur le travail »104. Ainsi, les persécutés et les anciens combattants105 bénéficient du droit à être réembauchés par les entreprises privées, qui les avaient licenciés pour des motifs raciaux ou politiques ou en raison de la guerre. Le législateur exerce des pressions importantes sur le patronat pour que celui-ci impose aux entrepreneurs de recruter une main d’œuvre jugée par ces derniers « vielle » et « débilitée »106. Le législateur considère également prioritaire l’insertion de ces victimes dans la fonction publique. Ainsi, dans les concours publics, 50% des postes est réservé à ces catégories et parfois sont institués des concours réservés.
Les déportés victimes du nazisme ont en outre bénéficié d’indemnisations provenant de l’Allemagne de l’ouest. Le dédommagement allemand a été le résultat de longues négociations diplomatiques. Dans un premier temps, les préjudices infligés par les nazis aux civils et aux soldats des pays occupés sont considérés faire l’objet des traités de paix. L’Italie se trouve alors dans une situations particulière : son alliance avec l’Allemagne nazie l’oblige en 1947 à renoncer aux réparations de guerre qui lui seraient dues par l’Allemagne107. Le gouvernement italien tente de faire passer l’idée selon laquelle les réparations de guerre devraient être séparées des indemnisations dues aux persécutés du nazisme. L’Allemagne reste toutefois sourde aux requêtes italiennes, jusqu’à ce que, le 21 juin 1956, huit États européens demandent au gouvernement fédéral allemand « d’examiner la question de l’indemnisation des déportés de guerre ». Le 8 décembre 1958, l’Allemagne répond admettant la possibilité d’indemniser les victimes étrangères du nazisme. Les associations italiennes des victimes du nazi-fascisme commencent alors à faire pression sur le gouvernement italien pour qu’il négocie et obtienne les mêmes conditions. Le 2 juin 1961 l’Italie et l’Allemagne arrivent à un accord. Les allemands s’engagent à verser 40 millions de marcs en faveur de citoyens italiens « pour des raisons humanitaires »108. Selon les allemands, les résistants et les militaires prisonniers dans les camps nazis sont donc exclus de toute forme d’indemnisation. Le débat italien sur la détermination des victimes ayant droit à réparation se fait très animé. Le décret du président de la République du 6 octobre 1963109, réglementant les critères pour établir les ayants droit et la distribution du fond, en dépit de la volonté allemande, élargit de fait le nombre des requérants potentiels. Le décret confirme qu’il s’agit d’une « réparation morale » de l’Allemagne en faveur des citoyens italiens « victimes d’une déportation pour des raisons de race, de foi ou d’idéologie ». La condition de la déportation est toutefois combinée avec l’exigence que le bénéficiaire ait adopté des comportements de résistance active avant la déportation. Ainsi, les résistants déportés dans des camps de concentration soumis au contrôle allemand – en Allemagne ou en Italie – ont droit à l’indemnisation110. De même, les militaires 103 J. LUTHER, « Riparare equamente : una storia dei diritti delle vittime », cit., p. 511. 104 Art. 1, Constitution de 1948. 105 Les « persécutés » sont les déportés politiques et raciaux dans les camps de concentration et d’extermination avant et après l’armistice du 8 septembre 1943. Les « anciens combattants ou rescapés» sont en revanche les combattants, les prisonniers de guerre, les résistants, les déportés et les internés dans des camps de concentration italiens. G. D’AMICO, Quando l’eccezione diventa norma, op. cit., p. 15. 106 Ibid. 107 Art. 77, 4e al., du Traité de paix des Nations Unies avec l’Italie, Paris, 10 février 1947. V. : S. LORENZINI, L’Italia e il trattato di pace del 1947, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 192. 108 F. FOCARDI, L. KLINKHAMMER, « Quale risarcimento alle vittime del nazionalsocialismo ? L’accordo globale italo-tedesco del 1961 », cit., p. 17. 109 Dpr n° 2043, GU 21 janvier 1964. 110 Cela a soulevé de nombreuses protestations dans la République fédérale allemande. De nombreux parlamentaires affirmaient en effet que les résistants italiens étaient des simples assasins que « selon le droit
15
déportés qui ont manifesté une résistance active au nazisme peuvent bénéficier du fond. Toutefois, la commission instituée pour évaluer les demandes et distribuer la somme envoyée par l’Allemagne111, limite fortement l’attribution de l’indemnisation aux militaires112. Le refus d’adhérer à la République sociale et de s’enrôler dans son armée n’est en effet pas considéré comme un acte de résistance active de la part des soldats italiens déportés.
Enfin, dans le cadre des victimes de « catégorie A », il est important de souligner l’attitude ambiguë et contradictoire des institutions italiennes vis-à-vis des résistants. Si les autorités politiques attribuent à ces derniers une reconnaissance et des réparations importantes, l’autorité judiciaire adopte une attitude qui pénalise et redimensionne fortement l’action du politique. L’absence d’une définition précise du statut de « combattant légitime » favorise une interprétation judiciaire subjective et discrétionnaire de la régularité des actions faisant partie de la lutte de résistance. Souvent, les juges associent ces actions à des infractions de droit commun, comme le vol, le meurtre, les violations de domicile, les lésions personnelles, les violences privées, les rapines ou bien les extorsions. Au lendemain de la chute du régime fasciste, au niveau juridico-formel, manque complètement « la reconnaissance stable de la nouvelle légalité issue de la Révolution »113. Au lieu de seconder « la rupture de la continuité juridique de l’État né de la Résistance »114, la magistrature privilégie la continuité des institutions et de ses lois au détriment de la lutte antifasciste115. Ainsi, les décrets amnistiant les délits commis pendant la guerre116 sont interprétés par les juges pénaux de façon très restrictive pour les cas concernant les résistants, alors que les fascistes du régime et de Salo bénéficient souvent d’une clémence plus importante117. Le régime de Salo est notamment interprété par la Cour de cassation comme une « république nécessaire », guidée par la volonté de protéger la population et racheter la patrie118. Par conséquent, l’assomption de fonctions directives dans la République sociale est considérée comme l’expression de la volonté non pas de collaborer avec les nazis, mais bien au contraire de s’y opposer. Les dirigeants les plus hauts placés de la République de Salo bénéficient ainsi de l’amnistie119.
La répression des actions commises par les résistants atteint après la guerre des proportions telles qu’un décret du 6 septembre 1946120 établit l’interdiction d’arrêter les maquis pour les faits commis pendant l’occupation nazi-fasciste. Les prisons sont remplies, à cette époque, de partigiani auxquels ont été appliquées les mesures de prévention pour les
international auraient dû être fusillés ». Cité par F. FOCARDI, L. KLINKHAMMER, « Quale risarcimento alle vittime del nazionalsocialismo ? L’accordo globale italo-tedesco del 1961 », cit., p. 22. 111 La commission a été nommée par le gouvernement italien en mai 1964 et a travaillé jusqu’en novembre 1967. Idem, pp. 22-23. 112 Sur un total de 12 673 personnes indemnisées, 8 275 étaient des déportés civils, 3 321 étaient des déportés raciaux et 1 077 des déportés militaires. Idem, p. 23. V. également : G. HAMMERMANN, « Le trattative per il risarcimento degli internati militari italiani 1945-2007 », Italia contemporanea, déc. 2007, n° 249, pp. 541-557. 113 P. CALAMANDREI, « Restaurazione clandestina », Il Ponte, 1947, pp. 965-966. 114 Idem, p. 683. 115 A. SANTOSUOSSO, F. COLAO, Politici e amnistia, Verona, Bertani ed., 1986, p. 108. 116 Pendant et après la guerre, trois mesures d’amnisties sont prises. Le royal décret n° 96 du 5 avril 1944 annule la peine pour les actions commises par ceux qui ont combattu contre l’armée allemande. Le décret-loi n° 719 du 28 octobre 1945 amnistie tous les délits commis pendant le régime mussolinien pour lutter contre le fascisme ou pour se défendre des persécutions du fascisme ou pour s’y soustraire. Enfin, le décret présidentiel n° 4 du 22 juin 1946 (amnistie « Togliatti ») vise à faire oublier non seulement les délits commis lors de l’activité de résistance mais aussi les délits liés à la collaboration avec les allemands envahisseurs. 117 En 1947, en vertu de l’amnistie Togliatti, des 7 061 politiques amnistiés 153 sont des résistants et 4 129 sont des fascistes. 2 973 fascistes ayant « revêtu des fonctions elévées de direction civile ou politique ou de commandement militaire » sont amnistiés. Idem, p. 114. 118 M. FRANZINELLI, L’amnistia Togliatti, Milano, Mondadori, 2006, p. 142. 119 V. l’analyse des arrêts des tribunaux spéciaux et ordinaires : Idem, pp. 143-250. 120 N° 96.
16
infractions commises pendant la lutte de libération121. Encore en 1959 une nouvelle amnistie tente de réparer aux tensions sociales déclenchées par l’attitude de la magistrature122 concédant l’annulation des peines à ceux qui, pendant le fascisme, en raison de leur activité politique d’opposition au régime, ont été qualifiés comme des délinquants habituels123.
Enfin, il ne faut pas manquer de souligner que si les autorités politiques semblent défendre la mémoire publique de la Résistance et valoriser son rôle dans la construction identitaire de la nouvelle république, elles contribuent toutefois également à discréditer les maquis. L’amnistie, en effet, est une mesure visant l’extinction de la prétention punitive de l’État et non pas l’effacement du délit. Elle laisse d’ailleurs persister les obligations civiles dérivant de ce dernier. Amnistier les résistants signifie donc vouloir oublier des actions qui sont de fait considérées comme des délits par l’État124.
2. Les victimes de « catégorie B » : les persécutés politiques et raciaux du régime
fasciste-monarchique (1922-1943) et les repubblichini Pendant que l’Italie du Nord et du Centre est déchirée par la guerre de libération contre
l’occupant nazie et la Repubblica sociale italiana, dans le Royaume du Sud le Conseil des ministres approuve la première loi de restitution du poste de travail aux persécutés du régime fasciste-monarchique. Le décret-loi royale n° 9 du 6 janvier 1944 dispose le recrutement obligatoire par l’Administration publique des personnes licenciées pour des raisons politiques et raciales. Un décret-loi royal du 20 janvier 1944125 reconnaît à nouveau aux juifs les droits civils et politiques et prévoit la restitution des biens soustraits à ces derniers par l’État126. En 1945, le décret-loi n° 222 complète la disposition de 1944 prévoyant la nullité de tous les contrats de vente ou les donations effectués par les juifs sous la pression ou la menace des lois raciales127.
Dans l’après guerre, toutefois, les persécutés politiques et raciales du régime autoritaire ne bénéficient pas des mêmes mesures réparatrices prévues pour les persécutés entre 1943 et 1945. Si la loi « Terracini » de 1955128 élargit aux persécutés par le régime le droit à l’indemnisation prévu par la loi n° 372 de 1946, les conditions sont tout de même moins favorables. En vertu de la loi, les personnes ayant subi une perte de leur capacité de travail supérieure à 30% en raison de la réclusion dans les prisons du régime, de l’isolement (confino) dans des maisons de travail ou de l’internement dans des camps de concentration italiens, obtiennent le droit à une aide financière étatique à vie (assegno vitalizio di benemerenza). Toutefois, cette aide, si d’une part reconnaît les souffrances infligées aux victimes par le régime, d’autre part, n’attribue pas un véritable droit à réparation. Il s’agit en effet d’une mesure de sécurité sociale, concédée à la condition que les individus, en plus que les préjudices subis, se trouvent dans une situation économique de nécessité. De plus, la
121 A. GALANTE GARRONE, « La magistratura italiana fra fascismo e Resistenza », Nuova Antologia, 1986, p. 110. 122 L’historien Neppi Modona parle d’un véritable « procès à la Résistance ». G. NEPPI MODONA, « Il problema della continuità dell’amministrazione della giustizia dopo la caduta del fascismo », in Giustizia penale e guerra di Liberazione, Milano, Angeli, 1984, p. 29. 123 Dpr n°460 du 11 juillet 1959. M. PONZANI, « Il diritto di Resistenza », cit., p. 41. 124 A. SANTOSUOSSO, F. COLAO, Politici e amnistia, cit., p. 106. 125 N° 26. 126 G. D’AMICO, Quando l’eccezione diventa norma, op. cit., pp. 31-35. 127 Idem, pp. 94-115. 128 Loi du 10 mars 1955, in GU 26 mars 1955, n°70.
17
couverture financière de la loi est très exiguë et donc insuffisante pour répondre aux exigences de toutes les victimes129.
De même, l’accès à la fonction publique est plus limité pour les victimes de « catégorie B ». La loi n° 1488 de 1947 introduit des quotas plus importants en faveur des anciens combattants et des persécutés après 1943. Par conséquent, les persécutés du régime fasciste avant 1943 doivent se contenter des postes restés vacants. En outre, les concours publics réservés aux « victimes de catégorie B » sont organisés seulement après que les concours réservés aux anciens combattants et persécutés du nazi-fascisme130 aient eu lieu, avec un nombre de postes plus limité. Enfin, les persécutés par le régime fasciste et monarchique n’obtiennent pas le droit d’être réembauchés par les entreprises privées. Cela reste donc une prérogative des victimes de « catégorie A ».
La raison du traitement différent résulte clairement dans les débats parlementaires relatifs à la loi Terracini. Dans le cas des victimes du régime avant 1943, manque la guerre comme condition engageant la responsabilité objective de l’État pour les préjudices subis. Les dommages infligés par l’État fasciste sont considérés comme la conséquence d’une sorte de « guerre civile », pour laquelle l’État républicain ne s’estime pas responsable131.
À la « catégorie B » des victimes appartiennent également les « Repubblichini », c’est-à-dire les personnes qui en 1943 ont décidé d’adhérer à la Repubblica sociale italiana. Cette inclusion est certainement dérangeante dans une reconstruction de la mémoire publique qui entend opérer une distinction nette entre ceux qui ont combattu pour les valeurs de la démocratie et de la liberté et ceux qui ont combattu pour un régime autoritaire fondé sur l’oppression des peuples et la haine raciale. Toutefois, l’Italie républicaine de l’après guerre n’établit pas cette distinction de façon tranchée. Malgré la proclamation des valeurs antifascistes dans la Constitution de 1948, les autorités politiques et judiciaires gardent une attitude ambiguë vis-à-vis du passé autoritaire. Ainsi, alors qu’en 1946 le parlement veut procéder à l’épuration des participants à la République sociale et au régime fasciste établissant des règles de déclassement et de licenciement des postes de la fonction publique, le décret-loi n° 1488 de 1947 soustrait du projet législatif les sanctions les plus lourdes. De fait, les cadres administratifs fascistes restent à leurs places132. En outre, dès 1945, la magistrature reconnaît aux militaires passés à la République de Salo après septembre 1943 le statut d’officiers en tant que « militaires réguliers »133. Par conséquent, dans les procès pénaux les concernant, les soldats de Salo bénéficient de l’application de la Convention de Genève de 1929 sur le traitement des prisonniers de guerre, alors que cela est exclu pour les résistants134. Le 6 mars 1953, la loi n° 178 permet aux ex miliciens fascistes de recevoir les décorations de la valeur militaire et d’exiger les rémunérations dues à ce titre. Enfin, l’amnistie « Togliatti » du 22 juin 1946135, associée à une forte bienveillance de la part de l’autorité judiciaire italienne136, contribue à laisser impunis de nombreux délits commis par les fonctionnaires et les militaires fascistes avant et pendant la guerre. La relation Togliatti au décret présidentiel illustre bien les raisons de l’opération de victimisation des ex repubblichini. Le secrétaire du parti communiste affirme que la réinsertion dans la vie nationale des ex fascistes est inévitable et essentielle pour la paix sociale et politique du pays. Les miliciens ne seraient que des 129 F. FOCARDI, L. KLINKHAMMER, « Quale risarcimento per le vittime del nazionalsocialismo ? », cit., p. 15. 130 G. D’AMICO, Quando l’eccezione diventa norma, op. cit., pp. 251-256. 131 G. D’AMICO, « Le « vittime » tra storia e diritto », cit., p. 506. 132 Idem, pp. 148-169. 133 Cour d’Assise de Rome, 19 juin 1945, n° 79, cité par M. PONZANI, « Il diritto di Resistenza », Italia contemporanea, a. XIV, n° 3, juill. 2011, p. 30. 134 Ibid. 135 Dpr n° 4, in Lex, 1946, XXXII-I, p. 722. 136 V. : M. PONZANI, « Il diritto di Resistenza », cit., pp. 26-42.
18
jeunes « piégés par une propagande mensongère… jeunes rendus incapables de distinguer le bien du mal par vingt ans de dictature »137. Dans la même logique, en 2008, un projet de loi138 inabouti propose d’élargir aux soldats de la République sociale les pensions de guerre prévues pour les résistants. Cette mesure est justifiée par la volonté de pacifier les deux factions par un discours de victimisation générale, concernant tous les participants à la guerre, sans distinction. De toute évidence, puisqu’à distance de plus de soixante ans la société italienne vit des conflits de valeurs encore très forts, la méthode de la pacification au travers d’une victimisation collective est vouée à l’échec. Comme le magistrat Carlo Galante Garrone l’affirmait en 1947, « pour atteindre la pacification, l’application d’une justice distributive aurait été plus efficace que le pardon des indignes »139.
3. Les victimes de « catégorie C » ou les victimes du silence Les victimes civiles ont été les grandes protagonistes de la « guerre de peuple » qui a été
le second conflit mondial 140 . Toutefois, pas tous les civils out eu droit à la même reconnaissance et aux mêmes formes de réparations. Ceux qui ne rentraient pas dans les catégories des persécutés politiques ou raciaux ont eu de nombreuses difficultés à se voir attribuer un droit à réparation, subissant ainsi un deuxième traumatisme, celui du silence. Dans le cas italien, les « victimes du silence » sont les victimes civiles italiennes des massacres nazi-fascistes (a) et les citoyens et les États étrangers victimes des occupations coloniale et militaire italiennes (b).
a. Les victimes civiles italiennes des massacres nazi-fascistes
« La plupart des crimes de guerre commis en Italie est constituée par des violences abusives contre les civils italiens, effectuées par les allemands et les italiens sous le contrôle allemand »141.
Le général Richmond s’exprimait ainsi le 27 juin 1945, répondant au ministre italien Scoccimarro. Le général précisait ensuite que le jugement des criminels de guerre était de grande importance pour les autorités italiennes et que les enquêtes auraient dû être de compétence du gouvernement italien. Toutefois, le statut de pays cobelligérant de l’Italie, aux côtés des Alliés, suite à l’armistice du 8 septembre 1943, permet à la United Nations War Crimes Commission, chargée d’enquêter sur les crimes de guerre du III Reich, d’élargir sa propre compétence à l’Italie. En raison du rôle d’alliée de l’Allemagne nazie joué par l’Italie jusqu’à l’armistice, les autorités italiennes ne peuvent pas participer à l’instruction des procès. La United Nations War Crimes Commission délègue le cas italien à une sous-commission, la War Crime Commission for Italy. Cette dernière travaille avec la Commissione centrale per i crimini di guerra, instituée en Italie en 1945, exclusivement pour ce qui concerne les enquêtes. La célébration des procès demeure réservée aux cours de justice militaire anglaises. « Aucun criminel sera consigné à l’autorité judiciaire italienne »142. Cela signifie que ni les criminels de guerre fascistes, responsable des massacres des civils non seulement en Italie, mais également en Grèce, en Éthiopie, en Lybie et en Yougoslavie, ni les criminels de guerre nazis, responsables des massacres italiens, ne peuvent être jugés par les cours italiennes.
137 Cité par A. SANTOSUOSSO, F. COLAO, Politici e amnistia, Verona, Bertani ed., 1986, p. 112. 138 N° 1360, Istituzione dell’Ordine Tricolore e adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra. 139 Cité par D. R. PERETTI-GRIVA, « Il fallimento dell’epurazione », Il Ponte, 1947, p. 1081. 140 E. J. HOBSBAWM, L’Âge des extrêmes : Le court Vingtième Siècle 1914-1991, op. cit., p. 58. 141 Lettre du 27 juin 1945, cité par M. BATTINI, Peccati di memoria, Roma-Bari, Laterza, 2003, p. 58. 142 Ibidem.
19
Les cours de justice militaires anglaises installées en Italie célèbrent toutefois très peu de procès143 et la plupart des criminels nazis-fascistes reste impunie144. En effet, si en mai 1946, eu regard à la gravité et au nombre de massacres effectués par l’armée nazie, les autorités britanniques pensent d’instruire un seul et grand procès contre les « responsables allemands de la politique de représailles et de sa planification », très vite l’idée d’une « Nuremberg italienne » est écartée145. Prévaut l’option de célébrer des procès distincts. Après les procès de Nuremberg, en effet, les américains ont hâte de créer un bloc occidental anticommuniste, uni et pacifié, dont l’Allemagne de l’ouest fait partie, et préfèrent archiver rapidement les faits de sang. Les autorités italiennes, en échange de l’impunité des criminels nazis, obtiennent de ne pas donner aux cours anglaises les responsables fascistes des massacres grecs, yougoslaves et africains146. Les exigences de la reconstruction matérielle et politique de l’Europe occidentale et la logique de la nouvelle guerre froide priment ainsi sur les victimes innocentes de la violence nazi-fasciste.
Le gouvernement et la magistrature italiens adhérent complètement à la solution de l’oubli choisie par les forces anglo-américaines. Non seulement les procès aux nazis ne sont pas célébrés par les Alliés, mais en 1947 le Parquet militaire général à Rome, qui depuis août 1945 avait centralisé tout le matériel informatif sur les massacres147, choisit délibérément de cacher dans un armoire situé dans une cave du Palais de justice, avec les portes soigneusement retournées contre le mur, 2274 dossiers relatifs aux crimes de guerre allemands et des collaborateurs fascistes, commis sur le sol italien entre septembre 1943 et avril 1945. Un tiers des dossiers contenait la description des crimes à partir des enquêtes effectuées par la police italienne et par les organes de justice anglo-américaine. Un tiers contenait les procès-verbaux des interrogatoires. Dans de nombreux cas étaient indiqués les noms des responsables présumés148.
L’armoire, appelé « della vergogna » - de la honte -, ne sera découvert qu’en 1994, par hasard, lors de travaux de restructuration149. Le 7 mai 1996, le Conseil de la magistrature militaire ouvre une enquête pour établir « les dimensions, les causes et les modalités de l’occultation des dossiers dans le Tribunal suprême militaire » et pour déterminer « la responsabilité des magistrats militaires »150. L’enquête, terminée trois ans après, condamne trois procureurs généraux qui entre 1944 et 1974 ont agit dans « l’illégalité absolue », se soustrayant à l’obligation de l’action pénale pour les crimes enregistrés. Les trois procureurs en question sont toutefois décédés entre temps. Aucune action ne peut donc être exercée à leur encontre.
143 Le premier procès célébré en Italie par les tribunaux des Alliés concerne le général Eberhard von Mackensen, commandant de la XIV armée de la Wehrmacht au printemps 1944 et du général Kurt Maltzer, commandant de la zone de Rome dans la même période. Les deux sont imputés du massacre des Fosse Ardeatine, dans lequel 335 citoyens romains ont été tués pour répresaille. Ensuite, les Alliés mettent sous procès le chef commandant de la Wehrmacht en Italie, Albert Kesselring, le général des SS Simon et le général Crasemann. Idem, pp. 73-88. 144 Les peines appliquées en outre sont souvent décevantes. Kesselring, par exemple, est condamné à mort. La peine capitale est ensuite transformée en peine à perpetuité, pour enfin se réduire à cinq ans de prison. F. GIUSTOLISI, L’armadio della vergogna, Roma, Nutrimenti, 2004, p. 39. 145 M. BATTINI, Peccati di memoria, op. cit., pp. 10-11. 146 Idem, pp. 93-96; F. GIUSTOLISI, L’armadio della vergogna, op. cit., pp. 67-74. Certains ex nazis responsables des massacres des victimes civiles italiennes ont été même recrutés dans les années cinquante par les services secrets américains pour effectuer un travail d’espionnage en fonction anticommuniste en Italie. Ils ont donc bénéficié d’une impunité totale. M. FRANZINELLI, Le stragi nascoste, Milano, Mondadori, 2002, p. 205. 147 F. GIUSTOLISI, L’armadio della vergogna, op. cit., pp. 32-34. 148 M. FRANZINELLI, Le stragi nascoste, op. cit., p. 137. 149 Idem, pp. 187-188. 150 Idem, p. 189.
20
Les victimes des massacres s’organisent en 2000 dans un Comité per la verità e la giustizia sulle stragi nazifasciste – pour la vérité et la justice sur les massacres nazi-fascistes -. Sous l’incitation du comité, le 18 janvier 2001, le parlement lance sa propre enquête. La Commission de justice dans un rapport de mars 2001 fait remarquer que jusqu’en 1981 le procureur militaire général était nommé par le président du Conseil et il se trouvait au sommet de la hiérarchie de la magistrature militaire. Selon la Commission, l’inertie judiciaire concernant la poursuite des crimes nazi-fascistes ne peut s’expliquer qu’en force d’une directive politique précise. « La raison d’État », dont les racines se trouvent dans les lignes directrices de la politique internationale de l’époque, a guidé le choix des juges militaires151. En 2003, suite à des nouvelles pressions de la part des comités des victimes, est institué une autre Commission parlementaire d’enquête sur les causes de l’occultation des dossiers relatifs aux crimes nazi-fascistes152. Le rapport final de la Commission, publié le 8 février 2006, conclue qu’en l’absence d’un document capable de prouver l’ingérence politique ou des services secrets sur la magistrature militaire il est impossible d’établir officiellement une telle relation153.
Entre temps, les 2274 dossiers sont repartis entre les parquets militaires compétents selon les lieux des massacres. De 1994 à 2001 les enquêtes conduisent à des milliers de classements sans suite et à des non lieux à statuer en l’état. Après cinquante ans, les imputés et les témoins sont souvent décédés ou disparus. Seulement très peu de procès sont instruits, dont cinq aboutissent à des condamnations154.
Dans les années quatre-vingt-dix, les victimes civiles ont également agit par la voie civile directement contre la République fédérale d’Allemagne. Le 20 octobre 2008, la Cour de cassation rend une décision historique : considérant que l’Allemagne est responsable civilement, la Cour la condamne à indemniser les victimes des massacres de Civitella, Cornia et San Pancrazio 155 . L’exécution de la décision conduit à inscrire une hypothèque conservatoire sur la Villa Vigoni, un immeuble appartenant à l’État allemand et situé en Italie. L’Allemagne réagit immédiatement. Le 23 décembre 2008, la République fédérale dépose au Greffe de la Cour internationale de justice une requête introductive d’instance contre la République italienne, pour « violations d’obligations juridiques internationales » qu’aurait commises l’Italie « en ne respectant pas » dans sa pratique judiciaire « l’immunité de juridiction reconnue à l’Allemagne par le droit international »156. L’Allemagne revendique le droit à l’immunité, selon lequel aucun État, concernant ses actes souverains, ne reconnaît la juridiction d’un autre État. Les actions militaires conduites sur un territoire étranger sont, selon l’Allemagne, des actes jure imperii, et bénéficient de l’immunité157. L’Italie justifie la décision de la Cour de Cassation sur la base de deux arguments principaux. Tout d’abord, le droit international coutumier, prévoyant le droit à l’immunité, aurait évolué de telle sorte que 151 Idem, p. 195. 152 F. GIUSTOLISI, L’armadio della vergogna, op. cit., pp. 77-82. 153 Une minorité des commissaires signent en revanche un rapport qui confirme les enquêtes du Conseil de la magistrature militaire et de la Commission de justice. V. : http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/023/018bis/INTERO.pdf 154 En 1998, le capitaine SS Priebke est condamné pour le massacre des Fosse Ardeatine. En 2005, dix ex officiers et sous officiers sont condamnés à la peine de perpétuité pour le massacre de Sant’Anna di Stazzema, qui a causé la mort de 400 civils. En 2007, dix officiers sont condamnés pour le massacre de Marzabotto, qui avait fait 770 victimes. V. : F. GIUSTOLISI, L’armadio della vergogna, op. cit., pp. 243-252 et M. FRANZINELLI, Le stragi nascoste, op. cit., pp. 198-206. 155 Cour cass., I sect. pénale, arrêt n° 206. V. : http://www.corriere.it/cronache/08_ottobre_21/cassazione_stragi_germania_c8b20ca4-9f87-11dd-b0d4-00144f02aabc.shtml 156 CIJ, arrêt n° 143, Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce intervenant), 3 fév. 2012, par. 20. 157 Idem, par. 37.
21
les États ne peuvent plus, à l’heure actuelle, prétendre à l’immunité à l’égard d’actes ayant entrainé la mort, un préjudice corporel ou matériel sur le territoire de l’État du for, et ce, même si les actes en question ont été accomplis jure imperii158. Deuxièmement, l’Italie fait valoir que le refus de l’immunité est justifié en raison de la nature particulière des actes qui font l’objet de ces réclamations et compte tenu des circonstances dans lesquelles celles-ci s’inscrivent. Il s’agit en effet d’actes constituant des violations graves des principes du droit international applicables à la conduite des conflits armés, à savoir des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Les règles du droit international ainsi violées sont des règles impératives (jus cogens) qui priment sur le droit à l’immunité159. En outre, dès lors que les requérants se sont vus refuser toute autre forme de réparation, l’exercice, par les juridictions italiennes, de leur compétence est nécessaire à titre de dernier recours160.
La Cour internationale de justice refuse tous les arguments défensifs de l’Italie donnant une interprétation conservatrice et restrictive du droit international coutumier. Après avoir reconstruit la raison et la portée du principe d’immunité des États161, la Cour conclut qu’à l’état actuelle le droit international n’admet pas les exceptions soulevées par le gouvernement italien162.
Cet arrêt a été considéré comme une « occasion perdue pour orienter le droit international vers une évolution qui aurait pu donner aux droits fondamentaux des personnes et à la possibilité de les faire valoir efficacement en justice, le poids que depuis l’après guerre ils ont conquis dans d’autres domaines »163. Le juge Cançado Trindade a exprimé avec force dans son opinion dissidente à l’arrêt les limites d’une telle décision. Selon lui, les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire atteignent un degré de gravité qui exclut tout obstacle juridictionnel à la recevabilité des demandes de réparation des préjudices subis par les victimes164. Les immunités ne sont qu’une prérogative ou un privilège et elles doivent céder le pas aux « droits naturels de la personne humaine »165. Ainsi, « lorsqu’un État s’autorise d’une politique criminelle pour anéantir une partie de sa population et de celle d’autres États, il ne saurait, plus tard, s’abriter derrière les immunités souveraines, qui n’ont certainement pas été conçues à une telle fin »166. Pour le juge, l’individu apparaît comme un sujet de droit international et non simplement un « acteur ». Il est donc légitime que les individus aient accès directement à la juridiction internationale afin de faire valoir leurs droits en tant que victimes167. Toutefois, la décision de la CIJ marque un temps d’arrêt dans l’évolution du droit international humanitaire, avec des conséquences qui peuvent être dramatiques non seulement pour la réparation des préjudices de l’histoire, mais aussi pour la réparation des préjudices présents et futurs causés par les opérations militaires que de nombreux États effectuent en ce moment en dehors de leur territoire168.
b. Les victimes étrangères de l’occupation italienne Les procès à la charge des criminels de guerre de l’Axe célébrés par les Alliés entre 1945
et 1948 constituent un moment crucial de la reconstruction politique de l’Europe de l’après guerre. Les compromis opérés entre les exigences politiques et le droit international 158 Idem, par. 62-79. 159 Idem, par. 80-97. 160 Par. 98-104. 161 Par. 52-61. 162 Par. 62-106. 163 V. ZAGREBELSKY, « L’occasione perduta », La Stampa, 4 fév. 2012, p. 30. 164 Partie VII. 165 Partie VIII. 166 Partie X. 167 Partie XVIII. 168 V. ZAGREBELSKY, « L’occasione perduta », cit.
22
conduisent à l’élaboration d’une mémoire publique partielle et sélective, tout particulièrement vis-à-vis des criminels de guerre italiens. À la différence des hauts dirigeants de l’appareil administratif nazi, les chefs politiques et militaires du fascisme ne sont pas soumis à des procès internationaux, comme les gouvernements grec, yougoslave et éthiopien avaient demandé aux Nations Unis 169. Ainsi, comme les criminels de guerre de l’Axe n’ont pas tous été considérés de la même façon, les victimes, de même, ont subies des traitements différenciés. Notamment, les victimes étrangères de la violence fasciste ont été exclues de la narration historique élaborée par les vainqueurs. La politique anglo-américaine préfère éviter l’instruction de procès pouvant affaiblir les gouvernements modérés élus en Italie dans l’après guerre. Dans le nouveau climat politique de la guerre froide, le Foreign Office renvoie la question des criminels de guerre italiens jusqu’à ce que, passées sous la juridiction du gouvernement de Rome, les demandes d’extradition des criminels de guerre présumés sont évadées pour ensuite disparaître de l’agenda politique. Le mythe du « bravo italiano » - bon italien – est entretenu en Italie et à l’étranger et le soldat italien est représenté comme indiscipliné, poussé par le besoin d’évader de la réalité dure de la guerre au travers d’aventures amoureuses improbables, foncièrement généreux, passionné et profondément humain170. L’armée italienne bénéficie donc d’une absolution préventive et inconditionnée, sans qu’aucune élaboration critique soit faite des crimes commis dans les pays occupés entre 1940 et 1943.
En Grèce, la célébration manquée des procès internationaux à la charge des criminels de guerre italiens fait obstacle à la poursuite des enquêtes commencées en 1945 par le Bureau national grec pour les criminels de guerre. Le déclenchement de la guerre civile grecque entre 1946 et 1949 rend d’autant plus difficiles l’enquête gouvernementale. Enfin, l’adhésion au Pacte atlantique du nouveau régime grec en 1952 contribue à améliorer les relations diplomatiques avec l’Italie sur la question des réparations des dommages de guerre et des crimes lors de l’occupation171.
Les gouvernements italiens républicains rejettent à plusieurs reprises les demandes de l’Éthiopie et de la Libye de mettre sous procès les criminels de guerre italiens. Recourant à toute sorte d’expédient, l’Italie tente de couvrir au travers du traité de paix et de conventions ad hoc toute requête des gouvernements des ex colonies172. Des formes de réparation n’ont été accordées qu’assez récemment. En 2008, l’Italie, après de très longues négociations, a enfin restitué à l’Éthiopie et contribué à restaurer l’obélisque d’Axum, qui avait été pris par l’armée mussolinienne en 1937 pour célébrer la conquête coloniale173. En août 2008, en outre, un accord conclu entre le président du Conseil Silvio Berlusconi et Kadhafi prévoyait que l’Italie aurait versé 5 milliards de dollars à la Libye en 20 ans, afin de l’indemniser du passé colonial. En échange, Kadhafi s’engageait à donner plus de pétrole à l’Italie et à collaborer aux contrôles des côtes pour combattre l’immigration clandestine174. L’accord a été annulé suite à la chute du dictateur libyen.
Conclusion
169 E. COLLOTTI, « Sulla politica di repressione italiana nei Balcani », cit., p. 187. 170 F. FOCARDI, « La memoria della guerra e il mito del « bravo italiano », Italia contemporanea, 2001, pp. 220-221. 171 L. SANTARELLI, « La violenza taciuta », cit., pp. 277-278. 172 N. LABANCA, « Dominio e repressione », cit., p. 268. 173 http://www.esteri.it/MAE/IT/Sala_Stampa/ArchivioNotizie/Approfondimenti/2008/10/20082024_ObeliscoAxum.htm?LANG=IT 174 www.corriere.it/esteri/08_agosto_30/berlusconi_libia_gheddafi_bengasi_478ee3f4-767e-11dd-9747-00144f02aabc.shtml
23
A l’instar des autres pays, l’Italie suit la tendance consistant à attacher une importance particulière aux victimes des préjudices de l’histoire. L’exemple italien montre que si d’une part cette tendance contribue à renforcer les droits de l’homme et à favoriser leur respect, d’autre part elle a conduit à des résultats nuancés et en partie contestés.
Le cas italien dévoile tout d’abord le rôle déterminant du politique dans la définition des titulaires d’un droit à réparation. D’un côté, dans le cadre des préjudices de l’histoire, l’intervention de la politique est essentielle et souhaitable. La rigidité du droit, comme l’illustre l’arrêt du 3 février 2012 de la Cour internationale de justice, risque en effet de faire oublier que dans le cadre des préjudices historiques « souvent il y a une extrême fragilité des fondements juridiques mais une extrême légitimité morale 175 ». D’un autre côté, la déterminante politique peut conduire à délaisser certaines catégories de victimes au nom de la « Raison d’État » ou en force d’autres exigences politiques contingentes. Cela déclenche le phénomène d’une deuxième victimisation : les victimes d’un préjudice historique deviennent les victimes du silence.
La focalisation de l’attention sur les victimes est en outre ressentie par certains comme l’expression du « déclin des idéologies » et de « la montée de l’individualisme » aboutissant « à un morcellement du lien social qui se renoue autour des victimes »176. Cela implique tout d’abord le phénomène de la concurrence des victimes. La solidarité sociale serait rompue par une course exaspérée et mondialisée aux indemnisations pour les préjudices subis dans l’histoire par les différents groupes humains. Puisque le préjudice de l’histoire ne se prescrit pas, le risque est que chaque individu ou collectivité revendique une réparation, dénonçant des nouvelles injustices en cas de refus de la part des pouvoirs publics et instaurant des nouvelles hostilités entre les groupes concurrents177.
L’autre risque caché derrière l’intérêt porté aux victimes est constitué par la construction d’une mémoire publique fondée sur la souffrance de tous les citoyens, sans distinction. Le cas italien est un bon exemple. En 2011, lors de la célébration du 150e anniversaire de l’unité italienne, les discours politiques ont tourné souvent autour des victimes de l’histoire du pays. Les victimes du Risorgimento, les victimes de la deuxième guerre mondiale toutes confondues, les victimes du terrorisme, les victimes de la mafia semblent permettre la construction d’une mémoire partagée. Le pacte social italien se structurerait alors essentiellement autour de la douleur pour les tragédies qui ont traversé le pays178. Ce discours constitue une tentative de pacification lâche et inefficace. La réparation des préjudices historiques par une sorte de reconnaissance globale et indulgente de toutes les victimes de l’après guerre italien continue en effet d’effacer les responsabilités et fait obstacle à la construction d’une identité nationale fondée sur des valeurs communes. La réparation manquée pour un grand nombre de victimes, l’impunité dont les collaborateurs du régime fasciste ont bénéficié dans l’après guerre, les nombreuses mensonges au nom de la raison d’État, contribuent encore aujourd’hui à alimenter en Italie la « memoria divisa »179.
La détermination des victimes d’un préjudice de l’histoire est une opération délicate, relevant souvent plus du politique que du droit et ayant des implications cruciales pour la bonne réussite de la justice transitionnelle et pour le maintien de la cohésion au sein des sociétés contemporaines. Dans ce contexte, le droit et le politique doivent se tempérer réciproquement pour que la rigueur du premier ne se transforme pas en rigidité et pour que la souplesse du second ne débouche pas sur de l’arbitraire.
175 A. GARAPON, Peut-on réparer l’histoire ?, op. cit., p. 52. 176 J. MOULY, « Regards sur la victimisation du droit contemporain de la responsabilité civile et pénale », cit., p. 299. 177 J.-M. CHAUMONT, La concurrence des victimes, op. cit. 178 G. DE LUNA, La Repubblica del dolore, op. cit., pp. 96-97. 179 G. CONTINI, La memoria divisa, Milano, Rizzoli, 1997.