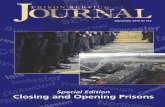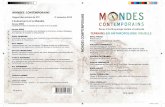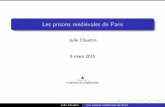Pour l'histoire du contrôle social dans les mondes coloniaux : justice, prisons, et enfermement de...
-
Upload
univ-paris1 -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Pour l'histoire du contrôle social dans les mondes coloniaux : justice, prisons, et enfermement de...
Florence BernaultPierre BoilleyIbrahima Thioub
Pour l'histoire du contrôle social dans les mondes coloniaux :justice, prisons, et enfermement de l'espaceIn: Revue française d'histoire d'outre-mer, tome 86, n°324-325, 2e semestre 1999. Pour une histoire du contrôlesocial dans les mondes coloniaux : justice, prisons, et enfermement de l'espace. pp. 7-15.
Citer ce document / Cite this document :
Bernault Florence, Boilley Pierre, Thioub Ibrahima. Pour l'histoire du contrôle social dans les mondes coloniaux : justice,prisons, et enfermement de l'espace. In: Revue française d'histoire d'outre-mer, tome 86, n°324-325, 2e semestre 1999. Pourune histoire du contrôle social dans les mondes coloniaux : justice, prisons, et enfermement de l'espace. pp. 7-15.
doi : 10.3406/outre.1999.3737
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/outre_0300-9513_1999_num_86_324_3737
une histoire du contrôle social dans les mondes
coloniaux : justice, prisons, et enfermement de
l'espace
Florence BERNAULT
Université de Madison
Pierre BOELLEY Université Paris 7 - Denis Diderot
Ibrahima THIOUB
Université de Dakar
La justice, ainsi que les appareils pénitentiaires coloniaux, sont restés les parents pauvres de l'histoire des mondes extra-européens. Ce numéro spécial voudrait montrer comment ces objets de recherche peuvent cependant apporter un éclairage essentiel sur le projet colonial, et sur certains des sites où entrèrent en contact colonisateurs et colonisés. Le droit colonial et le fonctionnement de la justice renseignent sur la nature de l'autorité établie outre-mer. La persistance de ces institutions informe ensuite sur le destin des « transferts de pouvoirs » après la charnière des années 1960. La résistance populaire, enfin, ou son indifférence, apporte de précieux éclairages sur la manière dont se déploya l'État dans les colonies et comment celui-ci s'articula ou non sur les imaginaires locaux. Ce n'est donc pas à une classique exploration institutionnelle et juridique du droit colonial que nous invitons ici, mais bien à une histoire culturelle et sociale de la justice et des prisons1.
Premier constat : née en Europe et en Amérique au XVIIIe siècle, la prison pénitentiaire (employée non comme forme de contrainte par corps, mais comme punition), s'imposa comme une réalité massive du système judiciaire colonial dès les premières années de la conquête. La justice locale étant établie sur le système de l'indigénat (colonies françaises), le remplacement autoritaire des systèmes punitifs locaux (indirect rule dans les colonies britanniques), les
1 Pour plus de détails sur cette problématique, se rapporter à Florence Bernault (dir), Enfermement, prison et châtiments en Afrique du XIXe s. à nos jours , Paris : Karthala, 1999. Ce thème de recherche a fait également l'objet des travaux du groupe de recherche sur l'enfermement réuni par le Laboratoire SEDET (Paris 7) en 1994-96.
8 Florence Bernault, Pierre Boilley, Ibrahima Thioub
saisies militaires, la plupart des postes administratifs construisirent, dès les premières années du siècle, des prisons temporaires, ou utilisèrent partie des bâtiments pour enfermer les récalcitrants. Cet effort, loin de disparaître avec la mise en place d'administrations civiles, se poursuivit très avant dans le siècle. En Afrique par exemple, les prisons des cercles d'AOF furent l'objet d'inspections officielles qui dénoncèrent leur état de surcharge chronique, tels ces locaux de Kindia (Guinée) composés de deux pièces de cinq mètres sur six où étaient détenus en décembre 1907 vingt-neuf prisonniers 2. En Haute- Volta, durant les mois d'hivernage, période des travaux agricoles, on comptait jusqu'à I 900 condamnations mensuelles à des peines disciplinaires en 1932, soit ramenée sur l'année à une population évaluée à 3,2 millions d'habitants, une condamnation pour 140 personnes3. Les chiffres les plus élevés appartiennent au Congo belge, où l'administration évaluait avant-guerre à 10% de la population masculine le nombre de détenus annuels, et à près de 7% encore en 1954, dans la province du Kivu4.
Ces enfermements, étroitement liés à l'organisation du travail forcé et, de manière générale, à l'établissement du contrôle de l'autorité coloniale sur les hommes et les territoires, ne transformèrent pas les colonies en pseudo-goulags. II s'agissait plutôt d'emprisonnements de proximité, souvent limités à quelques jours, et qui étaient le fait d'une administration pragmatique, peu nombreuse et très consciente de la fragilité de son emprise. Cependant, leur impact fut immense sur des sociétés qui ne connaissaient pas, pour la plupart, la réalité de la prison moderne. Celle-ci représentait une rupture extrême avec les pratiques locales de punition et de contrôle social, fondées essentiellement sur la réparation. Au XIXe siècle, la contrainte des corps, la restriction de la mobilité physique et sociale existaient partout mais ne prenaient pas la forme d'enfermement systématique. Elles n'étaient pas assimilables à une forme de réparation des délits, encore moins à un traitement curatif des vices. Même dans les États centralisés et militaristes, comme dans nombre de sociétés dites lignagères, la réclusion n'était qu'un moment temporaire qui soulignait la puissance de l'autorité publique. D'où les réactions des populations confrontées
2 Chérif Mamadou Dian Diallo, Histoire de la répression pénitentiaire en Guinée française (1900- 1958), thèse de l'Université de Paris 7, dactyl., 1998.
3 Laurent Fourchard, "La prison entre conservatisme et transgression : le quotidien carcéral en Haute- Volta, 1920-1960", in F. Bernault (dir), Enfertnetnent, prison..., op. cit.
4 Chiffres cités par Marie- Bénédicte Dembour, "La chicote comme symbole du colonialisme belge?", Canadian Journal of African Studies 26, 2, 1992, pp. 207-208. Voir aussi son article "La peine durant la colonisation belge", Recueils de la société Jean Bodin, LVIII, La Peine/Punishment, Bruxelles, De Boeck, 1991, pp. 67-95.
Introduction 9
à la réalité de la prison moderne, comme le montre plus loin Mamadou Chérif Diallo pour la Guinée5.
Les prisons, comme les tribunaux, furent aussi des lieux privilégiés où s'affrontèrent colonisateurs et colonisés, et des espaces où les colonisés purent dans certains cas, tirer avantage du nouveau système6. L'enracinement de ces nouvelles institutions, imposées de l'extérieur, est évident dans leur persistance actuelle, plus de trente ans après les indépendances.
Cette persistance cache cependant des traits nouveaux. En Afrique, l'utilisation des prisons au bénéfice de la répression d'État s'est considérablement renforcée. En cela, les régimes contemporains ont hérité des fonctions de la prison coloniale, lieu d'apprentissage de la soumission aux lois de la production, de la discipline sociale et de l'acceptation de l'ordre en place. La catégorie sociale la plus susceptible d'aller en prison dans l'Afrique d'aujourd'hui est celle des opposants politiques (réels ou imaginaires) aux régimes en place. Le contexte a changé par rapport à l'ère coloniale : un tel séjour est désormais moins de l'ordre de la répression pure que de la captation forcée. Maints gouvernements se servent ainsi de sentences arbitraires pour intimider les résistants, les affaiblir et les soumettre avant de les réintégrer finalement aux réseaux du pouvoir. Rares sont les cas, comme au Rwanda, où un tel système s'élargit à un enfermement de masse, à la détention de catégories politiques quasi-entières perçues comme ennemies du régime.
De nombreux régimes ont consolidé le dispositif des châtiments corporels, restés légaux dans la plupart des colonies jusqu'aux indépendances. La plupart des pays anglophones ont non seulement conservé, mais étendus à de multiples offenses mineures la peine de fouet et de bastonnade7. Les codes pénaux contemporains stipulent unanimement l'obligation du travail des détenus. Ce dernier continue de fournir un apport appréciable à la production nationale, notamment dans l'agriculture et les travaux publics. La majorité des prisons modernes n'a donc pas tenté de renouer le lien pénal entre État et société civile, mais a conforté la déviation du carcéral vers le punitif.
Tout indique, en contre-point, que les mentalités populaires continuent de s'arc-bouter sur le rejet de l'institution. La fréquence des évasions s'est multipliée. Depuis l'ère coloniale, elles appartiennent aux hauts faits de la
5 Cependant, les perceptions indigènes des prisons modernes s'appuyèrent jusqu'à un certain degré sur l'invasion plus ancienne de formes de captivité spatiale liées à la traite des esclaves, particulièrement au XIXe siècle.
6 Voir en particulier Kristin Mann et Richards Roberts (eds.), Law in Colonial Africa, Portsmouth: Heinemann, 1991. L'anthropologue Sally Falk Moore a étudié en profondeur la captation africaine de la loi coutumière dans son ouvrage Social Facts and Fabrication: Customary Law on Kilhnandjaro, 1880-1980, Cambridge : Cambridge University Vress, 1986.
7 Codes criminels contemporains du Nigeria, du Kenya (1973), de la Tanzanie et de l'Ouganda.
RFHOM t.86 (1999) n°324-325
10 Florence Bernault, Pierre Boilley, Ibrahima Thioub
protestation sociale. Un chiffrage officiel évalue les évasions dans les prisons congolaises (Congo-Kinshasa) au triple de ce qu'elles représentaient à la fin de la période coloniale. Elles affecteraient, rapportées au nombre journalier moyen des détentions, un tiers des prisonniers8. De telles proportions signalent non seulement un refus persistant des peines d'emprisonnement chez les détenus, mais le relâchement des institutions qui en ont théoriquement la charge. En effet, dans les pratiques juridiques établies, la prison fonctionne souvent comme une institution accessoire, en bordure de la routine des tribunaux. Dans beaucoup de pays, seules certaines catégories très particulières de personnes se retrouvent en prison et achèvent leur peine. Y échouent les individus déjà en partie hors du tissu social, dépourvus de protection et de liens sociaux minimum soit de par leur situation personnelle, soit à cause du délit commis (crimes de sorcellerie en particulier). A l'extérieur des murs existe une large gamme de résolution des conflits organisée par l'appareil d'État ou complètement en- dehors de lui. Le grand banditisme financier, les crimes perpétrés par des personnages haut-placés échappent entièrement à l'institution judiciaire. A l'autre extrémité, une grande partie de la petite délinquance est réglée au sein des familles, ou dans les enceintes des commissariats de quartier. Plutôt que de la déliquescence de l'État africain, ces faits attestent de la survivance des surimpositions juridiques de l'époque coloniale, au temps où la loi européenne n'atteint que la couche superficielle des délits, réglés en majorité par les tribunaux coutumiers, ou, à l'insu des colonisateurs, par les communautés locales.
Presque partout sur le continent règne un véritable abandon matériel des prisons, dont l'entretien, sinon la modernisation, est souvent relégué dans les derniers postes budgétaires nationaux. La majorité des bâtiments date de la période coloniale, la plupart ne sont plus entretenus. Les ressources financières sont inexistantes ou largement imprévisibles, ce qui conduit les directeurs à assurer la nourriture et la conservation minimum des détenus (linge, literie, infirmerie) par d'incessants appels à la charité publique et aux familles chargées d'assurer le ravitaillement quotidien des prisonniers.
A constater ces échecs apparents de la prison post-coloniale, - mais on serait plutôt tenté de parler ici de trajectoire particulière - il apparaît important de centrer l'interrogation sur une interprétation plus large de l'entreprise coloniale et post-coloniale. D'une certaine façon, le projet européen dans les colonies fit passer la souveraineté publique sur les espaces, en assujettissant les lieux et en déplaçant sur ceux-ci les rapports de pouvoir. La conquête cerne et délimite les territoires, les cartographie, construit des routes, dompte et détourne les axes économiques, fixe les habitats, attaque la mobilité des hommes. C'est ce que montre l'analyse de Marie-Albane de Suremain dans ce
Rapport de l'administration pénitientiaire, Imprimerie de Ndolo, s. d. (1990?). Archives nationales du Congo.
Introduction 1 1
numéro, et ce que nous avons voulu traduire par le terme d'enfermement au sens large. Mais on n'assiste pas là à l'émergence d'un carcéral tout-puissant, envahissant dans ses moindres replis tout le paysage spatial et culturel des colonies. La domination coloniale fut sans doute, plus que tout autre chose, une entreprise de conquête ininterrompue. Conquête : c'est-à-dire une hégémonie incomplète et aléatoire, toujours en train de s'établir au gré des initiatives des gouvernements et des colonisés, de leurs rapports de force et intérêts respectifs. C'est précisément le cheminement original, incomplet, imprévisible et complexe de ces rapports de pouvoir tels qu'on les perçoit au miroir des enfermements multiples déployés au XXe siècle, qui nous paraît former de vrais objets d'histoire, irréductibles au destin du pénitentiaire ocidental.
Dans ce champ particulier de l'histoire africaniste, les historiens sénégalais ont pris une place spécifique. Lors de sa phase nationaliste des années 1960-1970, l'historiographie sénégalaise a rédigé ses lettres de noblesse dans l'étude monographique des États précoloniaux de la Sénégambie qui se sont consolidés à la faveur de l'essor du commerce atlantique et ont eu à affronter l'intrusion coloniale du XIXe siècle. Les historiens de cette période ont répondu aux problèmes soulevés par le contexte du mouvement de libération nationaliste et d'accession à l'indépendance des États africains. La problématique des réactions dites « modernistes » des Africains au triomphe de l'ordre colonial a largement informé les études sur le syndicalisme, la lutte politique partisane, les mouvements de jeunesse, les questions religieuses, etc. A la fin des années 1970, se produit une rupture dans les objets étudiés et les questions posées. L'historiographie sénégalaise s'intéresse à de nouveaux centres d'intérêts : la ville, les terroirs périphériques par rapport au modèle économique colonial, la santé, l'évolution des systèmes politiques et administratifs.
Cette nouvelle préoccupation n'est pas étrangère à la crise de l'État postcolonial9 qui s'accompagne de difficultés éprouvées par les pouvoirs publics à exercer un contrôle efficace sur les populations des nouveaux espaces investis par les historiens. La rupture portant sur la façon de poser les questions et les objets étudiés fait écho aux pratiques et usages des citoyens de plus en plus nombreux à s'inscrire dans des logiques de déconstruction des projets définis et imposés par le pouvoir naguère prétendant à l'omnipotence. L'ouverture de la renégociation des légitimités a ouvert d'énormes possibilités de subversion rendant visible de nouveaux champs socio-politiques et économiques à explorer. Les problématiques émergeantes interrogent les trajectoires historiques des acteurs pour prendre la dimension historique de leurs logiques d'ajustement au contexte contemporain.
9 Bathily Abdoulaye, Mai 68 à Dakar ou la révolte universitaire et la démocratie, Paris, 1992, Chaka, 191 p. [Afrique contemporaine].
RFHOM t.86 (1999) n° 324-325
12 Florence Bernault, Pierre Boilley, Ibrahima Thioub
La constitution de la déviance, sous ses formes asociale, criminelle ou délinquante, en objet d'étude historique s'inscrit dans le sillage du renouvellement de la problématique des historiens au Sénégal. Ceux-ci, interpellés par l'actualité, interrogent la genèse, les ressorts, les mécanismes de fonctionnement et les espaces de la dissidence individuelle et collective dans le contexte issu de l'ordre colonial. Cette interrogation en appelle naturellement une autre sur les réponses des pouvoirs publics aux pratiques dissidentes et/ou déviantes.
Dans cette problématique, la thèse de O. Faye (1989), l'urbanisation et les processus sociaux au Sénégal : typologie descriptive et analytique des déviances à Dakar au cours de la période 1885-1940 10 constitue un travail pionnier. Par la suite des travaux de maîtrise ont été consacrés aux thèmes de la criminalité et de la délinquance dans le Sénégal colonial n. Ces travaux, principalement centrés sur l'espace urbain, ont tenté de mettre en évidence la corrélation entre les transformations introduites par l'exploitation coloniale (essor des rapports marchands avec monétarisation) et l'émergence de nouvelles déviances. Ils sont encore fortement influencés par l'historiographie nationaliste et ont tendance à hypertrophier le contenu anticolonial des pratiques déviantes. Ce contenu existe certes dans certaines trajectoires de déviants notoires, témoins de l'existence du phénomène du bandit d'honneur lors de la mise en place et du triomphe de l'ordre colonial. Les carrières de Kaan Fay et de Yaadikkoon étudiés respectivement par O. Faye12 et I. Thioub 13 sont exemplaires de l'histoire du banditisme social sous domination coloniale. Ainsi, l'échec des solutions de résistance collective a ouvert la voie à l'action
10 Faye Ousseynou, L'urbanisation et les processus sociaux au Sénégal : typologie descriptive et analytique des déviances à Dakar, d'après les sources d'archives de 1885 à 1940, UCAD, FLSH, [Thèse de 3e cycle, histoire], 1889, 648 p.
1 1 Voir par exemple : Ba Babacar, Histoire du personnel pénitentiaire colonial au Sénégal : 1863-1960, UCAD, FLSH, 1997, 49 p. [Mémoire de DEA d'histoire] Ba Babacar, L'incarcération à Dakar (1930-1960). Etudes de la population pénale et du vécu carcéral, UCAD, FLSH, [Mémoire de maîtrise d'histoire], 1997, 71 p. Bâ Chérif Daha, La criminalité à Diourbel, 1925-1960, UCAD, FLSH, [Mémoire de maîtrise d'histoire], 1994, 131 p. Diédhiou Nazaire Ch., L'évolution de la criminalité au Sénégal de 1930 aux années I960, UCAD, FLSH, [Mémoire de maîtrise d'histoire], 1991, 70 p. Kane Ngouda, L'évolution sociale de la ville de Saint-Louis à travers les archives de police, de 1900 à 1930, UCAD, FLSH, 1987, 120 p. [Mémoire de maîtrise d'histoire]. Ndiaye Bara, La justice indigène au Sénégal de 1903 à 1924, UCAD, FLSH, [Mémoire de maîtrise d'histoire], 1978-1979, 155 p.
12 Faye Ousseynou, « Mythe et histoire dans la vie de Kaan Fay du Cangin (Sénégal) », Cahiers d'Etudes africaines, 1994, 136, XXXIV : 613-637.
13 Thioub Ibrahima, « Banditisme social et ordre colonial : Yaadikkoon (1922-1984) », Annales de la FLSH, 1992,22: 161-173.
Introduction 13
individuelle d'hommes énergiques autour de qui se sont construits des légendes et mythes de victoires imaginaires contre un ordre colonial étouffant.
Kaan Fay a réussi pendant un temps relativement long à faire échec à l'articulation du pays Seerer à l'économie coloniale. Dirigeant son action contre les symboles de l'autorité coloniale et mettant en échec les solutions carcérales en s'évadant des prisons, Yaadikkoon a cristallisé les frustrations des jeunesses urbaines des années 1940-1950. Ce genre de réaction à l'ordre colonial sous la forme du banditisme d'honneur est demeuré longtemps invisible. Pour le mettre en évidence, il eût fallu tout d'abord passer au crible de la critique le discours colonial sur ces pratiques qualifiées, documentées et traitées comme des activités de délinquance ordinaire ce qui contribua efficacement à en voiler la véritable signification.
Les études consacrées à la déviance et à la dissidence, aux marges urbaines et rurales devaient conduire nécessairement à interroger les solutions mises en oeuvre par l'ordre colonial d'abord, par l'État indépendant du Sénégal ensuite, pour contenir les actions contraires aux normes qu'ils ont définies. La prison, un des outils majeurs de mise en ordre de la société introduite par le pouvoir colonial et repris à son compte par son héritier postcolonial, devient un thème central dans les études d'histoire au cours des années 1990. Elle s'est progressivement détachée des études sur la criminalité et la délinquance pour acquérir une autonomie14.
Les travaux consacrés à l'institution carcérale ont montré que dans le contexte colonial, la prison, issue du système pénal européen, acquiert de nouvelles dimensions et significations15. La prison fut un outil particulièrement disponible et présent dans tous les espaces sous le contrôle colonial. A ses origines, sa fonction centrale n'a pas été de punir les personnes auteurs d'une violation de la loi édictée par les pouvoirs publics ; elle a fonctionné comme un instrument de poursuite des guerres de conquête coloniale, visant à mettre un terme aux velléités de résistances des élites autochtones vaincues. Dans une seconde phase, avec la consolidation du régime colonial, les pouvoirs publics lui ont conféré la fonction de pourvoyeuse de main d'œuvre à bon marché. Avec l'essor de l'urbanisation et l'émergence de nouveaux citadins dont les comportements et pratiques ne sont pas toujours conformes à la norme édictée par les autorités gouvernementales et municipales, la prison entre à nouveau en jeu comme outil de contrôle des marges et de tous les acteurs considérés par le
14 La constitution en 1995 du Groupe d'étude et de Recherche sur la Marginalité et l'Exclusion au Sénégal (GERMES) qui a encadré les maîtrises soutenues sur ce thème depuis cette date, a contribué à l'autonomisation de la prison comme objet d'étude dans l'historiographie sénégalaise.
15 Thioub Ibrahima, « Sénégal : la prison à l'époque coloniale. Significations, évitements et évasions », in FI. Bernault (s.dir.), Enfermement, prisons et châtiments en Afrique du 19e s. à nos jours, Paris, Karthala, 1999, pp. 285-303.
RFHOM t.86 (1999) n°324-325
14 Florence Bernault, Pierre Boilley, Ibrahima Thioub
pouvoir colonial comme perturbateur de l'ordre établi : leaders des syndicats, des partis politiques et du mouvement associatif, dans le sillage du nationalisme.
Les études consacrées à la mise en œuvre de la politique carcérale ont en même temps interrogé les réactions africaines face à ce nouvel instrument pénal. De l'époque coloniale à nos jours, le refus de la prison reste constant dans les réactions des Africains. Ce refus s'est exprimé sous des formes variées et diverses suivant les époques et les fonctions conférées à la prison par les pouvoirs publics. Dans les débuts de la mise en place de l'institution carcérale, la privation de liberté a fréquemment provoqué le suicide des victimes. Passé ces premiers moments, les populations ont eu recours à l'évasion et aux solutions ésotériques pour échapper à l'incarcération. Pour montrer l'importance de l'institution carcérale dans l'imaginaire collectif autochtone, il est intéressant de noter le rôle qu'elle a joué dans les modifications des signifiés du champ onirique local16. Le contenu et les significations de ces réactions autochtones à l'ordre carcéral n'ont pas encore fait l'objet d'une étude systématique à l'échelle du territoire du Sénégal de l'époque coloniale à nos jours.
Les travaux sur la prison ont montré que l'espace carcéral est un des meilleurs observatoires de la mise en oeuvre de l'idéologie coloniale qui prend ici ses formes les plus extrêmes et offre en conséquence les conditions d'une meilleure visibilité. Ainsi, dans les prisons coloniales, les autochtones apparaissent comme une masse informe radicalement séparée des rares Européens maintenus dans les liens de la prévention ou condamnés. Les détenus africains et citoyens français ont du mal à faire prendre en compte leur statut — pourtant prévu par la législation coloniale — dans le traitement qui leur est infligé par l'ordre carcéral.
De même, dans la mise en œuvre de sa politique carcérale, l'ordre carcéral colonial a eu du mal à « voir » les femmes pendant longtemps incarcérées dans les mêmes établissements pénitentiaires que les hommes et parfois dans les mêmes cellules17. Si, à la fin du XIXe siècle, le pouvoir colonial a pris en compte la spécificité liée à l'incarcération des enfants en créant des écoles pénitentiaires confiées à l'Église, cette politique n'a jamais reçu les moyens de sa mise en application intégrale18. Jusqu'ici, les pouvoirs publics ont
16 Faye O., « Rêve et intrusion coloniale chez les Sereer du Bassin arachidier (Sénégal), Annales de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, N° 22, 1992. Konaté Dior, L'histoire des modes d'incarcération au Sénégal : les femmes en prison, 1925- 1995, UCAD, FLSH, 1997, 175 p. [Mémoire de maîtrise d'histoire].
18 Thioub Ibrahima, « Marginalité juvénile et enfermement à l'époque coloniale. Les premières écoles pénitentiaires du Sénégal : 1888-1927 », in FI. Bernault (s.dir.), Enfermement, prison et châtiments en Afrique du 19e s. à nos jours, Paris, Karthala, 1999, pp. 205-226.
Introduction 15
encore des difficultés à appliquer cette disposition de la loi rendant obligatoire la séparation des détenus mineurs des adultes.
Les travaux consacrés par les historiens de Dakar à la question carcérale ont donné des résultats encourageants mais le chantier reste encore largement en friche. Il importe d'ouvrir la perspective à d'autres thèmes : l'enfermement non pénal (asiles et lazarets), la typologie et la signification des peines de prisons, les instruments autochtones d'évitement de la prison, les modes de maîtrise des traumatismes carcéraux, l'architecture carcérale, le personnel de l'administration pénitentiaire, les modes d'adaptation à la vie carcérale, la prison contemporaine au Sénégal : héritages et problèmes nouveaux. Il est possible d'entreprendre de telles études. L'administration coloniale, en particulier ses dénombrements pénaux et pénitentiaires, a produit une riche documentation — archives policières, judiciaires, rapports administratifs, correspondances diverses — dont l'exploitation est à peine entamée. De même, il est temps d'entreprendre le travail de recension des témoignages des anciens détenus, des professionnels de l'administration pénitentiaire, les mythes et légendes, les savoirs autochtones sur l'institution carcérale, le discours social sur la prison.
RFHOM t.86 (1999) n° 324-325