La théorie des micro-mondes possibles
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of La théorie des micro-mondes possibles
La théorie des micro-mondes possibles
!!L’art de Vincent Broquaire est une révélation, pas au sens où l’on pourrait l’entendre dans le contexte somme toute très politique de l’art contemporain, mais au terme de la Gnose. Il met le monde en forme selon ses confidences, au repos sur plusieurs dualismes — la connaissance et l'ignorance, le bien et le mal, l'esprit et le corps, la nature et la culture, l’analogique et le numérique — eux-mêmes fondés sur l'idée que l’ordre des choses établies est dominé par des puissances insoupçonnées.
Foin de complot, l’art de Broquaire est celui d’un naïf éveillé, retiré sur le tard de sa modeste métairie pour faire péter le monde. A son recommencement n’est pas le verbe mais le point, celui du dessin de Big Bang, constellé par l’éclat d’une bombe en papier mise à feu par Candide et rallié à Pangloss. Ce même personnage, indifférencié, court dans la plupart de ses dessins. On l’y voit en général à l’œuvre d’une mécanique de sabotage optimiste, contraindre le réel à de nouveaux possibles. Le monde devient sous cet empire une ressource disponible, extensible ou compressible, souvent interchangeable : les sommets des montagnes comme ceux des gratte-ciel sont déposés par des hélicoptères, les nuages deviennent des objets de voirie et quand les arbres ne sortent pas de terre prêt à l’emploi, déjà parés de leur feuillage, on les change comme des affiches publicitaires. Le monde à portée de zapette ou clic-droit sur la poubelle, c’est aussi dans un dessin fameux la possibilité d’escamoter un lac comme une simple donnée: Supprimer ? : oui ou non ? La nature passe avec lui d’une existentiabilité à l’existentialisme. Elle n’est rien d’autre sinon ce que l’homme la désire.
On aura tout loisir de faire sur l’œuvre de Vincent Broquaire les pires projections. On peut souscrire aussi à son entière poésie, son Parti pris des choses, non écrit mais tracé. Si comme l’estime Jean-Louis Déotte « ce sont les appareils qui essentiellement génèrent la poéticité d’une époque » , celle 1
de Vincent Broquaire est une anthologie où vivent en harmonie l’invention de la roue, la machine à vapeur, le soleil, les oiseaux et la mer, Google et les plateformes pétrolières. Rien n’est trop beau pour son Candide, un activiste du relativisme, alter-ego feignant mais béat du terroriste Unabomber. Quand Théodore Kaczynski, mathématicien de génie, entre en campagne radicale pour l’effondrement imminent de la société industrielle et technologique, le dessin de Broquaire atteste une métaphysique du progrès leibnizien : il n’y
� Jean-Louis DÉOTTE, « Flusser : L’appareil et L’œuvre d’art » in L’époque des Appareils, 1
Paris, Éditions Lignes & Manifestes, 2004, p.109.
« aucune façon imaginable de créer le monde, qui soient si chaotique qu’elles ne reposent sur un certain ordre propre, fixe et déterminé, et des lois de progression ». 2
Ces lois, Vincent Broquaire les dicte dans ses dessins comme des protocoles ou des deus ex machina. La simplicité de son trait, mise au service de combines aussi complexes que loufoques, va dans le sens d’une réflexion du philosophe Mario Costa selon laquelle « dans le sublime technologique a lieu un affaiblissement de la forme. » Pour y parer, l’artiste fait muter ses 3
supports. Ainsi ses micro-mondes viennent se coller à notre banalité comme des vies compossibles, univers optionnels et parallèles au nôtre, complexifié par l’usage d’un écran. C’est dans cette position, et en elle seule, que réside la spécificité du sens de son oeuvre. La nature de l’écran comme lieu d’inscription est vraiment décisive. On s’y penche comme sur un microscope ou des lunettes astronomiques pour découvrir un monde plus vaste qu’il n’y paraissait. A l’instar des appareils qui servent à augmenter la puissance de la vue, les œuvres de Vincent Broquaire portent la nôtre « beaucoup plus loin que n’avait coutume d’aller l’imagination de nos pères » 4
!Alexis Jakubowicz
!!
� Gottfried Wilhelm LEIBNIZ, « Echantillon de découvertes sur les secrets admirables de la 2
nature » (1688) in Leibniz, Discours de métaphysique et autres textes, présentation et notes de Christiane Frémont, GF Flammarion, 2001, p. 293.
� Mario COSTA, Internet et globalisation esthétique. L’avenir de l’art et de la philosophie à 3
l’époque des réseaux. Trad. Giordana Di Nicola, Paris, L’Harmattan, « Ouverture philosophique », 2003.
� René DESCARTES, La Dioptrique, « De la Lumière », Discours premier, (1637), Gallimard, 4
« Folio Essais », 1991, p.81.
strabic.fr Vincent Broquaire : les paysages manigancés
Vincent Broquaire, Entrée en dialogue, 2012.
L’image pittoresque d’un lac dans un paysage de montagnes. « Supprimer ? : oui, non ». Mais peut-on vraiment supprimer aussi simplement un paysage entier comme on supprime une image jpeg de son ordinateur ?
Ce dessin ingénu, comme tous ceux de Vincent Broquaire, cache un questionnement plus sérieux : celui du statut « naturel » du paysage dans notre environnement contemporain.
Vincent Broquaire, Island, 2013.
Dans le monde dessiné de Vincent Broquaire, le paysage est dépeint comme une ressource disponible, malléable et interchangeable. Sa primauté naturelle n’existe plus. Il est le produit de machinations humaines ou la conséquence de manœuvres loufoques. Les sommets des montagnes sont maintenus par un hélicoptère. Les nuages sont entretenus par un service de la ville qui remplace ceux qui en ont besoin. Les arbres se changent comme des affiches publicitaires, quand ils ne sont pas extraits de terre – déjà poussés avec tronc, feuilles et racines. Le soleil et les cascades sont des machineries géantes nécessitant une flopée d’humains et d’ingénieurs pour les faire fonctionner.
Vincent Broquaire, Passage, 2011.
Revenons au lac de montagnes que l’on nous propose de supprimer. Ce dessin s’intitule Entrée en dialogue. Sans présumer des intentions de l’auteur, le dessin confronte deux extrêmes. À la définition classique du paysage comme « vue d’un décor naturel, ou peinture évoquant une telle scène » 1 (le dessin du lac et des montagnes) vient se surimposer le contrôle
informatique d’une nature gérée à distance et de manière impersonnelle par ordinateur (l’écran de commande).
Les technologies digitales ont complètement pénétré la manière dont nous percevons notre environnement, et la manière dont nous agissons au sein de celui-ci. Le wifi, la réalité augmentée ou les puces RFID font désormais partie d’un paysage naturel « augmenté ». Nous évoluons avec des appareils connectés qui nous aident à voir, enregistrer, sélectionner, partager ou supprimer une partie du monde qui nous entoure. À l’image du dessin Capture où le personnage prenant en photo un arbre l’aspire. Littéralement prisonnier à l’intérieur du téléphone, l’arbre n’est plus qu’une image disponible dans une base photos personnelles.
Vincent Broquaire, Capture, 2012.
Dans Truck, un camion décoré d’un panorama paysager de collines et de sapins offre en trompe l’œil l’image du paysage qu’il semble justement cacher. Au fil des kilomètres, ce paysage unique se déplace avec le camion, indifférent aux environnements naturels que la route traverse.
Vincent Broquaire, Truck, 2012.
Au-delà de la simple perception, c’est la « nature » même des paysages que les technologies de l’information et de la communication sont en train de bouleverser. John Brinckerhoff Jackson évoque l’aspect des champs agricoles du grand Ouest américain. Ces cercles verts et parfaits au milieu du désert sont le résultat d’un système d’irrigation hautement sophistiqué. Un ordinateur contrôle indépendamment l’irrigation dispensée à chacun des champs.
“Ces ordinateurs sont reliés à des scanners à infrarouges aériens mesurant en permanence la température et le taux d’évapotranspiration des champs pour ajuster en temps réel la pluie artificielle nécessaire aux cultures.
”Le dessin Plants renverse ce phénomène par l’absurde. Les images numériques ont bien remplacé les plantes d’appartement, mais il faut toujours les arroser avec de la vraie eau…
Vincent Broquaire, Plants, 2012.
La nature est une donnée qu’il s’agit de gérer et d’entretenir. Dans Billboard, le paysage rentre dans la même logique que l’urbain en devenant une image que l’on change sur un panneau publicitaire 4 par 3. On remplace un arbre sans feuille par un arbre bien fourni pour agrémenter le paysage urbain et l’adapter aux saisons.
Vincent Broquaire, Billboard, 2013.
Cette logistique de la nature est devenue un service spécifique. Comme il existe un service de gestion et d’entretien des espaces verts dans toutes les villes, il existera peut-être dans un futur proche, une unité de Cloud Maintenance intervenant pour remplacer un nuage mal formé par un autre afin d’assurer la qualité de l’air des habitants.
Vincent Broquaire, Cloud Maintenance, 2012.
John Brinckerhoff Jackson explique que le paysage est le lieu où les hommes peuvent enfin accélérer ou ralentir les processus naturels. Croissance, maturité ou déclin ne sont plus calqués sur le rythme de la nature mais sur celui de l’homme. Alors, plutôt que de devoir attendre des années que l’arbre atteigne sa taille adulte, les manutentionnaires de Growing font pousser les arbres en tirant dessus avec un camion-grue. Cette opération paraît aussi simple que de sortir un kleenex de sa boite ! Entre poésie de l’absurde et scénario d’anticipation, les dessins de Vincent Broquaire questionnent notre soif de contrôler la nature, dans un monde qui se technologise à toute allure. (Comment ne pas voir dans Growing une allusion aux manipulations génétiques faites sur les végétaux permettant à telle fleur de ne pas faner ou à tel arbre, peut-être un jour, de sortir de terre avec déjà sa taille adulte ?)
Vincent Broquaire, Growing, 2013.
Vincent Broquaire, In The Wood, 2012.
Ces scènes « paysagères » sont toujours le fruit d’un bricolage humain. Les paysages que nous voyons possèdent tous une part cachée. À mi-chemin entre machinerie et mascarade, la montagne de Elevation n’est haute que parce qu’un hélicoptère en soulève le sommet. Ce paysage de belle montagne n’est qu’une grande illusion. Les formes naturelles sont désormais soutenues entièrement par l’ingénierie humaine, et celle-ci déploie des moyens hollywoodiens pour continuer à entretenir le leurre.
Vincent Broquaire, Elevation, 2012.
Nous qui voulions « jouir » du paysage et du « spectacle de la nature », nous nous trouvons confrontés avec un paysage mis à nu, comme invités de force dans ses coulisses. Ce n’est pas par hasard que dans Sun le dispositif qui soutient le soleil au-dessus des gens heureux de bronzer ressemble à s’y méprendre à des cintres de théâtre, cet espace au-dessus de la scène où l’on manœuvre verticalement des éléments de décor ou d’éclairage…
Vincent Broquaire, Sun, 2012.
Pour Anne Cauquelin, le paysage est un « tissu de certitudes, à la fois fragile et résistant ». Il est une pure construction culturelle et esthétique 2 : nous ne le voyons qu’au travers de notre arsenal culturel qui comprend la perspective, l’histoire de l’art, les souvenirs personnels, etc… Les dessins de Vincent Broquaire semblent nous dire, eux, que le paysage est désormais une pure construction technique : un artefact, généré et entretenu par l’homme. Dans les deux cas, le paysage « naturel » est toujours le produit d’un artifice laborieux destiné à satisfaire notre « désir » de paysage. Alors pourquoi cacher ce processus de fabrication plus longtemps ?
- Écrit par Olympe Rabaté, en partenariat avec CRAP.
Toutes les images : courtesy Xpo Gallery, 2013-





















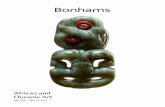









![(deprecated) [2015] Théorie de Richard VIALLE - Annexes de Philippe Albert](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633c361d967c8a4ebd0558c7/deprecated-2015-theorie-de-richard-vialle-annexes-de-philippe-albert.jpg)



