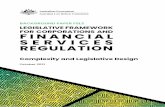SOCIALISATION, REGULATION et CONTRÔLE SOCIAL
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of SOCIALISATION, REGULATION et CONTRÔLE SOCIAL
SOCIALISATION, REGULATION et CONTRÔLE SOCIAL
Objectifs :
Tout d’abord, ce chapitre cherche à montrer que la socialisation, phénomène essentiel à la construction de l’identité sociale de l’individu, est un processus complexe qui n’est pas seulement un mécanisme de reproduction sociale. Il peut être également un mécanisme interactif qui, de fait, produit du changement social.
Ensuite, on montrera que toute société dispose d’un ensemble de normes qui s’appuient sur des sanctions formelles et informelles, positives et négatives. On insistera sur le lien entre ces normes et le système de valeurs qui permet de comprendre que les normes sont culturelles et non universelles et qu’elles évoluent dans le temps. Si les normes ont un caractère contraignant, cela n’empêche pas les individus et les groupes sociaux de les interpréter, ce qui contribue à les faire évoluer. En même temps, cela signifie que la conformité aux normes à laquelle pousse le contrôle social n’est jamais totale. Différentes formes de déviance existent. Les déviants sont tous sanctionnés et stigmatisés, certains sont marginalisés voire exclus ; quant aux délinquants, ils sont réprimés.
Plan :
Introduction : L’apprentissage de la vie en société.
I. Les fondements du lien social.
A. Le processus de socialisation.B. Les agents et les milieux de socialisation.C. La socialisation : mécanisme de reproduction sociale ou mécanisme interactif.D. La régulation et le contrôle social.
II. La fragilisation du lien social.
A. L’affaiblissement du lien social.B. La rupture du lien social.
Conclusion.
Vocabulaire :
1
Normes ; reproduction sociale ; interaction sociale ; rôles ; statuts ; valeurs.Contraintes ; production de normes ; règles ; sanctions.Déviance ; délinquance ; étiquetage ; marginalité ; stigmatisation.
SOCIALISATION, REGULATION et CONTRÔLE SOCIAL
La vie en société nécessite la maîtrise du langage et de certains codes sociaux, de systèmes conventionnels de règles, de lois. Mais cette maîtrise n’est pas innée et c’est lors du processus de socialisation, processus d’intériorisation par chacun de la culture* de son groupe et de la société dont il est membre, que l’homme va de devenir un être social. Ce processus permet ainsi l’adaptation et l’intégration des individus à leur milieu social.
De manière souvent inconsciente, l’environnement social influence fortement nos pratiques, y compris les actes les plus banals de la vie quotidienne qui nous paraissent « naturels ». Ainsi, la satisfaction des besoins d’ordre physiologique peut être effectuée de façons très différentes. Les manières de manger varient dans le temps, dans l’espace, dans les milieux sociaux… Les pratiques sociales peuvent donc combiner une exigence naturelle et une exigence sociale. L’homme est donc à la fois un être biologique pour ce qui relève de l’inné (par exemple, la différence homme – femme) et un être social pour ce qui est transmis par l’environnement social.
*Culture : au sens anthropologique, « Culture ou civilisation, pris dans son sens ethnologique le plus étendu, est ce tout complexe qui comprend la connaissance, les croyances, l’art, la morale, les lois, les coutumes et les autres capacités ou habitudes acquises par l’homme en tantque membre de la société ». Edward Burnett Tylor (1832 – 1917)
Au sens sociologique, « ensemble des représentations, des valeurs et des normes qui orientent les actions des individus. Une représentation est une construction mentale (croyance, idée…) élaborée par une collectivité humaine. Ces représentations prennent la forme de systèmes religieux, de mythes ou de théories portant sur la place de l’homme dans le monde et sur l’organisation de la société. Elles permettent aux hommes de justifier les inégalités spécifiques à chaque société. » (Dictionnaire de sciences économiques et sociales, éditions Bréal)
2
I. Les fondements du lien social.
L’existence de la société suppose et permet une certaine cohésion qui repose sur des lienssociaux
(liens familiaux, amicaux, civiques, politiques…). L’explication de l’origine de ces liens est différente selon les auteurs, tant en sociologie qu’en science politique ou en philosophie. On peut présenter brièvement quelques analyses :
- Des analyses reposant sur le contrat. Ici, on fait apparaître un lien civique entre les individus. Ce
lien résulterait d’un choix volontaire entre les individus : chaque individu limite partiellement sa liberté au profit de la collectivité à laquelle il appartient. (cf. John Locke, Jean-Jacques Rousseau…)
- Des analyses fondées sur l’utilité. On peut souligner l’approche utilitariste d’Adam Smith qui pos-
tule que l’homme est libre, a des droits naturels et cherche à satisfaire ses intérêts. Ainsi, son explication du lien social donne une supériorité à l’économique, plutôt qu’au politique. C’est la recherche des intérêts égoïstes qui pousserait les hommes à diviser le travail et à échanger.
- Des analyses privilégiant la proximité culturelle et le lien communautaire. Ferdinand Tönnies
donne une explication sociologique du lien social. Dans la communauté, une conscience collective forte guide les comportements des individus qui sont pris dans des réseaux de relations communes et proches : vie, travail, croyances, coutumes… Dans la société, l’individualisme domine et c’est l’intérêt qui est source de liens.
- Marx et Engels ont une autre conception du lien social. Le lien social ne relève pas d’un contrat
mais plutôt d’un rapport de forces. (cf. les classes sociales)- E. Durkheim(1858 – 1917) étudie le lien social comme sociologue en même temps qu’il
cherche à mettre au point une morale sociale correspondant aux valeurs républicaines, laïques et positivistes auxquelles il croit. Dans son analyse, il privilégie l’intégration c'est-à-dire l’état d’un système social dont les parties sont fortement reliées entre elles et montre que la division du travail génère du lien social et de l’intégration. Il opposera la solidarité mécanique caractéristique des sociétés traditionnelles à la solidarité organique propre aux sociétés modernes.
Quel que soit l’origine du lien social, sa création repose sur différents mécanismes.
A. Le processus de socialisation.
Tout d’abord, il n’est pas aussi simple de définir la socialisation dans la mesure où, sur un plan
théorique, les auteurs en ont une approche différente. Ainsi, certains la définissent comme intériorisation normative et culturelle : c’est le cas d’Emile Durkheim qui définit la socialisation comme l’éducation méthodique de la jeune génération, en vue de perpétuer et de renforcer
3
l’homogénéité de la société. Il s’agit de l’apprentissage d’un ensemble de règles et de normes. D’autres privilégie le thème de la distanciation, de l’activité des individus, de l’écart entre l’acteur et le système : on peut retenir la définition de François Dubet et Danilo Martuccelli qui considèrent la socialisation comme « le double mouvement par lequel une société se dote d’acteurs capables d’assurer son intégration, et d’individus, de sujets, susceptibles de produire une action autonome ».
Toutefois, on pourra retenir la définition donnée en introduction ou celle, dans le sens le plus gé-
néral, de Guy Rocher : « Le processus par lequel la personne humaine apprend et intériorise tout au cours de sa vie les éléments socioculturels de son milieu, les intègrent à la structure de sa personnalité sous l’influence d’expériences et d’agents sociaux significatifs et par là s’adapte à l’environnement social où elle doit vivre ».
Normes et valeurs :
La socialisation consiste en l’intériorisation – intégration des normes et des valeurs à sa person-
nalité – des normes – principes ou modèles de conduite propres à un groupe social ou à une société – et des valeurs – idéaux collectifs d’une société, représentant ce qui de l’ordre du désirable et qui influencent les actions des individus – en vigueur dans une société donnée. En d’autres termes, l’individu finit par faire siennes les normes et valeurs au départ imposées par l’extérieur ; ainsi, il oublie la dimension contraignante qui le pousse à les respecter.
Les mécanismes de la socialisation :
L’apprentissage de ces valeurs et de ces normes s’opère par le biais de deux mécanismes :
l’inculcation et l’imprégnation.- L’inculcation est la transmission volontaire et méthodique de valeurs et de normes par
des institu-tions. Les agents de socialisation interviennent donc de manière délibérée et systématique. Ce mécanisme suppose la mise en œuvre de sanctions – négatives : punitions ou positives : récompenses – envers ceux qui respectent ou transgressent les règles. Au cours de ces dernièresannées, ce mécanisme a vu son importance se réduire au profit du mécanisme de l’imprégnation.
- L’imprégnation est l’intériorisation de la culture d’un groupe par un individu qui adopte le mode
de vie de ce groupe. C’est le sociologue américain, George Herbert Mead, qui, dans les années 1930, a montré
comment les enfants se socialisaient en reproduisant au cours de leurs jeux les comportements des différents membres de la famille. En se mettant à la place de l’un des parents, l’enfant s’approprie un rôle social et donc des normes et des valeurs. Les apprentissages vont donc s’effectuer selon une forme plus diffuse et non intentionnelle, se réalisant par imitation et interaction.
4
Statuts et rôles :
La socialisation amène ainsi les individus à construire des statuts et des rôles sociaux quivont permettre d’établir le lien entre comportements individuels et conduites collectives.
Le statut est l’ensemble des positions qu’un individu occupe dans les différents domaines de la vie sociale (famille, entreprise, association…). Selon les lieux et les moments, chaque individu exerce différentes fonctions (époux, père, comptable, automobiliste, électeur, client d’une banque…) mais, à un moment donné, il n’occupe qu’un statut. On peut aussi définir le statut comme l’ensemble des comportements d’autrui auquel un individu peut s’attendre. Par exemple, le statut de professeur donne droit à un traitement, à des garanties statutaires en matière de carrière, à un comportement déférent de la part des élèves… L’appartenance à différents groupes contribue à caractériser le statut social des individus et leur place dans la société.
Remarque : Henri Mendras propose d’écrire status pour souligner la signification sociale du terme et le distinguer du concept juridique de statut.
Au statut qu’occupe chaque individu sont associés différents rôles avec leurs références et leurs normes. Le rôle social se définit comme un comportement normalisé que l’on doit adopter pour respecter le statut, donc la position que l’on détient. Les rôles sont en partie prescrits, c'est-à-dire imposés, dans le jeu social. Ils situent chacun à ses yeux et à ceux des autres par diverses apparences comme la tenue vestimentaire ou le langage employé. Exemple : le rôle du vêtement.
Mais, en même temps, les individus interprètent leurs rôles. Ils s’éloignent parfois des normes, ce qui peut conduire à de la réprobation, mais contribue à faire évoluer le jeu social.
Exemple : les mouvements féministes.Néanmoins, les individus sont catégorisés à partir de leur appartenance à des groupes,
de leur statut et de rôles sociaux dans un cadre social qui est ainsi structuré et hiérarchisé.(cf. lastructure sociale)
L’étude de la socialisation permet donc de comprendre les mécanismes de transmission de la culture, la manière dont les individus reçoivent cette transmission et intériorisent les valeurs, les normes, les statuts et les rôles sociaux. Ces mécanismes sont directement liés avec la manière dont les individus construisent leur identité, construisent leur rapport avec la société, les sentiments d’appartenance à des groupes. Par ailleurs, le concept de socialisation cherche à rendre compte de la manière dont les individus sont intégrés dans leur société et la meilleure connaissance de ces mécanismes possède plusieurs intérêts :
- Mieux maîtriser les motivations de l’action humaine.- Montrer que la société est composée de groupes sociaux qui ont des intérêts différents,
que cer-tains groupes ont intérêt à maintenir l’ordre social alors que d’autres ont intérêt à le transformer. Ainsi, les sociétés évoluent entre la continuité et le changement.
5
B. Les agents et les milieux de socialisation.
Le processus de socialisation se déroule tout au long de la vie d’un individu et différentes ins
tances de socialisation – structure particulière dans laquelle s’exerce une pratique spécifique – vont contribuer, dès le plus jeune âge, à le socialiser. Certains auteurs distinguent la socialisation primaire qui renvoie à l’enfance de la socialisation secondaire renvoyant à l’âge adulte. En fait, l’idée de la socialisation primaire s’inspire de la théorie des groupes primaires développée par le sociologue américain Charles H Cooley. Ces groupes reposent sur le lien de type communautaire construit sur l’affectif, l’émotionnel. Ce sont les groupes à partir desquels les individus s’insèrent dans leur monde social. Les individus y intériorisent les codes, le langage, les dispositions qui leur permettent de se repérer dans le monde social. Cette premièresocialisation met en place les structures mentales qui font de l’individu un être apte à s’intégrer dans sa société. La famille, les groupes de pairs ou encore tiennent une place importante dans la socialisation primaire. Les résultats de la socialisation dépendront donc des rapports qu’entretiennent la famille, l’école… avec le jeune individu. La socialisation secondaire se poursuit après l’enfance et certaines étapes de la vie seront à l’origine de ruptures (mariage, naissance d’un enfant, entrée sur le marché du travail, adhésion à une association, deuil, départ en retraite…). La socialisation secondaire est donc le processus qui permet aux individus de s’intégrer à des milieux sociaux particuliers et représente une étape supplémentaire dans la construction des identités qui nécessite l’apprentissage de nouveaux rôles.
Cette distinction entre socialisation primaire et socialisation secondaire permet surtout de souli-
gner que la socialisation ne s’arrête pas à l’enfance, c’est un processus jamais achevé qui se poursuit tout au long de la vie des individus. L’identité des individus n’est pas figée à la sortie de l’enfance ; elle se construit tout au long de la vie.
L’intégration de l’individu dans la société s’effectue dans des milieux de socialisation et au contact de différents agents de socialisation. On peut les distinguer de la manière suivante :
- Les agents explicitement socialisateurs.- Les agents implicitement socialisateurs.- Les milieux de socialisation.
1. Les agents explicitement socialisateurs.
a) La famille :
La famille est une instance essentielle de la socialisation primaire. En effet, le premier lien qui lie
6
l’enfant à autrui est un lien affectif et il se noue le plus souvent avec sa mère. C’est donc l’émotion qui est la première ressource permettant de structurer l’enfant dans son rapport aux autres. La pensée émotionnelle structure la faculté de juger et contribue à la conscience de soi et des autres. L’enfant va donc apprendre à inhiber certaines émotions et à en extérioriser d’autres. L’enfant a d’autant plus de chances de développer des compétences sociales étendues (sociabilité) qu’il sera éduqué dans un milieu social accordant à l’enfant de l’attention et de l’amour. L’enfant apprendra qu’il existe des limites. Les études ont montré que les enfants qui adoptent des comportements violents sont très souvent des enfants dont les parents n’exercent pas un contrôle social sur eux. L’absence de contrôle social des parents est donc un des facteursde la délinquance. Toutefois, pour être efficace, le contrôle social des parents doit être d’une part, consistante c'est-à-dire continue et régulière, et d’autre part, cohérente et non en décalageavec les comportements adoptés par les parents. Ainsi, une éducation autoritaire, recourant à des châtiments sévères, ne suffit pas à prévenir les conduites délinquantes.
Les transformations socioéconomiques de la société ont aussi affecté la famille. Ainsi, la société a évolué sous la pression croissante de la démocratisation et l’individualisation et a contribué à changer la forme du lien familial. L’individualisation transforme le concept de cellule de base de la société : c’est l’individu qui devient la cellule de base de la société et non plus la famille. Cela se traduit par l’individualisme – autonomie de l’individu – l’égotisme – sentiment exagéré de sa personnalité, de sa valeur – et le désir à court terme. La famille est moins centré sur la lignée et la filiation. L’individu n’est plus un maillon d’une chaîne de générations. La famille repose davantage sur le couple qui fonctionne sur le couple qui fonctionne sur l’échange d’estime réciproque. Chacun se voit reconnaître son autonomie. Ainsi, les enfants peuvent disposer de leur équipement personnel, leur permettant d’écouter leur musique, de regarder leur programme… Par ailleurs, les rythmes de vie parfois différents des membres de la famille ont imposé des repas plus fragmentés. L’engagement dans le collectif familial se fait dans des moments choisis (repas, fêtes, sorties, pratiques communes…).
Par ailleurs, une enquête publiée en 2002 conclut à l’effacement d’une éducation autoritaire. Les personnes interrogées reconnaissent la nécessité d’inculquer des contraintes et des valeurs morales mais elles admettent que l’éducation doit viser à l’épanouissement de l’individu, au développement de son imagination, de sa créativité, la responsabilité ; en un mot, à construire l’autonomie des jeunes. Le style d’éducation souple gagne du terrain de générationen génération et le rôle de parent n’est plus associé à l’exercice de l’autorité.
Toutefois, toutes les familles ne socialisent pas de la même manière leurs enfants. On observe une socialisation différentielle selon le milieu social. Les parents influencent fortement leurs enfants à travers leur CSP, leur statut, leur niveau d’études, leur patrimoine et leur mode de vie. On peut se référer à la notion d’habitus développée par Pierre Bourdieu. Ainsi, les parents de milieu ouvrier seraient plus autoritaires et exerceraient un contrôle direct des faits etgestes assorti de sanctions physiques. En revanche, les parents des catégories supérieures accepteraient de négocier leurs décisions. L’éducation fait appel à des motivations psychologiques et à certaines formes de chantage affectif. L’intérêt des jeunes pour la politique,la religion, la formation et l’expression de leurs choix s’expliquent en grande partie par l’héritage familial. Dans les catégories supérieures, on met l’accent sur l’intériorisation des normes et la maîtrise de soi ; on insiste sur la capacité d’élaborer des projets à long terme en adaptant les moyens aux objectifs. En revanche, dans le milieu ouvrier, l’avenir serait par la recherche de satisfaction immédiate.
7
Le développement du travail des femmes a également contribué à faire évoluer la socialisation par la famille. Ainsi, les rôles masculins et féminins évoluent peu à peu. Pendant longtemps, la socialisation différentielle entre les filles et les garçons était fortement marqué parce que les fonctions assumées par les hommes et les femmes dans la société différaient. Aujourd’hui, les femmes accèdent peu à peu aux fonctions de décision et les filles sont plus nombreuses à poursuivre leurs études que les garçons. Ces transformations engendrent la tendance au rapprochement des rôles de la fille et du garçon. Il faut néanmoins souligner que, si elle évolue, la répartition des tâches domestiques connaît encore une grande différenciation selon le sexe. De même, Marie Duru-Bellat, sociologue de l’éducation, qu’il existe encore des pratiques différenciées. Les interactions mère / bébé sont différentes selon qu’il s’agit d’une ou d’un garçon. Il semble que l’on stimule davantage le « comportement social » des filles. En revanche, les garçons sont plus stimulés sur le plan moteur : on les manipule avec plus de vigueur, on les aide davantage à s’asseoir, à marcher, que lorsqu’il s’agit d’une fille. Les filles sont ainsi invitées à une douce passivité et à une certaine dépendance vis-à-vis des adultes, tandis que les garçons sont poussés à l’autonomie, à l’activité et à l’indépendance. Pour les enfants plus âgées, lorsqu’on observe les pratiques éducatives au quotidien, on constate que l’esprit de « sérieux » dirige l’éducation des filles, qui sont considérées très tôt comme des adultes en miniature auxquels il est important de faire acquérir les exigences de leur rôle social.Elle montre aussi que les parents n’ont pas les mêmes ambitions scolaires pour les garçons et pour les filles.
Par ailleurs, il faut souligner le développement des familles monoparentales, résultant notamment de l’augmentation des divorces, prive de nombreux enfants de la présence permanente de leurs parents, leur père le plus souvent. Or l’absence du père peut déstabiliser un garçon adolescent manquant d’un modèle masculin d’identification et d’une figure d’autorité, mais la fonction socialisatrice du père peut éventuellement être assurée par un autrepersonne (beau-père, grand-père,…)
Enfin, il faut souligner que la socialisation est un processus qui se poursuit à l’âge adulte,y compris dans la famille. Ainsi, dans les familles immigrées, ce sont les enfants scolarisés qui peuvent socialiser leurs parents à la culture du pays d’accueil.
Cependant, la socialisation familiale est fragilisée par l’existence d’autres instances qui entrent en concurrence avec la famille : les groupes de pairs, les médias…
b) L’école :
Depuis quelque temps, l’école est remise en cause et certains s’interrogent sur sa capacité à jouer
un rôle dans la lutte contre l’échec scolaire, à assurer l’égalité des chances et à combattre les violences scolaires et les incivilités.
Il faut rappeler que le rôle de l’école a profondément évolué depuis le XIXème siècle.C’est Emile Durkheim (1858 – 1917) qui a théorisé le rôle de l’école dans la socialisation
des jeunes. L’école républicaine doit construire une société nouvelle en rejetant les institutions, les valeurs de la société de l’Ancien Régime. Pour lui, l’école a une importance primordiale dans la formation morale du pays. Seule l’école est capable d’offrir un lieu de socialisation commun àtous les petits français et d’éduquer les futurs citoyens en transmettant des valeurs communes. Il s’agit donc d’unifier la société autour de valeurs générales comme le respect de la patrie, de
8
la raison et de la discipline. Ce rôle est d’autant plus important que, selon lui, les individus sont asociaux et que des principes forts doivent atténuer l’individualisme. L’école doit préparer les individus aux différents emplois.
De la révolution à Jules Ferry va donc se mettre en place l’institution scolaire moderne. Les lois républicaines de Jules Ferry de 1880 et 1881 vont mettre en place l’école gratuite et cellede 1882, l’école laïque et obligatoire. Cette école de la IIIème république est tournée vers l’idée d’instituer la Nation en socialisant les jeunes générations et en les préparant à devenir de futurscitoyens. Il s’agit d’unifier la nation en éradiquant le patois et en transmettant une même éducation à tous les petits français. L’école n’a pas pour tâche de promouvoir l’égalité des chances. Seule l’école primaire est obligatoire. La conception de l’école reste élitiste et n’a pas pour tâche de former des actifs.
Au début du XXIème siècle, la situation est tout à fait différente :- Les transformations de la société ont modifié la demande sociale vis à vis de l’école.- On ne demande plus simplement à l’école de fabriquer un citoyen.- L’école est soumise à une demande de formation de la part des parents et des élèves.- On lui demande de transmettre des connaissances et des compétences qui rendent les
jeunes em-ployables. L’école est donc un moyen d’accéder au marché du travail.
Un diplôme élévé, signe d’une socialisation réussie, apparaît comme le plus sûr moyen deprotec-
tion contre le chômage et un passeport pour accéder à un poste élevé et bien rémunéré. L’accèsau savoir devient un facteur essentiel d’intégration. On peut ici rappeler que le parcours scolaire des enfants diffère selon l’origine sociale de la famille, que les enfants des catégories sociales favorisées réussissent mieux scolairement dans la mesure où l’école renforce la culture familiale.
Aujourd’hui, l’école se voit donc assigner des objectifs multiples :- Assurer une éducation citoyenne en prévenant les incivilités et les comportements
violents ; offrir une culture commune permettant d’intégrer les individus.
- Jouer un rôle de plus en plus actif dans l’insertion des individus dans la division sociale ettech-
nique du travail.
Par ailleurs, il faut souligner que l’école reste un facteur de développement social tant dans les
pays développés que dans les pays en développement. En effet, dans les PVD, l’école peut permettre de prendre du recul vis-à-vis des traditions et doit montrer aux individus qu’ils peuvent jouer sur leur avenir et ainsi combattre le fatalisme. Dans les pays développés, l’école est un facteur d’intégration et de développement. Aujourd’hui, l’économie demande un niveau de qualification toujours plus élevé et la lutte contre l’illettrisme est un moyen de faire reculer l’exclusion. L’école est donc aussi un instrument de mobilité sociale.
Enfin, on peut également préciser que l’école peut être un instrument d’endoctrinement dans les
régimes dictatoriaux ou les régimes totalitaires.
9
c) Les groupes de pairs :
La construction de l’identité qui caractérise l’adolescent l’amène à rechercher voire à accumuler
les appartenances à des groupes de pairs, c'est-à-dire de personnes ayant le même statut social que lui. Une enquête de L’INSEE a montré que la majorité des individus qui parlent avec un adolescent sont de même sexe et de même âge que lui. L’identité des jeunes se forge donc engrande partie dans l’interaction avec d’autres jeunes. Ainsi, certains auteurs ont montré que le jugement des pairs a souvent plus d’importance que celui des parents dans la tendance des jeunes à adopter ou à persévérer dans un comportement incivil ou délinquant. Par ailleurs, ces groupes adoptent souvent des valeurs et des normes innovantes par rapport à celles en vigueurdans la société et contribuent ainsi à son évolution.
2. Les agents implicitement socialisateurs.
a) L’entreprise :
Dans notre société, l’entreprise constitue non seulement un lieu de travail mais aussi un facteur
d’identité professionnelle et d’appartenance sociale. Travailler, c’est s’inscrire dans la norme de la société dans la mesure où le travail reste une valeur centrale. Pour être « normal », un individu doit être actif. Ainsi, il est utile à la société – il contribue à l’enrichissement de la société – et à lui-même – il se procure honnêtement un revenu - . Par le travail, on peut, d’une part, se reconnaître des semblables qui partagent notre profession ou notre situation économique et sociale, et d’autre part, se distinguer d’autres personnes qui exercent un métier différent, et donc d’autres valeurs, d’autres références, avec qui on peut même être en conflit. C’est donc un double mouvement de différenciation et d’assimilation qui permet à l’individu de s’intégrer dansla société.
Le travail est donc intégrateur du fait qu’il permet une reconnaissance sociale mais aussi parce
que le revenu perçu donne à l’individu la possibilité de consommer les biens valorisés par la société, et donc de s’y faire reconnaître : la consommation procure un certain statut social. Enfin, il faut aussi préciser que le travail assure des droits sociaux c'est-à-dire permet de bénéficier de prestations sociales ; par exemple, l’individu perdant son emploi percevra des indemnités.
b) Les médias :
Les médias ont souvent été considérés comme un facteur perturbateur dans le processus de socia-
lisation, assuré par la famille et l’école. L’utilisation excessive des médias a souvent été dénoncée pour trois raisons principales :
- elle affaiblirait la morale, diminuerait le temps passé au travail ou à des occupations plus impor-
10
tantes, et détruirait la vie familiale et sociale.- Elle pourrait conduire à une saturation qui détournerait les individus de leurs obligations
ci-toyennes, lors des campagnes électorales notamment (nombreux débats politiques). Une des conséquences en serait la non-participation à l’élection et serait donc contraire aux objectifs mêmes d’intégration à la vie sociale de la socialisation.
- Enfin, elle serait responsable de l’augmentation de la violence.Cependant, aucune étude sociologique ne vient étayer ces affirmations. Par ailleurs, les médias
n’agissent pas indépendamment des autres agents sociaux, la famille et l’école notamment. Pour Judith Lazar, sociologue, « si l’environnement de l’individu est relativement pauvre, s’il ne fournit pas de ressources de socialisation faibles et variées, la personne se tourne naturellement vers les médias, qui deviennent ainsi sa source principale de socialisation. Alors que pour les personnes vivant dans un milieu riche de sources socialisantes, la dépendance à l’égard des médias ne se produit pas ». Les médias n’agissent jamais seuls, mais dans un contexte historique, social, culturel, économique et c’est en fonction de ces conditions de réception que leur message agira.
Par ailleurs, Judith Lazar affirme que la télévision est le média principal et préféré des enfants,
quels que soient les pays. Ils consomment beaucoup de messages publicitaires et, même s’ils nesont pas directement destinés aux enfants, ces derniers remplissent une fonction de socialisation dans la mesure où ils permettent une familiarisation de l’enfant aux objets et aux comportements du monde adulte.
Toutefois, les enfants ne subissent pas passivement les modèles de consommation proposés par la
publicité car l’enfant reçoit l’image publicitaire dans un contexte social où ses parents, sa famille et d’autres agents de socialisation participent à la formation de sa personnalité, de ses concepts et des ses modèles
3. Les milieux de socialisation.
On peut effectuer une distinction entre les milieux auxquels appartiennent les agents de socialisa-
tion :- Le milieu géographique : des différences dans le processus et le résultat de la
socialisation peu-vent apparaître entre la ville et la campagne. Certains psychologues ont pu constater un développement culturel plus précoce en milieu urbain, mais plus stable en milieu rural.
- Le milieu ethnique : la socialisation ne s’effectue pas de la même manière dans les différents mi-
lieux ethniques.- Le milieu social : Pour un individu, son habitus trouve son origine autant dans sa famille
que dans le milieu social dont il fait partie.
11
- Par ailleurs, il faut souligner que Robert King Merton, sociologue, se demande pourquoi certains
individus, dans certaines situations, se définissent, se réfèrent à un groupe social qui n’est pas leur groupe d’appartenance – groupe auquel l’individu appartient en fonction de ses statuts – mais à un groupe auquel ils désirent appartenir, le groupe de référence. Merton développe le concept de socialisation anticipatrice c'est-à-dire le processus par lequel un individu apprend et intériorise les valeurs d’un groupe auquel il désire appartenir. Cette socialisation l’aide à se « hisser dans ce groupe » et devrait faciliter son adaptation au sein du groupe. Il faut remarquer que cette notion de socialisation est appliquée par Merton à des adultes et non à des enfants. Il s’agit d’apprendre, par avance, les normes, les valeurs et les modèles d’un groupe auquel on n’appartient pas. Cette notion est également reliée à celles de « groupe de référence » et de « frustration relative » : c’est parce qu’il se compare aux membres d’un groupe que l’individu se sent frustré par rapport à eux et qu’il se met à vouloir leur ressembler, pour parvenir à se faire reconnaître comme « membre ».
C. La socialisation : mécanisme de reproduction sociale ou mécanisme interactif.
La reproduction sociale est le mécanisme qui conduit une société à maintenir ses caractéristiques
essentielles de génération en génération. Le processus de socialisation assure la permanence etla cohésion de l’ordre social. Plusieurs exemples permettent d’illustrer cette dimension de la socialisation :
- La transmission des parents aux enfants des préférences idéologiques. Si les opinions des parents
ne conditionnent pas à 100% celles de leurs enfants, elles les influencent indéniablement.- La permanence des hiérarchies. Pierre Bourdieu montre comment, au sein de la famille,
sont transmis les capitaux – capital économique, capital culturel, capital social et capital symbolique– d’une génération à l’autre. La détention de ces capitaux est étroitement liée aux milieux sociaux et ils contribuent à la reproduction des hiérarchies sociales. L’école favorise cette reproduction.
- Le maintien d’une répartition sexuée inégalitaire des rôles sociaux. Même s’il existe une égalité
des droits politiques, économiques et sociaux, on constate que les pratiques ont évolué plus lentement que les mentalités. Ce paradoxe ne peut être expliqué que par le processus de socialisation. La répartition des tâches domestiques au sein du couple doit être mise en relationavec l’éducation différentielle reçue par les garçons et les filles.
Depuis les années 1970, les théories portant sur la socialisation relèvent davantage de l’individualisme méthodologique que du holisme méthodologique. Ces théories prennent mieux en compte le rôle du socialisé qui est désormais présenté comme un acteur de sa propre socialisation. Alors que le holisme renvoie au conditionnement, l’individualisme
12
méthodologique renvoie à l’interaction – action réciproque, voulue ou non, entre acteurs impliqués dans une situation – .
Cette interaction se manifeste de différentes façons. Ainsi, le jeune enfant fait ses premiers ap-
prentissages à travers avec ses parents puis avec d’autres individus. L’enfant ne subit donc pas la socialisation. C’est ce qui a été montré par de nombreux psychologues et on peut citer notamment George Herbert Mead (1863 – 1931). Il met en évidence dans « L’esprit, le soi, la société » l’importance de l’apprentissage des rôles sociaux dans la formation de la personnalité de l’enfant. La formation de soi de chaque individu s’explique par l’échange avec le groupe. C’est pourquoi l’interaction est considérée comme le mécanisme principal de la socialisation, car c’est d’abord par la relation que l’individu se perçoit et se conçoit.
La formation de la personnalité de l’enfant se réalise dans le cadre de jeux, ce que G. H. Mead
appelle la « prise de rôle ». Dans la prime enfance, la socialisation se traduit par des séquences d’apprentissage qui dévelop-
pent l’observation d’autrui. L’enfant joue librement avec lui-même en s’inventant un personnage imaginaire – son double – qui lui permet de jouer le rôle de ses proches (mère, père,…) ou de héros de bandes dessinées, de films…
Plus tard dans l’enfance, la socialisation se poursuit en rendant l’enfant capable de s’intégrer à
un jeu encadré par des règles extérieures (football…). L’enfant devient conscient que chaque situation se caractérise par des conduites appropriées, de la nécessité d’adopter une conduite « appropriée » à la situation pour s’intégrer à un groupe. Le processus de socialisation conduit à une abstraction de plus en plus grande du rapport à la règle. Alors qu’au départ, l’interaction se construisait sur des bases interpersonnelles, désormais les conduites s’orientent en fonction des attentes des autres.
Enfin, l’individu devient un être social. L’individu acquiert la reconnaissance du groupe comme
membre à part entière et s’identifie à des rôles en apprenant à les jouer de manière personnelle.
D. La régulation sociale et le contrôle social.
L’affaiblissement des règles sociales peut mettre en péril la cohésion et l’équilibre de la société.
Cela justifie la nécessité de maintenir le lien social, notamment à travers la régulation sociale.
La régulation sociale est l’ensemble des moyens dont dispose une société pour sauvegarder la co
hésion sociale et assurer un nombre suffisant d’interactions entre les individus.Les règles qui organisent la vie collective sont généralement classées en fonction de leur degré de
13
formalisation (Le Droit est plus formalisé que les usages) et du degré de prévisibilité de la sanction en cas de transgression. De façon codifié, les lois précisent ce qui est interdit (fumer dans un lieu public) et énoncent des obligations (présenter ses papiers à un policier) ; elles indiquent formellement les sanctions encourues en cas de non-respect. Les usages sont moins formalisés ; ainsi, aucun texte n’oblige à dire bonjour quand on entre dans un lieu, ni n’indique s’il faut serrer la main, embrasser, hocher la tête… Nulle sanction formelle n’est prévue, mais celui qui ne dit jamais bonjour ou ne le fait pas correctement risque d’être ignoré, voire mis à l’écart.
Le contrôle social est l’ensemble des pressions, implicites ou explicites, qu’exerce la société pour
amener les individus à se conformer aux normes.Aucun mécanisme spontané ne règle totalement les comportements sociaux. Pour éviter le dé-
sordre et la guerre permanente « de tous contre tous » (cf. Thomas Hobbes), les hommes ont confié un rôle de contrôle de la vie sociale à différentes structures. C’est une des fonctions traditionnelles de la famille. L’Eglise a longtemps joué ce rôle. La police, la justice le font dans toutes les sociétés.
Le contrôle social est donc lié à la question du maintien de l’ordre social stricto sensu et se limite à réprimer la déviance et à maintenir les règles en l’état. La régulation sociale désigne, en revanche, le processus de production des règles dont les termes ne sont pas fixés pour toutes. L’exercice du contrôle social entraîne une activité de régulation et de transformation de ces règles.
1. La conduite des individus.
a. La contrainte permet la conformité sociale.
- La notion de conformité :
Le conformiste est celui qui respecte les objectifs de la société et utilise les moyens usuels pour at-
teindre ces objectifs. Le conformisme permet le respect des attentes lors d’une communication, d’un échange.
Par exemple, si je demande mon chemin à un passant, j’attends du passant qu’il me réponde, qu’il
le fasse avec un minimum de politesse et le passant attend de moi, politesse et honnêteté. Les deux passants « se conforment » donc à l’idée qu’ils se font des attentes de la personne avec laquelle ils communiquent.
- La contrainte externe est source de conformité :
Les actions individuelles s’inscrivent dans un ensemble de règles, implicites ou explicites, qui
14
orientent la conduite à tenir. Les individus suivent ces prescriptions car ne pas respecter la norme entraîne, en théorie, la sanction.
L’efficacité des règles provient de la contrainte externe (« peur du gendarme »).Les sanctions ont donc une fonction dissuasive. Elles sont diverses et graduées, négatives (désap-
probation, condamnation) ou positives (encouragements, récompenses). Parmi celles qui sont négatives, les plus sévères correspondent à des normes juridiques et sont prononcées par des institutions spécialisées (justice, police, église (excommunication)). Cependant, la plupart des sanctions sont sans conséquence et se déroulent quotidiennement (coup de klaxon d’un automobiliste)
- La contrainte interne est source de conformité :
Beaucoup de nos comportements sont conformes aux normes sans avoir été objectivement con-
traints par une force extérieure. Il existe une contrainte interne qui provient d’abord de la socialisation.Emile Durkheim (1858-1917) avait souligné l’importance de l’intériorisation de la contrainte :
« Si, avec le temps, cette contrainte cesse d’être sentie, c’est qu’elle donne peu à peu naissance à
des habitudes, mais qui ne la remplacent que parce qu’elles en découlent » (Les règles de la méthode sociologique 1895).
La contrainte interne relève également de l’autocontrôle c'est-à-dire une forme morale decette
contrainte qui résulte de la compréhension par l’individu de l’avantage qu’il a de respecter les normes. Les travaux de Jean Piaget sur le jugement moral montrent que l’enfant dès l’âge de 7 ans a acquis un sens très clair des règles et la capacité de s’y soumettre, indépendamment de toute contrainte (cf. la capacité à inventer de nouvelles règles).
b. Les autres facteurs de conformité :
D’autres facteurs entrent en jeu dans la construction sociale de la conformité.
- La conformité au groupe :
Au sein d’un groupe, la plupart des individus perdent une partie de leur autonomie de décision et
de perception. Ainsi, par exemple, des gens pacifiques pris dans une manifestation se mettent àadopter un comportement agressif. Le groupe peut produire du consensus – les membre du groupe ajustent leur point de vue et parviennent à une norme que l’on peut qualifier de médiane – mais aussi être à l’origine du conformisme – l’individu s’aligne à tout prix sur les comportements et les opinions du plus grand nombre au risque même d’être en désaccord aveclui-même – .
15
Cf. expérience menée par Salomon Ash (polycopié)
- L’autorité :
La conformité de nombre de nos actes découle de l’autorité que nous reconnaissons à certaines
personnes.Cf. La soumission à l’autorité : L’expérience de Stanley Milgram et celle menée par Herbert Kellman (polycopié).Kellman a mené une réflexion sur les mécanismes inhérents au changement d’opinion. Il effectue
une distinction fondamentale entre processus d’influence :- La soumission (1).- L’identification (2).- L’intériorisation (3).
(1) La soumission implique une sorte de calcul utilitaire. Nous obéissons aux ordres d’autrui
parce qu’il contrôle les moyens et nous tient sous sa surveillance, c'est-à-dire qu’il peut user à notre égard de sanctions négatives.
(2) L’identification est l’association symbolique d’un comportement àautrui fortement valorisé
(individu ou groupe) qui nous pousse à l’adopter.(3) L’intériorisation est la conformité de tel ou tel mode de conduite
à notre système de valeurs qui nous incite à le faire nôtre.
Seuls (2) et (3) relèvent de l’influence au sens strict.
2. Les rapports entre normes juridiques et normes sociales.
Le social influence et fait évoluer le juridique. Pour que la norme légale soit considérée comme légitime, il faut qu’elle corresponde aux normes sociales. L’évolution des mœurs rend nécessaire l’évolution du droit. Par exemple, la loi Veil de 1975 autorisant l’IVG a fourni un cadre légal à une pratique qui existait déjà.
Cependant, le Droit est aussi producteur d’effets sociaux. Les relations entre normes juridiques et normes sociales sont donc à double sens.
Ainsi, l’un des arguments qui fut évoqués par les adversaires du PACS est que la reconnaissance des liens du couple hors mariage contribue à aggraver la crise du mariage et, àterme, celle de l’institution familiale. De même, les opposants à la dépénalisation des drogues dites douces affirment que cette dépénalisation risque de faire augmenter la consommation globale.
Par ailleurs, le Droit ne produit pas immédiatement tous ses effets. Pendant une période plus ou moins longue, normes légales nouvelles et normes sociales traditionnelles peuvent se trouver en concurrence. Cette situation s’explique par les phénomènes de reproduction sociale liés à la socialisation expliquant le poids des normes traditionnels.
16
Par exemple, dans la société française, si tous les hommes et les femmes disposent en théorie une égalité de droits, il subsiste encore des stéréotypes de sexe et expliquent les inégalités constatées dans la pratique.
Enfin, on peut préciser que Droit n’a pas prétention à régir l’ensemble des comportements sociaux ; cependant, depuis quelques années, on constate une progression de la prise en considération du juridique.
Dans les rapports normes juridiques – normes sociales, on peut donc distinguer deux approches dans la production des normes :
- Pour les juristes, le Droit est fondé sur une conception de l’homme et de la société qui commande
les principes fondamentaux. Les lois précèdent la transformation des normes et doivent servir à faire entrer dans les mœurs communes des progrès sociaux ou, à l’inverse, réprimer certains comportements. Par exemple, la législation du travail conçue par les dirigeants syndicaux et politiques a besoin de beaucoup de temps et de nombreuses décisions judiciaires pour entrer dans la pratique quotidienne des entreprises.
- Pour de nombreux sociologues, ce sont les pratiques sociales qui, en se transformant, entraînent
avec elles l’évolution du cadre législatif. (cf. loi sur l’avortement)
II. La fragilisation du lien social.
C’est au cours du processus de socialisation que sont transmises les normes et les valeurs. Ces dernières forment des ensembles culturels. La socialisation garantit donc une certaine conformité mais elle n’est jamais totale et n’est en rien automatique. En effet, la socialisation ne conduit pas à des individus strictement conditionnés ; ceux-ci disposant d’une relative liberté de choix face aux éléments culturels qui leur sont transmis.
Cette autonomie des individus se manifeste dans nos sociétés où peuvent coexister des systèmes de normes et de valeurs très différents voire opposés. Ainsi, certains actes qui paraissent normaux dans certains milieux sociaux sont déviants dans d’autres ; par exemple, l’union libre.
A. L’affaiblissement du lien social.
1. L’analyse durkheimienne : le normal et le pathologique :
Emile Durkheim a tenté de présenter une analyse scientifique du rapport du normal au pathologique par le biais de l’étude du crime. Pour lui, un fait social est normal sitôt qu’on l’observe dans la plupart des sociétés, ce qui est le cas du crime. Il existe une prédisposition de
17
toute société à fournir un certain nombre de criminels ; à ce titre, le crime est le produit de déterminismes sociaux découlant logiquement du fonctionnement de la société.
Le crime a donc pour fonction de réaffirmer la présence de la conscience collective puisqu’il permet la manifestation de la contrainte sociale et la consolidation de la légitimité des normes et des valeurs. Durkheim écrit : « Classer le crime parmi les phénomènes de sociologie normale, ce n’est pas seulement dire qu’il est un phénomène inévitable quoi que regrettable, (…) c’est affirmer qu’il est un facteur de la santé publique, une partie intégrante de toute société saine ».
Le crime devient pathologique dès lors qu’il subit une augmentation « trop forte » c'est-à-dire un certain seuil de « normalité » entraînant avec lui un risque d’anomie. L’anomie est un dérèglement social, une carence ou une perte de légitimité des règles et des lois ; c’est donc une conséquence de l’affaiblissement du lien social. Une société anomique est une société caractérisée par un affaiblissement du système normatif. Les individus agissent en privilégiant des buts individualisés puisque leurs désirs ne sont plus encadrés par des règles sociales. La conscience collective – l’ensemble des croyances et des sentiments communs à la moyenne des membres d’une même société – n’est donc pas suffisamment présente dans l’esprit des individus. Il en résulte des conduites déviantes. Le critère de normalité est alors défini par la régularité statistique.
2. L’émergence d’un nouveau lien social.
a. Les instances d’intégration traditionnelle se transforment :
Contrairement à ce que soutenait Durkheim à la fin du 19ème siècle, la solidarité mécanique* ne
disparaît pas mais de nouvelles de cette solidarité se maintiennent :- Des résistances nationalistes, ethniques et intégristes (en Europe de l’Est, en Afrique, en
Amé-rique latine…) continuent à manifester une volonté de maintenir leur intégrité et leur appartenance communautaire.
- L’émergence de mouvements sociaux « postmodernes » comme les mouvements féministes, écolo-
gistes, homosexuels, témoigne d’un engagement communautaire fort.- L’apparition de nouvelles communautés de croyants qualifiées de sectes (scientologie…)
et le succès de religion comme le bouddhisme sont la preuve que la religion, sous d’autres formes qu’auparavant, parvient toujours à rassembler des individus autour de valeurs communes.
Tous ces phénomènes montrent que de nouvelles modalités d’intégration (localités, régions,
groupes ethniques, mouvements sociaux…) sont aujourd’hui à l’œuvre.
b. De nouvelles relations sociales apparaissent :
Les nouvelles formes de solidarité entraîne une nouvelle forme d’organisation sociale :
18
l’organisation sociale en réseaux ; « Le renforcement de l’individualisme suppose le renforcement des liens sociaux de toutes sortes et la multiplication des réseaux sociaux » (HenriMendras) cf. polycopié sur les classes sociales.
Par ailleurs, il semble que les individus aient envie de s’engager aujourd’hui dans des activités où
ils peuvent exprimer leur citoyenneté ; par exemple, on peut souligner le dynamisme des mouvements associatifs.
*Solidarité mécanique : expression utilisée par Durkheim et qui correspond à une solidarité par similitude, caractéristique des sociétés traditionnelles. Dans ces sociétés, la division du travail est faible et les individus se différencient peu les uns des autres et adhèrent àdes valeurs et des croyances communes.
B. La rupture du lien social : la déviance et l’exclusion.
1. la déviance :
a. Normes et déviance :
Pour qu’un acte ou un comportement puisse être qualifié de déviant, il doit exister au préalable un ensemble de normes. Ce n’est que par comparaison entre les faits et les règles en vigueur que l’on peut parler de déviance. La déviance peut être considérée comme un revers de la socialisation.
La déviance correspond à tout comportement ou opinion pouvant s’écarter des normes sociales et pouvant susciter une certaine réprobation. Les comportements concernés sont donc très divers : crimes et délits, suicide, toxicomanie, alcoolisme, handicap, mouvances musicales, transgressions sexuelles, sorcellerie…
La délinquance est un aspect de la déviance. Ce sont tous les comportements sanctionnés par la loi c'est-à-dire tous les comportements correspondant à une transgression des normes juridiques.
Exemples de comportements déviants mais non délinquants :- Transgression des règles morales (rentrer ivre, mentir sur son âge, délaisser ses parents
malades…)- Transgression des règles de politesse (manger salement au restaurant, ne pas s’excuser
à telle occasion…)- Transgression des coutumes régissant le mode de vie (manière de s’habiller…)
La transgression d’une norme juridique fera l’objet d’une sanction explicite alors que le non respect d’une norme sociale entraînera une sanction implicite. Une sanction est explicite dès lors qu’il y a formalisation de la règle et codification de la sanction.
La déviance peut avoir plusieurs significations :
19
- Une menace de l’ordre social. On transgresse les normes sans chercher à les changer. Onpeut
aussi évoquer la déviance rebelle qui remet en cause les normes sociales mais aussi l’autorité, lepouvoir qui les met en œuvre.
- Une contribution au changement social. On transgresse les normes dans le but de les changer
(déviance non conformiste).
La sociologie de la déviance est appréhendée de différentes manières selon les auteurs etil existe donc différents courants.
b. Les différentes approches de la déviance.
Les approches fonctionnalistes de la déviance : l’analyse de Robert King Merton (1910 - ).
Selon Merton, le développement de la délinquance s’explique par l’accroissement des situations anomiques. Il distingue pour cela deux éléments constitutifs de ce qu’il appelle la structure sociale permettant de déterminer les comportements conformistes ou déviants :
- Un ensemble de valeurs valorisé par chaque membre du groupe social (objectifs culturelsou buts).
- Un ensemble de procédés acceptables pour atteindre ces objectifs (moyens).
Dans cette optique, la déviance correspond à une non concordance entre les buts culturellement valorisés par la société et les possibilités d’accès aux moyens légitimes pour les atteindre. Ainsi, par exemple, la société américaine valorise l’enrichissement et la réussite individuelle (but valorisé), le moyen légitime d’y accéder est le travail (logique méritocratique). Les individus qui ne détiennent pas les moyens légitimes pour atteindre ce but ont deux moyens : renoncer à atteindre le but ou utiliser des moyens illégitimes pour y parvenir.
Merton distingue 5 types de comportements individuels :
- Le conformisme s’applique aux comportements non déviants.- L’innovation correspond à un comportement pour lequel l’individu adhère aux valeurs
mais ne détient pas les moyens légitimes d’y accéder. Il utilise alors des moyens illégitimes (mafia, corruption, crime…)
- Le ritualisme correspond à une situation où l’individu applique aveuglément les règles prescrites
par la société sans se soucier de leur adaptation aux buts poursuivis. Le degré d’intériorisation des règles est tel qu’il supplante leur finalité (rigidité du bureaucrate, obéissance aveugle du militaire…).
- L’évasion fait référence aux individus qui se retirent de la société et qui en rejettent les valeurs ne
20
pouvant atteindre les objectifs ni par les moyens légitimes, ni par les moyens illégitimes. (vagabonds, clochards…)
- La rébellion est une forme de réaction qui cherche à imposer un nouvel ordre social en rejetant
les valeurs en vigueur que ce soit par des moyens légitimes (association politique démocratique) ou illégitimes (groupe révolutionnaire armé, terrorisme).
Cette approche de la déviance fait l’objet de trois critiques :
- C’est une approche individuelle. Le phénomène de déviance n’est pas abordé comme uneinteraction sociale.
- Les différents types de réaction du contrôle social vis-à-vis de la déviance ne sont pas prisen compte.
- La relation entre la déviance et la constitution de l’identité sociale n’est pas étudiée.
La déviance comme le produit d’une interaction sociale : la théorie de l’étiquetage et la stigmatisation.
Les sociologues de « l’interactionnisme symbolique » s’attachent à montrer que « la déviance n’est pas une qualité de l’acte commis par une personne, mais plutôt une conséquencede l’application par les autres, de normes et de sanctions à un « transgresseur » » (Howard Becker Outsiders).
Ces sociologues ne cherchent pas à répondre à la question : Pourquoi certains individus commentent-ils des actes déviants et pas d’autres ? Mais à celle-ci : Comment les groupes sociaux, par leurs jeux d’interaction, construisent le phénomène de déviance ?
De manière générale, les interactionnistes pensent donc qu’il faut distinguer la transgression de la règle perçue par la société de celle qui reste secrète. Ainsi, de nombreuses transgressions des règles sociales ne sont pas repérées par la société et ne peuvent donc pas être comptabilisées parmi les actes déviants
- Howard Becker (1928 - ) : La théorie de l’étiquetage :
Selon Becker, un comportement social déviant n’est pas étiqueté comme déviant à partir d’un jugement universel mais dans le cadre d’une interaction sociale située et datée. Il définit la déviance comme un écart – identifié comme tel et donc sanctionné – par rapport à une norme : « Le déviant est celui auquel cette étiquette a été appliquée avec succès, le comportement déviant est celui auquel la collectivité attache cette étiquette ».
Un individu a d’autant plus de chances d’être étiqueté comme déviant qu’il appartient à un groupe dont la sous-culture s’oppose à la culture globale. Par exemple, les musiciens de jazzfumeurs de marijuana étudiés par Becker dans les années 1950 étaient considérés comme déviants.
21
La déviance résulte de la succession d’un certain nombre d’étapes :- La première consiste en la transgression, intentionnelle ou non intentionnelle, d’une
norme mais celle-ci ne suffit pas à qualifier l’acte de déviant. Par exemple, Becker montre qu’en ce qui concerne les fumeurs de marijuana, l’étiquetage ne s’applique pas au fumeur occasionnel. L’entrée dans la déviance suppose l’adoption d’une conduite de vie particulière ;
- La deuxième étape correspond à la désignation publique des déviants entraînant l’acquisition
d’un nouveau statut social. Cet étiquetage est d’abord le fait de la famille et des groupes de pairs ; puis il est repris par les instances institutionnalisées du contrôle social. Dans le cas des transgressions non intentionnelles, la déviance prendra fin dès lors que l’acte aura été étiqueté. Dans celui des transgressions intentionnelles, la désignation publique entraîne deux conséquences :
1) Elle amène l’individu à intérioriser une image de soi qualifiée de déviante qui lui est renvoyée par
la société, il se définit ainsi lui-même comme déviant.2) Elle limite ses possibilités de retour à un comportement conforme aux normes. Par
exemple, les difficultés de réinsertion des anciens détenus.
- Enfin, l’étiquetage fait entrer l’individu dans un processus de déviance « secondaire » qui se tra-
duit par l’adhésion à un groupe déviant, organisé, régi par des règles spécifiques. Le déviant entre alors dans une spirale dans laquelle chaque acte appelle une nouvelle réaction sociale. Ceprocessus amplificateur entraîne l’individu dans une « carrière déviante ».
- L’approche d’Erving Goffman (1922 – 1982 : la stigmatisation.
Selon Goffman, c’est aussi dans l’interaction sociale que s’opère la catégorisation de la déviance mais à la différence de Becker, il montre que chaque individu évalue les actes d’autrui en les considérant comme une infraction à ses propres normes identitaires. Le stigmate se définit ainsi par la possession d’un attribut (couleur de peau, maladie, homosexualité…) susceptible de jeter le discrédit sur celui qui le porte. Pourtant, selon lui, c’est moins l’attribut lui-même qui est cause de stigmatisation qu’une certaine relation entre ce que la société attend de l’individu et de son attribut (identité sociale virtuelle) et ce que celui-ci estime être en réalité (identité sociale réelle). Tout individu est ainsi doté d’une identité sociale possédant ces deux dimensions.
C’est la discordance entre ces deux types d’identités qui enclenche un processus de stigmatisation. Par exemple, les malades du SIDA ou les séropositifs sont moins stigmatisés à cause de leur maladie que pour un « mode de vie coupable » lié à la toxicomanie ou à l’homosexualité : tant que la société perçoit un comportement en accord avec ce qu’elle attend d’eux (identité virtuelle), l’état de normalité perdure (la maladie est de plus en plus reconnue) ; si elle estime en revanche que les malades « usent de faux semblants » et cachent certains éléments de leur identité (identité réelle : mode de vie « coupable » lié à l’homosexualité par exemple), la stigmatisation s’effectue.
22
En d’autres termes, la stigmatisation est l’attribution à un individu ou un groupe d’une identité sociale dévalorisante en raison d’une caractéristique physique ou sociale jugée négativement par la majorité de la société.
L’intérêt de cette approche est de ne pas s’en tenir à une analyse de la « déviance classique » (délinquance…) mais également de la prendre en compte comme un phénomène omniprésent et permanent de la vie sociale dans lequel tout individu cherche à se dissimuler vis-à-vis d’autrui afin d’éviter la stigmatisation et « exerce ainsi un contrôle stratégique sur les images de lui-même que les autres glanent alentour ». Goffman récuse donc la conception « carriériste » de la déviance de Becker.
2. L’exclusion :
Comme le montre l’analyse de Merton, certaines formes de déviance peuvent déboucher sur des situations de rupture totale de lien social (évasion, retrait). A coté de celles-ci, des individus vivent également en exclusion sans pour autant être considérés comme des déviants. Pour caractériser toutes ces personnes en situation de rupture, le concept d’exclusion sociale estapparu dans les années 1990.
L’exclusion sociale, par opposition à l’intégration sociale, est à la fois une situation et un processus d’interaction selon lequel un individu éprouve des difficultés à établir des liens avec lasociété dans laquelle il est censé s’intégrer. Elle témoigne de la dualité de notre société avec d’un coté les « insiders » et de l’autre les « outsiders ».
Certains facteurs contribuent à l’exclusion sociale notamment le chômage de longue durée, la condamnation judiciaire et la pauvreté. La pauvreté qui doit être comprise comme un phénomène multidimensionnel (revenus faibles, confort du logement très limité, faible insertionculturelle, précarité du travail, peu de relations extrafamiliales, faible suivi de la santé…) montre bien que bien souvent les handicaps se cumulent et se renforcent mutuellement pour déboucher sur un processus de disqualification sociale.
Robert Castel analyse l’exclusion en privilégiant le travail. Le parcours des exclus consiste à traverser plusieurs « zones » dans lesquelles la cohésion sociale est d’intensité variable. Ainsi, la première zone dite zone d’intégration se caractérise par « travail stable – insertion relationnelle solide » ; la zone de vulnérabilité correspond à une situation intermédiaire, instable, conjuguant précarité du travail et « fragilité des supports de proximité »et enfin la zone de désaffiliation est la dernière étape du processus et se caractérise par une absence de participation à toute activité productive, sociale et à l’isolement relationnel. Certaines populations s’inscrivent ainsi dans un véritable processus d’exclusion pouvant conduire à un état de désaffiliation (grande pauvreté, SDF…)
Serge Paugam analyse l’exclusion en mettant davantage l’accent sur les trajectoires individuelles. Les exclus s’inscrivent dans un processus de disqualification sociale à partir du moment où ils admettent être désignés comme « pauvres » par les institutions officielles et leursreprésentants (travailleurs sociaux, élus…). Cette stigmatisation dépend de plusieurs facteurs tels qu’une condition sociale objective d’exclus, un degré de dépendance des populations en situation de précarité vis-à-vis des services d’action sociale.
23
Le processus de disqualification se caractérise par plusieurs phases qui concernent des populations différentes et dont l’enchaînement contribue à la dualisation de la société :
- La phase de fragilité concerne des personnes dont les difficultés sont essentiellement d’ordre
économique : incertitude et irrégularité du revenu lié à une situation de précarité de l’emploi. Lafragilité correspond à l’apprentissage de la disqualification sociale durant lequel les individus prennent progressivement conscience de la distance qui les sépare de la majorité de la population possédant un travail régulier.
- La phase de dépendance regroupe les personnes assistées qui font l’objet d’un suivi social régu-
lier lié à des difficultés plus importantes : handicap physique ou moral. Durant cette phase, la plupart des individus considèrent tout d’abord l’assistance comme une situation humiliante et adoptent une attitude de distanciation. Puis, peu à peu, ils acceptent les contraintes du statut d’assisté.
- La phase de rupture se caractérise par un cumul des handicaps (absence d’emploi, problème de
santé, absence de logement, perte de contacts avec la famille…), produit d’une accumulation d’échecs conduisant à une forte marginalisation. Cette dernière étape va généralement de pair avec une perte d’efficacité des derniers recours de la protection sociale. A ce stade, le mode de vie de l’exclu implique souvent des formes de résistance pouvant passer par la provocation sociale, la revendication de la liberté de vivre en marge de la société.
24