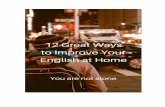Le libéralisme Italien: Introduction
Transcript of Le libéralisme Italien: Introduction
Sous la direction de Philippe N emo et Jean Petitot
Histoire du libéralisme en Europe
Ouvrage réalisé avec le soutien du Club international ESCP-Entreprises et du CREA de l'École Polytechnique
QUADRIGE / PUF
ISBN 2130552994
Dépôt légal - 1 édition: 2006, octobre © Presses Universitaires de France, 2006
6, avenue Reille, 75014 Paris
Introduction générale, par Philippe Nemo et Jean Petitot, 9 Présentation de l'ouvrage, 27 Présentation des auteurs, 51
PREMIÈRE PARTIE
ORIGINES
SODlDlaire
Les sources du libéralisme dans la pensée antique et médiévale, par Philippe Nemo (ESCP-EAP, CREPHE), 65
Juan de Mariana et la Seconde Scolastique espagnole, par J. Huerta de Soto (Université Rf!)' Juan Carlos, Madrid), 113
La pluralité des opinions: une chance pour la vérité ?, par Pierre Magnard (Université de Paris IV), 127
Grotius, un libéral républicain, par Hans Blom (Université Erasmus, Rotterdam), 153
La question de la tolérance chez Pierre Bayle, par Albert De Lange (Maison Melanchton de Bretten, Allemagne), 175
DEUXIÈME PARTIE
LE LIBÉRALISME FRANÇAIS
La « liberté du commerce» et la naissance de l'idée de marché comme lien social, par Gilbert Faccarello (Université de Paris 11), 205
Le débat sur la liberté du commerce des grains (1750-1775), par Philippe Steiner (Université de Lille III et Phare, Paris 1), 255
6 Histoire du libéralisme en Europe
L'économie politique française et le politique dans la seconde moitié du XVIII' siècle, par liJïc Charles (Université de Paris II - INED), 279
Lumières et laissez-faire: Turgot, entre les Physiocrates et un «moment américain», par Alain Laurent (Directeur de la « Bibliothèque classique de la liberté 313
Les Idéologues et le libéralisme, par Philippe Nemo (ESCP-EAP, CREPHE), 323 Pierre Daunou (1761-1840)., Libertés politiques, économiques, scolaires sous
la Révolution, l'Empire, les Restaurations, par Gérard Minart (ancien rédacteur en che] de La Voix du Nord), 369
Say et le libéralisme économique, par Philippe Steiner (Université de Lille III et Phare, Paris 1), 381
Le Groupe de Coppet. Mythe et réalité. Staël, Constant, Sismondi, par Alain Laurent (directeur de la « Bibliothèque classique de la liberté »), 405
Benjamin Constant, le grand architecte humaniste de la démocratie libérale, par Philippe Nemo (ESCP-EAP, CREPHE), 419
Éléments pour une étude de l'École de Paris (1803-1852), Michel Leler (écrivain, philosophe, sPécialiste de Frédéric Bastiat), 429
La vie et l'œuvre de Charles Coquelin (1802c I852), par Philippe Nata] (Université de Paris-Dauphine), 511
Le français et la pensée de Charles Renouvier, par Marie-Claude Blais (Université de Rouen), 531
TROISIÈME PARTIE
LE UBÉRALISME IT ALlEN
Introduction, par Raimondo Cubeddu (Université de Pise) et Antonio Masala (IMT Alti Studi, Lucques), 557
Le personnalisme libéral catholique dans l'Italie du XIX' siècle, par Paolo Heritier (Université de Turin), 567
Vilfredo Pareto et la révision du libéralisme économique classique, par Philippe Steiner (Université de Lille III et Phare, Paris I), 595
Le libéralisme radical des premières années du xx' siècle en Italie. Maffeo Pantaleoni - Antonio De Viti De Marco, par Flavio Felice (Université pontificale du Latran), 619
Le libéralisme de Luigi Einaudi, par Enzo Di Nuoscio (Université du Molise et Luiss de Rome), 651
L'apport de Benedetto Croce au libéralisme italien, par Roberta A. Modugno (Université de Rome III), 673
Sommaire 7
Libéralisme et illuminisme. La Révolution libérale de Piero Gobetti, par Jean Petitot (EHESS, CREA), 689
Le libéral-socialisme italien. De Croce à Calogero et Bobbio, par Luca Maria Scarantino (EHESS, UNESCO), 749
Liberté et droit dans la pensée de Bruno Leoni, par Antonio Masala (IMT Alti Studi, Lucques), 777
Deux figures du catholicisme libéral au xx' siècle: Luigi Sturzo, Angelo Tosato, par Dario Antiseri (Université LUISS de Rome), 795
QUATRIÈME PARTIE
LE UBÉRALISME ALLEMAND
Introduction. Les libéralismes allemands, par Patricia Commun (Université de Cergy-Pontoise), 829
Wilhelm von Humboldt et les origines du libéralisme allemand, par Detmar Doering (Liberales Institut, Potsdam), 859
Le libéralisme allemand authentique du XIX' siècle, par Ralph Raico (State Unwersiry ColLege at Buffalo), 881
L'école de Fribourg: Walter Eucken et l'ordolibéralisme, par Viktor J.. Vanberg (Université de Fribourg-en-Brisgau, Institut Walter Eucken), 911
La «mesure humaine» ou l' «ordre naturel»: l'humanisme économique de Wilhelm R6pke et Alexander Rüstow, par Gerd Habermann (Université de Potsdam), 937
Alfred Müller-Armack et Ludwig Erhard: le libéralisme social de marché, par Nils Go/dschmidt (Institut Walter Eucken, Fribourg-en-Brisgau), 953
L'influence de l'économie autrichienne sur le libéralisme allemand, par Michael Wohlgemuth (Institut Walter Eucken, Fribourg-en-Brisgau), 985
CINQUIÈME PARTIE
LE UBÉRALISME AUTRICHIEN
L'école autrichienne à la fin du XIX' et au début du xx' siècle, par Jô"rg Guido Hülsmann (Unwersité d'Angers, Ludwig von Mises Institute), 1033
La théorie hayékienne de l'ordre auto-organisé du marché «main invisible »), par Philippe Nemo (ESCP-EAP, CREPHE), 1067
Modèles formels de la « main invisible» : de Hayek à la théorie des jeux évolutionniste, par Jean Petitot (EHESS, CREA), 1095
8 Histoire du libéralisme en Europe
Friedrich Hayek et le génie du libéralisme, par Robert Nadeau (UQflM, Montréal), 1115
Friedrich Hayek ou la morale de l'économie, par Jean-Pierre DuPl!Y (CREA, GRISE), 1191
Libéralisme et Liberté: Hayek avec Kant ou une éthique de la finitude, par Jean Petitot (EHESS, CREA), 1215
L'épistémologie de Popper. Rationalisme critique et libéralisme, par Dario Antiseri (LUISS, Rome), 1225
Les Tchèques et les idées « autrichiennes », par Josif Sima (Université d'Économie de Prague), 1269
Un dialogue entre les Autrichiens et les libertariens a,méricains, par Roberta A. Modugno (Université de Rome III), 1279
SIXIÈME PARTIE
AUTRES PAYS D'EUROPE OCCIDENTALE
Le libéralisme espagnol, par José Maria Marco (Universidad Pontificia Comillas, Madrid), 1309
La pensée libérale au Portugal, par José Manuel Moreira (Université d'Aveiro), 1331
Libéralisme et partis politiques aux Pays-Bas, par Henk te Velde (Université de 1355
La transformation libérale de la Suède, 1765-1900, par Johan Norberg (Institut Timbro, Stockholm), 1377
EN GUISE D'ÉPILOGUE
La signification de la vie, et comment il convient d'évaluer les civilisations, par Barry Smith (.New York University at Bl!iJalo), 1399
1. Introduction
RAIMONDO CUBEDDU ET ANTONIO MASALA
Le rôle de l'Italie dans le développement du libéralisme euro-péen est original. D'un côté, il existe d'authentiques et d'impor-tantes contributions de l'Italie aux théories libérales, que ce soit à l'époque du Risorgimento avec des personnalités phares comme Cavour et Cattaneo, au tournant des XIXC et xxe siècles avec les travaux fondateurs de Pareto et Mosca (relayés ensuite pas ceux d'Einaudi et de Leoni), ou en réaction contre le fascisme avec le libéralisme de Gobetti, relayé ensuite par des personnalités plus social-libérales comme Norberto Bobbio, pour ne pas parler d'un catholicisme libéral sui generis.
Mais, d'un autre côté, l'Italie, comme la France, manifeste, dans sa culture politique dominante, une certaine méconnais-sance du main stream libéral. Par exemple, dans son ouvrage de 1925, Storia deI liberalismo europeo, qui est considéré aujourd'hui encore comme une référence pour l'historiographie de la pensée libérale, Guido De Ruggiero porte sur le libéralisme italien un jugement assez peu flatteur:
«Dans l'économie générale du mouvement européen, le libéralisme italien est d'importance modeste. Il n'est qu'un reflet de doctrines et d'orientations étrangères, même s'il est, par ailleurs, notable par son effort d'adaptation aux conditions particulières de l'Italie et par sa rela-tion étroite avec le processus d'unification nationale. »1
1. Guido De Ruggiero, Storia dei iiberalismo europeo, Laterza, Bari-Roma, 1995 (1925), p. 291.
558 Le libéralisme italien
Quatre-vingts ans après, certains souscriront encore à un tel jugement et l'accentueront même pour les œuvres postérieures à celles traitées par De Ruggiero. En effet, depuis l'avènement du fascisme jusqu'au début des années 1990, le libéralisme italien, malgré certaines exceptions importantes, est tombé dans une sorte de léthargie qui l'a souvent conduit à s'enfermer dans des discussions assez stériles sans s'insérer dans les courants les plus féconds du débat international.
Si l'on veut retracer un rapide panorama du libéralisme italien, il est important de considérer d'abord les années précédant l'unité de l'Italie, période dont la date symbolique est 1848 et qui vit s'ouvrir dans toute l'Europe un nouveau cycle révolutionnaire cen-tré sur la naissance des identités nationales. Si l'on envisage l'ensemble du cadre européen - et là l'Italie est la pointe de dia-mant - on constate que l'enthousiasme pour l'indépendance natio-nale ne semble pas accompagner mais plutôt se substituer à la réflexion sut les institutions permettant de garantir la liberté. On observe un changement de perspective, une nouvelle phase révolu-. tionnaire qui, comme l'a bien noté Giorgio Rebuffa, transforma
« le problème de l'unification en problème absolument dominant et fit passer au second plan celui de l'organisation politique [ ... ]. On visait la liberté de la nation, plutôt que la liberté et les droits des individus »'. En un certain sens, on peut soutenir que la grande période du
constitutionnalisme libéral, c'est-à-dire de cette recherche de la meilleure organisation institutionnelle pour garantir la liberté qui se manifeste avec la Révolution américaine, antérieurement avec les réflexions· de Locke et de Montesquieu, ensuite avec celles de Constant, ne passe pas de façon privilégiée par l'Italie. Incontes-tablement, les deux personnalités les plus marquantes de cette période sont Camille Cavour (1810-1861) et Carlo Cattaneo (1801-1869) qui étaient de profonds connaisseurs et des admirateurs du modèle libéral anglais et de la tradition du libéralisme français. Mais il manque au nouveau royaume (en raison de la disparition précoce de Cavour et de l'ambiguïté de la monarchie de Savoie) un projet organique de réforme des institutions qui soit de nature
1. Giogio Rebuffa, La statuto albertino, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 12-13. Cet essai met également en lumière le fait qu'en Italie ne furent réalisés ni un « système constitutionnel achevé », ni un « système politique moderne ».
Introduction 559
libérale. Et même si, dans les années suivant l'unité, les hommes politiques, juristes et constitutionnalistes libéraux de valeur ne manquèrent pas, les représentants du libéralisme italien furent plus préoccupés d'éviter que le fragile État construit par Cavour ne succombe aux tendances antilibérales que d'élaborer positive-ment de nouvelles solutions institutionnelles s'inspirant de la tra-dition libérale.
Toutefois, malgré ces réserves, il serait erroné de croire que l'Italie postunitaire n'a pas eu de tradition libérale. Celle-ci a bien existé et s'est manifestée dans deux directions importantes. D'une ]part, il y a eu les libéraux catholiques qui, bien que n'ayant jamais réussi à imposer leurs idées dans l'Église (on peut penser par exemple au cas . d'Antonio Rosmini, 1797-1855), se sont distin-gués par l'originalité de leur pensée et leur vivacité dans le débat politique. On pourrait même soutenir que le désir de surmonter les incompréhensions entre le libéralisme et la doctrine sociale chrétienne, surtout en ce qui concerne le marché, est à mettre au compte des mérites du libéralisme italien.
D'autre part, il y a eu l'école des économistes libéraux qui fait pleinement partie, et au plus haut niveau, du panorama interna-tional. On leur doit, entre la fin du XIX' siècle et le début du xxe ,
la période de 1'« Italie libérale », définition peut-être un peu emphatique, mais justifiée par ce qui est venu ensuite.
Les économistes libéraux sont habituellement considérés comme l'expression de la boùrgeoisie «illuministe ))1, avec une forte vocation scientifique. Les noms les plus connus sont ceux de Francesco Ferrara (1810-1900), Marco Minghetti (1818-1886) qui fut président du Conseil, Tullio Martello (1841-1918), Vil-fredo Pareto (1848-1923), Francesco Papafava (1864-1912), Maf-feo Pantaleoni (1857-1924), Antonio De Viti De Marco (1858-1943), Edoardo Giretti (1864-1940), Umberto Ricci (1879-1946) et Luigi Einaudi (1874-1961). Ces penseurs et savants différaient souvent entre eux, mais étaient tous des opposants convaincus au protectionnisme et des partisans actifs du libre-échange, dont ils attendaient une solution au problème de l'arriération du Mez-
1. «Illuministe» est l'adjectif utilisé en Italie pour dire « des Lumières », appe-lées elles-mêmes « illuminisme ». [N. des coord.]
560 Le libéralisme italien
zogiorno. Si l'on analyse la pensée de ces auteurs - qui ne consti-tuent pas un bloc monolithique et présentent, au· contraire, des différences significatives sur le plan théorique -, on constate que les thématiques de l'École de Manchester, les réflexions politico-sociales de Herbert Spencer, les idées de Jean-Baptiste Say, de Frédéric Bastiat ou de Gustave de Molinari, ainsi que la situa-tion économique américaine, étaient bien connues et débattues dans la Péninsule. Qui plus est, les économistes libéraux se caractérisent dans toute l'Europe par une activité politique intense à travers la création de journaux et d'associations (rappe-lons les plus connus: le Journal des économistes, la Société Adam Smith, l'Association pour la liberté économique). Ce fut aussi le cas des libéraux italiens. Leur activité parlementaire, à eux aussi, fut de grande qualité 1 , même si elle ne fut pas toujours couronnée de succès. Elle fut caractérisée par des batailles pour le libre-échange (y compris à l'intérieur du pays, avec la proposition d'établir des taxes internes sur la consommation), pour la réforme fiscale et, plus généralement, pour l'abolition des privi-lèges garantis par la loi et pour une réduction générale des fonc-tions de l'État.
Pour les économistes libéraux italiens, la liberté économique était inséparable de la liberté politique et en était même un pro-longement naturel. En accord avec la tradition libérale dont ils s'inspiraient, ils voyaient la liberté économique et la liberté poli-tique comme deux aspects d'une dimension unique. En outre, ils percevaient clairement la valeur symbolique et morale de ce que l'on pourrait appeler la « bataille contre l'étatisme )), valeur qui s'exprimait par la nécessité que l'État ne fût pas instrumentalisé au profit de la défense des privilèges d'une minorité. Ils en perce-
1. Ces dernières années, plusieurs études de grand intérêt ont été publiées sur ce sujet. Cf. les deux volumes édités par Massimo M. Augello et Marco E. L. Guidi, La Scienza economica in parlamento, 1861-1922. Una storia dell'economia politica dell'Italia liberale, l, Milano, Franco Angeli, 2002, et Gli economisti in par/amento, id., II, 2003 ; et Luca Tedesco, L'altematwa liberista in ltalia. Grisi di fine secolo, antiproibizionismo e finanza demo-cratica nei liberisti radicali (1898-1904), Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002. Citons aussi, malgré l'ancienneté et la divergence d'opinion, Giuseppe Are, Economia e politica· nell'Italia liberale (1890-1915), Bologna, Il Mulino, 1974; Roberto Vivarelli, Ilfalli-mento dei liberalismo, Bologna, Il Mulino, 1981, et Antonio Cardini, Stato liberale e prote-zionismo in ltalia (1890-1900), Bologna, Il Mulino, 1981.
.Introduction 561
vaient tout autant les conséquences sociales, à savoir le rappro-chement du peuple et des institutions l •
Le dernier et peut-être le principal représentant de cette école d'économistes libéraux a été Luigi Einaudi, qui en a passé le témoin à l'Italie républicaine. En un sens, son histoire est emblé-matique de la fin d'une époque. Quand le fascisme s'effondre, Einaudi, alors âgé, assume, grâce à son prestige, un rôle de pre-mier plan dans la nouvelle République. Toutefois, son rôle d'économiste dans l'histoire républicaine, s'il fut de grande importance, fut aussi de courte durée, et son élection à la prési-dence de la République représenta à la fois la reconnaissance tar-dive de la grande école des économistes libéraux et sa « neutrali-sation » définitive. En effet, une fois qu'il eut exercé cette charge, on perdit presque toute trace du libéralisme économique en Italie.
Pour comprendre comment il a pu se faire que le libéralisme italien qui, jusqu'aux années 1920, avait été minoritaire, mais prestigieux et bien inséré dans le débat international, ait pu se dissoudre aussi facilement dans l'après-guerre, il faut tenir compte non seulement du fascisme, mais aussi de la célèbre polémique qui s'est élevée entre Benedetto Croce (1866-1952) et Einaudi sur le libéralisme et le libérisme<. Dans son essai de 1927, liberismo e liberalismo, qui lança la querelle, Croce, bien que reconnaissant l'origine commune des concepts de «libérisme » et de «libéralisme », revient souvent sur le lien que le libérisme entretient «avec l'utilitarisme éthique» et sur la nécessité d'assujettir et de subordonner la sphère de l'économique, utilita-
1. Une telle conception explique également leur relative proximité avec la gauche, du moins en ce qui concerne des batailles que l'on peut qualifier de « contingentes », et non pas, certes, en ce qui concerne les fins dernières de la poli-tique, à propos desquelles la distance était évidemment irréductible. Le Parti «radi-cal » auquel appartenaient les économistes libéraux a eu de bonnes relations avec la gauche et, en particulier, avec les syndicalistes révolutionnaires, compte tenu de leur anti"étatisme. li a marqué aussi sa distance et même son opposition envers des per-sonnages ambigus comme Giovanni Giolitti, auxquels on attribuait la responsabilité de l'échec économique et social du royaume. Voir à ce propos Tedesco, L'alternative libérale ... , op. cit., avec sa documentation et sa bibliographie particulièrement riches.
2. Cette opposition n'existant pas en français nous gardons le néologisme ita-lien de « libérisme ». Sur l'opposition libéralisme/libérisme, cf. aussi irifra, p. 590-593 (Nd. T.).
562 I.e libéralisme italien
riste et hédoniste, à la sphère éthico-politique, à travers la recon-naissance du
« primat, non pas du libérisme économique, mais du libéralisme éthique »1.
Cela le poussa à affirmer également que (( l'on pourrait, avec la conscience libérale la plus sincère et la plus
vive, soutenir des mesures et des systèmes que les théoriciens de l'économie abstraite qualifient de socialistes et même parler de façon paradoxale [ ... ] d'un "socialisme libéral" à la Hobhouse »2.
Croce soutint plus tard « la neutralité du principe de la liberté par rapport à la particularité d.es systèmes économiques »3; il écrivit aussi que si
(( le cours de l'histoire conduisait à l'alternative soit d'endommager et d'affaiblir la production de la richesse en conservant le système capi-taliste, c'est-à-dire la propriété privée, soit de garantir et augmenter la production en abolissant la propriété privée, [ ... ] le libéralisme ne pour-rait pas ne pas approuver et prendre à son compte cette abolition »4.
Autrement dit, (( il serait vain de chercher à fixer dans le mouvement incessant,
variable et diversifié de l'histoire des systèmes éconornico-politiques, ceux que la liberté admet et ceux qu'elle refuse; car elle les admet tous et les refuse tous chacun à leur tour »5.
Cette distinction entre libéralisme et libérisme eut un grand succès dans le public. Or cela se passait à un moment où l'Italie avait presque oublié les économistes libéraux, et où l'on avait également oublié le vrai sens de l'épopée du Risorgimento, à savoir le souci, authentiquement libéral, de garantir constitutionnelle-ment les libertés. En conséquence, le terme de libérisme, qui s'identifiait, historiquement, avec les combats des économistes libéraux pour toutes les libertés, finit par signifier la seule satisfac-tion des besoins individuels à travers le marché et le libre-
1. Croce-Einaudi, Liberismo e Liberalismo, P. Solari (éd.), Milano-Napoli, Ricciardi, 1988, p. 12.
2. Croce-Einaudi, op. dt., p. 14. L. T. Hobhouse est l'auteur d'un ouvrage intitulé Liberalism (1911) où il prône une certaine régulation économique.
3. Croce, lA Storia come pensiero e come a.tione (1938), Bari, Laterza, 1966, p. 220. 4. Croce, Storia d'Europa nel secolo decimonono (1932), Bari, Laterza, 1972, p. 36. 5. Croce, lA Storia come pensiero ... , op. dt., p. 221.
Introduction 563
échange, tandis que libéralisme était entendu en un sens plus élevé et plus noble, à savoir l'organisation des intérêts individuels dans le cadre de l'État, relevant de la dimension éthico-politique de l'activité humaine. L'orientation fondamentale des esprits, en Italie, devenait donc différente de celle du libéralisme constitu-tionnel et économique européen. Il était entendu que l'orga-nisation des intérêts individuels ne pouvait advenir spontanément, mais devait être délibérément produite par la politique et l'éthique.
Croce venait d'une tradition philosophique hégélienne qui avait influencé la culture politique italienne où était déjà forte l'influence de l'école de 1'« économisme allemand », déjà cri-tiquée par Ferrara, qui justifiait le protectionnisme même contre lequel avaient lutté les économistes. On voit que, de façon plus ou moins consciente, Croce nie et rejette ce lien entre liberté éco-nomique et liberté politique qui caractérise la philosophie poli-tique de la tradition libérale, lien sans lequel le libéralisme n'a plus rien qui le distingue de la simple théorie politique démocra-tique l • Einaudi qui, comme nous l'avons dit, provenait d'une école qui avait, au contraire, bien conscience de ce lien, s'opposa fermement à la distinction de Croce, mais cette dernière devint néanmoins, pour longtemps, une idée communément acceptée dans l'Italie républicaine.
Ainsi, la conviction dominante devint que le dynamisme du marché devait être corrigé par l'éthique et la politique. Le libéra-lisme d'inspiration crocéenne ne se posait pas la question de savoir si une connaissance autorisant ces dernières à « diriger» le marché et à lui imposer un ensemble de fins partagées et dura-bles à moyen et long terme était possible. Il finit donc par ne plus se différencier (sinon par la façon de concevoir les contenus mêmes de l'éthique et de la politique) de la doctrine sociale catholique. En effet, celle-ci accepte elle aussi le marché, mais elle pense que celui-ci est fondamentalement instable, en raison de sa propension à satisfaire les besoins sans s'interroger sur leur carac-tère naturel ou artificiel. Aussi entend-elle subordonner le marché . à des normes transcendantes, politiques et surtout éthiques. Il
1. Sur ce point, cf. Raimondo Cubeddu, Croce, gli Austriaci e il liberalismo, in « MondOperaio», 2003, n. 6.
564 Le libéralisme italien
n'est donc pas étonnant que le libéralisme de Croce, dès lors qu'il ne défendait pas l'idée que les pouvoirs de l'État doivent être limités par le droit naturel, ait fini par soutenir un libéral-socialisme proche de la tradition des liberals américains 1 •
Malgré quelques aménagements (parmi lesquels mérite d'être signalée la tentative de Francesco Forte [né en 1929] d'élaborer un socialisme libéral ouvert à la tradition du Public Choice) et quel-ques exceptions louables, cette conviction a caractérisé la culture « libérale» italienne de l'après-guerre et elle a conduit à la consti-tution de ce qu'on pourrait appeler un « bloc culturel» qui, enri-chi des leçons de Keynes, a été longtemps dominant. Ce bloc s'est constitué malgré l'aversion crocéenne envers la tradition « actioniste ))2 qui s'inspirait de l'héritage spirituel de Piero Gobetti (1901-1926) et des socialistes libéraux, et sans que ni le libéral original que fut Ernesto Rossi (1897-1967), ni la presti-gieuse revue Il Monda, ne puissent jamais représenter une véri-table alternative. Une autre conséquence notable fut de liser deux autres traditions importantes: d'une part, celle de Carlo Antoni (1896-1959), Vittorio De Caprariis (1924-1964) et Nicola Matteuci (né en 1926), auteurs qui se réfèrent au constitu-tionna1isme libéral anglo-saxon tout en cherchant à l'intégrer à l'héritage crocéen; d'autre part, celle de libéraux comme Sergio Ricossa (né en 1927) et Antonio Martino (né en 1942), qui furent sommairement qualifiés de « libéristes )).
Le problème est donc qu'en Italie la version crocéenne et « actioniste)) du libéralisme n'a pas été une orientation de recherche parmi d'autres, mais est devenue dominante. Elle est responsable du fait que, dans la mesure où ses présupposés contredisent complètement les thèses du classical liberalism, on n'a pu, pendant longtemps, accueillir dans la Péninsule les nouveau-tés importantes provenant, surtout à partir des années 1960, de ce qui est devenu l'une des plus importantes traditions de la théorie politique et économique contemporaine. On peut facile-ment s'en convaincre en pensant au délai qui a dû s'écouler avant que des penseurs comme Hayek, Mises, Popper, Buchanan
1. Rappelons que les Liberais anglo-saxons sont, en fait, des sociodémo-crates (Nd. T.).
2. Le terme italien azionista est entre « activiste» et « engagé» (Nd. T.).
Introduction 565
(pour ne citer que quelques noms) s'imposent à l'attention de ceux qui se déclaraient «libéraux », mais qui, du point de vue économique, étaient essentiellement des dirigistes et, du point de vue juridique, étaient fortement influencés par la théorie du posi-tivisme juridique (par exemple, Norberto Bobbio [1909-2004] et Uberto Scarpelli [1924-1994])1. Le même regain d'intérêt pour les thèmes du droit naturel n'a eu pendant longtemps d'écho, malgré l'apport d'Alessandro Passerin d'Entrèves (1902-1985), que dans le milieu culturel catholique, où il faut signaler la con-tribution de don Angelo Tosato (1938-1999) à une relecture de l'Évangile s'opposant au paupérisme catholique traditionneF.
Il y a eu naturellement des auteurs qui ont su accueillir ces nouveautés et qui, plus généralement, ont clairement compris qu'on ne pouvait réduire la tradition libérale à la vision cro-céenne3• Mais ils ont payé de leur isolement le fait que leur dis-cours n'était pas compris. Sont emblématiques, à cet égard, Gae-tano Salvemini (1873-1957) et don Luigi Sturzo (1871-1959)4 qui reprennent les thèmes de la tradition catholique libérale italienne pour les relier à ceux du libéralisme américain, et aussi Bruno Leoni (1913-1967), le plus important penseur libéral de l'après-guerre, le seul à avoir exercé une influence sur l'évolution du Classical Liberalism5•
Leoni a élaboré un modèle de l'ordre social fondé sur le concept d'échange et le refus des décisions collectives. Il fait cons-
1. Si l'attention du public italien a fini par être attirée vers les auteurs libéraux, cela est dû notamment aux efforts de Dario Antiseri (né en 1940) et de ses collabo-rateurs.
2. Sur Tosato, cf. ùifra, l'article de Dario Antiseri, p. 810-826. 3. On doit rappeler à ce propos l'ouvrage d'Eugenio Capozzi, L'altemativa atlan-
tica. 1 modelli costitu;;ionali anglosassoni nella cultura italiana fÛI secono dopoguerra, Rubettino, Soveria Mannelli, 2003. On y présente les fortunes diverses des études sur le consti-tutionnalisme libéral en Italie. Citons aussi les volumes d'Antonio Jannazzo, Il libera-/ismo italiano fÛI Novecento. Da Giolitti a Malagodi, Rubbetino, Soveria Mannelli, 2003, et de Giovanni Orsina (dir.), Il partito liberak nell'Italia repubblicana, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004, qui retracent les vicissitudes, des libéraux qui se sont consacrés à l'action politique en Italie. Deux essais récents de Roberto Pertici et de Fabio Grassi Orsini sont également très intéressants: Riaprire il cantiere: i liberali dalla crisi fÛI regime alla ricostru;;iane fÛI partito, et La crisi fÛlla cuttura liberale in ltalia nel primo ventennio repubbli-cano, parus tous les deux dans (( Ventunesimosecolo », 2005.
4. Sur Sturzo, cf. in.fra, p. 795-810. 5. Sur Leoni, cf. infia, p. 777-794.
566 Le libéralisme italien
tamment référence aux auteurs qui ont relancé le libéralisme clas-sique dans l'après-guerre (Hayek, Buchanan, Tullock, Milton Friedman, Rothbard, pour ne citer que les plus connus). Mais, bien qu'il ait aussi prodigué son extraordinaire énergie en Italie (surtout dans les pages de la revue Il Politico qu'il fonda en 1950), son libéralisme est demeuré essentiellement incompris dans la Péninsule et, après sa disparition prématurée, il est longtemps resté, dans sa patrie, un illustre inconnu. La preuve en est que son œuvre maîtresse, Freedom and the Law, parue en 1961, n'a été traduite en italien qu'en 19951•
Ce regain d'intérêt pour les thèmes et les représentants du classical liberalism contemporain n'a émergé qu'à partir des années 1980, et le cas de Leoni montre comment l'Italie a pu res-ter longtemps imperméable aux tendances les plus fécondes de la culture libérale contemporaine. La défense de la liberté y a été trop souvent conçue· comme une grande fresque métaphysique, inutilisable pour les problèmes réels, ou comme une bataille sur des thèmes particuliers trop techniques pour permettre de saisir quels idéaux étaient en jeu.
Toutefois, depuis une vingtaine d'années, une nouvelle géné-ration de savants cherche patiemment à combler ce retard, comme le manifeste le regain d'intérêt soit pour les thèmes de l'école autrichienne, soit pour ceux de la tradition du libertarianism contemporain et pour les théories des natural rights, soit encore pour le catholicisme libéral. Cet intérêt, même s'il n'a peut-être pas encore produit de résultats originaux au niveau international, marque incontestablement une inversion de tendance par rapport aux dernières décennies.
Traduit de l'italien par Jean Petitot.
1. Bruno Leoni, Freedom and the Law, Princeton, Van Nostrand, 1961 ; préface de la traduction italienne La libertà e la legge, R. Cubeddu, Macerata, Liberilibri, 1995. Sur Leoni, voir Antonio Masala, Il liberalismo di Bruno Leoni, Soveria Mannelli, Rub-bettino, 2003, et Antonio Masala (éd.), La teoria politica di Bruno Leoni, introduction de A. Panebianco (textes de M. Barberis, R. Cubeddu, A. Febbrajo, G. Fedel, F. Forte, C. Lottieri, A. Masala, S. Mazzone, P. G. Monateri, P. Scaramozzino, V. Zanone), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005 .. L'ouvrage de Leoni vient également d'être tra-duit en français: Bruno Leoni, Liberté et loi, Paris, Les Belles Lettres, « Bibliothèque classique de la liberté », 2005.
Table des matières
Introduction générale, par Philippe Nemoet Jean Petitot, 9 Présentation de l'ouvrage, 27 Présentation des auteurs, 51
PREMIÈRE PARTIE ORIGINES
1. Les sources du libéralisme dans la pensée antique et médiévale, par Philippe Nemo, 65
1 - La «liberté sous la loi» dans la Cité grecque, 67 II - La doctrine stoïcienne du droit naturel, 71
III - Le droit romain comme droit scientifique, 80 IV - Le droit romain comme émergence de la propriété privée, 82 V - La Bible, une révolution morale annonciatrice de transforma-
tions sociétales majeures, 85 1. Un sens cosmique de La liberté, 86 2. Le «grain de sable» apporté par La Bible dans les mécanismes victi-
maires et mimétiques, 90 3. La désacralisation de l'État, 93
VI - Le rationalisme de la « révolution papale». Le thomisme, 95 VII - La tradition de la Common Law, 101
VIII - La tradition démocratique de l'Église, 103 IX - Des libertés «germaniques»?, 107
Conclusion, 110 2. Juan de Mariana et la Seconde Scolastique espagnole, par JesUs Huerta de
Sotot, 113
1414 Histoire du libéralisme en Europe
3. La pluralité des opinions: une chance pour la vérité?, par Pierre Magnard, 127 Discussion, 143
4. Grotius, un libéral républicain, par Hans Blom, 153 Introduction. Pourquoi Grotius?, 153
1 - Hugo Grotius: religion et liberté, 159 II - La justice et la responsabilité des individus, 163
III - Volontarisme versus intellectualisme: un malentendu dans l'his-toire du droit naturel, 165
IV - Le libéralisme dans le De jure belli ac pacis (1625), 169 Conclusion. Grotius, un libéral républicain, 173
5. La question de la tolérance chez Pierre Bayle, par Albert De Lange, 175
Introduction de Jean Petitot, 175 La Glorieuse Rentrée de 1689, 176 Pierre Bayle, 1 78
1 - «Contrains-les d'entrer », 179 1. Luc 14, 16-24. La parabole du Festin des noces, 179 2. Saint Augustin, 180 3. Auteurs catholiques autour de la révocation de l'édit de Nantes, 181
II - La réforme protestante et ses conséquences, 181 1. Libertas christiana et liberté de conscience, 181 2. Cuius regio, eius religio, 182 3. Tolérance négative, 183
III - Pierre Bayle, 184 1. Biographie, 184 2. Bibliographie, 185 3. Bayle et la révocation de l'édit de Nantes, 186 4. La réaction de Jurieu, 188
IV - Le Commentaire philosophique, 189
Appendice, 196 Discussion, 197
Table des matières 1415
DEUXIÈME PARTIE
LE LIBÉRALISME FRANÇAIS
1. La« liberté du commerce» et la naissance de l'idée de marché comme lien social, par Gilbert Faccarello, 205
1 - Le siècle du Moi-Soleil, 207 1. Passions, intérêt, amour-propre, 207 2. Augustinisme et jansénisme, 212
II - Le moment Pierre Nicole, 215 1. Le thème de l'amour-propre (<éclairé», 215 2. Le fondement: l'ordre politique, 217
III - Boisguilbert, la concurrence et l'équilibre d'opulence, 219 1. lA force agrégatrice de la concurrence, 220 2. Qyelques conséquences, 224 3. Les tâches du législateur, 227
IV - Turgot et l'économie politique sensualiste, 230 1. Le sensualisme de Turgot, 231 2. Droits naturels, propriété et valeur, 233 3. Qyelques conséquences, 236 4. lA prudence du législateur, 240 5. Vaincre les prijugés et l'esprit de corps, 242
Références, 247 2. Le débat sur la liberté du commerce des grains (1750-1775), par Philippe
Steiner, 255 1 - La question des blés au milieu du XVIII' siècle, 255
II - Quesnay et la liberté du commerce des grains, 258 III - Turgot et le prolongement du modèle de Quesnay, 264 IV - Le débat entre Turgot et Necker sur le fonctionnement du
marché du blé, 268 Conclusion, 274 Discussion, 275 Références, 277
3. L'économie politique française et le politique dans la seconde moitié du XVIII' siècle, par Loïc Charles, 279
1 - Introduction, 279 II - Le groupe Gournay et le modèle anglais de Montesquieu, 283
1. Le modèle de la liberté politique de Montesquieu, 285 2. lA lecture du cercle de Goumtry, 290
1416 Histoire du libéralisme en Europe
III - Doux commerce? Le cercle Gournay et l'étranger, 294 1. Goumqy, Montesquieu et les rapports entre nations, 294 2. Au-delà du « doux commerce », 298
IV - Remarques pour conclure, 301 Discussion, 303
4. Lumières et laissez-faire: Turgot, entre les Physiocrates et un « moment américain », par Alain Laurent, 313
1 - Laisser faire les intérêts particuliers, 314 II - Lumières et droits naturels de l'homme individuel, 317
III - Les disciples de Turgot et l'autre «découverte de l'Amé-rique » ... , 319
5. Les Idéologues et le libéralisme, par Philippe Nemo, 323
1 - Les Idéologues. Un tableau historique, 325 1. Qui sont-ils?, 326 2. Les institutions auxquelles ils ont pris part, 328 3. « La Décade philosophique », 330 4. Les écoles et l'Institut, 331
II - Le libéralisme économique des Idéologues: le Commentaire sur « L'Esprit des lois» de Destutt de Tracy, 335 1. L'échange, 336 2. L'essence vraie de la «Production », 339 3. Le messianisme industrialiste, 340 4. La croissance, 343
III - Le libéralisme intellectuel des Idéologues: Condorcet et Dau-nou adversaires du monopole étatique de l'éducation, 346 1. Condorcet, 346 2. Daunou, 357
6. Pierre Daunou (1761-1840). Libertés politiques, économiques, scolaires sous la Révolution, l'Empire, les Restaurations, par Gérard Minart, 369
1 - Une vie vouée à défendre les libertés, 370 II - Au cœur du libéralisme de Daunou, les garanties individuelles, 376
7. Say et le libéralisme économique, par Philippe Steiner, 381 1 - L'économie politique et la liberté des échanges, 382
1. La production et le marché, 382 2. Limites de l'intérêt particulier, 387
II - Du républicanisme à l'utilitarisme, 393
Table des matières 141 7
III - Comment contenir le gouvernement?, 397 Condusiop, 401 Références, 402
8. Le Groupe de Coppet. Mythe et réalité. Staël, Constant, Sismondi, par Alain Laurent, 405
1 - Germaine de Staël, « l'âme du Groupe de Coppet», 406 II - Benjamin Constant: figure canonique de l'individualisme
libéral, 409 III - Le « cas» Sismondi, 415
9. Benjamin Constant, le grand architecte humaniste de la démocratie libérale, par Philippe Nemo, 419
10. Éléments pour une étude de l'école de Paris (1803-1852), par Michel Leter, 429
Introduction, 429
1 - L'école de Paris, pierre d'angle du libéralisme français, 444 1. Dijinition et périodisation, 444 2. Les prémices de l'école de Paris (1803-1832), 450 3. Laformation et la cristallisation de l'école de Paris (1832-1841), 457 4. L'essor de l'école de Paris (1842-1877), 460 5. Le déclin de l'école de Paris (1877-1928), 471
II - L'école de Paris et les principes du libéralisme français, 472 1. Le pluralisme intellectuel et la liberté scolaire, 474 2. Une théorie libérale de l'État et du gouvernement, 485 3. Une théorie de la propriété et de la « spoliation légale », 491 4. La « loi des débouchés» de Sqy et le libre-échange, 499
Il. La vie et l'œuvre de Charles Coquelin (1802-1852), par Philippe Nataj, 511 .
1 - Jeunesse et formation de Coquelin (1802-1827),512 II - De l'avocat à l'économiste (1827-1839), 514
III - Le conseiller de l'industrie du lin (1839-1846), 521 IV - L'économiste à plein temps (1846-1852), 523
Les écrits de Charles Coquelin, 526 12. Le kantisme français et la pensée de Charles Renouvier, par Marie-
Claude Blais, 531 1 - 1848, ou la difficile synthèse entre individu et société, 533
II - Un retour critique à Kant, 536 III - La catégorie d'obligation. Contrat personnel et contrat social, 537 IV - Union de la morale et du droit. Morale pure et morale
appliquée, 540
1418 Histoire du libéralisme en Europe
v - État de paix et état de guerre, 542 VI - Le danger des socialismes, les pièges du libéralisme, 544-
VII - Un socialisme libéral, 550 Œuvres de Charles Renouvier, 552
TROISIÈME PARTIE
LE LIBÉRALISME ITALIEN
1. Introduction, par R. Cubeddu et A. Masala, 557 2. Le personnalisme libéral catholique dans l'Italie du XIX" siècle, par Paolo
Heritier, 567 1 - Une nouvelle écriture de l'histoire du libéralisme italien du
XIX' siècle?, 570 II - Le personnalisme libéral au XIX' siècle, 573
1. Antonio Rosmini (1797-1855), 574 2. Luigi Taparelli D'Azeglio (1793-1862), 582
III - A propos de l'origine de la distinction entre «libéralisme» et « libérisme », 590
3. Vilfredo Pareto et la révision du libéralisIl1e économique classique, par Philippe Steiner, 595
1 - Pareto et les économistes libéraux français: pacifisme et libre-échange, 595
II - La révision du libéralisme classique, 602 III - L'utopie libérale, le cycle économico-politique et la virtù, 607
Conclusion, 615 Réfèrences, 616
4. Le libéralisme radical des premières années du XX' siècle en Italie. Maffeo Pantaleoni - Antonio De Viti De Marco, par Flavio Felice, 619 Introduction, 619
1 - Le cadre historique, 621 II - Maffeo Pantaleoni, 624
1. La vie, 624-2. La pensée, 627
III - Antonio De Viti De Marco, 635 1. La vie, 635 2. La pensée, 637
IV - La contribution de l'École italienne à la science économique, 645 Conclusion, 649
Table des matières 1419
5. Le libéralisme de Luigi Einaudi, par Enzo di NuoseW, 651 1 - Le libéralisme: la recherche de la vérité par élimination de
l'erreur, 651 II - Le marché: la démocratie des consommateurs, 653
III - Contre l'étatisme, 655 IV - Le libéral est contre les monopoles, 657 V - Les tâches de l'État libéral, 659
VI - Économie de marché et solidarité, 662 VII - Libéralisme et socialisme, 663
VIII - L'État de droit: l'environnement de la concurrence, 666 IX - Un libéral anglo-saxon héritier de Cavour, 668
Conclusion, 670
Références, 672
6. L'apport de Benedetto Croce au libéralisme italien, par Roberta A. Modugno, 673·
1 - Un intellectuel contre le fascisme, 673 II - La critique à l'égard de Hegel et l'historicisme de Croce, 677
III - La critique de l'État éthique, 680 IV -La conception libérale comme conception de la vie, 682 V - L'individualisme méthodologique, 686
Références, 687
7. Libéralisme et illuminisme. La Révolution libérale de Piero Gobetti, par Jean Petitot, 689 Introduction, 689
1 - Éléments de la biographie et de la légende, 691 1. La jeunesse et le lYcée, \?91 2. Les maîtres, 693 3. Le débat initial avec le marxisme et le socialisme, 696 4. Activités culturelles, politiques et éditoriales, 697 5. La légende, 703
II - Le contexte et l'histoire des idées, 711 1. L'équation fondamentale du libéralisme gobettien, 711 2. Libéralisme, antifascisme et socialisme, 714 3. Les courants de pensée analYsés par Gobetti, 718
III - Certains principes du libéralisme gobettien, 728 1. Capitalisme, lutte des classes et concurrence, 728 2. La théorie des élites de Gaetano Mosca et Vilfredo Pareto, 729 3. De Pareto et Mosca à Georges Sorel, 732
1420 Histoire du libéralisme en Europe
4. L'originalité de Gobetti, 733 5. Qyatre thèses centrales de Gobetti sur l'histoire italienne, 734
IV - Les thèses de la Rivoluzione Liberale, 736 1. Libéralisme et modernité, 736 2. Le primat de la morale de l'autonomie, 738 3. La légalité et les sociétés de droit, critique de la bourgeoisie non
webérienne, 738 4. La mythification des classes sociales et les « palingénésies socialistes», 7 39 5. Le modèle concurrentiel de la lutte des classes, 741 6. L'exigence libérale, 745
Conclusion, 746 Références, 746
8. Le libéral-socialisme italien. De Croce à Calogero et Bobbio, par Luca Scarantino, 749
1 - La faillite du vieux libéralisme parlementaire, 749 II - Deux générations d'antifascistes. Le rôle de Benedetto Croce, 753
III - Le libéral-socialisme. Guido Calogero, 760 IV - La critique de la « main invisible », 765 V - Traduction politique: institutions, bicamérisme, école publique,
fiscalité, nationalisations, réforme agraire, fédéralisme euro-péen, 768
VI -:- Giustizia e libertà. Norberto Bobbio, 771 Références, 77 5
9. Liberté et droit dans la pensée de Bruno Leoni, par Antonio Masala, 777 1 - Économie, droit et politique, 777
II - Pouvoirs et demandes: un modèle d'ordre social, 781 III - Freedom and the Law, 788 IV - Ordre spontané et choix collectifs: le « modèle Leoni », 791
1 O. Deux figures du catholicisme libéral au xxe siècle: Luigi Sturzo, Angelo Tosato, par Dario Antiseri, 795
1 - Luigi Sturzo, 795 II - Angelo Tosato. Les sources de la liberté dans l'œuvre d'un exé-
. gète catholique, 810 Références, 824
J
Table des matières 1421
QUATRIÈME PARTIE
LE LIBÉRALISME ALLEMAND
1. Introduction. Les libéralismes allemands, par Patricia Commun, 829 1 - Le réformisme libéral dans les États allemands aux XVIIIe et
XIX' siècles, 835 1. Le Saint-Empire romain germanique: un État central peu structuré, 835 2. Le riformisme libéral en Prusse (1740-1815), 836 3. Lei Parlement de Franifort (1848-1849), 840 4. Le riformisme libéral dans les États allemands du Sud, 842 5. Les luttes riformistes du libéralisme politique et constitutionnel en
Prusse (1861-1914), 843 II - Les penseurs libéraux aux XVIII' et XIX' siècles, 847
1. Entre émancipation individuelle et respect d'un ordre social: de la Réforme à l'Aufklarung, 847
2. Le libéralisme culturel et universitaire, 850 3. Le libéralisme économique, 851
Conclusion, 855 2. Wilhelm von Humboldt et les origines du libéralisme allemand, par
Detmar Doering, 859 3. Le libéralisme allemand authentique du XIX'> siècle, par Ralph Raico, 881
1 - La nouvelle école allemande du droit naturel, 885 II - Jacob Mauvillon, 886
III - De Wilhelm von Humboldt au parti du libre-échange, 888 IV - John Prince-Smith, 890 V - Journalistes et politiciens: le Congrès des économistes alle-
mands, 894 VI - L'unification allemande et la position des libéraux face à Bis-
marck,897 VII - Prince-Smith atteint par le «syndrome de Pareto », 899
VIII - Eugen Richter, 904 4. L'École de Fribourg: Walter Eucken et l'ordolibéralisme, par Vzktor
Vanberg, 911 Références, 934
5. La « mesure humaine» ou 1'« ordre naturel»: l'humanisme éco-nomique de Wilhelm Rôpke et Alexander Rüstow, par Gerd Haber-mann, 937
1 - Quelques sujets particulièrement importants, 939 II - La racine des problèmes, 941
1422 Histoire du libéralisme en Europe
III - Contre l'utilitarisme, 943 IV - Qui sont les vrais bénéficiaires de YÉ,tat-providence ?, 945 V - Quelle alternative?, 946 "
Références, 950
6. Alfred Müller-Armack et Ludwig Erhard: Je libéralisme social de marché, par Nils Go/dschmidt, 953
1 - Introduction. Fins sociales, moyens économiques. L'économie sociale de marché, 953
II - Quelques considérations «étymologiques », 956 III - «Socialisme libéral» ou «libéralisme social» ? Franz Oppen-
heimer et Ludwig Erhard, 960 IV - L'École de Fribourg: tout a une importance sociale, 968 V - Alfred Müller-Armack: l'équilibre entre liberté économique et
justice sociale, 973 VI - Conclusion, 982
7. L'influence de l'économie autrichienne sur le libéralisme allemand,par Michael Wohlgemuth, 985
1 - Introduction. Quelques mises en garde, 985 II - Bref historique des tensions et des échanges intellectuels
germano-autrichiens, 987 III - Les concepts fondamentaux (néo-)autrichiens et leur impact sur
le libéralisme classique, 992 IV - Libéralisme autrichien et ordolibéralisme, 1002
1. Les opinions des Autrichiens et de l'École de Fribourg sur la concur-rence, 1008
2. Ordre spontané versus établissement intentionnel des règles, 1010 3. La « question sociale»: les visions hayékienne et ordolibérale, 1013
V - Une mise en perspective. Le libéralisme allemand et l'économie autrichienne aujourd'hui, 1016 1. L'irifluence de Hayek: la filière de Fribourg, 10 16 2. La science économique autrichienne aujourd'hui: sur la voie d'une idéo-
logie anarcho-libertaire?, 1023
Références, 1024
Table des matières 1423
CINQUIÈME PARTIE . LE LIBÉRALISME AUTRICHIEN
1. L'École autrichienne à la fin du XIX' et au début du xx' siècle, par Guido Hülsmann, 1033
1 - Les racines du libéralisme de l'école autrichienne, 1035 1. La Scolastique, tradition vivante, 1035 2. Le libéralisme économique de la Scolastique: l'École de Sala-
manque, 1037 3. Un libéralisme utilitariste et économique, 1039
II - Carl Menger, 1039 1. La méthode exacte et la théorie descriptive, 1041 2. Le monde économique ordonné par les besoins individuels, 1043 3. Les lefons au dauphin Rudolf, 1045 4. L'autonomie de la société civile, 1046
III - Euglm von Bôhm-Bawerk, 1047 1. Intérêt sans exploitation, 1048 2. Critique du marxisme, 1050 3. Le pouvoir impuissant face à la loi économique, 1051
IV - Ludwig von Mises, 1053 1. Vu et œuvres, 1054 , 2. Un théoricien des migrations et des communautés linguistiques, 1057 3. Critique du socialisme, 1058 4. Critique de l'interventionnisme, 1061 5. Un manijèste libéral, 1063 6. Un manuel de la science de la liberté, 1064
2. La théorie hayékienne de l'ordre auto-organisé du marché (la «main invisible »), par Philippe Nemo, 1067
1 - Théorie du marché et macro-économie, 1068 II - Le paradoxe de la division du travail et du savoir, 1071
III - Le droit et les prix comme systèmes de transmission d'information, 1075 1. Le droit, 1076 2. Les prix, 1078 3. La solution au problème de la complexité, 1082
IV - La cybernétique du marché, 1083 1. Nature cognitive du prqfit, 1083 2. Adaptation des agents individuels au système global, 1085
1424 Histoire du libéralisme en Europe
3. Rétroaction du local sur le global, 1088 4. Causalité circulaire, 1088 5. L'auto-organisation: l'énigme de la « mazn invisible» dijinitivement
dévoilée, 1089 6. Rattrapage des déséquilibres, 1090
Conclusion. Le rôle des structures et des institutions, 1092 Références, 1094
3. Modèles fonnels de la «main invisible»: de Hayek à la théorie des jeux évolutionniste, par Jean Petitot, 1095
1 - La tension chez Hayek entre modernité et conservatisme, 1095 1. Science et traditionalité chez Hayek, 1095 2. Vers une science du sens commun, 1095 3. La possibilité contemporaine d'une critique et d'un dépassement scienti-
fiques du constructivisme rationaliste, 1096 4. Hayek avec Kant, 1097 5. L'évolution culturelle comme apprentissage collectif, 1098
Il - L'exemple des jeux évolutionnistes, 1099 1. Le dilemme du prisonnier, 1099 2.· Le dilemme du prisonnier itéré (IPD), 1101 3. Les jeux évolutionnistes, 1102 4. La stratégie du « tit for tat»: du sens commun aux modèles, 1103 5. Les généralisations de Sigmund et Novak, 1105 6. Les IPD spatialisés de Nowak et May, 1106 7. La corifùmation par les algorithmes génétiques, 1111
Conclusion, 1112 Références, 1114
4. Friedrich Hayek et le génie du libéralisme, par Robert Nadeau, 1115 Introduction: le libéralisme comme philosophie de l'économie
politique, 1115
1 - Le principe d'une économie de marché, 1118 II - L'équité économique dans un État de droit, 1129
Conclusion, 1143 Références, 1146
5. Friedrich Hayek ou la morale de l'économie, par Jean-Pierre Duptg, 1151
1 - La philosophie de l'esprit, 1152 II - La philosophie sociale, 1155
III - La théorie de l'évolution culturelle, 1161
Table des matières 1425
IV - La justice et la liberté, 1168 V - Analyse critique de l'imitation chez Hayek, 1175
1. Logique de l'imitation, 1 1 75 2. Dissolution des contradictions dans le Savoir absolu, 1186 3. Du système d'incitations au marché-termitière, 1189
Discussion, 1201
6. Libéralisme et Liberté: Hayek avec Kant ou une éthique de la finitude, par Jean Petitot, 1215
1 - La double dimension de la raison pratique et le partage Nature/Liberté, 1215 1. L'architectonique transcendantale et les trois ordres de la Raison, 1215 2. Vers un dépassement de l'antinomie de la raison pratique, 121 7
II - Rationalisme critique et Aujklarung, 1219 1. Subreption dialectique et illusion transcendantale, 1219 2. Rationalisme critique et fins de l'homme, 1220
III - Vers des sciences du know how, 1221 Conclusion, 1223
Références, 1223
7. L'épistémologie de Popper. Rationalisme critique et libéralisme, par Daria Antiseri, 1225
1 - La vie et les œuvres, 1226 II - Les raisons d'une théorie faillibiliste de la connaissance scienti-
fique, 1228 III - Misère de l'historicisme et inconsistance du holisme, 1230 IV - L'explication scientifique et la division des sciences, 1232 V - L'explication historique, 1234
VI - La logique de la situation, 1236 VII - Critique de la théorie conspiratrice de la société et défense de
l'autonomie de la sociologie, 1240 VIII - La logique des sciences sociales: le débat entre Karl R. Popper
et Theodor W. Adorno, 1242 IX - Platon: un grand ennemi de la société ouverte, 1247 X - Hegel: le philosophe de Frédéric-Guillaume, 1250
XI - Pourquoi le matérialisme historique ne tient pas, 1253 XII - Marx, faux prophète, 1256
XIII - Société ouverte et société fermée, 1258 XIV - Démocratie et dictature, 1260 XV - Karl R. Popper et les valeurs du christianisme, 1261
1426 Histoire du libéralisme en Europe
Conclusion, 1264
Références, 1265
8. Les Tchèques et les idées «autrichiennes », par Josif Sima, 1269 1 - Les idées libérales en politique, 1271
II - Les idées libérales en dehors de la politique, 1276
9. Un dialogue entre et les Autrichiens et les libertariens américains, par Roberta A. Modugno, 1279
1 - Le libertarianisme: américain ou «autrichien»?, 1279 II - Murray Newton Rothbard: correspondances et discordances
entre libertarianisme et École autrichienne d'économie, 1285 III - Le système éthiql,\e de Murray N. Rothbard : critique du sub-
jectivisme des valeurs, 1287 IV - Rothbard et le droit naturel, 1292 V - Critique de Hayek. Droits historiques et droits naturels, 1297
Références, 1305
PAùRTIE
AUTRES PAYS D'EUROPE OCCIDENTALE
1. Le libéralisme espagnol, par José Maria Marco, 1309 1 - «Exaltados» et «Moderados », 1309
II - Isabelle II : un règne libéral et romantique, 1313 III - Le libéralisme, facteur d'intégration de la Restauration, 1319 IV - La crise du libéralisme et de la légitimité politique, 1322 V - Libéralisme sans liberté, 1328
Références, 1329 2. La pensée libérale au Portugal, par José Manuel Moreira, 1331
1 - Alexandre Herculano, 1335 II - Oliveira Martins, 1343
III - Almeida Garrett, 1345 IV - L'époque contemporaine, 1348
Références, 1352 3. Libéralisme et partis politiques aux Pays-Bas, par Henk Te Velde, 1355
1 - Un «art de la séparation », 1357 II - L'avènement des masses, 1361
III - Le libéralisme enté dans la culture nationale hollandaise, 1366 IV- Les succès du WD, 1369
Table des matières 1427
4. La transfonnation libérale de la Suède, 1765-1900, par Johan Norberg, 1377
1 - Montée, 1377 II - Victoire, 1382
III - Déclin, 1390
EN GUISE D'ÉPILOGUE La signification de la vie, et comment il convient d'évaluer les civilisations,
par Barry Smith, 1399
1 - Le problème du relativisme, 1399 II - Liberté et évaluation des civilisations, 1401 II - La signification de la vie, 1404
III - La signification de la ,vie et l'ordre libéral, 1407 Références, 1410
Cet ouvrage a été mis en pages par Vendôme Impressions
73, avenue Ronsard Groupe Landais 411 00 Vendôme
Imprimé en France par France çtuercy
Z.A. des Grands Camps 46090 Mercuès .
Numéro d'impression: 621701 Dépôt légal: octobre 2006