Sieyès et le libéralisme étatique
-
Upload
univ-paris1 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Sieyès et le libéralisme étatique
1
Sieyès et le libéralisme : problèmes d’idées, problèmes de textes
Pierre-Yves Quiviger, Professeur de philosophie à l’Université de Nice Sophia-Antipolis, directeur du Centre de Recherches en Histoire des Idées (CRHI, EA 4318), responsable de l’axe structurant interdisciplinaire UNS/UCA « Histoire des idées, des sciences et des arts ».
1 – Sieyès et le libéralisme étatique
Au principe de toute démarche politique, il y a pour Sieyès (Fréjus 1748- Paris 1836) la satisfaction objective des besoins — cette orientation est partagée par nombre de révolutionnaires, résurgence de l’épicurisme sous une forme moderne qui est un des éléments majeurs des Lumières.
Il n’y aurait pour lui aucun sens à construire un schéma politique, et en particulier à proclamer des droits fondamentaux, sans prendre acte de cette donnée de base qu’est le besoin et la recherche de la satisfaction de ce besoin. Et ce besoin a un caractère essentiellement économique. Sieyès a étudié la pensée économique de son temps, des Physiocrates à Adam Smith, et il pense toujours la question du besoin comme une réalité économiquement quantifiable. Ainsi, dans les Délinéamens politiques, texte de jeunesse : « Le bien-être social n’est pas une chose chimérique ; il existe pour chaque homme sur ce morceau de terre une somme de jouissances proportionnée à
son travail.(…) Il ne s’agirait que de l’ordonner sur un plan qui allât à ce but1. »
On sait d’ailleurs que dans Qu’est-ce que le Tiers-état ?, Sieyès s’appuie sur l’importance économique et sociale du Tiers-état pour affirmer que celui-ci est le Tout de la Nation. Le Tiers-état est politiquement légitime et la Noblesse est politiquement illégitime, parce que le Tiers-état produit la totalité de la richesse nationale et remplit l’ensemble des missions et des services alors que la Noblesse ne fait que bénéficier, comme un parasite, de ces efforts. Pour Sieyès, le statut politique ne peut provenir que d’une contribution matérielle significative au développement économique et social de la Nation. Si la capacité politique trouve son principe et sa légitimité dans la contribution sociale et économique, on peut distinguer parmi les citoyens les seuls dont le statut social et économique rende acceptable la participation directe à l’activité politique : d’où la célèbre distinction entre citoyens actifs et passifs. Si l’on poursuit encore le schéma, et si l’on y ajoute la notion de « division du travail», avec un corps spécialisé de « politiques », on aboutit à un système dans lequel l’activité du citoyen « actif » se réduit à proposer une liste, voire à entériner
une liste officielle, dans laquelle seront prélevés les représentants2. Sieyès, jusque dans les projets
de l’an VIII, ne renoncera jamais à l’élection — mais celle-ci se mutera en « confiance » accordée plutôt qu’en choix. Cette évolution est au cœur de la notion de représentation. On le sait, selon la
distinction d’Hanna Pitkin3, la représentation est toujours tiraillée entre une représentation-
mandat et une représentation-image. Sieyès utilise l’argument de la représentation-image pour renverser l’ordre ancien (les Nobles ne sont pas à l’image de la Nation) avant, in fine, d’élaborer des systèmes électifs dont l’horizon est moins la volonté électorale que la représentativité sociologique, autre forme de représentation-image. Les listes napoléoniennes de « notabilités » ne sont ainsi pas loin car les « notables » sont probablement, selon Sieyès, parmi les citoyens les plus à même d’exprimer les intérêts socio-économiques de la Nation.
1. Premier cahier (1774/1776), Des manuscrits de Sieyès, tome 1, Honoré Champion, p. 256. 2. Voir Pierre-Yves Quiviger, « Les listes de confiance » in Revue française d’histoire des idées politiques, 38, 2013, Picard, pp. 231-240. 3. Hanna Pitkin, The Concept of Representation, University of California Press, 1967.
2
Il faut ajouter à cela que Sieyès se méfie du volontarisme juridique d’inspiration
« rousseauiste » professé par Robespierre, et Lucien Jaume4 a bien décrit son anti-volontarisme.
Stéphane Rials5 avait pour sa part pointé le rationalisme non délibératif de Sieyès, en montrant la
singularité d’une position qui tout en professant le libéralisme n’acceptait pas l’empirisme sceptique qui l’accompagne normalement et définissait la vérité politique comme unique et objective. L’anti-volontarisme s’explique par l’encadrement de la volonté politique par la Constitution. La mise en avant du jury constitutionnaire n’est pas la conséquence d’un souhait d’empiéter sur le volontarisme, comme en fait l’hypothèse Lucien Jaume, c’est plutôt l’inverse : Sieyès empiète sur l’autorité du souverain par souci de cohérence du système juridique et de modération du pouvoir de la volonté politique (en termes anachroniques, on dirait qu’il valorise le fonctionnement technocratique et libéral des institutions par crainte des dérives totalitaires qui peuvent naître d’un mode de fonctionnement démocratique non libéral). De même, si l’on ne peut que suivre Stéphane Rials dans sa description du libéralisme atypique de Sieyès, il faut reconnaître aussi l’intérêt précoce de Sieyès pour les différents régimes de contrôle de la régularité de l’action administrative — dans ses manuscrits, on le voit s’intéresser au contrôle de l’administration, à la mise en jeu de la responsabilité des fonctionnaires, au dualisme juridictionnel, tout cela aboutissant à une place importante accordée au Conseil d’État dans les projets constitutionnels de l’an VIII (cf. P.Y Quiviger, Le principe d’immanence, H. Champion, 2008).
Le souci de contrôler l’action étatique et administrative, susceptible d’abus, caractérise la pensée libérale de manière constante : elle correspond chez Sieyès à un véritable enjeu, moins, effectivement, par une attitude radicalement prudentielle conforme à la grande tradition libérale (anglaise en particulier) que par la prise en considération des effets pratiques des décisions administratives, qui traduisent finement l’interaction complexe entre l’intérêt public et les intérêts privés. D’où la primauté donnée à la figure du juge sur celle du législateur — et c’est une nouvelle fois, en caricaturant, Sieyès versus Rousseau. On rencontre ainsi chez Sieyès une synthèse classique entre la défense du gouvernement modéré et du libéralisme politique et la prise en considération des données de l’empirie juridique — avec comme originalité un tropisme vers le rationalisme objectiviste qui permet de comprendre pourquoi le libéralisme de Sieyès est un libéralisme d’État.
Sieyès est en effet une figure exemplaire de ce singulier mélange de libéralisme politique et de tropisme étatique qui caractérise aussi, par ailleurs, le droit administratif français saisi dans la longue durée. Il est par ailleurs identifié, en particulier parmi les publicistes et les historiens du droit public, comme un de ceux qui ont proposé l’introduction du contrôle de constitutionnalité dans l’ordre juridique français. Cette proposition se fait conformément à un principe simple mais central : les pouvoirs constitués ont vocation à être encadrés par le pouvoir constituant. C’est le seul moyen de mettre en place une ré-publique, c’est-à-dire quelque chose qui n’est ni une ré-privée (la monarchie absolutiste) ni une ré-totale (un totalitarisme du peuple qui ne respecte pas la sphère propre à l’individu, qu’il faut donc distinguer du citoyen. Sieyès comprend (et on le voit avec ses autres travaux, en particulier sur la police ou l’ordre judiciaire) que le contrôle de constitutionnalité n’est qu’un élément parmi d’autres d’un nécessaire contrôle général de la légalité — et en particulier de la légalité des actes administratifs, accomplis au nom de l’intérêt public, et
constituant donc une voie privilégiée d’empiètement du public sur le privé. Pasquale Pasquino6 a
établi que le pouvoir constituant ne devait pas être lu chez Sieyès comme Carl Schmitt ou
4. Lucien Jaume, « Sieyès et le sens du jury constitutionnaire : une réinterprétation », Droits, n°36, 2002, pp. 115-134. 5. Stéphane Rials, « Sieyès ou la délibération sans la prudence. Éléments pour une interprétation de la philosophie de la Révolution et de l’esprit de légicentrisme », Droits, n°13, 1991, pp. 124-138. 6. Pasquale Pasquino, Sieyès et l’invention de la constitution en France, Paris, Odile Jacob, 1998.
3
Antonio Negri7 l’ont lu, c’est-à-dire comme une espèce de décisionnisme populaire qui
renverserait tout sur son passage mais tout au contraire comme un élément de modération du régime (distinct du schéma Montesquieu/Madison de l’équilibre des pouvoirs), qui ouvre la voie au normativisme kelsenien. Une étrange circulation des idées mérite ici d’être rapidement racontée : Sieyès a été, pendant le 19ème siècle (et encore aujourd’hui d’ailleurs), une figure centrale pour la pensée juridique allemande. Traduit fort tôt, grâce à sa grande proximité avec Oelsner, lu par Kant et Hegel et commenté par ce dernier, il fait l’objet d’une reconstruction très brillante, très « idéaliste » et devient l’un de ceux qui permet aux publicistes allemands, dans un climat post-kantien et post-hégélien, d’opposer l’Idée de Nation à la matière Peuple, pour le dire de manière simplifiée. Là-dessus, un des grands professeurs de droit français de la première moitié du 20ème siècle, né à Strasbourg en 1861, agrégé en 1890, pétri de culture allemande mais dans un contexte compliqué pour l’Alsace, Raymond Carré de Malberg, s’appuie sur les publicistes allemands pour théoriser une des distinctions encore centrales aujourd’hui dans la théorie du droit public, celle qui oppose souveraineté nationale et souveraineté populaire mais, erreur interprétative géniale, il attribue cette distinction à Sieyès sur la base d’éléments textuels rarissimes et pour cause : cette théorie repose sur l’interprétation allemande des textes de Sieyès et lui attribue un idéalisme d’un type qui lui est étranger – voir là-dessus l’article décisif de Jacques Guilhaumou qui rapporte l’analyse faite par Humboldt de la pensée de Sieyès. La fin de l’histoire est ironique : Sieyès reste une figure majeure chez les publicistes français grâce, entre autres, à… une distinction de Carré de Malberg qu’il a cru lire chez Sieyès mais qui ne s’y trouve pas. Fin de l’histoire, qu’il faudrait compléter en lisant deux belles thèses malheureusement non publiées, celle de Marcelle Adler-Besse et celle de Colette Clavreul. Je reviens au libéralisme étatique.
Le libéralisme étatique dont relève Sieyès a trouvé sa meilleure analyse dans L’individu effacé de Lucien Jaume qui montre, justement, la place du dualisme juridictionnel français dans cette conception. Le « libéral individualiste » soutient qu’entre l’État et l’individu, « si la balance devait pencher plutôt d’un côté que de l’autre, il semble que ce devrait être du côté de l’intérêt
individuel, toujours plus faible et plus digne de ménagements8», tandis que le « libéral étatique »
estime que, sous réserve de respecter les droits de l’individu, l’État doit bénéficier sinon de « passe-droits » en tout cas d’exceptions et de dérogations qui se justifient par la légitimité démocratique de l’État. On pourrait objecter à ce vocabulaire, comme l’a fait Olivier Beaud dans
sa recension de l’ouvrage de Lucien Jaume9, que le terme de « libéral » est impropre pour désigner
le courant étatique — désignation qui serait plus nominale que réelle. On peut néanmoins faire valoir contre la critique d’Olivier Beaud que Lucien Jaume permet de distinguer au cœur du large courant étatiste l’exigence libérale, définissant un étatisme spécifique. On peut voir alors dans l’analyse de Lucien Jaume une dichotomie fructueuse pour la pensée de l’État — sans préjuger de la pertinence de sa taxinomie pour penser le libéralisme. Cette distinction a aussi comme vertu heuristique de rendre lisible l’inflexion entre Sieyès et Napoléon, et de comprendre certaines tensions propres au bonapartisme, qui n’est pas réductible à un autoritarisme anti-libéral et centralisateur (comme l’attestait déjà par ailleurs le contenu du Code civil).
La fracture entre libéralisme étatique et libéralisme individualiste est particulièrement sensible dans le domaine de la justice administrative. Sachant qu’il arrive que des illégalismes surviennent du fait de l’action de l’administration, il convient de déterminer si ces illégalismes doivent être jugés par le juge ordinaire ou par un juge spécifique ou par l’administration elle-même. Jacques Chevallier, dans L’élaboration historique du principe de séparation de la juridiction
7. La lecture d’Antonio Negri diffère de celle de Carl Schmitt sur un point fondamental : pour Toni Negri, le pouvoir constituant est strictement incompatible avec le concept de souveraineté nationale. Vue sous cet angle, la lecture de Toni Negri est donc plus fidèle à Sieyès que la lecture schmittienne. 8. E. Poitou, La liberté civile et le pouvoir administratif en France, p. 61, cité par Lucien Jaume, L’individu effacé, 1997, p. 371. 9. Droits, n°28, 1998, pp. 195-203.
4
administrative et de l’administration active, décrit nettement les trois positions possibles : « Jusqu’à la réforme de 1872, trois thèses se réclamant de principes opposés s’affrontent quant à l’organisation de l’autorité chargée de statuer sur les litiges administratifs. La thèse judiciaire prône l’assimilation du contentieux administratif au contentieux judiciaire, au nom de l’unité de juridiction ; la thèse administrative, s’inspirant du désormais principe classique selon lequel “juger l’administration c’est encore administrer”, souhaite le maintien du statu quo et du rattachement de la juridiction administrative à l’administration active ; enfin, la troisième, que nous appelons “quasi-judiciaire”, désire maintenir l’existence d’une juridiction administrative distincte de la juridiction judiciaire, mais en lui conférant les mêmes garanties d’organisation et de procédure : elle s’inspire implicitement de l’idée de séparation de la juridiction administrative et de l’administration active, sans toujours l’ériger à la hauteur d’un
principe10
. »
Sieyès pose ainsi le problème dans le quatrième Cahier des Délinéamens politiques :
« L’exécution de la loi est nécessairement despotique. Elle l’est plus encore dans une constitution libre où l’exécuteur ne peut être qu’un instrument fidèle que dans les pays esclaves où les exceptions dépendent de celui qui ordonne l’exécution. Or l’exécution n’est assurée qu’autant 1e que ses agents ont entre les mains des moyens de
force toujours suffisants, des moyens toujours irrésistibles et 2° que la dernière application de ces moyens est livrée à l’arbitraire dans tous les cas de résistance arbitraire, sans quoi il faudrait un pouvoir législatif à côté de chaque commission exécutive.
Un arbitraire final se retrouve dans l’exercice du pouvoir administratif ; mais là il porte sur les choses plus que sur les personnes.
Pour soustraire la liberté à l’arbitraire, qu’on ne peut empêcher, on a imaginé de l’abandonner aux pairs de celui sur qui on l’exerce. De là les jurys dans l’ordre de la juridiction.
Si on n’en a pas fait autant pour toutes les autres branches du pouvoir actif c’est : 1e qu’un établissement eût été trop long, trop lent et plein d’inconvénients. C’est 2e parce que l’obéissance provisoire doit être dans tous les cas un sacrifice qu’exige l’intérêt général de tous les individus raisonnables. Aussi faut-il en faire une loi. 3e enfin, c’est qu’après l’obéissance provisoire on peut établir une contestation juridique et qu’ainsi on finit toujours par voir l’arbitraire provisoirement obligatoire soumis enfin à la décision définitive des jurys et par conséquent du seul remède qu’il a été possible de trouver contre la nécessité d’un arbitraire dans l’état social le plus libre. Cependant j’ai laissé le jugement de ces sortes de constitutions aux tribunaux politiques ; n’y a-t-il pas quelque
chose à revoir11
dans leur formation12
? »
L’argument semble paradoxal : le despotisme exécutif serait la conséquence de la liberté politique. Pourquoi ? Parce que le « despotisme » résulte de l’égalité devant la loi. Quand le peuple est à l’origine de la loi, il raisonne (comme l’a montré Rousseau dans le Contrat social) par lois générales qui s’appliquent à tout le monde sans exception — dans un régime de Ré-privée, selon le vocable sieyèsien exposé plus haut, le despote est maître de construire des régimes d’exemption, de privilèges nominaux, etc. Comment obtenir cette généralité dans l’application sinon, selon Sieyès, en anéantissant la capacité d’appréciation et de singularisation de celui qui applique la loi ? Le « despotisme » évoqué par Sieyès est précisément ce qui permet d’éviter le despotisme de la décision d’application ou de non-application « à la tête du client », pour ainsi dire. Sieyès n’exclut d’ailleurs pas conceptuellement le recours à ce « juge de la non-application despotique » — mais comme, en l’espèce, il s’agirait du législateur représentant du peuple, cela reviendrait à doubler toute la pyramide exécutive et administrative d’un législateur, ce qui est in concreto impossible (et absurde).
10. Jacques Chevallier, L’élaboration historique du principe de séparation de la juridiction administrative et de l’administration active, LGDJ, 1970, p. 317. 11. En effet, dans son projet de l’an VIII, Sieyès confie au Conseil d’État et non plus aux tribunaux politiques le jugement de ces dysfonctionnements administratifs. 12. Des manuscrits de Sieyès, tome 1, Honoré Champion, pp. 343-344.
5
Sieyès estime donc que ce « despotisme », arbitre aveugle comme la justice, est non seulement nécessaire mais est la condition de possibilité de l’égalité devant (l’application de) la lo i. Cette égalité de principe devant la loi a néanmoins malheureusement vocation à rencontrer des exceptions dans son application, résurgences locales de pouvoirs despotiques locaux. Sieyès rappelle que ce problème a été en grande partie réglé par la mise en place de contrôles hiérarchiques : sont organisées des commissions disciplinaires chargées de vérifier, qu’il s’agisse de la magistrature, des ministres, des fonctionnaires, que les différents acteurs de l’établissement public accomplissent bien leur mission. Néanmoins, il est impossible de contrôler en permanence, par la seule logique hiérarchique et disciplinaire, que tous les agents remplissent leur fonction. L’argument est connu et trivial : s’il faut placer un « inspecteur » derrière chaque agent, cela revient à doubler le nombre d’agents ; par ailleurs, qui inspectera l’inspecteur (« Quis custodiet ipsos custodes », qui garde les gardiens ?, selon la célèbre formule de Juvénal) ? On risquerait la paralysie complète de l’action publique, et cela au prix d’un coût aussi déraisonnable qu’inutile. L’inutilité est par ailleurs redoublée par l’absurdité juridique que représenterait un tel dispositif. Sieyès rappelle que le droit doit nécessairement, pour être efficace, être soumis à un régime d’obéissance préalable que Sieyès, en libéral, formule en termes d’obéissance provisoire, conscient de l’éventuelle caducité ultérieure de cette obéissance. Il n’en demeure pas moins que tout système d’organisation collective (même minimale) des relations sociales — ce que le droit est, entre autres choses — est par définition d’obéissance préalable. Un régime d’obéissance postérieure, c’est-à-dire après discussion, argumentation, débat, est proprement impossible et impraticable. Il ne s’agit pas de considérer comme dérisoires les mécanismes de justification de l’action publique (ainsi, dans certains cas, de la production d’un document signé par un juge pour pouvoir procéder à saisie, ou de la présentation d’une carte professionnelle, etc.) mais de raisonner par l’absurde en se demandant comment, pratiquement, pourrait exister un ordre juridique public ne bénéficiant pas de l’obéissance préalable. On imagine la série infinie de palabres, la lenteur et, au bout du compte, la paralysie de toute vie sociale… La transformation du « préalable » en « provisoire » proposée par Sieyès est très fructueuse puisqu’elle revient à indiquer qu’il n’y a pas un droit irréversible de la puissance publique et administrative à être obéie, mais simplement une convention, nécessaire et temporellement encadrée. Le caractère provisoire de cette obéissance ouvre la voie à une contestation juridique ex post en même temps qu’elle la ferme ex ante, d’où les profondes réserves de Sieyès par rapport à un éventuel « droit de résistance » ou à l’insurrection dans un contexte constitutionnel légitime.
Pour Sieyès, dans un État correctement constitué juridiquement, il n’y a presque aucune place pour l’insurrection (il ne faut jamais perdre de vue que pour Sieyès la France d’après 1789 est sans commune mesure avec celle d’avant 1789). Précisément parce qu’il y a toute place pour la contestation juridique de la légalité des actes étatiques, et en particulier des actes administratifs. D’où l’extraordinaire importance du Conseil d’État dans les projets de constitution de l’an VIII pour Sieyès. Constituer un jury administratif spécifique revient à consacrer, d’une part, le contrôle de l’action de l’administration — orientation libérale, qui soumet l’action étatique à évaluation, contestation, etc. — mais revient aussi, d’autre part, et en même temps, à ne pas la soumettre au juge ordinaire. Sieyès refuse le juge ordinaire comme juge de l’administration, et il semble prendre position en faveur d’un jury composé de membres de l’administration active — mais un jury néanmoins distinct. Le Conseil d’État va permettre de réaliser pleinement à la fois la distinction organique (le Conseil d’État, en temps qu’institution et que corps de fonctionnaires — les conseillers d’État), le contrôle ex post général de la légalité des actes de l’administration et la participation à l’administration, ou plus exactement au gouvernement (conseil, rédaction et interprétation des lois). Dans l’esprit de Sieyès, le Conseil d’État est ainsi à l’abri de la
6
contradiction qu’un libéralisme plus net pourrait lui opposer, car c’est en tant que conseil qu’il relève de l’administration active, nullement en tant que juge. Il est l’accomplissement parfait de l’étrange rêve sieyèsien d’un État ultimement technocratique — il a rêvé et souhaité ce qui est, pour beaucoup, politiquement, un cauchemar, le cauchemar d’aujourd’hui.
2 – Lire Sieyès aujourd’hui ?
Je voudrais maintenant revenir un peu sur la place de Sieyès dans l’histoire des idées politiques et juridiques, à travers des questions éditoriales car je crois que la question des corpus et de leur accessibilité est au cœur des problématiques d’histoire des idées, et particulièrement dans le contexte des humanités numériques. La perception que nous avons aujourd’hui de l’œuvre de Sieyès a été largement modifiée par la réapparition, en 1967, de ses manuscrits, que Sainte-Beuve avait pu consulter mais qui, depuis le milieu du XIXème siècle avaient disparu. Ces manuscrits, consultables aux Archives nationales13, sous la côte 284 AP, même s’ils sont très probablement incomplets, mettent en valeur trois aspects de la réflexion de Sieyès : 1) les projets de constitution, très nombreux, en particulier en l’an III et en l’an VIII, parfois esquissés, parfois développés très longuement – à cela il faut ajouter les projets de déclaration et les listes de principes fondamentaux (ainsi le texte intitulé Bases de l’ordre social, publié par Pasquale Pasquino dans Sieyès et l’invention de la constitution en France (Odile Jacob, 1998) puis par Christine Fauré dans le volume Des manuscrits de Sieyès 1773-1799 (Honoré Champion, 1999)) ; 2) les réflexions linguistiques14 : avec d’une part un important travail néologique, comprenant de nombreuses pages de recherche autour d’un terme (entre cent autres : « société » qui le conduit à forger le terme « sociologie », avant Auguste Comte comme l’a signalé Jacques Guilhaumou15) mais aussi des recherches sur le rôle de la langue dans l’activité spéculative comme dans l’activité normative ; 3) enfin, et c’est le plus surprenant, un important volume de travaux métaphysiques, relevant du champ classique de la philosophie, sans allusions, sinon obliques, à des enjeux politiques ou juridiques : ces réflexions encadrent, pour ainsi dire, la carrière politique de Sieyès, puisqu’elles proviennent soit des années 1770-178016, soit des années 1800 et suivantes.
Le dernier de ces trois points permet de mieux comprendre les références insistantes de Sieyès à la métaphysique, et à son statut supposé de métaphysicien : il n’est pas faux d’y voir des réponses à des attaques, « métaphysicien » signifiant dans la bouche de ses adversaires « compliqué », « abstrait », « embrouillé », « irréaliste », « naïf », « religieux », « superstitieux », ou plus exactement, signifiant l’addition de toutes ces « qualités », selon un dosage représentatif des manies du contradicteur. Mais cette explication est insuffisante car Sieyès assume cette étiquette, dès ses premiers textes, et cherche à montrer que ses adversaires ignorent non seulement ce qu’est la métaphysique mais aussi quelle est sa valeur épistémologique dans les domaines juridiques et politiques. Cette valeur est d’autant plus nette aux yeux de Sieyès que le terme « métaphysique » ne renvoie pas pour lui à une transcendance mais, à l’image de ce que Condillac
13 Face à une telle abondance de sources inédites, on regrette toujours qu’il n’existe aucun projet de mise en ligne, sur Internet, de fichiers-images reproduisant le contenu de ces cartons. 14 Sur cette question, les travaux les plus solides et les plus originaux sont ceux de Jacques Guilhaumou, en particulier dans son livre Sieyès et l’ordre de la langue (Kimé, 2002) ; on consultera aussi, pour une approche plus centrée sur la rhétorique, l’article d’Eric Avocat, « Sieyès orateur à l’Assemblée Constituante. Aventures et mésaventures rhétoriques de la langue philosophique » in P.Y. Quiviger, J. Salem, V. Denis (éds), Figures de Sieyès (Publications de la Sorbonne, à paraître en 2007) ; voir enfin, pour une approche historique marquée par Jacques Derrida : William Sewell, A Rhetoric of Bourgeois Revolution. The Abbé Sieyès and What is the Third Estate ? (Duke University Press, 1994). 15 Voir son article « Sieyès et le non-dit de la sociologie : du mot à la chose », Revue d’histoire des sciences humaines, 15, 2006. 16 Le texte le plus important et le plus volumineux de cette période est intitulé Grand cahier métaphysique et a été publié et présenté par Jacques Guilhaumou dans le volume Des manuscrits de Sieyès, dirigé par Christine Fauré, op. cit., p. 49-166.
7
avance dans son Essai sur l’origine des connaissances humaines17 (1746) à l’analyse des représentations communes à l’ensemble des sujets : métaphysique signifie alors « exploration de l’esprit ». Condillac écrit ainsi :
Soit que nous nous élevions, pour parler métaphoriquement, jusque dans les cieux ; soit que nous descendions dans les abymes ; nous ne sortons point de nous-mêmes ; et ce n’est jamais que notre propre pensée que nous apercevons.18
Dans les textes directement politiques ou juridiques de Sieyès, cet affleurement de la métaphysique, va témoigner d’un souci d’articuler trois choses : la vérité objective (il y a chez Sieyès un rationalisme très net, qui le rend assez largement incapable de scepticisme, de relativisme, de pluralisme19 : il ne croit pas qu’il puisse y avoir plusieurs « meilleure constitution possible » pour une même Nation), la recherche des principes fondamentaux ou premiers (il décrit ainsi une liaison entre la Constitution, les droits de l’homme et l’équité, liaison abusivement et confusément évidente pour nos contemporains mais qui, à nombre de contemporains de Sieyès, semblait une bizarrerie), et enfin, une attention à ce qu’on peut appeler la commun-auté, c’est-à-dire une vision de la société qui met en valeur la catégorie du « commun », à la fois comme instrument négatif (le privilégié est celui qui sort du commun, qui refuse le sort commun) et comme instrument positif (la construction juridique de l’ « ordre social », pour prendre une formule chère à Sieyès, suppose la mise en place d’un plus petit commun dénominateur en matières de droits, de propriété, de statut, etc – mais au-delà de ce « ppcd », il ne saurait y avoir de contrôle du commerce et des richesses, de limitations, car Sieyès demeure profondément attaché au libéralisme).
La connaissance des manuscrits, que les deux tomes édités sous la direction de Christine Fauré ont permis de diffuser au-delà du cercle des spécialistes, doit donc conduire à réévaluer l’œuvre imprimée de Sieyès. Cela suppose que ces textes soient accessibles. Or l’image politique complexe de Sieyès, trop révolutionnaire pour les conservateurs, et trop libéral pour les révolutionnaires, a conduit l’historiographie française à le négliger (avant les livres de Pasquale Pasquino, en 1998, de Jacques Guilhaumou en 2002 et d’Erwan Sommerer en 2011, le vingtième siècle n’avait connu que quatre travaux d’importance sur Sieyès : les thèses de Paul Bastid20, en 1939, de Marcelle Adler-Bresse en 1977, de Colette Clavreul21, en 1982, ces deux dernières restant malheureusement encore inédites, et la biographie de Jean-Denis Bredin22). Sieyès a fait (un peu) plus régulièrement l’objet de travaux en langue anglaise et en langue allemande (les plus récents
17 André Charrak a proposé un commentaire de référence de cet ouvrage sous le titre Empirisme et métaphysique (Vrin, 2003). 18 Partie I, section I, chapitre I, § 1. 19 Voir l’article de Stéphane Rials, « Sieyès ou la délibération sans la prudence. Eléments pour une interprétation de la philosophie de la Révolution et de l’esprit de légicentrisme », Droits, n° 13, 1991, p. 124-138. L’origine de ce « scientisme » paraît être la lecture des Physiocrates, d’une part (voir sur ce point : Catherine Larrère, « Sieyès lecteur des physiocrates : droit naturel ou économie ? » in Figures de Sieyès, op. cit. ainsi que son ouvrage L’invention de l’économie au XVIIIème siècle (PUF, 1992) ; voir aussi Marc Lahmer, « La doctrine physiocratique du contrôle juridictionnel de la loi positive », Giornale di storia costituzionale n°4/II semestre 2002, p. 125-144) et d’autre part Spinoza (voir dans le volume Figures de Sieyès, op. cit., l’article de Christine Fauré « Sieyès, Rousseau et la théorie du contrat », ainsi que ma contribution, sous le titre « Spinoza et Sieyès ».
20 Sieyès et sa pensée, Hachette, 1939, réédition augmentée en 1970. 21 L’influence de la théorie d’Emmanuel Sieyès sur les origines de la représentation en droit public, Paris I, deux tomes, dactylographiée, 666 p. 22 Sieyès. La clé de la Révolution française, De Fallois, 1988.
8
sont : Murray Forsyth, Reason and Revolution (Leicester University Press, 1987), William Sewell, A Rhetoric of Bourgois Revolution (Duke University Press, 1994), Thomas Haffen, Staat, Gesellschaft und Bürger im Denken von Emmanuel Joseph Sieyes (Paul Haupt, 1994), Alois Riklin, Emmanuel Joseph Sieyès und die Franzosische Revolution (Wallstein, 2001), Ramon Maiz, Nacion y Revolucion (Tecnos Editorial, 2007), Marco Goldoni, La dottrina costituzionale di Sieyes (Firenze University Press, 2009)). Cette négligence s’est traduite de façon encore plus flagrante sur le plan des éditions des œuvres de Sieyès23 : la première (et dernière à ce jour) publication des œuvres complètes de Sieyès en langue française est due à Cramer, en 1796, sous le titre Collection des écrits d’Emmanuel Sieyès ; cette édition, comprenant de trop nombreuses coquilles, porte, à partir du second tirage, la mention, exigée par Sieyès pour que les lecteurs français ne lui attribuent pas ces fautes, « édition à l’usage de l’Allemagne ». Ce volume, qui était le premier de plusieurs tomes annoncés qui n’ont jamais vu le jour, ne comprend que quatre œuvres de Sieyès : les Vues sur les moyens d’exécution dont les représentants de la France pourront disposer en 1789, l’Essai sur les privilèges, Qu’est-ce que le Tiers-Etat ? et les Délibérations à prendre dans les Assemblées des Baillages. Depuis 1796, il n’y a rien eu d’autre, sinon trois volumes, précieux pour les chercheurs, regroupant en fac-similé, en 1989, à l’initiative de Marcel Dorigny, chez EDHIS, l’ensemble des imprimés de Sieyès – ces volumes sont aujourd’hui épuisés mais une partie d’entre eux est accessible sur www.gallica.fr et la totalité sur la base de données (payante) FRANTEXT. Pour trouver une véritable édition complète des imprimés de Sieyès, il faut se procurer l’édition italienne, en langue italienne et sans les textes originaux, chez Giuffré24. Le seul texte relativement commode d’accès en France est Qu’est-ce que le tiers-état ? On en trouve en effet une édition dans la collection « Champs-Flammarion » (édition de Jean-Denis Bredin), dans la collection « Quadrige » des PUF (reprint de l’édition Champion/Aulard de 1888, précédée d’une préface de Jean Tulard, elle aussi épuisée à ce jour). Le lecteur soucieux de lire ce texte célèbre aura avantage à se tourner vers l’édition critique de Roberto Zapperi chez Droz (1970) qui, d’une part, figure encore au catalogue de l’éditeur, et d’autre part, est un modèle d’acribie et de probité philologique (la préface, plus contestable, présente une lecture personnelle de l’œuvre de Sieyès, à l’image de celle conduite dans Per la critica del concetto di rivoluzione borghese (De Donato, 1974)). Roberto Zapperi a rassemblé quelques textes imprimés importants de Sieyès, en y joignant quelques pages inédites tirées des manuscrits de jeunesse, dans un volume intitulé Ecrits politiques, aux éditions EAC, en 1985. Ce volume commode ne présente malheureusement aucune variante ni commentaire, sinon une brève préface.
Sieyès est un peu responsable de cet échec. Incapacité à achever définitivement un ouvrage – pris dans un jeu infini de réécriture à la recherche de l’expression parfaite (c’est-à-dire la moins équivoque et la plus expressive, nullement la plus belle ou la plus élégante), Sieyès s’est découragé en chemin et a abandonné des centaines de projets, parfois très avancés, comme on le voit en parcourant les manuscrits. Quand, enfin, il a pu remettre un manuscrit à un éditeur, chaque réédition a été l’occasion de remords assez vifs, conduisant à des ajouts parfois considérables mais aussi à des modifications dérisoires, de pur style, ajoutant ou retranchant une virgule ou un point d’exclamation.
Si l’on essaie de dresser un tableau intellectuel de l’œuvre de Sieyès et de son apport à la question du libéralisme, trois moments me paraissent isolables, via trois oeuvres. L’Essai sur les privilèges de novembre 1788 marque l’entrée sur la scène publique de l’abbé Sieyès, encore anonyme (la seconde édition sera tout aussi anonyme, Sieyès revendiquant l’Essai à partir de la troisième édition de Qu’est-ce que le tiers-état ? puisque cet écrit y est dit « servir de suite à l’Essai »). Ce texte n’est pas le premier écrit par Sieyès à fin de publication puisqu’il a auparavant rédigé une Lettre aux économistes, finalement non éditée, mais aussi les Vues sur les moyens d’exécution… qui ne
23 Par esprit de contraste, on peut remarquer que les Œuvres complètes de Robespierre de Saint-Just sont, elles, éditées. 24 Opere et testimonianze politische, a cura di Pasquale Pasquino e Giovana Stroisi Spagnoli, 1993.
9
paraissent qu’après l’Essai. Ce livre est par bien des aspects un pamphlet au style mordant, ne s’embarrassant pas de détails. L’atmosphère de « fin de règne » y est particulièrement sensible et l’on s’est souvent étonné qu’un tel texte ait tout simplement pu paraître dans la France de Louis XVI. C’est dans un tout autre contexte (on peine à imaginer qu’il y ait à peine six mois entre les deux ouvrages) qu’apparaît la contribution de Sieyès au projet de déclaration des droits de l’homme et du citoyen à l’été 1789 – grande figure du moment, pénétré de références philosophiques partagées par nombre de révolutionnaires (l’empreinte lockéenne est forte dans ce texte), Sieyès paraît néanmoins déjà en décalage sur la forme, avec ce long exposé préliminaire qui n’est pas compris par les contemporains, et sur le fond, car Locke se combine chez lui avec l’apport de la physiocratie et de Spinoza et le refus des thèses de Rousseau et de Montesquieu. Ce texte qui, par certains passages, semble s’inscrire dans le jusnaturalisme moderne, surprend par des accents positivistes tout aussi nets (Michel Villey nous a bien appris que c’était au fond la même chose, mais cet ouvrage est justement une étape sensible de ce processus d’identification, puisque c’est un des lieux d’épanouissement de ce constitutionnalisme moderne qu’Olivier Beaud a fort bien décrit dans l’article « Constitution et droit constitutionnel » du Dictionnaire de la culture juridique (Denis Alland et Stéphane Rials éds, PUF, 2003) - horizon où règne la plus grande confusion entre la notion de constitution (versant positiviste) et la notion de droits de l’homme (versant jusnaturalisme moderne)). Enfin, troisième moment tout aussi isolable, les deux Opinons de l’an III : Sieyès qui s’est habilement tenu à l’écart de la grande agitation qui traverse la France après 1791 essaie de revenir jouer un rôle et imagine donner à la nation sa nouvelle Constitution : la maladresse radicale de Sieyès, combinée avec une configuration politique défavorable, réduiront ces espoirs à néant jusqu’en 1799 (où l’échec sieyèsien est moins patent que ce que l’ont dit souvent) – Marc Lahmer a décrit merveilleusement les raisons de cet échec25. Dans ces textes, le « philosophe » Sieyès laisse largement la place au « juriste » Sieyès ; il s’agit moins pour lui d’insister sur les grands principes, sur les concepts fondamentaux – il estime les avoir déjà formulés dès 1788, inutile de se répéter ! – que de présenter un modèle constitutionnel opératoire. En lisant ces deux opinions, on voit qu’il y a une marge non négligeable entre l’intention de Sieyès et ce qu’il donne à entendre et à lire à ses contemporains. Sieyès reste une tête déraisonnablement théorique et abstraite – et c’est probablement le théoricien plus que l’historien du droit qui trouvera aujourd’hui de l’intérêt à ces textes (quant au praticien, on imagine qu’il risque d’être aussi effaré que les députés présents lors de la lecture par Sieyès de ses deux discours ; on vit ainsi paraître le 5 thermidor un pamphlet signé J.R.L. intitulé Le plan de Scyès ne s’entend pas, comme le rappelle Marc Lahmer). On est alors fort loin de l’abbé luttant contre les privilèges dans un style vif et « populaire » pour ainsi dire.
Et pourtant, la continuité est évidente entre ces trois moments. En 1788, il s’agit de dénoncer l’absence de toute communauté, de tout régime commun du droit ; cette position essentiellement réactive, critique, révolutionnaire appelle nécessairement, dès lors que les conditions d’un nouvel ordre social semblent réunies, une phase déclarative, de « reconnaissance » sur fond d’ « exposition raisonnée » des droits qui vont être communs à l’ensemble des hommes et des citoyens. C’est ce que cherche à réaliser le texte de 1789. Ensuite, en l’an III, une fois cette déclaration consacrée, et cette « commun-auté » constituée, il s’agit d’inventer les normes de droit public susceptibles de les pérenniser et de les garantir. Dans l’esprit de Sieyès, cela se fait par un processus d’essence juridictionnelle, qui comprend trois visages, trois jugements : juger la conformité de l’activité législative aux règles constitutionnelles (avec la possibilité d’une cassation en cas de non-conformité) ; juger la conformité de la constitution à la société qu’elle organise, avec la possibilité, le cas échéant d’une révision de cette constitution ; juger enfin du respect de l’équité, en particulier dans tous les cas où le fonctionnement normal des institutions conduirait à des situations inéquitables. Ces trois fonctions vont être confiées à une seule et même institution,
25 « Sieyès lors des débats constituants en l’an III : autopsie d’un échec » in Figures de Sieyès, op. cit.
10
le jury constitutionnaire, dont la fonction générale pourrait être décrite simplement en parlant d’un contrôle du respect par les producteurs de la règle commune de ce qui est à l’origine de la règle commune26.
Je voudrais revenir un peu plus en détail sur les textes de 1789 et de l’an III. Le texte de 1789 est pris dans un réseau de réminiscences évidentes : Locke (les lignes consacrées au rôle du travail dans l’appropriation sont largement démarquées du second Traité mais elles ne sont pas les seules - le livre de Jean-Fabien Spitz, John Locke et les fondements de la liberté individuelle27 montre fort bien la continuité philosophique entre Locke et Sieyès), Spinoza (l’insistance sur la question de l’utilité, le rationalisme juridique sur fonds de métaphysique matérialiste, l’importance de la force pour suppléer le droit), les Physiocrates (l’articulation de l’économique et du social, la mise en valeur de l’articulation besoins/moyens, la continuité nature/société), et l’on pourrait, avec une petite dose de mauvaise foi, le transformer en une manière de centon faiblement structuré. Mais cela n’épuiserait pas la richesse d’un texte que Sieyès considère comme une étape décisive de sa réflexion. Il intègre du reste dans ses Observations préliminaire au … Préliminaire un résumé de son travail antérieur :
quand on a parlé pour la première fois, d’une Constitution Nationale à donner à la France, c’étoit de la métaphysique. Quand on a démontré que le Pouvoir Législatif appartenoit à la Nation et non au Roi, c’était de la métaphysique. Quand on a voulu voir dans les Députés aux Etats-Généraux, de vrais Représentans, et qu’on a tiré de ce mot si fécond, les vérités les plus utiles, c’étoit de la métaphysique. Quand on a, pour la première fois, distingué le Pouvoir Constituant des Pouvoirs constitués, et en particulier du Pouvoir Législatif, c’étoit de la métaphysique. Quand on a osé attaquer tous les Priviléges à-la-fois, dans un temps où il étoit honteux de n’être pas Privilégié, c’étoit de la métaphysique. Quand au milieu d’une dispute de proportion entre les Ordres, on a tout-à-coup dénoncé la distinction des Ordres, comme l’absurdité la plus révoltante et la plus pernicieuse à tout État social, c’étoit de la métaphysique. Quand on s’est fait la question : Qu’est-ce que le Tiers-État ? La réponse a paru de la métaphysique. Quand, dans un pays où 26 millions d’Habitans étoient moins que rien aux yeux de 200 mille individus, on a professé l’égalité personnelle, celle des Droits civils, et qu’on a réclamé l’égalité non moins importante des Droits politiques, c’étoit de la métaphysique. Quand on a dit qu’une Nation libre étoit composée de Citoyens et non de Vassaux et de Seigneurs ; quand on s’est étonné qu’une fonction publique pût être regardée comme une propriété, c’était de la métaphysique. Quand on a prononcé le nom d’Assemblée Nationale, et qu’on l’a considérée comme préférable aux Etats-généraux de France, c’étoit de la métaphysique. Quand les Députés du Tiers-État, devenus Députés des Communes, se sont ensuite regardés comme la Nation, et se sont constitués en Assemblée Nationale, c’étoit de la métaphysique.
Loin d’estimer qu’est déjà venue l’heure du bilan, en cet été 1789, Sieyès, afin de proposer, s’appuie sur ce qu’il a déjà obtenu alors même que cela semblait inconcevable, ou plutôt purement idéaliste, quelques mois auparavant. L’usage du terme « métaphysique » est ici très habile, Sieyès jouant,
26 Avant de présenter chacun des textes, un mot sur deux sources assez surprenantes : les deux anthologies commentées de textes de Sieyès parues anonymement en l’an VIII. 27 PUF, 2001.
11
pour ainsi dire, « sur les deux tableaux » et semblant dire : vous me traitez de métaphysicien pour condamner mes idées, et pourtant les idées que vous jugiez auparavant métaphysiques sont désormais communes et acceptées ; vous avez donc bien raison de me dire métaphysicien, mais tort d’y voir une insulte ! Sieyès reprend donc son travail au point où il l’a laissé et entreprend ici ce qu’il avait fait en 1788 en rédigeant les Vues sur les moyens d’exécution…, premier élément de la trilogie complétée par l’Essai sur les privilèges et Qu’est-ce que le tiers-état ?, à savoir une traduction juridique des principes découverts par la métaphysique politique. Cette « traduction » mérite d’être retenue pour deux distinctions, préfigurant deux distinctions aujourd’hui usuelles, quoique contestées et contestables : la distinction droits civils/droits politiques et la distinction droit-liberté/droit-créance.
La distinction des droits civils et des droits politiques était déjà présente dans Qu’est-ce que le tiers-état ? Elle est ici clairement exposée à travers un vocabulaire un peu flottant : Sieyès parle de droits passifs/droits actifs, de droits naturels et civils/droits politiques, il parle aussi de citoyens passifs et de citoyens actifs et c’est surtout cette distinction qui a marqué ses contemporains entraînant un contresens, ou au moins une mécompréhension. En effet, pour Sieyès, cette « passivité » a tout d’abord un caractère temporaire : pour les enfants, c’est évident, mais aussi pour les femmes et les inactifs, car le développement social et économique permet d’envisager, à terme, leur intégration à l’ « établissement public » et donc une citoyenneté « active ». L’exclusion des « étrangers » de la citoyenneté active est plus difficilement justifiable selon les critères de Sieyès, dans la mesure où ils participeraient à l’activité économique : c’est un point où, à l’évidence, Sieyès replie sa vision originale de la citoyenneté sur la vision traditionnelle de la nationalité, ce qui est aussi compréhensible qu’inconséquent. Mais le caractère temporaire n’est pas le seul aspect négligé par les contemporains de Sieyès dans cette distinction : ils ont aussi oublié que ces droits civils ou passifs étaient véritablement des droits et ne se réduisaient pas à une version tronquée des « véritables » droits complets que seraient les « droits politiques ».
D’une part, les droits civils et politiques sont de nature et de destination différentes ; Sieyès parle des premiers comme de droits « pour le maintien & le développement desquels la société est formée » et des seconds comme de droits « par lesquels la société se forme & se maintient ». Les droits civils constituent donc la finalité, l’objectif du système juridique et les droits politiques n’en constituent qu’un moyen : le citoyen passif n’a donc pas moins de droits que le citoyen actif, puisqu’il a autant de libertés, de respect de sa propriété, de sa sécurité, que le citoyen actif et que le système juridique se résume à cela pour Sieyès. Si l’on pousse le raisonnement jusqu’au bout, ce que Sieyès s’interdit de faire, pour des raisons évidentes, le système de l’Ancien Régime aurait pu fonctionner s’il avait su garantir efficacement les droits civils et naturels de tous les sujets, et donner à la France une constitution et une déclaration des droits maintenant l’ensemble de ces droits. Dans les projets de constitution de l’an VIII, Sieyès s’approchera d’une telle conception, en réduisant fortement la participation politique des citoyens qui se contenteront de choisir leurs représentants au stade communal, sans voter pour les échelons supérieurs. En 1789, Sieyès, qui n’a pas encore été traumatisé par l’épisode de la Terreur, reste viscéralement attaché aux droits politiques partagés par le plus grand nombre de citoyens et il défend avec acharnement l’idée d’égalité des droits politiques, difficilement compatible avec les schémas de l’an VIII.
D’autre part, et c’est un point moins évident, les citoyens passifs ont des droits politiques, même s’ils n’ont pas de droits électifs. Ils ont des droits politiques passifs et à plusieurs titres : tout d’abord, dans la perspective de Sieyès, à l’exclusion des femmes, des enfants et des étrangers, la condition d’entrée dans la citoyenneté active se réduit à l’entrée dans ce qu’on appellerait aujourd’hui la « vie active » - c’est un droit au sens où est garanti qu’on n’opposera pas un autre critère que celui du travail (par exemple : un titre ou un cens) à la possession de ces droits actifs. Ensuite, certains droits civils touchent à la question politique sans être des droits politiques
12
actifs : la liberté d’expression, la liberté de la presse et la possibilité de faire circuler les idées, par lettres privées comme par des écrits publics (Sieyès détaille cette liberté, de manière presque excessive, dans son projet de déclaration). Les citoyens passifs bénéficiant tous pleinement de ces droits peuvent intervenir dans le champ politique et modifier l’opinion des citoyens actifs ; certes, c’est une intervention médiate, incertaine, qui dépend du bon vouloir des citoyens actifs à se laisser persuader, mais cela permet de nuancer l’idée d’une absence absolue de droits politiques pour les citoyens passifs.
Passons maintenant à l’autre distinction : celle des droits libertés et des droits créances. On attribue parfois à Sieyès l’invention de cette distinction. C’est peut-être vrai pour la chose, mais sûrement pas pour le mot. Ce qui est assuré, c’est la description par Sieyès, en deux endroits éloignés de son projet de Déclaration, de deux registres de droits. Il n’indique pas explicitement que ces droits seraient de nature différente. Néanmoins, leur place dans le projet, ainsi que les articles qui les entourent, conduisent à penser que pour Sieyès, il s’agit bien de deux types de droits. Les articles VI à X décrivent les droits issus des « facultés naturelles » de l’homme et circonscrivent assez clairement le territoire de ce qu’on peut appeler des droits libertés, soit des droits de faire quelque chose – le terme de « faculté » étant ici parfaitement adéquat, car il renvoie à ce qu’on peut appeler un espace des possibles. Ces articles interviennent après des développements touchant à l’état de nature, à la personne et ses propriétés, etc. Les articles XXVI :
Tout citoyen a droit aux avantages communs qui peuvent naître de l’état de société
et XXVII :
Tout citoyen qui est dans l’impuissance de pourvoir à ses besoins, ou qui ne trouve pas du travail, a droit au secours de la société, en se soumettant à ses ordres
semblent eux relever d’une toute autre perspective, et il n’est pas évident que Sieyès considère ici qu’il traite encore des « droits civils et naturels » : d’ailleurs, ces deux articles interviennent après des articles concernant la justice, les ordres illégaux et l’égalité plutôt que la liberté. On rapprochera plus volontiers l’article XXVII de l’article XLI :
Quant aux charités publiques, il est évident qu’elles ne doivent être répandues que sur des personnes qui sont dans une impuissance réelle de pourvoir à leurs besoins ; & il faut entendre, par ce mot, les besoins naturels, & non des besoins de vanité ; car il n’entrera jamais dans l’intention des contribuables, de se priver quelquefois même d’une partie de leur nécessaire, pour fournir au luxe d’un pensionnaire de l’Etat. Il faut encore que les secours de charité cessent, au moment où finit l’impuissance qui les justifioit.
plutôt que des articles VI à IX. L’article XXVII est d’ailleurs un article important pour Sieyès, puisqu’il en donne plusieurs versions ; la première rédaction indique : « Tout citoyen qui est dans
13
l’impuissance de pourvoir à ses besoins, a droit aux secours de ses concitoyens » et la seconde rédaction parle de « secours publics ». L’ajout de l’incise « ou qui ne trouve pas du travail » ainsi que l’abandon de la référence à une solidarité des concitoyens au bénéfice de la société, assortie de la contrainte du respect des ordres de cette même société sont signifiantes. Cette triple modification est très expressive : pour la première, elle montre que Sieyès envisage une possible inefficacité du mécanisme de l’offre et de la demande du travail, alors que dans la première étape de sa réflexion, il ne voyait pas d’autre source à l’inactivité que l’incapacité à travailler. Mais si cela nous informe sur un relatif effritement du libéralisme économique de Sieyès, cela ne nous aide pas à comprendre sa vision du droit créance. La seconde variante est plus utile car elle montre que pour Sieyès les mécanismes de solidarité sociale ou de « charités publiques » ne relèvent pas d’une solidarité horizontale mais d’une solidarité verticale : l’abandon de la référence aux concitoyens prouve que Sieyès refuse l’idée d’une obligation juridique de solidarité entre citoyens. Si mon voisin ne trouve pas de travail et ne peut s’acheter à manger ni payer son loyer, je n’ai aucune obligation (sinon morale ou religieuse, par esprit de charité) de lui fournir gîte ou couvert. En revanche, l’Etat, lui, doit assumer ses obligations vis-à-vis des citoyens et leur porter assistance. Pour Sieyès, et j’en viens ainsi à la troisième variante, cela prend tellement la forme d’une obligation contractuelle qu’intervient ici un aspect synallagmatique familier des civilistes, à savoir l’obligation symétrique pour le citoyen que la société secourt, de se soumettre « à ses ordres ». On a ici clairement un dispositif relevant d’un droit créance, puisqu’il s’agit d’un droit à un secours, une aide consentie par l’Etat. J’ajoute que ce droit créance est plus conforme à l’idée de créance que les droits créances contemporains qu’on trouve, par exemple, dans le Préambule de la Constitution de la IVème république, puisque ce droit est quantifié, il n’est pas indéfini : ainsi, écrit Sieyès dans l’article XLI, « les secours de charité cessent, au moment où finit l’impuissance qui les justifiait », d’une part, et d’autre part, il est limité « aux besoins naturels ». Nulle trace donc ici de droits indéfinis et virtuellement infinis. Le dispositif est donc radicalement différent des autres droits, qui sont décrits comme « civils et naturels » et ne semblent pas rencontrer d’autre limite que le droit d’autrui. Sieyès envisage donc clairement que l’on ait deux registres de droits, trois si l’on ajoute les droits politiques : des droits qui correspondent à des facultés, d’autres droits qui correspondent à des prétentions, les premières sont d’un usage virtuellement infinies, les secondes sont strictement bornées dans le temps et la quantité. On est en effet dans un registre conceptuel proche de la distinction liberté/créance mais avec cette nuance sensible : il n’est pas évident que Sieyès aurait accepté de subsumer ces deux catégories de « droits » sous un même ensemble de « droits subjectifs ». Passons à 1795.
Régulièrement discutées par les publicistes et les historiens du droit et dont l’importance fut soulignée très tôt par Benjamin Constant qui cite longuement l’Opinion du 2 thermidor dans la version de 1806 de ses Principes de politique28, ces deux Opinions n’ont pas connu le succès éditorial (relatif) de Qu’est-ce que le tiers-état ? Elles n’ont jamais été republiées du vivant de Sieyès, ce qui explique probablement la longueur des extraits dans l’anthologie Des opinions politiques du citoyen Sieyès, dans le contexte de l’an VIII, avec la nécessité pour lui de rappeler ses compétences et ses vues en matière constitutionnelle. Il faut attendre 1939 et la thèse complémentaire de Paul Bastid, Les discours de Sieyès dans les débats constitutionnels de l’an III (2 et 18 thermidor), malheureusement jamais rééditée, pour lire une remarquable édition critique de ces deux textes, avec de nombreux commentaires, qui fait aujourd’hui encore autorité. Ce volume est malheureusement difficilement accessible (il n’est pas à la Bibliothèque Nationale de France ; on le trouve néanmoins à la Bibliothèque de l’Ecole Normale supérieure ainsi qu’à la Bibliothèque Cuzin de la Sorbonne). Néanmoins, les deux Opinions ayant été reproduites dans le Moniteur universel, on pouvait se
28 Livre I, note C, édition E. Hofmann, tome 2, Droz, 1980, p. 45-46. Il s’agit du passage suivant : « Les pouvoirs illimités sont un monstre en politique et une grande erreur du peuple français. […] la souveraineté rentrera dans ses justes limites ; car encore une fois, la souveraineté du peuple n’est pas illimitée. »
14
reporter à la Réimpression de l’ancien Moniteur, disponible dans de nombreuses bibliothèques, pour lire ces textes. On trouve le discours du 2 thermidor dans les éditions du 7 thermidor an III (samedi 25 juillet 1795) (n°307), p. 291-296 et du 8 thermidor an III (dimanche 26 juillet 1795) (n° 308), p.297 ; on trouve le discours du 18 thermidor dans les éditions du 26 thermidor an III (jeudi 13 août 1795), p. 442-445 et du 27 thermidor an III (vendredi 14 août 1795), p. 449-452. L’impression tardive du second discours conduit curieusement Alfred Stern à affirmer qu’
il y a une erreur dans la brochure : Opinion sur la jurie constitutionnaire par Siéyès (…) où le discours de Siéyès est daté « du 18 thermidor ». La même date erronée se trouve dans « Emmanuel Siéyès Politische Schriften », 1796, t. II, p. 40329.
Il se trouve qu’à la date du 23 thermidor le Moniteur indique clairement pour la séance du 18 thermidor, à la Convention nationale, sous la Présidence de Daunou :
Sieyès présente de nouveaux développements sur l’organisation d’une jurie constitutionnaire, chargée de veiller à la garde du dépôt constitutionnel. La Convention ordonne l’impression de ce discours (que nous donnerons), le renvoi à la commission des Onze, et ajourne la discussion jusqu’au rapport qui doit être fait par cette commission sur cette question importante. La séance est levée à quatre heures30.
Il semble donc que le discours du 18 thermidor soit bien… du 18 thermidor.
Ces Opinions n’ont certes pas eu une grande postérité éditoriale ; mais elles ont fait l’objet de nombreux débats, encore vifs à ce jour.
Les historiens se sont intéressés au rôle de Sieyès dans la constitution de l’an III, tordant le coup à la légende d’un Sieyès négligeant de soumettre ses idées à la Comité des Onze chargé de rédiger la nouvelle Constitution pour délivrer, à la dernière minute, son plan dans deux discours interminables et énigmatiques. En réalité, c’est désormais incontestable, Sieyès a présenté ses projets au Comité des Onze, lors d’audiences particulières, comme l’établissent des feuillets conservés dans le carton 284 AP 5 et opportunément transcrits dans le volume Des manuscrits de Sieyès31. Sieyès évoque en effet les « 4 à 5 conférences que j’ai eues avec le Comité des 11 dans les 1ers jours de Messidor, l’an 3, au sujet de la C[onstitution] » ; et on peut d’ailleurs lire les esquisses des projets de constitution qu’il avait communiqué d’emblée à ce Comité. Pour le détail de tout cela, je ne peux que renvoyer à l’article de Marc Lahmer, « Sieyès lors des débats constituants en l’an III : autopsie d’un échec32 », mais aussi à Marcel Gauchet (La Révolution des pouvoirs33) et Michel Troper (Terminer la Révolution34).
29 « Sieyès et la constitution de l’an III », op. cit., p. 378, note 1. 30 P. 422. 31 P. 478 sq. 32 In Figures de Sieyès, op. cit. 33 Gallimard, 1995. 34 Fayard, 2006.
15
Le projet de jury constitutionnaire a retenu l’attention des publicistes dans ces deux Opinions, et particulièrement dans la seconde qui présente en détail ce projet. Une question récurrente et vivement débattue35 est de savoir si l’on peut faire de ce jury un ancêtre de notre Conseil constitutionnel ou, plus largement, une instance chargée d’un véritable contrôle de constitutionnalité. Ce débat complexe suppose, comme le rappelle fort justement Pasquale Pasquino36 que l’on se mette d’accord auparavant sur la méthode : doit-on définir le contrôle de constitutionnalité comme « ce que font les cours constitutionnels aujourd’hui » (genre) et à partir de là comparer l’institution de Sieyès (espèce) à cette activité ? Ou doit-on adopter une conception souple géographiquement et historiquement, et chercher s’il y a une structure commune à l’ensemble des dispositifs où il y a un contrôle par une instance autonome (je laisse volontairement de côté les problèmes posés par la définition de ce terme) de la conformité des actes de la puissance législative à la constitution ? Dans la première perspective, il sera délicat de rattacher directement Sieyès à la notion de contrôle de constitutionnalité, puisque, pour adopter le vocabulaire d’Olivier Beaud37, la conception que les Opinions de Sieyès engage de la notion de constitution ne saurait être purement « normative ». Elle n’est pas non plus purement « politique » puisque si Sieyès parle des « actes législatifs », ce qui peut sembler faire référence aux pratiques et non aux textes, il évoque néanmoins la conformité des « lois » aux « articles » de la Constitution, en précisant que ces articles doivent être en petit nombre et que la Constitution ne doit pas être trop détaillée. On semble ici être proche de l’examen d’une subsomption de la norme législative par la norme constitutionnel. Selon la deuxième méthodologie, ce type de difficulté s’évanouit puisqu’on admet alors que contrôler la constitutionnalité peut signifier tout aussi bien vérifier le respect d’une hiérarchie normative qu’examiner la régularité des procédures d’édiction de la loi par le législateur (conditions du vote, durée et nature des mandats). Au total, la lecture de ces deux Opinions montre que Sieyès ne sépare pas toujours clairement ce qui relève d’une vision « politique » de ce qui relève d’une vision « normative » de la constitution et cela le conduit à ne pas toujours dissocier clairement le contrôle interne du contrôle externe de constitutionnalité. Néanmoins, il me semble que la curieuse (pour ses contemporains) triple fonction du jury constitutionnaire - cassation, amélioration, équité naturelle – montre que Sieyès voit dans la Constitution autre chose que le mode d’organisation du système politique. Pour reprendre le vocabulaire du Préliminaire, il y voit plus que des principes : il y voit d’une part l’affirmation d’une série de droits fondamentaux, qui s’imposent aux législateurs, et qui limitent, par le haut pour ainsi dire, son action, et d’autre part la forme figée de ce pouvoir constituant, dont il a vu en 1789 l’extraordinaire puissance et en 1793 la redoutable violence, et dont il veut préserver la légitimité en limitant sa ductilité – ce pouvoir limite lui aussi, mais par le bas, l’action du législateur.
Dans ces Opinions, Sieyès rompt avec ce qui pouvait apparaître comme une forme de passion législatrice à l’œuvre dans l’Essai et dans le Préliminaire : il s’agissait de promouvoir la loi commune, cette « loi qui délie » selon l’excellente formule de Marcel Gauchet. En l’an III, six ans après, le souci de Sieyès est plutôt d’encadrer cette « volonté commune » qui avait été bridée si
35 Pour un aperçu des pro et contra, voir Pasquale Pasquino, Sieyès et l’invention de la constitution en France, op. cit. ; « Constitution et pouvoir constituant : le double corps du peuple » in Figures de Sieyès, op. cit.. Marcel Gauchet, La Révolution des pouvoirs, op. cit.. Michel Troper, Terminer la Révolution, op. cit. ; « Sieyès et le jury constitutionnaire » in Mélanges Pierre Avril, Montchrestien, 2001, p. 265-282 ; « Sieyès et la hiérarchie des normes » in Figures de Sieyès, op. cit.. Marc Lahmer, « La doctrine physiocratique du contrôle juridictionnel de la loi positive », op. cit. ; « Sieyès lors des débats constituants de l’an III : autopsie d’un échec », op. cit.. Lucien Jaume, « Sieyès et le sens du jury constitutionnaire : une réinterprétation », Droits, n° 36, 2002, p. 115-134. P.-Y. Quiviger, Le principe d’immanence, H Champion, 2008. 36 « Constitution et pouvoir constituant : le double corps du peuple » in Figures de Sieyès, op. cit. 37 « Constitution et droit constitutionnel » in Dictionnaire de la culture juridique, op. cit.
16
longtemps. Son anti-volontarisme, d’origine spinoziste et physiocratique, déjà présent en 1788 et 1789, s’épanouit désormais totalement ; il écrit ainsi dans l’Opinion du 2 thermidor, en insistant sur le champ sémantique de la volonté par le jeu des italiques :
Malheur aux hommes, malheur aux peuples qui croient savoir ce qu’ils veulent quand ils ne font que le vouloir ! Vouloir est la chose la plus aisée. Depuis qu’il y a des hommes sur la terre, ils veulent ; depuis qu’il s’est formé des associations politiques sur la terre, elles veulent ; par-tout on veut être bien gouverné, ne point laisser ensevelir ses droits dans le gouffre du despotisme, ne les point livrer aux griffes de l’anarchie.
Ce qui surprend le plus dans ces quelques lignes, c’est la dernière proposition, à laquelle Sieyès ne peut qu’adhérer : lui aussi « veut » être bien gouverné, « veut » voir ses droits respectés, etc. Pourquoi affecter d’un coefficient de moquerie une aspiration légitime et conforme au projet défendu par Sieyès ? L’explication la plus commode (et qui a sa part de vérité) est celle qui renvoie à la misanthropie du personnage Sieyès. Une explication plus complexe et plus « métaphysique » suppose, en se reportant au début du texte, de distinguer fermement la volonté qui « sait ce qu’elle veut », de la volonté qui « veut » simplement. « Savoir ce que l’on veut » ne signifie pas ici, comme dans le langage courant, être persévérant, obstiné, inflexible ; cela signifie : avoir une volonté éclairée par le savoir, par la connaissance, par la raison. La volonté éclairée par le savoir ne peut que se moquer de la volonté « libre » car c’est une volonté naïve, aveugle, qui s’abuse sur sa liberté et sa supériorité, confondant la multiplicité des possibles issus de l’ignorance avec la véritable liberté. C’est comme si l’on se croyait plus libre au Japon en ne parlant pas japonais parce qu’on peut prononcer plusieurs formules farfelues pour commander son thé, au lieu de la seule adéquate. Cette « volonté », même quand elle vise un objectif légitime, mérite, selon Sieyès, d’être moquée car elle vise par hasard ce qui est bon. La volonté et la liberté n’ont d’intérêt et de sens que dans la mesure où elles sont informées par la connaissance et la re-connaissance – qui sont chez Sieyès liées aux notions de justice et de jugement. C’était d’ailleurs le sens de sa formule célèbre, en 1789 : « Ils veulent être libres, ils ne savent pas être justes ! », mise en exergue de l’édition des Observations sommaires sur les biens ecclésiastiques. Cette formule contient déjà en germe le principe de limitation de la souveraineté que les deux Opinions vont expliciter.
En conclusion, un mot sur deux étranges textes, qui mériteraient vraiment une étude, qu’on trouve aujourd’hui facilement sur Internet, l’un grâce à une numérisation Gallica en mode image, l’autre grâce aux heures que j’ai passé à le saisir avant de le mettre gratuitement en ligne.
Le premier s’intitule Des opinions politiques du citoyen Sieyès et de sa vie comme homme public et a paru à Paris, chez Goujon Fils ; ce volume comprend 288 pages. Barbier l’attribue à Oelsner, ce qui est assez plausible au vu de la correspondance entre Sieyès et Oelsner (conservée dans le carton 284 AP 17) ; un seul auteur a refusé cette attribution, Alfred Stern (« Sieyès et la constitution de l’an III », La Révolution française, tome 39, 1900, p. 375-379) mais son argumentation est peu persuasive : « on y lit dans l’avertissement, p. VIII : « Nous déclarons ici en notre âme et conscience que nous ne l’avons (Siéyès) jamais approché, que nous ne croyons même pas être connus de lui, etc. » Or, Oelsner était un des amis intimes de Siéyès » (p. 379 note 1). Qu’un auteur anonyme déclare ne pas connaître Sieyès est en soi peu significatif, surtout quand, en l’espèce, il s’agit de défendre la cause de Sieyès avec « objectivité » ; mais il faut encore ajouter à cela que les citations de Sieyès qu’on trouve dans le volume connaissent quelques modifications
17
qui trahissent l’intervention de Sieyès ; ajoutons qu’Oelsner et Sieyès étaient familiers des impostures éditoriales puisque la Notice sur la vie de Sieyès avait été datée de façon fictive de l’an II. Disons qu’il n’est pas certain que l’auteur de cette anthologie soit Oelsner, mais qu’il est en revanche assuré que son auteur avait « approché » Sieyès (on ne voit d’ailleurs pas qui aurait, en l’an VIII, l’idée d’écrire 300 pages sur Sieyès pour montrer son génie, sans être son familier). Bref : on ne saurait suivre Murray Forsyth (Reason and Revolution, op. cit., p. 239) quand il indique qu’Alfred Stern a définitivement établi qu’Oelsner n’était pas l’auteur de cet ouvrage. La seconde anthologie de l’an VIII, Exposé historique des écrits de Sieyès, ne pose elle aucun problème pour son attribution puisque, selon l’auteur de l’inventaire du fonds Sieyès aux Archives nationales, Robert Marquant, l’exemplaire conservé aux Archives nationales comprenait une dédicace adressée à Sieyès « par l’auteur », d’une écriture qui est incontestablement celle d’Oelsner. Ce volume a en revanche longtemps posé un autre problème, celui de son accessibilité. Le volume, de 96 pages, a été tiré « à vingt-cinq exemplaires aux frais de l’auteur » en 1799 : après deux cents ans, on peut imaginer qu’il reste peu de volumes en circulation et, malheureusement, la Bibliothèque nationale de France n’en a jamais eu d’exemplaire, si bien qu’il ne figure pas à son catalogue. Ajoutons qu’aucune bibliothèque française, à notre connaissance, n’en possède non plus. En 1939, Paul Bastid évoquait un exemplaire conservé à Marbourg, en Allemagne. Dans l’inventaire de 1970 du fonds 284 AP, Robert Marquant mentionne, dans le carton 284 AP 18 réservé aux imprimés, un exemplaire de ce volume, avec la dédicace évoquée plus haut, et aussi, ce qui est plutôt curieux, un tirage à part du premier chapitre de ce même volume, comprenant, indique Robert Marquant, « une variante dans la première page ». Malheureusement, parmi la soixantaine d’imprimés de ce carton, un seul a disparu, l’Exposé historique, soit le seul volume rare. De quand date cette disparition ? C’est impossible à dire. Ce carton était peu consulté (il ne comprend rien d’inédit sinon ce volume) et peut-être l’anthologie a-t-elle disparue au milieu des années 1970. Le service des Archives privées a du reste constaté, avant mon propre signalement, cette disparition dès le 22 janvier 1993. Dans le carton, il reste, étonnamment, le chapitre 1 en tiré-à-part que mentionne Robert Marquant. Il n’y a donc plus d’exemplaire de cette anthologie sur le territoire français, sauf peut-être dans des collections particulières. Heureusement, il reste l’Allemagne. Deux exemplaires sont indiqués dans les catalogues des bibliothèques allemandes : l’un à la Staatsbibliothek zu Berlin, l’autre à l’UB München. Cette édition est ornée d’une dédicace en première page : « à son respectable ami, au citoyen Cramer ».
Ces deux ouvrages participent du même genre d’entreprise que celle qui avait conduit à la publication, en l’an III, d’une Notice sur la vie de Sieyes, fictivement datée de l’an II : il s’agissait de « relancer » la carrière politique d’Emmanuel Joseph Sieyès, en rappelant son rôle historique et l’importance de ses conceptions constitutionnelles et philosophiques. Pour ces trois textes, la rédaction semble partagée entre Oelsner et Sieyès ou, plus exactement, Oelsner semble avoir rédigé d’après des conversations avec Sieyès, lui soumettant probablement les pages au fur et à mesure. Cette proximité est illustrée par les lettres d’Oelsner, conservées dans le carton 284 AP 17 (dossier 5) des Archives Sieyès. On peut même supposer que Sieyès a eu un droit de regard sur les premières épreuves de l’Exposé historique, puisque le carton d’imprimés 284 AP 18 (dossier 1) contient un tiré à part du chapitre premier de l’Exposé, avec quelques différences dans les premières lignes du texte.
Alors que l’ouvrage de l’an III est usuellement désigné selon son titre (« Notice »), on décrit les deux textes de l’an VIII (que certains commentateurs confondent parfois) comme des « anthologies » ; ce n’est pas tout à fait exact. En effet, si ces deux textes, et particulièrement les Opinions politiques, comprennent des extraits d’œuvres imprimées de Sieyès, parfois assez longs, ces extraits représentent bien moins de la moitié de chaque texte. Et chaque extrait est accompagné de descriptions historiques, d’analyses politiques, de digressions philosophiques, sans compter les passages qui relèvent du résumé ou de la paraphrase d’une œuvre de Sieyès, sans recourir à la
18
citation expressis verbis. On peut imaginer que si elles sont considérées comme de simples anthologies, c’est probablement parce qu’elles ont principalement été étudiées dans la perspective d’éditions critiques. Pourtant, leur valeur théorique va au-delà des perspectives philologiques : dans la mesure où Sieyès n’a presque rien publié après l’an III, les deux publications anonymes de l’an VIII constituent à bien des égards le dernier état « imprimé » de la pensée de Sieyès (même si l’on sait, en particulier grâce au second volume des Manuscrits de Sieyès (Honoré Champion, 2007) que le travail théorique de Sieyès s’est poursuivi bien au-delà de son œuvre imprimée). Il est par conséquent dommage que ni l’un ni l’autre de ces ouvrages n’ait été retenu pour figurer dans les Œuvres de Sieyès parues chez E.D.H.I.S., contrairement à la Notice, qui figure au tome III.
Des deux ouvrages, l’Exposé historique est le plus tardif, puisque les Opinions politiques sont mentionnées dans les premières pages : « les journaux nous apprirent qu’une autre plume venait d’ériger à Sieyes un semblable monument ». L’attribution à une « autre plume » des Opinions politiques n’est pas très crédible, ne serait-ce que parce qu’on voit assez mal qui, à part Oelsner, aurait pu écrire et tirer à ses frais les 25 exemplaires de l’Exposé. On pourrait avancer le nom de Cramer, mais il se trouve qu’il est le dédicataire de l’exemplaire (portant le numéro 10) conservé à Berlin de l’Exposé. L’écriture de la dédicace est du reste très proche de celle d’Oelsner. Celui-ci est donc probablement l’auteur des deux ouvrages et la justification bien trop personnelle de l’ouvrage précédent est un indice supplémentaire : « Tout nous annonçait, de la part de l’Auteur, des intentions bonnes, un but honnête ; nous le jugions sur la conscience de nos propres sentiments. Néanmoins, à peine son livre avait-il vu le jour, qu’aussitôt une espèce d’anathème parut vouloir l’anéantir. Il est donc quelquefois plus dangereux de louer que de médire ». On notera pour finir que l’auteur anonyme des Opinions jurait quant à lui n’avoir « jamais rencontré Sieyès », comme s’il était crédible qu’en l’an VIII, on se mit à écrire 300 pages sur Sieyès sans le connaître ni de près ni de loin (c’est pourtant sur cette seule assertion qu’Alfred Stern s’appuyait, pour établir qu’Oelsner ne saurait être l’auteur des Opinions politiques de l’an VIII, dans « Sieyès et la constitution de l’an III », La Révolution française, tome 39, 1900, p. 375-379 – suivi par Murray Forsyth, dans Reason and Revolution, p. 239).
Il convient en tout état de cause de méditer sur ces quelques lignes de la Notice de l’an II (p. 4) :
« Si quelqu’un veut reconnaître l’Auteur, ce qui ne sera pas bien difficile, nous lui répondons d’avance : que vous importe, vous n’en avez été que mieux servi pour l’exactitude scrupuleuse des faits. D’ailleurs, il est des époques et des choses sur lesquelles la manière de voir d’un homme fait aussi partie de sa vie. »





















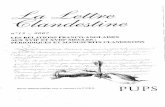





![Le règne de Joseph Bonaparte : une expérience décisive dans la transition de la Ilustración au libéralisme modéré [2006]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63222194078ed8e56c0a42e2/le-regne-de-joseph-bonaparte-une-experience-decisive-dans-la-transition-de.jpg)











