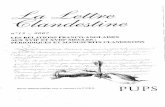Le génie celtique et le monde invisible - Arbre d'Or Editions
Le pluriuniversalisme de Balibar et le cosmopolitisme repensé
Transcript of Le pluriuniversalisme de Balibar et le cosmopolitisme repensé
Séminaire doctoral LISP 3300
Mylène Botbol-Baum
4 Octobre 2010
"L’universel n’existe pas"Aristote
"Tous les hommes croyons-nous aspirent, par nature à une autrenature"Spinoza
"Si la génération des années 70 relit Spinoza, c'est parce qu'il permet de penserl'universel dans l'immanence du pluralisme politique"
E. Balibar
Table of ContentsMylène Botbol-Baum.........................................14 Octobre 2010.............................................1"Si la génération des années 70 relit Spinoza, c'est parcequ'il permet de penser l'universel dans l'immanence du pluralisme politique"....................................1
Le pluri-universalisme, au-delà de la division universel particulier: une hallucination véridique ou un horizon de l'action ?.....................................................2Nécessité de repenser l'universel concret comme intuition de la raison....................................................2Entre Histoire et structure les enjeux de l'universel dans le débat éthique...........................................2Le désir d'universel comme moteur de l'histoire? ..........8
Un universel participatif ..................................9L'universalité pratique comme des-utopie et puissance constitutive.................................................9 Mon hypothèse:...........................................11Quels sont les enjeux philosophiques de cette histoire sémantique de l'universel ................................12Les invariants............................................18
Traduction pratique de l 'universel dans une pensée de
l'immanence ? ..............................................21 Immanence dynamique et narrativité ......................23
La place du sujet une vielle histoire qui réémerge .........26Suite la raison pratique chez Sen : encore un effort pour êtrespinoziste?.................................................35
Le pluri-universalisme, au-delà de la division universel particulier: une hallucination véridique ou un horizon de l'action ?
Nécessité de repenser l'universel concret comme intuition de la raison
Entre Histoire et structure les enjeux de l'universel dans le débat éthiqueChaque civilisation a tendance à surestimer l'orientation objective de sapensée nous disait Lévi-Strauss dans la Pensée Sauvage.L'idée d'universel a d'abord visé dans le discoursphilosophique l'unification du réel, pour deveniraujourd'hui le concept qui suscite, en dehors del'Occident, soit la haine et le ressentiment de ceuxqui en sont exclus, soit l'espoir utopique d'uneégaliberté1.L'universel reste associé à un paradoxe: celui de lapluralité des horizons du vivre en commun et del'intuition de l'unité de l'humanité, qui se trouve deplus en plus à l'étroit dans l'humanisme occidental, L'anthropologie sociale est venue questionner letranscendantalisme de la métaphysique par une approchecritique. Elle est néanmoins l'héritière des postulatsplacés au fondement du projet de connaissance objectivedes modernes ainsi que des idéaux émancipateurs :l'autonomie individuelle et collective doit promouvoirun constant progrès. L'anthropologie fut conduite nonseulement à en critiquer les dérives anthropocentristes
1 E.Balibar, "Egaliberté " puf 2010
et les instrumentalisations colonialistes ouassimilationnistes, mais surtout à questionner cethumanisme occidental qui se prétendait à vocationuniversaliste, et qu’elle a accusé d'entérinerl'uniformisation du monde contre l'idée de libertéindividuelle et collective.Alors que nous venons de célébrer le centenaire de lanaissance de Lévi-Strauss, qui s'inscrit au coeur decette tension entre relativisme et universalisme, laquestion de l'universel se rejoue aux niveaux à la foisépistémologique, éthique et politique. Nous montrerons pourquoi, chez Lévi-Strauss, la tensionferait souvent partie du projet qu'il propose pourl'anthropologie, c'est-à-dire un universalismecognitif, tout en s'intéressant à la diversité del'humanité par l'énonciation d'un relativisme culturelattentif aux savoirs concrets de la « pensée sauvage ».Le relativisme culturel est, en anthropologie, unprincipe méthodologique fondamental, qui a néanmoinsaussi des conséquences philosophiques etpolitiques(question qui sera traitée le 6 decembre parNathalie frogneux) Il nous faudra éclaircir les enjeuxthéoriques en anthropologie de la tension entreuniversalisme et relativisme. La méthode comparative sefonde sur un décentrement originel visant à dépasserles apories dans lesquelles tombent trop souvent leschoix auto-contradictoires de l'universel contre leparticulier ou du particulier contre l'universel. Latension universalisme-relativisme nous semble néanmoinsparadoxalement indépassable quand elle est inscritedans la finitude humaine, toujours inscrite dans unmonde relatif et historique.Mais si le monde des anthropologues est ordonné par laculture et la diversité des identités, l'ordre mondialest ordonné par le concept de souveraineté, qui est unequestion de philosophie politique qui nous ramèneencore à Spinoza. …. Nous explorerons la limite desconcepts permettant de relativiser les approches
essentialistes ou structurales, ou les objetsabusivement naturalisés comme le concept de naturehumaine. La dénonciation des pseudo-universels(assimilationnistes, ethnocentriques, …) est tue tropsouvent au nom d'une version plus englobante del'universel philosophique Il s'agira donc pour nous, endéplaçant la tension universel/relativisme autour de laquestion de la transcendance et de l'immanence,d'analyser les racines historiques et structurelles dece débat en trois moments: Aristote / Spinoza, Lévi-Strauss / Sartre, Balibar -Sahlins / Sen.
Si l'unité de l'homme a été le postulat de la traditionanthropologique dès la naissance de la discipline,celle-ci a subi de sérieuses modifications: del'évolutionnisme qui proposait un programme comparatifvisant à démontrer l'unité de l'espèce humaine pourréfuter l'absence d'âme chez certains peuples auxdémonstrations pseudo-scientifiques hiérarchisant des"races terrestres" considérées comme des espècesvivantes distinctes. Ces thèses ont justifié lacolonisation au nom du développement spirituel desdits"sauvages" (. Mais toute l'anthropologie n'est pasévolutionniste ou colonialiste. Elle contribue aussi àdévelopper un universalisme gradualiste et concret quipermet de sortir de certaines apories philosophiques,qui opposent encore universalisme et multiculturalisme,pour répondre à la question de la pertinence de lasurvivance, voire de la résilience du conceptd'universel.
Nous ferons d'abord l'archéologie de ce concept (d'Aristote à Spinoza) pour réinterroger la crise del'universel dans les années 1960, cristallisée par lefameux débat entre Lévi-Strauss et Sartre dans laPensée Sauvage et le retour de l'ontologie immanentistede Spinoza (Citton, Balibar, Atlan) comme alternative àl'essentialisation de l'universel et de l'objectif,
puis le retour au matérialisme marxiste ou au retour dela métaphysique, à la fois aux niveaux épistémologiqueet éthique,.
Cet enjeu de dé-finir l'universel se confronte à sadimension babélienne et a préexisté la dite crise(telle est notre hypothèse). Il traverse encore ledébat entre universalisme et multiculturalisme jusqu'àla post-modernité, nous voudrions le reprendre pourréinterroger de manière critique le lien entrephilosophie transcendentaliste et anthropologie. Ils'agit d'inviter la philosophie contemporaine, en débatavec les sciences sociales, à une approche plusimmanentiste de la construction du réel, voire à laréinvention d'une ontologie post-métaphysique.Ce débat entre universalisme et multiculturalisme seradicalise avec la naissance de l'individualisme auXVIIème siècle autour de Spinoza et sa réécriture del'éthique aristotélicienne, visant à lutter contre lefinalisme cartésien. L éthique spinoziste est d'unecertaine manière le fondement épistémologique del'anthropologie, d'où le succès du spinozisme dans lessciences sociales et dans l'épistémologiecontemporaine, pour sortir de l'impasse qui consiste àdire que la tension entre l'universalisme et lerelativisme est indépassable.J'ai choisi cet angle d'approche immanentiste qui mepermettra d'établir une corrélation d'intention et nonune opposition entre discours philosophique etanthropologie. Il s'agira moins de mettrel'anthropologie à l'épreuve de l'universel que desouligner les articulations possibles entre les deuxdisciplines dans une perspective immanentiste fondéesur l'épistémologie spinoziste.
L'anthropologie est née au XIXème siècle commeconséquence de cette rupture avec les penséesspéculatives ou métaphysiques du vrai. Le détour par
l'anti- idéalisme de Spinoza comme lecteur d'Aristotenous montrera que cette rupture est récurrente et a deseffets éthiques inséparables d'une perspectiveépistémologique d'un' Universel qui parce qu'il émergede la matrice dualiste de la pensée de la transcendancereste toujours à venir. Nous explorerons la versionmoniste à travers le dépassement de la coupure nature-culture. avec Sahlins, Balibar et Sen, qui partagentavec Spinoza une vision immanentiste de l'agentconfronté à un modèle comparatif. Or, ce modèlecomparatif implique une pluralité d'options éthiques etouvre ainsi à ce que j'apelle le pluriuniversalisme,qui seul pourrait affirmativement orienter la raisonpratique. Je proposerai en conclusion d'analyserpourquoi nous le retrouvons par analogie retrouvons deSpinoza à Sen dans une idée de la liberté associée à lapuissance ou à la capacité humaine.
Notre approche sera des lors celle d'un décentrementcomparatiste à partir des discours anthropologiques,mettant en scène entre des mondes humains socio-historiques cohérents, qui nous amèneront à questionnerle concept de "nature humaine" en miroir avec la notiond'universel. comparée c'est en effet admettre lapotentialité pratique de contradiction irréconciliableentre représentation du monde concurrente l'outil de lacomparaison impose une modestie épistémologique en cequ'il implique un rapport d'intérêt subjectif desociété à société dans un éclaircissement réciproque.Il relève comme nous le verrons avec Dali Barre unecapacité de traduction. Toutes les universités humainestoutes les sociétés humaines se définissent comme desuniversels concrets exilés s'expriment de manièrecohérente à travers une relation à l'invisible ou àl'infini à travers des codes éthiques des règlespolitiques et juridiques fondées sur une nécessitébiologique première télé la thèse de Castoriadis dansl'institution imaginaire de la société. Nous partirons comme de biais, du lien structurel entrela relecture d' Aristote et Spinoza aujourd'hui quisemble déjà tisser un lien critique contre touteperspective transcendentaliste de l'universel qui estle projet de l'anthropologie, pour proposer unealternative immanentiste présentée comme plus à même demener une approche éthique cohérente.Il s'agira concrètement d'interroger la pertinence decette vision de l'universel au XXIème siècle et dedépasser le clivage schizophrénique entre l'individu etl'universel créée artificiellement par une approchetranscendentaliste ne se donnant pas les moyensépistémologiques et politiques de son dépassement. -- L'approche immanentiste a un caractère immédiatementépistémologique et éthique, questionnant le sensimplicite du concept jacobin d'universel. A partir du
post modernisme et post structuralisme qui verraémerger une pensée qui sans les articuler, vise aretisser le lien entre description immanentiste etsociale ouvrant à un universel pragmatique.
Notre réflexion se divise donc entre trois moments dela métamorphose de l'enjeu de l'universel qui nouspermettrait de dépasser l'antinomie actuelle:Aristote-Spinoza ou la revendication de l'immanencecontre l'idéalisme platonicienLevy Strauss-Sartre et la mise en scène de la fausseantinomie entre l'histoire et le système dans leurrelation dynamique. Marshall Sahlins, citton - Sen, comme réactualisationde l'universel pragmatique revendiquée par lespinozisme dans sciences sociales 2 qui loin deproposer une synthèse entre l'universel et leparticulier présente la société comme universelconcret., en tentant de redonner sens à un monde communsans arché, qui rejoint l'intuition éthique de l'unitéde l'humanité comme déterminisme premier.
Au delà du pluralisme anthropologique de cesdescriptions, l' enjeu éthique et politique majeurreste de dépasser l'antinomie universel-particulier.afin de sortir d'une pensée de l'exclusion etrevendiquer une pensée intégrative construisant ununiversel a posteriori face aux défis du siècle. àpenser les conditions politiques du relativismeculturel. Dans la nature humaine comme illusion occidentaleSahlins, qui a subi l'influence conjointe de LeviStrauss et de Sartre, insiste sur la mise en questiond'une nature humaine universelle comme illusion
2 Yves Citton et Frédéric Lordon, Spinoza et les sciences sociales, Amsterdam Poches, 2008
occidentale pour lui cette conception loin d'êtreuniversel est une erreur ancienne qui perdure sous lemode du déterminisme biologique : l'homme serait mispar ses gènes. Ainsi contenir la bestialité antisocialede la nature humaine a selon lui légitimer de forme degouvernement l'anarchie ou la coercition qui constituel'antidote coercitive nécessaires à l'égoïsme naturelde l'homme il accuse cette conception pessimiste datantde Thucydide et fondant la réflexion de ce qui mène àvaloriser l'égoïsme individuel et qui menait unecaricature du rousseauiste sauvage, prétendu vierge detoute culture. Dans une approche comparatiste lui aussianalyse cette illusion occidentale par analogie à desexemples polynésiens ou indonésiens ou l'individuconstruit son identité par une culture qui ne s'opposepas à son état originel lui permet de dépasser sesdésirs et pulsions et avancent l'idée que nul ne naîtbon méchant soumis à ces gènes ou aliéné àl'assouvissement égoïste ces appétits car la diversitédes hommes et cette nature humaine ne nous déterminepas nécessairement à faire de l'homme un loup pourl'homme. ce pamphlet est déployé dans un texte oùs'articulent l'opposition entre Lévi-Strauss et Sartre
L'intuition forte qui fonde notre réflexion étant que,L'universel, surtout lorsqu'il est paradoxalementopposé au particulier, renvoie à l'opposition immanencetranscendance. A à force de déplacement sémantique dansl'histoire, Il devient confus si on l'enferme dans laperspective cartésienne de la raison dualiste. Il s'agira de montrer que l'antinomie universalisme/relativisme gagne à sortir de l'ontologie dualiste etcausaliste qui la radicalise et la mène à des aporieslogiques et éthiques insurmontables. Nous entreprendrons donc, à partir de l'ontologieSpinoziste adoptée de manière intéressante pas par lessciences sociales3 et l'éthique de l'économie, de3 Voir les travaux de Yves Citton
dépasser la forme dichotomique de cette antinomie, carelle oublie combien le moteur de l'action sont lesaffects, qui loin d'être contraires à la raison,peuvent relever de l'intuition véridique ou dutroisième genre de connaissance, telle qu'elle estsoulignée par Spinoza dans l'éthique ou le Courttraité:où il montre précisément la participation duparticulier à l'universel comme condition d'une raisonpartagée.
Un lien sera fait ici entre cette vision et une visionde l'anthropologie qui permet mieux que certainesphilosophies universalistes transcendentalistesd'analyser la complexité et les contradictions éthiquesliées à la confusion entre mondialisation etuniversalisation des idiomes du politique et del'éthique. Si pour Marshall Sahlins il est question de dés-utopier"la nature humaine" pour Godelier, "l'anthropologie estle passage obligé de leur reconstruction à un niveau derigueur et d'exigence critique". Il n'y a pasd'événement sans système, en posant la question dedépasser les catégories philosophiques dont nous avonshérité, "pour comprendre comment les autres peuples ontpu construire et transformer leurs modes d'existence"
La première évolution majeure de ce débat est laseconde guerre mondiale qui a amené les années 50 àrepenser la légitimité de l'approche droit del'hommiste à résister aux totalitarismes mais aussi às'interroger sur la légitimité de la colonisation à seprésenter comme œuvre civilisatrice de l'Occident enproposant, au nom de la raison des valeurs universellespartageables si ce n'est partagées de gré ou de force. Si le Marxisme a fait le premier cette critiquenotamment Marx, dans son analyse du colonialisme en
Asie4, surgit avec Lyotard la mort de tous lesmétarécits qui est en soi un acte spinoziste et qui vamener à un acte de "déconstruction des sciencessociales" et mener à reposer la question de "qu'est-cequ'être humain" par la philosophie dans un cadrepost métaphysique, post lumières qui n'en était que larationalisation abusive.A un moment où sonne comme une évidence impensable ledivorce entre raison et liberté.Les auteurs que je citerais ici ont précisément tentéautour du geste métaphysique de Spinoza qui est dedémoraliser et de dés-ontologiser la liberté deréintroduire une séparation liante entre raison etliberté, sans en passer par la transcendance mais endynamisant l'immanence.
Il s'agissait déjà pour Levi-Strauss de défairel'antinomie entre "histoire et système " d'où sonmagnifique chapitre en dialogue avec la pensée deSartre dont le Spinozisme reste sous jacent, même s'ilaffirme la similitude logique du structuralisme auspinozisme de l'éthique. Il montrera comme Spinoza avant lui, mais dans unedémarche descriptive et formaliste une relationdynamique entre peuples dits sauvages et peuplesoccidentaux. Il montrera comme il est possibled'établir une construction diachronique et nonarbitraire entre logique locale et système universeld'organisation des particuliers. Dans "Totémisme et polythéisme" il ira jusqu'à dire :
"Les classifications totémiques ont pour fonction essentielle, celle de faireéclater la fermeture du groupe sur lui même, et de promouvoir la notionapprochée d'une humanité sans frontières". Cette vision fait de l'identité humaine non uneidentité substantielle ou contingente, mais une
4 Marx, Du colonialisme en Asie :Inde, Perse, Afghanistan, col Mille et une nuit
identité relationnelle inscrite dans une histoire. Les choses qui nous entourent sont constituéssymboliquement dans un monde ou la substituabilité estliée à la détermination des objets., qui est uneémergence, une mise en valeur du réel constituant estdonc une ontologie culturelle qui fait émerger ce quel'on pourrait appeler une " totalité socio-cosmique"qui constitue une économie générale d'échangeuniversel, 'un sémiocosme voir un axiocosme qui nouspermet de nous penser comme des variantes d'autrescultures humaines dans un modèle comparatiste qui faitque le réel est immédiatement politique.""Qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en inquiète, laphilosophie occupe le devant de la scène. Non plusnotre philosophie, dont ma génération avait demandé auxpeuples exotiques de l'aider à se défaire : mais par unfrappant retour des choses, la leur" (Levi Strauss, Tristes Tropiques) C'est ici que Sartre pourra répondre paradoxalement " Pour l'homme historique qui se sait et se comprend,cette liberté pratique, Ne se saisit que comme condition permanente et concrètede la servitude; Et paraît-elle comme ce qui rendpossible, comme sans fondement... L'homme existe sonaliénation »(Sartre, critique de la raison dialectique.132)cette volonté de donner place à la contingence contrela structure est principalement ce qui oppose Levi-Strauss à Sartre.Sahlins reprend ce debat dans et c'est la encoreSpinoza qui permettra d'operer la médiation.Comment trouver de sinters universalisables? qui semanifeste sous des inters particuliers incompatibles?
Ici se dessine la volonté d'élaborer d'une éthiqueuniversaliste concrete, fondée, non sur un bientranscendantal mais sur un bien émergeant de
l'immanence d'un monde commun d'agents mais, où le bienhumain n'est plus relatif mais analogue au summum bonumpar la raison et l'imagination, sans déchirement entredésir et culpabilité, sans détachement doloriste desbiens du monde, mais surtout sans hiérarchie entre lesgroupes particuliers qui tous participent d'ununiversel qui n'échappe pas au comparatisme..néanmoins"chaque langue habille les notions communes d e laraison des expressions qui lui sont propres et quiacquierent de ce fait, un statut d'universalité, donton voit qu'il est en réalité usurpé. la contestation de la globalisation". nous dit Atlan reprenant l'idée desnotios comunes de Spinoza.
Le désir d'universel comme moteur de l'histoire? Si le désir est inapte à juger pour Spinoza, commepour Aristote, Spinoza constate surtout l'incapacité del'intellect à exercer une fonction motrice, qui échoitpar conséquent au désir. Le désirable n'existe pas à l'extérieur de l’individu,ce qui serait source d'aliénation, mais se déterminepar rapport à chacun dans sa responsabilité immanenteau monde. C'est donc comme chez Aristote un principe demouvement, qui permet au désir de déterminer le bien.La question éthique est alors : quel critère organisela légitimité de l'évaluation des biens en conflit ?Contre la position intellectualiste qui veut échapperau relativisme et qui reconnaîtra la faillibilité de lavolonté à reconnaître le bien, Spinoza admet leprincipe d'un désir mauvais. C'est la question autourde laquelle tourne toute l'Ethique : Le concept de bonum ne comporte a priori aucun élémentde jugement moral, il est désir d'échapper à lapassivité comme mal, car la passivité interrompt laparticipation au monde. (idee que nous retrouveronschez Balibar, Sahlins set sen)
Un universel participatif 5 C'est ce point que les postructuralistes spinozistesDeleuze et Negri, notamment considéreront comme unerévolution métaphysique : celle qui reconnaît que l'imagination procède autant dela constitution du corps que de l'âme, ce qui impliqueque l'imagination "court à travers tout le réel." En reconnaissant à l'imagination cette dimension ilsabolissent la dichotomie entre transcendance etimmanence et libère d'une surdétermination de l'êtrepar l'activité du niveau modal"6 Comme l'a bien montré Deleuze cela suppose entre lemonde et les sujets un rapport, non de transcendancemais d'immanence au sens d'un système horizontald'implications mutuelles", ce qui permet aux essencesd'être particulières tout en ayant une interaction parcompréhension mutuelle" cette émotion première défianttoute hiérarchie du discours analytique etsynchronique, annule l'idée d'un sujet fixe et séparé,ce qui permet d'abord la multiplicité positive decoexister et rend caduque la volonté de connecterl'universel éthique et le particularisme historique quifont que l'expression "valeurs universelles" outranscendance peuvent dire le tout et son contraire,.C'est ici la nature de l'expérience qui définit lebien, et l'universel n'est jamais exaucé par cesmodalités immanentes. Ce que Spinoza rend possible à penser en radicalisantl'intuition d' Aristote, est bien une pensée en devenirqui est immanente, sans désir de construire un plan detranscendance externe et vertical. La question n'estdès lors plus celle de la transcendance et/ou del'universel, ni celle de la preuve ontologique maiscelle de l'autodétermination comme pari qui libère dela séduction spéculaire du pouvoir, ou de l'uni-
5 Antonio Negri, l'anomalie sauvage. Puissance et pouvoir Chez Spinoza, PUF,1982, p 155
6 idem page 179.
dimensionnalité, et qui ouvre donc à l'expérimentationd'une pluri- rationalité.
L'universalité pratique comme des-utopie et puissance constitutiveEn fondant dans l'immanence une ontologie fondée sur laspontanéité des besoins surgit une irréductiblel'éthicité du monde auquel nous participons, qui permetde résister aux discours dialectiques de latranscendance et du pouvoir, qu’objective ladialectique du maître et de l'esclave pour en faire undestin voir une détermination inscrite dans unesupposée "nature humaine" cupide et violente. queMarshall Sahlins qualifiera d'illusion occidentale carelle nous empêche de voir que nous ne sommes passeulement déterminés par nos penchants animaux mais quenous sommes déterminés à créer du sens par notrebiologie même et en tout cas pas contre elle, ce quinous empêche d'opposer pensée sauvage(nature) et penséeoccidentale (culture).Contre le concept de souveraineté s'élabore alors "unradicalisme constitutionnel " une pensée sauvage refusanttoute normativité transcendante, a priori de la loicomme universelle et ouvrant à une philosophie del'avenir, qui révèle la contre factualité d'ununiversel transcendant, mais aussi le désir del'immanence du bien comme amoral. Cette rencontre permet une "synthèse spontanée entresubstance et mode" que révèle dans un processusrationnel le cinquième livre de l'Ethique. (liberté)Cette pensée de l'immanence serait-elle contraire à la"nature humaine" qui serait de transcender" notrecupidité et notre violence vers une forme de justice etde charité ? (voir Sahlins) Confronté aux apories du dualisme cartésien et del'interprétation théologique d'Aristote au XVIIème, quine sont que les scories d'un platonisme rénové, réduita vouloir la correspondance des causes et des effets.De l'un et du multiple...... car le bien doit par
définition être partageable, sans être librement etegalitairement partageable. Ainsi, loin d'être amoral, le concept d'utile en lequelle bien consiste chez Spinoza, mène là encore commechez Aristote à celui de vertu, mais une vertu qui estpotentia ou conatus, et n'a donc aucun besoin d'unesignification ou d'une intentionalité morale a priori.
Spinoza met en scène cette idée dans le livre 5 dansune sorte d' anthropologie pratique de la liberté,posant la connaissance comme intuition radicale durationalisme absolu. Cela lui permet de dépasser leclivage entre idéalisme et matérialisme, universel etparticulier de manière innovante, en faisant de l'actionhumaine une puissance constitutive et non seulementreprésentative d'un bien spéculaire. Ce point est au cœur de la théorie du conatus commeconquête intersubjective. L'individualité spinozisten'est ni une donnée ni une essence, mais un devenir quitransforme l'universalité de l'être métaphysique enêtre pratique et immanent en processus de libérationcontinue. Ce qui n'est pas une utopie substitutive maisce que Negri, Spinoziste politique a nommé une "des-utopie".
" Ainsi au lieu de poser la connaissance comme simplemécanisme d"enchaînement causLa connaissance est d'abord fondé sur la capacité d'uneintuition véridique" ce qui fait l'unité n'est pas lesavoir mais la capacité d'amour du vrai, la questionest de savoir pourquoi se définit comme ce quicristallise le particulier et le transcende. Et quelest l'impact de cette confusion sur une approche pluspragmatique de l'universel qui permettrait de luirendre son opérativité d'être un mouvementd'unification du sens et non un sens de l'Un a priori ?Comment penser le désir d'universel qui se manifestedans le désir de justice, d'égalité, de reconnaissance,
non pas contre les désirs particuliers mais dans unearticulation pragmatique à laquelle se sont attachésles philosophes qui pensent la version immanentiste etnon historique de l'universel que nous donne Spinoza,permettant d'articuler l'ontologique et l'historique ? Quel est l'enjeu de pouvoir de cette division qui nepermet pas la réalisation de l'intention éthique quepourrait porter l'universel dans son désir ou sapromesse d' articuler le déterminisme ontologique del'humain au champ historique ou s'exerce sa libertéd'agir ? Si l'ambition de l'universel est toujours présentequelle signification lui donner pour répondre aux defisdu relativisme éthique qui en défait toute pertinencepuisqu'elle résiste au désir d'universel ?
Mon hypothèse:
le désir Babélien au sens mais il reste pour beaucoupcet horizon indépassable de la pensée qui serait ledésir de l'un et la dissolution du multiple qui est aucœur de la métaphysique platonicienne. dans cetteapproche idéaliste, la source de toutes confusions estla séparation indépassable entre Universeltranscendantal et l'immanence des particuliers. Ce clivage pourrait-il être du à la perte du fil de latraduction d'Aristote à nos jours ? ou à la divisionqu'il inaugure entre les finalistes et les autres, lescréationnistes et les autres les immanentistes et lestranscendentalistes ? Ce clivage dualiste est- il autrechose qu'une approche méthodologique qui aurait révéléces limites ? Nous permet-elle de penser les questions que nousassocions aujourd'hui à la pertinence d'un universel
articulé et émanant des particuliers ? Quel est l'enjeud'un autre modèle de l'universel fondée sur la penséequi s'étend Aristote à Spinoza en passant par lestructuralisme et une certaine idée de l'universelsingulier chez Kierkegaard et Sartre?
L’universel n'aurait t-il encore une fonctionrégulatrice de nos désirs ? Peut-on désirer le multiplequi conditionne non seulement le pluralismedémocratique mais la possibilité de l'universelimmanent ? Ceci afin de penser que la diversité desmodes de vie et des régimes est un signe de liberté etnon d'erreur.
Nous entrons alors dans l'impact éthique de ladéfinition de l'universel qui m'intéresseraparticulièrement ici.
D'un point de vue à la fois historique etépistémologique, une certaine lecture d'Aristote,révélée par Spinoza, fait que le concept d'universel d'Aristote, continue d'habiter la pensée occidentale à unmoment où la revendication des particularismes contrel'universalisme abstrait nous fait nous réinterrogersur la significationà lui donner ; et de savoir s'ilconstitue pour la rationalité occidentale une matriceherméneutique dont les fondements contradictoires entresa définition physique et métaphysique; concrète etabstraite, physique et métaphysique dessine un spectrede significations si élargie qu'elle fait perdre auconcept sa pertinence ou du moins son opérativité.
L'approche d'Aristote et de Spinoza serait de garder àla notion d'universel une signification philosophiquetranscendante à la lecture des théologiens qui veulentprécisément séparer nature naturée et naturante, fairede l'idée Dieu une nature transitive et non immanente;cela en Établissant une scission entre un monde
immanent et un monde séparé de la transcendance del’universel comme arche, dont l'actualisation dansl'histoire humaine devient impossible voireirrationnelle.Cette vielle division sémantique est encore présentedans le débat contemporain autour du conceptd’universel et ne fait que reproduire le débat autourd'Aristote réactualisé et radicalisé par Spinoza dansl’Ethique, faisant de l'idée d'universel une idéecartésienne c'est-à-dire selon Spinoza "une peinture muetteet non un concept agissant" Cet universel serait devenu le palimpseste de querellesphilosophiques, sans que l'on puisse deviner à traversles couches successives l'intention première dupeintre. Ce qui nous fait passer de la réalité à lafiction voire au symbole pour reprendre les troiscatégories de l'universel que distingue Balibar lecteurde Spinoza.et de levy strauss La pensée d'Aristote relu, par qui tente d'en dégagerles interprétations théologiques qui trahissent saradicalité., et celle de Spinoza se rejoignent dansleur volonté immanentiste de lire l'universel, quisinon n'existe simplement pas selon Aristote lui même..
Quels sont les enjeux philosophiques de cette histoire sémantique de l'universel
A ce stade, L'universel se definit comme désir orientévers une forme de bien qui signale tout au plus et sansperspective morale, un désir de connaissance et un désir éthique et non moral ou religieux des –singuliersqui dé-multiplie les figures de l'universel à travers l'histoire, ce qui répond donc à une fonction épistémologique et éthique dont les réalisations ont pris des formes mouvementées à travers l'histoire, alors que cette notion par sa cohérence même se devraitd'être historique.
Nous traiterons ici de manière comparative de trois moments clés dans l'histoire du concept afin de saisir la fonction et la capacité de l'universel de permettre de penser au-delà du singulier, dans un débat où la philosophie comme discours spéculatif semble perdre pied, face a la nécessaire contextualisation des énoncés, et invite à reposer vigoureusement cette question au sein des sciences sociales
En introduisant dans un troisième temps Sen et son idéepragmatique de justice, je voudrais montrer qu'unecohérence peut être dessiné autour du monisme deSpinoza, du structuralisme et du marxisme dans lafinalité qu'elles partagent de réaliser l'universelcomme éthique pratique, tout en s'adressant à la raisonincarnée, non de manière abstraite ou procédurale maiséthique.
Paul Ricoeur avait déjà noté qu'Aristote et Spinozasont les deux représentants de l'éthique qui se sontdifferenciés de la théologie morale, en ne visant pas afaire plier la volonté qui suppose une morale del'obligation. le concept dynamique de nature SAvant d'aborder cette question revenons à cequ'épistémologiquement Aristote et Spinoza peuvent nousapporter sur une définition non transcendentaliste etimmanentisme de l’universel.
1° Aristote Spinoza: une dimension plurielle de l'universel historique.
la différence des hommes singuliers les uns par rapportaux autres est engendrée du fait de la matière, puisqueleurs formes grâce auxquelles ils sont hommes n'ontentre elles aucune différence. Mais l'intellect quisaisit le commun relativement aux individus perçoit la
forme à partir de la matière. En effet c'est le communet l'identique en eux
De fait dans De Anima, celui qui soutient que la notionétant la forme de la chose, elle est nécessairementengagée dans la matière donnée, si elle est réelle. Lelogos forme d'animal n'existe qu'en tant que réalisé"dans un individu au moins" mais l'universalité ne faitpas partie de son essence. Ainsi il n'y a en soi rien d'universel dans la notiond'une ousia de l’animal. Elle n'est l'ousia qu'elleest, que réalisée dans un corps. Etre réalisé luiconfère, comme par accident le statut d’universel. Il nous faut donc distinguer l'universel in re et postrem. L'universel in re est un concept tiré parabstraction des particuliers ou ce logos est réalisé enuniversel post-rem.
Il nous faut donc définir ce qu’entre Aristote et Spinoza, Levy Strauss etSartre, le globalisme et le relativisme des valeurs, l'universel n'est pas. l'enjeu de la sortie du modèle de l'Universeltranscendantal vers un pluri-universalisme construitpar des sujets es, la dimension utopique inhérente àcette construction. Si la formation des consciences est individuelle toutautant que celle des consciences collectives,l'histoire de l'universel ne peut être synchronique. Autrement dit l'universalité n'est pas factuelle maiscontrefactuelle ; l'égalité des hommes est un droitmais rarement un fait. L’idéalisation néanmoinsconsiste à passer des faits singuliers au niveau del'idée régulatrice du moins à partir d'Aristote.Historiquement l'humanisme s'est vu contesté à la foispar l'éthique spinoziste et l'anthropologiestructurale, et aujourd'hui par l'approche nontranscendentaliste de Sen et il me semble intéressantde souligner les convergences épistémologiques danscette filiation revendiquée par les auteurs eux
mêmes.........nous permettront de coordonner questionphilosophique et question anthropologique et reposer laquestion de ce qui suscite le désir d'universel ? pourdépasser l'humanisme transcendental vers un humanismepragmatique
Si pour Spinoza déjà tout est régi par les lois de lanature, ce n'est à cause d'aucune fin que nous tentonsde comprendre les choses. Le bien est-il la cause du désir d'universel ou désirdu bien ? Cette question est fondamentale car ellelibère d'une définition a priori du bien et le définitcomme ce à quoi les choses tendent. C’est-à-dire qu'ilest un objet tacite de désir comme l'universel lui-même, et que le désir contrairement à l'intellect estla fonction motrice qui permet d'agir. L’universel spinoziste serait ainsi lié à ce bien quechacun désir, qui peut apparaître sous des modalitésplurielles. Ainsi si Le risque de relativisme surgitlorsque l'on associe le désir à une idée a priori etdonc universel du bien, alors que Spinoza reconnaît ledésir du mal qui sépareront l'éthique de l'utile del'éthique de la vertu. Le bonum chez Spinoza necomprend, comme nous l'avons dit supra, a priori aucunenotion de moralité. Il identifie de manièrefonctionnaliste le bien au profitable et à l'utile dansune tradtion qui bien que non hobbesienne, ne dérivepas des commandements abstraits de la conscienceintérieure mais est liée à l'épanouissement voir à lacapabilité de l'agent responsable de choisir quelle viemener pour arriver au bien qu'il désire et qui dépassela particularité de son choix. L'universel structuredonc fonctionellement la hiérarchie ascendante de biensà partir d'Aristote, car le bien doit par définitionêtre partageable (éthique IV, 36). Ce qui permettra unlien entre la détermination du bien et l'obtention dubonheur par l'exercice de la vertu "qui soit néanmoins
à elle même sa propre récompense, puisque la plus hautejoie est celle qui nait de la raison et qui faitcoïncider le bien et le bonheur dans l'amour de soiactif, très loin d'une morale du repentir, face à ladéviance d'un bien préétabli de la morale chrétienne.La question de l'universel surgit alors avec latransition du problème de la vie individuelle à cellede la société où se réalise la vie selon la raison.C'est là que Spinoza dénonce comme Marshall Sahlins ouSen, Sartre "la fiction finaliste d'une nature humaineuniverselle que l'on trouve déjà dans la métaphysiqued'Aristote.:"les principes que nous disons universels n'existentpas : le principe de ceux-là qui existent, l'hommeuniversel n'existe assurément pas " (Mét A, 5 1071a 19-23)Qui répète la diatribe d'Aristote contre la conceptionidéaliste égalistariste de Platon. C' est ici un choixméthodologique empirique qui élimine d'emblée lapertinence d'un universalisme abstrait. En considérantles hommes empiriquement tels qu'ils sont, et non telsqu'ils devraient être. Pour Aristote comme pour Spinoza;, la multitude est le meilleur juge, car elle est plusdifficile à corrompre.
Epistémologiquement, dans cette approche, le libre nes'oppose pas au nécessaire mais au contraint (conatus)la liberté par l'autonomie d'un agir rationnel.Contrairement à Aristote qui reste platonicien en cequ'il considère que les affects ne se prêtent pas à lamathematicité, Spinoza ajoute par son éthique unedimension fonctionnaliste que nous retrouverons dans lapensée structuraliste puis sennienne"Considérer les actions et les aptes humains commes'ils étaient question de lignes, de plans ou de corps"(Ethique, 3, préface)et permet de repenser les rôles respectifs del'universel et du singulier
Il peut dès lors distinguer deux sortes d'universels1° les universaux et les transcendantaux (deux sivenatura)2° les notions communes (la republique)et un troisième genre de connaissance qui envisage lesparticuliers sous l'angle de l'intuition., le tempscomme ce qui nombre le mouvement.
Comment concilier déterminisme et hasard oudéterminisme et liberté si ce n'est en faisant que laliberté ne soit pas un hasard mais un acte qui s'opposeà la contrainte ?La modalité éternelle est temporellement indéterminée,car le refuge dans une causalité extraordinaire est lerefuge de notre ignorance. (éthique I 16, corollaire)Ce qui permet à Spinoza de distinguer deux causalités:et définit que certaines liaisons causales sontaccidentelles. "Nous disons que l'étant se divise en substance et enmode et non pas en substance et en accident. Carl'accident n'est rien de plus qu'un mode de penser" il veut séparer le mode et l'accident alors que lasubstance justifie le nécessarisme.
La causalité accidentelle réintroduit une certaineforme de contingence dont le lien avecl'intentionnalité qui sera mise à jour dansl'épistemologie de la pensée de la complexité pour lessciences contemporaines (voir Atlan notamment)
Tout se passe comme si la science donnait accès àl'universel épistémologique sous une forme évidente.Mais comment assurer le passage de cas particulier àl'universel ? L'induction est insuffisante à cettetâche. Mais Spinoza ajoute que cela est tributaire de lasubjectivité de chacun.
" Mais pourtant..j'ajouterai brièvement les causes à partir desquelles onttire leur origine les termes dits transcendantaux comme Etant, chose,quelque chose... Ces termes naissent de ce que puisque le corps humainest limité, il n'est capable de former en soi distinctement qu'un certainnombres d'images à la fois; et si ce nombre est dépassé elles seconfondent entre elles" (Ethique II, 40)
Argument qui sera repris par Levy Strauss dans Dans l'analysestructurale, : pour qu'un domaine déterminé soit circonscrit et acquiertson statut d'objet autonome, il faut que son caractère de système soitreconnu et que l'on ait repéré sa fonction en linguistique la fonction decommunication est évidente mais il faut passer de l'idée qu'un systèmeentre guillemets sert à quelque chose à son acceptation mathématiquec'est-à-dire l'idée d'un rapport constant entre des phénomènes, ceci pouréviter les erreurs du fonctionnalisme en anthropologie. Le langage offre donc un terrain très favorable à l'analyse structurale.
Pourquoi repenser aujourd'hui la querelle dustructuralisme dans les années 60 telle qu'illustréepar le dernier chapitre de la "Pensée sauvage où LevyStrauss défend le structuralisme contre une penséedialectique de l'histoire chez le Sartre de la critiquede la raison dialectique ?
Structure et histoire contingence hasard les modèles destinés à rendre compte des structures y sont en généralrelativement simple et aisément représentable en deux ou troisdimensions alors que les modèles équivalents dans le mythe ou lamusique exigerait immédiatement une multitude de dimensions qui lesrendraient difficilement accessibles à l'intuition. C'est cette articulation entre structure et intuition qui nous intéressera. Est-ce que la structure est incompatible avec le mouvement de l'histoire ?Comment l'anthropologie, science des organisations et desreprésentations sociales qui étudient la structure plutôt que la genèse lerésultat plutôt que le devenir peut-elle interpréter l'impact de l'événement
sur le ceci sur les sociétés (même numéro d'esprit.) Ainsi dans le dernierchapitre de la pensée sauvage Lévi-Strauss veut dissiper une équivoquepour ne pas fonder l'anthropologie sur des présupposés philosophiquescontestables. Lévi-Strauss analyse une triple diversité dans le temps, dansl'espace, dans l'espace et le temps qui caractérise l'objet même del'anthropologie et rendent cette science complexe.« C'est une discipline dont le but premier, sinon le seul est d'analyser etd'interpréter les différences » anthropologie structurales page 19
Pour éviter de tomber dans le relativisme Levi Strauss doit trouver uneunité de référence pour interpréter les différences sans les dissoudre telleest pour lui la question fondamentale de l'anthropologie. Il y a donc biendes analogies entre anthropologie et l'histoire puisqu'elles sont toutesdeux des sciences de l'altérité même si l'histoire étudie seulement unedimension de la diversité qui est la diversité dans le temps. Privilégier ladimension du temps matière de prendre comme unité de référence la «civilisation occidentale » dont on postule, qu'elle serait l'expression la plusavancée de l'évolution humaine (voir anthropologie structurale page six).Si pour égaler la victoire cumulative sans quitter notre société noussommes assurés a priori de pouvoir comprendre les autres cultures en lesramenant à l'unité de notre devenir. Mais cela suggère une erreurméthodologique basée sur une double réduction : les sociétés antérieuressont assimilées à des étapes antérieures de notre développement sauvagecomme si silence était l'etape antérieure de l'ordre d'apparition dans letemps. La diversité dans l'espace est ainsi réduite à la diversité dans letemps chaque société illustrant 1° de l'histoire de l'avenir de l'humanitéunifiée selon ses postulats serait alors justiciable d'une logique quigarantirait l'intelligibilité du passage d'une forme de société à une autre.L'anthropologie serait réductible à la description du développementgénétique de l'humanité ou se confondrait anthropologie et histoire. C'estprécisément ces postulats que critique Lévi-Strauss comme doxasvéhiculées par notre culture depuis plus d'un siècle ce sont bien lespostulats de la philosophie hégélienne. Selon Lévi-Strauss, Sartre reprendplus ou moins explicitement ses postulats et est donc soumis au mêmegenre de critique. Levi Strauss dit refuser " une histoire sans document." La validité épistémologique n'est garantie que par un enchaînement deconcepts abstraits et non par des constatations. Levi Strauss questionnecette coïncidence du logique et de l'historique.Il utilise une logique
analytique plurielle puisque plusieurs ordres de déduction y sontpossibles. « Un choix illimité de critères permettrait de construire un nombre illimitéde séries différentes » (Anthropologie structurales p.8) entre ces divers scénarios, seuls les faitspeuvent trancher ; ainsi il n'y a pas une seule histoire mais des histoires, etdonc des universaux. Lévi-Strauss refuse d e partir d 'une analogie partielle pour conclure àl'identité. « Le procédé consiste à prendre la partie pour le tout, à concluredu fait que certains aspects de deux civilisations offrent desressemblances, à l'analogie de tous les aspects. Or non seulement cettefaçon de raisonner logiquement insoutenable, mais dans bon nombre decas et les démentis par les faits » Race histoire page 252 Pour Levi Strauss des sociétés ne sont jamais entièrement comparablescar chacune se définit par une multitude de déterminations qui font d'elleun individu unique dans l'espace et le temps. Il refuse de fonderl'anthropologie sur cette forme d'histoire entendue au sens d'unitégénétique de toutes les sociétés humaines. Argument que nous retrouvonschez Marcel Sahlins. Mais s'il n'y a pas unification par l'histoire ne risquons-nous pas deretombées dans le relativisme ? Comme Spinoza Lévi-Strauss échappa cet écueil en articulant l'unité à unniveau plus fondamental ou plus radical qui est celui des conditions depossibilité de toute organisation sociale. Il analyse des différents systèmeset leur articulation en montrant qu'ils ne se sont que l'application d'uncertain nombre de lois logiques qui se retrouvent dans toute société cesont là les invariants qui donnent l'unité nécessaire pour fonderl'anthropologie et force par la même à repenser un universel concret.
Les invariantsCes invariants sont déshérités de la raison qui existe pour lui dansl'inconscient qui est une traduction de l'intuition spinoziste. « L'inconscientest le cas médiateur entre moi et autrui il nous met en coïncidence avecdes formes d'activités qui sont à la fois nôtres et autres » préfaces à Mauss
l'altérité n'est donc un acte dans l'actualisation, le tout n'a pasd'existence actuelle nous devons sortir de l'actualité vers le virtuel ;
et pour comprendre les autres sociétés seules ces distinctions du vrai et duvirtuel et de l'actuel permet de respecter la diversité des sociétés. ainsi nous sortons de la mythologie des peuples enfants il n'y a pas degenèse à cet égard , le chapitre quatre de la pensée Sauvage nous éclaire car Lévi-Strauss yanalyse les états intermédiaires entre une société dite totémique est unesociété de caste. Il montre que le déroulement historique particulier d'unesociété ne trouve son intelligibilité complexe que si les replacer ainsi dansla table des possibles. Ainsi ce qui nous intéresse ici c'est l'idée que fonderl'anthropologie sur l'histoire n'était possible que si on restait attachée uncertain nombre de présupposés philosophiques que Lévi-Strauss a révélécomme inacceptable. Comme Spinoza Lévi-Strauss se base sur l'évidence que toute sociétéchange. Dans sa leçon inaugurale il nous dira :l'idée d'une histoire structurale n'a rien qui puisse choquer les historiens iln'est pas contradictoire qu'une histoire des symboles et des signesengendrent des développements imprévisibles, bien qu'elle met en oeuvredes combinaisons structurales dont le nombre est limité. Dans unkaléidoscope, les combinaisons d'éléments identiques donnent toujours denouveaux résultats » leçon inaugurale page 23il affirmera également que « la dialectique structurale ne contredit pas ledéterminisme historique est l'appel illégal d'un nouvel instrument »anthropologie structural, page 346. Il admet néanmoins qu'il y a unesorte d'antipathie foncière entre l'histoire et le système voir pensersauvage de 307 »constamment se maintient une situation fondamentale qui relève de lacondition humaine, il y a toujours une inadéquation entre signifiants etsignifies qu'il résulte de l'existence d'une surabondance de signifiant parrapport au signifié sur lesquels elle peut se poser » c'est nous dit Lévi-Strauss la condition même de l'exercice de la pensée symbolique s'estsatinée inadéquation de principe qui confère en modèle des propriétésdynamiques. On a ainsi opposé Lévi-Strauss comme homme des systèmesfigés cristallisés contre une philosophie du sens ambigu et jamais fixémais cette lecture est réductrice puisqu'il dit lui-même que le signifiant etle signifié ne sont jamais exactement adaptées, et que nous sommessoumis un perpétuel effort de réajustement de signifiant creux quiprécisément entraîne ces sociétés dans les transformations perpétuelles.Il ajoute dans la leçon inaugurale ce qui pourrait être une définition de
l'universel « la multiplicité des systèmes inconscients, dont chacun concerne unaspect ou un niveau de la réalité sociale. Ces systèmes sont commediffractés sur une dimension temporelle dont l'épaisseur d'une synchroniesans consistance. À défaut de quoi elle se dissoudrait en une essenceténue et impalpable, un fantôme de réalité » leçon inaugurale page 25Ce qui intéresse Lévi-Strauss est donc bien l'élimination des illusionslaissées par la subjectivité. « Il faut comprendre l'être par rapport à lui-même, et non par rapport àmoi » Triste tropiques chapitre cinqà quel niveau qu'on analyse le devenir, il nous surprend par l'infinité deschangements qu'il recèle, une société est toujours confrontée à sonextérieur si bien que la connaissance intégrale dépasse les forceshumaines. L'anthropologie remonte ainsi de la multiplicité des faits à leurs conditionsde possibilité. Ainsi pour Lévi-Strauss la philosophie de l'histoire est nonseulement conjecturale mais aussi idéologique, sa méthode et l'analysedes différences essentielles contre les simplifications abusives de laphilosophie de l'histoire hégélienne. Mais son exigence d'objectivité s'infléchit vers la stratégie du positivismeoccidental selon Marc Gaborit , eu voulant fonder toutes les différends surl'identité de la nature en soi. , Lévi-Strauss met ici en péril la profondeur de son analyse del'inadéquation. C'est peut-être là la limite du structuralisme que tente d erepenser sahlins . Dans son dialogue avec Ricoeur où celui-ci nequestionne sur l'unité de la pensée mythique et donc sur le rapportstructure- événement, ce paysage philosophie que j'aperçois dans le lointain mais que je laissedans le vague parce qu'il n'est pas sur mon itinéraire. Il reconnaît ladimension kantisme sans sujet transcendantal, une autre manière de direle spinozisme de Lévi-Strauss. la pensée sauvage n'a aucun caractèreprédicatif, elle désigne le système des postulats et des axiomes requispour fonder un code permettant de traduire l'autre dans le nôtre etréciproquement. « Au fond de la pensée sauvage mais dans mon intentionque le lieu de rencontre, l'effet d'un effort de compréhension, de moi memettant à leur place d » sois une histoire est verrouillé par le mythesoit laissée ouverte comme une porte sur l'avenir dit Lévi-Strauss.Mais nous sommes prisonniers de la subjectivité nous ne pouvons pas à la
fois comprendre les choses du dehors et du dedans l'entreprise quiconsiste à transporter si je puis dire une intériorité particulière dans uneintériorité générale me semble d'avance compromise "le. Point le plus intéressant pour moi que dans tout ce débat Levi Straussn'utilise pas le concept d'universel puisque nous sommes des hommes quiétudions des hommes nous pouvons-nous offrir le luxe d'essayer de nousmettre à leur place. Mais est-ce que cela fonctionne? le travail essentielconsiste à démontrer le mécanisme d'une pensée objectiver, il y a mieux àfaire que de reprendre les termes mêmes de la critique de rigueur. il y aune participation affective dans le réseau structural Lévi-Strauss répondque la mythologie de la révolution française soulève la question de savoirsi ce que nous essayons d'atteindre est vrai par la conscience et pour laconscience que nous en avons ou en dehors de cette conscience il n'y apas choisir entre le subjectivisme d'une conscience immédiate du sens etl'objectivité d'un sens formalisé. Contre une pensée généalogique naïveselon laquelle les choses se suivent génération par génération, dansl'espace temps et une pensée généalogique spéculative à la Hegel, selonlaquelle il y a un développement généalogique, une phénoménologie del'esprit. ce développement généalogique n'étant que le développementd'une structure initiale totale qui est celle de la grande logique égale. Maisdans la réflexion critique envers Jean-Paul Sartre l'idée que l'histoire used'un code, que l'essentiel de son système de codage c'est la chronologieest donc un savoir important mais très limité l'histoire consiste pour LeviStrauss à obscurcir le jaillissement du sens. Ce Lévi-Strauss rappelle que dans le dernier chapitre il n'y a pas du toutfait une critique de l'histoire il a simplement essayé de réagir et de serebeller contre une tendance de la France philosophique de l'époque(Sartre Merleau,) de considérer que la connaissance historique était uneconnaissance d'un genre supérieur aux autres. "Je me suis borné à affirmer que l'histoire était une connaissance commeles autres qu'il ne serait existé de connaissance du continu, maisseulement du discontinu l'histoire est un code et donc la connaissancehistorique souffre des mêmes infirmités que toute connaissance". Il faut commencer à découvrir les séquences récurrentes dans un devenirqui ne permet pas toujours d'isoler des termes de comparaison. leproblème des structures diachroniques est trop complexe. Le signe est unopérateur de la réorganisation de l'ensemble, tandis que le concept est unopérateur de l'ouverture de l'ensemble.
La science moderne dans son progrès retrouve par elle-même un certainnombre de choses qui lui permet de porter sur la pensée magique. Lesphénomènes économiques sont un exemple favorable dans la mesure oùnous observons d'abord une société où ils ont joué un rôle essentiel depuislongtemps d'autre part le rythme la périodicité sont rapides il s'est passéun grand nombre de choses en I siècle dont un certain nombre derécurrences de sociétés capitalistes sont ainsi faites que tous cesphénomènes se sont trouvés inscrits recueillis dans des documents onpeut donc les reconstituer. S'il y a chez le philosophe une exigence du toutou rien, s'il désire que la cohérence maintienne l'ethnologue et plusinsouciant du lendemain il essaie de résoudre un problème et puis unautre si une contradiction entre les implications philosophiques des troistentatives ne s'en tourmentera pas car pour lui la réflexion philosophiqueest un moyen, non une fin. La question est de savoir si notre problème est de penser ou de donner unsens il ajoute que je ne serai pas effrayé si l'on me démontrait que lestructuralisme débouche la restauration d'une sorte de matérialismevulgaire. Ricoeur l'accuse alors d'être dans le désespoir du sens « voussauvez le sens mais c'est le sens du non-sens, l'admirable arrangementd'un discours qui ne dit rien je vous vois comme cette conjonction del'agnosticisme et d'une hyper intelligence syntaxique par quoi vous êtes àla fois fascinants et inquiétants » cette lecture de Ricoeur ne semblenéanmoins inadéquate car elle est kantienne et non spinoziste,destruction d'une certaine forme d'universalisme
Spinoza conçoit en effet la formation de l’universelcomme troisième genre de connaissance qui n'est plusfactuelle, mais relève de l'intuition immédiate.
C'est là une différence essentielle qui influencera leconcept d'universalité éthique 1° Si pour Aristote, le savoir éthique s'inscrit dansle genre dialectique à partir de la confrontationd'arguments, pour Spinoza cette dimension des jugementsparticuliers n'est certes pas ignorée, néanmoins il sepropose d'arracher la problématique éthique du régimedu premier genre de connaissance pour la placer dans
celle du second genre qui elle va démonstrativement descause aux effets, puis au troisième genre pour en faireune science pratique qui élimine le problème du risquede relativisme éthique que nous avons rencontré tout enpartant du désir du bien de l'agent. Il fera du lecteur, celui dont dépend le succès de lathéorie, par sa transformation en agent..une idée quenous retrouverons dans le modèle de Levy Strauss et deSen. qui sont tous trois des modèles immanentistes.
Traduction pratique de l 'universel dans une pensée de l'immanence ?
Que devient cette idée de structure dans la pensée immanentistecontemporaine? et aussi :comment faire que le relativisme culturel décrit par l'ethnologiene soit pas l'équivalent de l'indifférence morale ? ou de cettetolérance qui mène à tolérer l'intolérable. D'où laréflexion de Hegel qui nous ouvre à la question de lareconnaissance qu'a réactualisé Honneth et, Ricoeur ouSen. Dans la tradition Hégélienne, le désir reste lié àla reconnaissance,
Nous sommes donc bien auj à une croisée des chemins etle choix sera un renoncement à des voies d'explorationqui restent néanmoins ouvertes.
Notre parcours nous a mené à mettre en parallèle ledébat entre Aristote et Spinoza, puis le débat Strauss-Sartre et son impact sur la pensée de l'universel de 60a 80 pour revenir à notre époque et repenser le lienentre universalisme et cosmopolitisme ou unUniversalisme comme norme productrice de reel actif. A travers Sen, Marshall Sahlins, Castoriadisnotamment ; dans leur renouvellement des questionsposées par l'universalisme dans un contexte ou lepluriel de l'unique, la reproduction, la traduction aplus de valeur que l'unique ou de l'unicité d'une arché
à laquelle personne ne semble plus désirer croire enOccident. Mais la place occupée par l'universel reste-telle vide ? N'y a-t-il plus que des raisons pragmatiques voireépistémologiques et éthiques de défendre le conceptcentralisé d'universel dans sa diachronie même? Le pluri-universalisme peut-il faire sens dans unmonde globalisé où le centre n'est plus nulle part caril est partout, alors que le sujet lui semble prisentre un relativisme éthique incohérent ou ununiversalisme dogmatique inopérant? S'agit til d'uncomme si dont les bénéfices dépassent les risques entermes de construction narrative d'un reel fuyant dontla complexité semble engloutir toute possibilité desymbolisation? ? Si les sciences sociales accumulent depuis les années60 des connaissances sans précèdent sur la diversitédes cultures , l'effort vise a thésauriser et conserverce patrimoine culturel plutôt que d'élaborer uneréflexion théorique pour penser la diversité de cepatrimoine dans le temps et dans l'espace. La diversitéculturelle sans structure devient cacophonique et à deseffets politiques pervers de repli identitaire, celaconduit à affirmer une autonomie factice de la sphèreculturelle. Par rapport aux domaines du politiques. lerisque épistémologique est réduit les faits humainsplurielles aux psychologiques aux neurologiques auphysico-chimique sans pouvoir reposer sur l'idée d'undéterminisme universel qui pourrait réagir tous lesniveaux de la réalité en couches successives d'être etdonner sens aux efforts de sciences sociales.. la conception critique de l'interprétation ne reconnaîtpas d'autre objectivité que celle d'une subjectivitémultipliée., si Claude Lévi-Strauss en travaillant surl"Emile avait inventé une approche ou universalisme etdifférence n'était pas contradictoire, Triste Tropiquesreste l'une des réponses les plus magistrales audiscours du choc des civilisations, à l'opposition
entre Orient et et Occident qui font resurgir lesreprésentations essentialiste des cultures. Ces représentations dualistes font resurgir undiscours hiérarchisant opposants civilisés et barbareset il redevient urgent dès lors d'appréhender commeprojet l'unicité de la condition humaine dans sadiversité en déplaçant le centre de notre universmental. Lévi-Strauss a été le premier à rejeter ce qui « rangeles peuples étudiés dans des catégories séparées de lanôtre, les mettant au plus près de la nature commel'implique l'étymologie du mot sauvage qui vient dulatin silva ou forêt. Aux yeux de Lévi-Strauss dansRace et histoire en 1952, puis dans la Pensée sauvage lesmodes de pensée des sociétés dites primitives ne sedistinguent pas par leur degré de rationalité. Lapensée dite sauvage est aussi logique que la nôtre etsi l'universalisme occidental était sous-tendue parl'idée d'un progrès linéaire défendu notamment parMontesquieu, Hegel et, Marx, Weber ou Durkheim, il faitapparaître un universalisme autre fondé sur l'idéequ'il existe des lois de l'activité mentale commune à toutes lescultures. Il opère ainsi une révolution du regard quidépasse à la fois l'empirisme, lequel prétend décrireune réalité supposée objective, et un certainfonctionnalisme celui de Malinowski qui pense que lesstructures mentales inconscientes ne font querépercuter certaines exigences de la vie socialeincarnée par les institutions.
Lévi-Strauss nous apporte une nouvelle approche de laréalité sociale, fondée sur une analyse structurale,c'est-à-dire un ensemble des signes et des systèmessymboliques qui créent du sens dans la vie collectivesans référence à un quelconque finalisme, et qui n'ontrie à voir avec le nihilisme craint par Ricoeur. Levy Strauss cherchait à forger une science humaine quiembrasse la totalité des faits sociaux par le biais de
leur interprétation en termes de ce qu'il appelle unelogique inconsciente et que Spinoza appelleraitl'intuition fulgurante du troisième degré deconnaissance. Cette démarche a été au coeur des échangesintellectuels et politiques des années 60 certainscomme Cliford Geert aperçu le structuralisme comme unhyper rationalisme d'autres comme Roger Caillois y ontvu un relativisme culturel menaçant alors que lestructuralisme permettait enfin de penser la pluralitédes modes d'être ; d'affirmer que toutes les sociétéshumaines sont des expressions pleines de l'humanitésans valeur hiérarchique. Ce moment essentiel est-il unpremier moment acquis de ce que Balibar héritier decette pensée l'égaliberté 7 où un moment sur lequel ilnous faut revenir ? Depuis le succès de TristesTropiques et sa collaboration avec Jacobson à l'analysestructurale des chats de Baudelaire la question de latemporalité est liée à la Narratologie. pour Lévi-Strauss remonte de la logique des termes à la logiquedes jugements et extrapole les notions fondamentales deproches, d'éloigné et de médiation qui sont ensuiteappliqués aux relations entre la nature et l'homme. la mythologie est intégreée dans l'ensemble de l'espaceculturel mérite les habitudes des idées religieuses ledélit ils développent des principes méthodologiquesd'isomorphisme et de complémentarité tout transposée audénominateur commun la signification ce qui permetl'application de méthodes élaborées par la logique etmathématique, ainsi plus que le contenu du mythe c'estsa fonction par rapport aux autres mythes qui comptentpenser de la sorte la fonctionnalité devient une sortede lien relationnel avec d'autres mythes.
7 Voir Balibar
Immanence dynamique et narrativité Le modèle structural de Lévi-Strauss est un système àla fois plein est clos, où coexistent des élémentsstructurels et extra structurels il développe ainsi unimmanentisme structuraliste qui ne saurait accorder deplace à toute forme de temporalité, l'approcheparadigmatique et synchronique est préférée à toutediachronie ce sont les éléments narratifs quimatérialisent en quelque sorte la présence du tempshistorique.. le problème notionnel de la temporalité,posé sur le plan thématique, ce résidu sur le plannarratif par l'accroissement de l'importance del'action dans les temps cyclique de l'éternel retourconcerne les entités si réduites que c'est l'aspectcumulatif et linéaire du temps qui commence às'imposer. C'est un premier pas dans le tempshistorique Lévi-Strauss parle de durée historique quil'oppose à l'espace synchronique. Le temps et ladynamique temporelle constitue à ses yeux un scandaleauquel on ne peut se résigner que comme un malinévitable. Mais la situation change avec les mythes dela périodicité courte qui remplace la dispositionmétaphorique spatiale par la temporelle la catégorie dutemps n'est pas une catégorie innocente deux que letemps est représenté et transfiguré par le mythe. Lemythe devient récit, roman l'axe syntagmatique assumeune fonction signifiante créatrice de sens qui fait duconteur un agent participatif à l'histoire du monde.Lévi-Strauss découvre alors la possibilité d'uneimmanence non plus statique mais dynamique. Les analyses de Jean-Pierre Vernant introduisent lefacteur temporel dans la structure. Lévi-Strauss acertes entrevu l'importance de la temporalité tout enla considérant comme la dégradation du mythe la
narration est la temporalité intrinsèque du récit maisaussi facteurs extérieur aux contingences de lasituation historique et sociale. Il dira « enfin, aulieu d'une histoire inspirée par une notion de justicedistributive et s'achevant sur la séparation desprotagonistes en deux camps : les mauvais sont punis,les bons sont pardonnés, nous avons ici une intriguedont la marche conduite à une issue tragiqueinéluctable tous ces caractères montrent qu'avec cetteversion un passage décisif s'effectue d'une formulejusqu'alors mythique à une formule au romanesque (voirnuméros d'esprit Mai 1963) consacré à a pensée sauvageet au structuralisme :"il ajoute le passé est l'amorce d'un avenir quicommence à se dessiner » cette analyse est développée àla fin du troisième volume des mythologiques etréaffirme que le temps n'est pas une catégorienarrative innocente. Cette introduction du temps narratif est une brèchedans son modèle structural mais aussi une ouverture quipermet un nouveau regard sur la fonction temporelledans la narration. Il montre le lien entre la structurequi se veut universelle et la particularité du récitnarratif qui seule peut la rendre présente. Cette miseen perspective du savoir, questionne le fantasme del'un, du monothéisme et de l'universalisme. Ce toutélément ramené au dénominateur commun le un etsémantique non transformable en un autre élément toutcorrespond à tous, je communique avec tout, jusqu'àépuisement de toute éventualité. l'enjeu du débat entre Lévi-Strauss et Sartre dans lapensée sauvage Il confronte L'idée de l'attention entre structuresimmanentes et histoires dont l'enjeu ne concerne pourredéfinir l'enjeu de l'universalisme aujourd'hui.
Je constate en m'appuyant sur le tournant des années 60et 80 dans leur rapport à l'anthropologie et auxsciences sociales que cela me permet d'interroger lalégitimité d'une revendication d'un certain universelaprès son rejet radical par les sciences sociales. Alors que Sartre, Ricoeur, Derrida était à la foisfascinée et effrayé par les implications philosophiquesde l'anthropologie structurale. Si Lévi Strauss a fait peu de terrain, l'ethnologiequ'il a développée est une capacité de décentrement dusujet visant à poser autrement les problèmesimmémoriaux de la philosophie., non en termes destructure mais en termes de dialectique.
Cette question se cristallise dans le débat entre LevyStrauss et Sartre puis dans sa version plusconservatrice dans le débat avec Aron sur l'histoire. Quel est son impact l'universel anthropologiqueaujourd'hui ? je tenterais de faire dialoguer anthropologue MarshallSahlins et Balibar afin dé montrer l'enjeu éthique dela porosité des frontières disciplinaires. Pour penserces concerts transversaux que sont l'histoire, le tempsuniversel ou pluriel.
La reprise delà métaphore du sceau de cire issue duTimée(50 CD et qui sera reprise par Descartes. (lemorceau de cire est précisément mentionnée par Aristote dans son exposécritique de doctrine s.d. de Platon en Métaphysique 1987b)A l'aide du même sceau pour expliquer la multiplicationde l'un dans le multiple. L'objectif poursuivi par Aristote étant laréconciliation de trois points de vue 1° théologique (Platon)
2° logique 3° et noétique Une manière de trouver un moyen terme entre théorieplatonicienne des idées et théorie Aristotélicienne del'abstraction.
L'anthropologie structurale est la tentative de décriresous l'apparence d'arbitraire des phénomènes humains,un ordre qui leur donne sens. Ce sens n'est pasnécessairement celui que leur donnaient des acteurs.Cette méthode vient de la linguistique structurale, quien partant du caractère arbitraire du signe a dégagéles lois d'opposition régissant le système de lalangue. Ce fut une révolution car le sens d'unphénomène n'est plus cherché dans ce que disaient lesacteurs; (dans leur conscience ou leur vécu, mais dansun ordre extérieur qu'il faut chercher au moyen d'uneenquête sur les conditions et le contexte qui lescontraint à agir d'une certaine façon. La formation philosophique de Levy Strauss lui donnenéanmoins le souci de se situer au niveau descontraintes universelles de l'esprit humain maisautrement que ne le fait la philosophie. Et c'est surcet autrement que nous aurons à nous interroger pourdépasser le clivage entre universalisme et relativisme.Jacobson lui a apporté une manière de repenser lesoppositions binaires de la métaphysique, entre lalinguistique de Saussure et la phénoménologie deHusserl la structure et la lebenswelt. Du sujet à l'agent
En s'inspirant de Mauss, Levy Strauss reprendra l'idéeque les oppositions intellectuelles sont déjà présentesdans le mythe. Il emprunte cette idée à Marx selonlequel les idéologies expriment des contradictionssociales et que le mythe n'est rien d'autre qu'un récit
auquel on ne participe pas.C'est une tentative de rapporter toutes les oppositionsdifférentielles obscures à une même matriceintellectuelle. L'universalité (quasi biologique) del'esprit humain comme détermination. les structures jouent le rôle d'un synthétique a prioriqui se passe très bien de sujet car elle n'ont besoinque d'un agent. Levy Strauss est persuadé qu'un modelé mathématiquesera plus opératoire pour les sciences sociales qu'unmodèle empêtré dans la métaphysique. Ce sera le développement d'une théorie de l'esprit sanssujet. Cela parle lorsque l'homme croit parler,autrement dit l'hétéronomie précède et conditionnel'autonomie du sujet parlant. Ceci permettra un grandintérêt pour le modèle cybernétique. La technique eneffet révélerait la vérité quant à la nécessité de ladéconstruction du sujet. C'est pour quoi la construction et le postmoderneseront la dimension temporelle de notre interrogation.
Quel humanisme face à l'homme machine ? Y a-t-ilidentité des êtres vivants et des objets techniquesautorégulés ? 8
Pour Levy Strauss l'esprit comme l'universel est moinsce dont on part que ce à quoi on arrive. Levy Strauss est donc d'abord très optimiste quant à lacapacité humaine d'établir a posteriori un ordreuniversel; ce qui reste cohérent avec la des-utopiespinoziste.
La place du sujet une vielle histoire qui réémerge
Il n'est pas anodin de souligner que l'humanisme judéo-chrétien s'est trouvé contesté par l'éthique spinoziste
8 Simondon, Du mode d'existence des objets techniques" Aubier Montaigne, paris 1969
comme par la linguistique structurale car Levy Straussavait une passion pour la pensée structurée de Spinoza.Sartre, Ricoeur, Merleau Ponty seront à la foisfascinés et méfiants envers la pensée structurale et saremise en compte radicale du sujet cartésien.
L’ethnologie est une capacité de se décentrer c'estainsi qu'en regardant Sartre il dira dans la penséesauvage"Sartre se situe vis-à-vis de l'histoire comme leprimitif vis-à-vis de l'éternel passé".Dans le système de Sartre l'histoire joue le rôle d'unmythe c'est-à-dire un récit auquel je ne participe pasajoute-t-il. Ainsi si pour Spinoza tout est régi par les lois de lanature (Deus sive natura), les affects qui agissent surl'homme sont eux aussi partie de la nature. C'est ainsique chez Spinoza déjà l'anthropologie fonde lepolitique
Dans l'universel singulier publié par Sartre dansKierkegaard vivant, L’être prénatal de Kierkegaard est homologue à son êtrepost mortem. Mais pour Sartre une connaissancerationnelle de l'histoire est possible.
Il présente la CRD comme une révision de la penséemarxiste, le développement de la pensée marxistes'étant figé historiquement. Mais la pensée marxiste de Sartre manquait d'une baseontologique. Elle ne donnait pas d'explicationsatisfaisante sur ce qu'était un être de classe ou lasignification d'appartenir à une classe. C’est lié ausystème hégélien qui attribue aux groupes une viemétaphysique ou méta empirique.
Pour Sartre néanmoins l'être d’une collectivité est
problématique en soi. L’être individuel est une secondestructure ontologique. Il est donc nécessaire pourSartre de recouvrer un acte génératif ou la consciencehumaine individuelle puisse échapper à la contingencepour se faire auteur de soi, il a consacré la critiqueà se confronter à cette question. Le sous-titre de la critique est néanmoins "la théoriedes ensembles pratiques " et un ensemble pratique n'estpas nécessairement une classe.
Retour vers l'epistemologique
L’universel épistémologique et l’universel éthiquelecture de Spinoza par Atlan qui n'est pas sansrapeller l'approche structuraliste :
Pour différencier une intentionnalité finaliste d’uneintentionnalité fonctionnaliste Atlan se demande : Quelles sortes de machine sont capablesd’intentionnalité ? Est-ce qu’une intentionnalité mêmelimitée peut émerger dans un processus auto-organisateur « les sciences de la nature se développentconcrètement selon des critères de vérité etd’efficacité locaux qui les dispensent de fondementabsolu » (Atlan p. 247)
Selon ce modèle les fondements a priori et universelsapparaissent comme des constructions après coup quin’ont pas d’efficacité pratique. Ce qui lui permet de souligner que la position deSpinoza n’est ni idéaliste ni matérialiste ; puisquedans ce modèle épistémique l’esprit exclut unecausalité de l’esprit sur le corps puisqu’ils ne sontque deux aspects d’une même réalité, qui elle ne peutêtre décrite comme enchaînement des causes que dansl’un ou l’autre de ces aspects. La notion
d’intentionnalité prend alors le sens de comportementd’agents rationnels adaptant leurs moyens à leurs finset n’ont donc plus besoin d’un agent intentionnelexterne pour agir ce qui est le fondementépistémologique même de l’éthique spinoziste. Ce qui permet d’affirmer que la biologie n’a pas besoinde programme et permet de transformer une séquencecausale en procédure. Ce qui donne une impressiond’inversion du temps qu’impliquait le modèle finalistedes causes et des effets.
« Une fois qu’une séquence temporelle d’états oud’événements est mémorisée, son ordre passé futur esttransformée en un ordre d’indexation ou le tempsdisparaît » (p.260)
Ce qui n’est pas sans implication avec le débat entreLevy Strauss et Sartre sur histoire et structure.L’hypothèse étant que dans un modèle monisteimmanentiste
« la fonction de satisfaction doit être produite par lesystème lui-même comme un effet non programmé de sonhistoire » Ce qui permet d’éviter une régression à l’infini dansla recherche de l’universel ou du summum bonum carl’état désiré n’est pas a priori, mais est simplementl’état le plus probable produit par des contraintesdéterminées par des lois physico-chimiques defonctionnement. Si dans la littérature cognitiviste une façon classiquede relier l’intentionnalité à la poursuite d’un butconsiste à décrire un comportement téléologique etfinaliste Le modèle proposé par Atlan est fondée sur l’éthiquespinoziste envers le modèle de la survenanceL’alternative est de concevoir un processus orientévers un but par des mécanismes causaux, sans recourir à
des représentations internes et a priori. Cela permetde renforcer la presse intentionnelle par une dynamiquede réseau qui est identique à celle que produitl’action elle-même et met donc fin à la schizophrénieentre l’universel a priori et les multiples del’expérience immanente.En termes de temporalité, une réflexion sur lecaractère néanmoins relatif du temps défini par dessystèmes pluriels qui produisent leur propre temps ousystème de signification ne mène pas nécessairement aurelativisme mais dans un modèle qui n’est plussynchronique et qui n’oppose donc plus le passé commela cause du futur nous sommes face à une oppositionfonctionnelle entre connu et inconnu/ (Atlan biologieet organisation)Si le modèle est moniste ce modèle biologiques’applique par conséquent à une intentionnalitérévisée. Cette intentionnalité relève du fonctionnementdu conatus spinoziste ou la connaissance etl’intelligibilité de la nature sont vues comme partiesd’un entendement infini. Puisque pour Spinoza, il n’y apas de différence entre volonté et entendement (éthique2, prop. 49 corollaire). Cela lui permet d'admettre que« les notions ne sont pas formées par tous de la mêmemanière « sans tomber dans l’irrationalité relativistemais d epermettre une approche pluraliste qui faitplace à la multitude.En effet, si l’émergence dessignifications apparaît avec un degré de contingenceelle est néanmoins déterminée par le deus sive natura.qui est l'unversel abstrait chez Spinoza alors que larepublique est sa relatisation concrete Et nereprésente qu’un moment de la formation du jugement.Cette sous détermination n’est dès lors que l’effetd’une stabilité structurelle et d’une robustesse de ladynamique systémique. C’est même cette propriété qui est la condition del’intersubjectivité car ce qui importe n’est pas ladiversité des causes qui mène l’agent à l’action qui ne
sont donc pas immédiatement universelles etrationnelles mais la conclusion que ces différentsmodes de pensée permettent de construire de manièreintersubjective. Cela à une implication en termes d’universalismeéthique qui est fondamentale comme le souligne Atlan:
« il n’est pas nécessaire de s’accorder sur lesprincipes pour s’accorder sur des conclusions pratiquesconcernant une situation particulière" ce qui estcontraire à tout discours moralisant et permet unpluralisme qui n’est pas l’équivalent du relativismepuisque les conclusion peuvent être dérivés de systèmesde croyance différents. Ce qui est précisément la différence que fait Spinozaentre éthique et morale. Une question demeure : comment préserver dans unsystème immanentiste la transcendantalité non despropositions singulières, mais de la logique et del’éthique ? Il faut distinguer l’éthique dont la fonction est dedéterminer les jugements cognitifs sur le bien et lemal, et la production d’énormes de comportements quipermet d’éviter le mal et de recherche le bien.l’aspect normatif du jugement moral est superposé à nosactivités cognitives La logique et l’éthique parce qu’elle n’est pas séparéede la démarche cognitive sont bien transcendantalesrelativement à tout jugement particulier. (Atlan p.272) Ce qui ne veut absolument pas dire qu’elles seraientproduites par un sujet transcendantal à l’image d’unsujet pensant individuel « (Atlan)Si l’on défend le modèle spinoziste d’une unitépsychophysique, la raison serait la propriété émergented’interactions sociales d’un type particulier quis’effectuent à travers le langage humain.Son caractère partagé résulte, non d’un universel a
priori mais d’un caractère commun de propriétés etnotions qu’expriment des idées associées à des étatsmentaux commun aux locuteurs d’une même langue. Ainsinon immédiatement universelle car sinon elle parleraitune langue unique, une langue totalitaire Le risque de la liberté est la prise de risque de laconfusion ainsi la confusion n’est pas le contraire dela raison, elle est sa condition de légitimité. Le réductionnisme est donc dans une raison métaphysiquea priori et non dans le modèle immanentiste d’uneraison permettant la production de notions communes quin’aurait pas pour finalité transcendantale la réductionde différences l’élimination du multiple pourl’affirmation de l’universel, mais avec pour effetd’éliminer du champ rationnel tout ce qui peutconstituer la singularité de individus, ce modèleuniversaliste est réductionniste contrairement aumodèle. Cette globalisation du modèle de Babel ou n’estéchangé que l’interchangeable, ou les sujets sontréduits à des clones fait que le subjectif est reléguéà l’irrationnel. Mais le modèle du troisième genre permet
Amartya Sen partage cette vision immanentiste del’agent, raison pour laquelle il est en débat avecl’institutionnalisme transcendantal de Rawls de manièreanalogique. Il considère sur le modèle épistémologiqueéthique proposée par, tout en état un universaliste quela ??? des modes de vie et des régimes est un signe deliberté »é humaine et non ???Mais la question demeure : comment réduire l’injusticeen dépit de nos visions différentes du Bien.La question de l’universel se pose en termespragmatiques pour Sen.« Peut-on trouver une solution impartiale unique auproblème de la société parfaitement juste (Sen, p. 38)
Si la logique d’argumentation est plurielle, il est
difficile de prendre une décision.Car les finalités de ces logiques sont différentes.- élimination de la pauvreté- droit de jouir des fruits de son travail- des principes ??? doivent ??? l’ambition des ???Existe-t-il un dispositif ??? qui puisse faire justiceà 3 ??? si différentes et promouvoir un consensusimpartial.
Il faut alors choisir entre un modèle comparatif quiimplique une pluralité d’options ou un modèletranscendantal que ??? la difficulté.Pour Sens comme pour Aristote, Spinoza avant lui, letranscendantalisme est dépourvu de faisabilité pourorienter la raison pratique de la justice.
Dans la plupart des modèles universalistes del’occident, de Kant à Rawls n’opte pas de solution àdeux options qui permette une approche comparative.Si on choisit l’option ??? la légitimité du choix doitêtre associée à un raisonnement public.C’est cette approche comparative issue de la théorie duchoix social qui permet à Sen tout en restantuniversaliste dans son désir de justice.
Voir chapitre 4
Comment fonder des évaluations comparatives sur lesvaleurs et les priorités des personnes concernées. Celamène à élaborer une théorie qui ne se limite pas àaccomplir des principes transcendantaux dans desinstitutions, ou à identifier des dispositifs idéaux.La vision Sennienne de la justice est en effet fondéesur les accomplissements et les conséquences ; etintègre la pluralité des modes d’existence que les genssont capables de mener.Car quelle est la liberté réelle dont nous disposonspour choisir divers modes de vie ?
L’évaluation n’est pas finaliste mais se fonde sur desréalisations sociales mesurées à ??? des capabilités etnon de l’utilité ou du ??? ce qui mène nécessairement àd’importants conflits d’intérêts.
- Suppose dès lors les libertés correctes de ??? à laliberté qui nous rend responsable de nos choix.
Contre le droit naturel, la justice tend à ??? l’étatde la nature « ou un gros poisson est libre de dévorerun petit ».Car ce principe même est ??? flagrante du désir dejustice qui émane de l’intersubjectivité humaine.L’ambition de la justice ??? ne vise donc pas unejustice transcendantale, mais le désir de ne pas faireviolence à autrui. Et oriente la volonté de justicevers les accomplissements plutôt que vers lesprincipes.Chez Rawls, la théorie de la justice ??? un vasteensemble d’institutions justes.Ce qui réduit la justice à quelques idées communes,autant ??? commente Sen « à une rhétorique ??? et bienintentionnée. Car malgré la volonté de faire rimerespoir et ???, la justice de l’institutionnalismetranscendantal ne lui accorde aucune place (p.63)
Les promoteurs du choix ???, ne sont que les habilespromoteurs des intérêts propres.Pour Sen comme pour ??? Bertin, les ??? ont surestiméles capacités de la raison.Si la raison est auto-justificatrice, en quoi diffère-t-elle de la croyance aveugle ?
La discipline du raisonnement consiste à soumettre lesconvictions dominantes et raisons alléguées à un examencritique (p.62) afin ??? les marquages de la traditionou de la ???Que pourrait alors être l’objectivité éthique ? (p.66)
→ Sen a encore comme Spinoza affirmé que raison etémotion sont complémentaires.« Celui qui pour savoir l’heure se fie à une montrearrêtée, n’a l’heure juste que deux fois par jour ».
Ainsi la recherche ??? éthique n’est pas la recherched’objets, ou de principes éthiques.Et exige la prise de risque d’une éthique sansontologie.« L’acceptabilité de l’incomplétude dans l’évaluationest vraiment un enjeu central dans la théorie du choixsocial, alors que Rawls croit qu’un accord complet peutse dégager de la position originelle.La persistance de l’incomplétude est un trait desjugements de justice sociale retiré à la « cohérenceinterne des choix ».Si Rawls et Nozick maintiennent de manière inflexiblela rigueur des règles, il ne se donne pas les moyens defaire justice au concept dynamique de justice.Pour Sen la théorie de la justice doit faire place àdeux types d’incomplétude affirmée ou provisoire. comment fonder les évaluations comparatives sur lesvaleurs et les priorités des personnes concernées.Cela mène à élaborer une théorie qui ne se limite pasaccomplir des principes transcendantaux dans lesinstitutions, ni à identifier des dispositifs idéaux
la vision sennienne de la justice est en effet fondéesur le fonctionnement ou les accomplissements et leursconséquences. Elle intègre la pluralité des modesd'existence que les gens sont capables de mener ainsipour lui la recherche d'objectivité éthique n'est pasla recherche d'objets ou de principes éthiques.elle exige la prise de risque d'une éthique sans sel'ontologie.« L'acceptabilité de l'incomplétude dans l'évaluationest vraiment un enjeu central dans la théorie du choix
social, alors que le rôle se croit qu'un accord completpeut se dégager de la position originelle »
récemment publique et objectivitéun raisonnement public et objectivitéil s'agit pour scène de partir d'idées confuses etconformistes pour les mettre au service du des non-conformistes.- parquet le raisonnement est fondé une propositionéthique ?- l'évaluation éthique suppose une exigenced'impartialité.Chez Rawls, la dimension participative et fermée.Puisque le rôle de très précis le voile d'ignorance auxmembres d'un groupe focal donné. Mais il montre avecune logique puissante pourquoi les jugements de justicene peuvent être privés et requièrent un cadre public depenser. Ceci ceci nous dit S. et Tunis l'initiativecapitale. Le critère pertinent de l'objectivité desprincipes éthiques consiste fondamentalement à exigerqu'il soit défendable dans un cadre public de penser.Chez scène comme chez Spinoza, la focalisation estcomparative et non transcendantale ce qui dépassel'approche normative de R., et l'approche procéduralede H.il n'y a pas besoin de rechercher l'unanimité ou leconsensus total comme l'exige la camisole de forceinstitutionnelle de la théorie de la justice.S. est attentif à la négligence par exclusion, ouimpartialité fermée qui a pour conséquence d'exclureceux qui ne sont pas membres du groupe local. Ici lesdécisions n'ont aucun effet sur les membres externes dugroupe est produit donc des groupes cloisonnés.Deuxième pointincohérences dans l'inclusion : l'acte de fermer legroupe focal peut être porteur d'incohérencepotentielle. Le principe de différence de ne peutqu'influencer la structure des interactions sociales.
Troisième pointlocaliste procédurale. La partialité dans ce modèle estdue aux préjugés au parti pris collectif de l'ensembledu groupe. L'impartialité est donc ferméequatrième point la négligence par exclusionles impératifs de la justice mondiale qui n'est pas lajustice internationale peuvent diverger. Dans le droitdes gens, R entre des représentants du peupledifférentesun fait appel à une seconde position originelle. Thomas Pogge soutient cette position également. L'uneet l'autre relève de l'impartialité fermée ; lesgroupes sont différemment dotés en ressources et enpossibilité. cette version cosmopolite de R. et repensée par P.,mais il y ait une lacune institutionnelle à un contratsocial unique couvrant la population mondiale. Maisinsiste Sen, en même dans le monde politiquementconflictuel nous vivons des individus séparés par desfrontières ne sont pas obligés de passer par desrelations internationales.La division en nation ne doit pas avoir de priorité surles autres classifications comme le postule R. dans ledroit des gens. Les relations de devoirs et de souci del'autre ne sont pas tenus de passer par lescollectivités nationales respectives. Il est possiblepar exemple d'introduire la perspective féministe dansune démarche d'impartialité ouverte sans qu'elle soitsubordonnée à des identités nationales. Scène pose doncen termes d'anthropologie philosophique, que notreidentité d'êtres humains peut-être la plus fondamentaleet s'oppose ainsi à la nature du raisonnementidentitaire et relativiste.« Il y a une sorte de tyrannie idéologique à concevoirles lignes de démarcation politique entre états commefondamentale, à voir en elle, non pas seulement descontraintes pratiques auxquels il faut faire face, maisles clivages de base dans la philosophie politique et
éthique. Une autre tyrannie ajoute scène en note etcelle qui entend donner priorité à une identitéprétendument culturelle et/ou raciales sur les autresde l'identité et sur les préoccupations nonidentitaires. C'est également la position de d'AnthonyAppia et émis Buchmann dans " The political morality ofrace"
cet argument est également défendu par moller Okindans" le multiculturalisme est-il mauvais pour les femmes »Princeton 1999.Cette question a un intérêt direct sur les analysescontemporaines des droits humains. La notion de droitshumains repose en effet sur l'intuition épistémologiqueet affective de notre humanité commune. Pour surmonterles limites de la négligence par exclusion qui font del'universalisme une caricature on peut utiliser l'idéed'impartialité ouverte, plus intégrés à une approcheuniversaliste S. dénonce également l'incohérence dansl'inclusion la clôture du groupe nécessaire àl'impartialité fermée, devient en soi un facteurpotentiel d'incohérence. Le manque de plasticité dugroupe s'oppose en effet à « une version cosmopolite oumondiale de la justice comme équité. S. défendl'approche sans biais positionnel de MaryWollestonecraft. celle-ci critique le point de vue de nuit par de nullepart, qui ne permet pas de contextualiser le principed'égalité..Pour scène, l'épistémologie la théorie de la décisionde elliptique doivent tenir compte de ce que lesconstats et les inférences d'un individu dépendent dela position de celui-ci » S pages 200 c'est une manière pour F. de critiquer la visionclassique de l'objectivité defendu par Nagel. carlorsque l'emprise des croyances locales et fortes ilpeut y avoir un refus catégorique d'admettre que lafaçon dont les femmes sont traitées dans la société
constituent une injustice à leur égard.L'idée d'objectivité de position a comme portéescientifique qu'elle nous révèle l'usage illégitime dela compréhension dériver la position et même donc à uneillusion objective qui mène à une discordance de pointde vue ce point de vue positionnel a un impact sur lathéorie de la justice et des capacités. Alors quel'acteur rationnel et celui qui agit pour des raisonssuffisantes dit John Esther. Comment faire ladifférence entre décisions rationnelles et choixréelles ? La définition des choix rationnels et celled'une habile maximalisation de l'intérêt individuel S.pose une rationalité du choix moins restrictive. ilfaut certes assujettir ses choix à un examen raisonnéet évalué nos décisions et l'égard à nos objectifs. Lechoix est donc fondé sur des raisons soutenables etsuppose la possibilité d'une pluralité de raisonsoutenable qui rende justice à la rationalité. L'amourde soi s'il est légitime doit être limité par :l'empathie, la générosité, l'esprit public. x AdamSmith disait déjà que « l'humanité, la justice, lagénérosité et l'esprit public sont les qualités lesplus utiles à autrui » mais le point essentiel est laconfiance qui seule rend possible les échanges.Pluralité des raison impartiale et universalismeles exigences du raisonnable sont plus strictes que lesimpératifs de la simple rationalité. La rationalité estune discipline permissive, exige le raisonnement maistolérante quant aux diverses formes de questionnementpersonnel. Même si tout choix réel et rationnel lapluralité des options rationnelles rende difficiletoute prédiction unique du choix réel d'une personnesur la seule base de la rationalité. Il y a sinon unrisque réel de paternalisme qui mène à décider ce quiest bon pour les autres le débat autour du ouais séismedans les années 50 s'y prend appui sur l'économie dubien-être « page 337) le Welles hérissement sanscomparaison interpersonnelle est une base trop
restrictive pour les jugements sociaux (voir Elster etPutnam.) si la théorie du choix social est née avec kennethaînée de haro il en est resté à l'idée selon laquellela comparaison interpersonnelle des utilités n'a pas desens, ce qui l'amenait à son fameux théorèmed'impossibilité mais aussi à des problèmes de cohérencedans le vote anonyme déjà dénoncé par Condorcet. Cepessimisme est dépassé pour Sen , il y ajoute lacomparaison interpersonnelle des utilités pour unsystème d'évaluation sociale viable. Cela revient àquestionner la recevabilité d'une série ne dans lalimite évidente et que le même ensemble de bien-êtreindividuel peut accompagner un contexte global trèsdifférent. Le Wellfarism exige que l'évaluation neprête aucune attention directe à ces diversescaractéristiques mais uniquement à l'utilité ou aubonheur associé. Cette négligence frappe fortement leslibertés les possibilités concrètes ou libertéspositives. Par exemple la liberté de bénéficier d'unescolarisation gratuite ou peu coûteuse ou de soinsmédicaux de base. Mais aussi les libertés négatives quiexcluent l'ingérence d'autrui. Il système se distingued'Isaiah Berlin, car ce qui l'intéresse c'est commentpenser la relation entre contexte social et perceptionindividuelle. Par exemple aucune statistique médicalene peut comprendre ne peut conduire à une compréhensionjuste de la souffrance d'autrui dès lors que la douleurest une question de perception. La capacité est unaspect de la liberté qui porte en particulier sur despossibilités concrètes (voir page 347)la non capable idée d'une personne est-elle due auxinterférences des autres ? Pour Sen il nous faudra montrer le lien entre pluralisme etuniversalisme pragmatique qui découle selon nous del'approche immanente qui se construit d'Aristote aSen. dans le chapitre 13 Sen, montre l'absurdité de
l'argument avancé selon le quelle l'approche par lescapacités n'est utilisable opérationnelle que si elles'accompagne d'une pondération prédéterminée. Cetargument est conceptuellement infondé car il néglige lefait que les évaluations et les pondérations à utiliserpeuvent être raisonnablement influencées par notrepropre examen permanent et par l'impact du débatpublic. La tâche principale pour lui et de corriger cequi ne va pas à l'aide de jugement comparatif obtenupar le raisonnement personnel et public sans se sentirobligé d'opiner sur toutes les comparaisons possibles.(Page 298)
Suite la raison pratique chez Sen : encore un effort pour être spinoziste?
Textes de références (voir icampus)
1.Levi Strauss : La Pensée Sauvage, chapitre 9, Histoire et dialectique
2.Sartre "Critique de la raison dialectique"3.A. Matheron" Individu et communauté", ed de minuit
1969 (qui dit faire une lecture levi-straussienne de Spinoza) "la vie passionnelle" chapitre 5.
4.Spinoza, l'Ethique, chapitre 5 essentiellement 5.Balibar, "l'égaliberté", texte épuisé, version
électronique sur icampus 6.Sahlins : " la découverte du vrai Sauvage"
Gallimard, "La nature humaine" version électronique. (Lire l'introduction de Pierre Clastres à l'âge de Pierre de Marshall Sahlins)
7.Amartya Sen : " L'idée de justice", 8.Yves Citton, Le spinozisme et les sciences
sociales, ed Amsterdam9.Henri Atlan :" Les Etincelles de Hasard tome 2,
chapitre 7" Auto organisation intentionnelle." dépassement de l'ontologie spiritualiste et matérialiste dans le cadre de pensée moniste de Spinoza, Seuil
10. Mylène Botbol-Baum ed, " Bioéthique pour les Pays du Sud", l'Harmattan dernier chapitre versionélectronique sur icampus.