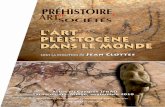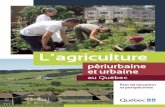Espaces de belligérance et territoires de mobilisation. Pistes pour l'histoire urbaine de la...
Transcript of Espaces de belligérance et territoires de mobilisation. Pistes pour l'histoire urbaine de la...
Draft
16 october 2014 1
Espaces de belligérance et territoires de mobilisation. Pistes pour l’histoire urbaine de la Première Guerre mondiale. Dr Pierre Purseigle, FRHistS Yale University - University of Warwick* Mesdames, Messieurs, Cher(ère)s collègues et ami(e)s, Je vous prie, tout d’abord, de bien vouloir excuser mon absence aujourd’hui. Retenu outre-atlantique, je suis néanmoins honoré et touché d’avoir été invité à introduire cet excellent colloque. Je regrette d’autant plus mon absence que Lyon est une ville qui m’est chère: la ville où j’ai commencé mes études et fait mes premières armes d’historiens; la ville, aussi, où je conserve quelques-uns de mes tout meilleurs amis et où je reviens toujours avec grand plaisir. Il est rarement aisé d’introduire un colloque d’une telle qualité. Dans les quarante minutes qui m’ont été généreusement allouées, je m’efforcerais néanmoins de souligner quelques-unes des principales questions que soulève l’expérience urbaine de la Première Guerre mondiale. Je m’appuierai ici notamment sur les travaux que j’ai consacrés à la France et à la Grande-Bretagne. Si les communications que vous entendrez au cours de ces deux journées mettent en lumière la Grande Guerre des Lyonnais, il me semble évident que leur portée dépasse les confins de la ville et souligne la richesse et l’importance de l’histoire urbaine du conflit. Cette dernière permet en effet, en considérant la guerre vécue sur les fronts de l’intérieur, de mener une réflexion sur les transformations de la guerre en ce premier vingtième siècle. Histoire urbaine et histoire du phénomène guerrier À bien des égards, le dynamisme des études sur la Première Guerre mondiale révèle une adaptation historiographique tardive aux évolutions du phénomène guerrier. Augurée par Clausewitz, la « guerre absolue » semble avoir enfin trouvé une réponse intellectuelle appropriée. Produit des révolutions industrielles, la guerre moderne procédait également des transformations sociales et de la participation politique
Draft
16 october 2014 2
croissante des masses européennes.1 Dès lors, « les militaires et leurs activités cessèrent de jouir de l’espèce d’autonomie qui avait accordé au concept d’“histoire militaire” sa légitimité particulière.2 » Les dernières décennies du xxe siècle virent ainsi l’émergence des approches interdisciplinaires et intégrées qui caractérisent désormais les études contemporaines du phénomène guerrier. Sans confondre l’expérience des combattants et celle des populations éloignées de la zone des combats, l’historiographie de la Grande Guerre admet désormais que les lignes de front ne séparaient pas seulement les sociétés belligérantes, mais les traversaient de part en part, déterminant selon des mécanismes complexes la réponse sociale apportée au conflit.3 Dès lors, le rapprochement des histoires militaires et culturelles témoigne d’un opportun ajustement historiographique aux dimensions d’un conflit dont la « logique totalisatrice4 » conduisit « à l’effacement de la distinction entre le soldat et le civil ». Dans une perspective inaugurée par l’histoire sociale et économique5 et systématisée par l’histoire du genre,6 on assiste désormais à un glissement significatif d’une « histoire de l’arrière » à une « histoire des fronts de l’intérieur7 ». Cette traduction quelque peu maladroite de l’expression anglaise « home front » apparue durant le conflit (comme son équivalent italien « fronte interno »)8 et fait écho à l’Allemand « Heimat Front » qui s’imposa, lui, à l’issue des guerres de l’unification allemande et de la guerre de 1870 en particulier.9 En août 1914, le déclenchement de la guerre signifiait en particulier une redéfinition du rôle des civils dans la guerre. Le conflit remettait en effet en cause les rapports conventionnels entre conduite de la guerre et organisation de la société civile. A cet égard, l’expérience urbaine du conflit témoignait des transformations du phénomène guerrier et de l’émergence des formes contemporaines de la belligérance. La mobilisation et la victimisation de l’arrière constituent deux aspects essentiels du processus de militarisation des sociétés occidentales évoqués par John R. Gillis et d’autres.10 A partir de 1914, la “guerre totale” conduisit selon eux au démantèlement de la sphère civile, ébranlé en ses fondements moraux et sociaux par la violence de guerre et l’effacement progressif de la division entre sphères civile et militaire.11 La notion de militarisation souligne le changement profond de nature des sociétés belligérantes. Il minimise et méconnaît néanmoins le rôle joué par la société civile elle-même dans ce processus. De fait, les concepts de militarisation et de victimisation ne
Draft
16 october 2014 3
rendent pas pleinement la complexité de la participation des civils à l’effort de guerre. Certes, la violence des champs de bataille et l’expérience de l’invasion occupèrent une place essentielle dans l’imaginaire des populations urbaines en 1914-1918. Mais ils soutinrent, plus qu’ils ne sapèrent, les discours et les pratiques de solidarités qui étaient au coeur de la mobilisation des arrières. Les changements d’échelle permis par l’histoire urbaine de l’Europe en guerre me semblent essentiels pour qui souhaite rendre compte de l’expérience de ces “fronts de l’intérieur”. Il faut toutefois reconnaître qu’une telle démarche prolonge une tradition déjà ancienne. Dès l’immédiat après-guerre en effet, la collection d’histoire économique et sociale de la Dotation Carnegie pour la paix accueillit des travaux d’une qualité indéniable qui, souvent réalisés par des acteurs (élus et hauts fonctionnaires notamment), se concentrèrent sur la mise en œuvre de politiques publiques à l’échelon urbain.12 Le Lyon pendant la guerre, publié en 1924 par Edouard Herriot, en fut l’un des exemples. Au-delà des innombrables histoires locales souvent rédigées par des amateurs comme autant de mémoriaux, les universitaires se sont également attachés à l’expérience locale de la Grande Guerre.13 Loin de moi, donc, l’idée de prétendre que ce type de travail marque l’éclosion d’un champ nouveau. Toutefois, l’accent porté ici sur l’activité des pouvoirs locaux procède de deux impératifs qu’il importe de préciser. Considérés comme les acteurs principaux des mobilisations sociales dans la ville, les pouvoirs locaux assumèrent la mise en œuvre, et en cohérence, des moyens dégagés pour faire face aux conditions et charges nouvelles créées par la guerre. Mais leur centralité traditionnelle dans le récit historique traduit également un effet de sources. Si les pouvoirs locaux représentaient la société locale, ils n’en épuisaient pas la diversité ; à charge pour l’historien de leur faire la place qu’ils méritent sans perdre de vue la complexité des communautés qu’ils représentaient.14 Communauté, identité, et société civile urbaine L’histoire urbaine de la Grande Guerre enjoint également à porter une attention toute particulière aux catégories qu’elle mobilise.
Draft
16 october 2014 4
Trois notions, dont il faut préciser les contours, se retrouvent en effet au cœur d’un tel projet : communauté, identité, et société civile urbaines. Le recours à la notion de communauté ne va pas naturellement de soi. Certes, l’histoire urbaine est essentiellement l’histoire d’un processus d’adaptation à la guerre dont les opérations se déployaient au sein de communautés professionnelles, religieuses, de quartier, etc..15 Mais, si l’idée de « communauté » est au cœur de la réalité sociale britannique par exemple, son adoption comme catégorie de l’analyse comparée est d’autant plus problématique que le terme n’apparaît que rarement dans les sources françaises.16 Une telle absence est certainement liée à la tradition universaliste française. Cette dernière rend particulièrement difficile l’étude de formations sociales qui contredisent la vision et le langage du politique hérités de la Révolution française et de la IIIe République.17 L’identité locale, entendue comme sentiment d’appartenance, occupe également une place centrale et problématique dans l’histoire urbaine. A cet égard, l’histoire de Lyon a souvent ouvert la voie à des réflexions comparatives et transnationales plus larges dont les travaux de Pierre-Yves Saunier en sont un des meilleurs exemples.18 Élément structurant du système de représentation des populations locales, l’identité urbaine n’épuisait pas leur pluralité. Elle procédait d’un rapport particulier aux systèmes politiques et économiques nationaux comme de leur dépendance aux mécanismes du marché. Ressort de l’action collective, l’identité locale s’était construite dans l’affirmation constante des droits et des devoirs respectifs de l’État et de la localité, et dans le respect des procédures de revendication et d’adjudication de conflits éventuels. On retrouve ici les réflexions que Max Weber consacra aux constructions urbaines.19 À ce titre, l’identité urbaine constituait donc une véritable culture politique.20 Enfin, l’accent mis sur la société civile, comme un site majeur de médiation de l’expérience de guerre et d’élaboration du consentement, prolonge les questionnements propres aux historiens du militaire et aux experts du social ; d’abord, car ceux qui occupaient les tranchées de la Grande Guerre demeuraient des civils en uniforme ; ensuite, car la violence de guerre remettait en cause la civilité des sociétés européennes.21 Le concept de société civile demeure néanmoins une catégorie d’analyse d’un emploi délicat.22 Il renvoie ici à l’ensemble des groupes organisés et
Draft
16 october 2014 5
pluriels qui, au-delà des sphères domestique et familiale, interagissaient avec l’État et le marché sans pour autant être exclusivement déterminés ni par l’un ni par l’autre. Ces groupes établirent et arrangèrent des médiations de l’expérience de guerre qui imposèrent à l’État des restrictions ou fournirent les moyens, certes limités, de résister à son empiètement sur les droits et libertés. Toutefois, la société civile contribua également à la logique totalisatrice du conflit. Instituée par les associations et organisations volontaires, la société civile n’exprimait pas seulement la demande sociale dans la sphère publique. Elle intéresse aussi les historiens de la Grande Guerre comme espace dans lequel les normes sociales du temps de guerre furent élaborées, disséminées, et où les rapports de pouvoir et les conflits politiques strictement encadrés par l’état de guerre pouvaient se dérouler et s’exercer. Il est ainsi nécessaire de distinguer « le corps institutionnel de la société civile et les valeurs qui coulaient dans ses veines23 » ; une distinction d’autant plus importante ici que la société civile participa au contrôle et à la censure de l’opinion publique durant le conflit. Dans ce cadre, il faut ainsi souligner l’importance de l’associationnisme comme instrument d’adaptation à une crise majeure et comme espace de formulation des identités sociales.24 En approchant les mobilisations sociales par le prisme des pouvoirs urbains et de la société civile, on met en outre l’accent sur les classes moyennes.25 L’histoire urbaine nous permet ainsi d’analyser l’attitude de groupes sociaux auxquels l’appareil d’État, malgré l’attention qu’il porta aux évolutions de l’opinion entre 1914 et 1918, ne s’était que peu intéressé.26 Pour une approche spatiale des mobilisations du temps de guerre L’histoire urbaine nous invite également à mener une réflexion systématique et pragmatique sur les territoires, comme sur les espaces d’analyse, des mobilisations politique et sociale du temps de guerre. Il ne s’agit toutefois pas ici de proclamer l’avènement d’un tournant spatial ou géographique dans l’historiographie du conflit.27 En France notamment, où les trajectoires intellectuelles comme institutionnelles de l’histoire et de la géographie ont été étroitement liées, il n’est guère besoin d’insister sur les rapports entretenus entre les deux disciplines. Les travaux d’un Braudel ou d’un Febvre témoignent de l’attention portée par les historiens à l’environnement géographique. Dans un tout autre et plus récent contexte, les propositions de la
Draft
16 october 2014 6
microstoria italienne suscitèrent une réflexion approfondie sur les échelles de l’analyse historique.28 Les historiens n’ont donc pas ignoré la pertinence des espaces de l’expérience historique. Par ailleurs, le rôle de la carte dans la réflexion militaire et la prise de décision opérationnelle souligne l’évidente spatialité du phénomène guerrier. En 1914, l’entrée en guerre et les mobilisations militaires furent d’abord vécues comme un déplacement et un éloignement. Les premiers combats et la stabilisation des lignes de front inscrivirent l’expérience de guerre dans la géographie européenne et mondiale, et projetèrent les populations de l’arrière dans une géographie imaginaire définie par les communiqués officiels et les maigres informations offertes par les combattants. La ligne de front traversait et déterminait l’imaginaire géographique des arrières. Phénomène géopolitique par excellence, la guerre souligne également la dimension territoriale des nationalismes et des identités nationales.29 Une conjonction plus récente de mouvements historiographiques distincts nous invite toutefois à reconsidérer les dimensions spatiales de l’expérience de guerre. Les approches comparatives et transnationales,30 comme l’historiographie des empires et les études postcoloniales,31 ont placé au cœur de leurs démarches respectives une réflexion critique sur leurs catégories et échelles d’analyse et ont notamment offert une critique généalogique de l’État-nation. Par ailleurs, l’émergence de l’histoire environnementale invite, elle aussi, les historiens de la guerre comme du fait urbain à replacer l’expérience historique dans son contexte physique.32 Enfin, les humanités numériques ont démontré les vertus heuristiques comme pédagogiques de visualisations inédites qui, en retour, soulignent la pertinence des approches spatiales de l’histoire.33 Loin de toute ambition paradigmatique, je souhaite proposer, plus modestement, de renouer les fils du dialogue avec la géographie et suggèrer aux historiens de la Grande Guerre tout l’intérêt d’une science sociale de l’espace. En corrigeant le biais national et étatique des analyses de la modernisation et de la nationalisation des sociétés européennes, la géographie inscrit le conflit dans la longue durée des sociétés belligérantes. Elle permet notamment de dénaturaliser le passage des communautés traditionnelles aux sociétés modernes auxquelles Tönnies consacra son œuvre. La longue marginalisation du local et des logiques communautaires dans les sciences sociales, comme dans l’histoire de la guerre, procédait en partie d’une interprétation partiale de la transition Gemeinschaft/Gesellschaft.34 Le retour au texte de Tönnies
Draft
16 october 2014 7
souligne le caractère dialectique de cette transition dont l’histoire comparée des mobilisations urbaines révèle la nature heurtée et négociée.35 Il est difficile de poursuivre cette discussion liminaire sans faire référence à Reinhart Koselleck. Sa fortune historiographique – qu’explique la profondeur des analyses qu’il consacra aux conditions historiques de la modernité comme aux conditions de sa connaissance – est illustrée par la propension des historiens à reprendre à leur compte la distinction qu’il fit entre « espaces d’expérience » et « horizons d’attente36 ». Extraites de son œuvre, ces métaphores spatiales semblent souvent adoptées en réponse aux exigences du récit historique, au risque d’amenuiser leur portée analytique.37 En évoquant ici les dimensions spatiales de l’expérience, j’entends les espaces et territoires dans lesquels les pratiques constitutives de la mobilisation sociale se déployèrent. Il semble en effet important d’insister sur la spatialité des rapports sociaux, de leurs représentations comme de leur pratique.38 En localisant aussi précisément que possible le processus de mobilisation sociale, il est ainsi possible de souligner les dimensions spatiales des identités mobilisées et transformées par le conflit.39 À bien des égards donc, cette histoire urbaine comparée rejoint les préoccupations des géographes, anthropologues et philosophes qui envisagent les modes de construction de l’espace et des territoires urbains notamment,40 et placent le politique et l’action sociale au cœur de leur réflexion.41 Ces questionnements prolongent des réflexions plus larges sur le statut de l’acteur en histoire.42 Ils invitent à saisir l’action et ses aspects normatifs, les identités comme les mémoires collectives, par un prisme géographique qui déplace le centre de gravité de l’analyse historique.43 Ainsi conçue, l’histoire locale et urbaine de la Grande Guerre souligne la pluralité des expériences et garde contre la tentation de l’orthodoxie.44 Elle contribue, surtout, à remettre en cause le primat analytique de l’État-nation consolidé par l’histoire militaire britannique et, en France, par la controverse historiographique. L’attention portée ici aux espaces de mobilisation souligne l’inscription géographique des ressources et sociabilités mobilisées pour faire face à la guerre. Elle souligne la nécessité et, je l’espère, tout l’intérêt de penser la Grande Guerre en se portant en deçà, au-delà, mais également à travers la nation.45 Écartant toute opposition entre matérialité et idéalité,46 une perspective articulée autour des espaces de mobilisations rejette l’antagonisme supposé des histoires sociales et culturelles du conflit, artificiellement invoqué dans
Draft
16 october 2014 8
les luttes propres au champ académique. Elle permet en effet de donner toute leur place aux déterminants physiques, culturels et politiques de mobilisations de ressources inégalement distribuées dans et entre les espaces sociaux.47 Histoire urbaine et nationalisation des masses européennes La comparaison franco-britannique que j’ai pratiquée se nourrit également de démarches élaborées à partir d’autres cas nationaux et participe d’un mouvement historiographique international. Les historiens de l’Allemagne – et de la France dans une moindre mesure – ont ainsi livré une série d’analyses du lien entre identités locales, nationalisation des masses, et mobilisation du temps de guerre.48 Outre-Rhin, l’expérience urbaine de la Grande Guerre apparaît en outre depuis quelques années comme un champ de recherche particulièrement dynamique.49 Plus récemment, deux historiennes ont consacré leurs premiers travaux à Vienne et à Belgrade, tandis qu’Istanbul et Prague font aujourd’hui l’objet de recherches doctorales.50 Mon projet initial procédait, à bien des égards, des tournants culturels et comparatistes que l’histoire de la Première Guerre mondiale connut au cours des années 1990 sous l’impulsion de l’Historial de la Grande Guerre. Articulée, en France tout particulièrement, autour de la notion de « culture de guerre », cette entreprise entendait éclairer l’engagement des populations dans la guerre en insistant sur l’importance des systèmes de représentations élaborées entre 1914 et 1918 et, notamment, sur la force du sentiment national. Elevé (vous l’aurez peut-être compris à mon accent) dans une ville et un milieu social dont les mémoires collectives résonnent encore des éclats de la révolte des vignerons de 1907 et de la mutinerie du 17ème Régiment d’Infanterie, il m’était difficile d’ignorer le caractère problématique de l’articulation entre identités locales, urbaines, et constructions nationales et étatiques. Dégagée des fictions nationalistes, l’historiographie de la Première Guerre mondiale poursuit l’exploration des conséquences les plus tragiques des nationalismes – « ces imaginaires ratatinés » – dont on peine toujours à comprendre qu’ils aient pu conduire à des conflits si cruels.51 L’histoire des mobilisations sociales en 1914-1918 nous permet de prolonger des questionnements classiques en « découplant » d’abord l’idée
Draft
16 october 2014 9
de nation et le sentiment national que la recherche doit lier sans pour autant que leurs réalités se confondent. Tout en insistant sur les dimensions symboliques des patriotismes,52 l’histoire urbaine permet de dépasser la stricte séparation trop souvent invoquée entre communautés imaginées et communautés d’expérience pour souligner la complexité du lien national.53 Refusant la transcendance de l’idée de Nation portée par le langage des nationalismes, elle s’attache au contraire à éclaircir les modes d’articulation des identités urbaines et du sentiment national pour rendre compte de la résilience des nations belligérantes.54 De la sorte, elle souligne la nature prosaïque et pragmatique du sentiment national. Loin des envolées rhétoriques des nationalismes, l’histoire urbaine s’attache à la quotidienneté de nations incarnées et situées par l’action collective.55 Par ailleurs, les développements de l’histoire comparée encourageaient également à poser à des contextes nationaux distincts, des questions qui, traditionnellement, n’avaient pas été soulevées ou approchées de la même manière. Ainsi, ma réflexion initiale sur l’expérience méridionale du conflit m’invita à prolonger l’analyse vers ces « fiertés locales » anglaises, procédant tout à la fois de l’extension des politiques de la ville et de leur accompagnement culturel que les historiens du dix-neuvième siècle avaient mises à l’honneur. Légitimement préoccupés par la définition d’une identité britannique, les historiens de la Grande-Bretagne me paraissaient pourtant avoir relativement négligé les identités locales pour privilégier les relations établies entre les nationalités irlandaise, écossaise, galloise et anglaise. Le surgissement du conflit, en 1914, paraissait en définitive avoir étouffé toute expression des identités locales. En retour, les particularités de l’État britannique et de sa relation à la société civile au tournant des dix-neuvième et vingtième siècles, particulièrement à l’échelon urbain, m’incitèrent à mettre en question les contours de l’État républicain français. Cette rencontre avec le pluralisme anglais m’invita donc à mettre en question la vision moniste de l’État héritée du système et de la culture politiques de la Troisième République. La Grande Guerre fut un choc des nations sans précédent. Tandis que les États mobilisaient l’intégralité de leurs ressources, les sociétés belligérantes traduisirent leur engagement par un surinvestissement culturel dont la Nation offrait l’un des horizons
Draft
16 october 2014 10
principaux. La Première Guerre mondiale ne se livre qu’avec difficulté hors du cadre fourni par les États-nations. Pourtant, mes travaux démontre l’intérêt, je l’espère, d’un changement d’échelle conduisant à se détacher de ce cadre national. L’histoire comparée des communautés urbaines entend ainsi compléter les approches nationales qui dominent encore largement la production historiographique. Mon travail se porte à la croisée de deux voies historiographiques qui s’attachent respectivement à l’étude des mobilisations nationales en Europe, et à l’histoire des capitales en guerre. Dirigés respectivement par John Horne et Jay Winter, les projets collectifs auxquels je fais ici référence dépassent les clivages inopérants et traditionnels opposant histoire culturelle et histoire sociale et embrassent, dans une même « totalité » les fondements matériels et mentaux du processus d’adaptation des sociétés à la guerre.56 Grâce à une histoire sociale des représentations, on peut ainsi mettre à jour les expressions particulières et plurielles des cultures de guerre nationales et des espaces de mobilisation dans lesquels elles se déployèrent.57 Des morceaux de bravoure littéraire et intellectuelle aux gestes banals d’un quotidien marqué par l’attente et l’angoisse, les manifestations concrètes d’un investissement martial se déclinèrent dans chaque groupe social, dans chaque région. L’effort de guerre reposait en effet sur le tissu complexe d’interdépendances qui assurait, en temps de paix déjà, la cohésion des sociétés urbaines. Je me suis dans un premier temps attachés aux mécanismes d’acculturation locale à la guerre. Après avoir resitué les communautés considérées dans le temps long de l’action collective et de la nationalisation des masses européennes, j’ai souligné l’importance des codes culturels locaux dans le succès des mobilisations nationales de 1914-1918. Ici, les identités urbaines constituaient tout à la fois une ressource cognitive, grâce à laquelle le conflit était appréhendé, approprié, et une ressource politique permettant la mobilisation des énergies civiques. Le changement d’échelle opéré par l’histoire comparée des mobilisations locales prolonge ainsi l’analyse des modes d’élaboration des cultures de guerre. Il permet d’envisager une pluralité d’espaces de mobilisation et d’apprécier, notamment, le poids de la propagande au sein des espaces publics urbains. Il souligne, surtout, l’autonomie relative, mais réelle, de la société civile qui participa de la mobilisation des consciences et de la
Draft
16 october 2014 11
conscription du verbe. L’histoire comparée des communautés urbaines invite ainsi à rompre avec les visions traditionnelles du rôle de l’appareil d’Etat et de la société civile dans l’encadrement idéologique des populations belligérantes. L’historiographie présente désormais les soldats au front comme des civils en uniforme. La solidarité des mondes civils et combattants était toutefois équivoque et constituait l’un des enjeux des mobilisations sociales. Ici, la comparaison met en évidence l’importance des différences existantes entre les systèmes de défense nationale adoptés dans les deux pays. Ces dernières expliquent ainsi que le lien entre le front et l’arrière, médiatisé par l’identité locale des deux côtés de la Manche, l’eut toutefois été, en France, dans une moindre mesure. Les modes de construction et de valorisation de « l’identité locale » des unités combattantes permettaient néanmoins aux communautés locales de se porter « par procuration » aux premières lignes. Elles s’efforçaient de la sorte de réduire la distance entre le front et l’arrière. Histoire urbaine et éthique des mobilisations Le lien des combattants à leurs communautés d’origine conserva tout au long du conflit sa force mobilisatrice. Son évocation permettait en outre à l’arrière de se situer au regard du sacrifice des combattants, tout en valorisant sa contribution spécifique à l’effort de guerre. Dès après le déclenchement des hostilités, les cultures de guerre dominantes portèrent une parole sur la guerre aux indéniables accents moraux. Dégageant les lignes de force de cette « éthique des mobilisations », je me suis intéressé aux normes gouvernant les pratiques sociales constitutives de la mobilisation des arrières. L’univers moral des cultures de guerre britanniques et française permit ainsi l’émergence d’une hiérarchie symbolique et sociale inédite et dominée par la figure tutélaire du combattant. L’éthique des mobilisations approfondit par conséquent l’exploration des interdépendances entre le front et l’arrière, dès lors régies par les « rapports sociaux du sacrifice ». Cristallisant les tensions nées de la mobilisation sociale et industrielle, la mesure et la qualification de la participation de chaque groupe à la guerre devint, avec l’installation dans le conflit, l’enjeu principal des luttes sociales. Par là, les acteurs s’attachaient à définir et à imposer au corps social la position qui, dans la hiérarchie du sacrifice, leur eût permis de négocier dans les termes les plus favorables les conditions de leur participation à l’effort de guerre.
Draft
16 october 2014 12
L’analyse de sources telles que le dessin d’humour ou les dénonciations démontre que cette éthique des mobilisations constituait l’un des mécanismes majeurs de régulation des rapports sociaux durant le conflit. L’étude de telles modalités du contrôle social pendant la guerre révèle en outre les stratégies d’accommodement à la guerre et l’ambivalence de sociétés belligérantes tout à la fois actrices et victimes du conflit. L’accueil des réfugiés jetés sur les routes de l’exil par l’invasion allemande nous permet d’explorer plus avant les manifestations concrètes de cette ambivalence, en offrant une histoire comparée de cette expérience transnationale. Constaté dès 1915, le fléchissement des solidarités et les tensions qui se firent jour entre les réfugiés et les communautés d’accueil traduisaient une modification de la dynamique des mobilisations sociales désormais structurée par une dialectique victimisation / participation. Histoire urbaine et histoire politique de la guerre Mon travail met ensuite la mobilisation sociale en regard des catégories traditionnelles de l’histoire politique du conflit. En proposant une critique des usages abusifs de l’Union Sacrée, j’ai cherché à préciser la nature de l’action collective unitaire du temps de guerre pour resituer l’Union Sacrée et la trêve des partis britannique au cœur d’une rhétorique des mobilisations. Cela m’a conduit à réévaluer l’importance de rapports de force politiques « informalisés » et déplacés vers la sphère associative. J’ai insisté, surtout, sur l’importance de luttes sociales à certains égards mal comprises dans l’historiographie récente de la Grande Guerre. Les conflits sociaux participaient en effet pleinement de la mobilisation du temps de guerre. Entre 1916 et 1918 en particulier, ces affrontements permettaient à chaque groupe d’intérêt de réaffirmer son identité, d’exprimer et d’imposer les conditions de sa participation à la défense nationale : en somme, ces luttes participaient d’un processus continu et disputé de légitimation de l’effort de guerre. Mon travail insiste en définitive sur les reformulations et les renégociations constantes du consentement des populations à la guerre, structuré autour de l’articulation problématique entre participation au conflit et représentation politique. Il souligne le poids des systèmes de recrutement militaire et leurs incidences sur les conditions sociologiques d’exercice du pouvoir urbain comme sur les modes de (re)définition des identités collectives et politiques. (Le système britannique se
Draft
16 october 2014 13
distinguant par l’introduction tardive et encadrée de la conscription). En dépit de la mobilisation massive des classes populaires et de la participation des femmes à l’effort de défense nationale, le jeu politique devint, à la faveur de la guerre, la chasse gardée presqu’exclusive d’hommes relativement âgés, issus des classes moyennes et supérieures, bien intégrés aux systèmes politiques nationaux. Dans ces conditions, le rôle politique de la société civile urbaine, entendue comme l’espace où étaient médiatisés et régulés les conflits politiques, s’en trouva réévalué. L’approche pragmatique de la société civile adoptée ici permet de reprendre à nouveaux frais l’analyse des mécanismes de domination sociale et de mobilisation en 1914-1918. En démontrant l’importance critique de la société civile dans le processus de mobilisation, cette perspective appréhende consentement et coercition comme des fonctions réciproques l’un de l’autre, et prolonge en définitive la conception gramscienne de la société civile et de l’hégémonie. Une approche sociologique de la contrainte légitime en 1914-1918, inspirée de la démarche wébérienne, permet également de replacer la guerre dans le temps long de la construction des états nationaux. Ainsi, la Première Guerre mondiale n’apparaît pas seulement comme le tournant qui introduit « l’Age du Massacre » mais également comme la continuation d’un processus social et politique qui liait inextricablement guerre et société. Le conflit renforça en effet de manière dramatique les termes du contrat social auquel la « citoyenneté » faisait référence. Un processus continu de négociation et de marchandage produisit ainsi le consentement populaire à l’effort de guerre ; consentement élaboré autant au travers des conflits sociaux et politiques qu’au travers d’un soutien déclaré ; au sein de la société civile tout autant que des arènes étatiques. Histoire urbaine et histoire de l’Etat Mon travail suggère enfin quelques manières de reconsidérer l’histoire de l’Etat en guerre. Liées, les histoires de l’Etat et de la société civile urbaine apparaissent en effet comme les deux faces d’une même médaille. La pensée libérale a, avec constance, assimilée la guerre à l’écrasement de la société civile. L’expérience de la Première Guerre mondiale démontre au contraire que la croissance spectaculaire de l’appareil étatique ne s’accompagna nullement d’un anéantissement ou d’une étatisation de la
Draft
16 october 2014 14
société civile. La société civile, en offrant tout à la fois un système de médiation culturelle et un espace de délibération, permit de préserver la légitimité d’un combat mené par l’État au nom de la Nation et qui ne fût jamais remise en cause de manière fondamentale. L’histoire sociale et économique de la Grande Guerre a montré que la résilience des populations dépendit largement de la plus grande capacité de la France et de la Grande-Bretagne à gérer les ressources nécessaires à la guerre tout en mobilisant de manière efficace le sentiment national et les identités locales. Mon travail souligne également l’importance du pluralisme dont firent preuve les systèmes politiques et administratifs anglais et français. Démocraties libérales et sociétés parlementaires, la France et la Grande-Bretagne proposèrent en effet durant la guerre deux types de pluralisme distincts, mais indéniablement parents. A bien des égards, mon travail souligne la pertinence des analyses de l’État élaborées autour du conflit par la pensée politique pluraliste illustrée en Grande-Bretagne par H. Laski et G.D.H. Cole notamment, et en France par Léon Duguit et l’école dite du « droit social ». Soucieux de ne pas calquer sur la réalité historique une grille de lecture issue directement de la philosophie politique contemporaine, il importe d’insister sur les conséquences profondes des différences entre les systèmes de recrutement français et britannique. Tandis que l’engagement de la société civile dans la guerre répondait très largement en Grande-Bretagne à une vision pluraliste « traditionnelle » de l’articulation entre le corps social et l’appareil d’État, il semble plus juste d’évoquer dans le cas français un pluralisme pragmatique. Nous ne saurions envisager ici que la guerre eût fondamentalement remise en cause la conception républicaine unitaire de la souveraineté et la représentation politique. Mais, le niveau très élevé de mobilisation militaire permit aux autorités étatiques de donner une large place aux acteurs de la société civile sans prendre de risque politique. En écartant mécaniquement avec les hommes les plus jeunes, les éléments les plus susceptibles d’animer un mouvement d’opposition, la mobilisation militaire transforma la sociologie politique urbaine. Les autorités étatiques eurent ainsi comme interlocuteurs des élites urbaines issues d’une cohorte d’hommes plus âgés, dont la proximité sociale et idéologique des représentants de l’État en fit des partenaires privilégiés. Dans ces circonstances, la République pouvait s’associer à la société civile sans crainte de voir l’intérêt général fragmenté et menacé.
Draft
16 october 2014 15
Conclusion: A l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, ce colloque et l’excellente exposition organisée par la Bibliothèque Municipale de Lyon, souligne l’intérêt et la nécessité d’une histoire urbaine de la Grande Guerre, au moment où l’historiographie du conflit a, pour l’essentiel, consacré sa rupture définitive avec les grands récits nationaux. L’histoire comparée, dont les travaux de Nicolas Beaupré sont en France l’un des tout meilleurs exemples, a dégagé les conditions d’une histoire européenne de la guerre tout en resituant l’étude du phénomène guerrier dans une démarche historiographique globale.58 Pour peu qu’elle renonce elle aussi aux mythes exceptionnalistes ou aux démarches essentiallistes, l’histoire urbaine est aujourd’hui en mesure de jouer un rôle de premier plan dans le renouveau des études de la Grande Guerre. Ce colloque, et la richesse des communications qu’il propose, en témoigne. Je vous remercie de votre attention. * Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon et docteur en histoire, Pierre Purseigle est Marie Curie Research Fellow à Yale University, Associate Professor à l’Université de Warwick, et Fellow de la Royal Historical Society, il a enseigné l’histoire contemporaine en France, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Président de la Société Internationale d’Etude de la Grande Guerre, il a notamment publié Mobilisation, Sacrifice, Citoyenneté. Angleterre - France, 1900-1918 (Les Belles Lettres, 2013). 1 Howard (Michael), « Total war in the twentieth century : Participation and consensus in the Second World War », dans Bond (Brian) et Roy (Ian) (dir.), War and Society. A Yearbook of Military History, Croom Helm, London, 1977, p. 217. 2 Howard (Michael), « World War One : The crisis in European history. The role of the military historian », Journal of Military History, 1993, vol. 57, no 5, p. 127-‐138, p. 128. L’attitude de l’institution militaire au sein de l’empire des Habsbourg, déterminée à maintenir l’autonomie de la chose militaire, révèle le caractère déstabilisant des transformations du phénomène guerrier. Voir sur ce point les analyses de Jonathan Gumz. Gumz (Jonathan), The Resurrection and Collapse of Empire in Habsburg Serbia, 1914-‐1918, CUP, Cambridge -‐ New York, 2009. 3 Grayzel (Susan R.), Women’s Identities at War. Gender, Motherhood, and Politics in Britain and France during the First World War, University of North Carolina Press, Chapel Hill and London, 1999 ; Grayzel (Susan R.), « The souls of soldiers » : Civilians under fire in First World War France », Journal of Modern History, 2006, vol. 78, p. 588-‐622. 4 Horne (John) (dir.), State, Society, and Mobilization in Europe during the First World War, CUP, Cambridge, 1997, p. 3.
Draft
16 october 2014 16
5 Fridenson (Patrick) (dir.), 1914-‐1918 : L’autre front, Éditions ouvrières, Paris, 1977. 6 Grayzel (Susan R.), « Across battle fronts : Gender and the comparative cultural history of modern European war », dans Cohen (Deborah) et O’Connor (Maura) (dir.), Comparison and History. Europe in Cross-‐National Perspective, Routledge, Abingdon -‐ New York, 2004, p. 71-‐84. 7 Traduction quelque peu maladroite de l’expression anglaise « home front » apparue durant le conflit, le front de l’intérieur fait écho à l’« Heimat Front » allemand qui s’imposa à l’issue des conflits de l’unification allemande. Il renvoie enfin à l’italien « fronte interno », privilégié par les cercles interventionnistes et nationalistes préoccupés de la menace intérieure autant que du danger extérieur. Purseigle (Pierre), « 1914-‐1918 : Les combats de l’arrière. Étude comparée des mobilisations sociales en France et en Grande-‐Bretagne », dans Duménil (Anne), Beaupré (Nicolas) et Ingrao (Christian) (dir.), Expériences de guerre. 1914-‐1945, Agnès Viénot éditions, Paris, 2004, p. 131-‐151 ; Purseigle (Pierre), « Home fronts : the mobilization of resources for total war », dans Chickering (Roger), Showalter (Dennis E.) et Ven (Hans J Van de) (dir.), The Cambridge History of War. Volume 4, War and the Modern World, CUP, Cambridge, 2012, p. 257-‐284 ; Gibelli (Antonio), La Grande Guerra degli italiani, R.C.S. Libri, Milano, 1998, p. 174 ; Seyferth (Alexander), Die Heimatfront 1870/71. Wirtschaft und Gesellschaft im deutsch-‐französischen Krieg, Schöningh Verlag, Paderborn, 2007. 8 Antonio Gibelli, La Grande Guerra degli italiani, (R.C.S. Libri: Milano, 1998), p. 174. 9 Alexander Seyferth, Die Heimatfront 1870/71. Wirtschaft und Gesellschaft im deutsch-‐französischen Krieg, (Schöningh Verlag: Paderborn, 2007). 10 John R. Gillis, The Militarization of the Western World, (Rutgers University Press: New Brunswick, N.J and London, 1989). 11 Becker (Jean-‐Jacques), « Retour sur la comparaison et réflexion sur les héritages », dans Audoin-‐Rouzeau (Stéphane), Becker (Annette), Ingrao (Christian) et Rousso (Henry) (dir.), La Violence de guerre, 1914-‐1945, éditions Complexe, Bruxelles, 2002, p. 336-‐337 ; Geiss (Imanuel), « The civilian dimension of the War », dans Cecil (Hugh) et Liddle (Peter) (dir.), Facing Armageddon. The First World War Experienced, Pen & Sword Paperback, London, 1996, p. 16-‐24. 12 Sellier (Henri) et Bruggeman (A.), Paris pendant la guerre, PUF -‐ Yale UP, Paris -‐ New Haven, 1926 ; Levainville (Jacques René), Rouen pendant la guerre, PUF -‐ Yale UP, Paris -‐ New Haven, 1926 ; Gignoux (Claude-‐Joseph), Bourges pendant la guerre, PUF -‐ Yale UP, Paris -‐ New Haven, 1926 ; Lhéritier (Michel) et Chautemps (Camille), Tours et la guerre, PUF -‐ Yale UP, Paris -‐ New Haven, 1926 ; Herriot (Édouard), Lyon pendant la guerre, PUF -‐ Yale UP, Paris -‐ New Haven, 1924. 13 Cochet (François), Reims ville-‐martyre. Vie et mort d’un mythe républicain ?, CNDP, Reims, 1985 ; Jacobzone (Alain), 14-‐18 : En Anjou, loin du front, éditions Ivan Davy, La Botellerie, 1988 ; Pourcher (Yves), Les Jours de guerre. La vie des Français au jour le jour. 1914-‐1918, Plon, Paris, 1994. 14 Notre approche pragmatique des pouvoirs locaux s’appuie ici largement sur la sociologie politique. Hampton (William), Democracy and Community. A Study of Politics in Sheffield, OUP, London -‐ New York -‐ Toronto, 1970 ; Biarez (Sylvie), Le Pouvoir local, Economica, Paris, 1989 ; Galès (Patrick Le), European Cities : Social Conflicts and Governance, OUP, New York, 2002 ; Lacam (Jean-‐Patrice), « Le politicien investisseur », Revue française de sciences politiques, 1988, vol. 1, no 1, p. 27. 15 Winter (Jay M.) et Robert (Jean-‐Louis) (dir.), Capital Cities at War, I, op. cit. 16 Pour une discussion de l’approche sociologique classique de la notion de communauté, voir Nisbet (Robert A.), La Tradition sociologique, PUF, Paris, 2000 (1re éd. 1966), p. 69-‐138. 17 Rosanvallon (Pierre), Le Modèle politique français : la société civile contre le jacobinisme de 1789 à nos jours, éditions du Seuil, Paris, 2004. 18 Saunier (Pierre-‐Yves), L’Esprit lyonnais. xixe-xxe siècle. Genèse d’une représentation sociale, « Espaces et Milieux », CNRS, Paris, 1995 ; Saunier (Pierre-‐Yves), « La ville comme antidote ou à la rencontre du troisième type (d’identité régionale) », dans Haupt (Heinz-‐Gerhardt), Müller (Michael G.) et Woolf (Stuart) (dir.), Regional and National Identities in Europe in the 19th and 20th Centuries, Kluwer Law International, The Hague -‐ London, 1998, p. 125-‐161 ; Brubaker (Rogers) et Cooper (Frederick), « Beyond “identity” », Theory and Society, 2000, vol. 29, p. 1-‐47. 19 Nous nous rapprochons de « l’identité participative (participation identity) » de Gould. Cf. Gould (Roger V.), Insurgent Identities : Class, Community, and Protest in Paris from 1848 to the Commune, University of Chicago
Draft
16 october 2014 17
Press, Chicago -‐ London, 1995, p. 14. Weber (Max), La Ville, Aubier, Paris, 1982, p. 37-‐38. 20 Berstein (Serge) (dir.), Les Cultures politiques en France, « L’Univers historique », Seuil, Paris, 1999. Nous empruntons notre définition de la culture politique à un historien de la Révolution française, Keith Baker. Fawcett (C. B.), Provinces of England. A Study of Some Geographical Aspects of Devolution, Wiliams & Norgate, London, 1919, p. 23-‐24 ; McKibbin (Ross), The Ideologies of Class. Social Relations in Britain, 1880-‐1950, OUP, Oxford -‐ New York, 1991, p. 295 ; Baker (Keith M.), « Introduction », dans Baker (Keith M.) (dir.), The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture, Pergamon Press, Oxford -‐ New York, 1987, p. xii. 21 Marx (Karl), The German Ideology, vol. I, p. 36, cité dans Bobbio (Norberto), « Gramsci and the concept of civil society », dans Keane (John) (dir.), Civil Society and the State : New European Perspectives, Verso, London, 1988, p. 82 ; Elias (Norbert), « Violence and civilization : The State monopoly of physical violence and its infringement », dans Keane (John) (dir.), Civil Society and the State : New European Perspectives, Verso, London, 1988, p. 177-‐198. 22 Kaldor (Mary), Global Civil Society : an Answer to War, Polity Press, Cambridge, 2003 ; Hoffmann (Stefan-‐Ludwig), Civil Society, 1750-‐1914, Palgrave, Basingstoke, 2006. 23 Trentmann (Frank), « Introduction : Paradoxes of civil society », dans Trentmann (Frank) (dir.), Paradoxes of Civil Society. New Perspectives on Modern German and British History, Berghahn Books, New York -‐ Oxford, 2000, p. 22. 24 Morris (R. J.), « Clubs, Societies and Association », dans Thompson (F. M. L.) (dir.), The Cambridge Social History of Britain 1750-‐1950, CUP, Cambridge, 1990, p. 395-‐443 ; Chrastil (Rachel), Organizing for War : France, 1870-‐1914, Louisiana State University Press, Baton Rouge, 2010. 25 Prochaska (Frank), Schools of Citizenship. Charity and Civic Virtue, Civitas, London, 2002, p. 19-‐23. 26 Becker (Jean-‐Jacques), Les Français dans la Grande Guerre, Laffont, Paris, 1980, p. 13. 27 Warf (Barney) et Arias (Santa) (dir.), The Spatial Turn, Routledge, London, 2009 ; Withers (Charles W. J.), « Place and the “spatial turn” in geography and in history », Journal of the History of Ideas, 2009, vol. 70, no 4, p. 637-‐658. 28 Revel (Jacques), Jeux d’échelles. La micro-‐analyse à l’expérience, Gallimard, Paris, 1996 ; Anheim (Étienne) et Gattinara (Enrico Castelli), « Jeux d’échelles. Une histoire internationale », Revue de Synthèse, 12 décembre 2009, vol. 130, no 4, p. 661-‐677. 29 Penrose (Jan), « Nations, states and homelands : Territory and territoriality in nationalist thought », Nations and Nationalism, juillet 2002, vol. 8, no 3, p. 277-‐297. 30 Clavin (Patricia), « Time, manner, place : Writing modern European history in global, transnational and international contexts », European History Quarterly, 9 septembre 2010, vol. 40, no 4, p. 624-‐640 ; Struck (Bernhard), Ferris (Kate) et Revel (Jacques), « Space and scale in transnational history », The International History Review, décembre 2011, vol. 33, no 4, p. 573-‐584. 31 Chakrabarty (Dipesh), Provincializing Europe, Princeton University Press, Princeton, N.J., 2000 ; Burton (Antoinette) (dir.), After the Imperial Turn. Thinking with and through the Nation, Duke University Press, Durham -‐ London, 2003. 32 McNeill (John), « Observations on the nature and culture of environmental history », History and Theory, 2003, vol. 42, no 4, p. 5-‐43 ; Tucker (Richard) et Russell (Edmund P.) (dir.), Natural Enemy, Natural Ally : toward an Environmental History of Warfare, Oregon State University Press, Corvallis, 2004 ; Massard-‐Guilbaud (Geneviève) et Thorsheim (Peter), « Cities, environments, and European history », Journal of Urban History, juillet 2007, vol. 33, no 5, p. 691-‐701 ; Purseigle (Pierre), « Towards an environmental history of the First World War », communication présentée au colloque de la Society for Military History, Lisle (IL, USA), 2011. 33 The Spatial History Project, Stanford University, http://www.stanford.edu/group/spatialhistory/cgi-‐bin/site/index.php, consulté le 8 août 2012. 34 Agnew (John A.) et Duncan (James S.), The Power of Place : Bringing together Geographical and Sociological Imaginations, Unwin Hyman, Boston, 1989, p. 9. 35 Tönnies (Ferdinand), Community and Civil Society, CUP, Cambridge, 2001 ; Harris (Jose), « Tönnies on “community” and “civil society” : Clarifying some cross-‐currents in post-‐Marxian political thought », dans Bevir (Mark) (dir.), Markets in Historical Contexts : Ideas and Politics in the Modern World, CUP, West Nyack, NY, 2004, p. 141-‐144. 36 Koselleck (Reinhart), Futures Past : on the Semantics of Historical Time, MIT Press, Cambridge Mass., 1985, p. 270. 37 Lorcin (Patricia M.) et Brewer (Daniel), France and its Spaces of War : Experience, Memory, Image, Palgrave,
Draft
16 october 2014 18
New York, 2009. 38 Thrift (Nigel), « Steps to an ecology of place », dans Massey (Doreen B.), Allen (John) et Sarre (Philip) (dir.), Human Geography today, Polity Press, Cambridge, 1999, p. 295-‐322 ; Thrift (Nigel), « Space », Theory, Culture & Society, 2006, vol. 23, nos 2-‐3, p. 139-‐155. 39 Méo (Guy Di), « Composantes spatiales, formes et processus géographiques des identités », Annales de géographie, 2004, vol. 113, no 638, p. 339-‐362. 40 Lefebvre (Henri), La Production de l’espace, Anthropos, Paris, 2000. 41 Lévy (Jacques), L’Espace légitime : sur la dimension géographique de la fonction politique, Presses de la F.N.S.P., Paris, 1994 ; Lussault (Michel), « Action(s) ! », dans Lévy (Jacques) et Lussault (Michel) (dir.), Logiques de l’espace, esprit des lieux : géographies à Cerisy, Belin, Paris, 2000, p. 11-‐36. 42 Lepetit (Bernard), « L’Histoire prend-‐elle les acteurs au sérieux ? », Espaces Temps, 1995, no 59-‐60-‐61, p. 112-‐122. 43 Sack (Robert David), Homo Geographicus : a Framework for Action, Awareness, and Moral Concern., Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1997 ; Chivallon (Christine), « D’un espace appelant forcément les sciences sociales pour le comprendre », dans Lévy (Jacques) et Lussault (Michel) (dir.), Logiques de l’espace, esprit des lieux : géographies à Cerisy, Belin, Paris, 2000, p. 299-‐317 ; Chivallon (Christine), « Espace, mémoire et identité à la Martinique. La belle histoire de “Providence” », Annales de géographie, 2004, vol. 113, no 638, p. 400-‐424 ; Amin (Ash), « Regions unbound : Towards a new politics of place », Geografiska Annaler, Series B : Human Geography, mars 2004, vol. 86, no 1, p. 33-‐44. 44 Driver (Felix) et Samuel (Raphael), « Rethinking the idea of place », History Workshop Journal, 1995, vol. 39, no 1, p. v-‐vii. 45 Antoinette Burton (dir.), After the Imperial Turn, op. cit. 46 Chivallon (Christine), « L’espace, le réel et l’imaginaire : a-‐t-‐on encore besoin de la géographie culturelle ? », Annales de géographie, 2008, vol. 660-‐661, no 2, p. 67. 47 Bourdieu (Pierre), « Effets de lieu », dans Bourdieu (Pierre) (dir.), La Misère du monde, Le Seuil, Paris, 1993, p. 161-‐162. 48 Applegate (Celia), A Nation of Provincials : the German Idea of Heimat, University of California Press, Berkeley -‐ Oxford, 1990 ; Confino (Alon), The Nation as a Local Metaphor. Württemberg, Imperial Germany and National Memory, 1871-‐1918, The University of North Carolina Press, Chapel Hill and London, 1997 ; Gerson (Stéphane), The Pride of Place. Local Memories and Political Culture in Nineteenth-‐Century France, Cornell University Press, Ithaca -‐ London, 2003 ; Gerson (Stéphane), « Une France locale : The local past in recent French scholarship », French Historical Studies, 2003, vol. 26, no 3, p. 539-‐559. 49 Ziemann (Benjamin), Front und Heimat : Ländliche Kriegserfahrungen Im Südlichen Bayern 1914-‐1923, Klartext, Essen, 1997 ; Davis (Belinda), Home Fires Burning : Food, Politics, and Everyday Life in World War I Berlin, University of North Carolina Press, Chapel Hill and London, 2000 ; Chickering (Roger), The Great War and Urban Life in Germany : Freiburg, 1914-‐1918, CUP, Cambridge, 2007 ; Julien (Elise), Paris, Berlin : la mémoire de la guerre, 1914-1933, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2009 ; Seipp (Adam R.), The Ordeal of Peace : Demobilization and the Urban Experience in Britain and Germany, 1917-‐1921, « Birmingham studies in First World War history », Ashgate, Farnham, 2009 ; Meteling (Wencke), Ehre, Einheit, Ordnung : preussische und französische Städte und ihre Regimenter im Krieg, 1870 71 und 1914-‐19, 1. Aufl., Nomos, Baden-‐Baden, 2010. 50 Healy (Maureen), Vienna and the Fall of the Habsburg Empire : Total War and Everyday Life in World War I, CUP, Cambridge, 2004 ; Knezevic-‐Lazic (Jovana), The Austro-‐Hungarian Occupation of Belgrade during the First World War : Battles at the Home Front, Yale University, New Haven, CT, 2006. Je fais respectivement référence ici aux travaux de Yigit Akin à Ohio State University et de Claire Morelon à Birmingham et Sciences Po. 51 Anderson (Benedict), Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 1991 (1re éd. 1983), Verso, London -‐ New York, 1983, p. 7. 52 Anderson (Benedict), Imagined Communities, op. cit. ; Samuel (Raphael) (dir.), Patriotism : the Making and Unmaking of British National Identity, vol. 3, Routledge, London, 1989. 53 Hobsbawm (Eric J.) et Ranger (Terence) (dir.), The Invention of Tradition, CUP, Cambridge, 1992 (1re éd. 1983). 54 Haupt (Heinz-‐Gerhardt), Müller (Michael G.) et Woolf (Stuart) (dir.), Regional and National Identities in Europe in the 19th and 20th Centuries, Kluwer Law International, The Hague -‐ London, 1998 ; Applegate (Celia), « A Europe
Draft
16 october 2014 19
of Regions : Reflections on the Historiography of Sub-‐National Places in Modern Times », American Historical Review, 1999, vol. 104, no 4, p. 1157-‐1182. 55 Certeau (Michel de), L’Invention du quotidien. 1, Arts de faire, Gallimard, Paris, 1990. 56 John Horne (dir.), State, Society, and Mobilization, op. cit. ; Winter (Jay M.) et Robert (Jean-‐Louis) (dir.), Capital Cities at War : Paris, London, Berlin, 1914-‐1919, CUP, Cambridge, 1997, vol. I ; Winter (Jay M.) et Robert (Jean-‐Louis) (dir.), Capital Cities at War. Paris, London, Berlin, 1914-‐1919, CUP, Cambridge, 2007, vol. II. 57 Prost (Antoine), « Sociale et culturelle indissociablement », dans Rioux (Jean-‐Pierre) et Sirinelli (Jean-‐François) (dir.), Pour une histoire culturelle, « L’Univers historique », Seuil, Paris, 1997, p. 131-‐146. 58 Howard (Michael), « World War One : The crisis in European history. The role of the military historian », Journal of Military History, 1993, vol. 57, no 5, p. 127-‐138 ; Horne (John), « War and conflict in contemporary European history, 1914-‐2004 », Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History, 2004, vol. 1, no 3 ; Bloxham (Donald) et Gerwarth (Robert) (dir.), Political Violence in Twentieth-‐Century Europe, CUP, Cambridge, 2011.