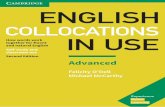learning collocations through interaction: the effects of the
Collocations et dictionnaires d'apprentissage onomasiologiques bilingues : questions aux...
-
Upload
uni-osnabrueck -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Collocations et dictionnaires d'apprentissage onomasiologiques bilingues : questions aux...
COLLOCATIONS ET DICTIONNAIRES D'APPRENTISSAGEONOMASIOLOGIQUES BILINGUES : QUESTIONS AUX THÉORICIENSET PISTES POUR L'AVENIR Dirk Siepmann Armand Colin / Dunod | Langue française 2006/2 - n° 150pages 99 à 117
ISSN 0023-8368
Article disponible en ligne à l'adresse:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-langue-francaise-2006-2-page-99.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siepmann Dirk,« Collocations et dictionnaires d'apprentissage onomasiologiques bilingues : questions aux théoriciens
et pistes pour l'avenir »,
Langue française, 2006/2 n° 150, p. 99-117. DOI : 10.3917/lf.150.0099
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour Armand Colin / Dunod.
© Armand Colin / Dunod. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites desconditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votreétablissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière quece soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur enFrance. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
1 / 1
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 10
9.90
.232
.190
- 2
4/03
/201
5 15
h45.
© A
rman
d C
olin
/ D
unod
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 109.90.232.190 - 24/03/2015 15h45. ©
Arm
and Colin / D
unod
99L ANGU E FRAN ÇA I S E 1 50
Dirk SiepmannUniversité de Siegen
Collocations et dictionnaires d’apprentis-sage onomasiologiques bilingues•:questions aux théoriciens et pistes pour l’avenir
Le présent article aborde le phénomène collocatif du point de vue del’apprenant de langues étrangères. On sait que celui-ci doit d’abord et avanttout assimiler le lexique. Or, curieusement, aucun dictionnaire actuellementdisponible sur le marché ne répertorie les unités lexico-grammaticales quipermettraient d’atteindre un niveau de compétence lexicale proche de celuid’un locuteur natifþ; pire encore, les instructions officielles destinées auxenseignants, tout en renfermant ici ou là quelques vagues références à desouvrages sur le vocabulaire de base, se contentent en règle générale de fairel’inventaire des structures grammaticales à apprendre et négligent largementle lexique ainsi que l’étroite imbrication qui existe entre les structures gram-maticales et le lexique (cf.þJulié 1994þ: 111).
Le didacticien des langues étrangères est donc amené à se poser deuxquestionsþ: 1°þQue faut-il apprendreþ? 2°þComment et avec quels moyenspeut-on acquérir les connaissances nécessairesþ?
Nous avons déjà répondu à ces questions dans un autre article (Siepmann2005b), mais nous les reprendrons ici sous un angle plus général.
En ce qui concerne la première question, on peut dire, pour faire court, quel’apprenant doit apprendre une bonne partie des signes linguistiques dontdispose le locuteur natif de la langue cible (pour plus de détails, voir lasectionþ3.1.). En laissant de côté la mimique et la gestuelle, il est opportun dedistinguer, avec Feilke (2004), deux types de signes dont Saussure n’avaitreconnu qu’unþ: le mot et «þl’expressionþ» (all. Ausdruck), qu’on appelle pluscommunément «þcollocationþ». La lexicologie et la lexicographie ont long-
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 10
9.90
.232
.190
- 2
4/03
/201
5 15
h45.
© A
rman
d C
olin
/ D
unod
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 109.90.232.190 - 24/03/2015 15h45. ©
Arm
and Colin / D
unod
100
Collocations, corpus, dictionnaires
temps focalisé l’attention sur le mot, avec les effets néfastes que l’on sait surl’assimilation du lexique en classe de langue (apprentissage de listes de motsisolés) et sur le niveau de compétence lexicale atteint par les élèves autant quepar les enseignants1. La première partie de cet article visera donc à brosser untableau de l’étendue du phénomène collocatif. Sans vouloir nous lancer dansde longues considérations théoriques, nous mettrons en évidence quelquesinsuffisances des théories en vigueur et nous tenterons de donner une défini-tion large de la collocation que nous pensons mieux adaptée à la lexicographiepédagogique, voire à la lexicographie tout court.
La deuxième question qui se pose au didacticien est celle des supportspédagogiques. Jusqu’à présent, la lexicographie pédagogique, s’inspirant dela lexicographie générale, a fait la part belle aux dictionnaires monolinguessémasiologiques. Or, il est évident que ce genre de dictionnaire ne permetjamais qu’un apprentissage ponctuelþ; en outre, une approche monolinguesémasiologique de la confection de dictionnaires se heurte forcément à deslimites méthodologiques.
C’est pour ces raisons que nous argumentons en faveur d’une méthodo-logie (et d’un dictionnaire d’apprentissage) onomasiologique bilingue oumultilingue, seule à même de répondre aux besoins de l’apprenant des langueset d’aboutir à un traitement exhaustif du lexique. Les premiers résultats d’unetelle méthodologie seront illustrés dans la dernière partie de l’article.
1. L’ÉTENDUE DU PHÉNOMÈNE COLLOCATIF OUÞ: LE CLIVAGE ENTRE THÉORIE LEXICOLOGIQUE ET PRATIQUE LEXICOGRAPHIQUE
Cette première section présente des exemples d’usage rencontrés lors de larédaction d’un nouveau manuel de vocabulaire à l’usage des apprenants deslangues étrangères et qui semblent aller dans le sens d’une définition pluslarge de la collocation que celle proposée par Hausmann ou Mel’ãuk.
1.1. Variation sémantique et figement syntaxique
On part souvent de l’idée que les collocations en tant que telles sont trans-posables d’une langue à l’autre et, par suite, constituent les unités de base quedoit savoir manier le traducteur et l’apprenant d’une langue étrangère. Or,cette vision du phénomène collocatif, qui présente une utilité incontestable,s’avère quelque peu fragmentaire et simplificatrice dans la perspective dulinguiste de corpus. Il y a à cela une raison premièreþ: les collocations, quinous livrent, pour ainsi dire, le contexte immédiat d’un mot, sont elles-mêmessoumises à des contraintes syntaxiques, sémantiques, pragmatiques et cultu-
1. Parmi trente professeurs d’anglais que nous avons testés lors d’un stage de formation continue,huit seulement avaient une connaissance suffisante (>þ80 %) des 5 000þmots anglais les plusfréquents, et il n’y avait que trois personnes qui avaient une maîtrise presque parfaite des10 000þmots les plus fréquents. On est donc loin de la compétence quasi-native que demandentles didacticiens universitaires.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 10
9.90
.232
.190
- 2
4/03
/201
5 15
h45.
© A
rman
d C
olin
/ D
unod
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 109.90.232.190 - 24/03/2015 15h45. ©
Arm
and Colin / D
unod
101L ANGU E FRAN ÇA I S E 1 50
Collocations et dictionnaires d’apprentissage onomasiologiques bilinguesþ
relles. Ainsi, par exemple, la description des collocations offertes par les théo-ries en vigueur est insuffisante pour rendre compte de leur polysémie ou deleur figement syntaxique.
Regardons-y de plus près. Comme nous l’avons montré ailleurs (Siepmann2002), la détermination du sens de la collocation exemple +þdonner fait inter-venir la notion du «þtype de procèsþ», notion empruntée à la grammairefonctionnelle et qui n’est pas prise en compte dans les théories actuelles sur lephénomène collocatif. Selon le type de procès encodé par le verbe«þdonnerþ», la collocation exemple +þdonner donnera lieu à des traductionsdifférentes. Autrement dit, l’usage peut conférer deux ou plusieurs fonctions àune seule et même collocation, ce qui révèle l’inadéquation d’une associationpurement «þmécaniqueþ» des unités lexicales (exemple +þdonner/fournir/citer/…) dans tout dictionnaire du français langue étrangère.
Le deuxième exemple nous sera fourni par la collocation quitter la route,dont voici quelques extraits de corpusþ:
La même nuit, un jeune conducteur a également trouvé la mort après avoir quitté la routeavec son véhicule à Contamines-sur-Arves, près de Bonneville.un petit chemin vicinal quitte la route principale pour se perdre dans les champsPeu après avoir quitté la route, prenez le sentier qui s’ouvre à droite de la parcelleþ116.
On constate que quitter la route possède au moins deux acceptions. Lapremière se rapporte à une déviation involontaire de la chaussée lors d’unaccident de la route, alors que la deuxième renvoie à la possibilitéd’emprunter une bifurcation. Dans cette deuxième acception, le sujet gram-matical du verbe quitter peut désigner soit un chemin soit un être humain.
Des observations analogues peuvent être faites à propos de collocations‹þnom +þadjectifþ› telles que heures creuses. Heures creuses a droit de cité dansau moins quatre domainesþ: l’économie énergétique, le trafic ferroviaire, lacirculation routière et les télécommunications. En voici quelques exemplesþ:
Les radiateurs à accumulation nécessitent la mise en œuvre d’un asservissement aux heurescreuses EDF.la SNCF renforce les trains aux heures creuses entre Paris et Combs-la-Ville0,075 ou 0,105 (Bouygues) aux heures creuses
Cette polysémie des collocations se manifeste également dans les relationsparadigmatiques instituées par heures creuses. En effet, l’antonyme de heurescreuses en téléphonie est heures pleines, alors que dans le domaine de la circula-tion routière nous trouvons heures de pointe.
Quant au figement syntaxique, celui-ci est souvent sous-estimé. Comme lefont remarquer Grossmann & Tutin (2003þ: 8),
certaines collocations présentent un figement syntaxique important (une peurbleue, *la peur est bleue, *une peur très bleue) contrairement à d’autres (un steakbleu, le steak est bleu, un steak est très bleu) sans que le degré de figement séman-tique y soit corrélé de façon évidente.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 10
9.90
.232
.190
- 2
4/03
/201
5 15
h45.
© A
rman
d C
olin
/ D
unod
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 109.90.232.190 - 24/03/2015 15h45. ©
Arm
and Colin / D
unod
102
Collocations, corpus, dictionnaires
On pourrait multiplier les exemples. Un exemple particulièrement intéressantest donné par la collocation situation +þfaire, où le verbe se trouve uniquementà la forme participialeþ: la situation faite aux protestants.
1.2. Caractère binaire des collocations
Dans les théories en vigueur, le terme de collocation est généralementcompris comme renvoyant à une association bipartite de deux ou plusieursunités lexicales, association qui entretient une relation syntaxique du type‹þNOM ( su jet ) + þVERBEþ ›, ‹þNOM (ob je t) + þVER BEþ ›, ‹þ NOM+þADJECTIFþ›, etc. Comme l’ont montré Hausmann (2004), Schafroth (2003)et Siepmann (2002), nombre de collocations apparemment tripartites peuventêtre décomposées en des unités plus petites (prendre une bouffée d’air → [air+þbouffée] +þprendre, voiture +þtenir la route 2). Or, il existe également des collo-cations tripartites irréductibles, comme en font foi les exemples suivantsþ:
der Wagen hat eine gute Straßenlage (*hat eine Straßenlage) (‘la voiture tientbien la route’)der Wagen hat einen zu großen Wendekreis (‘la voiture braque mal’)
Dans le cas présent, on peut très bien isoler le syntagme ‹þnom +þadjectifþ›gute Straßenlage, mais il n’en va pas de même pour le syntagme ‹þnom+þverbeþ› *Straßenlage haben. Quelques exemples supplémentairesþ:
avoir un geste déplacé → (?)avoir un gestetake a harder line (against) → (?)take a line (against)shall I break this note into something smallerþ?
S’y ajoutent des collocations du type trouver une place pour se garer (cf.þl’anglaisfind a parking space/find somewhere to park), qui sont segmentables, mais dont lesens spécifique se perd après segmentation (trouver une place). Force est doncde constater l’omniprésence de ces collocations tripartites qui sont certesmoins nombreuses que les syntagmes bipartites mais qui fragilisent l’hypo-thèse du caractère binaire des collocations.
De manière générale, la prise en compte des collocations tripartites irréduc-tibles ouvre la voie à une meilleure compréhension du phénomène collocatif.On constate ainsi que nombre de combinaisons de mots qui, traditionnelle-ment, ont été considérées comme «þlibresþ» sont en fait enchâssées dans des
2. Si l’on s’en tenait à la typologie grammaticale des collocations proposée par Hausmann (1999 :125), il faudrait poser une collocation du type ‹þverbe +þNþobjetþ› (tenir +þroute) et attribuer lestatut de base au nom route, ce qui irait à l’encontre de l’intuition ; si l’on veut parler de « base »dans le cas d’une collocation tripartite, cette base serait à l’évidence le sujet grammatical dessyntagmes en cause (voiture, pneu), comme le montre d’ailleurs la possibilité de substituer auxsyntagmes tenir la route et tenir au sol le simple verbe tenir. Le syntagme tenir la route constitueraitdonc le collocatif de la collocation voiture (base) +þtenir la route (collocatif). En règle générale, ledécoupage en base et en collocatif que nous venons d’opérer correspond d’ailleurs à l’enchaîne-ment du thème et du rhème en situation de communication ; la progression informationnelle partde la base thématique pour arriver au collocatif rhématique.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 10
9.90
.232
.190
- 2
4/03
/201
5 15
h45.
© A
rman
d C
olin
/ D
unod
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 109.90.232.190 - 24/03/2015 15h45. ©
Arm
and Colin / D
unod
103L ANGU E FRAN ÇA I S E 1 50
Collocations et dictionnaires d’apprentissage onomasiologiques bilinguesþ
structures tripartites assez figées. On en voit un bel exemple dans la collocationsuivanteþ:
l’horodateur (le parcmètre) n’accepte que des pièces de 20þcentimes → derParkscheinautomat (die Parkuhr) nimmt nur 20þCent-Stücke
Avec ce genre de collocation, il convient de prendre en considération à la foisle sujet et l’objet du verbe, et il est normalement impossible d’en rendrecompte en termes de fonction lexicale standard ou de poser une relationhiérarchique ‹þbase → collocatifþ› (cf.þaussi les sectionsþ1.4. etþ1.5.).
Ceci nous amène à un autre point faible des théories en vigueurþ: le traite-ment de la syntaxe des collocations. Tout en admettant que les tableaux derégime du DEC réussissent à mettre au point une description exhaustive despropriétés syntaxiques des «þlexiesþ» servant de base (Mel’ãuk, Clas &Polguère 1995þ: 119), il demeure que nombre de collocations participent deconstructions syntaxiques qui leur sont spécifiques et qui n’entrent donc pasen ligne de compte. Prenons, à titre d’illustration, la collocation mettre sonréveil, dont les propriétés syntaxiques ne sont pas prédictibles à partir dusubstantif réveilþ: mettre son réveil à/sur/pour [heure]. Même constat pour lesyntagme l’autoroute file [+þcomplément de lieuþ: vers la vallée, à gauche, etc.],qui n’est prévisible ni à partir du régime du nom autoroute ni à partir de celuidu verbe filer. En effet, en se fondant sur le seul régime de filer au sens de«þaller viteþ», on devrait pouvoir dire *l’autoroute file ou *l’autoroute file à touteallure. Là encore, le lexicographe doit donc enregistrer des unités tripartites(collocation bipartite +þrégime syntaxique spécifique +þactants ou circons-tants spécifiques)þ; il s’agit donc de ce qu’il est convenu d’appeler des «þcolli-gationsþ» dans l’école contextualiste britannique.
1.3. Statut sémiotaxique des constituants d’une collocation
Au cœur des théories sur le phénomène collocatif se trouve l’hypothèse selonlaquelle les deux constituants de la collocation ont un «þstatut sémiotaxiquedifférentþ» (Hausmann 1999þ: 124). La base de la collocation, sémiotaxiquementautonome, entre en combinaison avec le collocatif, sémiotaxiquement dépen-dant. Cette définition hausmannienne présente bien des points communs aveccelle de Mel’ãuk (2003þ: 23þsq), qui distingue également entre constituants auto-nomes et constituants sélectionnés de façon contrainte.
Cette distinction présuppose que «þle problème de la description lexicogra-phique des unités lexicales est un problème indépendant qui doit être résolu(…) avant toute discussion sur la phraséologieþ» (Mel’ãuk 1998þ: 31þ; c’estnous qui traduisons). Ainsi, Mel’ãuk part de l’idée que l’adjectif anglais rancidest un collocatif sémiotaxiquement dépendant qui apparaît uniquement dansla collocation ‹þnom +þverbeþ› rancid butter et qui ne saurait donc être définique par rapport à ce seul nom. Cette hypothèse est cependant invalidée parune étude sur corpus, dont il ressort que l’adjectif lui-même présente une apti-tude combinatoire assez vaste. On peut distinguer deux classes sémantiques decollocatifs reliées entre elles par une relation métonymiqueþ: a) food, butter,
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 10
9.90
.232
.190
- 2
4/03
/201
5 15
h45.
© A
rman
d C
olin
/ D
unod
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 109.90.232.190 - 24/03/2015 15h45. ©
Arm
and Colin / D
unod
104
Collocations, corpus, dictionnaires
bacon, milk, meat, cream, fat, grease, flour, wheat, oil, chocolateþ; smell, odour,aromaþ; socks, sweatþ; water b) atmosphere, sentiment, academics, affair, show,humour, prune. L’adjectif est donc susceptible d’au moins deux acceptions, dontl’une se rapporte à l’odeur ou au goût nauséabonds d’un aliment, alors quel’autre a trait aux qualités répugnantes d’une personne ou d’une chose. Unraisonnement analogue peut être tenu pour d’autres collocations en apparenceuniques, telles que schütteres Haar (cheveux clairsemésþ; Steyer 2004bþ: 107).
Les choses se compliquent du fait que certains noms, pris isolément, n’ontpas de sens clair et net. Un exemple cité par Feilke (1996) est l’allemand Lage,et il en va de même pour son équivalent français situation. La collocation fran-çaise situation +þfaire (p.þex. la situation faite aux protestants) serait donccomposée de deux mots plus ou moins vides de sens, et néanmoins la combi-naison des deux mots constitue une collocation dotée de sens. Nous avons làun premier indice tendant à montrer que les collocations sont des signeslinguistiques à plein titre.
Même si l’on pouvait établir avec une netteté parfaite la ligne de démarca-tion entre mots sémiotaxiquement autonomes et mots dépendants, il resteraitde nombreux cas où deux mots qui seraient alors définis comme sémiotaxi-quement autonomes forment une collocation. Quelques exemples (en carac-tères gras)þ:
an empty parking space/a vacant parking space → un emplacement (une placede stationnement) libre (ein freier Parkplatz (cf.þein leerer Parkplatz = anempty/deserted car park)
to tell a joke (on dit aussiþ: to crack/make a joke) → raconter/faire une blague→ einen Witz erzählen/machen/reißen
Mentionnons enfin des syntagmes en apparence compositionnels et constituésde deux ou plusieurs mots sémiotaxiquement autonomes, mais dont le carac-tère non compositionnel saute aux yeuxþ:
regarde où tu vasþ! → watch where you put your feetþ!/watch where you’regoingþ! → pass auf, wo Du hintrittsttu as vu l’heureþ? → have you seen the time/look at the timeþ! → so spät ist esschonþ!
tout se passe comme si (+þproposition) → all this points to the conclusion that(+þproposition) → man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass(+þproposition)that’s if (+þpropositionþ: that’s if he comes) → à condition que (+þpropositionþ:à condition qu’il vienne) → (d.þh.,) wenn (+þpropositionþ: wenn er überhauptkommt)
Est-on en droit de conclure que ces expressions constituent des semi-phra-sèmes, autrement dit des collocationsþ? Nous pensons que oui, pour troisraisons principalesþ:1. À la différence des expressions imagées, ces expressions sont immédiate-
ment compréhensibles en situation, même par un locuteur non-natifþ; cene sont donc pas des locutions ou phrasèmes au sens strict.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 10
9.90
.232
.190
- 2
4/03
/201
5 15
h45.
© A
rman
d C
olin
/ D
unod
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 109.90.232.190 - 24/03/2015 15h45. ©
Arm
and Colin / D
unod
105L ANGU E FRAN ÇA I S E 1 50
Collocations et dictionnaires d’apprentissage onomasiologiques bilinguesþ
2. Néanmoins, une interprétation tout à fait littérale de ce genre d’expressionserait abusive 3þ; ainsi, on ne peut «þvoirþ» l’heure, car le temps est unenotion abstraite.
3. Enfin, l’approche contrastive fait ressortir le caractère non-compositionneldes expressions en causeþ; les collocations tout se passe comme si ou regardeoù tu vas, par exemple, sont rebelles à la traduction littérale vers l’allemand(*alles geschieht, als obþ; *sieh/schau, wo Du gehst!).
1.4. •Directionnalité et contrastivité
Du point de vue de l’encodage, il est utile de considérer que la collocationconstitue une relation hiérarchique (González Rey 2002) ou «þorientéeþ»(Hausmann 1999þ: 124). En effet, le locuteur, surtout non-natif, part en règlegénérale du mot notionnellement supérieur en s’interrogeant sur le choix du«þmot justeþ» qui lui est typiquement associéþ: argent → retirer, table → débar-rasser, etc. Or, comme le constate Hausmann (1999þ: 125) lui-même, tel n’estnullement le cas pour l’ensemble des collocations. Ainsi, il est malaisé dedéterminer les bases des collocations rougir de honte ou le bas-côté de la route.Dans certains cas au moins, il serait donc de bon sens de considérerl’ensemble de la collocation comme un seul signe linguistique que le locuteurapprend tel quel. Cette hypothèse est confortée par des correspondances régu-lières entre lexèmes (souvent composés) et collocations dans différenteslanguesþ: le bas-côté de la route → all. der Seitenstreifen.
C’est donc l’approche contrastive qui permet de saisir le phénomène collo-catif dans sa vraie dimension. En règle générale, une collocation bipartite (ausens de Hausmann ou Mel’ãuk) se rend par une autre collocation bipartiteþ;pourtant, cette règle comporte de nombreuses exceptions dont le tableausuivant présente quelques exemplesþ: une collocation peut se rendre par unecombinaison en apparence libre ou une colligation. En réalité, cependant,toutes ces structures relèvent du phénomène collocatifþ:
3. À strictement parler, il n’y a d’ailleurs pas de sens littéral d’une expression compositionnelle(cf.þFeilke 1996 : 128).
combinaisons en apparence libres collocations/locutions
1. den Rock enger machen rétrécir la jupe
2. sur (une) autoroute dégagée auf freier Strecke (ouþ: wenn die Bahn frei istþ; auf einer freien Autobahn)
3. einen Unfall nach dem anderen haben (ouþ: bauen) collectionner les accidents
colligations colligation + collocation
4. his attempt on the (NPþ: record) sa tentative de battre le record
combinaisons de morphèmes colligation
5. Freizeit-(N), Hobby-(N), Gelegenheits-(N)[Gelegenheitsdichter, Freizeitmaler, Hobbykoch]
N à ses heures [poète, peintre, cuisinier à ses heures]
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 10
9.90
.232
.190
- 2
4/03
/201
5 15
h45.
© A
rman
d C
olin
/ D
unod
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 109.90.232.190 - 24/03/2015 15h45. ©
Arm
and Colin / D
unod
106
Collocations, corpus, dictionnaires
Ce qui nous conduit à deux conclusions préliminairesþ:1. Tout dictionnaire de collocations encourra le reproche d’inexhaustivité et
d’utilité restreinte tant qu’il ne tiendra pas compte des colligations et descombinaisons de mots sémantiquement autonomes (si tant est qu’il y en aiten dehors des mots concrets). Cela ne met pas en cause la notion hausman-nienne de base, car celle-ci pourrait toujours être considérée comme lepoint de départ «þinformationnelþ» de l’énoncé (cf.þnoteþ2)þ; le locuteurpartira en règle générale de parking space pour arriver à empty sans queempty soit moins autonome sémantiquement que parking space. Facilementcompréhensible aux apprenants de langue étrangère, le concept de baseprésente d’ailleurs un intérêt didactique indéniable.
2. Il est dangereux de s’enfermer dans une approche monolingue inféodée àune théorie restreinte du phénomène collocatif. Seules une démarchemultilingue ou une approche monolingue fondée sur la fréquence, telleque celle pratiquée par l’école contextualiste britannique, permettront decapturer toute la richesse des collocations. Une combinaison de ces deuxapproches nous semble très prometteuse (cf.þla sectionþ2.).
1.5. Collocation entre traits sémantiques
Tout au long des sections précédentes nous avons analysé des collocationsde deux ou plusieurs mots ainsi que des colligations entre des mots et desfonctions grammaticales. Or, si l’on s’en tenait à cette conception usuelle descollocations, on risquerait de perdre de vue un certain nombre de dépen-dances lexicales observables au niveau des sèmes. On peut distinguer deuxcas de figure que nous appellerons les collocations «þadjacentesþ» et les collo-cations «þnon-adjacentesþ» ou «þdiscontinuesþ» (nommées «þlong-distancecollocationsþ» en anglaisþ; cf.þSiepmann 2005a).
1.5.1. Collocations adjacentesHeid (1994), Mel’ãuk & Wanner (1996) et L’Homme (2003) ont démontré
que des mots sémantiquement apparentés ont en commun une partie de leurcombinatoire. Ainsi, le collocatif verbal initialiser se combine, dans le langagede l’informatique, avec la classe sémantique des noms désignant un équipe-ment autonomeþ: ordinateur, portable, modem, imprimante, etc. (L’Homme2003þ: 99). Les études susmentionnées sont axées sur les cooccurrents verbauxde bases nominales, mais le phénomène en question se retrouve égalementdans d’autres types collocatifs, comme par exemple les combinaisons‹þadverbe +þverbeþ› (joliment +þverbum dicendi) ou les colligations du genrenager en plein(e) +þNPþ:
joliment +þdire/baptiser/appeler/nommer/exprimer/qualifier/proposer/noter/écrire/résumer (etc.)nager en plein(e) incohérence/absurdité/délire/hypocrisie/science-fiction/utopie/conte de fée/illusion lyrique/mystère/paradoxe/cliché
Le phénomène collocatif revêt donc une dimension paradigmatique autantque syntagmatique, étant donné que le même environnement syntagmatique
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 10
9.90
.232
.190
- 2
4/03
/201
5 15
h45.
© A
rman
d C
olin
/ D
unod
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 109.90.232.190 - 24/03/2015 15h45. ©
Arm
and Colin / D
unod
107L ANGU E FRAN ÇA I S E 1 50
Collocations et dictionnaires d’apprentissage onomasiologiques bilinguesþ
peut être partagé non seulement par un ensemble strictement limité delexèmes (espoir [’illusoire’] → 1.þfallacieux 2.þtrompeur), mais encore par unensemble sémantique ouvert. Dans cet ordre d’idées, il faut se demander si ladistinction entre restrictions sélectionnelles et restrictions collocationnelles estencore opportune, car les deux types de restriction relèvent en fait de la collo-cation entre sèmes et lexèmes. En conséquence, plutôt que de postuler desrestrictions de sélection se rapportant aux syntagmes ‹þnom +þverbeþ› ou‹þnom +þadjectifþ› ainsi que des restrictions collocationnelles ayant trait àd’autres combinaisons, il serait plus logique d’élaborer une théorie unifiée des«þprofils combinatoiresþ» (Blumenthal 2002) fondée sur la notion de colloca-tion. Quelle différence y a-t-il en effet entre une restriction «þsélectionnelleþ»qui exige que l’adjectif mortel se construise avec un sujet désignant une armeou un instrument (cf.þp.þex. Blank 2001þ: 23) et une restriction «þcollocation-nelleþ» qui veut que l’objet d’initialiser soit un équipement autonomeþ? Neserait-il pas plus sensé – et plus proche des réalités neurobiologiques –d’appréhender certains syntagmes tripartites comme des «þconfigurationscollocativesþ» ou des «þunités lexicales étenduesþ» (extended lexical units,Sinclair 1996/2004, Stubbs 2002þ: 87þsqq) plutôt que d’en rendre compte entermes de valence verbaleþ? Examinons deux exemplesþ:
Le premier exemple représente une configuration sémantique très fréquentequi donne lieu à de nombreuses variantes lexicales. Il est aisé de décrire leprototype de cette configuration sémantique et d’en donner quelques exem-ples caractéristiques dont la fréquence d’apparition et partant la collocativitésont particulièrement fortes. Bien qu’il n’y ait aucun mot obligatoire danscette configuration, il est hors de doute que toutes ses réalisations lexicalessont apparentées sémantiquement.
On peut, schématiquement, considérer quatre échelons principaux d’unetelle configurationþ:
lexiqueþ: collocations préférentielles (livre +þs’articuler, s’articuler +þparties, etc.)
syntaxeþ: colligations préférentielles (S +þV +þpréposition +þN, normalementVþpronominal ou passif)
sémantiqueþ: champs sémantiques préférentiels (noms désignant des publicationsou des parties de ces publications, verbes servant à décrire la composition dequelque chose)
pragmatiqueþ: fonction discursive, attitude du locuteur (cf.þSinclair 1996/2004,1998/2004, Stubbs 2002þ: 87þsqq)
Exemple 1 Exemple 2
le texte s’articule en trois parties le bus mord sur le bas-côté
l’ouvrage s’ordonne en quatre sections le poids lourd aurait mordu la ligne blanche
le livre s’organise en huit dossiers la moto empiète sur la voie opposée
le volume est composé de dix chapitres son véhicule aurait empiété sur l’accotement
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 10
9.90
.232
.190
- 2
4/03
/201
5 15
h45.
© A
rman
d C
olin
/ D
unod
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 109.90.232.190 - 24/03/2015 15h45. ©
Arm
and Colin / D
unod
108
Collocations, corpus, dictionnaires
Dans le deuxième exemple, il y a également une relation d’interdépendanceentre le sème [véhicule] inscrit dans le sujet et le sème [partie de la route] quepossède l’objet, avec une certaine variation lexicale, mais peu de variationsyntaxique pour le verbe. S’agit-il d’une collocation ou d’une simple relationde valenceþ?
On constate également une certaine corrélation entre le sens et la syntaxe,bien que la syntaxe ne soit pas tout à fait prédictible à partir du sens (ou viceversaþ; cf.þHunston & Francis 2000þ: 86þ; Siepmann 2005c). En effet, les motssusceptibles des mêmes constructions se laissent en règle générale ranger endes familles de sens bien délimitées (cf.þFrancis, Hunston & Manning 1996,1998), et, on l’a vu, les configurations collocatives sont caractérisées par unecertaine uniformité syntaxique. Dans ces conditions, est-on fondé à conclureque «þla théorie de la dépendance est une affaire purement syntaxiqueþ»þ?
Nous laisserons à plus compétent le soin de mener à bien l’œuvre d’unifi-cation des théories valencielle et collocationnelle, non sans faire remarquerpour autant que la lexicographie pédagogique ne peut se soustraire à la néces-sité de proposer à l’apprenant ce type de configuration collocativeþ; nous yreviendrons dans la sectionþ2. Nous nous contenterons ici d’apporter unepierre supplémentaire à une théorie collocationnelle, celle des collocationsdiscontinues.
1.5.2. Collocations discontinuesEn poussant plus loin l’idée d’une attraction collocationnelle entre sèmes,
on finit par constater que cette attraction s’exerce également sur des distancesrelativement importantes allant jusqu’à plusieurs dizaines de mots. La plupartdu temps nous avons affaire à des variantes stylistiques de tours corrélatifs dutype certes… mais. De fait, ces tours corrélatifs sont particulièrement fréquentsdans le domaine de la concession. En voici l’un ou l’autre exempleþ:
on pourrait croire que/il serait tout à fait logique que/on s’attendrait à voir/NPpourrait suggérer NP/que (etc.) … mais/or/en fait/en réalité (etc.), il n’en est rien
La configuration lexico-sémantique de ces collocations discontinues a un fort airde ressemblance avec celle des collocations tripartites traitées dans la sectionprécédenteþ: à côté de certaines collocations dont la fréquence est très élevée (onpourrait croire que +þil n’en est rien), on trouve d’autres formulations plus libreset qui réalisent la même configuration sémantique. Notons cependant quel’apparente «þlibertéþ» de ces formulations est toute relative, car elle existeuniquement par rapport à la configuration sous examen ici. Lesdites formula-tions (p.þex. on s’attendrait à voir) sont elles-mêmes de nature collocativeþ; onpourrait parler, dans ce cas, de «þmarqueurs de discours polylexicauxþ» (del’anglais multi-word ou second-level discourse markers, cf.þSiepmann 2005a).
Semblablement, le marqueur concessif en admettant que induit le choix d’unmarqueur adversatif tel que pourtant, encore faut-il que ou le fait demeure que.Exempleþ:
R.-L.þWagner (1968), qui note que le «þterme de ‹þmotþ› en est venu assez tard en françaisà traduire la notion d’une unité lexicale autonomeþ», tout en admettant le bien-fondé de
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 10
9.90
.232
.190
- 2
4/03
/201
5 15
h45.
© A
rman
d C
olin
/ D
unod
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 109.90.232.190 - 24/03/2015 15h45. ©
Arm
and Colin / D
unod
109L ANGU E FRAN ÇA I S E 1 50
Collocations et dictionnaires d’apprentissage onomasiologiques bilinguesþ
l’analyse qu’A.þMartinet fait de la notion de «þmotþ», refuse pourtant d’abandonner ceterme parce que la lexicologie porte sur l’étude des signes en situation.
Enfin, on relève également des relations d’interdépendance entre des colli-gations (p.þex. sans +þINF) et des marqueurs polylexicaux du type nous feronsremarquer que, comme en témoigne l’exemple suivantþ:
Sans nous étendre outre mesure sur le chapitre des interprétations ésotériques, nous ajoute-rons quelques exemples à ceux que nous avons déjà signalés ici ou là.
1.6. Conclusion•: Une définition large du phénomène collocatif
Au terme de cette section, essayons de réunir en une vision synthétique lesprincipaux enseignements des analyses qui précèdent. Les éléments dethéorie que nous avons exposés et les exemples que nous avons cités portent àcroire que la définition traditionnelle de la collocation ne permet pas au lexi-cographe pédagogique de capturer l’ensemble des types collocatifs qui inté-ressent l’apprenant. De même que l’approche sémantique des collocationsadoptée par Hausmann et Mel’ãuk laisse de côté de grands pans de la syntag-matique, de même la recherche collocationnelle fondée sur la seule fréquence,bien que compensant les lacunes de l’approche sémantique, a jusqu’ici négligéla collocation entre sèmes 4.
Aussi serait-il de bonne méthode lexicographique d’étendre notre défini-tion du phénomène collocatif au-delà des syntagmes bipartites décrits parHausmann et Mel’ãuk. Nous proposons de ce fait une définition fondée sur lesnotions de norme d’usage (‹þGebrauchsnormþ›, Steyer 2001þ: 108) et d’holisti-cité (‹þinhaltliche Geschlossenheitþ›, Siepmann 2002). Ce dernier conceptrenvoie à deux aspects des collocationsþ: premièrement, tout locuteur peutassigner un sens à des collocations appartenant à la langue commune, mêmehors contexteþ; deuxièmement, ces unités sont intuitivement appréhendéescomme des touts cohérents. Nous aboutissons donc à la définition suivanteþ:
une collocation est une unité lexicale, lexico-grammaticale ou sémantique àcaractère holistique et ayant une récurrence minimale dans une communautélinguistique donnée.
Nous pourrons ainsi distinguer quatre types collocatifsþ:1. colligation (tu n’avais qu’à +þINF, ignorer tout de +þN, il n’y a qu’à +þINF,
ce/cette N [tradition, etc.] est resté(e), NP dans l’âme, etc.)þ; il est à remarquerque cette définition de la colligation va plus loin que celle de Hoey (1998)þ;à notre sens, la colligation concerne non seulement les préférences gram-maticales de mots individuels, mais encore celles de syntagmes plus longs.Ainsi en est-il, par exemple, du syntagme t’avais qu’à, qui entre en colliga-tion avec une proposition infinitive.
4. Précisons néanmoins que la raison en est d’ordre technique : il n’existe pas encore de groscorpus étiquetés sémantiquement.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 10
9.90
.232
.190
- 2
4/03
/201
5 15
h45.
© A
rman
d C
olin
/ D
unod
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 109.90.232.190 - 24/03/2015 15h45. ©
Arm
and Colin / D
unod
110
Collocations, corpus, dictionnaires
2. collocation entre lexèmes ou phrasèmes (de même… de même que, briser seschaussures, c’est-à-dire en l’occurrence, regarde où tu vas, bon ben, à la fin, etc.).
3. collocation entre lexèmes et sèmes (beautifully +þ[résultat d’une activitéartisanale], [incertitude] +þnot so, [question] +þeh bien, [attente] +þduly,[aspect contextuel négatif] +þ(not) detract from s.o.’s enjoyment, [véhicule]+þmordre sur +þ[partie de la chaussée], butþ! [sur ces collocations compo-sées d’un seul mot, cf.þGonzález Rey 2002þ: 95, 101])
4. collocation entre sèmes (configuration sémantique du type texte +þs’arti-culer +þpartiesþ; collocations discontinues)
Quant à la composition structurale des collocations (excepté les colloca-tions entre sèmes), elle apparaît maintenant d’une simplicité désarmanteþ:n’importe quelle structure syntaxique peut être à la base d’une collocation.Certains patrons syntaxiques ont une récurrence particulièrement élevée(cf.þSiepmann 2002)þ:
X + Y (grand maigre, gros mal, réaction à chaud, bon ben, où là, de même que +þde même)X + Y + Z (+ n) (vilain petit canard, petit coin tranquille, c’est-à-dire en l’occurrence que)X + et + Y (sain et sauf, sel et poivre)X + Prép (à la fin, rebelle à un traitement)X + Prép + Y (grand chasseur devant l’éternel)X + Verb + Y (la voiture a mordu sur la ligne blanche)
2. SUPÉRIORITÉ DE L’APPROCHE ONOMASIOLOGIQUE MULTILINGUE SUR L’APPROCHE SÉMASIOLOGIQUE
La raison principale d’une certaine supériorité de l’approche onomasiolo-gique de la confection de dictionnaires tient à la façon dont nous communi-quons 5. En tant que sujets parlants, nous ne partons pas d’une liste de motsisolés que nous combinons par la suite de façon appropriéeþ; ce ne sont pas«þdes unités individuelles et atomisées, mais des notions et des processusþ»(Götze 1999þ: 11þ; c’est nous qui traduisons) qui se trouvent représentés dansnotre cerveau. Les notions que nous souhaitons transmettre et les choixcommunicatifs que nous opérons trouvent leur expression soit dans des collo-cations, soit, plus rarement, dans des mots simples. De la même façon, le lexi-cographe qui focalise son attention sur l’expression de notions plutôt que surune liste alphabétique de mots isolés aboutira à un dictionnaire plus unifié.
En suivant le parcours onomasiologique qui va des intentions du dire à sesmanifestations linguistiques, le lexicographe pourra donc respecter les quatreprincipes de rigueur rédactionnelle formulés par Mel’ãuk, Clas & Polguère(1995þ: 34þsqq). L’une de leurs critiques vise le manque de cohérence quicaractérise le traitement des lexies d’un même champ sémantique dans les
5. Pour une critique détaillée de l’approche sémasiologique, cf.þSiepmann (à paraître).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 10
9.90
.232
.190
- 2
4/03
/201
5 15
h45.
© A
rman
d C
olin
/ D
unod
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 109.90.232.190 - 24/03/2015 15h45. ©
Arm
and Colin / D
unod
111L ANGU E FRAN ÇA I S E 1 50
Collocations et dictionnaires d’apprentissage onomasiologiques bilinguesþ
dictionnaires (sémasiologiques) traditionnels. Ainsi, les noms ethniques nereçoivent pas de traitement uniforme dans le DECþ:
«þun Français est défini comme ‘personne de nationalité française’ (…) Chinois n’apas de définition (…)þ»
Par conséquent, Mel’ãuk, Clas & Polguère (1995þ: 40) posent en principeque les descriptions des lexies sémantiquement apparentées soient réalisées«þstrictement de la même façonþ». Or, cette exigence sera bien plus facile àremplir au sein d’une méthodologie onomasiologique, où chaque lexico-graphe se consacre à un ou plusieurs champs sémantiques ou thèmes 6.
Deuxième avantageþ: la démarche onomasiologique permet de réaliser desdescriptions lexicographiques strictement explicites. Comme le font remar-quer Mel’ãuk, Clas & Polguère (1995þ: 35þsq), une collocation telle que maga-zine féminin ne saurait être répertoriée uniquement en tant qu’exempleillustratif, car elle pourrait signifier soit «þmagazine traitant de femmesþ»,soit «þmagazine s’adressant aux femmesþ». Le dictionnaire doit donc indi-quer par une définition ou une traduction qu’il s’agit du deuxième de cessens. Or, il est légitime de se demander si une approche sémasiologique etmonolingue peut jamais être totalement explicite, car certaines différences desens n’apparaissent qu’à la lumière d’une autre langue et de toutes manières,il est toujours possible, même en ne travaillant que sur une seule langue,d’opérer des distinctions sémantiques de plus en plus subtiles.
Néanmoins, il semblerait que l’approche onomasiologique bilingue estapte à faire ressortir certaines distinctions de sens que les dictionnaires mono-lingues et les bilingues sémasiologiques passent sous silence. Ainsi, à l’excep-tion partielle du Oxford Advanced Learner’s Dictionary, les monolingues anglaiset le Collins-Robert négligent le sens particulier (‹þrester en stationnementþ›)qu’assume le verbe anglais wait dans le domaine de la circulation routière(p.þex. waiting at traffic lights). Dans un bilingue onomasiologique, unedescription explicite est obtenue quasi automatiquement en enregistranttoutes les variantes possibles d’une configuration collocative avec ses traduc-tions spécifiques à un type de situation ou à un centre d’intérêt.
Semblablement, il est aisé de respecter le principe de cohérence interneformulé par Mel’ãuk, Clas & Polguère (1995þ: 36þsqq) au sein d’un bilingueonomasiologique. Ce principe veut que «þles descriptions sémantique,syntaxique et cooccurrentielle de la lexie vedette L montrent un accordcompletþ» (36). Les problèmes descriptifs liés au recensement de collocationsdu type célibataire endurci dans le monolingue ne se posent pas dans lebilingue et sont en fait purement théoriques, car, on l’a vu, les collocationssont des unités holistiques.
Deux autres principes rédactionnels formulés par Mel’ãuk, Clas &Polguère (1995) sont celui d’exhaustivité et celui de consultation obligatoire
6. Mel’ãuk, Clas & Polguère (1995) mettent en œuvre une telle méthodologie, bien que leurdictionnaire ait une structure sémasiologique.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 10
9.90
.232
.190
- 2
4/03
/201
5 15
h45.
© A
rman
d C
olin
/ D
unod
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 109.90.232.190 - 24/03/2015 15h45. ©
Arm
and Colin / D
unod
112
Collocations, corpus, dictionnaires
des bases de données textuelles. Le respect de ces principes peut être assuréde façon très efficace par une méthodologie onomasiologique bilingue oumultilingue procédant en cycle itératifþ:
constitution de corpus spécifiques à un centre d’intérêt dans au moins deuxlangues → établissement de listes de mots et de collocations spécifiques au centred’intérêt choisi → analyse contextuelle des collocations à l’aide d’Internet →compensation des lacunes collocationnelles dans l’une ou l’autre langue → ajoutsaux corpus sur la base des recherches sur Internet (etc.)
Un autre point mérite considération. L’approche onomasiologique nouspermet de dégrouper des unités de sens qui feraient l’objet d’un seul et mêmearticle dans un dictionnaire sémasiologique. En témoigne l’exemple précité dela collocation française donner +þexemple, qui s’emploie dans trois types desituations avec deux sens différentsþ:• une situation où le locuteur/scripteur cite un autre auteurþ: Miller (1995)
donne un exemple de• une situation où le locuteur/scripteur introduit lui-même un exempleþ:
pour donner un exemple, je vais vous donner un exemple• une situation où le locuteur/scripteur cite un exempleþ: l’Arabie Saoudite
donne un exemple d’État islamique moderne
En outre, l’approche onomasiologique permet l’économie de renvoiscomplexes vers des expressions sémantiquement apparentées ou synonymes.
Signalons enfin que la démarche onomasiologique permet d’atteindre undegré supplémentaire d’économie de traitement en rassemblant toutes lescollocations appartenant à un champ sémantique donné à l’entrée du lexèmegénérique de ce champ (Mel’ãuk & Wanner 1996þ: 233þsqq). Mel’ãuk &Wanner reconnaissent cependant que même des mots de sens voisin ne parta-gent jamais tous leurs collocatifs. Pour faciliter la recherche et l’apprentissage,il est d’ailleurs préférable de proposer l’ensemble des collocations relatives àune notion ou un lexème sous l’entrée (ou près de l’entrée) de ces derniers.
En résumé, on peut dire que la lexicographie du futur devrait mettre enœuvre une méthodologie diamétralement opposée à celle qui prédomineencore aujourd’huiþ: au lieu de calquer les microstructures du bilingue surcelles du monolingue en procédant dans l’ordre alphabétique, on partirad’une liste de collocations propres à un centre d’intérêt donné. La répartitiondes tâches entre lexicographes se ferait donc sur la base de centres d’intérêt,ce qui permettrait de faire d’une pierre deux coupsþ: d’une part, on résou-drait le problème des renvois manquants vers des synonymes (surtout collo-
Collocations synonymiques et apparentées sémantiquement
Thèmeþ: Type de situation (pour une explica-tion de ces notions, cf.þla section 3.)
encore nommé/autrement appelé/qu’on appelle aussi Marqueurs de discoursþ: Reformulation
Freizeit-N, Gelegenheits-N, Hobby-N Passe-tempsþ: Caractériser des amateurs
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 10
9.90
.232
.190
- 2
4/03
/201
5 15
h45.
© A
rman
d C
olin
/ D
unod
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 109.90.232.190 - 24/03/2015 15h45. ©
Arm
and Colin / D
unod
113L ANGU E FRAN ÇA I S E 1 50
Collocations et dictionnaires d’apprentissage onomasiologiques bilinguesþ
cationnelsþ: faire ses valises (plier bagages, etc.)þ; d’autre part, le travail seraitréparti en fonction du savoir spécialisé de chaque lexicographe. Cette métho-dologie pourrait également révolutionner la lexicographie monolingue, quibénéficierait de l’établissement de fines distinctions de sens par la lexicogra-phie bilingue 7.
3. LES COLLOCATIONS DANS UN MANUEL DE VOCABULAIRE DE FORT VOLUMEÞ: PRINCIPES ET EXEMPLES
Cette section présente une série d’éclairages ponctuels sur un projet dedictionnaire onomasiologique qui met en œuvre l’approche décrite ci-dessus.
3.1. Vocabulaire quasi natif
Le projet de dictionnaire d’apprentissage onomasiologique dont il est iciquestion vise à proposer aux apprenants du français et de l’anglais langueétrangère toutes les unités sémantiques complexes constitutives du vocabu-laire quasi natif, créant ainsi les conditions indispensables à l’apprentissageintentionnel et ciblé de cet ensemble linguistique hétérogène. En premièreapproximation, on peut définir le vocabulaire quasi natif comme suitþ:l’ensemble des mots et des collocations (au sens défini ci-dessus) qui permet-tent au locuteur natif de la langue cible de satisfaire tous ses besoins d’expres-sion et de communication sans enfreindre les normes de la langue cible.
Signalons toutefois qu’un étranger souhaitant parler comme un autochtonepeut économiser ses efforts s’il n’apprend qu’une seule formule adéquatecorrespondant à chaque besoin d’expression. À la différence du locuteur natif,il se contentera donc d’utiliser une seule formule là où le locuteur natif a unepossibilité de choix entre plusieurs variantes. Si toutes les variantes en causen’ont pas la même fréquence d’emploi, l’apprenant a intérêt à opter pour laformule la plus usitée.
Un exemple suffira à illustrer notre proposþ:
7. Nous ne proposons évidemment pas que la prise en compte d’une deuxième ou troisièmelangue doive imposer des distinctions de sens supplémentaires au lexicographe monolingue, carà ce moment-là il faudrait comparer la langue de départ avec un grand nombre d’autres languesafin de perfectionner le dictionnaire monolingue.
Noyau sémantique Locuteur natif anglophoneÉtranger possédant
une compétence quasi native
«þêtre pris dans un bouchonþ» get caught (up)/get stuck in a traffic jam, sit in traffic; be stationary
get caught in a traffic jam
«þrespecter la limitation de vitesseþ» stick to/keep to/abide by/observe the speed limit
stick to the speed limit
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 10
9.90
.232
.190
- 2
4/03
/201
5 15
h45.
© A
rman
d C
olin
/ D
unod
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 109.90.232.190 - 24/03/2015 15h45. ©
Arm
and Colin / D
unod
114
Collocations, corpus, dictionnaires
Lorsqu’on essaie d’établir un vocabulaire quasi natif à des fins pédagogi-ques, il convient de tenir compte de ce genre d’«þeffet d’économieþ». (Aucours de nos recherches en ce domaine, nous avons découvert de nombreuxautres types d’effet d’économie sur lesquels nous ne souhaitons pas nousétendre ici.)
3.2. Macrostructure•: thèmes et types de situations
Le manque de place nous interdit de traiter en profondeur l’agencementgénéral de la macrostructure, c’est-à-dire les principes gouvernant l’activité declassement par thèmes et par types de situation. Bornons-nous, pour abréger,à la distinction entre ces deux notions, qui n’est pourtant pas tout à fait nette.Si chaque situation communicative est unique, il semble légitime de généra-liser à partir de situations spécifiques pour parvenir à des types de situations(Lyne 1985) ou des types de textes similaires qui s’inscrivent dans des thèmes(«þtopic areasþ», McArthur 1981, 1998). Une concentration exclusive sur l’unede ces deux catégories, comme on la trouve dans les ouvrages que nousvenons de citer, nous paraît assez restrictive, étant donné que celles-ci secomplètent et s’éclairent mutuellement. En effet, un type de situation, telqu’une audience de tribunal, peut porter sur des thèmes très variés. Àl’inverse, le même thème, tel que le récit d’un accident de voiture, peuts’inscrire dans différents types de situation ou de textes, qui vont de laconversation de tous les jours aux audiences de tribunal, en passant par lesdemandes d’indemnisation. À titre d’exemples rapides, choisis parmi diffé-rents thèmes traités en anglais et en français, on peut citer les suivantsþ:
La structuration des relations entre entrées et thèmes découle d’une concep-tion ascendante (bottom-up en anglais)þ; autrement dit, la macrostructure d’unthème est commandée par les contenus et les collocations localisés dans descorpus spécifiques à ce thème. Ceci va à l’encontre des principes traditionnelsrégissant la confection de thésaurus, qui partaient d’une structure ontologiquepréétablie.
3.3. Complétude
Cette section vise à illustrer comment l’approche onomasiologique peutcombler certaines lacunes qu’on trouve dans les dictionnaires d’encodage
Collocation Thème 1þ: Type de situation 1 Thème 2þ: Type de situation 2
money/funds/a sum/etc. + leave + account/bank/etc.
L’argentþ: les entrées et les sorties
Tu craches ta valdaþ? La circulation routièreþ: feux de signa-lisation (vieilli)
Les émotionsþ: l’impatience
regarde où tu vasþ! Le mouvementþ: l’avertissement Les émotionsþ: la prudence
make s.o. feel small Les émotionsþ: l’humiliation –
je meurs d’envie de + INF Les émotionsþ: les désirs –
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 10
9.90
.232
.190
- 2
4/03
/201
5 15
h45.
© A
rman
d C
olin
/ D
unod
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 109.90.232.190 - 24/03/2015 15h45. ©
Arm
and Colin / D
unod
115L ANGU E FRAN ÇA I S E 1 50
Collocations et dictionnaires d’apprentissage onomasiologiques bilinguesþ
actuellement en service dans le domaine anglais, français et allemand. Dans lecadre du projet de dictionnaire onomasiologique, nous avons réalisé uneétude approfondie multilingue (anglais-français-allemand) sur les mots etexpressions propres à la circulation routière. Il s’est avéré que, si le plus volu-mineux dictionnaire de collocations – le Oxford Collocations Dictionary forStudents of English – accueille bon nombre de collocations appartenant à cedomaine, il ignore néanmoins certains items très courants. Exemplesþ:
an empty parking space, a tight parking spot, a traffic jam clears, double bend, avoid atraffic jam, the motorway (road) links (Paris) with (Bordeaux), close a motorway, come offthe motorway, open a (new) motorway, motorway journeys, a clear motorway, a validdriving licence, take one’s driving test, nothing coming (etc.)
Le tableau suivant compare les résultats obtenus dans notre étude multi-lingue pour le nom anglais motorway avec la liste des collocations de motorwayproposées dans le Oxford Collocationsþ:
Oxford Collocations Dictionary for Students of English
Collocations supplémentaires mises à jour par l’étude multilingue
N + ADJþ: busy, four-lane (etc.), orbital, urbanN + Vþ: join, leave, turn off, buildN + Nþ: driving, traffic, network, system, bridge, junction, service area, service station, crash, pile-upN + Prépþ: along the motorway, down the motorway, off the motorway, onto the motorway, on the motorway, up the motorway, motorway from, motorway to
N + ADJþ: big (large, major) (→ Fr. grande autoroute)þ; busyþ; clear (→ G.þfrei)þ; cloggedþ; congestedþ; control-ledþ; desertedþ; elevatedþ; emptyþ; toll-free (→ G.þgebührenfrei, mautfrei)
N + Vþ: block, come off, cruise, get onto, go onto, go on, turn off, get off, pull off, open, reopenN + motorwayþ: toll (→ Fr. à péage, G.þgebührenp-flichtig, mautpflichtig),motorway + Nþ: access, bridge, company (→ Fr. société d’autoroute), intersection, journey (→ G.þAutobahnfahrt), lay-by, madness, maintenance, miles, project (→ Fr. projet d’autoroute), trip
N + Prépþ: (be) beside the motorway (→ F. border l’autoroute)
collocations tripartitesþ: electronic motorway tolls (elektro-nische Mauterhebung), on a clear motorway, on clear motorways (→ G.þauf freier (Auto-)Bahn, auf einer freien Autobahn), excellent motorway access, turn a trunk road into a motorway (enlarge a trunk road into a motorway) (→ G.þeine Bundesstraße zur Autobahn ausbauen), widen a motorway to four lanes (→ G.þvierspurig ausbauen), to do a lot of motorway driving, the motorway links A with B (→ F. relie A à B)
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 10
9.90
.232
.190
- 2
4/03
/201
5 15
h45.
© A
rman
d C
olin
/ D
unod
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 109.90.232.190 - 24/03/2015 15h45. ©
Arm
and Colin / D
unod
116
Collocations, corpus, dictionnaires
La comparaison montre qu’un nombre important de collocations utiles aulocuteur non-natif n’ont pas été recensées. Les classes syntaxiques les mieuxreprésentées sont les collocations nom +þnom, nom +þadjectif et nom+þverbe. Parmi les collocations du typeþ2 (cf.þla sectionþ1.6.), les collocationstripartites reçoivent un traitement insuffisant, pour la simple raison que leOxford Collocations exclut des noms composés très courants de sa grille alpha-bétiqueþ; s’il lemmatise comme entrée le nom participial parking, il ne posepas d’entrée distincte pour le composé parking space, laissant ainsi de côté descollocations tripartites usuelles du type empty parking space, squeeze into aparking space ou look for a parking space.
Voici d’autres exemples de collocations tripartites appartenant au domainede la circulation routière qui n’ont pas été consignées (là où il y a un choixparmi plusieurs variantes, les variantes non répertoriées sont soulignées)þ:
Ceci nous amène à parler d’un autre domaine largement négligéþ: lesmarqueurs de discours polylexicaux (Siepmann 2005). Bien qu’omniprésentsdans la langue de la presse et dans le langage universitaire, ils sont réduits àla portion congrue dans la plupart des dictionnaires existants. Le Petit Robert,par exemple, ignore toutes les collocations basées sur le marqueur force est de+þINF (force est de constater/reconnaître/ajouter/…). Comme nous l’avons vudans la sectionþI., ces marqueurs forment à leur tour des collocations(souvent discontinues), qui brillent également par leur absenceþ; si tous lesdictionnaires français accueillent c’est-à-dire et en l’occurrence, aucun ne signalela combinaison fréquente des deux.
L’étude précitée a également permis de mettre en évidence une divergencegénérale entre le français et l’anglais au niveau de la valenceþ: l’anglais utiliseune séquence de deux prépositions avec les verbes de mouvement là où lefrançais est obligé de recourir à deux verbes de mouvement différents etpartant à deux propositions. Deux exemples caractéristiquesþ:
a busy road/a busy streetþ; a much used road une route très fréquentée
on the open roadþ; on clear roads/on clear motorways (etc.)
sur [une] (auto)route dégagée
outside lane hogging/blocking the fast lane/sitting in the outside lane
→ bloquer la voie de gauche
winter road clearance le déblaiement hivernal des routes/le déblaiement des routes en hiver
s.o. changes into first gear/goes into first gear/engages first gear/puts the car into first gear/gets the car into first gear
qqn passe en première/qqn enclenche la première
a good driving road une route sur laquelle il est agréable de conduire/une route où il fait bon conduire
people use a road as a rat-run les gens prennent un raccourci en passant par une route
s.o. gets into the correct lane/s.o. selects the correct lane/s.o. moves into the correct lane
qqn prend la bonne file
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 10
9.90
.232
.190
- 2
4/03
/201
5 15
h45.
© A
rman
d C
olin
/ D
unod
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 109.90.232.190 - 24/03/2015 15h45. ©
Arm
and Colin / D
unod
117L ANGU E FRAN ÇA I S E 1 50
Collocations et dictionnaires d’apprentissage onomasiologiques bilinguesþ
À notre connaissance, cette propriété des verbes anglais était jusqu’ici passéeinaperçue dans la lexicographie monolingue. Il serait facile de multiplier lesexemples de lacunes collocationnelles (et valencielles) de ce genre que seulel’approche onomasiologique multilingue est à même de combler. 8, 9
4. CONCLUSION
En nous plaçant dans l’optique d’une lexicographie centrée sur l’appre-nant, nous avons démontré l’utilité d’une vision élargie du phénomène collo-catif. Les futurs dictionnaires devront recenser tous les types de collocations,notamment celles d’apparence compositionnelle, et les rendre «þapprena-blesþ» à travers une démarche onomasiologique.
Anglais Français
the car swerved (1) across the road and (2) into the ditch la voiture (1) a traversé la route et (2) a fini dans le fossé 8
the car veered (1) off the side of the road and (2) several yards down an embankment
la voiture (1) s’est déportée sur le côté de la route et (2) a dévalé plusieurs mètres en contrebas 9
8. Cf.þl’exemple suivant : « … la Renaultþ11 conduite par Jacky Lapeyre, 53þans, de Montignac, aquitté la route et fini au fossé » (Sud-Ouest, 16.10.2000).
9. Cf.þ« Le car a dévalé plusieurs mètres en marche arrière, jusqu’au panneau publicitaire qui astoppé sa course. » (Sud-Ouest, 19.11.2003).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 10
9.90
.232
.190
- 2
4/03
/201
5 15
h45.
© A
rman
d C
olin
/ D
unod
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 109.90.232.190 - 24/03/2015 15h45. ©
Arm
and Colin / D
unod