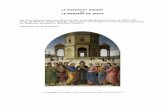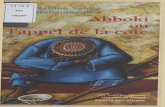Evaluer des demandes, ou la justesse comme travail invisible. Le cas du 115 de Paris
Le ṣîmṣȗm ou la révélation graduelle de lʼUnité
Transcript of Le ṣîmṣȗm ou la révélation graduelle de lʼUnité
1
Le ṣîmṣȗm ou la révélation graduelle de lʼUnité
Extrait du 3e chapitre de la IIe partie de ma thèse
LA KABBALE EN TANT QUE « MÉTAPHYSIQUE » DE LʼUNITÉ
CHEZ RABBI MOÏSE ḤAYYÎM LUZZATTO (RAMHAL)
© Mordékhaï CHRIQUI (Ph.D)
Résumé : Le ṣîmṣȗm qui est traduit généralement par « contraction » de la lumière du
Ein-sof (lʼInfini) ; signifierait aussi pour les kabbalistes « retrait » ou « rétraction »
de la lumière. Si le ṣîmṣȗm lurianique, produit lʼespace primordial de la Création,
pour le Ramhal : « Le ṣîmṣȗm est la source du principe par lequel les choses évoluent
par processus graduel selon la direction du monde jusquʼà sa finalité. » Le but
principal du ṣîmṣȗm, chez notre auteur, est dʼabord de révéler lʼUnité suprême. Le
retrait est perçu comme la dissimulation temporaire de lʼUnité absolue de lʼInfini
pour donner une place à la révélation de lʼUnité dans lʼespace-temps. Cette
dissimulation de la toute-puissance de lʼInfini, signifie, en somme, la révélation
graduelle et évolutive de la complétude
3.3.3. Le ṣîmṣȗm
Dans les différents écrits kabbalistiques pré-lurianiques, lʼémanation des
sefîrȏt, à partir du Ein-sof (lʼInfini), a été expliquée sans poser de difficulté
particulière, jusquʼau moment où Rabbi Isaac Luria aborda un nouveau principe : le
ṣîmṣȗm. Le Ramḥal, dans son chapitre trois du Qalaḥ, Portiques XXIV à XXX, en
propose une interprétation.
3.3.3.1. Le Retrait
Le ṣîmṣȗm1 est perçu généralement comme le retrait de lʼInfini : ce retrait
laisse un espace à la révélation des sefîrôt, origines de tous les mondes divins. Le
ṣîmṣȗm, cʼest aussi la rétraction divine, qui crée un intervalle entre lʼInfini et ce qui
est perçu de Lui, les sefîrȏt2. Avant dʼaborder réellement notre sujet, une question
sʼimpose : la théorie lurianique veut-elle interpréter seulement de manière allégorique
la révélation des sefîrôt à lʼextérieur du Ein-sof, ou consiste-t-elle plutôt à expliquer
1 . Le ṣîmṣȗm, est traduit généralement par « contraction » de la lumière du Ein-sof ; mais signifierait
aussi « retrait » ou « rétraction » de la lumière. 2 . Voir SCHOLEM, La kabbale, p. 220-229.
2
un acte réel de (retrait de) lʼInfini qui précède lʼémanation des sefîrȏt, pour leur faire
une place ?
La controverse oppose, semble-t-il, deux écoles post-lurianiques : lʼune
préconise la lecture littérale (ki-pěšȗṭȏ) du ṣîmṣȗm comme retrait de lʼInfini pour
libérer un lieu primordial, et lʼautre, recherchant le sens caché et allégorique de la
dissimulation, choisit lʼappréhension non littérale (lȏ ki-pěšȗṭȏ) du ṣîmṣȗm. Lisons à
la source, chez le Ari :
Sache quʼavant que ne soient émanés les émanés et que les créatures ne
soient créées, une lumière supérieure simple remplissait toute la réalité. Il
nʼy avait aucune place libre, sous lʼaspect dʼun air vide et dʼun creux,
mais tout était rempli de cette lumière infinie simple ; elle nʼavait ni début
ni fin ; tout était lumière, une, simple, homogène dʼune homogénéité une,
et cʼest ce que lʼon appelle la Lumière de lʼInfini. Lorsque lʼInfini,
engageant Sa Volonté simple, voulut créer les mondes et émaner les
émanés pour manifester la perfection de Ses actions, de Ses noms et de
Ses attributs, cause de la Création des mondes, Il se contracta alors, Lui-
même, en Son point central, vraiment au milieu ; et Il contracta cette
lumière, qui sʼéloigna sur les côtés, autour du point central. Il resta une
place vide, de lʼair, un évidement en creux, de ce point central3.
Pour les tenants de lʼinterprétation littérale, le ṣîmṣȗm est un acte de retrait par
lequel lʼInfini et les mondes divins se séparèrent. Pour les défenseurs de
lʼinterprétation allégorique, le ṣîmṣȗm signifie, non pas un retrait, mais une
dissimulation qualitative de la présence de lʼInfini par rapport à Son monde. Par
conséquent, le ṣîmṣȗm est le principe de privation qui nʼa de réalité que du point de
vue des êtres créés, il nʼaffecte pas lʼInfini lui-même4. Pour trancher la question chez
le Ramḥal, il nous faut dʼabord résumer et analyser les Portiques XXIV à XXX du
Qalaḥ. Dans sa première définition du ṣîmṣȗm au Portique XXIV, lʼauteur écrit :
Afin dʼextérioriser lʼaction [créatrice] en dehors de Lui, le Ein-sof,
lʼInfini, décréta et retira son infinitude de lʼaction créatrice pour agir selon
lʼaction délimitée. Cela est appelé : ṣîmṣȗm de lʼInfini.
« Lʼaction créatrice », ou lʼœuvre de la Création, était contenue dans lʼInfini
avant dʼêtre extériorisée. Dans son commentaire, notre auteur précise : « La Volonté
du Ein-sof comprend une infinité de forces [unifiées en une seule entité, sans aucune
3 . ʻȆṣ Ḥayyîm, Portique I, § 2.
4 . Voir ʼAddîr bamȃrȏm II, p. 47.
3
distinction]. […] LʼÉmanateur désire dévoiler une force parmi les forces à lʼextérieur
de Lui, qui sera lʼorigine de toute la Création. […] Le ṣîmṣȗm consiste justement à
extirper cette force en dehors de lʼInfini. » Le Ramḥal définit donc le retrait comme
lʼaction de soustraire le caractère infini à la force créatrice, (car celle-ci était aussi
obligatoirement contenue dans lʼInfini), mais délimitée sous Sa contrainte lors de la
Création. « LʼInfini retire lʼinfinitude à la force créatrice qui existait parmi une
multitude de forces contenues en Lui5. » À la fin de ce Portique XXIV, notre auteur
donne une première conclusion (non définitive) : « Le ṣîmṣȗm nʼest pas seulement un
retrait, cʼest dʼabord une révélation. Ce qui se retire cʼest le pouvoir infini dʼune
force, ce qui engendre [le principe de] la limite6. » Le ṣîmṣȗm consiste donc à révéler
la force de la Création, qui est le principe de la limite, le contenant. Pour ce faire,
lʼInfini retire à cette force son caractère ontologique dʼinfinitude, tout en y laissant la
trace (rĕšîmȗ) de la lumière infinie.
Au Portique XXV, notre auteur semble réduire lʼacception du ṣîmṣȗm à la
possibilité dʼêtre perçu (nîtȃn lĕ-hĕrȃʼȏt) :
Ce ṣîmṣȗm a permis que Sa lumière et Son rayonnement soient
perceptibles à partir de Lui [de lʼInfini], ce qui nʼétait pas possible
auparavant ; hormis dans le lieu laissé par le ṣîmṣȗm, point de perception.
Dans le Portique V, lʼauteur a déjà précisé cette différence entre le Ein-sof et
les sefîrȏt : « Les sefîrȏt sont des illuminations (hĕʼȃrȏt : flux, émanations) qui sont
proposées à la perception ; tandis que la lumière absolue (simple) du Ein-sof, nʼest pas
perceptible. » Quel est donc le rôle du ṣîmṣȗm chez le Ramḥal ? « Le ṣîmṣȗm nʼa pas
engendré la lumière émanée ou la voie de la limite [origine et condition du monde],
[…] mais a permis la perceptibilité de cette lumière7 […] ». Étant donné que « cette
lumière [lʼacte de la Création] existait en potentiel déjà au sein de lʼInfini », le ṣîmṣȗm
5 . Dans le commentaire du Portique XXIV, lʼauteur pose la question : « Comment lʼInfini peut-il
contenir une force qui sʼinscrit dans la limite, la Création ? En effet, la Création implique
lʼinscription des lois et des créatures dans la limite, alors comment peut-on considérer le limité à
lʼintérieur de lʼInfini ? Il y a contenir et contenir : un sujet peut contenir une idée “ par la positive ”,
mais aussi “ par la négative ”. Par exemple, la mort ne peut être comprise sans la vie. En effet, la
mort retire (“ par la négation ” de) la vie. Nous dirons alors que la mort contient la vie par la
négation. De même, nous dirons que lʼInfini contient la limite “ par la négative ”. On entend par
limite : les sefîrȏt, les lois impersonnelles et personnelles, les catégories, les modalités, etc., de la
Création. Cette limite, contenue dans lʼInfini, nʼavait aucune réalité ni corporéité, c'est seulement en
retirant lʼinfinitude de cette force, quʼelle va se révéler en tant que force vitale créatrice ». 6 . Ce qui revient à dire que lʼInfini contient tout, y compris son contraire : la limite. Cependant la
limite ne se révèle quʼau moment où lʼInfini sʼen retire. 7 . Qalaḥ, Portique XXV.
4
nʼa fait que révéler cette lumière primordiale inaccessible en lui retirant son caractère
infini. Et cela, dʼautant plus que la lumière émanée, la trace, « ne procède pas
obligatoirement du ṣîmṣȗm, comme lʼeffet procède de la cause ».
Somme toute, le ṣîmṣȗm nʼest pas nécessaire, « car cʼest la Volonté qui a
décrété cette révélation en dehors de lʼinfini ». Le ṣîmṣȗm, en fait, est le moyen, parmi
dʼautres moyens, utilisé par la Volonté pour réaliser lʼœuvre du commencement.
« Cependant, par téléologie, nous dirons que cʼest le ṣîmṣȗm qui a fait œuvre de
création », ou, tout au moins, quʼil a permis plus tard lʼapparition de la corporéité,
« non pas quʼil en soit la cause efficiente, mais parce quʼil reste la cause de
lʼexistence (sîbȃh la-mĕṣîȗt) ». La cause initiale est le décret de la Volonté, mais la
cause proche de toute la réalité sera le ṣîmṣȗm. Aussi, cette perception nʼest-elle pas
produite grâce à la nature de la lumière, mais « par décret de la Volonté du Ein-sof ».
La lumière des sefîrȏt nʼest quʼun dévoilement, une révélation de quelque chose qui
existait déjà. Cependant « nous attribuons à la lumière des sefîrȏt le caractère de
nouveauté car elle paraît, grâce au ṣîmṣȗm, comme une catégorie nouvelle […]. En
vérité, la lumière nʼest pas nouvelle, elle existait auparavant, soumise à la contrainte
absolue de lʼinfini8 ».
3.3.3.2. La trace et le Rayon
Si nous ne pouvons dʼores et déjà conclure sur la nature du ṣîmṣȗm, nous
sommes cependant en mesure dʼanalyser les conséquences de ce retrait énigmatique.
Si, pour le Arizal, ce qui résulte du ṣîmṣȗm, est un mâqôm, un espace, un lieu pour la
Création, pour notre auteur il sʼagit aussi dʼune lumière émanée (ʼȏr neʼĕṣȃl). « Cette
lumière émanée se nomme rĕšîmȗ : trace de la lumière primordiale qui, du fait de son
incommensurable grandeur, ne pouvait être perceptible avant le ṣîmṣȗm9. »
Dans les écrits de Vital, après le ṣîmṣȗm, un espace vide apparaît qui est
apparemment absolu et homogène. Cʼest dans lʼespace primordial10
que naîtront les
sefîrȏt à partir de la pénétration du « rayon (qaw) de lʼInfini ». Cependant, le Ramḥal
insiste sur le fait, notable, que les sefîrȏt existaient déjà au sein de lʼInfini et que cʼest
le ṣîmṣȗm exclusivement qui en permet lʼapparition. Donc, lʼespace primordial en
8 . Ibid.
9 . Qalaḥ, Portique XXVI.
10 . Voir ʻȆṣ Ḥayyîm I, 2 ; voir aussi SHATZ, « La métaphysique », p. 377-379.
5
question, qui se manifeste après le ṣîmṣȗm, nʼest pas un vide absolu puisqu’il contient
cette trace de la Lumière infinie. Désormais, après le ṣîmṣȗm, cʼest une lumière
émanée, donc effectivement diminuée et réduite à produire les dix sefîrȏt de la
Création. Dʼautre part, dans le rĕšîmȗ, la trace, « se trouve la racine de tout ce qui
adviendra. Ce qui ne sʼy trouve pas ne pourra pas être ensuite. […] Tous les êtres
créés, ainsi que leurs accidents, sont enracinés dans ce rĕšîmȗ […] Le rĕšîmȗ, cʼest
aussi bien la trace des forces transcendantes de la Création que la trace de toutes les
créatures et de leurs accidents11
. » Néanmoins, rien ne pourra sortir en acte que par
lʼintervention du rayon de lʼInfini :
Toutes les lois de la Direction divine sont enracinées dans le rĕšîmȗ ;
[cependant] le début de la Direction divine ne se trouve que dans le rayon
de lʼInfini ; et toutes les catégories du rĕšîmȗ ne sont animées que par Lui,
à lʼinstar dʼune hache dans la main dʼun bûcheron. […] Bien que lʼaction
du Ein-sof, en tant que rayon de lʼInfini qui pénètre à nouveau dans
lʼespace primordial, sʼexprime dʼune façon limitée adaptée à la créature, il
faut savoir que lʼorigine de lʼaction elle-même, inscrite dans lʼInfini, est
parfaite. De là nous déduisons que la direction de lʼInfini, par la
pénétration renouvelée du rayon, nʼest que bienfait, et tout ce que le
Miséricordieux fait nʼest que pour le Bien (selon T.B. Běrâkhôt, 60b).
Néanmoins, la contingence est le caractère des créatures dépourvues de
perfection. Cʼest donc lʼimperfection qui se révèle au préalable, pour
ensuite laisser place au cycle du temps qui débouchera sur la plénitude.
[…] Pour révéler Son unité, lʼÉmanateur procède dʼabord par la
dissimulation de Sa perfection pour faire place à une limite et donc à une
création incomplète et imparfaite. En effet, du rĕšîmȗ, de la trace,
procèdent les créatures incomplètes […]. Mais lʼintention, au préalable,
était de fournir la gradation12
pour que les créatures puissent Le rejoindre.
Les voies du rĕšîmȗ donnent une place à lʼhomme ainsi quʼà son
intervention volontaire. Si le monde était dirigé uniquement par le rayon
de lʼInfini, alors la plénitude régnerait, les créatures seraient statiques sans
pouvoir sʼélever vers lʼInfini. Si le monde était dirigé uniquement par le
rĕšîmȗ, alors le déterminisme régnerait et la direction du rĕšîmȗ, la justice
stipulant la récompense et la punition, gouvernerait à jamais ; il y aurait
alors toujours des justes et des mauvais13
. […] Mais puisque le rayon
dirige lui-même le rĕšîmȗ, ce dernier est asservi à la voie de la perfection,
11
. Qalaḥ, Portique XXVII 12
. Nous verrons encore cette idée de la gradation dans notre conclusion sur le ṣîmṣȗm, voir infra,
3.3.3.4. 13
. Voir aussi D.T, § 166.
6
et le mal, comme la mort, sʼévanouiront14
.
Pour Luria, le qaw, le rayon de lʼInfini, pénètre dans lʼespace primordial pour
réaliser les premières sefîrȏt15
; pour le Ramḥal, le rayon exprime deux manifestations
importantes : lʼactualisation de tout ce qui est enfermé dans la trace, et la Direction
divine de la souveraineté de lʼUnité. « Le Ein-sof introduit Son rayon dans la trace en
le dissimulant dans tous ses degrés, cʼest ainsi quʼIl la dirige […]. Le rayon qui
pénètre à lʼintérieur sʼintègre à tous les niveaux du rĕšîmȗ en se dissimulant [...]. Ce
qui signifie que la direction de la souveraineté (qaw, le rayon) gouverne, mais en se
dissimulant dans la direction de la rétribution, dite direction du bien et du mal,
récompense et punition, pour ramener le tout à la plénitude de lʼUnité16
. » Le rayon
fait sortir en acte les événements des sefîrôt, et cependant les dirige vers le but ultime
: le Bienfait et la révélation de lʼUnité.
Dʼautre part, le rayon de lʼInfini intervient selon un couple dialectique : un rayon
qui pénètre dans lʼespace de la Création, pnîmî, et un rayon qui englobe et contourne
lʼensemble de lʼespace primordial, mȃqîf – à la fois intérieur et englobant. Ainsi, « le
rayon se tient à la périphérie extérieure et lʼenglobe, cʼest pourquoi nous dirons quʼIl
en est la cause et le contourne de tous côtés », le rayon se nomme alors lumière qui
entoure et englobe, enveloppante. Cependant « toute intervention du rayon ]à
lʼintérieur comme à lʼextérieur[ équivaut à la mesure du rĕšîmȗ. […]. Même si la
lumière qui englobe est la cause, elle sʼadapte au rĕšîmȗ17
».
En résumé, le rayon de lʼInfini, le qaw, désigne avant tout la souveraineté de
lʼUnité du Ein-sof, et cela malgré « une certaine dissimulation engendrée par le
ṣîmṣȗm18
». Rien ne peut se révéler du rĕšîmȗ sans le rayon de lʼInfini, cʼest Lui qui
distille le code génétique de toute lʼexistence enracinée dans la trace. Rien ne peut se
manifester, ni dans la Création, ni dans lʼhistoire du « début jusquʼà la fin » sans son
intervention.
Pour révéler Son Unité, lʼÉmanateur procède dʼabord par la dissimulation de Sa
perfection absolue infinie afin de laisser une place à la limite, et donc à une nature
incomplète et imparfaite. Cependant, lʼintention première, comme nous allons le voir,
fut de fournir la gradation, donc lʼévolution, le temps ; afin aussi que les êtres créés
14
. Qalaḥ, Portique XXVII. 15
. Voir ʻIggȗlîm vě-yȏšer in ʻȆṣ Ḥayyîm I, 1, 3, p. 32-47. 16
. Qalaḥ, Portique XXVIII. 17
. Ibid. 18
. Voir Portique XXX.
7
puissent agir, intervenir et évoluer dans un espace-temps. Les voies du rĕšîmȗ
donnent une place à lʼhomme ainsi quʼà son intervention volontaire. Ainsi que nous
lʼavons vu, pour notre auteur, si le monde était dirigé uniquement par le rayon de
lʼInfini, alors la plénitude régnerait, les créatures seraient statiques et le déterminisme
prévaudrait. Mais puisque le rayon intervient directement dans le rĕšîmȗ, tout est alors
asservi à la voie de la perfection19
.
Avant de nous donner ses conclusions sur le ṣîmṣȗm au Portique XXX, le
Ramḥal précise, au Portique XXIX, à propos de lʼespace primordial : « Avant le
mâqôm, aucun existant ne pouvait exister, mais au moment où lʼespace se réalisa, les
sefîrȏt sʼeffectuèrent. » Le rĕšîmȗ se substitue au mâqôm ; la trace de lʼInfini et
lʼespace primordial se confondent, parce que « le mâqôm nʼest pas vide, mais empli
de la lumière des sefîrȏt ». Ainsi « les sefîrȏt procèdent de lʼespace [primordial]
réalisé au moment du ṣîmṣȗm : chaque sefira étant une partie du rĕšîmȗ20
».
3.3.3.3. La gradation
Lʼespace primordial ne représente pas seulement la matrice des sefîrôt, il
forme également une entité métaphysique où se déroule toute la dynamique des
interactions séfirotiques et leurs conséquences. Sous cet aspect, nous pouvons dire en
empruntant un langage newtonien : lʼespace est absolu et réel21
. Lʼespace nʼest pas un
espace géométrique, euclidien, cʼest une réalité métaphysique où se jouent les causes
premières des êtres créés et leurs accidents :
Le ṣîmṣȗm est la source du principe par lequel les choses évoluent par
processus [graduel] selon la direction du monde jusquʼà sa finalité.
Autrement dit, les détériorations peuvent se produire, mais, à la fin, tout
retourne nécessairement vers le tiqqȗn - lʼarrangement final, de sorte que
lʼUnité sera perceptible véritablement.
[Commentaire de lʼauteur] : Il faut savoir que la Volonté suprême a évalué
(lit. šîʻȇr : mesuré) le cycle tout entier de la Direction divine dans tous ses
détails et comment tout aboutit à la perfection absolue. Ces mesures sont
les sefîrȏt et les mondes divins […]. Le ṣîmṣȗm est la première racine que
19
. Voir supra, note 585 ; infra II, 8. 20
. Qalaḥ, Portique XXIX. 21
. À propos du concept de lʼespace absolu et réel chez Luria, Newton ainsi que chez Henri More, voir
SHATZ, « La métaphysique », p. 390. À ce sujet, on peut consulter aussi lʼouvrage de ʽEval
LESHEM-RAMATI, Isaac Newton vé-Bêt ha-miqdaš : maddâʽ vé-qabbâlâh (Newton et le Temple,
science et kabbale), Migdal : Éd. Raziel, 2005, p. 68.
8
la Volonté suprême a évaluée pour faire les créatures. Cela est appelé
lʼespace des mondes. Par le ṣîmṣȗm, lʼInfini retire le sans-fin dans
lʼespace de la Création […]. Cʼest ainsi que se révèlent les sefîrȏt en tant
que forces [graduées] de la Création. Somme toute, le ṣîmṣȗm signifie
gradation, lʼaction évolutive ; Il agit progressivement pour révéler dans le
temps […]. La gradation est le premier postulat qui est posé par lʼInfini
pour faire lʼespace primordial […]. Le Ein-sof a voulu adapter le flux à sa
ramification [cʼest-à-dire au réceptacle] […], de telle manière que naisse
la gradation qui est lʼespace du ṣîmṣȗm22
.
Lʼespace constitue cette possibilité de concevoir lʼautre ; pour lʼÉmanateur, il
sʼagit de réaliser ses créatures. La gradation23
ou la hadrȃgȃh, - signifiant ici lʼaction
évolutive - représente le moyen utilisé pour lʼémanation ; cʼest le postulat qui précède
lʼétablissement de la Direction divine. En effet, comment lʼInfini peut-Il se mettre à la
mesure du fini ? Cette contraction (ṣîmṣȗm) de la puissance infinie exprime lʼaction
évolutive de lʼÉmanateur, cela afin de réaliser le projet de la Création et de lʼhistoire.
Comme nous lʼavons déjà signalé, pour le Ramḥal, Il existe une Volonté
infinie (rȃṣȏn bîltîy takhlîtîy) qui sʼappelle Ein-sof, et une Volonté limitée (rȃṣȏn
takhlîtîy) ou mesurée liée au but de la Création. La Volonté infinie ne se contracte pas
pour devenir une Volonté limitée, mais Elle retire lʼinfinitude de lʼaction de la
Création. Cette action sʼinscrit donc dans un espace limité, qui se révèle en tant que
trace de lʼInfini donnant naissance aux mesures (sefîrȏt) de la Création destinées à
révéler lʼUnité (qui est de lʼordre de la Volonté infinie24
) :
Et si on se questionne sur les mesures de cette gradation, la réponse est
que la Volonté suprême a estimé que seule cette gradation [de lʼaction] est
apte à ramener le mal au bien et à faire advenir la révélation de lʼUnité25
.
Nous avons donc un ṣîmṣȗm à lʼadresse de la Création (pour octroyer le
Bienfait) et un ṣîmṣȗm qui tend à la révélation de lʼUnité26
. Cependant, comme nous
le verrons, les deux buts se rejoignent27
.
22
. Portique XXX, et commentaire. 23
. À propos de la gradation dans le domaine de la Logique, voir SH, § 23 ; Derekh Tĕvȗnȏt § 11 ;
LEDERMAN, La Logique du Talmud, op. cit., p. 89-93.
Luzzatto emploie le principe de la gradation, à lʼinstar de Ramus dans sa méthodologie, il lʼutilise
dans le Talmud, mais aussi pour son système métaphysique. 24
. Voir infra III, 2.1, 3.1.1. 25
. Portique XXX. 26
. Nous verrons dans le Sȏd ha-yîḥȗd la primauté de la révélation de lʼUnité sur la Création, infra II, 8
; III, 1-2. 27
. Voir infra, II, 7, sur : Le but ultime de la kabbale.
9
Dans ce Portique (XXX), notre auteur insiste sur lʼidée du but principal de la
Création et de lʼhistoire : « Bien que la Création reflète les manques ainsi que les
détériorations, tout le cycle événementiel poursuit le projet de la révélation de lʼUnité,
cʼest dire que la gradation ainsi que le système séfirotique poursuivent un seul et
même but : la révélation de lʼUnité. » Présentement, les vicissitudes du temps
obéissent à la direction dualiste du bien et mal engendrée par le ṣîmṣȗm, de même que
le libre arbitre, la récompense et la punition. Néanmoins, tout mal doit revenir au Bien
selon le principe de lʼUnité. « Cependant, ne pense pas que la direction de lʼUnité
advienne comme une étape après la direction du bien et mal, mais les deux directions
[celle du ṣîmṣȗm et celle de lʼUnité] fusionnent ensemble depuis lʼorigine. Le tiqqȗn,
la réparation, lʼarrangement du monde, ne vient pas comme une étape ultime de
lʼhistoire, mais la direction de lʼUnité se fait en même temps que la direction dualiste
du bien et mal, dans le temps28
. » À la fin de lʼhistoire, le tiqqȗn se révélera aux yeux
de tout vivant. Certes, durant le cycle du temps jusquʼau rétablissement final de
lʼUnité initiale, le tiqqȗn agit, mais, en attendant, il nʼest perçu que par des êtres
dʼexception.
3.3.3.4. Le secret du ṣîmṣȗm
Afin dʼaller plus loin dans la compréhension du ṣîmṣȗm, nous aurons recours à
un texte de ʼAddîr bamȃrȏm, sur la définition de la Volonté:
« Volonté » signifie la pensée volontaire (maḥšâvâh rĕṣȏnît) ; le jugement
ou décret intellectif (gĕzerȃh sîkhlît) ; le désir ; lʼintention finale ;
lʼhumeur […]. La pensée volontaire, cʼest le Ein-sof qui est à lʼorigine de
tous les existants. Car Elle (cette volonté) peut [les penser] de tant de
manières différentes au point quʼaucun des existants nʼait de limite […].
Cette Volonté sʼappelle la puissance de la volonté (kȏʼaḥ ha-rȃṣȏn) qui
est le Ein-sof […]. Cependant son décret [intellectif, dans la réflexion
divine interne] exprime le sujet du ṣîmṣȗm […] cʼest-à-dire lʼinclination
vers cette action particulière [de créer toute la réalité], alors que telle
inclination dans sa puissance [de vouloir] tend à des actions sans fin29
.
le Ramḥal perçoit continuellement lʼUnité dans la Volonté divine ; la dualité
dʼaspects dans la « volonté » nʼest en fait quʼune distinction (faisant partie des
28
. Voir aussi DT § 48, 50, Les Voies de la Direction divine, p. 117, 120. 29
. ʼAddîr bamȃrȏm, p. 209 – 210.
10
catégories logiques) dans la Volonté suprême. Ainsi, dans son discours Ma’ǎmȃr
ʼĂrîmît yĕday bîṣlȏtîn30
, il assimile la pensée volontaire à la volonté générale (rȃṣȏn
kelȃlî), donc au Ein-sof, et le décret à la puissance particulière (kȏʼaḥ perȃtî) qui a
comme but unique : le Bienfait. Cette inclination du Ein-sof vers un but déterminé
correspond au centre du Ein-sof (merqȃz ha-Ein-sof) ou point central rapporté par
Luria31
. Pour notre auteur, le point central est « lʼaxe sur lequel toutes les inclinations
de la Volonté tournent, cʼest-à-dire le Bienfait et le retour du mal en bien32
». Ce qui
signifie que la Volonté est une. Cette inclination de la Volonté à destination de la
Création nʼaffecte pas cette Volonté infinie, car « ʼȆyn ha-ṣîmṣȗm la-Ein-sof, ȇlaʼ la-
nȇʼȇṣȃlîm, kî ȇn ha-mĕnîʻah ʼȇlȃv, wĕhȗ ʼȇnȏ mîtʻalȇm : Il nʼy a pas de ṣîmṣȗm à
appliquer à lʼInfini, le ṣîmṣȗm est attribué aux émanés, car aucune lacune ne
Lʼaffecte, et Lui se dissimule pas33
». Le Ein-sof ne se retire pas, néanmoins une force
parmi une infinité de forces, qui serait à lʼorigine des mondes, se verrait retirer
lʼinfinitude, pour faire apparaître un « point ». Tel point serait la cause principielle de
la Création et son but ultime.
Avant le ṣîmṣȗm, cette réalité qui sera appelée plus tard : les sefîrôt, est définie
comme la « force » (la puissance, ou, lʼacte) de la Création, appartenant à un
ensemble homogène dʼune multitude de forces. Cʼest cette force, cause de la
Création, qui subit le ṣîmṣȗm, cʼest-à-dire le retrait du caractère infini pour nʼen
garder que la trace ontique, ou le point, qui permet de se dévoiler et de devenir
lʼespace des dix sefîrȏt. Il nous semble que le Ramḥal renouvelle ici le sens du
ṣîmṣȗm luranien : il ne sʼagit plus du retrait de lʼInfini pour créer un espace, mais de
retirer lʼinfinitude dʼun espace (qui lui aussi était infini) pour le révéler.
Au début, ce qui se révèle cʼest un point, le « centre de lʼInfini », cʼest lui qui
sera à lʼorigine des dix sefîrôt. Ce point est appelé la force ou la « cause de la
Création ». Cette force sʼidentifie à la malkhȗt (royauté) du Ein-sof qui est la cause et
lʼorigine de tous les existants et de leurs événements.
La corrélation entre la royauté (malkhȗt) et lʼHomme primordial (ʼÂdâm
qadmȏn) a déjà été relevée précédemment (3.3.2.). Il y a cependant une différence
entre malkhȗt, perçue comme lʼimage principielle contenant toutes les formes,
30
. Voir ʼAddîr bamȃrȏm II, p. 76. Nous reviendrons à ce texte fondamental dans notre IIIe partie, 2.3.
31 . Voir son Bĕʼȗrîm Lĕ -Sefer ʼOṣrȏt Ḥayyîm, in Ginzȇy Ramḥal, p. 297, à propos de « nĕqȗdȃt ha-
merqȃz ». 32
. Ibid. 33
. ʼAddîr bamȃrȏm II, p.47.
11
principe qui se dévoile comme étant lʼorigine des dix sefîrȏt et également racine de
tous les existants, et ʼÂdâm qadmȏn qui correspond à « lʼensemble de toute la réalité34
». Dans le prochain chapitre, nous traiterons de cet « ensemble » ou plutôt de la
structure de toute la réalité.
34
. Voir Portique XII.