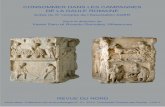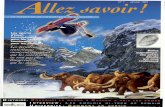Grands économistes
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Grands économistes
John Nash
John Nash est né en 1928. Ses travaux sur lathéorie des jeux lui ont valu le prix Nobeld’Economie en 1994. Il est l’auteur d’une séried’articles qui portent sur les équilibres non-coopératifs, plus tard rebaptisés « équilibresde Nash ».
La théorie des jeux
Issue des mathématiques dans les années 1920,la théorie des jeux permet de prévoir le comportement des agentséconomiques, en faisant l’hypothèse que tout agent effectue toujoursun choix rationnel visant à maximiser ses gains et à minimiser sespertes.
Elle offre un cadre formel à des questions de stratégies dansdes situations d’interactions entre plusieurs agents. Elles’intéresse notamment aux situations dans lesquelles les décisionsprises par un agent ont un impact sur la manière dont les autresagents agissent et réagissent. Par exemple, une entreprise a-t-elleintérêt à baisser le prix de vente de son produit pour augmenter sesventes ? Pas forcément… L’entreprise doit, ainsi, anticiper laréaction de ses concurrents, qui pourraient suivre la même stratégiede réduction du prix de vente. Sans anticipation de la contre-offensive commerciale des autres entreprises opérant sur le marché,le consommateur sera le seul gagnant (il bénéficiera de la baissedes prix).
Toute la question est de savoir s’il est possible de prévoir lesstratégies des différents protagonistes.
L’équilibre de Nash
Nash soutient sa thèse sur les jeux non-coopératifs en 1950.Dans cette catégorie de jeux, les agents ont des buts opposés. Lesjeux coopératifs, quant à eux, visent à trouver la meilleuresolution en faisant coopérer plusieurs joueurs.
Dans sa thèse, Nash présente une situation d’équilibre qui
deviendra bientôt l’« équilibre de Nash ». Par équilibre, il entendune situation dans laquelle aucun des joueurs ne peut trouver demeilleure stratégie de jeu, compte tenu des stratégies choisies parles autres joueurs.
Prenons l’exemple classique du dilemme du prisonnier. Deuxprisonniers (A et B) ont commis un cambriolage. Ils sont interrogésdans des pièces différentes et ne peuvent donc pas tenir compte desréponses de l’autre. Si l’un des prisonniers dénonce son complice,il est libre, mais son complice est condamné à vingt ans de prison.Si les prisonniers se dénoncent mutuellement, chacun est condamné àdix ans de prison. Enfin, dernier cas, si aucun des deux ne dénoncel’autre, ils écopent tous les deux d’un an de prison.
A l’équilibre,les prisonnierschoisissent de sedénoncer mutuellementcar ils n’ont pas lapossibilité decoopérer pour obtenirla peine minimale(ils sont dans des cellules séparées). On peut noter que dans cecas, l’équilibre de Nash n’est pas un optimum de Pareto puisque lesdeux joueurs pourraient augmenter leur bien-être en coopérant.
L’équilibre de Nash a eu et continue d’avoir de nombreusesapplications en économie : on peut citer, entre autres, l’analyse ducomportement des firmes en situation de duopole ou l’étude desmécanismes d’enchères pour l’octroi d’un marché public. Sesapplications s’étendent également à la géopolitique (un exemplecélèbre est celui de la crise des missiles de Cuba, où l’équilibrede Nash est utilisé pour étudier la dissuasion nucléaire) et, plusgénéralement, à l’étude des choix stratégiques.
Le Comité Nobel a salué à trois reprises (en 1994, 2005 et2007) les travaux de théoriciens des jeux.
Pour l’anecdote, la vie de Nash a fait l’objet d’un film Unhomme d’exception (2001), récompensé par l’Oscar du meilleur film en2002.
Alfred Marshall
Si le nom d’Alfred Marshall est peu cité, lesconcepts qu’il a élaborés sont aujourd’huiencore abondamment utilisés.De formation scientifique, l’Anglais AlfredMarshall (1842 – 1924) a notamment occupé laChaire d’économie politique à Cambridge. Ilfait partie de l’école néoclassique, et a étéle professeur de J.M. Keynes.
L’équilibre partiel
Marshall introduit dans ses Principes d’économie politique les
courbes d’offre et de demande qui constituent aujourd’hui lareprésentation la plus populaire du marché.Contrairement à l’approche de Léon Walras, qui dans la théorie del’équilibre général s’intéresse simultanément à l’ensemble desmarchés, Marshall raisonne toutes choses égales par ailleurs. Il nes’intéresse pas aux interactions avec les autres marchés. Le prixest déterminé par les seules variations de l’offre et de la demandedu bien considéré. Cette approche, en dépit de sa simplicité estaujourd’hui encore largement utilisée pour représenter les marchés.
Le coût et la valeur
Bien qu’il soit profondément imprégné des idées développées dans lesannées 1870 par Walras, Menger et Jevons, pour qui l’utilitémarginale (la satisfaction que retire un individu de la consommationde la dernière unité d’un bien) est décroissante, Alfred Marshallaffine cette idée en y intégrant les coûts de production.Sur le court terme, c’est essentiellement l’utilité (satisfactionprocurée par le bien au consommateur) qui détermine le prix d’unbien : les consommateurs sont prêts à payer davantage pour un bienqui leur apporte une utilité plus grande.Sur le long terme, les coûts de production deviennent déterminantsdans la formation du prix d’un bien. Sur ce point, Marshall renoueen partie avec la tradition classique, selon laquelle la valeurdépend essentiellement de la quantité de travail incorporée dans unbien.
Les rendements de la production
Marshall s’intéresse par ailleurs aux rendements de la production.Avant lui, deux idées s’opposent : pour Smith, les rendements sontessentiellement croissants (en raison de la division du travail),tandis qu’ils sont décroissants dans l’esprit de Ricardo (le capitalle plus productif étant utilisé en premier, chaque unité nouvelleest donc moins productive que la précédente).Face à cette dualité, Marshall développe la loi des rendements nonproportionnels. Selon lui, les deux effets se combinent : pour unemême production, les rendements croissants commencent par dominer,puis les rendements décroissants prennent le dessus. A l’optimum, unéquilibre est trouvé entre ces deux tendances contradictoires.Marshall regroupe au sein d’une théorie unifiée les concepts d’offreet de demande, de prix, de coût et d’utilité marginale. Cet édificede logique, qui se veut ancré « dans l’activité ordinaire de la vie», influencera plusieurs générations d’économistes.
Paul Krugman
Paul Krugman est un économiste américain, né en1953. Il est professeur à l’Université dePrinceton et éditorialiste au New York Times.Il est l’un des initiateurs de la « nouvellethéorie du commerce international ».Son analysedes modèles du commerce et de la distributionspatiale de l’activité économique lui a valud’obtenir le prix Nobel d’Economie 2008.
La nouvelle théorie du commerce international
Les théories traditionnelles – fondées sur la concurrence pure etparfaite et l’absence d’économies d’échelles (le coût moyen deproduction ne diminue pas quand la quantité produite augmente) –échouent à expliquer les flux du commerce mondial. A savoir, unepart significative du commerce mondial concerne des échanges debiens similaires, entre des pays de même niveau de développement(souvent des pays industrialisés). La Suède, par exemple, exporteses Volvos vers l’Allemagne, qui lui vend ses BMW. Autrement-dit, lecommerce n’est pas fondé sur la spécialisation.Krugman explique les flux observés par la concurrence imparfaite. Ila recours notamment à des modèles fondés sur la différenciation desproduits (goût du consommateur pour la variété des produits d’unemême branche) et l’existence de rendements croissants (économiesd’échelle).En offrant une formalisation mathématique, la nouvelle théorie ducommerce international prolonge, les travaux précurseurs de Linderet Vernon menés dans les années 1960. Ces derniers pointaient déjàles limites des théories traditionnelles pour rendre compte defaits, tels que l’échange de produits similaires entre pays riches.Bien que ses travaux modifient sensiblement les fondements del’analyse des échanges au point d’introduire des ambiguïtés sur les
avantages du libre-échange, Krugman n’en demeure pas moins unfervent partisan du libre-échange (voir son ouvrage Lamondialisation n’est pas coupable. Vertus et limites du libre-échange, 1998).Outre sa contribution à la nouvelle théorie du commerceinternational à la fin des années 1970, Krugman est reconnu pour sestravaux sur la nouvelle économie géographique, dont il devient l’undes leaders à la fin des années 1990. Son analyse suggère quel’implantation des lieux de production et de commercialisation estle fait d’un arbitrage entre les économies d’échelle (favorisant laconcentration) et les coûts de transport (favorisant, au contraire,la dispersion).
Un vulgarisateur hors-pair
Krugman est particulièrement connu du grand public pour saparticipation aux débats de politique économique. A l’instar deStiglitz, il est considéré comme un vulgarisateur hors-pair del’économie. Ses chroniques dans le New York Times ont renforcé sanotoriété internationale.Ses écrits percutants l’ont positionné comme un critique virulent del’administration Bush, dont il a attaqué la politique dedérégulation excessive. Au contraire, il a appelé à une hausse de lafiscalité et à un surcroît d’interventionnisme public aux Etats-Unis. Les Etats doivent accompagner la mondialisation. Dans sonessai l’Amérique que nous voulons (2008), Krugman argumente enfaveur de l’instauration d’une sécurité sociale pour tous.Enfin, on retiendra que dès 2005, Krugman a prévenu du risqued’éclatement de la bulle immobilière aux Etats-Unis (voir sachronique du New York Times, le 08/10/05). La crise des crédits «subprimes » (crédits hypothécaires risqués) en 2007 – qui aprécipité la crise financière actuelle – a validé ses prédictions.
John Hicks
Economiste britannique, John Hicks (1904-1989)a reçu le prix Nobel d’Economie en 1972 pour sacontribution à l’équilibre général et à
l’économie du bien-être.C’est à son fameux modèle IS-LM modélisantla Théorie générale (1936) de Keynes qu’il doit son aura planétaire.
Le modèle IS-LM
Le modèle IS-LM développé par Hicks peut être considéré comme uneinterprétation formalisée de la Théorie générale de Keynes. Pourrappel, ce dernier considère la demande comme le principal facteurdéterminant le niveau de production et celui de l’emploi.Le modèle IS-LM permet une représentation graphique d’une économie àl’équilibre.
Le graphique, ci-dessus, met en relation le niveau de produitintérieur brut (PIB) avec le taux d’intérêt.
La courbe IS décrit lescombinaisons de taux d’intérêtet de revenu national quiéquilibrent le marché des bienset services. Elle estdécroissante car une hausse dutaux d’intérêt réduit lademande globale (en freinantl’investissement et laconsommation) et, ainsi, lePIB.La courbe LM décrit lescombinaisons de taux d’intérêtet de revenu national quiéquilibrent le marché de lamonnaie. Elle est croissantecar une augmentation du PIB pousse à la hausse la demande demonnaie (pour réaliser des transactions supplémentaires). Commel’offre de monnaie est constante (son niveau est déterminé parla banque centrale), le prix de la monnaie va augmenter.Autrement-dit, le taux d’intérêt augmente.
Dans ce modèle, les prix sont fixes et il n’y pas de commerceinternational (on dit que l’on raisonne en économie fermée).Lorsque l’équilibre est atteint sur ces deux marchés (au pointd’intersection entre les courbes IS et LM), l’économie est stable.Cette situation correspond à une situation d’équilibre général.Toutefois, elle n’est pas synonyme de plein-emploi. En effet, leniveau d’investissement découlant du taux d’intérêt d’équilibren’est pas forcément suffisant.Hicks propose ainsi un modèle qui pose la question de l’interventionpublique : quelles politiques économiques pour le plein-emploi ? Sestravaux se concentrent en particulier sur le rôle des politiques
monétaire et budgétaire. Ces politiques ont un impact qui peut êtrereflété par le déplacement des courbes IS et LM.Pour beaucoup, le modèle IS-LM est considéré comme la base de lamacroéconomie.
Economie du bien-être
C’est pour sa contribution à l’économie du bien-être que Hicks areçu le Prix Nobel d’Economie, en 1972, conjointement avec KennethArrow. Dans son ouvrage le plus connu, Valeur et capital (1939), iloffre notamment une reformulation de la théorie du comportement duconsommateur.
Arthur Pigou
Arthur Pigou (1877-1959) est un économisteanglais. Il est le fondateur de l’économie dubien-être et l’un des premiers auteurs à avoirréfléchi à l’économie environnementale. Il estconnu par ailleurs pour avoir donné son nom àla fameuse « taxe Pigou ».
L’économie du bien-être et les externalités(1946)
Pigou est le père de l’économie du bien-être.Ce champ de l’économie étudie les conditions
dans lesquelles on peut assurer le maximum de satisfaction auxindividus qui composent la société.En étudiant un certain nombre de situations non optimales(situations dans lesquelles on peut améliorer le bien-être d’unindividu sans détériorer celui d’un autre individu), Pigou met enavant le rôle déterminant des externalités.Il est question d’externalités lorsque l’acte de consommation (ou deproduction) d’un agent influe positivement ou négativement sur lasituation d’un autre agent, sans que cette relation fasse l’objetd’une compensation monétaire. Il peut alors s’agir d’externalitésnégatives (exemple : la pollution causée par une usine rejetant sesdéchets dans une rivière, qui va affecter la situation des pêcheurs)ou d’externalités positives (exemple : si mon voisin est un bon
jardinier et que j’aime les fleurs, à chaque fois que je passeraidevant sa maison, je serai plus heureux).Le point commun des externalités est qu’elles ne sont pas prises encompte par le marché. Ainsi, en présence d’externalités, si chacunpoursuit son seul intérêt, on obtiendra une situation sous-optimale : l’usine polluera trop et mon voisin ne mettra pas assezen valeur son jardin.
La taxe Pigou (ou taxe pigouvienne)
Alors qu’il réfléchit à un moyen de réduire la pollution à Londres,Pigou développe un mécanisme permettant d’intégrer les externalitésau coût des activités.Le principal effet des externalités est que le coût privé diffère ducoût pour la société. Par exemple, quand une usine pollue, son coût(dit privé) est plus faible que le coût social, puisqu’ellen’intègre pas la pollution qu’elle génère dans ses coûts. Raisonnantuniquement sur le coût privé (qui est faible), elle va produire plusque si elle prenait en compte le coût social (qui intègre le coût detraitement des déchets). L’externalité négative va donc engendrerune surproduction.Pigou propose de mettre en place une taxe du montant del’externalité, afin que le coût social soit le coût effectif pour lafirme. La mise en place d’une telle taxe devrait ainsi réduire leseffets négatifs.A titre d’exemple, un raisonnement du même type a été appliqué dansle cadre de la taxe carbone : en taxant les pollueurs, on s’attend àce que ces derniers réduisent leur pollution
Friedrich List
Friedrich List (1789 – 1846) est un économisteallemand. Sa notoriété dans le domaine dessciences économiques est due à sa théorie surles nations, mais surtout au concept de «protectionnisme éducateur ».Friedrich List fait partie de ces économistesdont l’économie n’était pas l’activité
principale. Tour à tour greffier, politicien, journaliste,ambassadeur, List vécut en Allemagne, en Angleterre, aux Etats-Unis,en France… Son apport à la théorie économique est considérable, dansla mesure où il a su tirer parti de l’ensemble de ses expériences.
L’économie des nations
Les auteurs classiques (Smith, Ricardo) considéraient qu’une nationse comporte comme un individu qui cherche à maximiser ses richesses.List, à l’inverse, pense que la puissance d’une nation dépend de sacapacité à développer des « forces productives » qui lui permettrontde créer de la richesse à l’avenir. Il met ainsi en avant unensemble d’activités jusque-là négligées (puisque ne produisant pasde richesses à court terme) telles que la recherche, l’éducation,les infrastructures de transports, l’administration,…
Les étapes du développement des nations
Selon List, les nations se développent en respectant quatre grandesétapes. Dans un premier temps, l’agriculture est le cœur del’économie, et les produits industriels sont importés. Par la suite,l’industrie commence à se développer mais ne répond quepartiellement à la demande nationale, il faut donc continuerd’importer. La troisième étape est celle de l’autosuffisance : lepays peut répondre à l’ensemble des besoins de ses consommateurs etn’a plus besoin d’importer. Enfin, la dernière étape est celle del’exportation : l’industrie nationale produit suffisamment pourrépondre à la demande intérieure, mais aussi pour exporter.
Le protectionnisme éducateur
Si List est connu pour avoir milité en faveur de la suppression desbarrières douanières au sein de l’Allemagne (le « Zollverein »), ilest pour autant un défenseur du protectionnisme raisonné. Ildéveloppe ainsi le concept de protectionnisme éducateur. Selon lui,un pays qui n’a pas atteint le dernier stade de son développementsera perdant s’il s’ouvre au commerce international car sonindustrie sera trop faible. Les importations auront pour effet dedécourager le développement de l’industrie nationale. Ce pays doitdonc adopter une politique protectionniste, le temps que sesindustries se renforcent et puissent être compétitives sur le planinternational.
Wassily Leontief
Wassily Leontief (1905-1999) est un économisteaméricain d’origine russe. Il a reçu le prixNobel en 1973 pour ses travaux sur les tableauxentrée-sortie.Wassily Leontief débute ses études en URSS avantde s’exiler en raison de son opposition aucommunisme. Après avoir obtenu un doctorat enéconomie à l’université de Berlin, Leontiefémigre aux Etats-Unis en 1931 où il seraprofesseur à Harvard et à l’université de New-York.
Les tableaux d’entrée-sortie (1941)
Wassily Leontief a repris la démarche de François Quesnay et de son« tableau économique » pour construire des « tableaux d’entrée-sortie » (input-output, en Anglais). Ces tableaux permettent devisualiser puis d’analyser les relations entre les industries d’uneéconomie. Ainsi, ils établissent un lien entre les facteurs deproduction (travail, capital…), les produits intermédiaires échangéspar les industries et les produits finis.Prenons l’exemple d’un Etat qui voudrait doubler le nombre debâtiment construits chaque année. Le béton est utilisé comme un «input » dans l’industrie du bâtiment. Or, pour se développer,l’industrie du béton a elle-même besoin de construire des bâtiments.Pour que la production de bâtiment puisse doubler, il faut donc quela production de béton fasse plus que doubler. Le tableau d’entrée-sortie permet dans ce cas de déterminer les besoinsd’investissements pour réaliser l’objectif qui a été défini.Les informations fournies par les tableaux d’entrée-sortie sontparticulièrement utiles pour la planification économique. A la suitedes travaux de Leontief, les instituts statistiques ont commencé àcompléter leurs publications sur la comptabilité nationale par destableaux d’entrée-sortie.
Le paradoxe de Leontief
Wassily Leontief s’est servi des tableaux d’entrée-sortie pourétudier le commerce international. Le modèle HOS, qui était alors la
référence, prédit que les pays qui possèdent un facteur deproduction en quantité (par exemple le travail pour la Chine ou lecapital pour les Etats-Unis) devraient exporter les produits quinécessitent l’usage de ce facteur. Le paradoxe est apparu lorsqueLeontief a confronté cette théorie aux données de la comptabiliténationale américaine. Il a remarqué que les Etats-Unis exportentprincipalement des biens intensifs en travail, alors que la théorieprédit le contraire.Le paradoxe de Leontief a été résolu grâce à un modèle néo-technologique. En effet, les Etats-Unis exportent des biens quinécessitent une technologie avancée, et donc du travail qualifié. End’autres termes, ils exportent des biens qui nécessitent un certaintype de travail plutôt qu’un autre. Or, les Etats-Unis disposentd’une main-d’oeuvre plus qualifiée que la plupart de leurspartenaires commerciaux. Il est donc logique qu’ils exportent lesproduits de ce facteur de production.Les tableaux d’entrée-sortie sont constamment réalisés pour suivrel’évolution des économies. En France, c’est l’INSEE qui réalisechaque année ces tableaux. En appliquant l’outil qu’il a mis aupoint à l’étude du commerce international, Wassily Leontief a mis enévidence les faiblesses du modèle HOS et ouvert la voie à denouvelles théories du commerce international : le modèle néo-factoriel et le modèle néo-technologique.
Robert Lucas
Né en 1937, Robert Lucas a reçu le prix Nobelen 1995 pour ses travaux sur les anticipationsrationnelles. Principal représentant de l’écoledes nouveaux classiques, il estparticulièrement critique à l’égard de touteintervention de l’Etat.Influencé par les travaux de Samuelson et deFriedman, Lucas enseigne d’abord au CarnegieInstitute of Technology, où il travaille surles décisions d’investissement des entreprises.En 1974, il entre à l’Ecole de Chicago et
devient l’un des principaux opposants aux théories keynésiennes.Bien qu’elles soient dominantes à l’époque, Lucas les juge troprigides, et inefficaces à long terme.
La théorie des anticipations rationnelles
Introduite par John Muth en 1961, cette théorie pose pour principela capacité des agents à anticiper les conséquences des politiqueséconomiques initiées par les Etats.Un premier développement, la théorie des anticipations adaptativesde Friedman, supposait une adaptation progressive des agents, enfonction de la variation des prix et des salaires.Lucas est allé plus loin en affirmant que les agents ajustaientimmédiatement leurs comportements aux politiques économiques, enanticipant leur impact sur les variations de monnaie et de prix.Cette hypothèse a conduit Lucas à une critique des modèleséconométriques. Le biais introduit par les anticipations des agentssur les effets des politiques économiques adoptées, rend en effetvaine toute tentative de mesure. C’est ce qu’on appelle la «critique de Lucas ».
La critique de l’interventionnisme
Au regard de la théorie des anticipations rationnelles, la mise enœuvre de politiques économiques perd de son intérêt : les agentsanticipant instantanément les variations de prix et de salairesliées à une politique économique, les effets de cette dernières’annulent automatiquement.Par exemple, si un gouvernement décide de recourir à une politiquemonétaire expansionniste pour relancer l’économie, les agentsanticiperont l’inflation future en augmentant leur taux d’épargne,ce qui annule l’effet de la relance initiée.Une politique économique peut néanmoins être efficace, à lacondition de contourner ces phénomènes d’anticipation ; elle doitpour cela être acceptée « sans réserves » par les agents. Lucas ad’ailleurs admis la place de l’action publique pour favoriser lacroissance endogène quand, en 1988, il a montré que le capitalhumain était un facteur déterminant du progrès technique.Économiste influent, lauréat du prix Nobel d’économie, Robert Lucasest pourtant peu médiatisé. La critique radicale del’interventionnisme qu’il développe a sans doute contribué, la criseaidant, à le dépopulariser. Sa place particulière au sein de l’Ecoledes nouveaux classiques, aux côtés de Sargent et de Barro, en faitnéanmoins l’un des économistes les plus influents de ces dernièresdécennies.
Vilfredo Pareto
Vilfredo Pareto (1848 – 1923) est un économisteet sociologue italien. Il doit sa notoriété dansle domaine des sciences économiques à sa théoriesur l’Optimum (de Pareto) et à son apport auxstatistiques avec la loi de Pareto.Né en France mais d’origine italienne, VilfredoPareto a entamé des études d’ingénieur à l’EcolePolytechnique de Turin (Italie). Ses études leconduiront néanmoins à s’intéresser plus
particulièrement à l’économie et la sociologie. Grand admirateur deWalras, il lui succède à l’Ecole de Lausanne où il enseigneral’économie politique jusqu’à la fin de sa vie.
L’optimum de Pareto (1896, 1909)
Pareto fait partie des grands théoriciens néoclassiques. Sonapproche originale de la notion d’utilité (c’est-à-dire de lasatisfaction des individus) le pousse à développer une théoriepermettant de trouver une situation qui puisse satisfaire l’ensembledes individus. Il développe ainsi le concept d’optimum de Pareto.Cet optimum est défini comme une situation dans laquelle on ne peutaméliorer la satisfaction d’un individu sans réduire la satisfactiond’une autre personne.Il s’agit donc essentiellement d’un critère d’efficience, puisquedans cette situation, tout le monde maximise sa satisfaction comptetenu de ce que font les autres. Pour autant, si cette situation estoptimale au plan économique, elle ne relève pas forcément d’unesituation juste (ou équitable). Par exemple, si une seule personnepossède toutes les ressources, il s’agit quand même d’un optimum dePareto car cette personne ne voudra rien céder pour améliorer lasatisfaction des autres.
La distribution de Pareto ou « la loi des 80 – 20 »
L’étude sociologique des inégalités de revenus en Italie par Paretol’a amené à un constat : 20% de la population italienne détenait 80%des richesses. Bien plus qu’une observation ponctuelle, il s’agit enfait d’une régularité statistique que l’on observe dans de nombreuxdomaines. Par exemple, en économie, on observe qu’environ 80% desrichesses mondiales sont détenues par 20% de la population.En management, dans les compagnies aériennes, près de 20% despassagers représentent 80% du CA. De même pour les impôts, 80% desrecettes fiscales sont le fait des cotisations de 20% des citoyens
imposables. Cette régularité statistique est par conséquent trèsutile à la prise en compte des différences entre les individus, afind’adapter au mieux la mise en œuvre d’une politique publique oud’une stratégie d’entreprise.
Paul Samuelson
Auteur extrêmement prolifique, Paul AnthonySamuelson fut l’un des plus grands économistesdu XXème siècle. Son œuvre, couronnée en 1970par le prix Nobel, aborde l’ensemble desdomaines de l’économie, de la théorie néo-classique au commerce international qu’ilrévolutionne avec le modèle HOS.
Né en 1915 aux Etats-Unis, Samuelson est diplômé de l’université deChicago avant de poursuivre ses études à Harvard. Avant d’obtenirson doctorat en 1941, Samuelson a déjà écrit ce qui constitue sonouvrage majeur : Les Fondements de l’Analyse Economique. Professeurau MIT (Massachussetts Institute of Technology) depuis le début desa carrière, auteur du manuel d’économie le plus célèbre du monde,Economie, il a également contribué à de nombreux travaux pour lesautorités américaines, que ce soit pour le Département du Trésor, laRéserve Fédérale ou pour le Président J.F. Kennedy. Paul Samuelsons’est éteint le 13 décembre 2009.
Fondateur de la théorie néo-classique contemporaine
Reprenant les travaux de John Hicks, Samuelson décrit à l’aide delois et de formules mathématiques les comportements des agentséconomiques sur les marchés. Ceux-ci cherchent à obtenir le meilleurprix possible, c’est-à-dire celui qui leur permettra de maximiserleur profit (pour un vendeur) ou leur bien-être (pour un acheteur).Pour cela, ils procèdent au « tâtonnement », décrit par Walras.
Samuelson défend alors la possibilité de voir les marchés parvenir àun équilibre général.Ce modèle est toujours la base de la théorie économique tellequ’elle est enseignée. Les hypothèses très fortes sur lesquelles ilrepose – des agents purement rationnels, des marchés concurrentielsparfaits – ont toutefois fait l’objet de nombreuses critiques.D’un point de vue macroéconomique, Samuelson a contribué à réaliserce que l’on appelle « la synthèse néo-classique », mettant en placedes modèles considérés comme fondateurs. Ainsi, le modèle àgénérations imbriquées, développé d’abord avec Maurice Allais (1947)puis avec Peter Diamond (1965), permet de comprendre lesinteractions et les transferts de ressources entre deux générationsqui cohabitent en permanence : les agents « jeunes », quitravaillent, et ceux, à la retraite, qui consomment leur épargne.
Le modèle Hecksher-Ohlin-Samuelson (HOS)
Jusqu’à la publication de l’article fondateur de Samuelson en 1941 ,qui reformule les intuitions d’Eli Heckscher et de Bertil Ohlin, lefonctionnement du commerce international n’était envisagé que sousl’angle de la théorie des avantages comparatifs de Ricardo. Lemodèle HOS, – qui reprend les initiales de ses concepteurs –,explique pourquoi les économies choisissent de se spécialiser :l’explication vient de leur dotation plus ou moins importante encapital et en travail.Considérons par exemple deux pays, qui tous les deux fabriquent deuxbiens, des vêtements et des ordinateurs par exemple. Si le pays Apossède une importante main-d’œuvre à bas coût, il l’utilisera pourse spécialiser dans le textile ; le pays B étant mieux doté encapital et moins en travailleurs, il choisit de fabriquer davantaged’ordinateurs, secteur qui nécessite surtout des investissementsmassifs. Les deux pays exportent alors le bien dans lequel ils sesont spécialisés et importent le deuxième : par le biais de ceséchanges, le prix de ces biens, mais aussi les salaires et les tauxd’intérêt, s’égalisent alors dans les deux pays.Malgré la pertinence de son approche, le modèle HOS s’est à la foisvu infirmé par les faits empiriques (paradoxe de Leontief, quicalcule la proportion en capital et en travail des exportationsaméricaines) et par certaines lacunes théoriques, comme la non-priseen compte de l’existence de coûts fixes pour les producteurs.Samuelson a de plus récemment concédé que tous les pays n’avaientpas forcément intérêt à se spécialiser, contrairement à cequ’affirme le modèle HOS.Se considérant à juste titre comme le « dernier généraliste del’économie », Samuelson a fait avancer presque tous les domaines dela science économique, et son manuel Economie reste une référence.
Aujourd’hui, tous les néoclassiques et tous les néokeynésienss’appuient sur l’une ou l’autre de ses contributions.
John Rawls
John Rawls (1921-2002) est un philosophelibéral américain. Professeur à Harvard, ilpublie en 1971 sa célèbre Théorie de la justicedans laquelle il défend une société basée surune justice redistributive qui réduirait lesinégalités. L’ouvrage connait un succès rapideaux Etats-Unis, où la lutte pour les droitsciviques et la guerre du Vietnam ont soulevédes questions liées à la notion de justice.
La justice comme équité
Chez Rawls, le bien s’entend comme une notion individuelle. Lasociété juste doit dès lors permettre de faire cohabiter différentesvisions du bien. Dans sa Théorie de la justice, Rawls dégage lesprincipes qui régissent une société juste. Il cherche à réconcilierdeux principes qui s’opposent souvent, mais qui sont au cœur del’idéal démocratique : la liberté et l’égalité.Les démocraties libérales ont privilégié le respect des libertés,parfois au détriment de l’égalité, tandis que les régimessocialistes ont restreint les libertés au nom de l’égalité. Rawlsenvisage une solution à ce dilemme : une société juste doits’appuyer sur des principes qui garantissent la liberté et l’équité.Rawls critique la philosophie utilitariste, qui repose sur l’idéeque la société juste est celle qui maximise la somme des utilités deses membres. En d’autres termes, qu’importe la répartition dubonheur, ce qui compte c’est le nombre total d’ « unités de bonheur» dans la société. Rawls critique cette approche : pour lui, lasociété doit s’occuper de maximiser l’utilité des plus désavantagés.
Le « voile d’ignorance » et les deux principes de justice
Pour Rawls, le législateur doit prendre ses décisions sous un «voile d’ignorance ». Autrement dit, le législateur doit occulter sapropre position dans la société et prendre ses décisions comme s’ilpouvait, un jour, occuper une autre position sociale. Ce faisant, lelégislateur fera en sorte d’établir des règles les moinsdéfavorables aux plus désavantagés, étant lui-même conscient depouvoir potentiellement se retrouver dans cette position. Rawlsestime que, sous ce « voile d’ignorance », deux principes de justice
seraient décidés, et doivent donc être garantis par les institutions:Le principe de liberté : chaque citoyen doit avoir accès aux mêmeslibertés, et la liberté de chacun doit être compatible avec laliberté des autres membres de la société.Le principe de différence : certaines différences peuvent êtretolérées dans une société juste, à une double condition :A - Les fonctions qui procurent des avantages doivent êtreaccessibles de la même manière à tous les membres de la société.L’égalité des chances est le socle nécessaire d’une société juste («il doit être indifférent de naître avec telles caractéristiquesplutôt que telles autres »).B - Les inégalités sont justifiées lorsqu’elles permettentd’améliorer la situation des plus désavantagés. Ce principe justifieles aides accordées aux plus pauvres, mais aussi certains écarts desalaires (« une personne talentueuse aura […] droit légitimement auxrevenus plus élevés que lui vaut son talent si la collectivité enprofite aussi »).Rawls introduit dans sa pensée le concept de « biens premiers ». Cesderniers recouvrent les libertés et droits fondamentaux (revenu,richesse, pouvoir, opportunités et bases sociales du respect desoi). Ces « biens premiers » forment les soubassements d’une sociétéjuste, il convient de les mettre à disposition de tous. Amartya Senira plus loin que Rawls en considérant que l’accès aux « bienspremiers » n’est pas suffisant pour garantir la justice d’unesociété. Pour Sen, il faut également se préoccuper d’égaliser lescapacités ("capabilités") des citoyens à profiter de ces biens (lasanté, la réflexion, une longue espérance de vie, etc.).Par ses travaux, Rawls a considérablement contribué à la philosophiepolitique. Sa Théorie de la justice fut traduite dans 23 langues, eta, encore aujourd’hui, une influence considérable, en philosophie,en économie et en science politique.
Kenneth Arrow
Né en 1921, Kenneth Arrow est l’un desfondateurs de l’école néoclassique moderne. Ila acquis une grande notoriété dès 1951 grâce àsa démonstration du théorème d’impossibilité.Economiste majeur de la seconde moitié du XXesiècle, Kenneth Arrow a reçu en 1972 le prixNobel d’économie, et en 2004 la National Medalof Science. Ces distinctions témoignent de
l’importance et de la diversité de ses travaux.
Le théorème d’impossibilité d’Arrow
Publiée dans sa thèse intitulée Social choice and individual values,la démonstration mathématique du théorème d’impossibilité confirmeet généralise le paradoxe de Condorcet, selon lequel il n’est pastoujours possible de hiérarchiser des préférences au sein d’unecollectivité.Arrow étudie les fonctions de choix social, qui désignent lesméthodes qui permettent de passer des préférences individuelles auxpréférences collectives (par exemple les élections). En formalisantles travaux de Condorcet, il montre qu’aucune fonction ne respecteles hypothèses néoclassiques (anonymat, universalité, indépendance,pas de dictateur etc.).Par exemple, à partir de trois propositions A, B et C (par exempletrois candidats à une élection ou trois décisions budgétaires),telles que A est préféré à B pour certains, B à C pour d’autres, etC à A pour un dernier groupe, l’opération de transitivité des choixconduit à une équation du type A > B > C > A.Les décisions politiques ou économiques, prises au niveau collectif,découlent alors nécessairement d’un arbitrage imparfait. Ce résultatconduit à séparer l’aspect démocratique d’un Etat et la légitimitéde ses décisions, donc à remettre en cause l’interventionnismeéconomique.
Le précurseur des théories néoclassiques
Plus tard, Arrow fût le premier, avec Debreu, à justifiermathématiquement la théorie de l’équilibre général élaborée parWalras. Sous certaines hypothèses (notamment la rationalité desagents), il a démontré qu’il existait toujours au moins un équilibregénéral concurrentiel (avec égalisation de l’offre et de la demandepar les prix), jetant ainsi les bases des théories néoclassiquesmodernes.Par ailleurs, il est l’inventeur du « learning by doing »(apprentissage par la pratique). Ce concept économique permetd’expliquer l’amélioration de la productivité des facteurs deproduction dans le temps (par la correction des erreurs, lacoordination entre les agents, …). Cette découverte, reprise plustard par Romer, est à la base des théories sur la croissanceendogène.Enfin, il a également contribué au développement des conceptsd’asymétries d’information, d’aléa moral et de sélection adversepour tenter d’expliquer l’imperfection des marchés.Avec la démonstration du théorème d’impossibilité, Arrow a mis encause la capacité de l’Etat à répondre aux préférences des citoyens
collectivement, ce qui a permis le développement de la théorie deschoix publics. Mais sa contribution à l’économie ne se limite pas àce théorème : auteur prolifique, il s’est intéressé à quasiment tousles aspects de la théorie néoclassique.
Georges Akerlof
George Akerlof est un économiste américaind’inspiration keynésienne, né en 1940. Sestravaux sur l’analyse des imperfections demarché ont été récompensés par le prix Nobeld’Economie 2001, également attribué à Stiglitzet Spence.Ils montrent que le modèle deconcurrence pure et parfaite (modèle standardde la théorie économique), qui supposenotamment que l’information des agents estelle-même parfaite, est une approximation très
éloignée de la réalité.
Les asymétries d’information
Akerlof a consacré une large partie de sa recherche sur lesimperfections de marché au problème des asymétries d’information.L’asymétrie d’information est chose courante sur les marchés. Elleimplique qu’un des participants à l’échange dispose d’uneinformation « privée », qu’il cache à l’autre partie. A titred’exemple, on peut penser à l’emprunteur qui connaît mieux que sonprêteur sa capacité de remboursement ou au titulaire d’une policed’assurance qui connaît mieux que son assureur ses risquespotentiels…Akerlof, quant à lui, privilégie l’exemple du marché des voituresd’occasion (lemons en anglais), marché sur lequel le vendeur connaîtmieux que l’acheteur la qualité de sa voiture. Publié en 1970, sontravail (paru sous le titre "Le marché des voitures d’occasion :incertitude sur la qualité et mécanisme de marché") est inspiré parle questionnement suivant : pourquoi une voiture à peine utiliséesubit une décote importante sur le marché de l’occasion ? Il montreque pour se prémunir des vices cachés de véhicules de mauvaisequalité, les acheteurs intéressés proposent des prix délibérémentfaibles. Insatisfaits par les prix proposés, les vendeurs devéhicules de bonne qualité quittent le marché, ne laissant alorsdisponibles à la vente que des produits de mauvaise qualité. Un
phénomène de « sélection adverse » (ou « antisélection ») est donc àl’œuvre : les voitures de piètre qualité chassent du marché lesbonnes voitures. L’asymétrie d’information conduit ainsi à unéquilibre inefficace.
La théorie du signal
Une manière pour le vendeur d’échapper au problème de l’asymétried’information est de mettre en place un signal sur la qualité de sonbien (une garantie dans le cas du marché des lemons, par exemple).L’Etat peut également intervenir en imposant des mécanismes decertifications de bon état du véhicule (contrôles techniquesréguliers, par exemple). Les signaux ainsi générés assurent des prixcohérents avec la qualité du produit échangé et restaurel’efficacité à l’équilibre.
L’économie comportementale
Akerlof se distingue également par l’intérêt qu’il porte àl’économie comportementale, qui permet de resituer la scienceéconomique par rapport à d’autres sciences sociales (comme lasociologie ou la psychologie). Ce champ récent de la rechercheéconomique produit des travaux à l’interface entre ces différentesdisciplines, qui font la part belle à l’étude des comportements (parrapport à l’investissement, à la production, au travail, à laconsommation, à l’épargne, etc.).Ces travaux ont sérieusement questionné l’hypothèse de rationalitédes agents dans le modèle standard et ont conduit à l’introductiond’hypothèses beaucoup plus réalistes basées sur l’observation descomportements. Dans son ouvrage Les Esprits animaux, Comment lesforces psychologiques mènent la finance et l’économie, paru en 2009,Akerlof propose d’intégrer les apports de l’économie comportementaledans un cadre théorique keynésien afin de mieux appréhender lefonctionnement de l’économie (instabilité des marchés, problème duchômage, crise, etc.).La théorie des asymétries d’information est l’une des plusimportantes du renouvellement de la pensée économique ces dernièresdécennies. Elle a suscité de nombreux travaux conduisant à laformulation d’une théorie des incitations.
Ancien économiste en chef de la banque Mondiale (1997-2000), ilenseigne actuellement à la Graduate School of Business del’Université de Columbia. En 2001, il reçoit conjointement avecAkerlof et Spence le prix Nobel d’économie en 2001.Chercheur prolifique, Joseph Stiglitz a publié de nombreux travauxdans des domaines aussi variés que l’économie du travail, le marchédu crédit ou encore l’économie industrielle. Il est avec Akerlof etSpence le fondateur de l’économie de l’information, ce qui lui valuson prix Nobel.Contrairement à l’approche économique néo-classique qui considèreque les agents économiques disposent de toute l’informationnécessaire à la prise de décisions, Stiglitz se base sur l’hypothèse– bien plus réaliste – d’information imparfaite. Concrètement, lesagents économiques sont contraints à prendre des décisions ensituation d’incertitude. Dans certains cas, les individus nedisposent pas de la même quantité d’information, - l’un peut ensavoir plus que l’autre - on parle alors d’asymétrie d’information.Les travaux de Stiglitz ont notamment permis une meilleurecompréhension du fonctionnement du marché du crédit.
Marché du créditQuand les mauvais emprunteurs chassent les bons.Prenons l’exemple d’un dirigeant d’entreprise qui sollicite un prêtauprès d’un établissement bancaire. Le banquier doit décider del’octroi du prêt en situation d’asymétrie d’information :contrairement au chef d’entreprise, il ne connaît pas la rentabilitéréelle de l’investissement que celui-ci souhaite réaliser et donc lavéritable capacité à rembourser de son emprunteur.Ainsi, la banque ne pouvant ajuster le taux du crédit à lasolvabilité de chaque débiteur va facturer à un « taux moyen »l’ensemble de sa clientèle.Au final, les emprunteurs de « bonne qualité » s’estimant lésésrefusent le taux de la banque qu’ils jugent trop élevé. Lesdébiteurs douteux en revanche, se précipitent sur ce taux qui leurest favorable. Les mauvais emprunteurs chassent les bons. C’est cequ’on appelle un phénomène d’antisélection ou encore de sélectionadverse.Face à la multiplication des mauvais emprunteurs, les banquescraignant d’accumuler un trop grand nombre de créances douteusestendent à limiter l’octroi de prêts. Après son passage à la Banque Mondiale, qu’il a tout comme le FMIardemment critiquée, Stiglitz s’est intéressé à la question de lagouvernance de l’économie mondiale. Fort de sa notoriété de PrixNobel, il a sans être altermondialiste, vigoureusement dénoncé ledogmatisme libéral des grandes institutions internationales et prône
une meilleure régulation de la mondialisation.Plus récemment, Stiglitz a réfléchi aux conditions d’élaborationd’un indicateur de développement alternatif au Produit intérieurbrut (PIB). La commission qui porte son nom a rendu son rapport enseptembre 2009.
Milton Friedman
Fondateur de l’ « École de Chicago », MiltonFriedman (1912-2006), a été un critiquevirulent de l’interventionnisme étatique et despolitiques économiques keynésiennes. Conseillerdu président Nixon à la fin des années 1960, onlui reproche d’avoir été l’inspirateur enéconomie, avec ses disciples ultralibérauxsurnommés les « Chicago Boys », du dictateurchilien Augusto Pinochet. Il a reçu le prixNobel d’Economie en 1976 pour « ses découvertes
dans le champ de l’analyse de la consommation, de l’histoire et dela théorie monétaire et pour sa démonstration de la complexité despolitiques de stabilisation monétaire. »
La théorie quantitative de la monnaie
Friedman est le père du courant « monétariste » et a notammentréactivé la théorie quantitative de la monnaie. Selon celle ci,c’est l’augmentation de la masse monétaire qui est la cause uniquede la hausse des prix : « L’inflation est toujours et partout unphénomène monétaire en ce sens qu’elle est et qu’elle ne peut êtregénérée que par une augmentation de la quantité de monnaie plusrapide que celle de la production », écrit-il en 1970. Son analyses’inscrit alors dans un contexte de cette époque marquée par uneforte inflation les pays occidentaux. Surtout Friedman permetd’expliquer le phénomène de « stagflation » (croissance faible etinflation forte) auquel sont confrontés les pays occidentaux dansles années 1970, notamment suite aux chocs pétroliers de 1973 et
1979. Il ne suffit pas d’abaisser les taux d’intérêt (ce quiaugmente en retour l’inflation) pour relancer l’investissement et lacroissance. Dès lors Friedman recommande en premier lieu de luttercontre l’inflation, phénomène qu’il juge dangereux et sans aucunbienfait à terme pour le fonctionnement de l’économie, en réduisantla masse monétaire et en augmentant les taux d’intérêt. C’est cettepolitique qui sera menée par Paul Volcker, à la tête de la FED àpartir de 1979 et qui parvient à diminuer l’inflation de 13,5 % (en1981) à 3,2 % en 1983.
La critique de l’interventionnisme public
Concernant la consommation, Milton Friedman a formulé l’ « hypothèsedu revenu permanent » qui postule que les agents économiquesagissent, non pas seulement en fonction de leur revenu disponible,mais en fonction du revenu futur qu’ils anticipent. Celui-ci étantrelativement stable, ce phénomène tend à lisser l’évolution de laconsommation et à la rendre moins sensible, d’une part auxévolutions de la conjoncture, d’autre part aux politiques de relancepréconisées par Keynes. Par ailleurs Friedman que toute interventionpublique conjoncturelle est vouée à être trop tardive, du fait de lalenteur inhérente aux prises de décisions publiques et du caractèreretardé de leurs effets. Dès lors toute politique de relance risqued’alimenter une surchauffe et d’aggraver la crise.
Le taux de chômage naturel
A propos du chômage, Friedman a développé l’idée d’un taux dechômage naturel : l’offre du travail et la demande se rencontrent enun point qui n’est pas toujours atteint car certaines entreprisesmonopolistiques vont profiter de leur position pour proposer dessalaires trop bas, tandis que certains travailleurs exigeront dessalaires trop élevés (par choix personnel en fonction de leursalaire de réserve, du fait des exigences syndicales ou encore àcause d’un salaire minimum fixé par l’Etat). Plus ces phénomènessont marqués, plus le taux de chômage naturel est élevé.Si Milton Friedman est aujourd’hui critiqué comme l’un des apôtresdu « laissez-faire » qui domine les politiques économiquescontemporaines, il est important de rappeler qu’il a développé sesthéories dans un contexte où le keynésianisme était le courant depensée très largement dominant.
L’anglais John Maynard Keynes (1883-1946) estprobablement l’économiste le plus influent duXXe siècle. Keynes est un des penseurs auxquelstout économiste fait inévitablement référence,soit pour interpréter et prolonger sa théorie,soit pour l’infirmer. Si la vie de Keynes estelle-même passionnante – il a joué un rôleessentiel dans la mise en place desinstitutions de Bretton Woods en 1944 (labanque Mondiale et le Fonds Monétaire
International) et s’est plusieurs fois ruiné et enrichi en spéculantà la bourse –, c’est avant tout à la révolution qu’il a opérée dansla théorie économique qu’il doit sa renommée. Ses idées ontnotamment inspiré la politique interventionniste du New Deal, miseen œuvre dans les années 30 par le gouvernement américain, maisaussi la plupart des politiques économiques occidentales jusque dansles années 1970 et au-delà.
La réfutation de la loi de Say et de l’équilibre spontané desmarché
L’ouvrage le plus célèbre de Keynes est sa Théorie générale del’emploi, de l’intérêt et de la monnaie (1936) qui est à l’originede la macroéconomie moderne. Keynes y récuse l’idée alors dominantequ’une économie de marché se régule spontanément pour atteindre leplein emploi de ses ressources. Il réfute alors la loi de Say selonlaquelle l’offre et la demande seraient toujours en équilibreparfait. Keynes souligne à la fois le rôle des incertitudes dansl’économie (les acteurs ne font pas toujours les bons choix, parexemple en surinvestissant ou en sous-investissant dans un secteur)et le fait que la monnaie puisse être détenue pour elle-même(l’individu thésaurise pour se prémunir contre l’avenir et serassurer), ce qui infirme son rôle de « voile » neutre, c’est-à-diresans influence sur le fonctionnement de l’économie, décrit par leséconomistes classiques. Ces éléments font apparaître le risque d’unchômage involontaire, d’une sous-production et de crises économiquesauxquels les pouvoirs publics doivent répondre.
L’intervention des pouvoirs publics
Contrairement à ce qui est parfois énoncé, Keynes ne préconise pasaux pouvoirs publics de mener une politique économique active entoutes circonstances. Il estime notamment que les comptes
budgétaires doivent être équilibrés sur le long terme. En revanche,il soutient l’idée d’une intervention conjoncturelle, pour soutenirla demande et surtout pour stimuler l’investissement (ce quiimplique une baisse des taux d’intérêt). Pour lui l’État, par sonintervention, « est en mesure de rétablir les équilibresfondamentaux ». Il n’est en revanche pas question de porter atteinteà l’autonomie de l’entreprise privée.
La question de l’emploi et des salaires
Keynes insiste sur le fait que les salaires ne constituent pasuniquement un coût de production, mais jouent également un rôleimportant sur la demande. De plus il démontre que les salairesnominaux ne sont pas pleinement flexibles. Les travailleurs refusentle plus souvent une baisse de leur rémunération, qui leur estgarantie par contrat. Il n’est par ailleurs pas souhaitable quecette baisse se produise car elle déprimerait la demande etrisquerait d’enclencher une spirale déflationniste. La seule façond’ajuster les salaires trop élevés est donc de jouer surl’inflation, qui permet d’abaisser les salaires réels. Enfin Keynes,en démontrant qu’une demande trop faible (ou des anticipations troppessimistes) risque d’entraîner une sous-production, atteste qu’ilpeut exister un chômage involontaire issu de ce déséquilibre. Ils’oppose encore en cela aux économistes classiques pour qui lechômage était uniquement volontaire et dû au refus des salariésd’offrir leur travail au prix d’équilibre de celui-ci.
Les prolongements de la pensée de Keynes
Les travaux de Keynes ont influencé la majorité des économistesultérieurs, qui furent nombreux à se réclamer du keynésianisme.Ainsi apparurent le néo-keynésianisme, la nouvelle économiekeynésienne et le post-keynésianisme. Ces courants s’accordent surla nécessité de l’intervention, ponctuelle ou permanente, de l’Etatdans la vie économique, mais diffèrent néanmoins dans leursapproches.
James Tobin
Économiste keynésien, élève de Joseph Schumpeter àHarvard, James Tobin (1918-2002) reçoit le prixNobel en 1981.
Il est connu du grand public pour avoir lancél’idée d’une taxe qui a pris son nom (« Taxe Tobin
» surnommée aussi « Taxe Robin des Bois ») sur les transactionsmonétaires internationales. A l’origine, il s’agissait pour luid’utiliser une arme fiscale en complément de la hausse des tauxd’intérêt afin de réduire la spéculation qui menace la stabilité desrégimes de change fixe. Aujourd’hui le système monétaireinternational est en change flottant : il s’agit moins de luttercontre la spéculation que d’essayer de limiter les évolutionsheurtées pour les monnaies, en limitant la circulation des capitaux.La proposition d’une "taxe Tobin" fait par les altermondialistesoppose sur un taux faible(de 0,05 % à 1 %), les revenus de cettetaxe devant être affectés au développement des pays du tiers-monde.En France le parlement a adopté à la fin des années 90’ une taxeTobin à 0%.
James Tobin a récusé l’utilisation de son patronyme par lesaltermondialistes : « J’apprécie, avait-il expliqué, l’intérêt quel’on porte à mon idée, mais beaucoup de ces éloges ne viennent pasd’où il faut. Je suis économiste et, comme la plupart deséconomistes, je défends le libre-échange (…), on détourne mon nom ».
Conseiller économique de John Fitzgerald Kennedy au début des années60, James Tobin a, notamment, analysé les incidences sur l’économiedes politiques budgétaire et monétaire. Il est à l’origine de laformulation des concepts modernes de la politique économique. Enparticulier on lui doit l’expression de "NAIRU" (Non Acceleratinginflation Rate of Unemployment) qui désigne le taux de chômageminimal dans une société, c’est à dire le taux en dessous duquell’inflation a tendance à s’accroitre systématiquement.
En outre, il a eu le prix Nobel pour ses travaux sur les critèresque doivent adopter les entreprises pour arbitrer entre uninvestissement physique et un investissement financier ("Q" deTobin).
Jean Fourastié
L’économiste Jean Fourastié (1907-1990) est lepère de l’expression "Les Trente Glorieuses",titre de son ouvrage sur la croissanceexceptionnelle de l’après-guerre. Mais il avaitaussi un surprenant don prémonitoire.
Il avait prédit que cette croissance ne pouvaitpas continuer indéfiniment à un rythme proche
de 7%, ce qui aurait signifié un doublement de la richesse nationalepar décennie. Le rattrapage de l’après-guerre avait dopé l’économie,mais le dynamisme économique change en fonction du niveau dedéveloppement. Une fois l’équipement des ménages effectué, on entredans une phase de renouvellement, qui se traduit naturellement parun ralentissement de la consommation.
Aujourd’hui, par exemple, les Français sont équipés à 76 % d’untéléphone portable (source : TNS Sofres pour l’Association Françaisedes Opérateurs Mobiles - Oct. 2007). L’enjeu pour les fabricants estde trouver de nouvelles technologies pour accélérer le remplacementdes mobiles, et pour les opérateurs de proposer des servicess’adossant aux nouvelles fonctionnalités proposées.
Jean Fourastié avait également prévu le risque de chômage demasse, lié à la quête permanente de gains de productivité et à cettesaturation relative des marchés de consommation.Il entrevoyait déjàla nécessité à laquelle nous sommes aujourd’hui confrontés d’adapternos modes de production à l’écologie.
Jean Fourastié a, par ailleurs, démontré que l’évolution dupouvoir d’achat dépend essentiellement des gains de productivité quipermettent de baisser le « prix réel » des biens et des services. Ila établi une norme universelle permettant de mesurer ce prix réeld’un produit : c’est selon ses calculs, « le temps d’équivalent demain d’œuvre qu’il faut pour le fabriquer ». Cela permet deconnaître dans le temps l’évolution du pouvoir d’achat. Ce mode decalcul neutralise les effets de la hausse des prix selon lessecteurs et de la hausse des revenus, qui n’évoluent pas à la mêmevitesse. Il cite comme exemple le prix réel du kilowattheured’électricité qui a considérablement baissé depuis 1925 alors que
pour certains services, comme la coupe de cheveux, où les progrèstechniques ont été quasi-inexistants, le prix réel a augmenté.
Jean Fourastié n’est pas reconnu comme un « grand » économisteau plan international. Mais il a inspiré des générations deresponsables des politiques publiques en France en leur fournissantun appareil conceptuel leur permettant de légitimer l’interventionde l’Etat dans l’économie.
Karl Marx
Karl Marx (1818-1883) est le père de la théoriemarxiste. Sa pensée combine les idéeséconomiques des classiques anglais, notammentde Ricardo, les idées politiques dessocialistes français et les idéesphilosophiques allemandes, notamment celle deFichte et Hegel. Il donne une interprétationpolitique à l’analyse économique de Ricardo
divisant la société en classes sociales.
Les deux principales, le prolétariat et la bourgeoisie ont desintérêts antagonistes. Les ouvriers (le prolétariat) vendent leurforce de travail, seule source de valeur, aux capitalistes (lespropriétaires du capital des entreprises). Mais les travailleurssont exploités car ils sont payés à vil prix, c’est-à-dire à « lavaleur des objets de première nécessité qu’il faut pour produire,développer, conserver et perpétuer la force de travail ». Or par saforce de travail, l’ouvrier crée plus de valeur que ce pour quoielle est payée.
Le capitaliste confisque une « plus-value » au prolétaire.Cette plus-value est donc, au sens marxiste, du travail qui n’a pas
été payé à l’ouvrier. Marx prend l’exemple d’un ouvrier fileur. Pourrenouveler sa force de travail, il a besoin de trois shillings, soitsix heures de travail.Mais pour ce salaire, il travaille 12 heures.Le fileur travaille donc pendant six heures sans être rémunéré pourcela. Quant à l’État, c’est l’instrument de domination d’une classesur l’autre. Mais le capitalisme finira par disparaître au termed’une lutte entre ces classes.
Mis en œuvre dans de nombreux pays, en Europe de l’Est et enChine notamment, le marxisme a systématiquement engendré untotalitarisme politique et s’est soldé par un échec économiquegénéral. Les régimes dits communistes se sont pour la pluparteffondrés ou ont fini par se convertir à l’économie de marché. Ilsont seulement sauvé les apparences en gardant officiellementl’étiquette communiste.
Jean-Baptiste Say
Jean-Baptiste Say est considéré comme leprincipal économiste classique français. Né en1767, Il est connu pour avoir élaboré la « loide Say » (ou « loi des débouchés »). Cette loiest essentielle pour les économistes libérauxet peut se résumer ainsi : toute offre crée sapropre demande. En pratique une entreprise qui
met un bien sur le marché donne l’équivalent de sa valeur à sessalariés sous forme de salaires et à ses propriétaires sous forme dedividendes.
Par ailleurs pour Jean-Baptiste Say la gestion de quantité demonnaie en circulation dans l’économie d’un pays n’a aucun impactsur le niveau de production.On vend un produit, non pas pourrécupérer de la monnaie, mais pour pouvoir en acheter un autre. «Les produits s’échangent contre des produits », la monnaie « n’estqu’un voile », qu’un instrument pour faciliter les échanges, pouréviter le troc.
Cette loi implique un équilibre global entre l’offre et lademande. Il ne peut donc y avoir de surproduction. Il y a seulementdes déséquilibres passagers, des ajustements qui seront corrigés parle jeu naturel des prix. Il considère ainsi qu’une créationmonétaire (l’augmentation du volume de monnaie en circulation)supérieure au strict nécessaire pour permettre les échanges de bienset services ne dope pas l’économie. Bien au contraire, ellen’engendre que de l’inflation.
La doctrine que développera plus tard Keynes prônant la relancede l’économie par l’injection de monnaie sera en totale oppositionavec cette loi des débouchés élaborée par Jean-Baptiste Say.
Friedrich von Hayek
Économiste et philosophe, Friedrich August vonHayek (1899-1992), prix Nobel d’économie en1974, affirme que les crises économiques sontla conséquence de l’excès de crédit résultantdes politiques monétaires trop souventlaxistes. Cela permet aux entreprisesd’emprunter de manière inconsidérée sans tenirsuffisamment compte de la demande réelle desconsommateurs. Ce décalage engendre des haussesde prix pour tenter de compenser desinvestissements non rentables. Une crise
d’ajustement est alors inévitable pour laisser les prix revenir àleur configuration d’équilibre. Contrairement à Keynes, Hayek estimenécessaire d’encourager l’épargne pour réduire l’écart révélé par lacrise entre l’investissement et son financement. L’argent mis ainside coté n’est pas investi de manière inconsidérée.
Il s’oppose aux théoriciens « constructivistes », qui élaborentdes « projets de société » à partir de constructions intellectuellespseudo-scientifiques. Hayek critique ainsi les « socialistes » maiségalement les « conservateurs » qui veulent modeler la sociétéconformément à leur idéaux. Il considère que nul ne peut appréhenderle monde dans sa complexité, notamment les gouvernants. Ladémocratie est un moyen, et non une fin en soi. Couplée àl’étatisme, elle risque de se transformer en totalitarisme carl’appareil d’État contrôle alors tout. Il est l’un des représentantsles plus significatifs de l’école autrichienne.
Frédéric Bastiat
Journaliste, économiste puis homme politiquefrançais, Frédéric Bastiat (1801-1850) estsouvent considéré comme l’un des pionniers dulibéralisme, qu’il qualifie de systèmefournissant « l’harmonie des intérêts ». Il estfarouchement opposé au protectionnisme. Ilaccuse les barrières commerciales d’entretenirdes prix élevés, ce qui a pour conséquence dene pas stimuler l’activité économique et la
concurrence et de brider la progression du pouvoir d’achat. Ilcritique avec virulence toute intervention de l’Etat qu’il considèrecomme étant « la grande fiction à travers laquelle tout le mondes’efforce de vivre aux dépens de tout le monde ». Il estime que larichesse bénéficie à tous, « Le profit de l’un est le profit del’autre ». Aujourd’hui, on qualifierait cet effet de relation «gagnant-gagnant ».
Il est connu pour un mode de raisonnement où il metsystématiquement en parallèle " ce qui se voit" avec "ce qui ne sevoit pas". Concrètement, il rappelle que chaque fois que quelqu’unreçoit, c’est que quelqu’un a donné.Une de ses paraboles les pluscélèbres est celle de la demande fictive qu’il rédige desproducteurs de chandelles qui, pour préserver l’emploi, demandent auroi Louis Philippe de chasser le soleil du territoire national caril leur fait une concurrence déloyale.
Ses théories économiques libérales ont largement inspiré le 1erMinistre britannique Margaret Thatcher (1979-1990) et le présidentaméricain Ronald Reagan (1981-1989), chacun dans leur politique dedésengagement de l’Etat de l’économie. Son libéralismes’accompagnait d’idées très progressistes pour l’époque : ildéfendait le droit syndical permettant un dialogue social pluséquilibré et il a combattu avec ardeur la peine de mort etl’esclavage.
Nicolaï Kondratieff
Nicolaï Kondratieff (1892 - 1938) aobservé l’existence de cycles économiquesd’une durée de 50 à 60 ans. Ces cycles économiques comportent plusieursphases :
Une phase d’expansion pendant 20 à25 ans.
Une brève phase de retournement de
la conjoncture.Une phase de dépression pendant 20 à 25 ans également.
Pendant ces cycles longs, d’autres économistes ont constaté
l’existence de cycles plus courts d’une dizaine d’années appelés «cycles des affaires ». Ils engendrent, par exemple, unralentissement passager de la croissance pendant une phased’expansion, mais ne remettent pas en cause l’existence des cycleslongs.Mais la découverte de Kondratieff est empirique : il aconstaté l’existence de ces cycles en analysant l’évolution des prixde la France, des États-Unis, de la Grande-Bretagne et del’Allemagne de 1770 à 1920.
C’est Joseph Schumpeter qui a mis en avant ses travaux. Il leura donné une interprétation théorique en expliquant ces cycles pardes phases de progrès et d’innovations importantes qui dopentl’économie, suivies par des périodes peu créatives.
David Ricardo
Economiste anglais, David Ricardo publie en1817 "Principes de l’économie politique et del’impôt" et est considéré comme l’un deséconomistes classiques les plus importants. Il
développe une théorie de la valeur : selon lui, le prix d’échanged’un bien n’est pas déterminé par son utilité. A titre d’exemple,l’eau ne coûte pas cher, pourtant on en a besoin tous les jours. Cen’est pas la loi de l’offre et la demande mais « c’est le coût deproduction qui détermine en définitive le prix des marchandises »,c’est-à-dire que c’est le travail qui donne la valeur aux choses.
Qualifié de « libéral pessimiste », il pense aussi qu’alors quela population ne cesse de croître, les rendements de la terre sontdécroissants, c’est-à-dire que chaque nouvelle terre mise en culturepour faire face aux besoins d’une population croissante est moinsfertile que les terres précédemment cultivées.Il arrive un moment oùla terre ne rapportera plus suffisamment pour faire face audéveloppement démographique. On atteint alors ce qu’il appelle"l’état stationnaire".
A long terme ce mécanisme des rendements décroissants estcontre balancé par le progrès technique. Pour toute société, l’enjeuest de gérer cet arbitrage entre progrès technique et rendementsdécroissants.Le bon moyen pour éviter que les rendementsdécroissants ne paralysent l’économie est de spécialiser chaque paysdans le domaine d’activité où il est le plus efficace ; c’est lajustification du libre échange par ce qu’il appelle "les avantagescomparatifs".
Il démontre aussi que tous les pays, sans exception, ont unintérêt à participer au commerce international. Le libre-échangeprofite à chaque pays puisque c’est un jeu à somme positive. Il n’ya pas de perdants mais que des gagnants.Par ailleurs, en termemonétaire Ricardo est un défenseur systématique de l’étalon-or. Sesidées ont été assez systématiquement mises en œuvre par legouvernement britannique dans les années 1850.
Robert Thomas Malthus
Pasteur anglican, Malthus (1766-1834) observeavec inquiétude l’extension de la pauvreté enAngleterre à la fin du XVIIIe siècle. La raison ?
Elle est simple : « la population progresse plus vite que lessubsistances » ce qui engendre un « déséquilibre croissant ». Ilpart d’un constat pour lui évident qui est que les surfacescultivables s’additionnent alors que les bouches à nourrir semultiplient. En langage de son époque, il dit que les subsistancesaugmentent de façon "arithmétique" et les besoins de façon"géométrique". En langage moderne on parle dans le premier casd’évolution "linéaire" et dans le deuxième d’évolution"exponentielle".
La solution ?
Il faut réduire le nombre de naissances. Comment ? Enrespectant « des contraintes morales » : en retardant l’âge dumariage et en observant une chasteté absolue avant la bénédictionnuptiale. Chaque famille doit, par ailleurs, se limiter « au nombred’enfants qu’elle est certaine de pouvoir entretenir ». Et l’État ne
doit surtout pas s’en mêler en octroyant des aides sociales : « Lepeuple doit se considérer comme étant lui-même la cause principalesde ses misères » et « aider les pauvres, c’est multiplier lapauvreté ».Par extension, le « malthusianisme » définit une politique ou uneattitude craintive qui considère que les capacités de développementsont limitées. Concrètement, en cas de déséquilibre entre l’offre etla demande être "malthusien" revient à vouloir réduire la demande etêtre "anti-malthusien" suppose de chercher à remonter l’offre.Malthus est un ardent défenseur du protectionnisme absolu, à savoirla mise en place de tous les dispositifs visant à préserver uneéconomie nationale de la concurrence étrangère.Aujourd’hui la Chine, malgré sa croissance rapide, reste confrontéeà un problème démographique d’envergure avec plus d’1,3 milliardd’habitants. Elle a mis en place une politique très malthusienne decontrôle des naissances.
Adam Smith
Adam Smith, écossais et professeur de «philosophie morale » de son état, est né en1723. Il publie en 1776 Recherche sur lescauses et la nature de la richesse des nations,ouvrage considéré aujourd’hui comme l’acte denaissance de l’analyse économique et dulibéralisme.
La main invisible
Pour lui, seule l’efficacité du marché permet la satisfactiondu plus grand nombre. Bien que moraliste, Adam Smith considère quel’égoïsme de chacun conduit par la satisfaction de son intérêt à unéquilibre. Autrement dit, "la recherche des intérêts particuliersaboutit à l’intérêt général". C’est ce que la postérité a retenusous le nom de "mécanisme de la main invisible", expression célèbrequ’Adam Smith n’utilise pourtant qu’une fois dans son œuvre. L’Etatn’a donc pas à intervenir sur le marché puisque celui-ci se régulenaturellement. Il doit se cantonner à des fonctions ditesrégaliennes (armée, police, justice) pour protéger les citoyens desviolences et des injustices.
Smith distingue le « prix naturel d’une marchandise » qui estégal à la somme de « ce qu’il faut pour payer (…) les salaires dutravail, le fermage de la terre, et les profits du capital utilisé »et le prix de marché, déterminé par la loi de l’offre et la demande.La « main invisible » permet donc d’atteindre une situationd’équilibre entre le prix de marché et le prix naturel. S’il esttrop élevé, cela veut dire que les ouvriers, les capitalistes (quiinvestissent dans les manufactures ou les établissements financiers)et les propriétaires fonciers gagnent trop d’argent. S’il est tropfaible, il ne rémunère pas suffisamment le capital et le travail.
De même, dans les échanges internationaux, Smith conseille « dene jamais essayer de faire chez soi la chose qui coûtera moins àacheter qu’à faire ». C’est la théorie de l’avantage absolu.Certains pays ont des avantages que d’autres non pas et donc « tantque l’un des pays aura ces avantages et qu’ils manqueront à l’autre,il sera toujours plus avantageux pour celui-ci d’acheter au premier,que de le fabriquer lui-même ».
Finalement, la notion de « main invisible » reposefondamentalement sur le principe d’un équilibre naturel résultant dujeu de tous les acteurs de l’économie en présence et de laconfrontation de leurs intérêts, sans qu’aucune interventionrégulatrice ne soit nécessaire.
Joseph Schumpeter
Joseph Schumpeter naît en 1883, la même annéeque Keynes et l’année de mort de Marx. Comme eux,il aura jusqu’à sa mort en 1950 une réputationd’économiste « hérétique », qui bouscule lapensée économique établie. Professeur à Harvard àpartir des années 1930, il formera leséconomistes les plus brillants de l’après guerre.
Ce qui l’intéresse par-dessus tout, c’est l’évolution dusystème capitaliste : « il constitue, de par sa nature, un type ouune méthode de transformation économique, et non seulement il n’estjamais stationnaire mais il ne pourra jamais le devenir » écrit-ilen 1942. Le moteur du système, c’est l’innovation et le progrèstechnique à travers le phénomène de « destruction créatrice ».
Les 5 formes d'innovations
Joseph Schumpeter distingue à ce titre 5 formes d’innovations :l'innovation de produits ;l'innovation de procédés ;l'innovation de modes de production ;l'innovation de débouchés ;l'innovation de matières premières.
C’est grâce à un « entrepreneur innovateur » que la dynamiqueéconomique se fait sentir à travers des progrès aussi bienquantitatifs (avec l’augmentation du niveau de production) quequalitatifs. L’entrepreneur est donc l’acteur fondamental de lacroissance économique. Il aime le risque et est à la recherche duprofit maximal. L’innovation lui permettra d’obtenir un monopoletemporaire sur le marché. Il sera donc le seul pendant un certaintemps à pouvoir produire cet objet qui lui rapportera donc gros.
Aussi, Schumpeter explique que l’économie est gouvernée par unphénomène particulier : la « destruction créatrice ». C’est « la
donnée fondamentale du capitalisme et toute entreprise doit, bon grémal gré, s’y adapter ». La croissance est un processus permanent decréation, de destruction et de restructuration des activitéséconomiques. En effet, « le nouveau ne sort pas de l’ancien, mais àcôté de l’ancien, lui fait concurrence jusqu’à le nuire ». Ceprocessus de destruction créatrice est à l’origine des fluctuationséconomiques sous forme de cycles.
Ainsi, les formats de fichier audio numérique (ex. mp3) sont enpasse de remplacer les supports physiques de lecture (ex. CD), ils’agit d’un phénomène de destruction créatrice. Ce phénomènes’inscrit dans la montée en puissance de l’économie numérique quisera à l’origine d’une nouvelle période de croissance.
Jean-Baptiste Colbert
Contrôleur général des finances de Louis XIV,autrement dit ministre des Finances, Jean-Baptiste Colbert avait une idée fixe : remplirles caisses du Royaume.
Sa recette ?
L’intervention sans complexe de l’État dansl’économie. L’État se doit d’impulser, stimuler, prévoir, organiser.Pour favoriser le développement économique du pays, il crée ou sefait le promoteur des « manufactures royales ». Celles-cibénéficient d’un « privilège royal » leur assurant un quasi-monopoledans leur secteur pendant un certain temps. Quant au roi, il ytrouve son compte : elles fournissent les matériaux et objets dedécoration dont il a besoin pour Versailles… Les verreries de Saint-Gobain fabriquent les miroirs de la Galerie des glaces, lamanufacture des Gobelins, les tapisseries. De même, des manufacturesvoient le jour pour l’équipement des armées (chantiers navals,fabriques de poudre à canon…).
Colbert ne veut cependant pas substituer définitivement lapuissance publique aux entrepreneurs. L’intervention de l’Étatcolbertien n’est que temporaire. Cette impulsion, destinée àstimuler l’économie, doit être relayée par des capitaux privés, car
l’État n’a pas vocation à rester éternellement actionnaire.
Les adeptes de l’intervention de l’Etat dans l’économie se sontsouvent inspirés de la doctrine interventionniste de Colbert. C’estle cas de la planification d’après-guerre en France. Mais, cetteplanification reste indicative et non pas contraignante. Parailleurs, l’important service public industriel qui se constitue àla Libération est plus le fruit de décisions strictement politiquesque d’un calcul économique : ainsi Charbonnages de France est créépour sanctionner l’attitude pendant la guerre des compagniesminières. Néanmoins cette entreprise devient avec la nouvelle EDF lefer de lance de la politique énergétique Française ; le Plan Calcul(1967) avec la création de la CII (Compagnie internationale pourl’informatique) pour tenter de préserver l’indépendance française enmatière d’informatique ; la création en 1961 du CNES (Centrenational d’études spatiales) pour engager la France dans la conquêtede l’espace.
Amartya Sen
Né en 1933, Amartya Sen est un économiste etphilosophe indien. Spécialiste desproblématiques de la pauvreté et dudéveloppement, il a reçu le prix Nobeld’Economie 1998 pour « sa contribution àl’économie du bien-être ». Il enseigneactuellement à Harvard.
La théorie du choix social
Dès la fin des années 1960, les principales publications de Senont porté sur la théorie du choix social, prolongeant les travaux deKenneth Arrow qui a prouvé que les procédures de choix collectifs(comme le vote ou le marché) ne peuvent satisfaire les critères dedémocratie (théorème d’impossibilité d’Arrow). Autrement dit,l’intérêt général ne peut être défini à partir de la simpleagrégation des préférences des individus : la décision au niveaucollectif doit être imposée !Sen s’est efforcé de montrer que leproblème posé par le théorème d’impossibilité réside dans le cadred’analyse utilisé par Arrow. Ce cadre est extrêmement étroit : laseule information mobilisée pour prendre une décision au niveaucollectif est le classement individuel des différentes optionsproposées. Sen promeut une théorie du choix social qui prenne enconsidération des éléments autres que la seule utilité des individuset permette la prise en compte des enjeux de justice sociale et deredistribution.
La théorie des « capabilités »
Pour Sen, les inégalités entre les individus ne s’apprécientpas au regard de leurs seules dotations en ressources mais de leurscapacités à les convertir en libertés réelles. Il introduit ainsi lanotion de « capabilités », qui invite à considérer la pauvreté au-delà des seuls aspects monétaires et à la penser en termes delibertés d’action, de capacités à faire.Dans son ouvrage Un nouveaumodèle économique. Développement, Justice, Liberté (2000), Sensoutient la thèse selon laquelle il n’y a de développement que paret pour la liberté. La tyrannie, l’absence d’opportunitéséconomiques, l’inexistence des services publics, l’intolérance sontautant d’entraves à la liberté. Le marché est nécessaire : sonabsence serait le déni d’une liberté fondamentale, l’échange debiens.Sa théorie a toutefois fait l’objet de critiques, notammentcar elle ne propose aucune liste des « capabilités » de base.
L’indice de développement humain (IDH)
Son influence en économie du développement s’est traduite parla création de l’IDH par le PNUD (Programme des Nations Unies pourle Développement) en 1990, qui permet d’effectuer des comparaisonsinternationales en termes de développement.Cet indice combine trois« capabilités » considérées comme essentielles : la santé,l’éducation et les ressources monétaires. Chaque dimension estévaluée via le recours à un indicateur élémentaire : l’espérance devie (pour la santé), les taux de scolarisation et d’alphabétisation(pour l’éducation) et le revenu par tête en parité de pouvoir
d’achat (c’est-à-dire en faisant en sorte que l’unité de monnaie aitle même pouvoir d’achat dans les pays comparés). L’IDH est leproduit de la combinaison de ces indicateurs.
D’après le classement IDH établi par le PNUD en 2009, laNorvège arrivait en tête en termes de développement humain. LaFrance se plaçait au 8ème rang mondial, les Etats-Unis étantderrière, au 13ème rang. Le Niger occupait le dernier rang.
Pauvreté et famines
Enfin, Sen a apporté une contribution pionnière à l’étude desfamines, ayant trouvé, par la suite, un écho favorable auprès desgouvernements dans les modes de prévention et de lutte contre lesfamines.En 1943, alors âgé d’une dizaine d’années, il est témoin de lafamine du Bengale au cours de laquelle plus de trois millions depersonnes sont décédées. Observateurs et décideurs ont mis en avantla baisse de la production alimentaire pour expliquer ce drame. DansPauvreté et Famines (1982), où il traite des famines en Inde, auBangladesh et dans des pays d’Afrique subsaharienne, Sen a montréque les situations de famine ne s’expliquent pas forcément par dessituations de pénurie alimentaire, mais par de mauvais choixpolitiques.Son analyse met en évidence les inégalités engendrées parles mécanismes de distribution et les « droits d’accès » à lanourriture. Pour les réduire, il faut commencer par encourager lecontrôle démocratique des gouvernements, car, comme il aime à lerappeler, les démocraties ne connaissent pas de famines.
Conclusion
Amartya Sen est un des rares économistes à appréhender sadiscipline avec à la fois le formalisme mathématique et le reculphilosophique. Auteur très prolifique, il a bouleversé le champ dudéveloppement en enrichissant les critères de définition de lapauvreté habituellement retenus par les institutions internationalesopérant dans ce domaine.