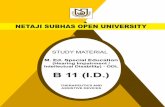Le patrimoine des grands fermiers in Les Fermiers de l’Île-de-France. L'Ascension d'un patronat...
Transcript of Le patrimoine des grands fermiers in Les Fermiers de l’Île-de-France. L'Ascension d'un patronat...
CHAPITRE XIV
Le patrimoine foncier :
un atout pour l'exploitant ?
« Il est en Brie infinité de riches laboureurs plus aisés et plus pécunieux que beaucoup de seigneurs et gentilshommes1. »
À l'époque moderne, l'historiographie rurale insiste invariablement sur l'expropriation paysanne qui a accompagné l'« invasion » du capital urbain. Dans les campagnes proches des grandes villes, soumises au partage égalitaire qui morcelait les successions et au crédit hypothécaire extérieur qui exposait la terre aux convoitises bourgeoises, la menace n'était pas mince. Quand se mirent en place les dynasties de fermiers, entre 1450 et 1550, le maintien dans les grandes exploitations avait bien entraîné quelques aliénations de patrimoine2. Pour le siècle qui court des guerres de Religion à la Fronde, la plupart des travaux portant sur le Bassin parisien soulignent, à cet égard, une longue « crise » rurale : dans les transferts entre groupes sociaux, la paysannerie, victime de la concentration bourgeoise, est alors toujours perdante3. Chez des marchands-laboureurs dont l'activité principale se situait dans le cadre du fermage, la possession du sol ne tenait pas une place centrale. Le rapport à la terre y était conçu comme infiniment plus lâche et plus mobile que pour les sociétés paysannes dans lesquelles l'exploitation 1Charles ESTIENNE et Jean LIÉBAUT, L'agriculture et maison rustique, éd. 1646, p 531. 2Supra, chap. II, p. 174-175. 3Marc VENARD, Bourgeois et Paysans au XVIIe siècle..., 1957, p. 39-49 ; Jean-Marie CONSTANT, « La propriété et le problème de la constitution des fermes sur les censives de Beauce aux XVIe et XVIIe siècles », RH, 1973, p. 373-376 ; Jean JACQUART, La crise rurale..., 1974, p. 629 et 740.
LES FERMIERS DE L'ÎLE-DE-FRANCE 614
familiale reposait sur la transmission inégalitaire4. À l'extrême, dégagés de toute attache foncière, les fermiers du Bassin parisien avaient toute liberté pour « promener partout leur capital d'exploitation à la recherche de la ferme la plus avantageuse »5. Pourtant, la mobilité géographique n'était pas si indifférente à l'espace local : d'un bail à l'autre, les dynasties agricoles cherchaient à se pérenniser dans un « pays » bien défini. Pour un groupe social aussi « territorialisé » que les grands fermiers, l'assise terrienne n'était pas sans valeur6. Mettre en avant l'exploitation agricole ne doit donc pas conduire à sous-estimer les patrimoines. Il convient d'échapper enfin à une vision linéaire de l'évolution des structures foncières, dans laquelle l'« offensive » bourgeoise est considérée comme une constante même si on lui accorde une intensité variable selon les époques. Or, malgré la parenthèse créée par les quelques années de la Ligue, assez vite fermée grâce à la collaboration des propriétaires, la hausse des prix agricoles et la modération relative du fisc assurèrent, jusqu'aux années 1640, une situation favorable aux exploitants. Loin d'être contraints de sacrifier leur patrimoine pour sauver l'exploitation, les marchands-laboureurs se lancèrent dans une véritable conquête foncière dont l'échelle est sans commune mesure avec le cadre des censives où l'analyse s'était d'abord cantonnée. Il y a là un comportement original qui souligne que les préoccupations des fermiers ne se réduisaient pas au seul capital agricole. Le foncier a pris une place de plus en plus diversifiée dans les stratégies d'exploitation et le système familial. C'est donc à une réévaluation qu'on voudrait procéder ici. I. L'IMPORTANCE DE L'ASSISE TERRIENNE Avant la mise en place des bureaux de l'Enregistrement, qui dotent le chercheur d'instruments d'analyse à une tout autre échelle7, l'étude des structures foncières s'effectue avant tout dans un cadre local. Entre XIVe et
4Bernard DEROUET, « Pratiques successorales et rapport à la terre : les sociétés paysannes d'Ancien Régime », Annales ESC, 1989, p. 173-206. 5Marc VENARD, op. cit., p. 112. 6Jean-Louis GUIGOU, « Le sol et l'espace : des énigmes pour les économistes », L'espace géographique, 1, 1980, p. 28. 7Pour le XVIIIe siècle, l'exploitation des ressources du centième denier autorise une étude très riche du marché, cf. Gérard BÉAUR, Le marché foncier à la veille de la Révolution. Les mouvements de propriété beaucerons dans les régions de Maintenon et de Janville de 1761 à 1790, 1984. Mais le contrôle des actes — qui comprend aussi les opérations strictement familiales comme les donations et les successions — ne paraît pas avoir suscité encore le même intérêt.
LE PATRIMOINE FONCIER 615
XVIIe siècles, les documents seigneuriaux — terriers ou censiers en particulier — ont longtemps fourni le pain quotidien de l'histoire agraire. Focalisées sur un seul village — quand les limites ne les resserraient pas davantage encore — combien d'études sous-estiment l'importance des patrimoines, dans des proportions variables selon le type de propriétaires ? Dès qu'on dépasse la taille de la simple tenure, un changement d'échelle s'impose. Or, au moins pour les catégories dominantes, l'utilisation sérielle des partages de succession permet d'établir de réels bilans. Eux seuls, rassemblant des éléments souvent dispersés géographiquement, autorisent une vue d'ensemble qui échappe à la vision déformante des terriers. Assez fiable pour les catégories rurales enracinées sur place — comme les vignerons — ou dépourvues de grands moyens d'investissement— artisans, journaliers, petits laboureurs — l'analyse classique de la propriété foncière à l'intérieur des bornes de la censive perd beaucoup de signification dès qu'on s'attache aux élites villageoises, marchands ou fermiers, dont la mobilité et le champ d'action dépassaient l'échelle locale. Pour cette aristocratie rurale, la seigneurie et même la paroisse étaient loin de circonscrire les opérations foncières. Il arrivait même que le lieu de résidence n'ait aucun rapport avec la situation des biens patrimoniaux et des nouvelles acquisitions. Venus de villages voisins — pas toujours limitrophes —, héritiers de parents partis ou restés à l'extérieur du terroir d'exploitation, habitués à raisonner sur un espace régional qu'ils connaissaient si bien et dans lequel agissait leur réseau de relations, les coqs de village regardaient au delà de leur clocher. Presque toutes les successions en administrent la preuve. Et il apparaît même qu'au cours du siècle qui nous occupe, le gonflement de l'assise foncière est allé de pair avec un élargissement de l'aire des interventions. 1. Un capital qui double À partir des lots établis pour régler chaque succession, on a donc reconstitué les patrimoines rassemblés par les fermiers du nord de la capitale jusqu'au milieu du XVIIe siècle. En dépit d'une légère sous-estimation liée aux caractéristiques juridiques du partage — qui comprend d'abord les biens de la communauté et n'intègre pas toujours la totalité des propres — l'accumulation foncière est générale. De 1568 à 1654, des 30 successions qu'il a été possible de prendre en compte ici, aucune n'était
LES FERMIERS DE L'ÎLE-DE-FRANCE 616
dépourvue de biens au soleil8. Même dans les cas les moins favorables, les héritiers avaient à se partager une bonne dizaine d'arpents de terre labourable et une maison d'exploitation, qui comportait logis, grange, étables, cour et jardin. Mais très souvent, il y en avait bien davantage : dans notre échantillon, plus de la moitié des patrimoines se classent entre 10 et 30 ha et les trois quarts égalent ou dépassent la quinzaine d'hectares (figures 14-15).
Figure 14. La concentration patrimoniale (1570-1654)
0
2 0
4 0
6 0
8 0
100
120
140
160
180
1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650
Surfaces (en ha)
8On ne peut saisir les patrimoines que dans deux moments essentiels : celui de la liquidation de communauté, au cours duquel le notaire inventoriait l'ensemble des biens acquis depuis le mariage et rappelait les propres du conjoint disparu ; celui du partage définitif, qui tenait compte des propres du parent survivant. Dans la pratique, les deux étapes se confondaient parfois quand les enfants laissaient au veuf la jouissance de leurs parts de succession, conformément aux stipulations prises dans leurs contrats de mariage. D'autre part, par le biais du douaire, il est parfois possible de reconstituer l'importance des biens de communauté. Au XVIIIe siècle, les partages de succession, retardés au second décès, offriront toutes les garanties nécessaires. Antérieurement, une marge d'incertitude subsiste, qu'une analyse détaillée confrontant les actes complémentaires permet de dissiper dans un certain nombre de cas. En accordant une grande place aux rachats familiaux, ces derniers réintégraient une partie des propres de la génération antérieure. Pour notre analyse, les successions considérées ont été examinées de la manière la plus exhaustive possible. On trouvera toutes les précisions souhaitables dans l'annexe, tableau 130.
LE PATRIMOINE FONCIER 617
Figure 15. L'extension des superficies (1568-1654)
0
1
2
3
4
5
0 - 2,5 ha 2,5 - 5 5 - 7,5 7,5 - 10 10-15 ha 15 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 100 + 100 ha
Nb de cas
Périodes observées
1568-1621
1623-1654
On sait que depuis au moins le XVe siècle les fermiers étaient en même temps de solides propriétaires fonciers. Pourtant ce capital avait été entamé dans les moments critiques quand les arriérés de fermage s'accumulant et les obligations s'alourdissant, la vente d'une partie du foncier au propriétaire soldait les comptes : en 1565, les Bonnevie du Plessis-Gassot cédèrent ainsi aux Potier de Blancmesnil leur maison principale avec ses bâtiments d'exploitation qui furent annexés à la ferme dont ils étaient locataires9. Cas de figure classique que répandit l'endettement chronique lié à la fin des guerres de Religion10. Mais c'est dans la seconde moitié du XVIIe siècle que les patrimoines fonciers seront les plus malmenés. Nonobstant ces pertes individuelles, dans l'ensemble le capital s'était accru fortement. Car la première moitié du XVIIe siècle marque une forte progression par rapport au demi siècle précédent. De 1568 à 1621, les quinze partages suivis ici portaient sur une moyenne de 20,4 ha (médiane 16 ha). De 1623 à 1654, les chiffres ont plus que doublé (moyenne 53 ha et médiane 34,3 ha sur quatorze cas). Ce gonflement patrimonial résulte de la disparition, dans notre échantillon, des petites successions (moins de 10 ha) et de l'essor des grandes assises terriennes (plus de 50 ha). Certes ces dernières n'étaient pas 9AN, S 4772B, 27-11-1565, vente Bonnevie-Potier de Blancmesnil. 10Supra, p. 328.
LES FERMIERS DE L'ÎLE-DE-FRANCE 618
inconnues antérieurement : en 1571, Pierre Navarre, ancien marchand-laboureur de Charny-en-France, retiré comme bourgeois de Paris, ne cédait pas moins de 86 ha à ses quatre enfants avec deux centres d'exploitations rurales et une maison à Meaux, résultat de toute une vie d'acquisitions11. Mais combien plus représentatif était alors Antoine Bridault, qui laissait à ses sept héritiers une grande maison d'habitation avec granges, étables à chevaux et à vaches, toits à porc et foulerie, et une quarantaine d'arpents (16,2 ha)12. Encore plus riche d'écus, Antoine Bimont, gros exploitant de Louvres-en-Parisis — puisqu'il mettait en valeur 4 charrues avec ses 10 chevaux — avait fort convenablement réussi pour pouvoir avancer 5 700 livres à ses enfants et laisser un actif supérieur à 9 300 livres : son patrimoine, qui n'était pas négligeable, ne dépassait pourtant pas 37 arpents (15,6 ha)13. Au milieu du XVIIe siècle, les dimensions ont changé. Si les patrimoines d'une vingtaine ou d'une trentaine d'hectares semblent monnaie courante, on ne s'étonne plus de l'importance de certaines successions. Une Françoise Ganneron, longtemps fermière à Vaulerent, reste, en 1639, une douairière fort à son aise sur ses 88 ha bien qu'elle ait dû en vendre déjà 51 pour liquider les droits de ses enfants du premier lit14. Un Guillaume Gibert, ancien fermier de la seigneurie de Rosoy-en-Multien avait rassemblé, en 1654, environ 77 ha autour d'une ferme avec volet à pigeon qui comprenait
11AN, Y 113, f° 205-213. 12Ibid., S 205, partage du 6-07-1571. 13AD Val-d'Oise, B 1979, Louvres-en-Parisis, 24-11-1588, inventaire après décès de Jeanne Guérin, veuve d'Antoine Bimont ; ibid., B 1970, 15-02-1590, partage de succession. Ce marchand-laboureur de Louvres offre l'un des rares cas où l'on puisse connaître alors l'ensemble de la fortune. En novembre 1588, l'actif mobilier dépassait 9 330 livres (dont 2 545 livres en deniers comptants, 4 147 livres en réserves de grains et fourrages, 1 895 livres en cheptels mort et vif, 620 livres de « meubles meublants » et 123 livres de créances). Les avances à la culture, non estimées dans l'inventaire, pouvaient atteindre aisément 2 000 livres. Les trois filles avaient reçues chacune une dot de 500 écus (1 500 livres) auxquels s'étaient ajoutés des avances diverses : l'ensemble des rapports montait à 5 737 livres. En estimant les terres à 320 livres l'hectare, suivant des indications contemporaines, le foncier atteignait 5 000 livres. Évaluerait-on les bâtiments de la ferme familiale à 2 000 livres, ce qui est sans doute trop fort, que le capital immobilier serait loin d'égaler le capital mobilier et ne représenterait pas 30 % de la fortune totale (7 000 /24 000 livres). Le passif de l'exploitation atteignait 2 500 livres. 14Veuve de Guillaume Le Maire puis d'Antoine Guérin, Françoise Ganneron avait vendu ainsi à des fermiers apparentés 12 arpents à Roissy-en-France en 1626 puis, trois ans plus tard, deux fois 50 arpents qui faisaient partie de sa petite ferme de Villeron (A. Not. Gonesse, minutes Gaudet, 13-07-1626 et 30-07-1629). En dehors de ces 112 arpents (51 ha environ), elle conservait à son décès un patrimoine foncier de 155 arpents de terres labourables (77 ha) et de 13,5 arpents de bois (6,7 ha) que se partagèrent ses dix héritiers (ibid., partage du 11-06-1639).
LE PATRIMOINE FONCIER 619
deux granges — l'une de quatre travées et l'autre de deux — et de nombreux bâtiments annexes15. Franchi le seuil d'une cinquantaine d'hectares, c'est autour de véritables corps de ferme que se rassemblaient la majorité des parcelles. Toujours en 1654, « honorable homme » Jean Boucheron, ancien fermier de Messy-en-France, retiré à Coubron, détenait 139 ha autour de son village natal où il avait « ferme et manoir »16. Un quart de siècle auparavant, Marc Berson, l'un des fermiers de Choisy-aux-Bœufs, lui aussi « honorable homme », et « honneste femme » Noëlle Durant, sa veuve, étaient à la tête d'un patrimoine de 170 ha, organisé autour de cinq centres domaniaux : deux fermes avec « maison manable », granges, étables, bergeries, colombier, cour et jardins enclos, l'une à Charmentray et l'autre à Tremblay-en-France ; trois maisons avec bâtiments d'exploitation, la première à Mitry, la seconde à Mauregard et la dernière à Vémars — la « maison Hamelin », héritée des générations précédentes17. La preuve est donc faite qu'en 1650 les fermiers les plus puissants ont accédé à la grande propriété. Assurément, la plupart se contentaient d'une assise moyenne, comparable à la yeomanry anglaise. En tout cas, ils avaient l'espoir de mourir chez eux, au moins le conjoint survivant, une fois cédée l'exploitation principale. Certes, quelques veuves préféraient se réserver une portion de logis dans la ferme tenue par l'un des enfants18. Mais c'était pour y recevoir des revenus bien supérieurs à une pension alimentaire. On ne tardera pas à y revenir. Autour de leur maison, voire de leur propre ferme, s'étendait un patrimoine foncier de plusieurs dizaines d'hectares, sans commune mesure avec celui qu'indiquaient les terriers du XVIe siècle19. 15AD Oise, 2 E Acy-en-Multien, minutes Lenfant, 19-05-1654. 16AD Seine-et-Marne, 79 E 86, 28-11-1654. 17L'ensemble comprenait, il est vrai, les biens de l'oncle Pierre Berson. Mais les propres de la veuve — qui ne pouvaient qu'être fort importants — y échappaient (A. not. Gonesse, minutes Gaudet, 21-10-1629). 18Pratique que de nombreux contrats de mariage s'efforçaient de définir. En cédant aux futurs conjoints l'ensemble de la ferme, le parent survivant se réservait un logement gratuit qui comportait chambre, grenier et étable dans le cas assez fréquent où il conservait une exploitation résiduelle. 19Quelques vérifications permettent de s'en assurer aisément. Dans la censive qu'Étienne de Sainctot possédait à Vémars, Marc Berson détenait une tenure de 5 ha en 1609. À pareille époque son patrimoine foncier dépassait 30 ha (Arch. privées R. Bouix, terrier de la seigneurie des Carneaux, 1609 et A. not. Gonesse, minutes Gaudet, 21-10-1629).
LES FERMIERS DE L'ÎLE-DE-FRANCE 620
2. L'emprise spatiale Car la dispersion parcellaire était souvent très forte. Encore exclus des catégories supérieures du marché foncier — à commencer par celui des unités les mieux remembrées comme certaines réserves seigneuriales — les riches laboureurs devaient se contenter des petits marchés quand ils ne s'attelaient pas à une patiente politique d'acquisitions parcellaires. Aux « conquêts » de communauté réalisés sur des exploitants en difficulté et aux dépens des autres ruraux, s'ajoutaient les héritages venus de chaque côté. Il en résultait un éclatement plus ou moins marqué d'une famille à l'autre. Mais rester dans les limites d'un seul terroir, a fortiori celui de l'exploitation principale, était exceptionnel. À cet égard, le cas d'Étienne Bonnevie, qui s'accrochait en 1608 à son village du Plessis-Gassot, où se disséminaient une trentaine de parcelles autour de la « maison du colombier »20, ne paraît témoigner que pour les laboureurs de seconde classe, incapables d'intervenir à l'extérieur de leur lieu de résidence. Pour la grande majorité des autres, c'était tout le contraire. Le rayon d'action foncière des fermiers allait bien plus loin que celui de la simple paysannerie, et surtout des vignerons qui intégraient dans leur micro-exploitation les lopins patrimoniaux : alors, le manque de moyens et la nécessité du faire-valoir direct réduisaient l'assise terrienne au terroir d'exploitation et à ses environs immédiats21. Chez les marchands-laboureurs, de telles contraintes ne jouaient pas, ce qui élargissait les horizons. Des douze successions pour lesquelles un décompte est possible, entre 1571 et 1616, l'éventail va de 1 à 13 terroirs (moyenne 5,5). L'accumulation ultérieure dilate encore l'espace de référence : de 1624 à 1654, l'échelle d'observation passe de 4 à 19 terroirs (moyenne 10,1). Considéré à cette échelle, le patrimoine foncier ne s'est pas concentré à la faveur des investissements réalisés. Quand les fermiers doublaient leur assise terrienne, ils élargissaient d'autant ses limites géographiques. L'espace de référence en vint alors à couvrir une zone importante de la plaine, qui atteignait fréquemment une centaine de km2. Un patrimoine de
20AN, S 3698, 7-02-1608, partage de la succession d'Étiennne Bonnevie, laboureur au Plessis-Gassot. 21L'étroitesse de l'assise terrienne allait de concert avec un resserrement spatial des opérations foncières. Dans la vallée de l'Eure, passé 5 km, les vignerons n'intervenaient presque plus, cf. Gérard BÉAUR, « Une petite ville, Maintenon et son marché foncier à la fin de l'Ancien Régime », dans Les petites villes du Moyen Âge à nos jours (colloque international du CESURB, Bordeaux, 25-26 octobre 1985), Jean-Pierre POUSSOU et Philippe LOUPÈS éd., Paris, CNRS, 1987, p. 335-350.
LE PATRIMOINE FONCIER 621
taille moyenne comme celui de maître Jacques Guérin, receveur de la seigneurie de Vémars (32,6 ha), se disperse en 1649 sur une douzaine de terroirs : Vémars qui, certes, rassemble le plus gros lot — 7,5 ha soit 23 % de l'ensemble — mais aussi Mauregard, Moussy-le-Neuf, Le Mesnil-Amelot, Chennevières et Épiais-lès-Louvres, Saint-Witz et Montmélian, Plailly et Survilliers, et jusqu'à Tremblay-en-France, ce qui dessine un rectangle d'une quinzaine de kilomètres de long, du nord au sud et de six de large22. À la même époque, celui de Jean Boucheron, centré sur Messy où se regroupent 51 ha (36,6 % de la superficie totale), s'étend sur un espace comparable puisqu'il concerne Vinantes, Claye, Saint-Mesmes, Vineuil, Thieux, Dammartin, Trilbardou, Villeroy et Charny-en-France23. À quelques différences près, en plus ou en moins, il en allait de même dans toute l'étendue de la plaine. Autour d'un ou deux villages, la plupart des familles de laboureurs rayonnaient sur des espaces micro-régionaux à l'intérieur desquels il n'y avait guère de terroirs à échapper à leur emprise. Examinées à bonne distance, les constructions patrimoniales s'attribuaient chacune un territoire propre (carte 15).
Carte 15. Constructions territoriales et éclatement foncier
au milieu du XVIIe siècle
22A. not. Gonesse, minutes Gaudet, 2-12-1649. 23AD Seine-et-Marne, 79 E 86, 28-11-1654.
LES FERMIERS DE L'ÎLE-DE-FRANCE 622
L'Oise
La Marne
La Seine
SENLIS
MEAUX
PARIS
DammartinVémars
Messy
Rosoy--en-
Multien
0 10 km
AttainvilleFontenay
Le Pl.-GassotEzanville
EcouenVilliers-le-Bel
Sarcelles
Saint-Denis
Gonesse
Survilliers
Plailly
MontmélianSt-Witz
Moussy-le-Neuf
Moussy-le-VxMauregard
Le Mesnil-Amelot
Tremblay-en-France
Chennevières
Epiais
Claye Trilbardou
St-MesmesVineuil
Vinantes
Thieux
St-Mard
VilleroyCharny
Bouillancy
Fossemartin
Vincy May-en-Multien
Rouvres
Acy
Guillaume GIBERT et Aliénor BESNARD(1654)
77 ha sur 7 terroirs
Jean BOUCHERON et Françoise LE VACHER
(1654)139 ha sur 11 terroirs
Jacques GUERIN et Antoinette BERSON(1649)
33 ha sur 12 terroirs
Gilles LE DUC et Anne PONCEL(1643)
19 ha sur 10 terroirs
Mareil-en-France
Le Mesnil-Aubry
Mais dans la réalité, la situation était plus complexe. À partir de chaque terroir — où ne figurait pas nécessairement le siège de leur exploitation — quatre ou cinq fermiers entraient en lice. Choisit-on l'exemple de Chennevières-lès-Louvres, paroisse centrale du Pays de France où deux « coqs de village » conservaient leur maison familiale? Se dessine alors deux organisations spatiales qui interfèrent largement tout en affirmant des décalages liées à l'histoire patrimoniale des lignages et aux capacités d'investissements réciproques (carte 16).
LE PATRIMOINE FONCIER 623
Carte 16.
Emprise spatiale et enchevêtrement des patrimoines : deux fermiers de Chennevières en 1650
Charmentray
SENLIS
Gonesse
Saint-Denis
Dammartin
MitryTremblay-en-France
Roissy-en-France
EpiaisLe Mesnil-Amelot
Fontenay-en-Parisis
VémarsVilleron
Chennevières-lès-Louvres
Marly-la-Ville
Mauregard
Le-Pl.-Luzarches
Jagny
Le Pl.-Gassot
Ezanville Bouqueval
Villiers-le-BelGoussainville
Moussy-le-Neuf
PlaillySurvilliers
St-WitzFosses
Martine Chulot veuve d'Augustin Decan et
de Pierre Guerin (1652)28 ha sur 20 terroirs
Antoinette Durandveuve de Pierre Berson
(1650)59 ha sur 13 terroirs
0 10 km
Pour Pierre Berson et Antoinette Durant, le champ couvert, orienté de part et d'autre des deux terroirs d'origine des conjoints — Vémars et Mitry — correspond à l'aire moyenne qu'on vient de définir. Mais il s'y ajoute une annexe en dehors, à une dizaine de kilomètres au sud-est — Charmentray où la veuve conservait une fermette en 1650, reliquat d'un important héritage venu des Berson. Toute différente apparaît la structure des biens-fonds de Martine Chulot. Cette veuve successive de deux fermiers d'égale lignée — Augustin Decan et Pierre Guérin —, elle-même originaire de Bouqueval, avait accumulé les parcelles à l'intérieur d'un vaste quadrilatère de plus de 150 km2. À sa mort, en 1652, la dilatation est extrême : pour partager moins de 28 ha, il faut se rendre dans 20 paroisses circonvoisines24. Avec 4 ha, le lieu de résidence — qui comprend pourtant
24A. not. Gonesse, minutes Gaudet, 20-01-1652.
LES FERMIERS DE L'ÎLE-DE-FRANCE 624
deux grandes maisons — ne représente pas 15 % du patrimoine foncier, disséminé entre Bouqueval, Moussy-le-Neuf, Mitry et Tremblay-en-France. 3. L'organisation territoriale Une emprise si étendue mais en même temps si lâche caractérisait une structure foncière originale, intermédiaire entre les patrimoines de l'aristocratie et ceux de la paysannerie. Chez les fermiers, le sol était infiniment moins concentré que la plupart des domaines seigneuriaux et, dans des proportions variables, que les fermes « bourgeoises », dont l'effort de remembrement était souvent plus ancien et d'une autre échelle. Mais, vis-à-vis de ces deux types de grande propriété, les écarts tendaient à se combler et les différences n'étaient plus souvent que de degré. Avec le commun des ruraux, l'opposition était encore plus forte. Les biens-fonds des fermiers comprenaient des unités sans commune mesure avec les quelques parcelles des gens du village qui se réduisaient souvent à une maigre tenure. Par ses dimensions comme son étendue dans l'espace, le patrimoine foncier des marchands-laboureurs sortait de l'ordinaire. Des fiefs de vavasseurs Il s'étendait aux terres nobles. Ici, fiefs et rotures voisinaient et se complétaient. Les premiers, matérialisés parfois par un corps d'hôtel — comme le fief du Poncelet que les Musnier se transmettaient à Chauconin depuis le XVIe siècle25 — ou plus souvent réduits à quelques arpents de terre, comptaient dans la recherche d'une distinction sociale. On sait que la détention des fiefs marquait une étape dans l'agrégation à la gentry locale26. Voici en 1612, parmi bien d'autres de ses pairs, Antoine Boucher, fermier et procureur de la seigneurie de Marly-la-Ville : le fief et seigneurie dont il venait d'hériter — Belloy et Rougemailles —, enclavé dans le terroir de Chennevières, se limitait à une réserve d'une douzaine d'arpents (6 ha) et à une censive à peine plus étendue mais sur laquelle notre homme faisait
25Le fief comprenait un « grand corps de logis avec étables, granges, volets à pigeons, bâtiments, cour et jardin » avec cinq arpents. Il marquait donc le siège d'un domaine rural (AD Seine-et-Marne, 80 E 17, aveu du 27-04-1600 ; ibid., 80 E 82, aveu du 17-12-1637). 26Supra, chap. V, p. 295-296.
LE PATRIMOINE FONCIER 625
peser ses « droits de justice foncière, cens et champarts portant lods et ventes, saisies et amendes »27. Fief minuscule, comme il y en avait tant. Dépourvus de tout pouvoir banal, les droits qui s'y attachaient restaient trop modestes pour transformer le mode de vie. Les honorables personnes pouvaient bien collectionner les parcelles nobles jusqu'à passer huit actes de foi et hommage, comme le firent les Berson de 1618 à 1645. Au mieux la condition juridique de la terre favorisait une relative concentration parcellaire que chaque génération s'efforçait de préserver. Sans aller au-delà. Chez ces fermiers qui venaient genou en terre, en posture de vassaux, présenter régulièrement leur foi et hommage à la porte des châteaux voisins, les petits fiefs n'entraînaient guère l'usage de la particule. Il faudra attendre le XVIIIe siècle pour que, parvenus au degré supérieur de la hiérarchie féodale, nos personnages se décident à allonger leur signature. Au milieu du XVIIe, on en était fort loin : ce n'est pas en plaine de France que Chrysalde eût trouvé à épingler ces Gros-Pierre affublés de « noms pompeux ». Noyau patrimonial... Une organisation spécifique tendait à opposer un « noyau patrimonial » — éventuellement dédoublé pour les plus gros ensembles — à une nébuleuse parcellaire localisée dans les paroisses périphériques. Le premier, situé en général au lieu d'exploitation pouvait s'en éloigner, en cas de déménagement professionnel ou de simple installation en dehors du lieu de naissance, ce qui n'était pas rare, en raison de la micro-mobilité inhérente au groupe. Il se matérialisait par un siège d'exploitation particulier puisqu'il comprenait tous les équipements nécessaires : corps de logis, granges et hangars, étables et écuries, avec à l'occasion une volière. À en juger par les estimations d'experts, l'ensemble était loin d'être dérisoire. Dans la première moitié du XVIIe siècle, on comptait 2 à 3 000 livres pour les simples « maisons » rurales, équipées de bâtiments d'exploitation mais dans le cas de fermettes, ces chiffres pouvaient doubler : chez les Berson en 1629, la ferme de Charmentray montait à 3 700 livres et celle du Coq, à Tremblay-en-France, à 7 500. Cependant, la maison de Mitry n'était évaluée qu'à 2 800 livres tout comme celle de Mauregard alors qu'à Vémars, la
27A. not. Gonesse, minutes Gaudet, aveu et dénombrement du 29-10-1612.
LES FERMIERS DE L'ÎLE-DE-FRANCE 626
maison Hamelin ne valait que 2 600 livres28. Il est vrai qu'avec les petits corps de ferme, l'espace était plus grand — travées intérieures et jardins enclos — et que l'ensemble était muré. S'y ajoutaient d'autre part des bergeries qui manquaient toujours aux maisons rurales. Le degré d'autonomie de ces différents types d'exploitation n'était pas égal. On a vu qu'à l'échelle inférieure des corps de ferme — une charrue, ce qui correspondait à la plupart de ces noyaux domaniaux — l'entretien de bêtes à laine apparaissait superfétatoire29. Mais en cas de juxtaposition avec la ferme prise à bail, rien n'empêchait les parcelles du domaine propre de profiter des fumures du cheptel ovin entretenu tout à côté. Et les bâtiments acquis ou agrandis de se transformer en cas de besoin30. Plus généralement, la réunion d'un parc immobilier d'origine variée induisait une certaine rationalisation des activités agricoles. Chez les Chartier, qui surent préserver longtemps cette association, la grande maison familiale servait de corps de logis, alors que la ferme des Ursulines, située juste de l'autre côté de la rue, était consacrée entièrement à l'exploitation agricole31. Orientés principalement sur un patrimoine immobilier accru à la faveur des transactions avec les voisins, les réaménagements incessants qu'effectuait chaque génération prenaient aussi en compte les bâtiments loués. ... et nébuleuse parcellaire Pour autant, la coïncidence n'était pas générale et rarement durable. Et l'essentiel du foncier, dispersé à l'extérieur, ne s'intégrait pas à l'exploitation. Néanmoins, l'éclatement régional des biens-fonds n'allait pas sans avantage : jamais sûr de rester au même endroit et, à tout le moins, conscient qu'il ne pourrait y retenir tous ses enfants, un fermier n'avait pas d'intérêt particulier à trop borner ses regards. Consolider une emprise foncière dans un terroir du voisinage ou la compléter par des implantations extérieures préparait l'avenir familial. Toute une série d'options, qui seront précisées bientôt, s'ouvraient pour tirer parti de ces investissements à large échelle. Contentons-nous pour l'instant de marquer cet élargissement des horizons fonciers, même si l'acquisition d'un gros marché, voire d'une petite 28Ibid., 21-10-1629, partage Berson. 29Supra, chap. XI. 30Supra, chap. VII, p. 375-376. 31Jean-Marc MORICEAU, et Gilles POSTEL-VINAY, Ferme, entreprise, famille...., chap. IV.
LE PATRIMOINE FONCIER 627
ferme, hiérarchisait les préoccupations. Ainsi chez les Berson, les trois petits domaines constitués autour de Vémars — la maison « Hamelin » —, de Charmentray et de Tremblay-en-France, représentaient en 1629 70 % des biens patrimoniaux (120 ha/170,5)32. Quel que fut le degré de regroupement territorial du foncier, dès qu'on passait à la situation des pièces, il était bien rare qu'on s'écartât du morcellement général. Les 912 ha que laissèrent 24 ménages de marchands-laboureurs correspondaient à 2 418 parcelles, soit une moyenne parcellaire de 38 ares, significative de la plupart des successions. C'était là une taille intermédiaire entre celle des exploitations en corps de ferme qui correspondaient à la grande propriété urbaine33 et celle des tenures paysannes. De cet émiettement relatif — que les partages égalitaires s'efforçaient toutefois de contrôler — les noyaux patrimoniaux n'étaient pas exempts. Mais avec eux on rencontrait un regroupement relatif : des deux fermes que les Berson possédaient, celle de Charmentray (35,7 ha) comportait 66 pièces de terre — soit une moyenne de 54 ares — tandis qu'à la ferme du Coq, à Tremblay-en-France, les 95 arpents du domaine (41,3 ha) ne comprenaient que 59 pièces (70 ares)34. II. L'OFFENSIVE SUR LE MARCHÉ FONCIER La fin du XVIe siècle et la première moitié du XVIIe ont marqué une longue phase d'accumulation foncière au cours de laquelle les marchands-laboureurs ont réussi à pénétrer, pour une première fois au moins, dans le marché des grandes propriétés. Traditionnellement, une partie des revenus tirés de la prise à bail des corps de fermes était investie au coup par coup dans un pullulement de petites transactions parcellaires avec la famille, les voisins ou la clientèle locale des débiteurs. Le crédit hypothécaire et le grignotage foncier allaient de pair, tout comme les opérations intra-familiales vouées à reconstituer inlassablement ce que défaisaient les partages. Acquisitions et échanges modelaient les patrimoines, parcelle après parcelle. Avec ce marché local, on en restait à un cercle étroit, défini
32A. not. Gonesse, minutes Gaudet, 21-10-1629, partage de succession Berson. 33Supra, chap. VII, p. 345-346. 34A. not. Gonesse, minutes Gaudet, 21-10-1629, partage de succession Berson.
LES FERMIERS DE L'ÎLE-DE-FRANCE 628
par les notaires du voisinage. Tel n'est plus toujours le cas, passé le milieu du XVIe siècle. 1. Un ressort ordinaire : le marché parcellaire Indépendamment de la conjoncture agricole, la circulation des petites unités foncières — marchés ou simples parcelles — fournissait le courant des transactions. Récupération des lots abandonnés à des cohéritiers, pièce après pièce, à la faveur des disponibilités du moment. Acquisition des biens périphériques sur d'autres lignages agricoles. Aboutissement d'un crédit hypothécaire consenti aux plus petits. Toutes ces voies ouvertes contribuaient à l'animation d'un marché local, contrôlé en grande partie par les fermiers et polarisé autour des études notariales du voisinage. Des rassembleurs-nés Tout au long de leur activité, les parents saisissaient les occasions de se constituer un patrimoine commun auquel s'ajoutaient les biens propres échus en héritage. À l'instar de l'exploitation dont la taille se modifiait en fonction des différents cycles que traversait le ménage35, le rythme de ces acquisitions parcellaires enregistrait-il des variations tout au long des carrières ? À l'échelle du marché parcellaire, il ne le semble pas. La modicité des investissements requis à chaque opération n'avait qu'une incidence assez faible sur la trésorerie de la ferme et en temps normal, point n'était besoin de recourir au crédit. L'eût-il été d'aventure que la parenté offrait les appuis souhaitables. Dépositaire d'espèces sonnantes et trébuchantes, le marchand-laboureur était bien placé pour intervenir soit directement, à la faveur des ventes consenties par le reste du monde rural, soit indirectement, par le biais des constitutions de rente. Bien davantage que le vigneron du pays chartrain, notre personnage était un habitué du
35Jean-Marc MORICEAU et Gilles POSTEL-VINAY, op. cit, chap. VI, p. 301-307.
LE PATRIMOINE FONCIER 629
marché36. Dès qu'une transaction se présentait, il accourait chez le notaire quand bien même ce dernier n'intervenait pas après coup pour l'officialiser. Informé immédiatement des occasions, par son réseau de relations et sa parenté, sollicité ou solliciteur au sein de sa propre famille, il était orfèvre en la matière. Chez celui qui vivait assez longtemps pour prolonger son activité jusqu'à la retraite, l'œuvre de construction foncière aboutissait à des monceaux d'archives. C'est ce qu'on observe dans le cas privilégié de Pierre Berson et d'Antoinette Durant dont l'activité peut être suivie sur un demi-siècle (figure 16).
Figure 16. Un demi-siècle de construction foncière :
l'œuvre de Pierre Berson et d'Antoinette Durant (1596-1648)
Nom
bre
d'op
érat
ions
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1596
-160
0
1601
-160
5
1606
-161
0
1611
-161
5
1616
-162
0
1621
-162
5
1626
-163
0
1631
-163
5
1636
-164
0
1641
-164
5
1646
-165
0
échanges
achats de rentes foncières
acquisitions foncières
Formé en 1596, ce ménage de marchands-laboureurs ne fut rompu qu'en octobre 1627, au décès du père. N'ayant pas eu d'enfants, les deux époux s'étaient consenti une donation mutuelle en 1623. Mais en raison de la « courtoisie » et des « agréables services » qu'elle avait toujours reçus de
36Gérard BÉAUR. « Investissement foncier, épargne et cycle de vie dans le pays chartrain au XVIIIe siècle », Histoire et Mesure, 1991, p. 279-281.
LES FERMIERS DE L'ÎLE-DE-FRANCE 630
ses neveux et nièces, la veuve renonça à ses droits d'usufruit sur la succession de son mari et fit procéder à un premier partage en 1628. De l'ensemble des acquisitions effectuées durant la communauté, Antoinette ne conserva que la moitié. Elle abandonna alors toute activité agricole et passé 1632, tout investissement foncier, pour vivre de ses rentes, dans la maison acquise pendant la communauté à Chennevières-lès-Louvres — la maison « Picquement », où elle survécut jusqu'en 1648. Les acquisitions que jalonnent ses titres et papiers n'ont joué qu'un rôle de complément dans un patrimoine dont l'essentiel avait été hérité des Berson ou récupéré des cohéritiers sur au moins deux générations. Elles ne concernent que la moitié des conquêts dont le total dépassait 44 ha en 162837. Pourtant, l'ensemble de ces transactions — conclues en dehors du circuit familial — révèle le dynamisme d'un riche fermier sur le marché foncier local38. Soulignons tout d'abord un premier trait : le laboureur n'est pas vendeur. S'il se résigne à céder une partie de son patrimoine, c'est seulement en faveur des enfants ou des héritiers, comme ce fut le cas ici au lendemain du décès de Pierre. Alors, mais alors seulement et pas toujours immédiatement, notre personnage s'efface du marché foncier sans lui rétrocéder ce qu'il lui avait prélevé auparavant, alors que nécessité fait loi chez plus petit que lui39. Si la retombée finale se lit aisément à partir de la septième période quinquennale, antérieurement le rythme des opérations connaît une intensité soutenue qui culmine dans la seconde moitié de la carrière professionnelle. Mais la progression est toute relative : dès l'installation du ménage, chaque année qui passe donne lieu à la signature d'un ou deux contrats. Au total 67 ont été conservés dans les papiers inventoriés en 1650, après la mort d'Antoinette40. Dans cette frénésie d'opérations, priorité est donnée aux acquisitions foncières (35) mais le crédit accordé à des voisins en difficulté, garanti sur quelque parcelle, ouvrait la perspective de nouveaux achats (12).
37La masse immobilière de la communauté s'élevait alors à 13 428 livres (A. not. Gonesse, minutes Gaudet, 9-05-1628, partage Berson). 38Il est vrai qu'il s'agit d'un ménage sans enfants dont la trésorerie n'avait pas été entamée par les dépenses éducatives dont on connaît l'importance. Mais si dans le détail, les degrés d'investissement ont pu varier d'un type de famille à l'autre, les résultats qu'on saisit au moment des partages soulignent que l'ampleur des interventions foncières y était souvent comparable. 39Gérard BÉAUR, art. cit., p. 283-286. À ce niveau l'épargne-retraite ne passe plus par une liquidation partielle du capital accumulé mais par un changement du mode de production — la faire-valoir direct faisant place nette au fermage familial — ou par une cession familiale en viager. 40A. not. Gonesse, 9-09-1648, minutes Gaudet, inventaire après décès d'Antoinette Durant, veuve de Pierre Berson. Les titres et papiers furent classés en 112 cotes par le notaire.
LE PATRIMOINE FONCIER 631
Orienté principalement sur la paroisse où résidaient les acheteurs, ce grignotage lilliputien s'opérait au hasard des occasions, aux quatre coins du terroir et parfois au-delà : il fallait bien accepter les parcelles disponibles, quelle que fût leur situation. Il en résultait une extrême dispersion que les lots de partage étaient loin de compenser. Des remembrements partiels La corriger était pourtant le souci de la plupart des familles de laboureurs qui, à cet effet, multipliaient les échanges de propriété. Après les acquisitions, un remembrement partiel intervenait : pas moins de vingt contrats furent passés par les Berson. Ici, davantage que pour les achats parcellaires qui soulignaient la prééminence des fermiers dans la société rurale, les affaires se négociaient entre égaux. Pour au moins une douzaine de contrats, Pierre et Antoinette s'arrangèrent avec d'autres marchands-laboureurs du voisinage, tels Antoine Fieffé, de Survilliers en 1598, Jean Prévost du Mesnil-Amelot en 1619 ou Nicolas Ganneron, de Moussy-le-Vieux en 1621. L'effort de remodelage de l'assise terrienne profitait parfois à l'exploitation sans présenter d'avantage à long terme dans la construction foncière : les Berson renonçaient alors à la formule classique des « échanges perpétuels » pour conclure des « échanges ad tempus ». En l'occurrence, il n'était pas indispensable de passer devant notaire et deux des quatre opérations furent effectuées simplement sous seing privé. Tout laisse à penser que cette pratique se rapprochait davantage des échanges de jouissance entre exploitants, passés oralement — n'en était-elle pas une variante officielle ?— qu'aux véritables transferts de propriété. Gestionnaire prudent, Pierre Berson préférait conserver une trace écrite de toutes ces négociations, jusqu'à une « transaction de cessation d'échange » qui, passée en 1610, ne devait plus avoir à son décès qu'une valeur très relative. En dehors de la multiplicité des interventions possibles, le marché local offrait donc des solutions assez diversifiées pour constituer un patrimoine, avec des degrés de souplesse inégaux. Pour s'y reconnaître dans cette variété, mieux valait avoir en bon ordre ses titres et papiers. En la matière, Pierre Berson n'avait rien à se reprocher : en dehors de son livre-journal de « cent trente deux feuillets », notre homme avait établi de sa main un « répertoire des contrats d'acquisitions et eschanges » pour lesquels il s'était tant dépensé. Car cette énergie, concentrée dans l'étude de maître Gaudet, le notaire local, établi « es branches de Vémars, Villeron et
LES FERMIERS DE L'ÎLE-DE-FRANCE 632
Chennevières-lès-Louvres » en plein cœur du patrimoine des Berson, s'était manifestée aussi chez des confrères plus éloignés. En dehors des deux générations de Gaudet chez qui nos contractants étaient intervenus soixante-douze fois, une dizaine d'autres tabellions du plat pays avaient reçu leur visite à Dammartin, Gonesse, Moussy-le-Neuf, Mauregard, Mitry, Trilbardou et au Mesnil-Amelot. Pour autant, on restait là dans les horizons du voisinage d'autant que, passé 1612, et hormis la gestion des terres de Charmentray, tout se régla chez le notaire local, les affaires familiales aussi bien que les transactions41. Pour l'activité foncière « ordinaire », entre le tabellion et le coq du village, une fidélité durable et réciproque arrangait bien les affaires. Le premier agissait comme relais d'information et entremetteur. Néanmoins, il n'était mis dans la confidence que lorsque le second avait déjà pris les arrangements nécessaires. Autour de Gonesse comme de Sentena, l'homme public n'intervenait souvent qu'en aval d'une chaîne d'accords silencieux42.
L'entremetteur ordinaire du marché foncier :
le tabellion de village
(A. not. Gonesse, minutes Gaudet, couverture de la liasse de l'année 1674) 41Comme presque tous leurs pairs, les Berson conservaient leur confiance au notaire local qui traita leurs affaires jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Maître Gaudet intervenait aussi bien dans les questions individuelles et familiales (contrats de mariage, testaments, transactions, partages) que dans les relations avec l'extérieur (baux, acquisitions, échanges, foi et hommage). 42Giovanni LEVI, Le pouvoir au village. Histoire d'un exorciste dans le Piémont du XVIIe siècle, 1989, p. 129.
LE PATRIMOINE FONCIER 633
2. Au delà des petites affaires Du notaire des champs au notaire des villes Encore prédominant, le marché local n'interdisait pas les relations à l'extérieur, avec les villes en particulier. Mais dans ce domaine, les fermiers étaient placés traditionnellement dans une position de dépendance qu'illustrait d'abord la signature des baux à ferme passés par les propriétaires ou leurs agents d'affaire. Or, peu à peu, les voici qui prennent des initiatives. Chez certains esprits audacieux, les activités à l'échelle locale sont éclipsées par des interventions bien plus considérables qui font intervenir les notaires de la ville, à commencer par ceux du Châtelet de Paris. Voici en 1570 Jean Navarre, alors marchand-laboureur à Villeroy, acquéreur d'une ferme auprès de Guillaume Dauvet, conseiller au Parlement, moyennant 1 400 livres de rente43. Deux années après, la veuve de Pierre Boucher, de pareil état à Louvres-en-Parisis, se fait adjuger par décret du Châtelet de Paris la ferme où elle réside pour 10 000 livres « pris sur la communauté »44. De tels engagements soulignent les capacités de crédit ou d'épargne atteintes alors. Certes, dans les quelques achats de biens d'Église, issus des aliénations des guerres de Religion, les fermiers ne reçoivent que les miettes — encore que celles-ci ne soient pas toujours négligeables : pour un Urbain Navarre qui n'obtient en 1575 et 1577 que deux parcelles de 58 ares et de 26 à Charny, François Berson, qui exploite alors Choisy-aux-Bœufs, enlève un marché de 12,5 arpents (5,6 ha) lors d'une adjudication où les principaux enchérisseurs ne sont autres que ses parents45. Mais pour les lots plus 43D'après AD Seine-et-Marne, 80 E 7, 14-03-1583. 44AD Val-d'Oise, B 1978, Louvres-en-Parisis, titres de l'inventaire après décès de Pierre Boucher, 14-04-1578. 45AD Seine-et-Marne, H 187, ventes des 5-02-1575 et 25-02-1577 ; AN, S 6765, aliénation du 30-04-1575. En 1639, les descendants de Marc Berson devront rétrocéder les biens acquis alors.
LES FERMIERS DE L'ÎLE-DE-FRANCE 634
importants, ce sont des villes — Meaux, Senlis et surtout Paris — que viennent les gros opérateurs, tel François de L'Aubespine, président au Grand-Conseil, acquéreur des 155 arpents (61 ha) que le Chapitre de Notre-Dame possédait à Mitry, tout près de son domaine de Bois-le-Vicomte46. Le grappillage des domaines bourgeois Une fois passées les épreuves de la Ligue et les années de relèvement qui s'ensuivirent, les fermiers réapparaissent sur le marché extérieur. En 1633, Martin Afforty, alors receveur temporel du prieuré d'Aulnay-sous-Bois, se rend maître d'une ferme de 48 arpents (18 ha) sur Marly-la-Ville. L'ensemble comprend 65 pièces autour d'« un grand corps dhostel manable avec deux granges, escurye, estables a vaches et porcs, engart, court, jardin [et] petit vollet à pigeon ». La vente, passée chez maître Leroy, rue Saint-Honoré, fait intervenir un maître d'hôtel ordinaire du roi et un conseiller au Grand Conseil, cohéritiers d'un commissaire au Châtelet. Sans sourciller, notre homme leur verse une somme de 9 500 livres « payee baillee comptee et dellivree réellement comptant en pièces de sceize sols, testons pistolles despagne escus au soleil et aultres monnayes47 ». À cette époque, Martin Navarre, marchand-laboureur à Villeroy, avait acquis de Madeleine Potier, veuve de Théodore Choart, seigneur de Buzenval, un bel ensemble de 133 arpents (68 ha) autour d'un corps de ferme établi à Fossemartin48. Des Choart encore, un domaine d'une vingtaine d'hectares à Roissy-en-France passe aux Thérouënne, principaux laboureurs du cru avant d'échoir par mariage à Pierre Le Maire, fermier à Barbery. Longtemps après, souvenir des temps anciens, les lignages agricoles conserveront la « maison des Choart », et sa vingtaine d'arpents (10 ha)49. Vers 1650, un certain nombre de petits domaines ou « fermettes », constitués depuis le XVe siècle par les notables parisiens sont donc passés aux mains des marchands-laboureurs. Il serait vain de multiplier les exemples d'autant que le mouvement d'ensemble nous échappe largement. Mais quelle que soit l'ampleur
46AN, S 327. Le 27 août 1564, les chanoines récupèrent leur marché en remboursant François de L'Aubespine de 5 230 livres. 47AN, MC, LXXXVII, 473, vente du 12-11-1633 par Claude Oudet et Charles De Bragelongne. 48AD Seine-et-Marne, 79 E 40. 49AN, MC, XXVI, 115, 27-03-1669, partage de la succession de Pierre Le Maire et de Madeleine Thérouënne ; AD Val-d'Oise, E 7009, 26-01-1681, vente Le Maire.
LE PATRIMOINE FONCIER 635
effective des gains ainsi réalisés, le dynamisme des marchands-laboureurs est certain. Il contraste avec celui de la période antérieure — tel du moins qu'on peut l'observer — et de celle qui va suivre, dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Pour la première fois on voit s'opérer un transfert des élites urbaines vers celles du plat pays. Dans ce dernier, les rassemblements effectués ne se cantonnent plus seulement à des glissements internes. Entre 1560 et 1640, le bilan foncier de l'élite des gros fermiers est donc largement positif. Un demi-siècle avant le démarrage d'un nouveau cycle de prospérité qui la conduira encore plus loin, elle remporte un premier succès50. Les résultats s'en lisaient dans le gonflement général des patrimoines. III. EN FAMILLE : UNE PERPÉTUELLE RECOMPOSITION 1. La transmission patrimoniale La construction foncière n'était que viagère. Une fois le ménage disparu, ses biens étaient divisés en autant de parts qu'il y avait d'héritiers. D'une succession à l'autre, l'ensemble des patrimoines subissaient un partage égalitaire qui, au moins pour un moment, détruisait l'œuvre de la génération précédente. En matière successorale, les coutumes réduisaient à peu de choses le libre arbitre des parents. Pour les biens roturiers qui composaient la quasi-totalité des héritages, aucun avantage n'était admis en faveur d'un copartageant, fût-ce par le bais d'une donation ou d'un testament51. Seule la pratique des « avancements d'hoirie » introduisait une inégalité mais, chez les fermiers, ces derniers ne portaient que sur le capital mobilier, sous forme de dots et d'« augmentations ». Auraient-ils concerné par exception le foncier qu'ils ne pouvaient attenter à la « légitime » des cohéritiers et que l'obligation de tout rapporter avant d'être admis à partager la succession aurait réduit sensiblement l'avantage. Depuis le XVIe siècle, le droit orléano-parisien comme le droit champenois érigeaient en règle l'égalité entre héritiers52. Même s'il n'était pas impossible de la tourner53, la
50« Les mutations traduisent surtout dans les faits le dynamisme ou l'état de langueur de chaque classe à un moment donné », Gérard BÉAUR, Le marché foncier..., p. 335. 51« Père et mère ne peuvent par donation faite entre vifs, par testament et ordonnance de dernière volonté, ou autrement en manière quelconque, advantager leurs enfants venans à leur succession l'un plus que l'autre » (coutume de Paris, rédaction de 1580, art. 303). 52Charles Antoine BOURDOT de RICHEBOURG, Nouveau coutumier général ou corps des coutumes générales et particulières de France, t. III, 1724 ; François OLIVIER-MARTIN, Histoire
LES FERMIERS DE L'ÎLE-DE-FRANCE 636
pratique ne s'en écartait pas d'un pouce. Que le partage ait été effectué devant le prévôt seigneurial ou que tout ait été transmis au notaire familial, le déroulement était identique. Une portion congrue : les fondations d'obits On faisait d'abord la part au salut des défunts : il était rare que dans leur testament, les parents n'aient pas fait un legs à la fabrique paroissiale pour assurer les obits54. Mais il ne s'agissait que d'un champ, de quelques quartiers de terre. La fondation de messes anniversaires ne coûta qu'un demi arpent et demi quartier (25 ares) à Gillette Frémin en 1602 et seulement un quartier (10 ares) à Antoine Gibert en 162555. Il est vrai qu'en comptant les fondations créées d'une génération à l'autre, les patrimoines s'effilochaient quelque peu : des Berson, l'« œuvre » et fabrique de Vémars récupéra ainsi en 1609 deux parcelles jointives de 29 ares56. Dans le cas des grosses successions, les legs étaient plus consistants. Françoise Ganneron donna un arpent (45 ares) à l'église de Villeron en 1628 tandis que l'année précédente, celles de Vémars et de Chennevières-lès-Louvres en avaient reçu chacune autant de Pierre Berson, qui n'avait pas oublié sa paroisse d'origine57. Mais le salut des âmes n'exigeait pas l'abandon du foncier : la constitution d'une rente voire une simple somme de deniers épargnait un patrimoine qu'au demeurant, la générosité testamentaire écornait à peine. Les partages : une fragmentation intense
de la coutume de la Prévôté et Vicomté de Paris, 1922-1932 ; Jean YVER, Égalité entre héritiers et exclusion des enfants dotés. Essai de géographie coutumière, 1966. 53L'héritier avantagé du vivant de ses parents pouvait prétendre à un legs équivalent à sa part d'héritage sans rapport intégral, cf. François OLIVIER-MARTIN, op. cit., t. II, p. 425. 54Supra, chap. III, p. 232-233. 55A. not. Gonesse, minutes Gaudet, 30-06-1612, testament de Gillette Frémin, veuve de Jacques Berson, marchand-laboureur à Vémars ; AD Oise, 2 E Acy-en-Multien, 24-02-1625, testament d'Antoine Gibert, marchand-laboureur à Acy. 56A. not. Gonesse, minutes Gaudet, 11 et 12-07-1609, fondations d'obits par François Berson et Jeanne Hamelin. 57Ibid., 17-10-1627, testament de Pierre Berson, marchand-laboureur à Chennevières-lès-Louvres ; AC Villeron, état civil, 2e registre, 9-03-1628, testament de Françoise Ganneron.
LE PATRIMOINE FONCIER 637
Arrivait alors la grande affaire : le partage entre les cohéritiers. Mesurées par un arpenteur local, prisées par les experts choisis d'un commun accord — marchands-laboureurs pour le foncier, maçons pour le bâti — les successions faisaient l'objet d'un lotissement « le plus juste et égal » que faire se pouvait, ce qui limitait les soultes à très peu de choses. Chaque lot était numéroté sur des billets qu'on roulait dans le chapeau d'un jeune garçon « passant par la rue ». La main innocente les attribuait l'un après l'autre à chacun des copartageants. Le tirage au sort parachevait donc la division égalitaire. Chez les fermiers, la fragmentation était d'autant plus accusée qu'elle reposait sur une abondante descendance. Au moment du décès des parents, le nombre de cohéritiers était deux fois plus élevé que celui des autres ruraux, à commencer par les vignerons58. La longévité du dernier veuf pouvait bien avoir éclairci le nombre des enfants survivants. La croissance démographique, dont on a déjà souligné la vitalité59, multipliait encore les ayants droit. Par aventure le ménage disparu avait-il été stérile ? L'importance des lignées collatérales n'était pas de nature à réduire le nombre des cohéritiers. Pour l'ensemble des partages considérés, il a fallu établir au moins 5 lots en moyenne (5,8 pour les 16 successions réglées de 1568 à 1621 et 5 pour les 14 de la période 1623-1654). Les modalités du découpage Dans des patrimoines qui ne comportaient souvent qu'un noyau domanial, le bâti, limité à une petite ferme et à quelques annexes, supportait de plein fouet la division égalitaire. Alors, un à un, les éléments du siège de la propriété familiale, corps de logis, granges, étables, etc..., partaient pour un lot ou un autre. Chaque héritier obtenait ainsi un tiers, un quart ou un cinquième de l'immobilier, étendu aux jardins attenants. Le découpage allait parfois jusqu'à la travée. Au terme du processus on aboutissait à l'indivision sur une ou deux travées. Pour fixer les idées, prenons l'exemple d'Antoine Bridault et d'Antoinette Rousseau, marchands-laboureurs à Compans, qui laissèrent, en 1571, une maison rurale et 16,7 ha : une fortune moyenne
58Marcel LACHIVER, Vin, vigne et vignerons en région parisienne du XVIIe au XIXe siècle, p. 358-361. 59Supra, chap. IV, p. 242-249.
LES FERMIERS DE L'ÎLE-DE-FRANCE 638
comme il y en avait tant alors dans leur milieu. Deux garçons et cinq filles, tous mariés et établis dans les fermes du voisinage, interviennent comme cohéritiers. La succession vient d'être estimée à 3 391 livres, ce qui élève les droits de chacun à 484 livres. Dans la composition des lots, on distingue alors trois types de biens (tableau 51).
Tableau 51.
La fragmentation égalitaire : une succession de marchand-laboureur à Compans en 1571
Lots Bâtiments et jardins N° et valeur
Terres labourables
Autres*
1.
(483 l.)
1/2 ind. de 2 trav. maison, cv. tuile 1/2 ind. d'1 trav. étable non finie
1/2 de 22 perches de j. (8,7 a)
2,15 ha en 4 parcelles :
1,28 ha (dans 5,1 ha), 0,24 ha, 0,39 ha, 0,24 ha
2.
(482 l.)
1/2 ind. de 2 trav. maison, couvert de tuile
1/2 ind. d'1 trav. étable non finie 1/2 de 22 perches de j. (8,7 a)
2,08 ha en 3 parcelles :
1,28 ha (dans 5,1 ha),0,5 ha 0,3 ha
3.
(475 l.)
3 trav. grange 1 toit à porcs
2,24 ha en 4 parcelles : 1,27 ha (dans 5,1 ha) 0,59 ha (dans 1,6 ha) 0,3 ha (dans 0,6 ha)
0,08 ha
0,16 ha vigne
0,04 ha saussaie
4.
(476 l.)
2 trav. grange 2 toits àporcs
11 perches de j. (8,7 a)
2,24 ha en 4 parcelles : 1,27 ha (dans 5,1 ha)
0,59 ha, 0,1 ha, 0,28 ha
0,16 ha vigne
5.
(499 l.)
1 bergerie
2 toits à porcs 11 perches de j. (8,7 a)
1/2 de 1/4 de 0,7 ha d'ouches
2,28 ha en 7 parcelles : 1/2 de 0,3 ha, 0,22 ha
0,89 ha, 0,42 ha (dans 1,6 ha), 0,2 ha, 0,33 ha
0,07 ha
0,05 ha vigne 0,1 ha
saussaie
LE PATRIMOINE FONCIER 639
6.
(511 l.)
2 trav. grange
1 étable à vaches 11 perches de j. (8,7 a)
1/2 de 1/4 de 0,7 ha d'ouches
2,58 ha en 8 parcelles : 0,15 ha (dans 0,3 ha)
0,26 ha, 0,35 ha, 0,69 ha 0,1 ha, 0,1 ha, 0,6 ha
0,33 ha
0,12 saus.
7.
(465 l.)
1 étable à chevaux (1 trav.)
1 étable à vaches la foulerie 1 petit toit
2,11 ha en 7 parcelles :
0,11 ha, 0,59 ha, 0,52 ha 0,1 ha, 0,59 ha (dans 1,6 ha)
0,15 ha (dans 0,3 ha) 0,05 ha
* Abréviations : ind. (indivis), j. (jardin), saus. (saussaie), trav. (travée). Source : AN, S 205, 6-07-1571, partage de la succession Antoine Bridault-Antoinette Rousseau. Pour les trois quartiers et demi de vigne (37 ares) conservés à Thieux et à Villevaudé, et les 62 perches de saussaie (24 ares), les attributions ne poursuivent pas un démembrement parcellaire déjà très avancé (moyenne 10 ares). La seconde catégorie, qui comprend les terres labourables — et les prés, le cas échéant — fournit le gros de l'héritage : 15,7 ha en 29 parcelles pour 2 380 livres (70 % de le la valeur totale). Les grandes parcelles font les frais du partage : une pièce de terre de 12 arpents et 90 perches (5,09 ha) éclate en quatre morceaux tandis qu'on en taille trois dans une surface de 4 arpents et 8 perches (1,6 ha). Mais les autres unités foncières — à l'exception d'une petite parcelle de 30 ares — sont préservées. Il y a là une différence bien marquée avec le partage à outrance que connaissaient alors les successions de vignerons60 : la quantité de parcelles et l'aire géographique en jeu réduisaient au minimum les démembrements que les conditions de culture rendaient par ailleurs peu souhaitables. En ne touchant qu'à trois pièces de terre, on a donc freiné la réduction de la taille moyenne du parcellaire foncier, passé ici de 54 ares à 42. En revanche, rien ne permettait de procéder ainsi pour le siège du domaine, qui se fractionna en autant de portions qu'il y avait d'héritiers : les bâtiments d'habitation furent rattachés par indivis aux deux premiers lots, les granges furent divisées par travées entre le 3e, le 4e et le 6e, tandis que les logements des animaux échurent l'un après l'autre aux cinq derniers lots. Les jardins 60Quand ils laissaient toutefois plusieurs héritiers comme ce vigneron de Taverny dont les 70 ares de vigne furent découpés en 31 parcelles en 1737. Nulle part l'émiettement était aussi grand, cf. Marcel LACHIVER, op. cit., p. 358-361.
LES FERMIERS DE L'ÎLE-DE-FRANCE 640
adjacents, partagés en cinq parcelles de 8 ares ne pouvaient être fragmentés davantage. Finalement, sans pouvoir atteindre une parfaite égalité, la valeur des lots était presque identique et à quelques 5 % près dans les cas de distorsions les plus forts (6e et 7e lot), on retrouvait les 484 livres attendues. Toutes les fois qu'un patrimoine ne comportait qu'un seul siège — ce qui était le cas général — la partition s'opérait ainsi, nonobstant l'importance de l'assise foncière. En 1649 la fermette de Jacques Guérin à Vémars fut jetée au sort en quatre lots avec plus de 32 ha et en 1654, il en fut de même de la « maison et ferme » que Guillaume Gibert détenait à Rosoy-en-Multien : le portail et la cour demeuraient communs entre les cinq cohéritiers, qui recevaient chacun une partie des bâtiments avec leur cinquième de 77 ha61. Mais là comme ici, le foncier avait été peu touché. Dans un système agricole fondé sur la mise en valeur du patrimoine familial, l'éclatement de l'immobilier aurait pu avoir des conséquences redoutables. Mais ici propriété et exploitation ne coïncidaient pas. Pas davantage dans les patrimoines des laboureurs que dans ceux des autres propriétaires. Pour le bâti, la distorsion était très fréquente. L'ensemble était loué par ailleurs à un fermier qui n'était pas nécessairement l'un des enfants. En pays de fermage, l'exploitation ne dépendait pas directement de la propriété familiale. Fondée sur le droit au bail des corps de ferme, la reproduction sociale s'accommodait des partages égalitaires. Dans le Bassin parisien, la continuité du patrimoine foncier ne conditionnait pas la survie du groupe62. Pourtant, la construction réalisée n'était pas vouée à l'éclatement. En fait, le partage successoral ne marquait qu'un moment transitoire en établissant un accord de copropriété destiné à disparaître le plus rapidement possible. 2. Dans les bornes du circuit familial Menée très loin, l'accumulation foncière autorisait une relative souplesse. À partir d'une certaine échelle, la division ne s'opérait plus à la parcelle mais suivant le terroir et il devenait possible de préserver de grandes unités. Chez les Berson, en 1629, chacun des cinq lots regroupait l'essentiel des marchés qui dépendaient d'un siège domanial. Mais toutes les
61A. not. Gonesse, minutes Gaudet, 2-12-1649, partage Berson ; AD Oise, 2 E Acy-en-Multien, minutes Lenfant, 19-05-1654, partage Gibert. 62Bernard DEROUET, « Pratiques successorales et rapport à la terre...», art. cit., p. 186.
LE PATRIMOINE FONCIER 641
successions étaient loin d'égaler leurs 170 ha. Encore leur fallut-il procéder à quelques prélèvements pour équilibrer les parts respectives des cohéritiers : si les biens de Charmentray ne furent amputés que de 3 ha sur près de 39, la petite ferme de Tremblay perdit dans l'affaire 24 ha sur 6563. Indépendamment de la taille des patrimoines, les terres possédées en fief échappaient à l'égalité roturière quand l'aîné des enfants était un garçon. À défaut de manoir principal — la question ne commencera à se poser qu'au XVIIIe siècle — la coutume n'accordait à celui-ci qu'un préciput d'un arpent — « le vol du chapon » —accompagné, il est vrai, de la moitié du reste du fief. Mais pour les fermiers concernés, il ne s'agissait que de quelques parcelles. Jacques Berson reçut ainsi en 1629 2,6 ha de plus que ses cohéritiers, Jacques Guérin, 1 ha en 1649 et Pierre Boucheron 7 ha en 165564. Pourtant, rapportés à la masse de la succession, ces avantages restaient secondaires. D'une génération à l'autre : contrôler la transmission Les arrangements de famille auxquels donnait lieu la dévolution du patrimoine étaient de tout autre conséquence. Ils intervenaient d'abord entre deux générations pour préserver le plus longtemps possible le patrimoine et réduire les dissensions entre cohéritiers. Le premier risque à conjurer venait du veuvage qui autorisait les enfants majeurs à réclamer leur part d'héritage, fût-ce au détriment du parent survivant. Aussi, chez les veufs qui établissaient leurs enfants, s'introduisit au cours de la fin du XVIe siècle et de la première moitié du XVIIe une cession d'usufruit lors de la signature du contrat de mariage : le futur ne recevait sa dot qu'au prix d'une renonciation expresse à ses droits dans la succession du prédécédé. Pour le moins, il déchargeait le survivant de tout compte de tutelle. Or comme la dot n'était réglée qu'en capital mobilier, l'immobilier évitait ainsi tout partage au bénéfice des parents65. Inconnue dans les coutumes de Valois, de Meaux ou 63A. not. Gonesse, minutes Gaudet, 21-10-1629, partage Berson. 64Ibid., 2-12-1649, partage de la succession d'Antoinette Guérin, épouse de Jacques Guérin, receveur de la seigneurie de Vémars ; AD Seine-et-Marne, 79 E 86, 28-11-1654, partage de la succession de Jean Boucheron et de Françoise Le Vacher, laboureurs à Coubron. 65Sur le développement de cette pratique, cf. Jean-Marc MORICEAU, « Un système de protection sociale efficace : l'exemple des vieux fermiers de l'Île-de-France (XVIIe-début XIXe siècle), » ADH, 1985, p. 127-144. Tout en en confirmant les grandes lignes de cet article, la documentation retrouvée depuis souligne l'ancienneté des donations au veuf. Dès 1588, la veuve d'un laboureur à Chauconin imposait une décharge de tutelle pour verser les 500 livres de la dot de sa fille (AD Seine-et-Marne,
LES FERMIERS DE L'ÎLE-DE-FRANCE 642
de Senlis, la donation d'usufruit entre conjoints était entrée dans celle de la prévôté de Paris à la faveur de la réformation de 1580 (article 281) : la rapidité de son application laisse à entendre que l'usage en avait été introduit depuis un certain temps déjà. Si la clause n'était pas encore générale au milieu du XVIIe siècle, bien des partages étaient reculés jusqu'au second décès. Le veuf trouvait souvent opportun d'y procéder de son vivant, quitte à y adjoindre sa part propre pour conserver une jouissance sur l'ensemble ou recevoir une pension viagère. Au surplus, il n'était pas impossible de contrôler les opérations en procédant à de véritables donations-partages. Ainsi fit Pierre Navarre en 1571, distribuant à ses quatre enfants l'essentiel de son patrimoine « pour la parfaite et singulière amitié » qu'il portait à chacun d'eux. L'opération favorisait une division à l'amiable tout en ménageant les vieux jours du donateur puisque les cohéritiers s'engageaient à maintenir le bail que le père avait consenti à l'un d'entre eux66. En 1625, Nicolas Hébert et Françoise Mouton procédèrent ainsi pour maintenir « la paix lamour et dilection entre tous leurs enfans » et éviter « les differends et procès » qui résultent « ordinairement » des successions : après avoir fait dresser quatre lots, les plus justes et égaux possible, et avoir reçu l'assentiment de leurs quatre enfants, ils déterminèrent eux-mêmes les attributions67. De tels aménagements excluaient généralement l'immobilier. Reconstituer l'unité foncière du bâti supposait des arrangements avec les cohéritiers. Entre cohéritiers : faciliter la récupération La copropriété des maisons et fermes offrait une solution d'attente, conforme au droit successoral égalitaire. Car une fois déterminés les droits de chacun sur le siège domanial, l'avenir de ce dernier se jouait en famille. Pour l'enfant intéressé, racheter une à une la part de ses voisins était d'autant plus facile qu'il opérait en circuit fermé. En dehors même des considérations morales qui pesaient sur chacun des cohéritiers, était-il concevable de porter
80 E 9, contrat de mariage Cochard-Meignan). Nicole Lobligeois s'engageait en 1598 à laisser à son père la jouissance de sa part d'héritage dans la succession de sa mère et, dans le contrat, ses frère et sœur faisaient de même (AD Oise, 2 E Acy-en-Multien, 15-06-1598, contrat de mariage Lucy-Lobligeois). 66AN, Y 113, f° 205-213. 67AD Seine-et-Marne, 143 E 21, 19-04-1625, partage Hébert.
LE PATRIMOINE FONCIER 643
sur le marché une portion du bâti quand on ne voit guère quel étranger aurait eu d'intérêt à s'en rendre acquéreur ? Seuls des corps de fermes ou des maisons rurales entières, avec un minimum de terres labourables avaient quelque chance de trouver preneur à l'extérieur. En revanche, le lotissement à l'intérieur de la famille, en offrant les délais souhaitables, « gelait » la portion convoitée jusqu'au moment où un des cohéritiers se décidait à tout réunifier. Au demeurant, ce moment ne se faisait pas tant attendre. En 1606, des six enfants de Jean Chartier et de Jeanne Denibert, marchands-laboureurs à Belloy-en-France, les cinq qui étaient le plus éloignés de la ferme de Survilliers qu'ils venaient de se partager, acceptèrent un échange68. En 1642, dans le partage de la succession laissée par Martin Navarre et Jeanne Le Febvre, les bâtiments de la ferme de Villeroy n'avaient pu éviter une divison en deux lots. Antoine Boucher, marchand-laboureur de Marly-la-Ville, tira le premier tandis que le second revint à Jean Navarre, qui exploitait sur place. Dès l'année suivante, celui-ci réalisa un échange avec son beau-frère aux termes duquel l'ensemble du corps de ferme lui revenait69. Une décennie plus tard, Jean Chartier reconstituait au Plessis-Gassot la propriété de la « grande maison » de ses parents en procédant à des rachats auprès de ses cohéritiers70. De fait, la pratique des rachats de droits successifs ou les échanges entre cohéritiers rétablissait l'unité du siège des domaines, dans l'intérêt mutuel des parties prenantes. L'achèvement de cette œuvre de reconstitution dépendait aussi du bon vouloir des copropriétaires : mais pourvus à leur tour de nombreux héritiers, quand bien même la mort de leurs parents ne les avait pas contraint à subdiviser encore leur propre lot, ils trouvaient tôt ou tard une cession bien préférable. S'y refusaient-ils que la procédure de retrait lignager venait rappeler les droits prioritaires de la famille71. Inéluctables sur le bâti, de tels réaménagements étaient très fréquents pour le foncier, comme on l'a précédemment remarqué. Observe-t-on alors une différence dans les termes de l'échange en fonction de la proximité sociale des contractants? On sait qu'à Santena, à la 68A. not. Gonesse, minutes Gaudet, 31-01-1606. 69Partage du 13-02-1642 devant Étienne Leblanc, arpenteur à Villenoy-lès-Meaux et échange du 25-10-1643 devant le tabellion de Marly-la-Ville, d'après les titres du partage de succession de Jean Navarre et de Catherine Chulot (AD Seine-et-Marne, 79 E 144, 16-11-1673). 70Entre 1654 et 1656, cf. Jean-Marc MORICEAU et Gilles POSTEL-VINAY, op.cit., chap. III, p. 150 et p. 165 71Martin Navarre récupéra ainsi 4,5 ha que son père avait venud en 1603 (AD Seine-et-Marne, 112 E 33, 23-05-1628, partage Navarre).
LES FERMIERS DE L'ÎLE-DE-FRANCE 644
fin du XVIIe siècle, les prix montaient au fur et à mesure qu'on se rapprochait du cercle familial et qu'à l'inverse les transactions se concluaient à des taux extrêmement bas avec les étrangers72. En fait, la plaine de France a peu à voir avec les collines piémontaises où la paysannerie n'agissait que dans le cadre de la micro-propriété, dans une économie assez peu ouverte sur l'extérieur. Si, dans un cas comme dans l'autre, les relations inter-personnelles avaient une incidence dans les transactions, elle n'allait pas dans le même sens. Tant que les profits agricoles limitèrent l'endettement rural, le prix de la terre ne concluait pas une longue série d'avances et ne se relevait donc pas entre proches parents. Quand la conjoncture s'assombrira, passé 1650, certaines transactions familiales s'apparenteront bien à des ventes forcées, destinées à liquider un passif indélébile : même alors, la préservation des biens patrimoniaux dans les circuits familiaux n'entraînera pas, semble-t-il, de surenchère73. Ni de cadeau. Pour ne pas s'écarter sensiblement des conditions générales du marché — contrôlé en fait par l'ensemble du groupe — les exigences posées par l'entourage avaient au moins le mérite de la souplesse : facultés de recourir à des échanges, pratiques de rémérés74, abandon individuel ou collectif de droits successifs, ventes à constitutions de rente... On ne s'étonnera donc pas de la place que les actes de cette nature prenaient dans les minutiers locaux : pour une bonne part, le marché foncier local était un marché captif. IV. LE FONCIER : POUR QUOI FAIRE?
72Giovanni LEVI, op. cit., p. 112-138. 73En sortait-on qu'un surcoût pouvait être imposé aux autres lignages. Quand Françoise Ganneron vend une partie de son patrimoine pour régler des dettes familiales, en 1626 et en 1629, les fermiers acquéreurs contractent sur la base de 200 à 210 livres l'arpent à Vémars et à Roissy-en-France (440 à 500 livres l'hectare, selon les différentes mesures locales). Au même moment, des experts y estiment la valeur de l'arpent à un maximum de 180 livres. Cette sortie des biens du cercle de la parenté a donc permis à la veuve de vendre ses biens 15 à 20 % plus cher (A. not. Gonesse, minutes Gaudet, 13-07-1626, vente de 12 arpents à Nicolas Thérouënne, marchand-laboureur à Roissy-en-France pour 2 520 livres ; ibid., 30-07-1629, vente de 50 arpents à Henri Le Febvre, marchand-laboureur à Tremblay-en-France et de 50 autres arpents au même Nicolas Thérouënne, pour 10 000 livres chacune ; ibid., 21-10-1629, partage Berson). Mais quelle valeur attribuer à cet écart ? Seule une analyse quantitative des transactions permettrait de conclure sur cette question : nos remarques restent sous bénéfice d'inventaire. 74Nicolas Malice et Claudine Mongé, laboureurs à Marly-la-Ville avaient vendus en 1647 1 arpent à leur parent, Éloy Antheaume maître chandelier en suif à Paris : « par grâce et courtoisie », l'acquéreur laissait aux vendeurs une faculté de réméré pour 3 ans (AD Val-d'Oise, E 1529, 17-03-1647). De tels exemples sont alors assz courants.
LE PATRIMOINE FONCIER 645
Chez des fermiers dont l'exploitation reposait d'abord sur le marché locatif, comment comprendre un tel attachement à la propriété du sol ? Quels avantages recherchaient-ils dans une aussi forte accumulation ? Si leurs patrimoines se composaient surtout de terres labourables, la dispersion des biens-fonds et la mobilité géographique liée au fermage reléguaient à un second plan le faire-valoir direct, encore qu'il constituât un complément d'exploitation. En revanche, louées à la famille ou à d'autres laboureurs, les terres en propre assuraient des revenus qui s'ajoutaient à ceux de la ferme prise à bail ou lui succédaient. À ce titre, ils constituaient une épargne-retraite. Enfin, elles donnaient une garantie hypothécaire face au propriétaire principal comme aux autres créanciers éventuels, en cas de besoin important. Ce qui, dans une conjoncture agricole propice aux producteurs, offrait un accès à des entreprises plus ambitieuses. 1. Exploiter en faire-valoir direct Au milieu du XVIIIe siècle, une reconstitution parcellaire met en évidence le rôle de complément que jouaient les parcelles du patrimoine foncier localisées sur le finage de l'exploitation : chez les Chartier du Plessis-Gassot, la presque totalité du foncier s'intégrait dans les deux exploitations de Savigny et du Plessis. Pour cette dernière localité, des 14,7 ha que contenaient les 52 pièces du noyau patrimonial, 94 % — 13,9 ha en 48 parcelles — s'accrochaient au puzzle des locations qu'ils avaient pu rassembler. La plupart des parcelles en propre complétaient avantageusement les blocs hétéroclites et multiformes de la structure agraire. Parfois, elles en assuraient l'unité75. L'exemple analysé en 1758 est tout-à-fait transposable au siècle précédent puisque pour la plupart des parcelles, la distribution des propriétaires était comparable. Sans pouvoir les cartographier aussi aisément, des situations de ce type étaient courantes antérieurement. Chez Claude Papelart, on l'avait marqué dès le milieu du XVIe siècle76. Au cours de la période qui nous retient ici, certains inventaires distinguent dans les avances à la culture, les terres prises en location de celles exploitées en faire-valoir direct. Nous connaissons ainsi l'importance
75Jean-Marc MORICEAU et Gilles POSTEL-VINAY, op. cit., chap. IV. 76Supra, chap. III, p. 212.
LES FERMIERS DE L'ÎLE-DE-FRANCE 646
que tenait le patrimoine dans l'exploitation : 4,3 % pour Tristan Dutocq, qui labourait 118 ha à Juilly en 1620 et 9,1 % chez Jacques Delamare, fermier au Thillay qui en occupait 73 en 162877. De tels chiffres, glanés dans des exemples favorisés par la documentation, se maintiennent passé le milieu du siècle : en 1663, quand meurt Pierre Guérin, son exploitation de Chennevières-lès-Louvres comprenait 10 ha de propres sur un total de 112 (8,9 %) alors que celle de Pasquier Billouart, fermier de Trianon à Épinay-Champlâtreux n'en comportait que 6,8 % en 167778. Chez les fermiers qui adjoignaient ainsi quelques parcelles à leurs locations, l'intérêt économique n'était pas négligeable puisqu'ils amortissaient davantage leur capital d'exploitation. Mais quantitativement, la mesure de cet apport restait assez faible. Il n'offrait qu'un complément limité, d'autant plus qu'il était loin de pouvoir s'incorporer ainsi dans l'exploitation principale. 2. Assurer le cycle familial L'essentiel était ailleurs. Situés à trop grande distance du siège de l'exploitation pour que le déplacement des attelages fût rentable — on a vu que le seuil ne dépassait guère les 1500 m79 — les biens-fonds étaient confiés à bail à d'autres exploitants. Dès leurs acquisitions et leurs premiers héritages, pour une part de leurs revenus, les fermiers étaient donc rentiers du sol. Une aide à l'installation Pour le noyau patrimonial, qui comprenait en général une fermette, les parents pouvaient simplement installer un enfant, à condition de trouver sur place des baux complémentaires. Dans sa corbeille de mariage, Antoinette Berson reçoit ainsi, en 1638, les 150 arpents (63,3 ha) de la ferme du Coq à Tremblay dont son père était copropriétaire80. Le gendre,
77AN, Z2 1274, 15-04-1620, inventaire après décès d'Anne Mouton, épouse de Tristan Dutocq, ; AD Val-d'Oise, B 2916, Le Thillay, 30-06-1628, inventaire après décès de Jacques Delamare. 78AD Seine-et-Marne, E Dammartin, non classé, 19-06-1663, inventaire après décès de Marie Bienvenu, épouse de Pierre Guérin ; AD Val-d'Oise, 2 E Luzarches, 29-03-1677, inventaire après décès de Pasquier Billouart. 79Supra, chap. VII, p. 356. 80AD Seine-et-Marne, 143 E 41, 21-12-1638, contrat de mariage Ganneron-Berson.
LE PATRIMOINE FONCIER 647
Christophe Ganneron, démarrait alors comme locataire de ses beaux-parents. C'était à son père que Noël Navarre était redevable de 900 livres dans les années 1620 pour la ferme de 140 arpents (59 ha) qu'il exploitait à Ognes81. La longévité des parents prolongeait-elle le cycle familial sur trois générations ? L'aïeul était là pour mettre en selle ses descendants comme le fit Antoine Bernier en 1662 : déjà octogénaire, cet ancien receveur de la seigneurie du Plessis-Placy confiait pour six ans à son petit-fils Jean un corps de ferme entier, bien « fermé de murs et haies vifves » avec 37 ha de terres, prés, jardins et bois. Avec les baux qu'il recevait par la même occasion, Jean Bernier devait à son grand-père son premier établissement82. Des compléments de revenus Dès que le fermage familial n'offrait plus d'avantages, la ferme des parents rejoignait le marché général. Il en allait ainsi après les partages, une fois achevé le dernier bail consenti par la génération précédente. En 1631, l'exploitation de la ferme d'Ognes quitte la famille Navarre pour être confiée à un laboureur d'Étavigny qui renouvelle le bail dix ans plus tard : les 1 550 livres de fermage sont alors divisés entre cinq cohéritiers83. Au même moment, Pierre Hébert, laboureur à Fossemartin, règle 10 muids de « bon blé pur froment sain secq » mesure de Paris (187 hl) aux quatre enfants de Martin Navarre, co-détenteurs de sa ferme84. À ces grosses locations s'ajoutaient les baux secondaires qui confiaient les petits marchés à d'autres laboureurs. Or, de plus en plus, les propriétaires-fermiers imposaient à ces derniers des livraisons directes sur le carreau de la halle. Le bailleur n'avait plus qu'à mettre en vente le grain acheminé par les charrettes de son locataire, mesuré par ses soins. Livrable et non quérable, et tout conditionné pour le marché, le fermage en nature n'avait plus qu'à être négocié au meilleur cours, aussi bien à Paris qu'au voisinage de la ferme85. Au sein d'un même lignage ou entre lignages d'importance économique équivalente, et souvent apparentés, les baux s'entrecroisaient.
81Ibid., 80 E 53, bail du 19-11-1622. 82Ibid, 230 E 132, bail du 26-06-1662. L'avantage tenait aux bons et fidèles services que Jean Bernier avait rendu à son grand père dans son exploitation, supra, chap. IX, p. 435. Pareils avantages intervenaient entre collatéraux, supra, chap. VII, p. 336. 83Ibid., 80 E 76, bail du 25-04-1631 ; ibid., 80 E 87, bail du 13-11-1641. 84Ibid., 79 E 40, bail renouvelé le 3-05-1642. . 85Supra, chap. XIII, p. 599-602.
LES FERMIERS DE L'ÎLE-DE-FRANCE 648
Mais ils établissaient aussi une hiérarchie entre les familles dotées d'un centre d'exploitation autonome et celles qui en étaient dépourvues. Chez les Berson qui donnaient à loyer leurs deux fermes de Charmentray et de Tremblay, l'identité des fermiers — Damien De Beaucan et Robert Clausier — souligne qu'ils n'appartenaient pas au cénacle des marchands-laboureurs. Le premier avait d'ailleurs reçu du propriétaire son capital d'exploitation et méfiant, ce dernier tenait un mémoire de ce qu'il lui devait86. Quand Jean Bruslé, co-fermier de Vaulerent et Martin Navarre, marchand-laboureur à Villeroy accordent pour neuf ans, en 1603 et en 1604, leurs fermettes de Survilliers (de 19 ha et 14,8 ha respectivement), c'est à Sébastien Marquet et Toussaint Fournier, des locataires dont les patronymes sont loin de suggérer une égalité économique87. De fait, dans un grand nombre de cas, les preneurs de ces baux n'avaient aucune relation de parenté avec les bailleurs. Sans doute s'agissait-il d'une seconde classe de fermiers qui, la seconde moitié du XVIIe siècle arrivée, seront les premiers sacrifiés. Siège ou simple complément d'exploitation pour les locataires, ces biens-fonds apportaient au propriétaire des revenus supplémentaires, s'il cultivait encore. En dehors des profits qu'il était à même de retirer de sa propre exploitation — 600 à 900 livres par an pour une ferme moyenne de deux à trois charrues vers 1620 — notre fermier-rentier en attendait de plus sûrs, et de plus réguliers, de son patrimoine : à raison de 20 à 30 ha, estimation que devaient atteindre un grand nombre de marchands-laboureurs après quarante ans, c'était 350 à 500 livres qui venaient gonfler ainsi sa trésorerie annuelle. On peut donc estimer qu'en année moyenne, il augmentait alors de moitié son bénéfice d'exploitation. Quand ce dernier commença à s'effriter, avec la montée des exigences fiscales consécutives à l'entrée de la France dans la guerre de Trente Ans, ces ressources connues d'avance prirent une place encore plus importante. Elles assuraient l'avenir. Ne serait-ce que les vieux jours de ceux qui connaissaient une confortable retraite. Une assurance-vieillesse Le cycle de vie complet d'un ménage de fermier autorisait, en effet, une sortie de l'exploitation au moment de l'établissement du dernier des enfants, en principe sur la ferme conservée par les parents. Si la mort ne
86A. not. Gonesse, minutes Gaudet, 9-09-1648, inventaire après décès d'Antoinette Durant, veuve de Pierre Berson. 87Ibid., 12-09-1603, bail Bruslé ; ibid., 8-07-1604, bail Navarre.
LE PATRIMOINE FONCIER 649
venait perturber le processus, les deux parents abandonnaient toute activité agricole pour se retirer dans une de leurs maisons rurales, voire, dans le meilleur des cas, dans la ville proche88. Mais la fécondité du groupe retardait longtemps pareille perspective et c'était un veuf — et plus souvent une douairière — qui profitait des rentes. À son douaire qui, aux termes de la coutume de Paris, portait sur la moitié des héritages échus à son mari, la veuve ajoutait l'usufruit de sa part de communauté. Seule ou avec l'un des héritiers, elle passait bail de l'ensemble à un tiers, pour un loyer qui devait lui assurer ses vieux jours. « Honnête personne » Catherine Buisson, veuve de Jacques Tellier loue ainsi en 1591 un beau marché de 36 arpents et demi, mesure de roi (18,6 ha) sur Fossemartin pour 34 setiers de blé, mesure de Meaux (environ 42,5 hl)89. Suzanne Bimont, personne tout aussi « honnête », veuve d'« honorable homme » Nicolas Thérouënne, marchand-laboureur à Roissy-en-France afferme en 1644 un lot de 35 arpents à Villeron (15,2 ha) pour 2,5 muids (46,8 hl) de blé froment « rendu es halles de Gonesse » à son gendre Pierre le Maire tandis que 15 arpents sur Vémars (6,8 ha), confiés à un autre laboureur, lui rapportent 14 setiers (21,8 hl)90. Pour ces veuves au rang desquelles figuraient aussi une Françoise Ganneron ou une Antoinette Durant, les revenus fonciers complétaient ceux qu'elles tiraient d'une exploitation résiduelle, conservée en faire-valoir direct91. Parvenait-on à l'extrême vieillesse que la donation-partage dissipait tout souci de gestion sans perdre pour autant les revenus patrimoniaux. En se démettant de son bien en faveur des héritiers, le veuf fixait la pension viagère qui conditionnait sa retraite. En 1638, Anne Poncel, veuve d'un laboureur de Villiers-le-Bel, « considérant son antien aage et caducité et quelle ne peult plus subvenir a maintenir son mesnage » abandonne à ses six enfants tous ses biens-fonds y compris son douaire, moyennant le choix de sa résidence et 400 livres de rente92. On était bien au delà d'une simple pension alimentaire. Mais ce n'était pas toujours le cas. Chargé de dettes à
88Ainsi de Pierre Navarre, ancien fermier de Charny-en-France, retiré comme bourgois de Paris en 1571 puis de son propre fils Robert, son successeur dans l'exploitation, qui termine son existence comme bourgois de Meaux à partir de 1606 (AN, Y 113, f° 205 ; ibid., S 5186A ; AD Seine-et-Marne, 135 E 25). 89AD Oise, 2 E Acy-en-Multien, 8-12-1591. 90A. not. Gonesse, minutes Gaudet, 2-01-1642, bail à Jean Gaudet ; ibid., 10-09-1644, bail à Pierre Le Maire. 91Ainsi Antoinette Boudet, veuve de Daniel Berson qui, en 1633, se fait assister par ses enfants pour son labourage (ibid., 15-04-1633, succession Berson) 92AD Val-d'Oise, 2 E Écouen, 3-12-1638, donation Poncelle-Le Duc.
LES FERMIERS DE L'ÎLE-DE-FRANCE 650
l'égard de ses deux fils, Guillaume Bernier leur cède en 1650 les 7,3 ha qu'il cultivait encore en faire-valoir direct au Plessis-Placy, à charge de le nourrir et de lui assurer 6 setiers de blé chacun par moitié93. On ne tombait pourtant pas dans la misère. 3. Le crédit d'entreprise Les réserves foncières constituaient enfin une garantie indispensable en cas de gros emprunts, supérieurs aux capacités internes du groupe. Elles allaient se révéler, dans la seconde moitié du siècle, bien utiles vis-à-vis des propriétaires. Mais tant que la conjoncture économique resta favorable aux producteurs, le recours au crédit pouvait être avantageux pour passer à une autre échelle d'exploitation. Une autre échelle : la gestion des grands domaines C'est ainsi qu'André Berson, qui avait été le premier à prendre seul en charge les 250 ha de l'exploitation de Choisy-aux-Bœufs94, accède en 1648 aux fonctions de receveur général de l'abbaye de Châalis. Conclu pour 37 000 livres par an, le bail comprenait un gros pot de vin et requérait de fortes avances de trésorerie. Notre homme avait souscrit là un engagement bien au-dessus des moyens d'un marchand-laboureur, aussi puissant fût-il. Aussi dut-il emprunter à un procureur au Châtelet — sans doute homme de paille d'intérêts plus importants — 11 694 livres, remboursables en un an, « pour employer à ses affaires ». La principale était imminente. Quatre jours après, Charles de Lorraine, l'abbé commendataire, lui consent un bail général de « tout le revenu temporel de ladite abbaye de Chaalis, fruits, proffits, revenus et esmollumens quelconques », soit la gestion d'une bonne vingtaine de fermes dans le Valois et la plaine de France, sans compter les bois, les droits féodaux et la chasse. Pour trouver les prêts qui lui sont indispensables, il consent une hypothèque sur tous ses biens meubles et immeubles, et « specialement » sur sa ferme de Charmentray (36 ha) et le gros marché de 20 ha que
93AD Seine-et-Marne, 230 E 121, 3-07-1650, partage Bernier. 94En 1636, cf. supra, chap. VII, p. 341-343.
LE PATRIMOINE FONCIER 651
Geneviève Guérin, son épouse, détenait sur Vémars et Marly-la-Ville95. Quand un an après André Berson renouvelle son obligation, son frère Jacques, marchand-laboureur à Mauregard, se porte caution auprès du créancier. Et voici une autre ferme, une bonne vingtaine d'hectares de terres et dix-huit de bois, hypothéqués à nouveau96. En 1650 enfin, la veuve n'obtient une reconduction de l'emprunt que grâce à son gendre, Nicolas Thérouënne, qui apporte en garantie ses biens de Roissy-en-France. À la Noël 1650 arrivait à échéance le premier terme des baux à ferme que les Berson avaient passés depuis deux ans ainsi que celui du bail général qu'ils avaient eux-mêmes signé. Entre-temps il avait donc fallu disposer des avances nécessaires pour lesquelles le patrimoine foncier n'avait pas été superflu. Le temps des intermédiaires Ainsi en fut-il de tous ces marchands-laboureurs qui se hissèrent alors à des positions comparables. En l'affaire, André Berson ne faisait que succéder à Noël Le Maire, qui, passé lui aussi par les grandes fermes de Chaalis — La Bultée et Vaulerent — était devenu en 1632 amodiateur général du revenu temporel de l'abbé97. Pour leur part, Cosme Poixalolle et son fils François étaient parvenus en 1635 aux fonctions de receveurs généraux de l'abbaye de Juilly98. Tout en conservant sa résidence dans la ferme Saint-Lazare à Saint-Witz, Charles Fieffé était passé receveur de l'abbaye de Saint-Quentin de Beauvais en 1640 avant de prendre en charge les intérêts de celle d'Hérivaux99. À pareille époque, Martin Navarre gérait de Villeroy l'ensemble du temporel des moines de Saint-Faron de Meaux100. Ces positions ne se limitaient pas aux patrimoines ecclésiastiques : Nicolas Géhenaut, d'abord fermier à Gonesse, cumulait dans les années 1640 la
95AN, MC, LXXV, 67, 27-06-1648 (obligation), 1-07-1648 (bail général) et 8-07-1649 (ratification par Geneviève Guérin). 96Ibid., 30-06-1649. 97Supra, chap. VII, p. 340. 98AN, S 6766, bail du 27-06-1635. 99A. not. Gonesse, minutes Gaudet, années 1640 et 1646. 100AD Seine-et-Marne, 80 E 91.
LES FERMIERS DE L'ÎLE-DE-FRANCE 652
recette générale des dames de Chelles avec celle des domaines du Président Molé, autour de Champlâtreux101. Chez ces puissants personnages, dont la liste ne s'arrête pas là, l'entreprise avait changé d'échelle : partis d'une ferme tenue à bail d'un grand propriétaire, ils en étaient arrivés à assurer l'administration générale de son patrimoine. De simples exploitants agricole, ils étaient devenus des hommes d'affaires, en charge des fortunes foncières les plus considérables de la région. En passant ainsi de la grande culture au rôle d'intermédiaire, les gros fermiers s'érigeaient en arbitres : d'un bail à l'autre, ils tenaient en mains une part croissante du marché des grandes exploitations et, corollairement, du crédit agricole. Jamais leur pouvoir économique n'avait été si fort . Le processus ne se circonscrivait pas au nord de l'Île-de-France : un Antoine Gallier, receveur de l'ensemble des domaines des Brûlart de Puisieux autour d'Antony en 1639 ou un Claude Hébert, amodiateur du revenu du duché de Chevreuse en 1647102, soulignent que le Hurepoix avait connu quelques cas comparables, sans doute moins nombreux. Par rapport aux autres régions françaises, la singularité était extrême.
* * *
Dans l'évolution générale du XVIIe siècle, les quinze années qui précèdent la Fronde constituent une manière d'apogée. Fermiers généraux des riches abbayes ou des puissantes familles parlementaires, certains laboureurs avaient donc délogé la bourgeoisie dans des places qu'elle s'était réservées jusque-là103. Désormais les marchands de la ville et les hommes de 101AD Val-d'Oise, B 695, Épinay-Champlâtreux, 4-11-1637, inventaire après décès d'Élisabeth Billouart (fermages dus à Géhenaut) ; A. not. Gonesse, minutes Duhamel, 21-04-1646 et 6-12-1647, baux passé par Géhenaut. 102Jean JACQUART, La crise rurale..., p. 436-438. 103Jean MEUVRET, Le problème des subsistances à l'époque Louis XIV, t. II, vol. 1, 1987, p. 130-136. Certains parents de marchands-laboureurs avaient déjà exercé les fonctions de fermier général au XVIe siècle comme cet Étienne Tiphaine, « recepveur et entremetteur des affaires » de l'abbaye de Saint-Paul-lès-Beauvais en 1563, frère d'un fermier des religieuses à Ézanville (AD Oise, H 7461, bail à ferme du 30-04-1563) ou ce Pierre Guibillon « tresorier recepveur général » du connétable de
LE PATRIMOINE FONCIER 653
loi durent laisser entrer les anciens fermiers, qui, s'ils abandonnaient la direction personnelle des belles fermes, ne manquaient pas d'y maintenir leurs proches en leur passant des sous-baux. Avoir chassé ainsi, aux portes de Paris, le capital urbain qui ne demandait qu'à s'y investir, dit assez la puissance que le groupe des marchands-laboureurs avait alors atteinte. Dans cet élargissement de l'entreprise économique, l'assise foncière avait formé, aux yeux des grands propriétaires, un titre aussi recommandable que les succès dans l'exploitation. C'est ce qui marque une différence avec d'autres types de promotion comparable — tels les gabellotti siciliens104.
Montmorency et prévôt d'Écouen (BM Senlis, ms Afforty, vol. XI, p. 7044). Mais ils avaient quitté depuis longtemps tout lien avec l'agriculture et faisaient figure de cas exceptionnels. 104Maurice AYMARD, « Un bourg de Sicile entre XVIe et XVIIe siècle : Gangi », Mélanges Labrousse, p. 369-373.
LES FERMIERS DE L'ÎLE-DE-FRANCE 654
La fin d'une époque :
une agriculture en voie de spécialisation Du milieu du XVIe siècle aux années Colbert, la grande culture a donc conservé, aux portes de Paris, ses caractéristiques essentielles. Une taille relativement modeste — de 60 à 80 ha en moyenne — réduit les contrastes entre une majorité de laboureurs à une charrue, qui se maintiennent dans toutes les paroisses, et une oligarchie étroite de grands exploitants, à trois charrues et plus. Le siège d'exploitation associe des éléments composites à la faveur des acquisitions et des reconstructions toujours partielles et longtemps différées, même au lendemain des destructions de la fin du XVIe siècle. Pour les propriétaires, chargés des grosses réparations, le souci essentiel reste la protection contre l'incendie : la tuile achève de remplacer le chaume. Derrière les murs de son enclos, la ferme de l'Île-de-France ne présente pas encore la grande cour fermée à laquelle nous sommes habitués depuis les reconstructions du XVIIIe siècle. L'attelage, dont les deux chevaux représentent plus de 90 % de la valeur, ne subit pas de transformations. La ferme reste une petite entreprise qui, sous la direction du patron et de sa famille, procure un emploi local et parfois régional. Le matériel et les techniques agricoles varient peu. Tout en assurant une relative souplesse à l'assolement triennal, l'organisation des cultures n'entame guère la jachère qui prépare la récolte essentielle, celle des blés. Pour ces derniers les rendements plafonnent, autour de 19 hl/ha, sans dépasser les 25 hl dans les meilleures années : des performances néanmoins honorables, qui invitent à une réévaluation. L'association entre culture et élevage, reste étroite, dictée par la priorité des labours et les besoins de la fumure. Pour autant, le bétail n'est pas le « mal nécessaire » de l'économie céréalière : simplement il répond à des finalités multiples qui dissuadent toute idée de sélection. Plus généralement, la grande exploitation
LE PATRIMOINE FONCIER 655
est le théâtre d'une agriculture encore diversifiée et largement plurifonctionnelle, qu'il s'agisse de ses produits céréaliers ou des variétés animales. Les grandes lignes du tableau paraissent donc assez stable. Pourtant, ce n'est qu'un trompe-l'œil. Resserre-t-on l'objectif qu'on découvre des transformations multiples. Certaines tiennent à la routine, c'est-à-dire à l'expérience quotidienne d'exploitants en position de force pour organiser la production agricole. L'aménagement de l'assolement et de la rotation triennales, par la multiplication des « refroissis » au détriment des cultures de printemps n'en est qu'un exemple. L'attention portée aux légumineuses annuelles puis au sainfoin traduit des choix individuels. Loin de dépendre de la communauté rurale, l'oligarchie des marchands-laboureurs impose ses décisions dans l'organisation de la vaine pâture et la garde des récoltes, choisissant les messiers et utilisant l'arbitrage des justices seigneuriales. Dans cette auto-discipline qu'ils s'efforcent de mettre en œuvre, les tensions sont d'abord internes. Car il s'agit de répondre vite à une demande croissante de produits alimentaires pour les Parisiens et leur cavalerie. La concentration des exploitations accroît les dimensions du labour dans le second quart du XVIIe siècle, alors que le patrimoine foncier élargit les inégalités internes entre gros et petits. Les marchands-laboureurs gagnent en spécialisation et en productivité. Dans l'assolement, les céréales de second ordre — seigle et méteil — s'effacent devant le froment alors que les premières prairies artificielles sont destinées aux livraisons sur la capitale. L'élevage des chevaux et des bœufs disparaît tandis que se contracte celui des porcs au fur et à mesure que la fermeture des forêts arrête la transhumance de glandée. À l'époque de la Renaissance, la ferme de l'Île-de-France animait une polyculture dont les blés et le mouton ne formaient que l'élément principal. Les échanges restaient souvent localisés. Ils s'élargissent ensuite, à la faveur de la spécialisation. Sauf exceptions, la cavalerie est achetée sur les marchés et peu à peu, l'âne vient la compléter pour les transactions à courte distance. Les ventes de bœufs gras et de porcs aux marchands locaux se restreignent alors que se développent les opérations sur les ovins, dont les effectifs gonflent, l'été arrivé, en vertu de location ou d'acquisitions saisonnières. La charge animale à l'hectare s'élève avec la taille des entreprises. Le parcage peut alors réduire le manque de fumier. Les marnages se multiplient pour remédier au lessivage des sols. Avec la capitale, les relations s'intensifient. Sous Louis XIV, les deux roues remplacent les chariots d'antan, assurant des transports plus rapides et plus
LES FERMIERS DE L'ÎLE-DE-FRANCE 656
volumineux. Aux livraisons de blé, les fermiers ajoutent celles des fourrages et bientôt de la paille. La grande culture est sonc le théâtre d'un processus de modernisation, initié entre Sully et Colbert. Certes, il faut attendre l'époque du second pour voir apparaître en plein jour des changement à l'oeuvre depuis quelques décennies. Les années 1640-1670 marquent un tournant entre une économie rurale traditionnelle, c'est-à-dire en évolution très lente depuis le XVe siècle, et les progrès rapides que l'on observe sous Louis XIV. Pareille image n'était pas attendue, surtout dans le cadre de la grande exploitation. Car, au bout du compte, les entrepreneurs inventifs étaient les plus gros. Les avantages de la petite culture ne valaient pas pour les grains. C'est en changeant d'échelle que les fermiers recherchaient la productivité et s'ouvraient de nouveaux débouchés. Les spéculations sur les fourrages et les ovins viennent d'en administrer la preuve. Concentration, intensification et spécialisation marchent de pair, dans une évolution qui déjà amorcée en 1650. Mais c'est au siècle suivant qu'était réservée la mutation véritable, quand les transformations s'accélèrent pour prendre un tout autre rythme.




























































!['JNCLASSIF]ED - DTIC](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6323a138be5419ea700eb098/jnclassifed-dtic.jpg)