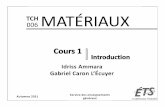Trade Marks Journal No: 1793 , 17/04/2017 Class 41 Series ...
L’agriculture sur l’île de Montréal, 1793-1951
Transcript of L’agriculture sur l’île de Montréal, 1793-1951
Le marché Sainte-anne, rue Mcgill. auteur non identifié, 1880.(Bibliothèque et archives nationales du Québec, Centre d’archives de Montréal, Collection é.Z. Massicotte, p750, album 36a)
Agriculture et société urbaine sur l’île de Montréal 571
processus pluriséculaire, le façonnement de l’arrière-pays agricole de Montréal – dans la ville, sur l’île et à l’extérieur du périmètre insulaire – accom-pagne la lente conversion de cet espace en un milieu urbanisé. au cœur de ces transformations des environnements urbains, suburbains, puis périurbains, nous assistons à une longue cohabitation de la ville et de la campagne qui va bien au-delà des débuts de la période industrielle. en fait, même lorsque la vague de suburbanisation qui déferle sur l’amérique du nord au lendemain de la Seconde guerre mondiale atteint les municipalités et les paroisses rurales excentrées sur l’île de Montréal, un contingent important de producteurs maraîchers au cœur de l’île continue d’alimenter le marché urbain. Ce chapitre examine les caractéristiques de la structure agraire changeante de l’île de Montréal et ses incidences sur le paysage agricole, défini à partir d’emblavures, de cultures et d’animaux, puis étudie les institutions d’encadrement d’une agriculture dynamique et sa desserte du marché urbain.
L’agriculture sur l’île de Montréal, 1790-18501
L’île de Montréal se situe au centre d’un territoire, la plaine de Montréal, qui constitue « le véritable cœur de l’espace agraire québécois2 ». pareille situation découle de facteurs pédoclimatiques – « un relief favorable, des sols peu podzolisés (sols bruns et gris brun), mais quelquefois un peu lourds, sans être moins fertiles (terres noires dérivées de sols organiques), un climat plus clément » –, ainsi que de la proximité de marchés urbains et villageois3. À la fin du XVIIIe siècle existe sur l’île de Montréal une petite industrie – essentiellement brassicole, mais aussi des meuneries, des carderies et des tanneries – qui table sur la proximité d’exploitants agricoles pour s’approvi-sionner. Dans la ville même, les communautés religieuses entretiennent de grands jardins sur leur propriété, tandis que dans les faubourgs la production de certains vergers et jardins potagers dépasse le stade de l’autosubsistance et contribue à nourrir la population urbaine. De plus, l’exploitation de prairies et de pâturages sert à l’alimentation de vaches laitières et de chevaux dans les côtes avoisinantes. outre la vente de produits dérivés de leurs terres en culture ou des élevages, des agriculteurs alimentent le marché urbain en bois de chauf-fage. Montréal est devenu « un marché de consommation pour des produits du cru » à la fin du XVIIIe siècle4.
Comme pour les cultivateurs de partout ailleurs dans la province, ceux de Montréal font l’objet de critiques peu élogieuses par des commentateurs étrangers. plusieurs récits de voyage comportent des descriptions négatives qui présentent une agriculture retardataire en regard des avancées agronomiques de certaines contrées européennes, et soulignent la propension chez les agri-
Une agricUltUre peU dynamiqUe
572 Formation d’une région et naissance d’une métropole, 1796-1930
culteurs canadiens à mettre en culture de nouvelles terres qu’ils épuisent, plutôt qu’à mettre en pratique des techniques propres à intensifier la production sur un même sol. par contre, des voyageurs – des américains, mais surtout des européens principalement d’origine britannique – retrouvent des cultivateurs prospères et majoritairement anglophones qui exploitent de grandes superficies améliorées pour desservir un marché urbain en expansion, avec les villes et les villages qui essaiment le territoire de la plaine de Montréal et qui requièrent d’être alimentés. en plus de ce marché, les producteurs montréalais trouvent ailleurs au Bas-Canada des acheteurs pour écouler les surplus de leur produc-tion céréalière. Ils disposent toutefois d’un élevage animal insuffisant pour fumer les terres. Le faible apport conséquent en fumure d’origine animale est compensé par des pratiques agricoles adaptées aux caractéristiques des sols lourds de la région, en ce qui concerne aussi bien l’assolement que les cultures dominantes, comme le blé ou l’orge, des céréales qui correspondent également aux exigences des industries locales. au début du XIXe siècle, le blé est encore une céréale populaire sur l’île de Montréal, mais, comme pour la majorité des emblavures du nord-est américain, les champs montréalais subissent les atta-ques de la mouche hessoise entre 1809 et 1813. À compter de 1815, alors que les agriculteurs du Bas-Canada se démènent face à des conditions climatiques défavorables, la production de blé dans le district de Montréal compense les récoltes désastreuses ailleurs au pays. Il en sera de même en 1816. Le blé est toutefois en passe d’être déclassé par l’avoine, puis par le foin, entre autres pour nourrir un bétail qui se fait plus nombreux.
Dès les premières décennies du XIXe siècle, l’intégration des agricul-teurs montréalais au marché semble déjà acquise. Selon l’historienne Louise Dechêne, il s’agit là « d’une agriculture qui dispose de plus gros capitaux, qui peut se permettre d’innover, et qui offre aux cultivateurs des alentours de bons exemples5 ». Montréal devient le moteur de changements de sa région immé-diate et « le centre polarisateur d’une plaine agricole importante ». D’abord, la ville détermine les activités agricoles à l’intérieur du périmètre urbain et dans la zone périurbaine immédiate, le « district des campagnes ». La paroisse de Montréal correspond à une zone d’agriculture intensive comparativement à l’ensemble des exploitations sur l’île ; les exploitations possèdent « un peu moins de 19 % des terres en culture du comté » en 1831 et 1844, mais des cultures particulières (orge, seigle et maïs) s’y concentrent et représentent une forte proportion de la production de l’île6. ainsi, on trouve dans la paroisse plus de 40 % de la production de pommes de terre, un tubercule qui intègre l’agriculture canadienne au début du XIXe siècle pour satisfaire les Britanniques récemment installés au Canada. enfin, le nombre de vergers dans la ville augmente jusqu’aux années 1820, et tant la production des pomiculteurs que celles des autres arboriculteurs sont en pleine expansion.
intégration aU marché
Agriculture et société urbaine sur l’île de Montréal 573
La pression de l’urbanisation se fait sentir néanmoins, et le morcelle-ment des terres oblige l’agriculture à céder constamment du terrain ; par rapport à l’ensemble des terres cultivées dans le comté de Montréal, les terres cultivées dans la ville de Montréal voient leur importance diminuer de moitié entre 1831 et 18447. Depuis le début du XIXe siècle, la croissance des villages dans la paroisse de Montréal s’appuie sur une activité économique suscitée par la proximité de la ville et rendue possible par des agriculteurs qui approvisionnent des métiers de l’artisan, comme le travail du cuir dans les villages de Côte-des-neiges et de Saint-henri-des-tanneries ou le travail du bois à hochelaga. pareille croissance retire une partie du territoire d’un usage agricole au profit des établissements résidentiels et industriels.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l’urbanisation envahit la zone périurbaine qui devient une banlieue industrielle. C’est notamment le cas du territoire sis au sud et au sud-ouest de la ville, qui regroupe la majorité des exploitations agricoles périurbaines. S’y trouvent entre autres des agriculteurs d’origine britannique qui exploitent des superficies plus grandes où ils obtien-nent des rendements plus élevés et où ils élèvent un cheptel plus nombreux. par exemple, William evans, un des premiers agronomes du Canada, exploite une ferme de plus de 150 acres à la Côte-Saint-paul. À l’inverse, les parcelles agricoles dans les faubourgs du nord et du nord-ouest de Montréal sont de plus petite taille que les exploitations du sud-ouest. toutefois, elles subsisteront plus longtemps que ces dernières, constamment pressées par les lotissements et les constructions8.
Le territoire situé au sud de l’île devient le berceau de l’industrie canadienne à partir de la fin des années 1840, quand l’élargissement du canal de Lachine – ouvert à la navigation depuis 1825 – mène à l’établissement d’un corridor industriel dans le milieu rural montréalais. C’est sur cette section de l’île que se trouve le domaine Saint-gabriel, une des premières fermes fortifiées de Montréal, qui couvre une superficie de plus de 300 acres au début du XIXe siècle. Le domaine appartient aux Sulpiciens dont les activités agricoles sur l’île de Montréal comprennent, outre le pâturage et l’élevage laitier à la ferme Saint-gabriel, la production céréalière, maraîchère et fruitière au domaine de la Montagne, ainsi que la coupe de bois de chauffage sur les terres du Sault-au-Récollet, un domaine de 800 acres au nord-est de l’île. en échange de la reconnaissance de leurs droits par la Couronne britannique en 1840, les Sulpiciens s’engagent à se départir du domaine Saint-gabriel, qu’ils lotissent puis vendent à l’encan à partir de 1845. La commune de Sainte-anne, située sur le bord de l’eau sur la pointe, est également rayée de ce territoire dont la vocation agricole cesse avec l’établissement d’une population ouvrière et de manufactures. Il y a toujours des entreprises de l’industrie alimentaire comme la minoterie ogilvie et la raffinerie Redpath Sugar, mais elles tirent leurs matières premières de l’extérieur de la région9.
la pression de l’Urbanisation
574 Formation d’une région et naissance d’une métropole, 1796-1930
Si la partie montréalaise de l’île produit de moins en moins, elle se peuple de plus en plus et requiert un approvisionnement substantiel d’aliments. La Chambre d’assemblée du Bas-Canada reçoit régulièrement des pétitions touchant l’établissement et l’élargissement d’espaces publics pour accueillir les producteurs agricoles, alors que seul un marché situé sur l’actuelle place Royale, officiellement reconnu par une ordonnance de 1676 mais en service depuis 165710, dessert la population urbaine au début du XIXe siècle. Cet enjeu et, parallèlement, celui de l’amélioration des voies de communication pour faciliter le voyage des habitants et des marchandises de la campagne vers la ville visent à assurer un lieu d’échange de divers produits agricoles – bois, foin et aliments – pour stimuler le commerce et, surtout, approvisionner une population urbaine qui déborde dans les nombreux faubourgs. en effet, après l’ouverture du marché neuf en 1808, sur l’actuelle place Jacques-Cartier, le « vieux marché » reste ouvert jusqu’en 1837, principalement comme marché à foin. À partir de la fin des années 1820, une série de marchés s’élèvent dans les faubourgs qui connais-sent une forte croissance démographique ; par exemple, le marché Sainte-anne, dont la construction sur le site actuel de la place D’youville débute en 1832 pour desservir les habitants des faubourgs Sainte-anne et Saint-Joseph, ainsi que le marché dit pré-de-Ville qui ouvre en 1829 dans le faubourg Saint-Laurent pour être fermé puis remplacé en 1840 par le marché Saint-Laurent. au cours des années 1830, après la réception de nombreuses pétitions, la Ville accorde
Le marché Saint-Laurent, rue Saint-Laurent. auteur non
identifié, 1880.(Bibliothèque et archives
nationales du Québec, Centre d’archives de Montréal,
Collection é.Z. Massicotte, p750, album 743a)
les marchés pUblics
Agriculture et société urbaine sur l’île de Montréal 575
des permis pour l’ouverture d’un marché sur la place papineau dans le faubourg Sainte-Marie, et pour l’adjonction d’un marché à foin au marché aux animaux du square Viger11.
Cette décentralisation du marché à l’échelle du quartier n’enlève en rien au dynamisme du marché neuf, auquel s’ajoute quelques années après sa création un marché aux poissons, au sud de la rue Saint-paul. aussi, en 1844, quand le conseil de ville cède le marché Sainte-anne au parlement, il entreprend de faire construire un plus grand marché public dans un nouvel édifice, le marché Bonsecours. Il décide de transformer le site du marché neuf en place publique et d’en déplacer les activités vers le sud, dans les espaces publics du marché Bonsecours, ouvert en 184712. À l’extérieur, sur la place publique de l’ancien marché neuf, les cultivateurs continueront d’affluer deux jours par semaine. Le marché Bonsecours constituera le principal lieu de distribution des produits de la ferme pour un peu plus de cent ans, jusqu’à ce que repren-nent des débats dénonçant l’exiguïté de ce « vieux marché » et que prenne forme le projet du marché central métropolitain13.
La construction de l’édifice du marché Bonsecours et la multiplication des interventions, en vue d’établir des marchés urbains sur les places publiques, révèlent un renouveau de l’interventionnisme du gouvernement local après la mise en place de la Corporation de la Cité de Montréal en 1842. Il faut toute-fois reconnaître qu’un comité des marchés est déjà à l’œuvre, et que ses respon-sabilités dépassent la désignation et l’implantation des marchés publics et embrassent également la réglementation des ventes sur des lieux désignés. entre autres, le comité interdit la vente d’aliments sur d’autres lieux que le marché public et refuse en 1851 aux fermiers de l’île de Montréal l’octroi de permis pour écouler leurs produits dans les rues. Des règlements interdisent aussi de tuer et de faire saigner des animaux, de plumer des volailles ou d’évider du poisson dans les marchés, et permettent aux inspecteurs de confisquer toute viande gâtée ou malsaine mise en vente14.
La production agricole sur l’île de Montréal, 1850-1950Le processus d’urbanisation sur l’île de Montréal connaît un nouvel
élan dans la seconde moitié du XIXe siècle, au moment où se modifie la struc-ture économique du Québec15. Face au déclin de la production de blé et à l’incapacité des agriculteurs québécois de faire face à la compétition des nouveaux producteurs céréaliers de l’ouest du continent, les élites se penchent sur les difficultés du monde agricole de la province. À la recherche d’une autre production que le blé pour insuffler un nouvel élan à l’économie agricole, peu d’entre elles s’accordent sur les remèdes à prescrire, entre autres à cause des
576 Formation d’une région et naissance d’une métropole, 1796-1930
réalités régionales16. D’ailleurs, l’examen des recensements décennaux révèle que la struc-ture agraire montréalaise suit des tendances inverses à celles qui sont observées à l’échelle de la province, notamment lorsque l’agricul-ture entreprend sa lente modernisation avec une offensive tous azimus en faveur de la production laitière17. Cette dernière, comme la culture du foin, bénéficiera grandement des marchés urbains nord-américains en pleine croissance18. Des réseaux d’échange avec les villes de new york, Boston ou philadelphie, notamment, engageront une frange solide des cultivateurs québécois vers l’agriculture commerciale. en marge de cette modernisa-tion, des mouvements de colonisation se lancent sur les fronts pionniers et maintien-nent une part non négligeable de la popula-tion rurale dans l’agriculture de subsistance19. par rapport à l’ensemble du Québec, l’agri-culture sur l’île de Montréal a les caractéristi-ques d’une agriculture au fait des avancées agronomiques tout au long du XIXe siècle, même si nominalement son importance décroît dans le temps.
Scènes d’hiver au marché Bonsecours, l’une au cours des années 1850 (en haut), l’autre la veille de noël 1884 (en bas).
(Musée McCord d’histoire canadienne, M316)
(archives de la Ville de Montréal, Fonds edgar gariépy, g753)
L’agriculture montréalaise dans l’ensemble québécoistandis que le nombre de cultivateurs au Québec (exploitation de plus
de 10 acres) suit une croissance arithmétique, passant de 81 136 à 129 666, entre 1851 et 1921, sur l’île de Montréal, il oscille autour de 1 400 individus, avant de décroître de 45 % entre 1891 et 1921. Mais, même au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, la proportion des cultivateurs montréalais dans l’ensemble québécois chute dramatiquement de moitié (figure 14.1). Ce
Agriculture et société urbaine sur l’île de Montréal 577
phénomène s’accentue au lendemain de la Seconde guerre mondiale dans des proportions encore plus abruptes, les fermes montréalaises ne représentant plus que le tiers de ce qu’elles étaient 100 ans plus tôt.
Les fermes montréalaises se distinguent aussi par leur taille. elles dont la superficie moyenne équivalait presque au double de celle de la ferme québé-coise, au milieu du XIXe siècle, rétrécissent graduellement, contrairement à la ferme québécoise qui se consolide et dont la taille moyenne augmente jusqu’en 1921 (figure 14.2). À partir de cette date, la taille moyenne des fermes montréa-laises et québécoises décline, mais de façon plus accentuée et soutenue sur l’île de Montréal. De plus, pendant que sur le territoire québécois le nombre de fermes de grande (100-200 acres) et de très grande (200 acres et plus) taille augmente avec le remembrement des terres, c’est essentiellement le nombre de fermes de petite (10-50 acres) et de moyenne (50-100 acres) taille qui augmente. C’est donc dire qu’il y a moins de cultivateurs qui travaillent sur des parcelles de terre plus petites. notons enfin que le rapport entre les super-ficies défrichées et les superficies occupées, autre indice d’une agriculture
Figure 14.1nombre d’exploitations agricoles de plus de 10 acres sur l’île de Montréal
et au Québec
Source : Recensements du Canada, 1851-1951.
taille des fermes montréalaises
578 Formation d’une région et naissance d’une métropole, 1796-1930
intensive, est beaucoup plus petit sur l’île de Montréal (tableau 14.1). tout au long du XIXe siècle, le taux d’amélioration des surfaces agricoles est deux fois plus élevé sur l’île que dans la province. La tendance s’inverse au milieu du XXe siècle, où une partie de la terre inutilisée sur l’île de Montréal est laissée à l’abandon. Dans la foulée du boom résidentiel suivant la Seconde guerre mondiale, les fermiers attendent que se manifestent des promoteurs désireux de s’approprier de nouvelles terres pour lotir, bâtir et vendre.
Tableau 14.1taux d’amélioration des terres agricoles sur l’île de Montréal et au Québec
1851 1861 1871 1881 1891 1921 1931 1941 1951
province 44,4 % 46,3 % 51,7 % 50,8 % 54,3 % 52,5 % 52,0 % 50,2 % 52,6 %Île de Montréal 81,1 % 84,3 % 90,2 % 82,2 % 84,7 % 85,0 % 79,2 % 85,5 % 81,8 %
Source : Recensements du Canada, 1851-1951.
Figure 14.2taille moyenne des exploitations sur l’île de Montréal et au Québec, en acres
Source : Recensements du Canada, 1851-1951.
Agriculture et société urbaine sur l’île de Montréal 579
Ces caractéristiques de la ferme montréalaise – une production inten-sive sur une superficie réduite et fortement améliorée – se reflètent nécessaire-ment dans les productions, déterminées par un marché urbain en expansion et à proximité, mais aussi, comme nous le verrons, en fonction des spécialisa-tions régionales qui prennent forme dans la plaine de Montréal. Mais, d’abord, quel paysage agricole se dessine sur l’île de Montréal depuis la fin du XIXe siècle ? La culture de la vigne – on trouve des vignobles commerciaux à Beacons-field et sur les coteaux occidentaux du mont Royal – disparaît de l’île à la fin du XIXe siècle, pendant que le verger se rétrécit pour ne produire que des pommes, et ce de moins en moins (tableau 14.2). Le potager s’étend, et la production maraîchère et celle des petits fruits s’accroissent (tableau 14.7). Du côté des grandes cultures, la production d’avoine oscille entre 15 % et 30 % et, avec les superficies en pâturage et en foin, domine le paysage agricole montréalais. Les superficies en foin progressent graduellement dans le dernier quart du XIXe siècle, dépassant les surfaces consacrées au pâturage. Mais ce sera surtout au lendemain de la première guerre mondiale que le fourrage dominera les emblavures, occupant plus de 30 % des surfaces en culture de 1921 à 1951. encore ici les producteurs montréalais se démarquent. Ils tablent sur l’accès immédiat du marché montréalais plutôt que sur l’exportation vers les villes américaines, parvenant ainsi à éviter l’effondrement de l’économie du
Vignobles commerciaux à Beaconsfield, en 1879.(Canadian Illustrated News, 9 août 1879, p. 85. Bibliothèque et archives nationales du Québec, peR C582)
les prodUctions
580 Formation d’une région et naissance d’une métropole, 1796-1930
foin qui a stimulé l’agriculture québécoise depuis la fin du XIXe siècle. enfin, l’importance du cheptel montréalais dans l’ensemble québécois diminue suivant une logique similaire. par exemple, le cheptel laitier montréalais se maintient en nombre absolu, mais son importance dans l’ensemble du Québec diminue rapidement dans les dernières décennies du XIXe siècle ; il devient marginal après la première guerre mondiale (figure 14.3).
Tableau 14.2Superficie des cultures maraîchères, en acres, dans les régions de la plaine
de Montréal, et contribution à la superficie agricole de chaque région, en pourcentage, 1931-1951
1931 1941 1951
Nombre % Nombre % Nombre %
Sud-ouest 974 4,7 2 643 9,1 5 095 11,7Sud-est 6 096 29,7 7 967 27,5 12 984 29,8nord-ouest 1 316 6,4 2 781 9,6 4 344 10,0ouest 72 0,4 270 0,9 463 1,1est 2 993 14,6 5 865 20,2 9 902 22,7Île Jésus 5 666 27,6 4 820 16,6 6 703 15,4Montréal 2 512 16,7 4 650 16,0 4 097 9,4
Source : Recensements du Canada, 1851-1951.
entre 1891 et 1921, le paysage agricole sur l’île se modifie radicale-ment. C’est au cours de cette période que l’agriculture québécoise achève sa lente réorientation enclenchée quelques décennies plus tôt autour du dévelop-pement de l’industrie laitière. C’est également au cours de cette période que la Cité de Montréal connaît une forte expansion démographique et spatiale. La croissance de la population urbaine (figure 14.4) repose notamment sur une expansion du territoire de la ville de Montréal qui connaît de nombreuses poussées au gré d’une série d’annexions ; on en dénombre 34 entre 1867 et 1918 qui permettent à la ville-centre de quintupler le territoire qu’elle occupait en 1867.
Ces transformations que nous observons au lendemain de la première guerre mondiale s’inscrivent dans des tendances qui s’installent au siècle précédent. toutefois, les agriculteurs de l’île qui semblaient avoir adopté rapi-dement et intensément le lait et le foin pour les destiner au marché urbain
Agriculture et société urbaine sur l’île de Montréal 581
Figure 14.3Cheptel laitier sur l’île de Montréal
Figure 14.4population de la ville et de l’île de Montréal
Source : Recensements du Canada, 1851-1951.
Source : Recensements du Canada, 1851-1951.
582 Formation d’une région et naissance d’une métropole, 1796-1930
montréalais s’orientent, durant l’entre-deux-guerres, vers des productions qui caractérisent un autre agrosystème. ainsi, selon les principales sources de revenu déclarées en 1940 (figure 14.5), la ferme montréalaise concentre ses activités principalement autour de la production de légumes et de fruits, tirant 35 % de ses revenus de la vente de légumes, fruits et produits de pépinière, une production qui représente seulement 4 % des revenus de la ferme québécoise. Ces productions se reflètent également dans la structure des coûts, alors que les fournitures pour les fruits représentent 16,2 % des dépenses pour les fermes de l’île de Montréal contre 2,4 % ailleurs dans la province, et que la principale dépense concerne la main-d’œuvre agricole – les productions fruitières et maraîchères résistant à la mécanisation et étant intensives en main-d’œuvre20. on note également sur la ferme montréalaise une plus faible propension à obtenir un revenu de l’extérieur de la ferme et une moins forte consommation de produits sur la ferme, tandis que l’achat de provendes pour nourrir le bétail constitue la principale dépense sur la ferme ailleurs au Québec. Comptabilisées une première fois en 1941, ces différences apparaissent de nouveau en 1951. L’exploitation agricole de l’île de Montréal qui émerge alors se distingue non seulement des fermes ailleurs dans la province, mais aussi de la ferme montréa-laise de la fin du XIXe siècle.
Source : Recensements du Canada, 1851-1951.
Figure 14.5types de fermes selon la principale source de revenu (plus de 50 %),
déclarée 1940
Agriculture et société urbaine sur l’île de Montréal 583
Les lieux de production sur l’île de MontréalLes transformations de l’agriculture sur l’île de Montréal entre 1850
et 1950 sont nombreuses et influencées par une série d’événements – les crises économiques et les guerres mondiales notamment – et de facteurs structurels, comme bien sûr les processus d’urbanisation et d’industrialisation, mais égale-ment la croissance démographique et le changement technologique. Ces transformations affectent l’ensemble des fermes sur l’île de Montréal, où les agrosystèmes qui se succèdent donnent lieu à une nouvelle exploitation de la terre, intensive, à faible apport animal, et dont les productions s’alignent toujours plus étroitement vers le marché urbain voisin. est-ce à dire qu’il en est ainsi partout sur l’île, ou dénotons-nous quelques particularités spatiales, au regard de l’extension de la ville-centre et des noyaux villageois qui prennent forme et se consolident ? une fine analyse de l’utilisation du sol et de la produc-tion agricole fera ressortir la transformation de l’agriculture et ses variations spatiales sur le territoire de l’île de Montréal et, dans une moindre mesure, la manière dont celles-ci accompagnent le rythme de l’urbanisation. encore ici, nous recourons aux recensements décennaux pour reconstruire les activités agricoles dans les divisions de recensement (voir la carte 14.1), délimitées selon les frontières paroissiales telles qu’elles étaient établies depuis le début du XIXe siècle et que nous reconstituons cent ans plus tard pour les besoins de l’analyse. nous employons également des enquêtes sur les marchés pour connaître les lieux d’écoulement des productions et les origines des denrées consommées dans la ville.
Le domaine agricole (la superficie occupée), qui s’est maintenu de façon quasi constante dans les différentes divisions jusqu’en 1890 (figure 14.6), a nettement régressé au lendemain de la première guerre mondiale, quoique de façon plus abrupte en certains endroits. Dans la plupart des divisions, la superficie améliorée en 1921 atteint le tiers ou la moitié de la superficie de 1891, la moyenne sur l’île approchant 50 %. Ces diminutions abruptes des superficies améliorées renforcent l’importance de quelques divisions qui domi-nent la production agricole de l’île de Montréal à la fin du XIXe siècle (tableau 14.3). en 1921, cinq divisions concentrent les deux tiers des exploitations agricoles : Sainte-geneviève-de-pierrefonds (143 exploitations), Saint-Raphaël-de-l’Île-Bizard (90), Saint-Laurent (128), Saint-Joachim-de-pointe-Claire (104) et Saint-Léonard-de-port-Maurice (107). en 1891, c’était moins de la moitié (47,5 %), un total probablement équivalent à celui de 1861, la création de Saint-Léonard-de-port-Maurice sur les territoires de Longue-pointe et Sault-au-Récollet nous empêchant toutefois de proposer une évaluation définitive. Quant au domaine agricole, c’est près des trois quarts que ces mêmes cinq divisions occupent (74,2 %) en 1921, alors que c’était moins de la moitié (45,7 %) de la production en 1891.
évolUtion dU domaine agricole
584 Formation d’une région et naissance d’une métropole, 1796-1930
en dépit de cette concentration de la production agricole dans quel-ques divisions, on constate que les superficies mises en culture n’ont cessé de diminuer et d’occuper une portion de moins en moins grande de la superficie totale des divisions. ainsi, pour ces cinq divisions, le rapport de la superficie agricole sur la superficie totale passe en moyenne de 90,4 % à 39,7 % entre 1891 et 1951, atteignant, dans les cas de Saint-Joachim-de-pointe-Claire et de Sainte-geneviève-de-pierrefonds, respectivement 35,0 % et 23,8 %. Cette réduction n’accompagne pas nécessairement une croissance de la densité de population de ces divisions, ni ne découle automatiquement de l’éloignement ou de la proximité par rapport au centre urbain, comme le signale la bonne tenue de l’activité agricole à Saint-Léonard-de-port-Maurice. parmi les facteurs potentiellement responsables de cette réduction, nous pouvons repérer la multiplication de petites municipalités et le développement industriel. encore là, Saint-Laurent, particulièrement frappé par la municipalisation du territoire au tournant du XXe siècle et par l’installation d’entreprises comme la Vickers ou la noorduyn durant la Seconde guerre mondiale, abrite toujours une forte activité fermière en 195121.
* notre analyse statistique se base sur les frontières paroissiales de l’île de Montréal, malgré le fait que celles-ci se fragmentent pour rendre compte de l’émergence d’un village (comme celui du village de Lachine dans la paroisse des Saints-anges-de-Lachine en 1848) ou de la création d’une nouvelle paroisse (comme celle de Saint-Léonard-de-port-Maurice en 1886). néanmoins, nous avons été en mesure de reconstruire pour la plupart des paroisses des séries continues des données de recensement entre 1851 et 1951.
Carte 14.1Les divisions de l’île de Montréal*
Agriculture et société urbaine sur l’île de Montréal 585
Source : Recensements du Canada, 1851-1951.
Figure 14.6Superficie améliorée des paroisses de l’île de Montréal par districts
de recensement, en acres
L’expansion de la ville-centre confine la production agricole sur un territoire qui se rétrécit et l’industrialisation a également des répercussions sur l’organisation spatiale de l’agriculture. Malgré une répartition quasi uniforme des exploitations sur l’île de Montréal au début de la période étudiée, nous assistons à un glissement des lieux de production vers le sud et l’ouest de l’île. en effet, les fermes du comté de Jacques-Cartier (la partie sud et ouest de l’île) qui occupaient la moitié de la superficie agricole de l’île entre 1851 et 1891 en représentent les deux tiers en 1921 et plus des trois quarts en 1951. Dans ce comté, pour lequel nous possédons des données en 1901 et 1911, le déclin semble enclenché en 1891 ; ailleurs sur l’île, la réduction des superficies débute en 1861. nous pouvons en déduire que, dans les divisions du comté d’hoche-laga (la partie nord et est de l’île), la réduction des superficies commence plus tôt et se manifeste de façon plus abrupte. ainsi, pointe-aux-trembles et Longue-pointe perdent leur « splendeur agricole » dans les premières années du XXe siècle, lorsque l’établissement de l’industrie lourde et d’activités liées au trafic portuaire fait fuir les agriculteurs ou encouragent ces derniers à soumettre leur terre au jeu de la spéculation foncière22. par exemple, Montréal-est naît à la suite de l’acquisition de six grandes terres agricoles de pointe-aux-trembles en 1910, et accueille les grandes industries du ciment et du pétrole. Sur le bord de la rivière des prairies, ce sont le développement de la ville de Montréal-nord
586 Formation d’une région et naissance d’une métropole, 1796-1930
et la construction du barrage de la Montreal Island power qui détruisent le tissu rural du Sault-au-Récollet. Cette tendance ne ralentit pas, même durant la crise, quand des familles viennent s’établir à Rivière-des-prairies ou à Longue-pointe pour s’engager dans des travaux agricoles et éviter le secours direct. Dans le sud de l’île, seule une partie de Lachine connaît pareil sort, alors que le Bas-Lachine (LaSalle) conserve sa vocation agricole au contraire de localités comme Côte-Saint-paul, pointe-Saint-Charles et Saint-henri, qui deviennent des centres industriels.
présente dès le début du XXe siècle dans les parties nord et est de l’île, la pression sur le territoire agricole se fait sentir dans les parties sud et ouest de l’île surtout au lendemain de la Seconde guerre mondiale, au moment où une nouvelle phase de croissance suburbaine démarre23. Il faut dire que, sur les bords du fleuve et de la rivière des prairies, aussi bien dans le comté de Jacques-Cartier que dans le comté d’hochelaga, la construction de chemins de fer et la prolifération de pavillons de villégiature ont contribué depuis la fin du XIXe siècle à détourner le sol de son usage agricole et à stimuler la vente des fermes et le lotissement des terres. Mais, après 1945, ce sont surtout la construction résidentielle et celle d’autoroutes qui se répercutent sur le territoire et orientent le déplacement et le rétrécissement des lieux de production agri-cole24. L’arrivée massive d’immigrants européens et de ruraux québécois à Montréal enclenche une expansion suburbaine, avec une décentralisation de l’industrie, jusqu’alors massivement concentrée autour du fleuve et du cœur original de la ville, ainsi que le long du corridor liant les ponts de la rive sud à ceux de la rive nord. La croissance urbaine sur l’île de Montréal, alors limitée au pourtour de la ville de Montréal et à quelques villages excentrés dans les paroisses de Saint-Laurent ou de Lachine, notamment, s’étend autour des nouveaux noyaux industriels.
La redistribution spatiale de superficies agricoles décroissantes se répercute sur les productions. en 1951, le cheptel laitier montréalais réside principalement dans les parties sud et ouest de l’île, une tendance entamée en 1921 même si, en 1891, les comtés de Jacques-Cartier et d’hochelaga semblaient se partager équitablement les vaches laitières (figure 14.7). un autre signe de la domination des divisions du comté de Jacques-Cartier dans les activités d’élevage est que 79,3 % des superficies en pâturage sur l’île de Montréal en 1951 se trouvent dans les parties sud et ouest de l’île, alors que cette proportion atteignait seulement 45,6 % en 1921 (figure 14.8). enfin, la culture du foin, en déclin sur l’île dans son ensemble, se concentre de plus en plus dans les exploitations du comté de Jacques-Cartier (figure 14.9).
Vue des vergers de LaSalle, en mai 1947.
(archives de la ville de Montréal, VM97, S3, D7, p902)
le cheptel
Agriculture et société urbaine sur l’île de Montréal 587
Tableau 14.3exploitants de plus de 10 acres, proportion de la paroisse
sur l’ensemble montréalais
1861 1891 1921 1951
Sainte-anne-du-Bout-de-l’Île 4 % 5 % 3 % 3 %Saint-Raphaël-de-l’Île-Bizard 6 % 5 % 10 % 13 %Sainte-geneviève-de-pierrefonds 10 % 10 % 17 % 13 %Saint-Joachim-de-pointe-Claire 9 % 8 % 13 % 13 %Saint-Laurent 16 % 15 % 15 % 21 %Saint-Michel-de-Lachine 7 % 6 % 4 %pointe-aux-trembles 7 % 5 % 4 %Sault-au-Récollet 11 % 6 %Longue-pointe 6 % 2 %Saint-Léonard-de-port-Maurice 6 % 13 % 14 %Saint-Joseph-de-la-Rivière-des-prairies 5 % 5 % 7 % 10 %paroisse de Montréal 16 %Jacques-Cartier 52 % 48 % 68 % 76 %hochelaga 48 % 50 % 23 % 24 %Île de Montréal 1 378 1 494 829 616
Source : Recensements du Canada, 1861, 1891, 1921, 1951.
Source : Recensements du Canada, 1851-1951.
Figure 14.7Le cheptel montréalais. part des exploitations du comté de Jacques-Cartier
sur l’ensemble de l’île
588 Formation d’une région et naissance d’une métropole, 1796-1930
Figure 14.8pâturage sur l’île de Montréal, superficie et contribution des divisions
de recensement
Source : Recensements du Canada, 1851-1951.
Source : Recensements du Canada, 1851-1951.
Figure 14.9production de foin sur l’île de Montréal, superficie et contribution
du comté de Jacques-Cartier
Agriculture et société urbaine sur l’île de Montréal 589
outre la concentration de l’élevage dans le sud et l’ouest de l’île, nous constatons également des modifications en horticulture, « la culture ordinai-rement combinée de légumes frais et de petits fruits ou, dans une moindre mesure, de pommes de terre de primeur25 ». C’est notamment le cas à proximité du centre urbain où, dans la seconde moitié du XIXe siècle, les cultivateurs de la paroisse de notre-Dame-de-Montréal ont joué un rôle appréciable dans la production agricole de l’île de Montréal, à tout le moins jusqu’en 1891, dernière année pour laquelle nous possédons quelques données de recensements signi-ficatives. La plus grande portion des superficies en vergers et en jardins sur l’île de Montréal (tableau 14.4) se trouvait dans les villes et les villages que compre-nait le territoire de la paroisse de Montréal en 1871. De même, c’est sur ce territoire que les cultivateurs consacraient, proportionnellement, la plus grande superficie de leur exploitation aux vergers et aux jardins. notre-Dame-de-grâce et outremont sont toujours des « refuges de primeuristes » au début du XXe siècle. Les cultivateurs quittent tôt le matin les jardins potagers et les vergers pour atteindre les premiers les marchés publics avec leurs voitures chargées de fruits et de légumes. À notre-Dame-de-grâce, notamment, une véritable dynastie de jardiniers-maraîchers, les Barthélémi-télesphore, anatole et alphonse-édouard Décarie, approvisionne les grands marchés urbains – la réputation du melon de Montréal atteint les hôtels et les restaurants de new york. De même, dans les vergers qui « s’échelonnent en grappes sur les coteaux » se cultive la pomme Fameuse, une variété recherchée à fort prix sur le marché britannique26.
Tableau 14.4Contribution de la subdivision à la superficie en vergers et en jardins sur l’île de Montréal
1851 1871 1891
Sainte-anne-du-Bout-de-l’Île 4,3 % 3,2 % 5,0 %Sainte-geneviève-de-pierrrefonds et île Bizard 7,0 % 8,7 % 8,1 %Saint-Joachim-de-pointe-Claire 6,9 % 3,0 % 4,0 %Saint-Laurent 14,3 % 8,4 % 9,9 %Saint-Michel-de-Lachine 6,6 % 7,8 % 7,2 %pointe-aux-trembles 0,1 % 2,5 % 0,2 %Saint-Joseph-de-la-Rivière-des-prairies 2,9 % 2,5 % 0,8 %Sault-au-Récollet, Longue-pointe et Saint-Léonard-de-port-Maurice 8,1 % 6,2 % 10,8 %paroisse de Montréal (comprenant Coteau-Saint-Louis et Saint-Jean-Baptiste) 49,7 % 57,7 % 53,9 %
Source : Recensements du Canada, 1851, 1871, 1891.
l’horticUltUre
590 Formation d’une région et naissance d’une métropole, 1796-1930
Tableau 14.5Superficie en vergers et en jardins maraîchers, contribution de chaque paroisse au total
pour l’île de Montréal, en pourcentage, 1921-1941
Vergers Jardins
1921 1931 1941 1931 1941
8,2 16,1 11,2 Saint-Raphaël-de-l’Île-Bizard 11,1 10,017,6 18,3 15,2 Sainte-geneviève, paroisse 18,6 15,07,6 2,2 10,9 Sainte-anne-du-Bout-de-l’Île 0,6 19,2 12,2 15,7 Saint-Joachim-de-pointe-Claire 2,3 2,620,9 19,7 10,0 Saint-Laurent 17,7 16,50,9 3,4 4,0 La présentation-de-la-Sainte-Vierge 1,3 2,921,7 15,9 25,4 Lachine 4,5 8,18,7 9,1 5,7 Montréal-est*, partie 23,5 26,25,1 3,2 1,9 Cité de Montréal 20,4 17,7
* Dans le recensement de 1941, Montréal-est comprend les districts suivants : Saint-Léonard, pointe-aux-trembles, Saint-Joseph-de-la-Rivière-des-prairies et Longue-pointe.Source : Recensements du Canada, 1921, 1941.
Dans ces villages pratiquent les membres de l’élite agricole de Montréal, reconnaissables tant par les positions qu’ils occupent dans les sociétés d’agri-culture et d’horticulture du district que par les succès qu’ils remportent aux concours d’expositions agricoles27. De part et d’autre du mont Royal, nous trouvons les lauréats du concours du Mérite agricole, les agriculteurs de la petite-Côte remportant le quart des prix des quatre premiers concours entre 1890 et 1905 remis aux participants de la région de Montréal (qui comprend également les producteurs des comtés de Laval, Soulanges, Vaudreuil, terre-bonne et argenteuil). Ces agriculteurs modèles s’adonnent à une culture de légumes pour le marché urbain et se procurent, à faible coût dans les étables et les écuries en ville, des charges de fumier – « l’engrais le plus convenable et le plus économique pour la production des récoltes maxima et une culture mixte intensive (avoine, fourrage vert, betteraves fourragères, carottes fourra-gères, carottes grosses blanches) » –, tirant ainsi doublement avantage de la proximité de la ville28. Durant l’entre-deux-guerres, les horticulteurs dans ces secteurs détonnent toujours dans le paysage montréalais, même si un obser-vateur remarque la disparition des vergers de notre-Dame-de-grâce. Les dernières traces d’agriculture dans la ville de Montréal s’effacent alors au profit d’une nouvelle banlieue maraîchère29.
l’élite agricole
Agriculture et société urbaine sur l’île de Montréal 591
À partir de 1921, les données pour les superficies en vergers et en jardins révèlent que la production arboricole devient surtout l’affaire des exploitants de Sainte-geneviève-de-pierrefonds et de Saint-Raphaël-de-l’Île-Bizard, dans le comté de Jacques-Cartier, quoique ces derniers tirent l’essentiel de leur revenu de la vente de légumes. Si, dans le cas d’autres grandes agglo-mérations, ce sont les productions maraîchères qui dominent dans le voisinage immédiat de l’espace urbain, elles tendent ici à se distribuer dans quelques divisions excentrées sur l’île de Montréal (tableau 14.3). Raoul Blanchard y a vu des raisons historiques, soit que la proximité du marché urbain ainsi que l’absence de ponts sur le fleuve ont privé pendant longtemps les producteurs de la rive sud de l’accès au marché montréalais et permis aux producteurs de l’île de prendre une forte avance sur leurs compétiteurs30.
Durant l’entre-deux-guerres, ces cultivateurs adoptent une lucrative production maraîchère et, dans une moindre mesure, laitière. Des enquêtes du ministère provincial de l’agriculture effectuées en 1938 et 1953 révèlent le maintien d’une activité agricole intensive et diversifiée, dont les produits sont livrés aux industries agroalimentaires ou aux marchés publics ; à Montréal, outre le marché Bonsecours qui reçoit plus de la moitié des charges, citons les marchés Maisonneuve, Jean-talon, atwater, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Laurent, auxquels s’ajoute le marché de Lachine. L’étude de 1938 signale que les légumes du Québec représentent 76 % de la quantité et 47 % de la valeur de tous les légumes vendus à Montréal, contre 11 % de la valeur et 15 % de
exposition agricole, avenue de l’esplanade. auteur non identifié, entre 1870 et 1920.(Bibliothèque et archives nationales du Québec, Centre d’archives de Montréal, Collection é.Z. Massicotte, p750, album 2134a)
importance de la prodUction maraîchère
592 Formation d’une région et naissance d’une métropole, 1796-1930
la quantité des fruits ; un tiers des charges apportées sur les marchés publics de la métropole proviennent donc de producteurs demeurant sur l’île (32,7 %, à quoi nous ajoutons 2,5 % en provenance de l’île Bizard)31. Quinze ans plus tard, la division des marchés du ministère de l’agriculture reconnaît toujours la contribution des producteurs maraîchers de l’île de Montréal, notamment à Saint-Laurent, Sainte-geneviève-de-pierrefonds, Saint-Léonard-de-port-Maurice et Rivière-des-prairies32. Du côté de la production laitière, les fermes de Saint-Joachim-de-pointe-Claire, Sainte-anne-de-Bellevue, Sainte- geneviève-de-pierrefonds et Saint-Léonard-de-port-Maurice continuent d’écouler plus d’un million de livres de lait en nature dans les laiteries de la région du nord de Montréal en 1953. Raoul Blanchard note aussi l’apport des producteurs de pointe-aux-trembles et de Montréal-est, qui bénéficient de grosses terres pesantes, propices à la production de foin pour les fermes à lait. en outre, nombre de laiteries sur le territoire de l’île sont installées à proximité des producteurs, comme à Saint-Laurent, ou à proximité des consommateurs, comme dans Saint-Louis du Mile end33.
au cours de la première moitié du XXe siècle, l’agriculture sur l’île de Montréal s’est fortement spécialisée. en accord avec les tendances de l’agro-économie, que stimulent par ailleurs les gouvernements34, les cultivateurs de chaque division optent pour des cultures maraîchères particulières ou la production laitière. au lendemain de la Seconde guerre, cette spécialisation s’accentue dans les parties sud et ouest de l’île, tandis que, sur le plan spatial, la contribution des divisions du comté d’hochelaga s’amenuise. par ailleurs, avec la croissance de la population dans les secteurs urbains et suburbains, l’industrie agroalimentaire multiplie ses lieux de transformation35, car elle dispose à la fois d’un vaste marché pour écouler ses produits et d’un vaste territoire pour drainer les ressources nécessaires à sa production même si, sur l’île, l’agriculture maintient sa présence tant bien que mal. en effet, une démo-graphie urbaine galopante compromet son développement en prenant d’assaut les terres agricoles encore disponibles dans les divisions du comté de Jacques-Cartier.
La contribution des régions de la plaine de MontréalLes changements dans la structure agraire – territoire et productions
– sur l’île de Montréal posent le problème du nécessaire lieu d’approvisionne-ment en denrées alimentaires pour nourrir une population urbaine et indus-trieuse croissante. Si, pendant une certaine période, des familles ouvrières pouvaient compter sur l’élevage individuel de porcs et de vaches laitières et sur un lopin de terre pour cultiver leurs légumes, la progression de l’appareil réglementaire et du mode de lotissement contribue à évacuer ces pratiques de
Agriculture et société urbaine sur l’île de Montréal 593
la ville-centre36. La population doit alors se tourner vers les marchés publics et une industrie agroalimentaire qui multiplie ses produits ainsi que ses lieux de production et de vente37. Dans ces deux cas, les cultivateurs de la plaine de Montréal suppléent aux insuffisances de la production insulaire, bien que partiellement. ainsi, le ministre de l’agriculture notera en 1930 : « Le marché de Montréal importe en dehors de la province 70 % à 75 % de ses œufs, pour plus de deux millions de dollars de bœufs, pour plus de cinq millions de dollars de porcs et pour plus de deux millions de dollars de chevaux38. » Qu’à cela ne tienne, le paysage agraire des régions environnantes porte l’empreinte de la métropole.
Dès la fin du XIXe siècle, une spécialisation régionale des productions agricoles se met en place dans la plaine de Montréal. Si la ferme laitière domine le paysage agraire, ce dernier ne présente pas pour autant le portrait d’une agriculture homogène. Dans certains comtés très vastes, comme terrebonne ou Missisquoi, des colons avancent sur les fronts pionniers, tirant vers le bas les moyennes agricoles. ailleurs, les cultivateurs trouvent dans les villes améri-caines un marché pour certaines productions – on pense au foin de la vallée du Richelieu et du haut-Saint-Laurent. Mais la plupart d’entre eux bénéficient surtout de la proximité d’un marché urbain en plein essor, en fonction duquel leur production se raffermit et se spécialise dans le temps39. nous illustrerons ce mouvement en examinant la production et les conditions des exploitations dans les comtés de la plaine de Montréal (voir carte 14.2) que nous avons regroupés en six régions : l’est (Verchères, Saint-hyacinthe, Chambly, Missis-quoi, Richelieu et Rouville), le Sud-est (Iberville, Saint-Jean, napierville, Laprairie), le Sud-ouest (huntingdon, Châteauguay, Beauharnois), l’ouest (Vaudreuil, Soulanges), le nord-ouest (L’assomption, terrebonne et Deux-Montagnes)40. À ces regroupements régionaux nous avons ajouté ceux de l’île Jésus et de l’île de Montréal41.
un secteur où se fait fortement sentir la présence d’un marché urbain est celui du lait, aussi bien pour la consommation que pour la transformation. À partir des années 1860, au moment où l’agriculture québécoise entreprend son tournant laitier, nous constatons que la proportion de vaches laitières sur l’île de Montréal ne suit pas les tendances des fermes de la plaine de Montréal (figure 14.10). tandis que le nombre absolu de bêtes sur l’île se maintient ou croît légèrement, leur proportion ne cesse de diminuer dans la plaine, en même temps que le cheptel des régions Sud-ouest et est s’apprécie (tableau 14.6). Cet effacement graduel du troupeau laitier de l’île de Montréal par rapport au cheptel de la plaine de Montréal se produit au moment où la consommation de lait nature augmente abruptement, de pair avec la population42. Les culti-vateurs à proximité de ce marché urbain peuvent y écouler de fortes quantités de lait. Cette diversification passe par le marché du lait de consommation dans
le lait
594 Formation d’une région et naissance d’une métropole, 1796-1930
la ville de Montréal43. parallèlement, le commerce du lait se consolide, avec la multiplication du nombre de laitiers des faubourgs et des paroisses sur l’île de Montréal (quatre fois plus nombreux au tournant du XXe siècle), mais aussi avec l’établissement de grossistes et d’entreprises laitières qui bénéficient d’un réseau ferroviaire drainant vers Montréal la production des cultivateurs de la plaine et de l’ontario44.
* en utilisant les études de Raoul Blanchard et d’yves otis, nous avons groupé les comtés entourant l’île de Montréal en régions pour comparer la division spatiale de la production agricole dans la plaine de Montréal.
Carte 14.2Régions de la plaine de Montréal, en 1871*
Agriculture et société urbaine sur l’île de Montréal 595
Figure 14.10Distribution du cheptel laitier dans la plaine de Montréal
Source : Recensements du Canada, 1851-1951.
Tableau 14.6troupeau laitier moyen, par exploitation, dans les régions de la plaine
de Montréal, 1861-1951
1861 1881 1891 1941 1951
Sud-ouest 3,8 6,0 6,7 14,1 13,7Sud-est 3,8 4,2 3,9 10,0 10,0nord-ouest 4,5 5,0 5,2 8,4 8,9ouest 3,8 4,3 4,6 9,3 8,6est 4,3 5,7 5,5 11,6 11,1Île Jésus 4,9 5,3 5,5 2,9 3,8Montréal 8,3 8,1 7,9 7,4 6,0province 3,1 4,1 4,4 8,1 8,4
Source : Recensements du Canada, 1861, 1881, 1891, 1941, 1951.
596 Formation d’une région et naissance d’une métropole, 1796-1930
L’augmentation de la population urbaine ne fait pas qu’accroître la consommation de lait ; elle participe aussi à la réduction de l’espace agraire et à l’expulsion de certaines activités agricoles à la périphérie de la ville. ainsi, les producteurs de Saint-Laurent, Longue-pointe, Saint-Léonard-de-port-Maurice et Coteau-Saint-Louis étaient fortement actifs dans l’approvisionnement de la ville en lait nature en 1891, fournissant plus de la moitié du volume consommé. en 1924, alors que la population de la ville a presque triplé, la contribution des producteurs de l’île dans son ensemble équivaut à « un soixantième de la consommation quotidienne », évaluée à près de 60 000 gallons45. un portrait compilé à la fin des années 1930 atteste également de la propension moindre des cultivateurs dans l’environnement immédiat de la cité de Montréal – y compris sur l’île de Montréal – à s’adonner à la production laitière, car la production maraîchère s’avère plus lucrative46. toutefois, dans les régions est, Sud-est, Sud-ouest, ouest et nord-ouest, la majorité des producteurs trou-vent leur principale source de revenus dans l’expédition de lait nature.
L’emprise de la ville sur le paysage agricole de la plaine se répercute également sur la composition du cheptel laitier. en effet, face aux exigences du Service de santé de la cité de Montréal, seuls les agriculteurs bien établis peuvent s’adonner à ce commerce avec la métropole. Depuis 1910, les inspec-teurs de la ville responsables de l’inspection du lait et des fermes ont le pouvoir d’agir sur toutes les exploitations qui expédient du lait à Montréal47. L’adoption de règlements sur les recommandations du commissaire à l’hygiène de la ville de Montréal a une incidence sur la pratique agricole dans les environs de l’île, à tout le moins pour les agriculteurs qui s’y conforment. C’est notamment le cas des producteurs laitiers de Châteauguay, Deux-Montagnes et Sainte-Rose,
Le propriétaire de ferme laitière de Sainte-Rose
participe au concours du Mérite agricole en 1940. Le lait nature que produit cette ferme est écoulé à Montréal.(Rapport du concours du Mérite
agricole, 1940, p. 70)
Agriculture et société urbaine sur l’île de Montréal 597
sur l’île Jésus, qui doivent rebâtir leur troupeau laitier une fois éliminés les éléments tuberculeux. Si certains y décèlent une forme de concurrence indue de la part des producteurs laitiers de Montréal48, il faut comprendre que le marché urbain commande pareils changements en région.
Comme pour le lait nature, l’horticulture offre des bénéfices appré-ciables, à condition d’avoir un fort marché à proximité. La présence de lieux de villégiature que fréquente une frange aisée de la population urbaine fournit également un marché pour les horticulteurs, à Vaudreuil à l’ouest, et à terre-bonne au nord49. tandis que les superficies maraîchères de la plaine de Montréal augmentent leur contribution à l’ensemble québécois, passant de 81 % à 87 % entre 1921 et 1951, la part des superficies maraîchères de l’île de Montréal à la plaine de Montréal rétrécit. Ces pertes relatives, qui, comme l’accroissement absolu des superficies, se produisent également sur l’île Jésus s’expliquent par un accroissement des superficies maraîchères ailleurs, surtout dans l’est, le sud-est et le sud-ouest de la plaine de Montréal (tableau 14.7).
Tableau 14.7Superficie des vergers, en acres, sur la plaine de Montréal, et contribution
à la superficie agricole de chaque région, en pourcentage, 1921-1951
1921 1931 1941 1951
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Sud-ouest 2 645 21,5 3 494 21,6 3 399 21,2 4 655 22,5Sud-est 2 425 19,7 1 961 12,1 1 569 9,8 2 053 9,9nord-ouest 1 195 9,7 2 447 15,1 1 946 12,2 2 408 11,6ouest 652 5,3 496 3,1 200 1,3 279 1,4est 4 143 33,6 6 626 40,9 8 320 51,9 10 886 52,6Île Jésus 294 2,4 255 1,6 168 1,1 139 0,7Montréal 976 7,9 925 5,7 421 2,6 259 1,3
Source : Recensements du Canada, 1851-1951.
enfin, la culture des gros fruits devient principalement le fait des régions de l’est et du Sud-ouest. Sur la plaine, les superficies des vergers augmentent presque partout, mais principalement dans le comté de Rouville (tableau 14.7). Dans le Sud-est et dans les îles de Montréal et Jésus, les super-ficies augmentent, sans toutefois permettre à ces régions d’accroître leur contribution à l’ensemble de la plaine. Il faut ajouter que ces régions sont tournées principalement vers la culture maraîchère.
les frUits et les légUmes
598 Formation d’une région et naissance d’une métropole, 1796-1930
au cours de la période étudiée, nous assistons à une spécialisation et une régionalisation des productions agricoles dans la plaine de Montréal, ce que confirme l’examen des types de fermes selon le principal revenu en 1940 (figure 14.5). Les productions de gros fruits et de lait qui déclinent sur l’île s’installent à la périphérie, et se consolident là où elles sont déjà importantes. Il en va de même de la culture du foin et des pâturages qui accompagnent l’intensification de l’élevage et de la production laitière50. Si, dans des comtés comme Saint-hyacinthe ou Missisquoi, la production laitière approvisionne un marché local richement doté en lieux de transformation, d’autres régions en font leur spécialité pour desservir plutôt la population montréalaise. De même, dans certains comtés dont le sol est particulièrement propice à l’horti-culture, que ce soient les terres noires de Laprairie ou les terres sablonneuses du Richelieu, la production maraîchère stimule l’essor de conserveries qui, elles aussi, visent le marché urbain de la métropole51. Dans cet ensemble, l’agricul-ture sur l’île de Montréal semble participer aux grandes tendances caractéris-tiques des agricultures de la plaine, mais avec un léger décalage qui découle de productions autrefois présentes sur son territoire et maintenant reléguées à la périphérie.
L’encadrement de l’agriculture sur l’île de MontréalBénéficiant de conditions pédoclimatiques favorables et de la proximité
d’un marché urbain en pleine expansion, l’agriculture sur l’île de Montréal s’avère un terreau favorable à l’émergence d’une série d’organisations agricoles vouées à l’amélioration des pratiques agricoles et à la promotion des intérêts des cultivateurs et des éleveurs. La multiplication de ces organisations provient de la spécialisation des producteurs et des techniques de production, épaulée par des savoirs agronomiques constamment revus et institutionnalisés, de la préséance du parc hippomobile de la métropole canadienne, ainsi que de la commercialisation poussée des produits de l’agriculture et de la formation d’une pléiade de coopératives desservant initialement les producteurs de l’île, mais intégrant rapidement ceux des régions avoisinantes au fur et à mesure de l’épuisement de l’agriculture montréalaise.
La Société d’agriculture du district de MontréalLa Société d’agriculture du district de Montréal est créée en 1817,
dans la foulée du rapport du comité spécial sur les affaires agricoles de l’assem-blée du Bas-Canada, de 181652. À cette époque, ce genre d’institution n’existe que dans les districts de Québec et de trois-Rivières ailleurs au Bas-Canada. Les sociétés d’agriculture reçoivent des subventions du gouvernement qu’elles
Agriculture et société urbaine sur l’île de Montréal 599
utilisent principalement pour organiser des expositions et des foires agricoles, ainsi que pour remettre des prix lors de concours. À l’occasion, elles achètent et distribuent des instruments aratoires, des semences et des animaux de race pour améliorer l’agriculture. Si ces organisations chapeautent quelques sociétés auxiliaires implantées dans les comtés en milieu rural, leur composition est à l’image du milieu urbain dont elles émergent : des hommes d’affaires et des marchands qui possèdent des fermes en bons propriétaires terriens mais qui, pour la plupart, n’entendent rien, ou si peu, à l’agriculture. Leur vision des productions du sol est essentiellement mercantile, et rares sont ceux qui mani-festent une quelconque affinité pour l’agriculture53. Il existe bien sûr des exceptions, et ce sont ces individus qui portent le flambeau de la science agronomique. parmi ceux-ci, un des membres de la Société d’agriculture du district de Montréal se distingue et, dans la première moitié du XIXe siècle, agit comme un de grands éducateurs agricoles de la métropole et de la province : William evans.
D’origine irlandaise, William evans arrive à Montréal en 1819 et s’installe à Côte-Saint-paul, où il cultive une exploitation agricole de 150 acres, une superficie imposante à l’époque. Cette exploitation devient, aux yeux de contemporains, une « ferme modèle », dont les principales sources de profit sont l’élevage animal et les graines de semence. en tant que secrétaire-trésorier de la Société d’agriculture du district de Montréal à compter de 1830 (il occu-pera les mêmes fonctions à la Société d’agriculture du Bas-Canada en 1847, puis à la Chambre d’agriculture du Bas-Canada en 1852), il assiste les juges lors de concours pour l’inspection des cultures aux champs. Son travail de propagandiste vise à encourager l’abandon des pratiques routinières et des cultures, comme celle du blé, qui confineraient l’agriculteur à la misère, tout en cherchant l’adoption de techniques pour mettre à profit l’ensemble des ressources de la ferme, par l’amélioration des techniques de drainage et de gestion du fumier, par exemple. evans rédige un traité sur la théorie et la pratique de l’agriculture qui paraît en anglais en 1835, puis en français en 1836 grâce à une subvention de l’assemblée. Il publie également des chroniques dans des journaux comme la Montreal Gazette, avant de fonder ses propres revues agricoles, dont le Canadian Agricultural Journal, qui paraît sous divers titres et de façon irrégulière à partir de 1843. Ses diagnostics sur les problèmes de l’agriculture bas-canadienne et ses pistes de solution, evans les réitérera dans les années précédant sa mort, lors des audiences du comité spécial sur l’état de l’agriculture dans le Bas-Canada et dans son Review of the agriculture of Lower Canada, with suggestions for its amelioration. après la mort d’evans en 1856, sa ferme Broadlands sera transformée en pépinière d’arbres fruitiers54.
ardent partisan du journalisme agricole, evans déprécie le mode traditionnel et populaire de diffusion de la connaissance agricole : l’exposition.
William evans, Un propagandiste agricole
600 Formation d’une région et naissance d’une métropole, 1796-1930
Il reproche à ce type de manifestation et aux concours qui s’y tiennent leur caractère élitiste, car ils se soldent ordinairement par la victoire des mêmes individus aisés, année après année, au détriment de l’éclairage de la masse paysanne. evans doit se résigner à faire vivoter ses expériences éditoriales, pendant que florissent les expositions agricoles dans le district de Montréal. De plus, la création de la Chambre d’agriculture du Bas-Canada en 1852 est suivie de l’organisation d’une exposition agricole provinciale dont la première se tient dans la cité de Montréal sur le domaine de la Montagne du Séminaire des Sulpiciens en 1853. entre 35 000 et 45 000 personnes foulent le terrain de l’exposition pour examiner les bêtes et les céréales qui y sont exposées, ainsi que pour assister aux nombreuses attractions comme la procession aux flam-beaux, les feux d’artifice et les balles. L’exposition provinciale revient à Montréal en 1857 et en 1859, après avoir visité Québec, Sherbrooke et trois-Rivières, sans toutefois y avoir attiré les exposants et les foules en nombre aussi impor-tant que dans la métropole ; elle se tiendra à Montréal à quatre autres reprises dans les années 1860. À partir 1870, l’exposition agricole de Montréal dispose d’un terrain permanent, à cheval sur les territoires de la cité de Montréal, de Saint-Jean-Baptiste et de Saint-Louis du Mile end, après que le Conseil d’agri-culture de la province de Québec eut acquis une terre des sœurs de l’hôtel-Dieu au pied du mont Royal. C’est sur ce site qu’est transposé en 1878 le palais de cristal, la reproduction d’une structure construite à Londres lors de l’exposition universelle de 1851, et que l’élite montréalaise avait jugé approprié de bâtir sur le terrain du Mcgill College pour la visite du prince de galles en 1860. Bénéficiant notamment de leur jumelage à un événement d’envergure nationale, l’exposition agricole et industrielle de la puissance du Canada en 1880 et 1884, les expositions à Montréal disposent d’un site et d’édifices permanents à compter de 1880. Si les organisateurs tentent de leur donner une couleur de plus en en plus industrielle, et de moins en moins agricole, les visiteurs et les exposants semblent en décider autrement et obligent les organisateurs à accorder aux sections industrielle et agricole de l’exposition une envergue équivalente. Ces expositions sont l’occasion pour des éleveurs montréalais comme James Logan et les Dawes de Lachine de rivaliser avec des éleveurs de l’ontario. L’épidémie de variole de 1885 force l’interruption des expositions qui reprennent en 1890, mais sous la responsabilité d’organisations privées. La tenue de l’événement provincial cesse après qu’un incendie eut détruit des édifices et le site de l’expo-sition en 189755.
D’autres organisations associatives offrent sur une base annuelle des foires commerciales et des concours. notamment, la Société d’horticulture de Montréal qui organise une exposition annuelle, ordinairement au Victoria Skating Rink, semble devenir la principale raison d’être de cette association fondée en 184756. Si la fréquentation de cet événement diminue lors de la
la société d’horticUltUre
de montréal
Agriculture et société urbaine sur l’île de Montréal 601
tenue simultanée de l’exposition provinciale, il demeure que la durée de vie de l’exposition horticole dépassera celle des expositions organisées par les sociétés agricoles ou le Conseil d’agriculture du Québec. entre autres, l’exposition horticole est l’occa-sion de faire connaître de nouvelles variétés créées par des professionnels améliorateurs et des horticulteurs amateurs qui y présentent, outre les fruits de vergers, des fleurs coupées et des plantes cultivées en serre. en 1895, la société crée une section composée d’écoliers pour promouvoir une meilleure connaissance de la culture des fleurs dans la cité de Montréal. elle invite les enfants à présenter leurs fleurs et à concourir lors de l’exposition horticole annuelle. Les plantes exposées par les enfants étaient au nombre de 700 en 1897, et le succès de cette activité mène la société à encourager les instituteurs à travailler à l’embellissement du terrain de leur école et à y tenir un jardin maraîcher. une autre initiative de la société qui vise le grand public et le paysage montréalais est la création du Montreal Botanic garden association en 1885 ; la société fait alors pression sur la Cité de Montréal et les commissaires du parc du Mont-Royal pour l’im-plantation d’un jardin botanique et d’un arboretum sur la montagne57.
en 1878, après avoir obtenu une charte du gouvernement provincial pour étendre son rayonne-ment à la grandeur du Québec, la nouvelle association, la Société d’horticulture de Montréal et l’association des horticulteurs fruitiers de la province de Québec, chapeaute une série d’associations locales spécialisées dans la production fruitière, tout en continuant de promouvoir les intérêts immédiats de sa communauté montréalaise, qui se compose, outre de membres de l’élite économique et scientifique – elle tient régulièrement ses assemblées dans les locaux de la Société d’histoire naturelle de Montréal –, des producteurs horticoles, maraîchers et fruitiers, tant chez les francophones que les anglophones58. plusieurs d’entre eux sont fortement actifs dans la promotion des intérêts de leurs secteurs, en même temps qu’ils souhaitent, par l’entremise de ces associations, participer au développement de la connaissance agronomique, et non seulement à la diffusion de cette connaissance. aussi les horticulteurs et les pomologistes, en plus d’exposer
affiche publicitaire de la grande exposition agricole et industrielle de la puissance qui se tient à Montréal entre le 5 et le 13 septembre 1884.(Musée McCord d’histoire canadienne, M977X.56)
602 Formation d’une région et naissance d’une métropole, 1796-1930
leurs produits, échangent sur les techniques de production par l’organisation de conférences et la publication d’un rapport annuel où sont consignées les communications techniques sur la production fruitière et maraîchère, ainsi que sur les affaires de la société dont le nombre de membres atteint 894 en 1889, avant de tomber à 414 en 1895. Cette année-là, des pressions de l’inté-rieur visent à scinder l’organisation et à ne réunir que les associations locales de producteurs fruitiers, abandonnant la Société d’horticulture de Montréal à son sort. Si cette dernière se retrouve effectivement isolée, une série d’organi-sations locales dispersées sur l’île de Montréal viendra l’épauler, en commençant par la Lachine horticultural Society (aussi connue sous le nom de Société d’horticulture de Jacques-Cartier, avec 297 membres en 1927) en 1900. D’autres suivront : la Montreal West horticultural and agricultural Society de Montréal-ouest (fondée en 1909, avec 258 membres en 1927), la Verdun horticultural Society (fondée en 1915, avec 215 membres en 1927), la Sainte-anne-de-Bellevue horticultural association (fondée en 1916, avec 220 membres en 1927), la Back River horticultural Society de Montréal-nord (fondée en 1920, avec 162 membres en 1927), la horticultural Society of the town of Mount-Royal (fondée en 1924). Quant à l’association des horticul-teurs fruitiers, aussi désignée association de pomologie et culture fruitière de la province de Québec, elle demeure à Montréal jusqu’à ce que son président, W. W. Dunlop, d’outremont, soit remplacé par peter Reid, de Châteauguay, en 1906.
Les sociétés d’agriculture de comté et les cercles agricoles de paroisseÀ la Confédération, trois sociétés de comté chapeautent les activités
des agriculteurs de l’île de Montréal ; à la Société d’agriculture de Montréal s’ajoutent deux sociétés pour les comtés d’hochelaga et de Jacques-Cartier. La Société d’agriculture de Montréal devient la Société d’agriculture et d’horti-culture de Montréal, pour être désignée en 1878 la Société d’horticulture de Montréal et l’association des horticulteurs fruitiers de la province de Québec. Comme pour la précédente société de district, ces sociétés sont dirigées par des individus bien en vue, tels les hommes d’affaires alexander Walker ogilvie et Louis Beaubien ; homme politique, ce dernier est également membre du Conseil d’agriculture entre 1869 et 1886, puis commissaire de l’agriculture et de la Colonisation entre 1892 et 1897. tandis que la Société de Montréal restreint ses activités à l’horticulture, comme le reflète sa nouvelle dénomina-tion, les deux sociétés de comté maintiennent des activités similaires à celles de la Société de district qui les précédait, soit la tenue d’expositions et de concours, ainsi que l’octroi de prix pour des semences, des bêtes « bonnes et fortes » et des instruments aratoires perfectionnés. un ensemble d’activités
les sociétés d’agricUltUre
Agriculture et société urbaine sur l’île de Montréal 603
tourne autour du bétail comme l’importation d’animaux de race pour l’amé-lioration du cheptel59. Il s’agit là d’une priorité pour le Conseil d’agriculture qui cherche à renouveler et à renforcer le cheptel québécois par l’octroi de subventions et diverses formes d’encouragement financier auprès des organi-sations agricoles. À cet effet, Louis Beaubien fonde la Compagnie nationale du haras qu’il exploite avec son gendre Raymond-auzias turenne depuis sa ferme à outremont. La compagnie fonctionne entre 1889 et 1893 et jouit de subventions des gouvernements provincial et fédéral, intéressés par l’amélio-ration des races chevalines au Québec, que Beaubien et turenne cherchent à écouler auprès des organisations locales, des sociétés d’agriculture ou des cercles agricoles60.
Reflet de l’intensité de la production agricole du territoire qu’elle dessert, la Société d’agriculture du comté d’hochelaga est mieux dotée initia-lement, tant en ce qui concerne le nombre de membres que l’argent, que la Société d’agriculture du comté de Jacques-Cartier. Cette dernière tient peu fréquemment des expositions, mais organise des concours dans les paroisses, puis dans le comté, pour les fermes les mieux tenues. elle offre également les services d’un étalon percheron qui donne « de bons et beaux élèves » et distribue des graines de mil61. en cela, son champ d’action s’apparente à celui des sociétés ailleurs dans la province, davantage que ce n’est le cas pour la Société d’agri-culture du comté d’hochelaga. Celle-là tient de façon régulière des compétitions
exposition horticole et agricole au Victoria Skating Rink, 1871.(« The horticultural exhibition in the Victoria Skating Rink, Montreal », Canadian Illustrated News, 30 septembre 1871, p. 212. Bibliothèque et archives nationales du Québec, peR C582)
604 Formation d’une région et naissance d’une métropole, 1796-1930
d’étalons et des partis de labour, et met au concours, outre les animaux sur pied et les manufactures domestiques, des grains et des graines ainsi que des racines. Ses concours jouissent d’une forte visibilité et prennent place lors d’une grande exposition annuelle, pour laquelle elle se dote de bâtiments permanents, ou sur la place du marché à foin, dans la cité de Montréal62.
Fer de lance de la modernisation de l’agriculture québécoise orchestrée notamment par le directeur de l’agriculture du Département de l’agriculture et des travaux publics de la province de Québec, édouard-andré Barnard, les cercles agricoles exercent une influence limitée sur l’île de Montréal, particu-lièrement dans le comté d’hochelaga63. Institutionnalisés en 1893 par le ministère de l’agriculture en échange de son soutien financier, les cercles existent depuis les années 1850 d’abord dans les cantons de l’est, avant de se répandre dans les paroisses du reste de la province. Barnard y voit une façon simple et efficace d’atteindre la masse des agriculteurs que marginalisent, par leur fonctionnement et leur composition élitiste, les sociétés d’agriculture de comté. Fortement appuyé par le curé local qui y tient une place d’office, le cercle agricole devient la structure d’encadrement par excellence en milieu rural. Sur l’île de Montréal, par contre, on en dénombre peu, et la plupart ne survivent pas une année. Dans le comté d’hochelaga, il n’y a que le cercle de la paroisse de Saint-Joseph-de-la-Rivière-des-prairies qui demeure en activité quelques années – il était d’ailleurs le seul lors de sa première année d’existence à utiliser l’aide gouvernementale pour acheter des animaux reproducteurs, les autres se contentant de cette somme pour distribuer des prix. Le nombre de ses membres oscille annuellement autour de 42 entre 1897 et 1911 (la paroisse comptait 74 exploitants de plus de 10 acres en 1891). Sauf pour le cercle de la paroisse de Saint-François-d’assise-de-Longue-pointe disparu en 1895, les cercles agricoles des paroisses de L’enfant-Jésus-de-pointe-aux-trembles et de Saint-Léonard-de-port-Maurice n’existent que l’année de leur création, en 1894 ; la même année, le cercle de la paroisse de la Visitation-du-Sault-au-Récollet créé en 1893 met également fin à ses activités. Dans le comté de Jacques-Cartier, les cercles agricoles s’installent en 1895, un an plus tard que dans le comté d’hochelaga, mais ils y demeurent plus longtemps, sauf dans la paroisse de Sainte-anne-de-Bellevue, dont le cercle disparaît en 1900 (34 membres), et à Saraguayville, dont le cercle est en fonction seulement l’année de sa création, en 1905. Dans les paroisses de Sainte-geneviève-de-pierrefonds et de Saint-Raphaël-de-l’Île-Bizard, les cercles agricoles perdurent jusqu’en 1912, malgré des débuts hésitants, avec respectivement une moyenne annuelle de 100 et 102 membres. C’est d’ailleurs dans ces deux paroisses que nous assistons à la naissance de cercles de fermières sur l’île de Montréal dans les années 1940.
les cercles agricoles
Agriculture et société urbaine sur l’île de Montréal 605
Dernier indice de la présence de ce type d’ins-titution d’encadrement : le taux de participation des agriculteurs à leur société de comté. en 1871 et 1881, les taux sont respectivement de 30,2 % et 32,1 % dans le comté d’hochelaga, et de 19,8 % et 21,5 % dans le comté de Jacques-Cartier. en 1891, le taux de participation atteint 41,8 % dans chaque comté. La seule donnée disponible pour le XXe siècle pour le comté d’hochelaga est celle de 1921, où moins d’un agriculteur sur cinq (19,1 %) est membre de la société d’agriculture. pour la Société d’agricul-ture du comté de Jacques-Cartier, ce taux oscille autour de 48,0 % en 1901 et 1911, avant de descendre à 36,1 % en 1921. Compte tenu qu’en 1880 ce taux atteignait 32,1 % dans le comté de Jacques-Cartier et 21,5 % dans le comté d’hochelaga, force est de constater que l’activité des institutions d’encadrement suit les variations du paysage agricole décrites dans la section précédente.
Les regroupements coopératifsau XXe siècle, le milieu coopératif
agricole québécois est marqué par la fondation de la Coopérative fédérée de Québec en 1922. À la base de la Fédérée se trou-vent deux sociétés coopératives qui ont pignon sur rue à Montréal (la troisième est la Société coopérative des producteurs de semences de Sainte-Rosalie, créée en 1915). La première, la Société coopérative agricole des fromagers de Québec, établit ses bureaux et ses premiers entrepôts sur la rue William. Sous l’impul-sion de la Société d’industrie laitière du Québec et de la Chambre de commerce de Montréal, qui contrôle le marché des produits laitiers destinés à l’exporta-tion, elle est responsable de la vente de fromage classifié par les inspecteurs du ministère. La société devient la Coopérative centrale des agriculteurs de Québec en 1920 et, grâce à l’instauration d’un système de classification des produits laitiers par son gérant, auguste trudel, elle parvient a rétablir la réputation du fromage du Québec sur le marché britannique, alors que, depuis quelques décennies, des producteurs québécois n’hésitaient pas à apposer l’étiquette « ontario » sur leurs fromages pour éviter l’opprobre. La seconde société, le Comptoir coopératif de Montréal, s’installe sur la rue Saint-Jacques où ses membres peuvent profiter de la présence d’un grand marché urbain pour
La Montreal Fruit auction Company, lieu où se fait l’enchère des grosses cargaisons de fruits. Rue de la Montagne, 1912.(Bibliothèque et archives nationales du Québec, Centre d’archives de Montréal, Collection é.Z. Massicotte, p750, album 3112e)
606 Formation d’une région et naissance d’une métropole, 1796-1930
acquérir le matériel de production à bon prix et écouler leur produit – le Comptoir distribue le lait dans certains quartiers de Montréal à partir de 1916. parmi les autres coopératives qui joindront la Fédérée, l’association des jardi-niers maraîchers de Québec marquera le paysage montréalais. elle est créée à Côte-des-neiges en 1909, et ses 43 membres fondateurs résident tous sur l’île de Montréal. Deux ans après sa fondation, l’association comprend 135 membres, dont 26 proviennent de l’extérieur de l’île. L’association compte 815 membres en 1927, et s’occupe des achats de pommes de terre de semence, de graines de légumes, d’engrais chimiques. elle joint la Fédérée en 1931, mais s’en détache en 1944 pour devenir l’association des jardiniers maraîchers de Montréal64. Devant la congestion sur les lieux du marché Bonsecours, elle voit à la construction d’un grand marché central de fruits et de légumes à Montréal par l’entremise de la Compagnie du marché central métropolitain qu’elle fonde au lendemain de la Seconde guerre mondiale65.
À sa fondation, la Coopérative fédérée installe son siège social à Montréal, et un entrepôt de fruits et légumes sur la rue de la Montagne. elle est très active dans le commerce des animaux vivants. À pointe-Saint-Charles, où le Canadien national a ses parcs à bestiaux, elle vend les bêtes que lui expédient des agriculteurs de la province66. elle y ouvre aussi une succursale pour offrir à ses membres des semences et des engrais minéraux. À partir de 1934, elle exploite un moulin et des élévateurs à grain à Saint-henri, en bordure du canal de Lachine, où elle tente d’implanter un système de fabrication de moulées. outre la vente de bétail sur pied, la principale activité de la Fédérée est celle des produits laitiers. elle reprend la laiterie du Comptoir coopératif, mais fait de la distribution de lait nature une activité secondaire. en 1929, la Fédérée vend sa laiterie à la Coopérative de lait et de crème de Montréal, et devient gestionnaire de cette dernière ; elle s’en départit en 1944. elle doit aussi composer avec la principale coopérative dans ce secteur : la Montreal Milk producers association, créée en 1918. Fort de la présence de 956 membres en 1921 (ils sont 1 101 en 1937), ce regroupement rejoint principalement des producteurs laitiers anglophones des comtés de huntingdon, Châteauguay, Beauharnois, Vaudreuil, d’argenteuil, ainsi que de l’est de l’ontario. La Montreal Milk producers association serait responsable de 60 % l’approvi-sionnement en lait nature de la cité de Montréal lorsqu’éclate la crise de surproduction du lait, après l’instauration de tarifs douaniers par les états-unis en 1930. À la même époque, des producteurs laitiers de Montréal et de ses environs, majoritairement francophones et qui se détournent des beurreries et des fromageries pour écouler leur production, fondent l’association des producteurs laitiers de la province de Québec, avec près de 3 000 membres. L’existence éphémère de cette association – elle disparaît au début des années 1930 – témoigne des turbulences agitant le monde coopératif laitier pour approvisionner le marché montréalais durant l’entre-deux-guerres67.
la coopérative fédérée
Agriculture et société urbaine sur l’île de Montréal 607
L’enseignement vétérinaire et les écoles d’agricultureComme tout centre urbain, Montréal est le site de nombreuses insti-
tutions d’enseignement supérieur. À une époque où les frontières entre la ville et la campagne sont fort ténues, les universités en milieu urbain offrent une formation en agriculture. Il faut également reconnaître que la forte présence des chevaux en ville encourage la formation de vétérinaires. aussi, dans la seconde moitié du XIXe siècle, la cité de Montréal accueille plusieurs écoles vétérinaires qu’abritent l’université Mcgill et la succursale montréalaise de l’université Laval.
La première à voir le jour est l’œuvre d’un grand scientifique canadien d’origine écossaise, Duncan Mcnab Mceachran, qui fonde le Montreal Vete-rinary College en 1866, avec l’appui du recteur du Mcgill College, John William Dawson68. Situé au coin de la rue Craig et de la rue De Bleury, puis déménagé dans un nouvel édifice au coin de l’avenue union et de la rue Dorchester, le Montreal Veterinary College offre une formation scientifique très poussée et acquiert rapidement une excellente réputation, accueillant des étudiants de par le monde. en 1877, le Conseil d’agriculture accorde une
Jour de marché à la place Jacques-Cartier, 1923-1926.(Musée McCord d’histoire canadienne, Mp-1984.105.28)
les écoles vétérinaires
608 Formation d’une région et naissance d’une métropole, 1796-1930
subvention à Mceachran pour mettre en place une section francophone avec deux diplômés de son école, orphir Bruneau et Joseph alphonse Couture. après le départ de Couture qui devient vétérinaire inspecteur pour le Conseil d’agriculture, le gouvernement provincial décide de remplacer le Montreal Veterinary College par deux écoles vétérinaires à Québec et à Montréal. en 1885, des professeurs de la section française du Montreal Veterinary College, orphir Bruneau et Victor-Théodule Daubigny, un autre diplômé de cette institution, fondent l’école de médecine vétérinaire de Montréal, affiliée à la Victoria university de Cobourg en ontario. L’année suivante, Daubigny abandonne ce projet pour créer l’école vétérinaire française de Montréal, rattachée à l’université Laval. Les écoles vétérinaires anglophone et francophone de Montréal évoluent parallèlement par la suite. Le Montreal Veterinary College devient la Faculté de médecine comparative et de science vétérinaire de l’uni-versité Mcgill en 1889, avant de fermer ses portes en 1903. pour Mceachran, la présence des nouveaux modes de transport mus par des moteurs électriques, comme le tramway, décroît l’intérêt pour les chevaux et détourne les jeunes de la profession de vétérinaire. Cette situation sera exacerbée durant l’entre-deux-guerres et influe sur le sort de l’enseignement vétérinaire francophone à Montréal. Les deux écoles francophones ont fusionné en 1893 pour former deux ans plus tard l’école de médecine comparative et de science vétérinaire de Montréal, toujours située au cœur de la cité. D’abord installée sur la rue Craig, l’école occupe un nouvel édifice au coin des rues Saint-hubert et
Montreal Veterinary College, 1875.
(Musée McCord d’histoire canadienne, M979.87.400)
Agriculture et société urbaine sur l’île de Montréal 609
Demontigny. après un court séjour entre 1928 et 1947 dans Deux-Montagnes pour l’enseignement vétérinaire de l’école d’agriculture d’oka, elle déménage à Saint-hyacinthe en 1947 et devient, deux ans plus tard, l’école de médecine vétérinaire du Québec affiliée à l’université de Montréal69.
outre l’école d’agriculture d’oka, fondée en 1893, et qui offre à partir de 1911 le baccalauréat en sciences agricoles sous l’égide de la succursale montréalaise de l’université Laval, l’université Mcgill offre une formation en sciences agricoles dans un collège situé sur le territoire même de l’île de Montréal, à Sainte-anne-de-Bellevue. Le Macdonald College porte le nom de son fondateur philanthrope, le magnat du tabac William Christopher Macdo-nald. Sa création s’inscrit dans un mouvement promu par Macdonald et James Wilson Robertson, chef de la Division de l’agriculture de la Direction des fermes expérimentales et commissaire de l’industrie laitière du Dominion, au tournant du XXe siècle. Macdonald et Robertson travaillent à l’amélioration de la qualité de l’éducation en milieu rural, notamment par la consolidation des écoles de campagne et par un enseignement axé sur l’apprentissage manuel et l’étude de la nature. Macdonald finance la création d’établissements – les instituts Macdonald – pour former des instituteurs et des institutrices en histoire naturelle, en économie domestique et en arts mécaniques, d’abord à guelph, sur le campus du Collège d’agriculture de l’ontario, en 1904, puis, l’année suivante, dans l’ouest de l’île de Montréal pour desservir la population rurale anglophone au Québec. De ce projet naît le Macdonald College qui comprend une école d’agriculture, une école d’économie domestique et un institut Macdonald pour la formation des instituteurs. avec Robertson à sa tête en tant que principal, le collège ouvre ses portes en novembre 1907 et accueille 215 étudiants. Quarante ans plus tard, au lendemain de la Seconde guerre mondiale, ils sont plus de huit cents inscrits. entre 1907 et 1952, 11 192 étudiants auront fréquenté la seule école d’agriculture qui aura acquis rapidement une réputation enviable à l’échelle mondiale, notamment avec la création d’une faculté d’études supérieures et des programmes de deuxième cycle en 1920 et de troisième cycle en 1922, ainsi que des diplômés disséminés dans le milieu agricole en amérique du nord et dans l’empire britannique, au sein d’agences gouvernementales ou d’institutions d’enseignement. Ses professeurs jouent un rôle d’animation scientifique dans la communauté agri-cole, anglophone et francophone, de la plaine de Montréal et dans la commu-nauté savante québécoise. entre autres, William Lochhead, professeur d’entomologie, crée la Société pour la protection des plantes et des arbres de la province de Québec en 1908, qui rassemble des naturalistes intéressés par la prévention des infestations d’insectes nuisibles à l’agriculture et à la forêt. Le même Lochhead veille à la publication de l’édition anglophone du pério-dique mensuel du ministère provincial de l’agriculture, le Journal d’agriculture
le macdonald college
610 Formation d’une région et naissance d’une métropole, 1796-1930
et d’horticulture de la province de Québec, entre 1908 et 1920, puis est remplacé par le professeur hodgins jusqu’en 1936, quand le ministère met un terme à cette publication. grâce au financement de l’empire Marketing Board, du Conseil national de la recherche du Canada et du ministère de l’agriculture du Québec, le collège Macdonald accueille également en 1932 l’Institut de parasitologie pour combler les besoins des dominions et des colonies de l’empire britannique70. Malgré l’effacement de l’agriculture sur l’île de Montréal, le collège Macdonald, devenu la Faculté des sciences agricoles et environnementales de l’université Mcgill en 1992, demeure la vitrine inter-nationale de l’agriculture de l’île de Montréal.
* * *
avant de s’effacer dans le dernier quart du XXe siècle, l’agriculture sur l’île de Montréal se transforme, mue par deux tendances : la modernisation de l’agriculture québécoise et l’accélération de l’urbanisation qui, avant de repousser la production agricole à la marge, offre un marché pour certaines cultures que les producteurs locaux ont tout avantage à adopter. Les transfor-mations conséquentes des pratiques agricoles se répercutent sur la taille et le contenu des emblavures ainsi que sur les cheptels qui composent le paysage, avec des glissements de production vers les parties sud et ouest de l’île, ainsi que la concentration de cultures et d’élevages dans certains districts. elles s’inscrivent dans une dynamique spatiale analogue dans la plaine de Montréal, où les comtés qui la composent se divisent le travail agricole et les productions
Le collège Macdonald, situé à Sainte-anne-de-Bellevue, fut fondé en 1905 grâce au
soutien du philanthrope William Macdonald, un
industriel dans le domaine du tabac.
(archives de l’université Mcgill, pa003761)
Agriculture et société urbaine sur l’île de Montréal 611
en fonction de leurs possibilités agrosystémiques et des transformations de l’agriculture au Québec.
L’histoire de l’agriculture sur l’île de Montréal se lit non pas comme un long déclin ou un abandon graduel à la marge, mais plutôt comme une transformation de pratiques d’occupation du sol et une réinvention de rapports à un environnement agricole façonné par l’activité humaine. elle indique également comment la société urbaine accroît son emprise sur des terres parmi les plus fertiles d’un territoire déjà limité dans ses capacités de production, coincé entre les affleurements rocheux précambriens du Bouclier canadien et les escarpements appalachiens, non moins impropres à la pratique agricole. La société urbaine a néanmoins fortement contribué à entretenir une proximité entre la ville et la campagne sur l’île de Montréal. en témoigne la forte parti-cipation des Montréalais à des organisations agricoles, notamment les associa-tions et les institutions fondamentalement orientées vers l’élaboration et la diffusion de techniques de production. Mais c’est surtout le vaste marché que la population urbaine crée qui oriente les productions agricoles et les modes d’utilisation du sol dans le milieu rural sur l’île, à l’extérieur du périmètre immédiat de la ville de Montréal. Bien sûr l’agriculture cède constamment du territoire à la ville, en même temps qu’elle fait plus sur ce qu’il lui reste par la production intensive de cultures à haute valeur ajoutée. néanmoins, cet examen des rapports ville-campagne où se composent et se recomposent des hinterlands montre que la production et la consommation urbaine de denrées alimentaires marquent l’espace urbain autrement que par le seul empiètement territorial.
1442 Histoire de Montréal et de sa région
autres, dir., Les travailleurs québécois 1851-1896, op. cit., p. 132.
64. Bryan D. Palmer, Working-Class Experience : Rethinking the History of Canadian Labour, 1800-1991, Toronto, McClellet and Stewart, 1992, p. 142.
65. Hamelin, Larocque et Rouillard, Répertoire des grèves dans la province..., op. cit., p. 90-97, 124-125.
66. Jacques Bernier, « La condition des travailleurs, 1851-1896 », dans Noël Bélanger et autres, dir., Les travailleurs québécois 1851-1896, op. cit., p. 44-45.
Chapitre 14 : agriculture et société urbaine sur l’île de Montréal
1. Pour cette section, voir Louise Dechêne, « Observations sur l’agri-culture du Bas-Canada au début du XIXe siècle », dans Joseph Goy et Jean-Pierre Wallot, dir., Évolution et éclatement du monde rural. Struc-tures, fonctionnement et évolution différentielle des sociétés rurales fran-çaises et québécoises XVIIe-XXe siècles, Paris, Éditions de l’EHESS, 1986, p. 195. Jean-Claude Robert, « Acti-vités agricoles et urbanisation dans la paroisse de Montréal, 1820-1840 », dans François Lebrun et Normand Séguin, dir., Sociétés villageoises et rapports villes-campa-gnes au Québec et dans la France de l’ouest, XVIIe-XXe siècles, Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières et Presses universi-taires de Rennes 2, 1987, p. 91-100.
2. Serge Courville, Le Québec. Genèses et mutations du territoire, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, 1999, 508 p.
3. P. Bays, « Le Québec méridional », dans Ludger Beauregard, Le Canada : une interprétation géogra-phique, Toronto, Methuen, 1970, p. 298-355.
4. Sylvie Dépatie, « Jardins et vergers à Montréal au XVIIIe siècle », dans Sylvie Dépatie, Catherine Desba-rats, Danielle Gauvreau et Mario Lalancette, dir., Vingt ans après, Habitants et marchands : lectures de l’histoire des XVIIe et XVIIIe siècles canadiens, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 1998, p. 226-253.
5. Dechêne, op. cit., p. 195 ; Robert, op. cit., p. 91-100.
6. Robert, op. cit., p. 91-100.
7. Ibid., p. 96.
8. Jean-Claude Robert, « William Evans », DBC en ligne.
9. Brian Young, In its Corporate Capa-city : The Seminary of Montreal as a Business Institution, 1816-1876, Montréal et Kingston, McGill-Queen’s University Press, 1986 ; Jean-Claude Robert, « Les Sulpi-ciens et l’espace montréalais », dans Dominique Delandres, John A. Dickinson et Ollivier Hubert, dir., Les Sulpiciens de Montréal. Une histoire de pouvoir et de discrétion 1657-2007, Montréal, Fides, 2007, p. 155-178 ; Michèle Benoit et Roger Gratton, Pignon sur rue. Les quartiers de Montréal, Montréal, Guérin, 1991, p. 5.
10. Louise Pothier, « Ville-Marie fran-çaise et amérindienne. 1642-1685 », dans Gilles Lauzon et Madeleine Forget, dir., L’histoire du Vieux-Montréal à travers son patri-moine, Sainte-Foy, Publications du Québec, 2004, p. 52.
11. Yves Bergeron, Les anciennes halles et places de marché au Québec, thèse de doctorat (arts et traditions popu-laires), Université Laval, 1990 ; Jean de Laplante, Les parcs de Montréal : des origines à nos jours, Montréal, Éditions du Méridien, 1990 ; Marc Choko, Les grandes places publiques de Montréal, Montréal, Méridien, 1987 ; Journal de la Chambre d’As-semblée du Bas-Canada, 1823, p. 15-16, 86, 89 ; 1828-1829, passim.
12. Gilles Lauzon et Alan M. Stewart, « Le centre bourgeois. Nouvelle façade de la ville, 1800-1850 », dans Gilles Lauzon et Madeleine Forget, dir., L’histoire du Vieux-Montréal à travers son patrimoine, Sainte-Foy, Publications du Québec, 2004, p. 141-142.
13. Blake A. Campbell et Albert Gosselin, Le commerce des fruits et des légumes frais dans la ville de Montréal, Québec, ministère de l’Agriculture, 1940.
14. Journal de la Chambre d’Assemblée du Bas-Canada.
15. Jean Hamelin et Yves Roby, Histoire économique du Québec 1851-1896, Montréal, Fides, 1971.
16. Serge Courville et Normand Séguin, Le monde rural québécois au XIXe siècle, Ottawa, 1989, Brochure de la Société historique du Canada.
17. Régis Thibeault, Industrie laitière et transformation agraire au Saguenay–Lac-Saint-Jean, 1870-1950, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, 2008, 256 p.
18. Normand Perron, « Genèses des activités laitières, 1850-1960 », dans Normand Séguin, dir., Agri-culture et colonisation au Québec.
Notes 1443
Aspects historiques, Montréal, Boréal Express 1980 p. 113-140.
19. LDR, Histoire du Québec contempo-rain, tome 1, De la Confédération à la Crise, Montréal, Boréal Express, 1989.
20. Recensement du Canada, 1941.
21. Robert Rumilly, Histoire de Saint-Laurent, Montréal, Beauchemin, 1969 ; Ludger Beauregard , « Géographie manufacturière de Montréal », Cahiers de géographie de Québec, vol. 3, no 6, 1959, p. 275.
22. Robert Lewis, Manufacturing Montreal the making of an industrial landscape, 1850 to 1930, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2000 ; Claude Manzagol, « L’industrie manufacturière à Montréal », dans Ludger Beaure-gard, dir., Montréal. Guide d’excur-s ions , Montréa l , Pres ses de l’Université de Montréal, 1972, p. 125-135. Pour Longue-Pointe, voir Rapport du concours du Mérite agricole, 1905, p. 40 ; pour Pointe-aux-Trembles, Rapport du concours du Mérite agricole, 1910, p. 16.
23. Claude Langlois, « Problems of urban growth in greater Montreal », Canadian Geographer, vol. V, no 3, 1961, p. 1-11.
24. David B. Hanna, « Les réseaux de transport et leur rôle dans l’étale-ment urbain de Montréal », dans Horacio Capel et Paul-André Linteau, dir., Barcelona-Montréal : desarrollo urbano comparado, Barce-lone, publicacions de la Universitad de Barcelona, 1998, p. 117-132.
25. Raoul Blanchard, « Montréal : esquisse de géographie urbaine », Revue de géographie alpine, no 35, fascicule II, 1947, p. 133-328, réédité dans L’Ouest du Canada
français, Montréal et sa région, Montréal, Beauchemin, 1953.
26. La Patrie, 29 août 1903.
27. Voir aussi Benoit et Gratton, op. cit., pour la description des activités agricoles de certains secteurs.
28. Rapport du Mérite agricole, 1900, 3e concours de la première région, Québec, 1891.
29. Blanchard, op. cit., p. 228.
30. Blanchard, op. cit., p. 265.
31. Blake A. Campbell et Albert Gosselin, Le commerce des fruits et des légumes frais dans la ville de Montréal, Québec, ministère de l’Agriculture, 1940.
32. Québec (Province), ministère de l’agriculture, Division des marchés et des enquêtes, Sommaire des dispo-nibilités, mode de vente et lieux d’écoulement des produits agricoles 1953, ministère de l’Agriculture, Division des marchés et des enquêtes, Service de l’économie rurale, 1954.
33. Patricia Thornton, Martha Lang-ford, Brian Slack et autres, Étude historique du patrimoine industriel de Montréal : phase 1, vol. 4 : Atlas industriel de Montréal, 1825-1946, Montréal, Université Concordia, Département de géographie, 1991, p. 911.
34. J.H. Lavoie, Orientation de la culture et de l’industrie maraîchères dans la province de Québec, conférence prononcée au congrès de la Société des jardinier s -maraîcher s t enu à Montréal, les 13 et 14 décembre 1926, Québec, ministère de l’Agri-culture, 1927, p. 11.
35. Thornton, Langford, Slack et autres, op. cit., p. 911.
36. Bettina Bradbury, « Pigs, Cows and Boarders. Non-wage forms of Survival among Montreal Families, 1861-1881 », Labour / Le Travail, vol. 14, 1984, p. 9-46.
37. Luc i en Genê t , « Comment Montréal se nourrit de Montréal », Licence en sciences commerciales, École des hautes études commer-ciales, 1930.
38. J.L. Perron, Rapport annuel du ministère de l’Agriculture de la Province de Québec, D.S. 1930 p. iv.
39. Jean-Charles Fortin, « L’agricul-ture », dans Mario Filion et autres, Histoire du Haut Saint-Laurent, S a i n t e - Fo y, I Q RC , 2 0 0 0 , p. 218-219 ; Ludger Beauregard, « La plaine du Richelieu, banlieue agricole de Montréal », Revue cana-dienne de géographie, vol. XXIII, nos 1-2, 1959, p. 19-38.
40. Blanchard, op. cit., p. 133-328.
41. À l’occasion, surtout pour les recen-sements du XXe siècle, nous procé-derons à la recomposition de certains districts selon les directives de Henripin. Jacques Henripin, « Les Divisions de recensement au Canada, de 1871 à 1951 », L’Actua-lité économique (1955-1956), vol. 30, p. 633-659 ; vol. 31, p. 102-127.
42. Yves Otis, « La différenciation des producteurs laitiers et le marché de Montréal (1900-1930) », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 45, no 1, été 1991, p. 39-71.
43. Ibid.
44. Francis Charles Harrison, The milk supply of Montreal ; a report of a bacteriological investigation of the
1444 Histoire de Montréal et de sa région
city’s milk supply in 1913-1914, Sainte-Anne-de-Bellevue, Québec, Macdonald College, McGil l University, 1914 ; Maurice J. Scar-lett, « Milk Market of Montreal », Revue de géographie de Montréal, vol. 21, no 2, 1967, p. 343-360.
45. Otis, op. cit.
46. Blanchard, op. cit., p. 112. Voir aussi Jean-Charles Fortin, Jacques Saint-Pierre et Normand Perron, Histoire de Laval, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, 2008.
47. Ibid., p. 65.
48. Voir la pétition de cent agriculteurs de Saint-Elzéar, à Laval, adressée au m i n i s t r e d e l ’ A g r i c u l t u r e , 2 décembre 1912, dans BANQ, fonds du ministère de l’Agriculture, E9, S100, SS1, SSS2 contenant 1960-01-029/20.
49. Blanchard, op. cit., p. 115.
50. Beauregard, « La plaine du Riche-l i eu , b an l i eue a g r i co l e d e Montréal », op. cit.
51. Yolande Lépine, Intégration d’une communauté rurale de la banlieue maraîchère de Montréal à la société urbaine, mémoire de maîtrise, géographie, Québec, Université Laval, 1972, et Ludger Beauregard, « Les étapes de la mise en valeur agricole de la vallée du Richelieu », Cahiers de géographie de Québec, vol. 14, no 32, 1970, p. 171-215.
52. Journal de la Chambre d’Assemblée du Bas-Canada, 1816, p. 34, app. E, p. 36, 92, 106, 628 ; 1818, p. 9, 42, 46, 82.
53. Vernon C. Fowke, Canadian Agri-cultural Policy. The Historical Pattern, University of Toronto Press, 1947, p. 194.
54. Paul-Louis Martin, Les fruits du Québec, Sillery, Septentrion, 2002, p. 82.
55. Jean-François Constant, Les exposi-tions agricoles et industrielles à Montréal entre 1880 et 1884, mémoire de maîtrise en histoire, Université de Montréal, 2004 : Elsbeth Heaman, The Inglorious Art of Peace. Exhibitions in Canadian Society during the 19th Century, Toronto, University of Toronto Press, 1999, p. 90-98 ; Sylvie Dufresne, « Attractions, curiosités, carnaval d’hiver, expositions agri-coles et industrielles : le loisir public à Montréal au XIXe siècle », dans Montréal au XIXe siècle. Des gens, des idées, des arts, une ville, Montréal, Leméac, 1988, p. 254-265.
56. Proceedings connected with the forma-tion of the Montreal Horticultural Society, and it s const i tution , Montréal, J. Starke & Company, 1847, 22 p.
57. David Pearce Penhallow, Sur l’éta-blissement d’un jardin botanique et d’un arboretum à Montréal : sous les auspices de la Société d’horticulture de Montréal et de l’Association pour la culture des fruits de la province de Québec, s. l., s. n., 1885, 15 p.
58. Constitution and by-laws of the Montreal Horticultural Society and Fruit-Growers’ Association of the Province of Quebec : adopted at a General Meeting of the Society held in Montreal on the 27th May, 1878, approved of by His Honor the Lieut-Governor in Council, on the 9th July, 1878, By-Laws Committee : J.D. Gibb, Dr. Andres, N.S. Whitney, J. Doyle, Henry S. Evans, Montréal, « Herald » Printing & Publishing Company, 1878, 11 p.
59. Canada, Assembly Journal, 1846, app. Jw.
60. Fernande Roy, « Louis Beaubien », Dictionnaire biographique du Canada.
61. Rapport du commissaire de l’Agri-culture et des Travaux publics de la province de Québec, Documents de la session, 10, A., 1875-1876 (1876), doc. 3.
62. Rapport du commissaire de l’Agri-culture et des Travaux publics de la province de Québec, Documents de la session 15, A, 1880-1881 (1881-1882), 1 doc. 2.
63. Bruno Jean, « Édouard-André Barnard », DBC en ligne.
64. Jacques Saint-Pierre, Histoire de la Coopérative fédérée de Québec, l’in-dustrie de la terre, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, 1997, p. 118.
65. Firmin Létourneau, Histoire de l’agriculture (Canada français), Montréal, Imprimerie populaire, deuxième édition, 1952, 324 p.
66. Jacques Saint-Pierre, op. cit., p. 54.
67. Otis, op. cit., p. 63, note 56.
68. Denis Goulet et Frédéric Jean, « Duncan McNab McEachran », DBC en ligne.
69. Denis Goulet et Frédéric Jean, « Duncan MacEachren », DCB en ligne ; Louis-Philippe Phaneuf, « Victor-Théodule Daubigny », DBC en ligne ; Michel Pépin, Histoire et petites histoires des vétéri-naires du Québec , Montréal, Éditions François Lubrina, 1986 ; P.M. Teigen, « The establishment of the Montreal Veterinary College, 1866-1867–1874-1875 », Revue
Notes 1445
vétérinaire canadienne, vol. 29, 1988, p. 185-189.
70. J.F. Snell, Macdonald College of McGill University, Montréal, McGill University Press, 1963, p. 123-125.
Chapitre 15 : Scolarisation, industrialisation et urbanisation au XiXe siècle
1. Les historiens ne s’entendent pas tous sur la proportion de l’ensemble des enfants qui vont à l’école avant l’instauration, en 1829, du réseau des écoles de syndics. Louis-Philippe Audet estime à 9 % l’ef-fectif scolaire des enfants âgés de 5 à 14 ans et Allan Green avance un taux de 14,3 %. Louis-Philippe Audet, Le système scolaire de la province de Québec, tome V : Les écoles élémentaires dans le Bas-Canada, 1800-1836, Québec, Éditions de l’érable, p. 137-138 ; Allan Greer, « The pattern of lite-racy in Quebec, 1745-1899 », Histoire sociale / Social History, vol. 11, no 22, p. 293-335.
2. A. Dufour, « Diversité institution-nelle et fréquentation scolaire dans l’île de Montréal en 1825 et en 1853 », Revue d’histoire de l’Amé-rique française, vol. XLI, no 4, printemps 1988, p. 524 et 533.
3. Raoul Blanchard, L’Ouest du Canada français. Montréal et sa région, Montréal, Beauchemin, 1954.
4. G. Bernier et R. Boily, Le Québec en chiffres de 1850 à nos jours, Montréal, Acfas, 1986.
5. Robert Gagnon, Histoire de la Commission des écoles catholiques de
Montréal, Montréal, Boréal, 1996, p. 22.
6. J.B. Meilleur à Mgr Bourget, 30 septembre 1846. Cité par Y. Majerus, L’éducation dans le diocèse de Montréal d’après la correspondance de ses deux premiers évêques Mgr Lartigue et Mgr Bourget, thèse de Ph. D., Université McGill, 1971, p. 132.
7. Robert Gagnon, Histoire de la Commission des écoles catholiques de Montréal, op. cit., p. 28-29.
8. Roderick Macleod et Mary Anne Poutanen, A Meeting of the People. School Boards and Protestant Communities in Quebec, 1801-1998, Montréal et Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2004, p. 113.
9. CECM, Notice sur les écoles relevant du Bureau des commissaires catholi-ques romains de la cité de Montréal, 1893, p. 4.
10. Pour une analyse détaillée des carrières des présidents de la CECM, voir R. Lescop-Beaudoin, Une étude du pouvoir officiel à la CECM. Les présidents de la CECM de 1846 à 1965, mémoire de maîtrise, Université de Montréal, 1967.
11. CECM, Notice sur les..., op. cit., p. 4.
12. Jean-Philippe Croteau, Le finance-ment des écoles publiques à Montréal. Deux poids, deux mesures, thèse de doctorat, UQAM, 2006, p. 34-74.
13. Voir à ce sujet Marie-Paule Malouin, Ma sœur à quelle école allez-vous ? Deux écoles de filles à la fin du XIXe siècle, Montréal, Fides, 1985.
14. « Rapport semi-annuel des commis-saires pour les derniers six mois de 1847 », Livre des délibérations des commissaires (LDC), 1850, Archives de la Commission scolaire de Montréal (ACSDM).
15. Avant 1859, on acceptait les garçons dans ces écoles jusqu’à l’âge de neuf ans. En 1859, une résolution inter-dira aux garçons de plus de 7 ans d’être admis dans une école de filles (LDC, 5 août 1859, ACSDM). Or, ces directives ne sont pas toujours appliquées. En décembre 1860, par exemple, 18 garçons entre 7 et 14 ans sont inscrits dans la classe de Mme Sanguinet (LDC, juillet 1860).
16. Rapport du surintendant de l’éduca-tion pour le Bas-Canada pour l’année 1857, Québec, 1858, p. 102.
17. Jean-Philippe Croteau, Le finance-ment des écoles publiques à Montréal. Deux poids, deux mesures, op. cit., p. 41.
18. Voir à ce sujet Robert Gagnon, Histoire de la Commission des écoles catholiques de Montréal, op. cit., p. 42-43.
19. De fait, il y a une quatrième liste qui comprend les propriétés foncières exemptes de taxes.
20. Voir à ce sujet Jean-Philippe Croteau et Robert Gagnon, « Le débat sur le partage de la taxe scolaire à Montréal », dans Histo-rical Studies in Education / Revue d’histoire de l’éducation, vol. XX, no 1, printemps 2008, p. 33-68.
21. Roderick Macleod et Mary Anne Poutaten, A Meeting of the People..., op. cit., p. 116-122.
22. Jean-Philippe Croteau, Le finance-ment des écoles publiques à Montréal, op. cit., p. 42.