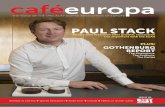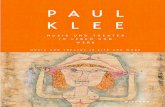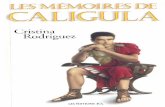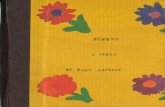4. Les Grands Paris de Paul Delouvrier (préface de Jean-Paul Huchon)
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of 4. Les Grands Paris de Paul Delouvrier (préface de Jean-Paul Huchon)
Collection «Les Urbanités» Cette collection est dirigée par Catherine Bidou-Zachariasen.
Responsable de publication: Marc Guillaume.
© descartes & Cie, 201032, rue Cassette, 75006 Paris
www.editions-descartes.fr
isBn 978-2-84446-166-7
en application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent ouvrage sans autorisation du
Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC), 20, rue des Grands-augustins, 75006 Paris.
5
sommaire
Préfacepar Jean-Paul Huchon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
avant-propos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
enTreTiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Michel debré
(témoignage recueilli par Bernard Hirsch) . . . . . . . . . . 19 Éric Westphal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Jean Millier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 serge Goldberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Jean-eudes roullier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 edgard Pisani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Georges valbon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Jérôme Monod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Jacques voisard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 robert Lion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
anneXes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Paul delouvrier: éléments biographiques . . . . . . . . . . . . 113 L’aménagement de la région parisienne (1961-1962)
[extraits] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
6
introduction au schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la région de Paris (1965) [extraits] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
discours de Paul delouvrier à l’occasion de la remise du prix Érasme (1985) . . . . . . . . . . . . . . . 125
notices biographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Bibliographie succincte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
7
Préface
par Jean-Paul Huchon
Le travail et les témoignages réunis dans le présent ouvrage sont inédits, vivants, et de tout premier ordre. Je suis très
heureux qu’à travers le soutien qu’elle apporte à l’institut Paul delouvrier la région Île-de-France ait pu y contribuer.
sortant des anecdotes mille fois rapportées, et souvent faussées par le passage du temps, les récits de professionnels, d’acteurs politiques, d’urbanistes qui ont travaillé avec le préfet delouvrier viennent nous rappeler combien la construction des villes nou velles et l’élaboration d’une vision urbaine planifiée pour l’Île-de-France relèvent d’un contexte particulier, celui de la croissance des Trente Glorieuses, mais aussi de choix politiques précis.
Les villes nouvelles ont trop souvent été réduites à une aventure singulière. on a pu gloser longuement sur leur réussite, leurs limites. Je pense pour ma part que les villes nouvelles ont beaucoup contribué à conférer à la région son armature d’aujourd’hui, et qu’elles ont su à travers le temps devenir de véritables pôles de développement, très stratégiques, à la croisée du cœur de l’agglo-mération et de la zone dense, et de ce que l’on a longtemps appelé la grande couronne de l’Île-de-France.
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
8
Les villes nouvelles sont multiples, plurielles, et si elles portent la marque d’un État constructeur et centralisé, elles ont su s’imposer dans le monde de l’après-guerre, non seulement en raison de leur modernité et de leur ambition, mais aussi de la volonté constante des élus qui s’y sont succédé, des acteurs associatifs et de la société civile, attentifs à développer l’emploi et à offrir des projets urbains, sociaux, culturels, alternatifs et souvent créatifs.
il est difficile de ne pas faire le parallèle entre le temps des villes nouvelles, du schéma directeur de 1965, de la construction du CniT puis du quartier d’affaires de la défense, de l’évolution de l’armature des transports en commun, avec la période actuelle. À cet égard, j’ai souvent eu l’occasion de dire combien l’on pouvait regretter, en dépit de la qualité des chercheurs et des laboratoires de recherche, que les sciences humaines ne soient pas plus présentes dans le débat sur la ville, sur la métropole, sur le développement urbain durable en Île-de-France. Les sciences humaines, et plus spécialement l’histoire, et même l’histoire urbaine. de la même manière que de récents travaux de grande qualité ont permis de reconsidérer l’histoire urbaine et politique de la banlieue parisienne depuis le milieu du xixe siècle, nous avons collectivement besoin de plus de travaux d’analyse de fond sur l’histoire urbaine récente, celle des années cinquante, soixante, et soixante-dix, celle des grands ensembles, celle de la fin des bidonvilles, celle de la crois-sance économique, urbaine, démographique de l’Île-de-France, celle de ces grandes coupures spatiales et sociologiques construites avec la banlieue.
il y a eu, certes, la mission d’histoire et d’évaluation des villes nouvelles, menée par Jean-eudes roullier, qui nous a malheu- reusement quitté récemment. Les travaux conduits ont bien mis en lumière que la fabrique de la ville francilienne, si l’on peut dire, est loin d’avoir été homogène. il a fallu la rencontre de mul-tiples creusets professionnels, il a fallu des outils de politique publique, des outils d’analyse, des sociétés d’ingénierie, et choisir, sans cesse, entre différentes options possibles. L’histoire de ces
Préface
9
choix, passionnante, mais trop rare, nous conduit pourtant à la politique. C’est cela qui nous montre combien la création d’un grand district de l’agglomération parisienne était une option parmi d’autres possibles. Qui montre combien l’anecdote légendaire sur la nécessité de remettre de l’ordre dans l’agglomération pari-sienne relevait d’une vision régalienne de l’État, de l’expression de choix politiques.
deux événements récents, bien différents l’un de l’autre en appa-rence, nous confirment ce que cet ouvrage présente en filigrane. Les nombreuses réflexions liées aux travaux des équipes pluri-disciplinaires sur le «Grand Pari(s)» de l’agglomération parisienne d’une part, la belle exposition sur les travaux photographiques inédits de robert doisneau d’autre part. À force de regarder de plus près l’organisation urbaine de l’Île-de-France, nombre d’ex-perts, urbanistes, architectes, sociologues, ont pu mettre en avant l’imbrication étroite entre les césures sociales et urbaines des grands ensembles et la place de ces grands ensembles dans le dévelop-pement de l’Île-de-France urbaine. Tout en soulignant combien les phénomènes de ségrégation sociospatiale contre lesquelles nous nous battons sont finalement inhérents à la façon même dont l’Île-de-France a pu être pensée, organisée, planifiée. L’expo-sition sur des travaux photographiques méconnus de robert doisneau sur la banlieue parisienne de la fin des années quarante et des années cinquante nous montre quant à elle des paysages méconnus, des modes de vie oubliés, et fait ressurgir un monde du quotidien rarement évoqué, rarement décrit, et des villes plus souvent vieilles que réellement désordonnées, appelant certes un souffle nouveau, appelant peut-être aussi plus de participation des habitants eux-mêmes.
L’héritage des villes nouvelles, celui de la France urbaine façon-née par des élites volontaires, éclairées, c’est aussi un héritage culturel, patrimonial, sociologique, un passé toujours présent, une histoire des lieux, une histoire des idées, une histoire qui s’est écrite dans la pierre, et qui s’est écrite avec des hommes. Comment ne
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
10
pas faire le lien avec les défis que nous avons chaque jour à relever aujourd’hui, le combat pour le logement, le combat pour des villes accueillantes et justes, le combat pour une région attractive, dynamique, accueillante. Le combat pour inventer et bâtir la métropole la plus durable, celle qui saura le mieux faire valoir l’ensemble de ses atouts et en inventer de nouveaux pour attirer plus de forces vives… sans pour autant oublier de connaître l’im-pact de nos choix sur d’autres territoires.
Grande région urbaine, l’Île-de-France appartient aujourd’hui à un monde ouvert et globalisé, où la population urbaine est en croissance continue. en l’espace d’une génération, plus de la moitié de la population africaine, plus de la moitié de la popu-lation asiatique habiteront en ville. Pour répondre aux besoins de logement des futurs citadins, il faudrait construire d’ici à 2030 près de 4 000 logements par heure, près d’une nouvelle ville d’un million d’habitants par semaine. il y aura plus de nouveaux citadins qu’il n’y avait d’habitants sur l’ensemble de la planète au début des années cinquante, ou presque. notre monde est très différent d’il y a quarante ans.
Quelques semaines après le sommet de Copenhague, à quelques semaines du Forum urbain mondial de rio et de l’ouverture de l’exposition universelle de shanghai, nous voyons chaque jour plus distinctement combien la question du développement durable se joue à l’échelle des grandes villes ou régions métropolitaines, là où les gouvernements nationaux, soumis à d’autres pressions, sont de plus en plus obligés de composer avec les autorités locales. Je crois que l’échelle régionale est, de plus en plus, une échelle incontournable pour la gouvernance du monde de demain. La priorité devrait aller à l’affirmation d’une décentralisation négociée entre les États et les régions, plutôt qu’une concurrence stérile et incompréhensible pour les habitants. C’est, je crois, ce que nous avons voulu faire dans le nouveau schéma directeur de l’Île-de-France (sdriF) comme à travers le plan régional de
Préface
11
mobilisation pour les transports. C’est ce dont témoigne aussi la création du syndicat Paris Métropole.
dans des régions d’urbanisation ancienne comme les nôtres, l’enjeu est certes moins de construire ex nihilo que de valoriser ce qui existe, de permettre et de négocier démocratiquement le chan-gement. si nous voulons agir stratégiquement par rapport aux mutations du monde contemporain où, il faut bien le reconnaître, les changements sont spectaculaires, et les risques aussi, qu’ils soient climatiques, énergétiques, alimentaires, sociaux, nous avons besoin de programmes de recherche qui soient à la hauteur. Les besoins de savoir, les besoins de connaissance sont immenses, et cela porte aussi sur les questions d’urbanisme. on ne peut plus faire de la planification comme il y a vingt ou même dix ans, et cela impose un travail de fond exigeant, permanent.
Plus que jamais, c’est la façon dont les villes changent qui est déterminante, et, avec elle, les sociétés qui s’y développent. Paradoxalement, c’est probablement une leçon toujours vivante de l’urbanisme de l’après-guerre et des Trente Glorieuses, un sens de l’engagement au service de l’intérêt général, une envie d’avancer et de partager. Ces qualités humaines-là, cette générosité, sont indispensables, pour les élus, pour leurs collaborateurs, dans les administrations publiques, dans les agences d’urbanisme 1 et de développement, dans les universités, les pôles de compétitivité, à tous niveaux, dans tous les maillons de la chaîne, tous les opé-rateurs, publics et privés… Ce sont des ressources plus que jamais précieuses et nécessaires, pour un pays, comme pour ses villes et ses régions.
1. Créé en 1960 sous le nom d’iaurP (institut d’urbanisme de la région Parisienne), l’iau-Île-de-France fêtera cette année ses 50 ans.
13
avant-propos
À l’heure où le «Grand Paris» est revenu au centre du débat politique, le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de 1965 est souvent cité comme une référence et une source d’inspiration pour les décideurs d’aujourd’hui. Plus de qua- rante ans après son lancement, le schéma directeur a abouti à des réalisations (parmi lesquelles le rer, le périphérique, les villes nouvelles) qui ont changé le quotidien des Franciliens. en même temps, ces réalisations font parfois l’objet d’une pro-fonde méconnaissance. dans l’imaginaire collectif, les villes nouvelles sont généralement associées aux «barres» et aux «grands ensembles» de la période antérieure. Curieuse destinée pour un projet qui avait été conçu pour mettre un terme à l’urbanisme désordonné et monotone des banlieues des années cinquante… dès lors, il nous a semblé utile de redonner la parole aux acteurs qui ont été directement impliqués dans la naissance du schéma directeur.
un personnage occupe évidemment une place centrale dans ce recueil de témoignages. inspecteur des Finances et résistant, Paul delouvrier a travaillé aux côtés de Jean Monnet au Plan et à la Haute autorité de la Communauté européenne du charbon et de l’acier. en 1958, le général de Gaulle l’a nommé
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
14
délégué général du gouvernement en algérie. de cette expé-rience difficile, il tire une grande notoriété – grâce notamment à son très controversé «discours des barricades» – et obtient définitivement ses galons de grand commis de l’État. Lorsqu’il est porté à la tête du district, Paul delouvrier a 46 ans et aucune expérience particulière en matière d’urbanisme. C’est le début de ce qu’il définira lui-même comme «l’aventure la plus passion-nante de sa vie» et qui lui vaudra le surnom de «Haussmann des faubourgs». Cette période est illustrée par les entretiens avec les membres de l’équipe du district et de l’institut d’amé-nagement et d’urbanisme de la région parisienne (iaurP), mais également par les souvenirs d’un ministre de l’Équipement (edgard Pisani), d’un haut responsable de la daTar (Jérôme Monod) et d’un opposant politique (Georges valbon).
après avoir contribué à créer les sept nouveaux départements de la région parisienne et avoir lancé la construction de cinq villes nouvelles (Cergy-Pontoise, Évry, Marne-la-vallée, Melun-sénart et saint-Quentin-en-Yvelines), delouvrier quitte le district en 1969 pour prendre la présidence d’Électricité de France. Toutefois, la réorganisation de la région-capitale ne sera pas le dernier des «grands paris» de Paul delouvrier, qui continuera toujours – c’est là l’un des aspects les moins connus de sa car-rière – de s’intéresser à l’architecture et à l’aménagement du territoire: en témoigne notamment son action à la tête du Plan-construction, d’ouest-atlantique et du parc de la villette, évoquée ici par robert Lion, Jacques voisard et serge Goldberg.
Les entretiens de ce livre avaient en partie été publiés dans l’ouvrage Paul Delouvrier, un demi-siècle au service de la France et de l’Europe. d’autres ont été réalisés pour ce livre. Tous les textes ont été revus, corrigés et validés par les témoins, qui portent la responsabilité de leurs propos. L’interview de Michel debré, qui ouvre ce recueil, a été recueillie par Bernard Hirsch, ancien directeur de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise. en annexe, nous présentons plusieurs textes dans lesquels Paul
Avant-propos
15
delouvrier relate la genèse du schéma directeur. nous espérons que ces témoignages pourront jeter un éclairage nouveau sur le Grand Paris d’aujourd’hui.
Mes remerciements vont à Christian Bouvier, à Horia djoudi, à François debray, à Paul Jaeger et à la famille delouvrier; à la fondation Hippocrène et au conseil régional d’Île-de-France pour le soutien apporté à cette publication; et, avant tout, aux témoins qui m’ont consacré une partie de leur temps pour me raconter la grande aventure du district et des villes nouvelles.
alessandro Giacone
19
Témoignage de Michel debré
(recueilli par Bernard Hirsch 2)
Michel Debré:Je suis un enfant de Paris et, à bien des égards, mes souvenirs
d’enfance, mes réflexions d’adolescence ont été à l’origine de l’in-térêt que j’ai pris, une fois arrivé au pouvoir, aux problèmes de Paris et de la région parisienne.
J’étais un fils d’un médecin d’enfants. on appelait, à ce moment, au temps de la jeunesse de mon père, médecin d’enfants ce que par la suite on a appelé pédiatre. et bien souvent, mon père me parlait de ses consultations, tantôt dans les riches quartiers de Paris, tantôt dans les faubourgs et la banlieue.
À mesure que sa réputation et renommée grandissaient, il était appelé, plusieurs fois par semaine, par des médecins de la banlieue et me parlait, en outre, de la vie des faubourgs.
2. extrait de Bernard Hirsch (dir.), L’Aménagement de la région parisienne (1961-1969), Paris, Presses de l’École nationale des ponts et chaussées, 2003, p. 191-220. Le texte a été légèrement modifié en vue de cette publication.
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
20
en outre, j’étais jeune à une époque où le dimanche était un dimanche parisien. Peu de familles s’en allaient en fin de semaine et, par conséquent, très tôt, lycéen, étudiant, j’ai pris l’habitude de réserver mon dimanche à des promenades dans Paris, naturel-lement des promenades d’abord vers les musées, les monuments, les églises. Mais aussi des promenades dans le quartier, dans les quartiers, pour connaître la différence entre les différents quartiers.
Plus tard, j’ai fait ma thèse à la faculté de droit, sur l’artisanat et j’ai connu les artisans de Paris, les quartiers des artisans de Paris. Plus tard encore, j’ai fait volontiers, à l’image de ce qu’avait fait mon père dans ma jeunesse, des promenades dans les quartiers ouvriers. et j’avais retenu, de tout cela, un sentiment de honte à l’égard des générations qui m’avaient précédé.
J’ajoute qu’une lecture d’adolescent de Jean Giraudoux m’avait frappé, dans la mesure où Jean Giraudoux avait expliqué que la disparition des fortifications de Paris aurait pu donner à Paris des espaces verts qui lui manquaient, alors qu’on avait construit tout au long de la capitale de véritables casernes, qui, déjà à l’époque étaient, pour certaines, lépreuses.
Bref, ma fierté profonde d’être parisien a été accompagnée, très jeune, par le sentiment que Paris n’avait pas été gouverné, administré. Qu’à la place des vosges, à la place des victoires, à la place vendôme, à l’avenue des Champs-Élysées, même à la rue de l’université avec son urbanisme ancien, avait succédé une ère de désordre, d’indifférence, de laisser-aller, qui était à la fois laide du point de vue de l’esthétique et honteuse du point de vue de la morale sociale.
Est-ce que vous connaissiez la banlieue aussi, à cette époque?J’ai connu la banlieue et j’ai même fait quelque chose de
très particulier et d’unique, c’est que je m’y suis promené à cheval. J’ai fait mon service militaire dans la cavalerie…
Témoignage de Michel Debré
21
C’était avant la guerre?avant la guerre… et j’ai choisi, après mes cinq mois à l’école de
cavalerie de saumur, le 11e régiment de cuirassiers. Le 11e régiment de cuirassiers était un régiment à cheval près du Champ-de-Mars et il se trouvait que, parfois, le samedi ou le dimanche, je faisais des promenades. Je faisais naturellement des promenades vers saint-Cloud, mais je faisais aussi des promenades un peu partout dans la région parisienne.
Je ne sais pas si c’était très indiqué, étant donné l’atmosphère politique de ces années-là, mais enfin, je l’ai fait. si bien que ma connaissance de Paris s’est fondée à la fois sur des souvenirs de mon père, médecin appelé par d’autres médecins en banlieue, et sur mes propres visites. J’ai pris conscience, encore une fois, de la laideur et de la honte sociale que représentait l’approche de Paris, et même de certains quartiers de Paris.
sur ces entrefaites, j’avais un oncle, qui avait épousé une sœur de ma mère, qui était maire de Boulogne-Billancourt et sénateur. il s’appelait andré Morizet. il avait été communiste, puis était devenu socialiste. vers les années trente, alors que j’étais jeune, à peine jeune étudiant, il a entrepris d’écrire un livre sur Haussmann et m’a demandé de regarder les archives d’Haussmann, ce que j’ai fait, pour lui faire des notes résumées, en vue de son livre. Ce qui m’a mis en liaison avec une pensée du xixe siècle en ce qui concerne l’urbanisme et en ce qui concerne l’organisation administrative.
Je ne suis pas un admirateur total d’Haussmann. et j’ai bien lu les critiques adressées à son œuvre, en particulier celles de Jules Ferry. Cependant, quelque chose m’a frappé dans cette action d’Haussmann, c’est que c’était un homme qui avait une vue de Paris, une vue administrative en même temps qu’une vue technique.
sur ce point, je peux raconter une petite aventure qui se relie directement à mes fonctions de Premier ministre, bien des années plus tard. J’avais pris conscience, brusquement, que le plan d’Haussmann pour Paris, notamment la rue de rennes, avait
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
22
crevé, vous le savez, le quartier saint-Germain, et ce n’est pas ce qu’il a fait de mieux. or, en ce qui concerne la rue de rennes, Haussmann a quitté la Préfecture au moment où il s’apprêtait, à partir de saint-Germain-des-Prés, à la faire traverser, d’une art, vers le Carrousel et, d’autre part, vers l’institut et le palais Mazarine. et je me suis aperçu, d’une part, que la rue de rennes commençait au 40 ou au 44, c’est-à-dire que tout avait été fait en attente de ces deux prolongements. et, d’autre part, que depuis Haussmann – nous étions en 1930, par conséquent il y avait déjà plus de soixante ans qu’Haussmann avait quitté ses fonctions –, la ville de Paris achetait régulièrement toutes les maisons qui se trouvaient sur le plan d’Haussmann, afin, un jour, de pouvoir briser la rue Bonaparte et la rue des saints-Pères, et de briser la rue Mazarine, en fonction d’un plan qui était toujours appliqué, puisqu’il n’avait jamais été arrêté.
et je m’étais dit, en 1930: «Le jour où j’aurai le moindre pouvoir j’arrêterai ces achats ridicules.» J’ajoute qu’en 1936, au moment où on a construit la faculté de médecine sur le vieil hôpital de la Charité, on l’a construite de façon à ce qu’elle ait une porte sur la voie à venir et que, lorsqu’on a construit le pont du Carrousel, on ne l’a pas fait devant la rue des saints-Pères, mais on l’a construit devant les guichets et devant les maisons qui sont le long du quai, en fonction de l’arrivée future du plan d’Haussmann.
et quand j’ai été Premier ministre, je ne dis pas que ça a été ma première décision, j’ai demandé à M. Benedetti, préfet de la seine, d’arrêter. M. Benedetti m’a dit que, tout en ayant le même titre que celui qu’avait Haussmann, il n’avait pas les mêmes pouvoirs, qu’il fallait consulter le conseil municipal, qu’il ne savait pas si le conseil municipal avait, en réalité, la possibilité d’annuler le projet d’Haussmann, et je lui ai dit: «Qu’est-ce qu’il faut?». il m’a dit: «C’est très difficile, l’organisation de napoléon iii était une organisation très particulière, Haussmann a pris ce plan à la fois comme ministre et comme préfet». Je lui ai dit: «C’est bon,
Témoignage de Michel Debré
23
j’adopte un texte.». et j’ai pris un décret, signé de mon nom, sans contreseing, annulant le plan d’Haussmann, en obligeant la ville de Paris à ne plus acheter, et même à revendre, et à arrêter ces deux percées qui, d’un côté, auraient crevé toute la rue des saints-Pères et auraient débouché devant le Carrousel.
C’est vous dire, que d’un point de vue esthétique, j’étais donc très marqué, à la fois, par ma jeunesse, mon adolescence et cette étude d’Haussmann, et j’ajoute alors, d’une marnière très profonde, que j’étais ulcéré du laisser-faire des faubourgs et de la banlieue.
J’ajoute que ce qu’on appelait la «ceinture rouge» de Paris m’avait bien révélé qu’elle n’était pas née par hasard. elle était née du fait de l’inconscience ou de l’indifférence des gouver-nements de 1900-1914 et, de nouveau, après la Première Guerre mondiale.
J’avais donc, en moi-même, le désir de m’occuper de Paris, en tout cas de régler les affaires de Paris, et je dois dire que, dans mes rêves d’enfant, s’il n’y avait pas eu le général de Gaulle, la guerre, la résistance, et s’il n’y avait pas eu tous ces évènements qui se sont déroulés et qui ont changé ma vie comme ils ont changé la vie de beaucoup, mon ambition aurait été, un jour, d’être préfet de la seine.
J’arrive au pouvoir, si j’ose dire, en 1958, comme garde des sceaux du général de Gaulle, et le général de Gaulle me fait l’honneur, en janvier 1959, de me nommer Premier ministre.
sous des influences diverses, auxquelles j’avais donné mon appui, mais sans avoir eu un examen attentif du texte, puisque je n’étais que garde des sceaux, avait paru dans le lot des ordon-nances du gouvernement présidé par le général de Gaulle, une ordonnance sur le district de Paris. L’affaire était dans l’air du temps, et, depuis plusieurs années, en effet, depuis je crois 1932, c’est-à-dire bien avant la guerre, sous l’influence, en particulier, de mon oncle, andré Morizet, et d’un autre sénateur socialiste, qui était le maire de suresnes, M. sellier, on avait mis au point une idée: le plan d’aménagement de la région parisienne.
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
24
des projets avaient été entrepris qui, en 1959, étaient encore des études. Mais comme l’idée de district, pour les grandes agglo-mérations, était dans l’air, le ministère de l’intérieur avait proposé un district de Paris. Comme garde des sceaux, j’avais été consulté, intéressé, mais sans plus. J’avais, à ce moment-là, le travail de la Constitution, le travail des lois organiques et je n’ai pas pu me pencher, comme il aurait convenu, sur cette ordonnance qui a été prise, en fait, par le gouvernement du général de Gaulle où je n’étais que garde des sceaux.
À partir de ce moment-là s’ouvre une période difficile. Je n’ai pas à en donner beaucoup de détails, l’ordonnance ne s’applique pas, car les assemblées qui étaient intéressées par l’application de cette ordonnance, les assemblées parisiennes, les assemblées extra-parisiennes refusent, en fait, de désigner leurs délégués. Pour quelle raison? en principe, parce que cette ordonnance avait été prise sans qu’elles soient consultées. en fait, parce qu’elles étaient hostiles à toute organisation qui, d’une manière ou d’une autre, aurait diminué leur pouvoir.
Je m’intéresse beaucoup à la ville de Paris, à cette époque. en particulier, je brise une tradition stupide, qui était une tradition répétée depuis plusieurs années, qui était d’interdire à la ville de Paris d’emprunter, sous prétexte que la ville de Paris avait trop emprunté sous l’ancien régime. Je donne le droit, et M. Griotteray, qui était à ce moment-là rapporteur général de la ville de Paris, s’en souvient, à la ville de Paris le pouvoir d’emprunter pour s’équiper, et en particulier je me rappelle lui avoir dit: «Construi-sez des piscines, construisez des maisons, construisez des logements, c’est pour ça que je vous demande d’emprunter, pour renoncer à une vétusté terrible du logement parisien et à l’inexistence de terrains sportifs.»
Je fais une petite parenthèse ici: les terrains sportifs, que ce soient des tennis, le polo à Bagatelle, étaient uniquement des ter-rains de gens fortunés. il n’y avait pas de terrains sportifs, ou très peu, pour les écoliers, et pas du tout dans les quartiers populaires.
Témoignage de Michel Debré
25
Bref, je m’étais intéressé à Paris, mais je passe sur ce problème, ce n’est pas ça qui nous intéresse aujourd’hui. J’ai fait des comités sur Paris pour essayer d’aider le conseil municipal de Paris, l’orga-nisation administrative qui était alors celle de Paris, à sortir du néant et de l’inactivité qui étaient les leurs.
Il y avait une volonté locale à Paris?il y avait une volonté locale qui était représentée par la majorité
du conseil municipal. et je dois dire que M. Benedetti, qui était préfet de la seine, était tout à fait ardent à sortir de la routine. on oublie le temps où le personnage dont on parlait à Paris, c’était le préfet de police. son importance était considérable, c’est vrai, mais on avait toujours le sentiment que le préfet de la seine était un personnage secondaire. et, d’accord avec M. Benedetti, d’accord avec le conseil municipal de Paris, j’ai voulu rompre cette tradition et faire que par ses réalisations dans Paris, le préfet de la seine, appuyé par le conseil municipal, sorte d’une certaine oisiveté qui était une oisiveté forcée car, encore une fois, je ne sais pour quelle raison absurde, la ville de Paris s’était inclinée devant les impératifs du ministère des Finances et des gouvernements qui s’étaient succédé et n’avait jamais emprunté ou n’empruntait pas.
Puis l’ordonnance de 1959 ne s’applique pas. or, il n’était pas inadmissible qu’une ordonnance ne s’appliquât pas. et c’était d’autant plus inadmissible que les problèmes redevenaient des problèmes de fond […]. et le problème de fond c’est que le plan d’aménagement de la région parisienne était en panne, complè tement. C’était très plaisant de faire des études, et puis encore des études, mais rien ne sortait, par conséquent rien ne se réalisait. et il y avait d’autre part des travaux qui ne pouvaient pas ne pas dépasser la ville de Paris, que ce soit le réseau express régional (rer), que ce soit les Halles, que ce soit les boulevards périphériques…
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
26
On parlait déjà du RER?C’est moi qui l’ai fait, c’est moi qui l’ai décidé. Le rer, le
transfert des Halles et les boulevards périphériques, c’est moi qui les ai décidés. La réalisation en a été faite par M. delouvrier et par le district de Paris en partie, mais les décisions ont été prises à Matignon sous ma présidence. Pour tout cela, il fallait une organisation. et j’ajoute qu’il fallait avoir absolument une poli-tique du logement, une politique de l’habitat et une politique en même temps de zoning. il ne fallait pas priver la région pari-sienne de toutes ses usines, de toutes ses industries. Mais il ne fallait pas non plus miter l’ensemble du paysage parisien. il fallait donc vraiment avoir un urbanisme. donc, penser un urbanisme en général qui ne pouvait pas ne pas dépasser Paris, et par ailleurs, des travaux réels.
Ma première réaction, dans l’année 1960, devant l’inappli-cation de l’ordonnance de 1959, a été de refaire deux choses: refaire l’opération d’Haussmann, c’est-à-dire d’augmenter la superficie de la ville de Paris, et deuxièmement refaire l’opération qui avait été faite naguère sous la révolution et au début du xixe siècle, qui avait consisté à faire un département de seine- et-oise, qui devenait une absurdité. C’est-à-dire faire un régime très particulier, et j’avais l’idée à la fois d’élargir Paris et de faire ce qui s’est fait par la suite, c’est-à-dire des départements qui étaient des départements qui prenaient chacun une partie de la seine- et-oise et une partie des départements voisins.
Mais, c’était le temps de la guerre d’algérie, c’était le temps des discussions politiques passionnées et je me suis trouvé, peut-être à tort, à considérer que si j’allais tout de suite proposer un texte abrogeant l’ordonnance de 1959, puisqu’elle ne s’appliquait pas et qu’elle n’était pas appliquée, et allant tout de suite à l’extension de Paris, à la réforme du régime de Paris et à la création de nouveaux départements, j’allais à un échec. en effet, c’était une opération très ambitieuse. elle consistait en réalité non seulement à étendre
Témoignage de Michel Debré
27
Paris à quelques communes de la périphérie, mais à transformer le statut de Paris.
Mais Paris, à peu près jusqu’à l’ensemble du département de la Seine?
L’ensemble du département de la seine de l’époque aurait été transformé, peut-être un peu moins. Mais en même temps, les arrondissements de Paris seraient devenus des communes. et il y aurait eu, un petit peu à l’image du grand Londres, un conseil du grand Paris qui aurait été l’émanation des différentes communes constituant Paris et des communes qui auraient été rattachées à Paris. et puis enfin, j’aurais fait des départements qui ont vu le jour par la suite.
Et le général de Gaulle partageait votre point de vue?Je vais vous dire que le général de Gaulle était très surpris de
l’intérêt que je prenais à ces problèmes. C’étaient pour lui des problèmes nouveaux, dont personne ne lui avait parlé, et je me souviens de sa surprise. Étant donné que nous étions pris, l’un et l’autre, par de très graves problèmes, quelquefois il souriait. il s’est intéressé profondément à Paris, après la guerre d’algérie, en partie, je dois dire, à la suite des conversations que j’avais eues avec lui. Toutefois, il y avait un point qui le choquait beaucoup, c’est que l’ordonnance au bas de laquelle il avait mis son nom, en 1959, n’était pas appliquée. alors, sur ce point, il me suivait.
Et cette ordonnance comportait quand même un article où pendant cinq ans vous aviez le droit de réformer le statut du District, par un acte régalien?
Par un acte régalien. et c’était d’ailleurs une des dispositions contre lesquelles les assemblées locales s’élevaient le plus, étant donné que beaucoup de membres des assemblées locales siégeaient au Parlement, avec des échos très forts à l’assemblée nationale et au sénat.
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
28
alors c’est ainsi que, voyant que ce trop grand projet aurait rencontré des difficultés majeures, il était urgent – je le voyais bien par les comités réguliers que j’organisais à Matignon sur les pro blèmes de Paris – d’avoir une autorité pour la réalisation de tous ces grands projets que j’ai cités tout à l’heure: l’extension du métro, le transfert des halles, les boulevards périphériques et le grand problème du logement. il fallait tout de suite avoir un instrument.
L’idée a alors germé en moi d’affronter une révision totale de l’ordonnance de 1959 – révision totale dans ses dispositions, mais non pas dans son esprit – c’est-à-dire de créer un district de Paris. Je dois dire que j’ai été seul pendant quelque temps. Les ministres, sauf mes propres collaborateurs, étaient très réservés et l’idée était que l’ordonnance de 1959 avait été un faux pas et qu’il fallait laisser tomber les choses. Je n’ai pas voulu aller dans cette voie et j’ai donc décidé que je referais une ordonnance. J’ai donc dû expli-quer au général de Gaulle pourquoi je refaisais l’ordonnance par une loi, que cette ordonnance de 1959 avait été trop rapidement rédigée, trop rapidement signée, qu’elle comportait, vous venez de le rappeler, une disposition contre laquelle s’élevaient toutes les assemblées locales et qu’il fallait donc remettre les choses en chantier. Le général de Gaulle a été convaincu. en tout cas, il m’a laissé faire. et c’est ainsi que j’ai fait rédiger à Matignon, par mes collaborateurs, en particulier Pierre racine et Jérôme Monod, la loi de 1961. Ce n’était qu’un début parce qu’il allait y avoir un débat parlementaire qui m’a laissé un bon souvenir, dans la mesure où j’avais devant moi une assemblée qui ne voulait pas de la loi et un sénat qui ne voulait pas de la loi. et qu’il fallait absolument que je convainque la majorité de l’assemblée et la majorité du sénat.
J’ai relu les débats parlementaires de l’époque: vous vous êtes vraiment donné personnellement à fond dans cette aventure?
Je me suis donné personnellement à fond, car j’étais mû par mes souvenirs de jeunesse. La ve république était pour moi une
Témoignage de Michel Debré
29
république qui ne devait pas être comme les autres. J’avais honte de la iiie et de la ive républiques, en ce qui concernait leur absence d’urbanisme, leur laisser-faire et, vraiment, la lèpre des faubourgs, je vous en ai dit un mot tout à l’heure, est restée et reste toujours pour moi comme une brûlure. donc il fallait absolument que la ve république ne fût pas comme la iiie ou la ive. et, d’autre part, il ne fallait pas considérer non plus que les assemblées locales fussent des assemblées souveraines. C’était aussi un point impor-tant. L’assemblée locale de Paris, c’était Paris, et l’assemblée de seine-et-oise, c’était la seine-et-oise. Ce n’est pas vrai! Paris n’appartient pas seulement aux Parisiens, Paris appartient à la France, qui en est comptable. et, si on laisse des autorités locales abîmer un paysage, abîmer un département, ne pas avoir d’urba-nisme, ce n’est pas seulement eux qui peuvent éventuellement un jour en souffrir, c’est toute la France qui en souffre et tous les Français. Par conséquent, j’ai été très ferme sur le fait que c’était un problème d’État, que j’étais l’État, que j’étais la ve république et qu’il fallait que je sois compris par les députés et les sénateurs.
or, vous avez vu ces débats, et comme vous dites, je me suis donné à fond et j’ai beaucoup parlé. J’ai beaucoup parlé et j’ai été catégorique en ce qui concerne les objectifs. en cela, j’avais quand même une bonne situation. depuis 1932, on parlait du plan d’aménagement, et le plan d’aménagement restait une histoire de cartographes et, je m’excuse, d’ingénieurs. Mais jamais une autorité locale n’avait émis autre chose que des observations, des revendications. J’ai dit: «Ce n’est pas comme ça qu’on y arrivera, il faut que le plan d’aménagement sorte et il faut qu’il sorte prochainement.»
deuxièmement, il y avait des grands travaux, je n’y reviens pas, je viens de vous parler des principaux.
et puis, troisièmement, il y avait un problème démographique. Je reliais l’organisation de Paris et des travaux de Paris au déve-loppement de la population parisienne. Même si on arrêtait la totalité du mouvement de la province vers Paris, il y avait un
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
30
développement de la population parisienne. il faut savoir que 1959 et 1960 étaient des années de belle natalité. il y avait donc devant nous des perspectives importantes. Ceci, à côté du premier effort, que j’ai tenté et fait réaliser, d’installations d’usines en province, de décentralisation, effort réussi notamment vers la Bretagne, vers le sud-ouest, qui étaient les deux régions les plus défavorisées, et vers le Centre. Je voulais qu’à Paris il y ait une prise de conscience des problèmes de Paris, capitale industrielle en même temps que capitale politique. alors tout ça m’a donné – comment dirai-je? – une volonté de réussir, et j’ajoute que j’ai dit aux députés, aux sénateurs et aux représentants de la majorité que je réunissais à Matignon, que j’aurais honte, à leur place […]. À partir du moment où les assemblées locales étaient convoquées, à partir du moment où le district n’aurait pas été une autorité hiérarchique supérieure, à partir du moment où, en plus, je prenais la respon-sabilité, moi Premier ministre, de continuer à diriger les affaires, ils auraient la responsabilité devant l’histoire, s’ils ne me suivaient pas, d’avoir renoncé à des grands travaux indispensables, à un urbanisme nécessaire et à des logements pour les générations qui viennent. J’ai dû être suffisamment convaincant pour que, malgré une navette…
Il y a eu un renvoi en commission qui a été repoussé par trente-sept voix contre trente-sept?
Je me souviens de cette séance. on n’avait pas demandé de scrutin public et il y avait seulement quatre-vingts personnes en séance. Je dois dire que je pensais que la majorité serait plus importante et que certains qui ont voté contre l’ont fait parce qu’ils espéraient que la majorité serait pour. enfin, le renvoi en commission a été refusé et à partir de ce moment-là, ça a mieux marché. Mais s’il y avait eu un renvoi en commission, j’étais décidé à faire réunir la commission la semaine suivante et à faire revenir, dans quinze jours, le projet.
Témoignage de Michel Debré
31
il faut bien vous rendre compte que la ve république est née – de ma part, mais je n’étais pas le seul – avec un certain enthou-siasme de faire le contraire de ce qu’avaient fait les républiques précédentes qui n’avaient fait que des choses honteuses, ou à peu près, ou avaient laissé faire. il fallait donc réagir dans bien des domaines et en particulier, celui de Paris et de la région parisienne. Bref, la loi est votée et j’en suis remercié et complimenté par le général de Gaulle qui avait regardé cette activité qui était, c’est vrai, par rapport à toutes les activités gouvernementales une activité sub sidiaire. il la regardait un peu comme une sorte de particularité attachée à ma personne. Mais s’est posé très vite le problème de la désignation du délégué…
Vous n’aviez pas prévu un délégué, à l’origine, dans votre projet de loi?
non, je n’avais pas prévu…
C’était le préfet de la Seine?C’était le préfet de la seine.
Certains disent que c’est le lobby du corps préfectoral qui avait imposé cette disposition?
Je ne peux pas vous dire…
Est-ce que vous avez regretté que les fonctions soient séparées?non… J’étais au contraire très partisan. Je me demande même
si le fait de déléguer n’a pas été décidé par une petite réunion de députés, avec un de mes collaborateurs, à Matignon. il y avait, en effet, le sentiment qu’on étendait trop les pouvoirs du préfet de la seine, que le préfet de seine-et-oise allait peut-être réagir devant l’autorité d’un préfet qui serait un collègue et qui devien-drait son supérieur. Je ne me souviens plus très bien, mais je sais que dès que j’ai senti que l’on pouvait accepter certaines choses, moyennant quoi la loi était passée, et que parmi ces «certaines
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
32
choses», il y avait la nomination d’un délégué, j’ai sauté sur l’occasion. et je crois même, encore une fois, que cette idée de compromis a été suggérée par un de mes collaborateurs à plusieurs des parlementaires, et je m’en suis félicité.
il y avait donc un délégué. il fallait donc un délégué, je crois même que c’est moi qui l’ai proposé, après les conversations qu’avaient eues mes collaborateurs et, en particulier, un autre collaborateur dont je dois évoquer la mémoire qui s’appelait Jérôme solal de séligny, qui était le lien permanent entre Mati-gnon et le Parlement. il était, par conséquent, le lien permanent entre moi-même et les députés. et je me souviens très bien que, dans ces discussions, il a joué un très grand rôle. il épousait tout à fait mes idées, il sentait que je voulais réussir cette loi, et c’est lui qui a été à l’origine de modifications de la loi, dont certaines ont été acceptées par lui puis par moi, et dont certaines ont été présentées par lui, avec mon accord, pour améliorer les choses. Quoi qu’il en soit, la loi est votée et elle contient pour l’essentiel ce que je voulais, c’est-à-dire un conseil d’admi nistration relati-vement peu nombreux et un patron. Ceux qui s’y intéressent pourront, en effet, relire mes discours qui ont été des discours longs…
Passionnés!… Passionnés, ces discours étaient peu rédigés. J’avais porté ça
en moi depuis trop longtemps et en plus, à certains égards, ça me distrayait d’autres préoccupations. Mais j’avais une volonté, et il faut bien comprendre ma volonté de faire. J’avais la honte de la ive et de la iiie républiques, surtout la honte de la iiie république et la honte des faubourgs, la honte de l’absence d’urbanisme, la honte de la capitale Paris, qui était sale. il faut voir qu’à ce moment-là j’ai poussé sudreau à nettoyer, à reprendre la vieille réglementation, qui était en désuétude depuis 1914, obligeant les propriétaires, tous les dix ans, à nettoyer leurs immeubles. […] J’avais rétabli, en 1960, l’obligation de ravalement. et Malraux,
Témoignage de Michel Debré
33
à l’image de sudreau et moi-même, a commencé à faire ravaler les grands monuments. enfin, vraiment, on voulait faire autre chose que ce qu’on avait fait, et c’était facile: il fallait faire quelque chose là où on n’avait rien fait!
Quant au choix du délégué… J’avais de la sympathie profonde et de l’estime pour delouvrier. Le Général me demande: «alors, qui allez-vous nommer?» alors, je lui dis: «Je vais proposer en Conseil des ministres Paul delouvrier.» Le Général dit: «non.» Pourquoi? delouvrier avait démissionné de ses fonctions de délégué général en algérie. il m’avait envoyé une lettre. il m’avait donné sa démission, et c’est moi qui l’avais apportée au général de Gaulle. et le général de Gaulle en avait gardé de l’humeur. il considérait qu’il avait donné sa confiance à delouvrier en 1958, et que delouvrier devait rester jusqu’au bout. J’avais plaidé la cause de delouvrier au moment de sa démission.
C’est de sa propre initiative que Delouvrier est parti, ce n’est pas le gouvernement qui avait mis fin à ses fonctions?
C’est delouvrier qui avait donné sa démission. et j’ai dit: «Écoutez, delouvrier n’est pas comme moi. Moi, je suis à côté de vous pour tout ce qui se fera. vous le savez bien. delouvrier est un haut fonctionnaire. vous l’avez envoyé en 1958, avec une certaine orientation. il considère qu’il ne peut plus remplir sa tâche, il faut le suivre.» voilà un peu le thème de la conver- sation que j’avais eue. Le général de Gaulle en avait gardé de l’humeur. et je lui dis: «non, delouvrier est un homme sérieux, delouvrier est un homme honnête, delouvrier est un grand fonctionnaire…»
Vous le connaissiez avant qu’il aille en Algérie?Je le connaissais un peu. Je dois vous dire, pour dire les choses
comme elles sont, que j’avais eu des points de désaccord avec lui. Car il faisait un peu partie de l’école de Jean Monnet, c’est-à-dire des supranationaux que j’avais en horreur! et que je continue à
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
34
avoir en horreur… Mais, enfin, delouvrier était quand même un homme très capable et quand le Général avait proposé de le nommer en algérie, j’avais été tout à fait d’accord, considérant que la ve république devait prendre les meilleurs partout où ils étaient. et, encore une fois, je l’avais soutenu. et donc là, je dis au Général: «nous allons le mettre à Paris.» Le Général dit: «non, non.» Je lui réponds: «ecoutez, il faut prendre les bons fonctionnaires.» enfin, je passe, ça n’a d’ailleurs pas été très long. Le Général m’a dit: «Bon, si vous le voulez, faites-le.» alors, je téléphone à delouvrier qui, lui, ne veut pas! il ne veut pas! Je ne sais pas pourquoi, delouvrier s’était mis en tête de s’occuper de la province! alors là, la moutarde m’est un peu montée au nez, parce que vraiment j’avais obtenu du Général un accord sur un nom qui me tenait à cœur et ce Paul delouvrier n’allait pas brusquement faire la fine bouche! Je lui dis: «C’est capital et je vous nomme!» il m’a dit, je crois: «Je vais réfléchir», il était en Bretagne. Je lui ai répondu: «C’est tout réfléchi, votre nomina-tion va paraître.» il me répond: «Bien, je donnerai ma démission.» Je lui dis: «vous ne donnerez pas votre démission!»
et personne, personne n’a jamais imaginé qu’un autre que Paul delouvrier eût pu faire ce qu’il a fait, car il a vraiment très bien travaillé, comme je le pensais.
Je l’ai installé, c’était rue Barbet-de-Jouy [sic], je crois. À la pre mière réunion du conseil d’administration, j’étais fatigué, car l’affaire était grave et je n’ai pas un bon souvenir de cette instal-lation, parce que j’avais dû rédiger mon discours et j’avais trop de choses… enfin, j’ai quand même tenu à installer delouvrier, et, à partir de ce moment-là, les choses sont allées très bien. C’est-à-dire que tous ces projets qui étaient des projets vagues, que ce soit le Plan d’aménagement (PadoG), que ce soit le rer, que ce soit toute autre chose, tout cela a été pris en main. et j’avais un très grand soulagement, le district a très bien marché. naturellement, je tenais à ce que delouvrier soit rattaché au Premier ministre, c’est-à-dire qu’il ait un statut qui le mette en mesure de résister
Témoignage de Michel Debré
35
aux autres ministres, comme aux assemblées locales, et je dois dire qu’il a très bien réussi, il faut dire les choses comme elles sont. il a été très bon. en particulier pour tout ce qui était prévu, que j’avais exposé dans les débats parlementaires comme étant le projet. Je dois dire que delouvrier l’a très bien réalisé. il a pris tout de suite, en trois ou quatre mois, une autorité et, en même temps, un sens des responsabilités qui ont fait que s’il y a vraiment une nomination que je ne regrette pas, c’est celle-là.
si j’étais resté Premier ministre, j’aurais fait plus complètement ce que, sous le gouvernement Pompidou, a fait roger Frey: comme je l’avais proposé, comme je l’avais d’ailleurs dit à l’assemblée à mes risques et périls, il fallait changer la carte départementale, et j’aurais changé la carte départementale, notamment autour de Paris. roger Frey l’a fait, et je crois que ce qu’il a fait était bien. J’ai quand même regretté, parce que, à l’époque, j’aurais fait une réforme administrative de Paris en même temps. et sur ce point, j’aurais été plus loin. en tout cas, j’aurais complété en revenant à l’idée d’Haussmann, qui a consisté à prendre Passy, à prendre auteuil et à les enserrer dans Paris. C’était une bonne orientation des choses. on pouvait parfaitement développer la ville de Paris et reprendre l’idée du Grand Londres. Mais peut-être que j’avais trop marqué de mes initiatives ce projet. il était connu à l’époque comme étant le projet debré.
Le projet debré: on étend Paris, on crée des communes à l’intérieur de Paris, on crée un Grand Paris à l’image du Grand Londres. et c’était très marqué, car j’avais expliqué ça en comité interministériel, j’avais dit en Conseil des ministres: «C’est ça la voie!» alors finalement, le gouvernement Pompidou n’a retenu de ce projet, et roger Frey en particulier, que le changement départemental: on a créé les Yvelines, l’essonne, le val-d’oise, le val-de-Marne, c’est très bien, mais je crois qu’on a laissé Paris intra-muros. J’aurais été plus loin. et j’ai la prétention de croire que ce complément était bon et qu’on aurait évité les discussions sur le statut de Paris. enfin, maintenant tout ça est le passé.
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
36
Peut-être que sur le plan de l’urbanisme, il aurait pu y avoir une plus grande unité, une harmonie, parce que l’œuvre d’Haussmann s’arrête aux boulevards périphériques aujourd’hui?
Je dois vous dire que – les choses étant maintenant ce qu’elles sont – je le regrette. et je regrette surtout la disparition du district, car la région Île-de-France n’a rien à voir. C’est tout à fait autre chose, c’est une conception différente. et, en particulier, je continue à penser qu’un grand district de Paris, à défaut de l’élargis sement de la ville de Paris, avait et a toujours sa respon-sabilité, avait et a toujours son objectif. Pour la raison que vous dites, pour un urbanisme qui soit un urbanisme extra-muros, en même temps qu’intra-muros, et pour une organisation plus rationnelle dans le respect démocratique des libertés municipales de l’ensemble parisien. La région d’Île-de-France n’est en aucune façon l’héritière directe du district de Paris. C’est autre chose, avec sa valeur, ses qualités, avec une certaine solidarité, mais je main-tiens qu’on laisse Paris intra-muros dans une situation qui n’est pas une situation d’avenir. et je suis persuadé qu’il faudra revenir un peu sur la structure si on veut, un jour, avoir plus de vues d’avenir qu’on en a aujourd’hui.
Le District était une organisation où l’État jouait un rôle très important, puisque le délégué général était le représentant de l’État, et l’assemblée, le conseil d’administration, n’était pas une assemblée vraiment représentative, puisque la moitié de ses membres était nommée par le gouvernement?
il faut voir l’époque où nous étions: je suis persuadé qu’il aurait dû y avoir une évolution. Mais l’époque où nous étions était très claire: les assemblées locales ne voulaient rien! et moi je voulais tout. Par conséquent, il fallait que ce soit l’État. et encore une fois, il y a une raison de fond: Paris est aux Parisiens, c’est vrai, mais Paris est à la France! Par conséquent à l’État. et la région parisienne, encore une fois, était lamentable! J’entends pleurer sur ceci ou cela, mais il faut dire que les Halles étaient un scandale
Témoignage de Michel Debré
37
à Paris! Personne ne s’en émouvait, tout le monde était trop heu reux… il y avait tous les bistrots autour des Halles, les forts des halles, que sais-je, etc. et les Halles, un jour, M. Benedetti et moi nous l’avons décidé comme ça! J’ai décidé: on transférera les Halles! il fallait que ça soit l’État. il y a des époques où les décisions doivent être prises. et les décisions ont été prises par un système un peu particulier, c’est vrai. Mais aujourd’hui, quand vous avez un jeune de 20 ou 25 ans et que vous lui expliquez que les Halles étaient au milieu de Paris et que tous les produits étaient sur les trottoirs, que les Halles s’étendaient dans des conditions insupportables, il ne peut pas le croire! Quand on lui explique que le métro était un petit métro intra-muros et qu’il fallait changer dès qu’on arrivait à la porte de saint-Cloud ou à la porte d’orléans, il ne le croit pas!
donc, il fallait réaliser et ça a été fait. alors, quand les choses sont réalisées, il arrive qu’on donne de l’importance à d’autres problèmes qui étaient importants, mais qui ne pouvaient pas être vus de la même façon. et c’est vrai. il fallait que les assemblées élues aient plus de représentation.
Donc vous pensez que les institutions doivent varier un peu en fonction du temps et des problèmes qui se posent?
on ne peut pas toujours avoir la même attitude, et j’ajoute que les défauts se créent, mais les années qui ont été celles du district, on peut dire que ce sont les belles années, ce sont les années où on a réalisé des choses. ensuite, on a suivi. et puis, naturellement, il y a un élément qui est capital dans cette affaire, c’est que la France a été renaissante, chaque année voyait une prospérité accrue, des finances publiques relativement à l’aise, une épargne abondante, avec un État qui ne prenait pas toute l’épargne, une sécurité sociale dont on s’efforçait qu’elle fût en équilibre, une politique des revenus, toute une série de choses qui ont permis d’avoir de l’argent, et c’est un point important. Car si le conseil de district était formé comme il était formé au début, avec beaucoup
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
38
de représentants de l’État, c’est que l’État y mettait de l’argent. C’était normal qu’il y soit.
Mais je crois qu’on ne peut pas comprendre, on ne peut pas d’abord imaginer les difficultés que j’ai rencontrées. on ne peut pas les exagérer, c’étaient des difficultés humaines, mais elles étaient très grandes, j’étais un peu considéré comme un ours blanc dans cette affaire. Mais on ne comprend pas, ou plutôt on peut comprendre, parce que le problème continue de se poser, il n’a pas été résolu, si on ne voit pas ce que doit être une ville moderne. on vous dit que le progrès social, c’est la diminution de la durée du travail, c’est les loisirs… Le premier progrès social, c’est le logement. Le second progrès social, c’est les jardins et les parcs de sport.
Vous avez d’ailleurs contribué à la disparition des bidonvilles?J’ai fait la première loi antibidonville, comme député, et c’est
une des rares propositions de loi présentées par un député. en 1964, j’étais député de la réunion et j’étais également scandalisé. J’avais le souvenir des taudis que le district de Paris avait pour objectif de démolir, mais tout ça était des questions d’argent, des questions d’intérêts privés. J’ai vu ça grandissant à la réunion, j’ai fait une loi, qui est une loi de 1965 et qui a été votée à l’unanimité – alors que j’étais député, je n’étais pas ministre – qui était la première loi, même la loi fondamentale, de destruction des bidonvilles et des taudis.
Mais, là aussi, c’est une question d’argent. La loi était bonne en ce sens qu’elle a permis des évaluations de terrains qui soient des évaluations raisonnables. on ne se rendait pas compte, à l’époque, que comme les bidonvilles étaient quelquefois sur des terrains urbanisables, ils étaient très chers. et comme ils étaient très chers, on n’arrivait pas à exproprier. on ne pouvait pas acheter. alors, il fallait avoir de la poigne. À partir du moment où un propriétaire accepte des bidonvilles ou des taudis sur son terrain, il n’est plus digne d’être propriétaire, par conséquent on peut
Témoignage de Michel Debré
39
l’exproprier dans des conditions qui sont moins onéreuses pour la collectivité. C’est ce que j’ai fait décider à l’époque. depuis, on a un peu changé. enfin, la loi contre les bidonvilles a permis de changer nanterre. on ne se souvient pas de ce qu’était nanterre. Personne n’allait visiter. Je suis allé visiter les bidonvilles de nanterre. Comment voulez-vous que ces gens-là aient des sen-timents politiques, patriotiques ou n’importe quoi? Peut-être reviendra-t-elle l’époque où il faudra de nouveau une autorité pour… Mais encore faut-il des finances et de l’argent, c’est-à-dire que la France soit redressée.
Et la politique des villes nouvelles en région parisienne, qu’est-ce que vous en pensez?
alors ça, c’est plutôt, me semble-t-il, une initiative de delouvrier.
Oui, qui a été faite vers 1964 ou 1965…C’est une initiative de delouvrier, dont il est venu me parler à
un moment où je n’étais plus rien, et je l’ai considérée comme bonne. Je dois vous dire que j’avais eu l’idée d’une ville nouvelle, en 1961, et j’en avais parlé, discuté avec M. Jean Morin, qui était préfet de Toulouse à l’époque, avant d’être nommé gouverneur de l’algérie. Ceux qu’on appelle les pieds-noirs, non seulement d’algérie, mais de Tunisie ou du Maroc, étaient déjà assez nom-breux en France, et on pouvait prévoir que de jeunes pieds-noirs viendraient, même si ce qu’on ne prévoyait pas à l’époque, c’était leur départ total d’afrique du nord. Mais j’avais eu l’idée de recréer dans le sud-ouest, du point de vue agricole comme du point de vue industriel, une ou deux villes nouvelles qui auraient été des villes nouvelles d’accueil des pieds-noirs d’afrique du nord. Je ne sais pas, à la réflexion, si c’était une bonne idée, mais enfin l’idée m’avait séduit. Je connaissais, pour des raisons familiales, la vallée de la Garonne et, avec Jean Morin, j’avais même fixé, près de Cazères-sur-Garonne, ou pas loin, l’emplacement d’une ville nouvelle.
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
40
J’étais tenté par le fait que, déjà à cette époque, un certain nombre d’anciens colons, ou même de Marocains ou de Tunisiens pro-priétaires, avaient acheté des terres en Lot-et-Garonne, en Tarn-et-Garonne et commençaient à les faire fructifier. C’était des départements à démographie relativement faible, et j’avais donc eu l’idée d’une ville nouvelle…
Peuplée essentiellement de pieds-noirs?Peuplée essentiellement de pieds-noirs, et pour les accueillir.
C’était une idée qui m’était personnelle et que mon départ en 1962 n’a pas permis de réaliser. Je crois que si j’étais resté, je l’aurais réalisée, parce que j’étais tout à fait résolu. Je ne sais si ça aurait été une bonne chose, mais je l’aurais réalisée. et j’aurais, en par-ticulier, réalisé une ville aux alentours de Cazères-sur-Garonne. Je me rappelle encore avoir parcouru ces terres, un soir avec Jean Morin; j’avais pris un avion pour le faire. Là-dessus, Jean Morin est parti en algérie, et moi-même je ne suis pas resté au pouvoir.
donc l’idée de villes nouvelles ne m’était pas étrangère, au contraire. Mais je n’avais pas réfléchi aux villes nouvelles autour de Paris, et c’est delouvrier qui a eu cette idée qui m’a paru tout de suite une bonne idée. donc je l’ai approuvée, mais je n’en suis pas responsable.
Je voudrais vous poser une dernière question, Monsieur le Premier ministre, sur la démocratie et l’urbanisme. La tendance actuelle est de confier véritablement de plus en plus aux élus locaux la responsabilité de l’urbanisme, sans avoir d’ailleurs réformé le régime communal français, qui comporte toujours 35 000 communes. Il y a donc toujours 35 000 plans d’urbanisme.
Je vous dis tout de suite que la sociologie française, c’est le maintien des communes. naturellement, on peut supprimer des communes qui meurent, mais la commune, la petite commune, la moyenne commune, la grande commune sont des réalités, et je ne crois pas ceux qui vous disent: «35 000 communes, y en a
Témoignage de Michel Debré
41
20 000 de trop…», non, non. il faut prendre la France comme elle est, elle n’est pas si mal, au moins de ce point de vue-là. simplement, il faut des organisations intercommunales. en par-ticulier, il y a un premier point que j’avais prévu et que j’aurais réalisé si j’étais resté au pouvoir, qui était de diversifier notre législation municipale, à l’image, d’ailleurs, des législations étran-gères qui distinguent les petites communes, les villes moyennes et les grandes agglomérations. Ce n’est pas bon d’avoir une légis-lation uniforme. sur ce point, je n’ai pas été suivi, mais je le regrette. et d’ailleurs, je n’ai pas eu le temps. si j’étais resté, j’aurais fait voter la loi et j’aurais fait voter trois régimes municipaux. C’est certain.
Parce qu’alors, à ce moment-là, on peut laisser l’urbanisme aux grandes agglomérations, et on a un régime spécial pour les villes moyennes et les petites villes. À l’heure actuelle, et la loi récente de décentralisation aggrave un peu ce caractère, c’est l’unifor-misation, alors que c’est une uniformisation qui est contraire à la nature des choses. […] Je suis depuis de longues années, depuis même plus de trente ans, conseiller général, je suis même le doyen du conseil général d’indre-et-Loire, je suis depuis vingt ans maire d’amboise et j’ai observé deux choses. La première, c’est que lors-qu’on se donne du mal, on peut être compris. Par exemple, même comme simple conseiller général et même comme conseiller municipal – je n’étais pas maire encore – j’ai convaincu les édiles municipaux d’amboise de n’accep ter ni les crépis de couleur, ni les toits de tuiles rouges. et maintenant, depuis vingt ans, on ne construit à amboise que des toits d’ardoises ou de petites tuiles vieillies et des crépis blancs. Je ne peux pas dire que j’ai eu de grandes difficultés, ce n’est pas vrai. on explique surtout l’idée que le tourisme est un élément économique qui doit être encou-ragé, qu’il ne faut pas abîmer le centre d’une ville. Quand on se donne la pleine d’expliquer, qu’on sent qu’il n’y a pas d’intérêts particuliers ou d’intérêts personnels derrière, à mon avis, on peut être compris.
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
42
Oui, mais pour interdire de construire sur des terrains qui appartiennent aux élus?
Le plan d’occupation des sols a été une grande réforme, elle est comprise. J’ai été à amboise, je crois, la première ou la deuxième ville de France, à prendre un plan d’occupation des sols. J’ai convaincu pas mal de communes du canton, dont je suis conseiller général, d’avoir des plans d’occupation des sols. naturellement, il y a des problèmes. naturellement, il y a des pro priétaires qui protestent. naturellement, il y a quelquefois des choses qui ne sont pas tout à fait admissibles. Mais, pour l’ensemble, les plans d’occupation des sols sont compris et acceptés. naturellement, il n’y a pas un enthousiasme général, mais je ne peux pas le dire, et encore une fois j’ai des relations avec les maires de mon canton, qui sont des maires d’opinions politiques tout à fait différentes, particulières, mais nous avons discuté des plans d’occupation des sols, je suis allé presque dans chaque commune, il y a quelques années, pour demander à chaque commune de faire son plan d’occupation des sols. Je ne peux pas dire qu’il y a eu des impos-sibilités. encore une fois, il y a eu des difficultés, mais les Français sont beaucoup plus aptes à la conception d’ensemble de l’intérêt général qu’on le croit.
Pour en revenir à votre question, je suis un petit peu préoccupé, car il y a un état d’esprit qui est différent selon qu’il y a une autorité de tutelle ou qu’il n’y a pas d’autorité de tutelle. et je trouve qu’en matière d’urbanisme, on est allé à l’extrême. encore une fois, dans une grande agglomération, ma foi, il y a des services, il y a des gens compétents, il y a une opinion publique qui est bonne ou mauvaise, qui peut, le cas échéant, coiffer les intérêts par-ticuliers, et puis, en tout cas, il y a les moyens techniques.
une petite commune, c’est plus difficile. et c’est peut-être quelquefois un cadeau empoisonné qu’on a fait aux maires. il va falloir attendre l’expérience. encore une fois, je ne suis pas du tout contre la responsabilité des élus. non, les élus peuvent s’élever à la hauteur de leurs fonctions, mais il y a une affaire d’esthétique,
Témoignage de Michel Debré
43
une affaire, le cas échéant, de résistance à certaines pressions, notamment du point de vue commercial. Quelquefois, le maire ça lui plaisait de pouvoir dire: «L’administration supérieure ne me permet pas.» il est probable, que sur ce point, l’expérience révélera qu’on est probablement allé trop loin d’un seul coup.
45
entretien avec Éric Westphal
Quels sont vos premiers souvenirs de Paul Delouvrier? Je l’ai rencontré à Luxembourg en 1955, alors que j’étais le
secrétaire particulier de Jean Monnet. Mon bureau était un passage obligé pour entrer chez Monnet. Comme tous les autres fonc-tionnaires de la Haute autorité de la CeCa, Paul delouvrier y passait souvent. C’était un homme qui s’imposait très vite par son autorité, mais aussi grâce à sa grande gentillesse. on s’est vite lié d’amitié: on jouait souvent au tennis et on allait se promener dans la campagne luxembourgeoise. Je lui ai fait lire ma première pièce de théâtre. il était un homme pratique et m’a dit aussitôt: «on pourrait créer une association pour financer la pièce.» C’était une bonne idée, même si cela n’a pas abouti…
En décembre 1958, Paul Delouvrier est nommé délégué général du gouvernement en Algérie. Vous demandez à partir avec lui. À cause de lui ou à cause de l’Algérie?
des deux. J’avais lu quelques livres sur l’algérie, avec laquelle j’estimais que la France était très injuste. La question algérienne
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
46
m’intéressait beaucoup, parce que j’avais fait en partie mon service dans un régiment de tirailleurs algériens. dès que Paul delouvrier a été nommé, je lui ai dit: «emmenez-moi! vous serez entouré de mensonges. il vous faut deux ou trois personnes qui soient sûres. Moi, je suis sûr, vous le savez.»
Pendant les deux années qui ont suivi, j’ai eu un rapport quo-tidien avec delouvrier, en m’occupant particulièrement des questions de justice. il y a des liens qui se nouent dans des périodes de ce genre. Je me souviens de certains jours, en tête à tête, sur la table se trouve un dossier insoutenable, et nous nous regardons avec désespoir… Quand, en me remettant bien plus tard la légion d’honneur, delouvrier a dit «Éric Westphal était ma conscience en algérie», c’est à ce genre de situation qu’il pensait, je crois.
En 1961, Paul Delouvrier vous a proposé de travailler au district de la région de Paris.
dans le livre de mémoires recueillies par roselyne Chenu, Paul delouvrier raconte: «au district, nous avons démarré en sep-tembre 1961, dans deux pièces poussiéreuses du quai voltaire, avec une secrétaire, un balai, Jean Poincaré et Éric Westphal. Le trio d’alger 3.»
Le trio d’amitié dont parle delouvrier s’était formé à Luxem-bourg, auprès de Jean Monnet, puis s’était retrouvé en algérie, où Jean Poincaré et moi-même assistions le délégué général du gouvernement. et voilà qu’il était réuni une nouvelle fois à l’aube du district!
Le district venait d’être créé. Le Premier ministre, Michel debré, en avait offert la présidence à Paul delouvrier, lequel avait décliné l’offre. Mais voilà qu’un peu plus tard, le 11 août 1961, Paul delouvrier est convoqué chez le général de Gaulle, qui parvient à le convaincre.
3. roselyne Chenu, Paul Delouvrier ou la passion díagir, Paris, seuil, 1995, p. 312.
Entretien avec Éric Westphal
47
on a beaucoup glosé sur cet entretien. La petite histoire veut que le Général, après avoir survolé la région parisienne en hélicoptère, lui ait lancé: «delouvrier, mettez-moi de l’ordre dans ce…!» (ici un substantif qui désigne un certain lieu de débauche pour la gent masculine).
La réalité est très proche et je la tiens d’un récit du délégué lui-même, à peine différent: le Général reçoit delouvrier, le conduit devant une table sur laquelle est déployée une carte de la région parisienne, parle un moment de spéculation, désordre, planification et conclut en disant: «Je cherche un homme solide pour mettre de l’ordre dans ce foutoir. Pourquoi pas vous?» et il ajoute avec un léger sourire: «Je sais que personne ne pourra vous marcher sur les pieds. C’est essentiel.»
et Paul delouvrier répond: «Mon général, j’accepte à deux conditions.» Le Général fronce un sourcil, un peu mécontent qu’on lui pose des conditions. «Lesquelles? – Premièrement, je ne dépendrai que du Premier ministre, directement. deuxiè-mement, je rédigerai moi-même mon ordre de mission.» Ce qui lui fut accordé.
La réussite du district, à mon sens, c’est de Gaulle plus delouvrier.
du quai voltaire, nous sommes passés très rapidement à l’hôtel de Castries, rue de varenne, où l’équipe s’est peu à peu constituée, et enfin, au printemps 1963, ce fut l’installation rue Barbet-de-Jouy, où se trouve encore le siège du Conseil régional de l’Île-de-France.
Quelles étaient vos tâches au District? Je m’occupais surtout de culture et de sport. Je vous donne
un exemple. J’avais constaté qu’à Paris il n’y avait pas de grand aquarium. Je suis donc allé à Monaco et dans d’autres villes euro-péennes chercher des renseignements sur les aquariums. Mon rôle était d’avoir toujours des idées originales. delouvrier était amusé par ce type d’initiatives et me soutenait toujours, me proposant à chaque fois de faire un projet.
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
48
en 1963, je suis parti un an aux États-unis, puis je suis retourné travailler avec Jean Monnet (j’ai quitté Monnet trois fois et suis revenu trois fois travailler avec lui!) Finalement, au printemps 1967, delouvrier m’a proposé de revenir au district, car il cherchait quelqu’un pour s’occuper de la culture. J’ai accepté et j’y suis resté jusqu’en 1976, m’occupant surtout de musique, de théâtre et du patrimoine de la région parisienne. après 1976, j’ai travaillé au cabinet de Françoise Giroud, puis à l’inspection générale des spectacles au ministère de la Culture, où je suis resté jusqu’à ma retraite en 1992.
Dans quelle mesure la méthode Monnet a-t-elle influencé Delouvrier?
La méthode Monnet, finalement, c’est l’art de convaincre. Quand on vous impose de faire quelque chose, vous êtes toujours un peu réticent. Monnet, lui, tournait autour d’un sujet, jusqu’à ce que vous trouviez vous-même la solution et vous félicitait. de cette manière, vous étiez beaucoup plus enthousiaste, car l’idée semblait venir de vous.
delouvrier procédait également de cette manière, même s’il était parfois plus directif. il faut aussi souligner les différences entre les deux: Monnet était un homme de synthèse, alors que delou-vrier était plus analytique. Monnet était un mauvais orateur, tandis que delouvrier était un homme d’estrade. dans son action en algérie et au district, Paul delouvrier s’est naturellement inspiré des expériences qu’il avait vécues avec Monnet. il se référait souvent à lui et à la période de la rue de Martignac, à l’époque du Plan.
49
entretien avec Jean Millier
Connaissiez-vous Paul Delouvrier avant de commencer à travailler avec lui, en 1961?
non. J’étais rentré en France après quinze années passées en Côte-d’ivoire et j’étais en disponibilité. un jour, delouvrier m’a téléphoné pour que j’aille le voir. il m’a demandé si je voulais travailler avec lui à l’aménagement de la région parisienne (en afrique, je m’étais beaucoup occupé d’aménagement du territoire et, dans ce domaine, la Côte-d’ivoire était peut-être plus avancée que la France). Je lui ai donné mon accord, et c’est ainsi que je me suis retrouvé dans le petit bureau du quai voltaire.
Qui lui avait parlé de vous?Je pense que c’est robert Buron, qui à l’époque était ministre
des Travaux publics.
Quel portrait brosseriez-vous de Delouvrier?sur le plan professionnel, il avait beaucoup de qualités, et
je n’ai jamais eu à discuter avec lui. C’était un homme libre, choisi par le général de Gaulle pour mettre de l’ordre dans la région parisienne: comme un curé de campagne désigné par le pape pour devenir évêque! J’ajouterai qu’il écrivait beaucoup et qu’il avait une excellente plume.
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
50
Quelle était sa méthode de travail?il faut distinguer ce qui se passait à l’intérieur et à l’extérieur
de notre équipe.La mission première de delouvrier était de convaincre le poli-
tique, de faire accepter aux élus locaux nos propositions dans le domaine de l’urbanisme et de l’aménagement de la région. il avait donc un rôle politique important, et il lui fallait beaucoup d’autorité. Tout le monde croyait qu’il voyait le général de Gaulle une fois par jour. en réalité, il l’appelait de temps en temps mais ne le tenait pas au courant en permanence.
en ce qui nous concerne, il organisait une fois par semaine une réunion de réflexion, avec dix ou quinze personnes. nous travaillions beaucoup, souvent de neuf heures du matin à neuf heures du soir.
Comment a été conçu le Schéma directeur?Quand delouvrier a pris la présidence de l’institut d’amé-
nagement et d’urbanisme de la région parisienne (iaurP), le premier problème fut le choix des directeurs de chaque secteur. Le reste a suivi. Les villes nouvelles étaient une idée dans l’air du temps, et pas seulement en France. nous avons voyagé en suède, en Finlande, en angleterre et ailleurs pour voir comment elles étaient organisées.
Quand elles furent conçues, il a fallu les desservir par le réseau autoroutier et le rer. delouvrier a obtenu de la société nationale des chemins de fer français (snCF) qu’il n’y ait qu’un seul respon-sable pour toute la région parisienne (c’était important: la snCF était divisée en réseaux qui étaient des entités séparées, et il n’existait pas d’unité autonome pour l’ensemble de la région), c’est-à-dire la création d’une direction des transports de la région parisienne, qui pourrait avoir une vue d’ensemble. il nous fut plus aisé de discuter avec un interlocuteur unique.
Entretien avec Jean Millier
51
Comment étaient vos relations avec les élus locaux?Pas toujours faciles. Mais il ne faut pas dramatiser!À quelques exceptions près, elles furent bonnes. Grâce à son
charisme, son autorité, son verbe, delouvrier était respecté. Les relations ont été compliquées avec alain Griotteray, qui était rapporteur général à la fois du budget de la ville de Paris et du Conseil du district de Paris, mais il n’y a jamais eu de difficulté insurmontable. nous n’avions qu’un objectif: que les gens pussent vivre mieux en région parisienne.
nous avons eu des conflits surtout avec les promoteurs, notam-ment avec Bouygues. amenés à mettre la main sur des terrains convoités par d’autres, nous avons inscrit des communes entières en zone d’aménagement différé (Zad), afin que les promoteurs ne viennent pas construire n’importe quoi, sans se soucier des trans ports et des équipements. nous avons également créé une agence foncière pour acheter les terrains qui nous convenaient. La Caisse des dépôts et consignations en achetait aussi et, à un moment donné, nous avons été obligés de lui interdire de construire là où elle voulait. dans l’ensemble, delouvrier a pu utiliser la pro-cédure des Zad – qui existait déjà, mais n’était guère utilisée – grâce à l’autorité que lui conféraient ses relations avec de Gaulle.
Comment a été accueilli le découpage de la région parisienne en nouveaux départements?
C’était une nécessité. une question de bon sens. Les dépar-tements de la seine et de la seine-et-oise étaient trop étendus. en seine-et-oise, il n’était pas commode pour un habitant de l’est de se rendre à la préfecture de versailles.
Le découpage a été fait en fonction de critères naturels établis par nous et de critères politiques fixés par le ministre de l’intérieur.
Avez-vous accompagné Delouvrier dans les tournées où il exposait ses projets?
rarement. Je réglais quelques problèmes techniques avec les
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
52
élus, mais le porte-parole, c’était lui. orateur talentueux, c’était aussi un excellent professeur avec une grande clarté d’esprit.
Quelles étaient ses relations avec les ministres chargés du dossier?avec albin Chalandon, il n’y a pas eu de réel différend. J’ignore
les détails de leurs prises de bec, mais ce n’était qu’un conflit entre deux inspecteurs des finances qui se connaissaient de longue date et dont l’un était devenu ministre (ils se tutoyaient, leurs parcours avaient été proches, leurs perspectives d’avenir différaient): il y a eu certes des moments de tension, mais il ne faut pas en faire une histoire. Peut-être une ou deux villes nouvelles ont-elles disparu des projets, mais, dans l’ensemble, il n’y eut pas de difficultés majeures.
Les relations avec olivier Guichard ont toujours été excel-lentes: j’ai plusieurs fois déjeuné avec delouvrier et lui, qui s’entendaient très bien.
Quant à edgard Pisani, il avait un côté théâtral. il y eut avec lui un désaccord sur les villes nouvelles, mais sans suites: elles ont été réalisées comme elles devaient l’être parce que delouvrier avait la confiance du général de Gaulle. et ce n’est pas parce qu’un ministre disait quelque chose que delouvrier renonçait: le chef de l’État lui avait confié une mission claire et nette.
Delouvrier avait-il envie de quitter le District? La situation a-t-elle changé après son départ?
on s’use dans ce genre de poste et, à un moment donné, on sent qu’il faut partir. Beaucoup de choses avaient été mises en place, les départements de la seine et la seine-et-oise avaient été démantelés (je ne sais pas si vous imaginez le bouleverse- ment que cela a représenté!). on ne peut rester éternellement en place…
delouvrier a été nommé président d’edF et m’a demandé si j’étais intéressé par la présidence de l’Établissement public pour l’aménagement de la région de La défense (ePad): j’ai accepté.
Entretien avec Jean Millier
53
il m’a mis en garde: «attention, il faut que vous soyez à la fois président et directeur général.» et il a fait changer les statuts, qui ne prévoyaient pas cette double responsabilité. dans les quinze jours les choses ont été réglées, un arrêté ministériel modifiait les statuts et j’ai été nommé président-directeur général: il avait une connaissance remarquable des hommes et du fonctionnement de l’administration!
après que Maurice doublet eut pris sa succession à la tête de la région parisienne et du district, le schéma d’aménagement n’a guère été remanié, parce que tout avait déjà été mis en place. doublet a fait un bon travail, même s’il n’avait pas la créativité et le charisme de son prédécesseur.
À votre avis, quelles doivent être aujourd’hui les responsabilités de l’État dans le domaine de l’urbanisme?
en matière d’urbanisme, les élus et la puissance publique ont une grande responsabilité, qu’il faut être capable d’assumer.
Je me demande dans quelle mesure le maire d’une commune en est capable: il ne doit pas seulement faire construire, mais aussi interdire de construire, ce qui fait beaucoup de mécontents parmi les promoteurs immobiliers et les propriétaires dont les terrains sont dévalorisés. il faut aussi veiller à ne pas créer des ghettos, comme cela s’est fait, en concentrant dans un endroit les gens qui «votent mal».
dans certains pays, l’aménagement du territoire est confié à des organismes privés. Je ne suis pas contre le rôle du privé, bien entendu, mais cette pratique-là me paraît dangereuse, car, dans ce domaine, il y a incompatibilité entre la recherche du profit et l’intérêt général.
55
entretien avec serge Goldberg
Comment êtes-vous entré à l’IAURP? Je revenais des États-unis, où j’avais obtenu un master d’ur-
banisme à l’université de Yale, et j’ai été embauché à l’iaurP. Cet organisme avait été créé en 1960 par le ministre de la Construc-tion, Pierre sudreau, qui souhaitait avoir un outil de réflexion. en 1962, son président, robert Bordaz, avait envie de quitter l’iaurP pour partir à l’orTF. delouvrier venait d’être nommé au district et Bordaz lui a proposé de prendre sa succession.
À cette époque, l’iaurP ne comptait que six ou sept personnes. Les rôles n’étaient pas bien répartis. il y avait d’un côté les techni-ciens (comme Jacques Michel et moi), de l’autre le clan de la Cour des comptes (qui était venu avec Bordaz), auxquels il faut ajouter Mongin, un homme brouillon qui venait du Conseil d’État et Lefebvre. Ces deux hommes ne sont pas restés longtemps après l’arrivée de Paul delouvrier. Lefebvre a été remplacé par Jean Millier, qui est devenu directeur général de l’iaurP. Jacques Michel, qui avait une grande expérience en matière d’urbanisme, a été nommé à la direction du planning, et moi-même à la tête de la direction des études générales.
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
56
Voyiez-vous souvent Paul Delouvrier à l’IAURP? notre interlocuteur au district, c’était surtout Jean Millier.
Toutefois, Paul delouvrier présidait toujours les réunions (au moins quatre par an) où l’on discutait les grandes orientations de l’urbanisme de la région parisienne.
Quels ont été les premiers pas de Delouvrier au District? Quand delouvrier a pris la tête du district, il ne connaissait
rien à la région parisienne. il a donc commencé par lire les Mémoires du Baron Haussmann… sa première réflexion a été que les perspectives démographiques que nous élaborions devaient aller jusqu’à l’année 2000. il est vite apparu que le Plan d’amé-nagement et d’organisation générale de la région parisienne (PadoG) qui avait été élaboré par l’équipe de Pierre Gibel était insuffisant.
nous avons donc mené des études démographiques. on a fait une extrapolation, qui situait entre douze et seize millions le nombre d’habitants de la région parisienne en l’an 2000. nous avons choisi le chiffre de quatorze millions, qui se situait entre les deux.
Ce qui m’a beaucoup frappé chez delouvrier, c’était son souci d’être concret. au lieu de dire que la région parisienne gagnait tous les ans 140 000 habitants, il préférait expliquer que ce nombre d’habitants était l’équivalent de la ville de nantes. de même, quand on a mis au point le schéma d’aménagement de la région parisienne, on a passé des heures à rédiger la légende, car tout était dans les mots.
Delouvrier avait-il un contact régulier avec le Général?il n’allait pas le voir très souvent, même si celui-ci s’intéressait
beaucoup à la question de la région parisienne. en général, il se rendait à l’Élysée avant les séances du Conseil des ministres consacrées à la région parisienne. delouvrier nous faisait souvent le récit de ces visites. il adorait contrefaire la voix du Général.
Entretien avec Serge Goldberg
57
Je me souviens notamment d’une scène où delouvrier nous racontait que de Gaulle lui avait dit: «il me faudrait un nouvel Haussmann. Mais la situation a changé. napoléon iii, lui, avait du pouvoir.»
À quel moment a-t-on commencé à parler des villes nouvelles? avant même l’arrivée de delouvrier, on évoquait déjà la pers-
pective de la construction d’un certain nombre de villes nouvelles (au sud de la future Marne-la-vallée). nous avons commencé à aborder véritablement cette question à la fin de l’année 1962. Quand delouvrier s’y est intéressé nous avons effectué une série de voyages en suède, en Finlande et au royaume-uni. Je dois préciser que l’architecture finlandaise et suédoise a eu une influence notable sur nos travaux.
Comment a été élaboré le Schéma directeur? C’est Michel Piquard qui a rédigé le livre blanc sur la région
parisienne. L’iaurP a ensuite consulté beaucoup de gens. C’était toujours Paul delouvrier qui illustrait le schéma directeur, en infléchissant la présentation en fonction de l’interlocuteur. une rencontre avec Marc Jacquet, qui était alors ministre des Travaux publics, a eu une incidence notable sur le choix de l’emplacement du futur aéroport de roissy. Je me souviens aussi (c’était la fin de 1963 ou le début de 1964) d’une présentation du schéma en présence d’andré Malraux. delouvrier exposait et Malraux ne faisait aucun commentaire. Millier eut alors une idée de génie: «Monsieur le ministre, ne faudrait-il pas créer un haut lieu de culture dans ces villes nouvelles?». Malraux s’est emparé de l’idée et a improvisé un discours d’une heure…
Le schéma directeur a finalement été finalisé en juillet 1964. nous avons sablé le champagne avec Jacques Michel, Jean Millier, Michel Piquard et Jean vaujour.
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
58
Quelle était, au quotidien, l’activité de Paul Delouvrier? il avait mis en place une organisation d’encadrement très
moderne. il y avait le Groupe central des villes nouvelles, dont le secrétariat général a été confié à roger Goetze. C’était lui qui négociait avec le ministère des Finances et avec la direction du budget.
delouvrier se rendait lui-même assez peu sur les sites en construction, car cette tâche était surtout confiée aux directeurs des villes nouvelles. en revanche, c’était lui qui assurait le contact avec les grandes banques parisiennes pour toutes les questions d’emprunt. C’était également lui qui rencontrait la plupart du temps les ministres en charge du dossier, en particulier le ministre de l’Équipement. si les rapports étaient bons avec Pisani et ortoli, ils ont été épouvantables avec Chalandon, homme insupportable et vaniteux.
Comment êtes-vous devenu directeur de l’établissement public de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines?
Quand edgard Pisani a quitté le ministère, en avril 1967, il avait déjà nommé tous les directeurs des villes nouvelles, sauf celui de la ville de Trappes (qui est devenue par la suite saint-Quentin-en-Yvelines) et du Grand Évry (qui est devenu Melun-sénart). Je suis allé voir delouvrier, je lui ai dit que j’étais candidat pour Trappes. il a hésité pendant plus d’un an. et finalement j’ai été nommé quelques mois avant qu’il ne quitte le district.
En 1983, vous avez retrouvé Paul Delouvrier à l’établissement public du Parc de la Villette…
Je suis arrivé à la villette par un concours de circonstances. après avoir été nommé président de l’établissement public en 1977, delouvrier avait pris comme directeur général Yves Maux, un jeune ingénieur des Ponts. Cela n’a pas fonctionné.
de mon côté, j’avais été mis au placard pendant deux ou trois ans. un jour, j’ai reçu un coup de fil d’Yves dauge. Le président
Entretien avec Serge Goldberg
59
Mitterrand avait le projet de construire une salle de rock à la Porte de Bagnolet, près d’un échangeur routier. on lui avait promis de bâtir en un an une salle de 10 000 places. J’ai dit au téléphone que cela n’était possible et que l’emplacement n’était pas approprié. Jack Lang, qui avait défendu le projet, a piqué une crise épouvan-table, car on lui avait raconté des histoires. Je lui ai montré qu’il était possible de construire cette salle à la villette: l’État participerait à hauteur de dix millions de francs, le reste serait financé par un emprunt de la Caisse des dépôts. Le Zénith est né comme cela…
Je me suis heurté à delouvrier, qui ne voulait pas de salle rock à la villette, mais Jack Lang (nous sommes en février 1983) lui a forcé la main et a emporté la décision. Heureux de cette réalisation, Lang m’a proposé de succéder à Christian sautter, qui cherchait un remplaçant au poste de directeur général de la villette. J’ai accepté.
delouvrier ne m’a pas vu arriver avec plaisir. il m’a mis à l’épreuve: tout d’abord, il m’a demandé de faire un audit, puis il a accepté ma présence. Pendant un an, je l’ai vu au moins vingt fois par jour. Comme il avait toujours des idées à me soumettre, il n’hésitait pas à m’appeler toutes les trente minutes!
À ce moment, où en était la réalisation de la Villette? en 1977, valéry Giscard d’estaing avait demandé à Maurice
Lévy de lui remettre un rapport sur l’utilisation des terrains où auraient dû se trouver les abattoirs de Paris. Cette brillante opération s’était soldée par un milliard de dettes pour la ville de Paris, et les abattoirs n’étaient pas fonctionnels. L’État a repris ces terrains (il s’agissait de cinquante hectares en friche). Giscard avait déjà décidé de créer une Cité de la musique, et il était déjà question d’un musée des sciences (ce qui suscitait l’hostilité du Palais de la découverte, qui existait déjà).
Quand delouvrier est arrivé, il a eu la tâche d’organiser un concours d’architecture pour un musée des sciences et un centre de musique et danse.
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
60
En 1981, François Mitterrand devient président de la République. Mitterrand et delouvrier se sont rencontrés assez souvent.
delouvrier intervenait souvent auprès du Président par l’inter-médiaire de la sœur de celui-ci, Geneviève delachenal. avant l’élection de Mitterrand, il avait déjà été décidé de construire une salle à écran géant hémisphérique, qui est devenue la Géode. Quatre ingénieurs (qui avaient travaillé au centre Pompidou) se sont rendus à orlando (Floride) pour s’inspirer d’une salle de cinéma analogue. Giscard était hostile au projet de la Géode, ou mieux, il la voulait à l’intérieur de la Cité des sciences. Quand Mitterrand a été élu, delouvrier s’est précipité à l’Élysée pour faire modifier le projet, ce qui a été le cas.
Le Delouvrier que vous avez connu à la Villette était-il différent de celui du District?
avec l’âge, ses traits de caractère se sont exagérés. À chaque fois qu’il visitait un chantier, il agissait toujours en homme de théâtre… Comme je vous ai dit, il a eu un rôle très important pour sauver la Géode. il a également fait agrandir le hall de la Cité des sciences. il était encore président de la villette quand a été lancé le concours de la Cité de la musique. il a tenu à ce que les bâtiments de celle-ci soient équilibrés des deux côtés et il a eu raison. Le projet qui lui tenait le plus à cœur était la Cité des sciences, même si l’architecte avait été nommé sur insistance de Jack Lang. en revanche, le projet de la Cité de la musique lui était extérieur, même s’il a fait nommer son président et son directeur général. enfin, il n’aimait pas du tout le parc de la villette.
En 1984, Paul Delouvrier est flanqué à la retraite. La loi sur la retraite à 60 ans venait d’être adoptée et les direc-
teurs des établissements publics ne pouvaient pas rester en place au-delà des 70 ans. delouvrier, qui allait les avoir, avait pensé qu’il y aurait des exceptions à cette règle. Quand il a compris que ce ne
Entretien avec Serge Goldberg
61
serait pas le cas, il a donné sa démission, quinze jours avant son anniversaire.
Je lui ai succédé à la présidence de l’établissement public de la villette, tandis qu’il en est devenu le président d’honneur. dans ses nouvelles fonctions, il m’a laissé agir comme je le souhaitais. il ne lui est arrivé qu’une ou de deux fois de dire: «À votre place, j’aurais fait ceci ou cela…» en revanche, je m’effaçais lors des cérémonies officielles. C’est Paul delouvrier qui a accueilli le président Mitterrand lors des inaugurations de la Grande halle de la villette (en janvier 1985) et de la Cité des sciences et des industries (en 1986).
en conclusion, je dirais que Paul delouvrier a beaucoup aimé l’expérience de la villette, la dernière d’une longue série, et qu’il aurait certainement préféré ne pas partir à la retraite!
63
entretien avec Jean-eudes roullier
Vous avez rencontré Paul Delouvrier en Algérie en 1958. Était-ce au cours de sa mission d’exploration ou quand il était déjà délégué général du gouvernement?
au cours de sa mission d’exploration. Paul delouvrier avait été envoyé, un peu incognito par le général de Gaulle qui lui avait demandé de passer trois semaines en algérie et de lui donner son sentiment. on avait organisé un dîner chez Michel rocard avec quatre ou cinq autres stagiaires de notre promotion de l’ena. Quelqu’un m’avait demandé d’apporter les photos de l’assaut du bâtiment du gouverneur général. en effet, le 13 mai 1958, j’avais eu l’idée de prendre mon appareil photo pour prendre des photos depuis la terrasse, car il y avait ce jour-là une manifestation autour du monument aux morts. au bout d’un certain temps, de petits groupes se sont mis à monter les escaliers et se rapprochaient des grilles du gouvernement général. J’ai pris machinalement des photos, jusqu’au moment où les parachutistes ont pratiqué un trou dans la grille et la foule s’y est engouffrée. il y a eu des bagarres avec des gaz lacrymogènes. Ces photos ont beaucoup impressionné
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
64
delouvrier, car il voyait très bien qu’au-delà des mouvements de foule, il y avait des hommes qui savaient très bien ce qu’ils cherchaient. il avait beaucoup de curiosité et posait beaucoup de questions sur ce que pensait la population. delouvrier lui-même m’a beaucoup impressionné, d’autant plus qu’il avait un côté Gary Cooper, qui me rappelait des films que j’avais vus dans ma jeunesse…
Et quand il a été nommé délégué général, l’avez-vous souvent revu?
Ma seule autre rencontre avec lui en algérie a eu lieu un peu plus tard, quand il avait été nommé délégué général du gouver-nement. Je l’ai croisé à la sortie de la messe. on a échangé deux mots et il a eu pratiquement une seule phrase: «Me voilà prisonnier d’honneur.»
Mon impression était double: c’était un homme de respon-sabilité, il avait une fierté d’être à la tête de l’administration civile en algérie. en même temps, c’était à des années-lumière de tout ce qu’il avait fait auparavant, de ses compétences financières.
À part cette rencontre, je ne l’ai pas vraiment revu en algérie. Car nos fonctions (il s’agissait notamment de faire la tournée des perceptions et de régler les problèmes de cadastre) ne nous amenaient pas à le voir. Le seul énarque qui ait continué à avoir des contacts avec delouvrier fut Michel rocard, qui avait «monté» avec lui une mission sur les camps de regroupement, dont nous n’étions pas vraiment au courant.
delouvrier était un homme d’honneur et d’un grand réalisme. il a essayé d’avoir tous les contacts pour trouver une issue à la crise algérienne. À cette époque, il y a eu tout un mouvement, lancé par alain Peyrefitte, pour arriver à une partition de l’algérie. delouvrier a vite compris que cette proposition n’était pas réaliste et qu’on allait vers l’indépendance.
Entretien avec Jean-Eudes Roullier
65
Comment êtes-vous arrivé au District? après mon stage de l’ena en algérie, je suis rentré en France,
avant d’être envoyé une nouvelle fois en algérie avec les autres inspecteurs des Finances. À mon retour en France, delouvrier avait déjà été nommé à la tête du district. il a commandé à l’ins-pection des Finances un énorme rapport sur la fiscalité locale en région parisienne, car il y avait une forte disparité entre les communes. il a ensuite demandé à l’inspection un chargé de mission pour exploiter ce rapport sur la fiscalité (dont il n’est jamais rien sorti, du fait de l’opposition du rapporteur général du budget de la ville de Paris). C’est ainsi que je suis entré au district. Je note au passage que je n’ai pas l’impression d’avoir emballé Paul delouvrier…
il travaillait avec une petite équipe de sept ou huit personnes. il tenait à avoir un préfet (Jean vaujour), un ingénieur des Ponts (Jean Millier) et un inspecteur des Finances, Jean Masquart, qui était dans les rouages de la direction du budget. il y avait ensuite Jean Poincaré et Éric Westphal, qui avaient déjà été ses colla- borateurs en algérie, et trois ou quatre chargés de mission et de jeunes inspecteurs des Ponts (comme Christian Bouvier, qui a rejoint l’équipe un peu plus tard). Par ailleurs, delouvrier conti-nuait à avoir des contacts avec des anciens des Finances, comme simon nora ou François Bloch-Lainé. il avait un réseau de connaissances remarquable, grâce à ses cours de sciences-Po, à ses activités de financier à la Haute autorité et aux amitiés qu’il avait nouées avec les anciens résistants (comme Georges valbon).
Comment se passaient les réunions au District?on était sept ou huit, y compris l’agent comptable du district.
delouvrier passait son temps à prendre des notes. Les brain-stormings sur le schéma directeur ont surtout eu lieu à l’iaurP. delouvrier a fixé d’emblée l’objectif qu’il fallait regarder à échéance de 12 ans, puis à échéance de l’an 2000. au départ, il n’y avait que sept ou huit personnes à l’iaurP, mais delouvrier a obtenu
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
66
un crédit de dix-sept millions de francs (ce qui était l’équivalent de tous les crédits d’urbanisme du ministère de la Construction). Trois ans après, environ 200 personnes travaillaient à l’iaurP. une autre chose qui m’a frappé, c’était le refus des «mandarins». La moyenne d’âge de ceux qui travaillaient à l’iaurP était autour des 30 ans.
de mon côté, je gérais des dossiers administratifs. Tout a basculé vers 1963 et 1964, quand on a lancé le projet des villes nouvelles. dans les premières années, delouvrier s’était déjà posé la question des villes nouvelles, s’était beaucoup promené, avait réuni des groupes de promoteurs, de constructeurs, les membres d’associations. Lors d’une de ces réunions, un promoteur lui a dit: «Monsieur le délégué, votre projet est formidable et passionnant, mais dans le système administratif français, c’est exactement comme si vous vouliez construire le Concorde avec un tournevis. aucune des structures communales ou d’aménagement ne permet de faire ce que vous préconisez». J’ai progressivement reçu la mission de décortiquer les problèmes communaux, en matière de fiscalité et d’aménagement. nous sommes allés en angleterre pour voir comment on s’y était pris pour construire les villes nouvelles et mettre en place les établissements publics d’aménagement. delouvrier tenait à ce que ses collaborateurs fassent au moins une fois par an un voyage à l’étranger…
Quels pays avez-vous visité dans le cadre de vos missions? delouvrier m’a envoyé aux États-unis, avec Michel Picquard et
un ingénieur des Ponts pour observer quelles étaient les approches américaines en matière de politique urbaine. J’ai été en suède avec une équipe de l’iaurP. J’ai fait plusieurs visites en angleterre, car les villes nouvelles anglaises étaient la grande référence à l’époque. Je m’occupais surtout des mécanismes financiers des sociétés mixtes et des relations avec les administrations centrales. J’ai donc noué des contacts avec des urbanistes anglais, qui nous ont ensuite rendu visite en France.
Entretien avec Jean-Eudes Roullier
67
Pouvez-vous me décrire les relations entre Paul Delouvrier et les différents ministres de l’Équipement? Commençons par Edgard Pisani.
Les rapports entre les deux hommes étaient généralement bons. edgard Pisani était un homme expansif, il nous recevait dans un grand bureau, c’était un pacha à sa manière. La région parisienne était l’enjeu de tous les débats et de toutes les spéculations. Pour Pisani, il devait être irritant de se trouver à chaque fois devant quelqu’un qui était à la fois moins et plus qu’un ministre. en même temps, Pisani partageait beaucoup des préoccupations et des objectifs de delouvrier. en 1966, les ministères de la Construc-tion et de l’Équipement ont été fusionnés. L’un des objectifs de Pisani était de préparer le plan d’orientation foncière (PLouF). Le titre n’était pas des plus heureux! Pisani en avait élaboré un premier projet, qu’il avait envoyé à un petit nombre de personnes, dont delouvrier. Celui-ci m’a demandé de faire une note, ce que j’ai fait, critiquant certains aspects un peu farfelus. J’en ai ronéotypé cinq exemplaires et j’en ai envoyé un au directeur de cabinet de Pisani. Cela a provoqué un violent accident. Pisani a cru que j’avais ronéotypé un nombre important d’exemplaires, ce qui n’était pas le cas. Pisani a demandé à delouvrier de me mettre à la porte! on a convenu que je rencontre Georges Pébereau (le directeur-adjoint du cabinet de Pisani), chacun accompagné d’un témoin. Cela a commencé brutalement, puis Pébereau m’a gardé pour le déjeuner.
Il y a ensuite eu François-Xavier Ortoli. Pisani ayant démissionné, ortoli lui a succédé et Pébereau est
devenu son directeur de cabinet. J’étais dans une situation difficile, car j’avais été prêté pendant quatre ans au district par l’inspection des Finances. il fallait me trouver un poste. Pébereau est venu me voir et m’a proposé un emploi bien rémunéré, à condition que je travaille pour le cabinet. Comme je ne voulais pas quitter delouvrier, on a fini par couper la poire en deux. J’ai travaillé à
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
68
mi-temps pour delouvrier et j’étais à mi-temps conseiller budgétaire pour le cabinet.
on vivait alors une période difficile. Pour faire quoi que ce soit, il fallait l’accord de trois ministères (Finances, Équipement, intérieur). on a créé un groupe de travail interministériel sur les villes nouvelles de la région parisienne, ce qui permettait à delouvrier de réunir sous sa présidence les représentants des trois ministères. il y avait notamment un problème lié aux rues, car on ne savait pas de quel ressort étaient les voies des villes nouvelles. on a donc créé une nouvelle catégorie de voirie primaire des villes nouvelles…
Les rapports entre Chalandon et Delouvrier n’ont pas été faciles. Vous avez travaillé pour les deux hommes. D’où sont nés ces différends?
Je n’en sais rien. C’étaient des hommes très différents, il s’agissait d’une question épidermique. delouvrier avait un tempérament de professeur, Chalandon était beaucoup plus impulsif. il y avait eu des liens entre eux, car ils se connaissaient depuis la guerre. delouvrier avait peut-être été le professeur de Chalandon à sciences-Po, et ils avaient tous les deux été résistants dans la région de nemours. J’ai cru comprendre que Chalandon recevait une maîtresse dans la forêt de Fontainebleau, protégé par quelques maquisards, qui s’étaient fait surprendre et descendre par les allemands…
J’ai travaillé pour delouvrier, tout en étant au cabinet de François-Xavier ortoli. après un bref passage de robert Galley, c’est Chalandon qui a été nommé ministre de l’Équipement. delouvrier m’a convoqué: «roullier, ça va mal se passer. vous ne pouvez pas me laisser tomber, j’ai besoin de vous.» Je songeais à quitter le cabinet, il m’a convaincu d’y rester, car, m’a-t-il dit, «il avait besoin d’un agent dans la place». il s’est arrangé, je ne sais comment, pour que je reçoive la visite d’un émissaire de Chalandon (Michel Carmona), qui m’a dit que Chalandon serait
Entretien avec Jean-Eudes Roullier
69
heureux que je rentre dans son cabinet. J’ai accepté. Huit jours après, Chalandon a monté une grande réunion avec tout son cabinet, avec M. Labourdette, l’architecte des grands ensembles (qui avait construit sarcelles) et Max stern, qui était un ami de Chalandon, qui dirigeait le Bureau d’études et de recherches urbaines (Beru). La réunion portait sur le schéma directeur de la région parisienne. Tout le monde s’est mis à déblatérer sur le schéma «qui n’avait ni queue ni tête», pourquoi il fallait une ville nouvelle à tel endroit et pas à tel autre, pourquoi tel axe routier passait par là et pas dans une autre direction… Le maître mot de Chalandon fut: «delouvrier, c’est le papisme, il veut tout diriger», alors que lui, c’était le libéralisme. Je n’ai pas ouvert la bouche, mais à la fin de la réunion, je suis allé voir Labourdette. Je lui ai dit que j’avais travaillé au schéma directeur, que je pensais que les villes nouvelles étaient une bonne solution. À ma grande surprise, Labourdette m’a dit: «Cher ami, vous avez peut-être raison, mais pourquoi delouvrier n’est-il pas venu me chercher pour faire une ville nouvelle?». Je suis allé voir Max stern et il m’a tenu le même type de discours. Cela a joué contre delouvrier. il avait misé sur de jeunes architectes. Beaucoup des mandarins de l’époque lui en voulaient, ils étaient choqués. J’ai aussi eu une discussion avec Chalandon: «Mais pourquoi parlez-vous de villes nouvelles? Ce ne sont pas des villes et elles ne sont pas nouvelles; et puis, je ne vois que des maquettes. Je ne suis pas contre, mais quand verrons-nous ces villes?» il a ensuite donné des directives, qui n’étaient d’ailleurs pas contre les villes nouvelles, mais qui permettaient de construire ailleurs, tout en diminuant au maximum l’intervention administrative.
Je me souviens d’un autre épisode. Les rapports étaient glaciaux entre delouvrier et Chalandon. Chalandon a fait le grand effort de proposer à delouvrier de venir rue Barbet-du-Jouy pour une réunion sur le schéma directeur. Comme toujours quand il était un peu mal à l’aise, delouvrier a fait un exposé très professoral. Chalandon a dit à delouvrier: «dans le domaine autoroutier,
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
70
il n’y a qu’une seule urgence: c’est doubler l’autoroute de l’ouest, qui est toujours encombrée.» il s’est fait couper par delouvrier: «Ca, c’est une idée de bourgeois», car les bourgeois habitent à l’ouest. Chalandon s’emmêle les pinceaux, il a parlé des détails techniques, mais à partir de là il n’y avait plus de discussion possible. il y avait une irritation visible de part et d’autre.
en même temps, Chalandon a plutôt soutenu les villes nouvelles et, en quelque sorte, il a contribué à les sauver. après le départ de delouvrier, Chalandon, furieux qu’on n’arrive pas à accroître le rythme des constructions en Île-de-France, a déclaré deux ou trois fois qu’il enlèverait aux maires les permis de construire. Les maires étaient furieux. M. doublet m’a convoqué. Je lui ai proposé de convoquer tous les maires de la région parisienne et de faire en sorte que M. dailly parle en dernier (s’il parlait en premier, aucun maire n’aurait osé le contredire). J’ai fait un grand discours sur les villes nouvelles, en invitant à réfléchir à l’avenir de la seine- et-Marne si les permis de construire étaient distribués sans l’avis des maires. ne valait-il pas mieux se concerter et urbaniser la seine-et-Marne selon un schéma raisonnable? Les maires ont été unanimement d’accord. dès lors, ils ont commencé à défendre le schéma directeur et les villes nouvelles, en partie pour se prémunir contre les menaces de Chalandon!
Pour terminer mon histoire personnelle, il y a eu un remaniement ministériel en 1970, mais Chalandon restait au gouver nement. J’ai appris par divers moyens, qu’il était question que je parte du cabinet de Chalandon. Je lui ai demandé rendez-vous. il m’a accueilli froidement: «Cher ami, il ne faut pas rester trop longtemps dans un cabinet ministériel. nous allons créer un groupe central des villes nouvelles, vous en serez le secrétaire général». Chalandon songeait à nommer son collaborateur Max stern comme président. Finalement, propulsé par la daTar, c’est roger Goetze qui l’est devenu.
Entretien avec Jean-Eudes Roullier
71
Quelle était l’attitude à votre égard de Georges Pompidou et de ses équipes?
François-Xavier ortoli a été successivement directeur de cabinet de Pompidou, commissaire au Plan, puis ministre de l’Équipe ment. il a eu une importance certaine pour la réussite de nos projets, car il y avait entre lui et delouvrier une complicité évidente, qui s’est perpétuée par la suite. d’autres personnes ont servi d’intermédiaire entre notre équipe et le pouvoir, comme les préfets aurillac et Carrère, qui étaient respectivement aux cabi-nets de Pompidou et du chef de l’État. delouvrier avait de bons correspondants. autour de Pompidou, il y avait tout un milieu «parisien», avec lequel il y a parfois eu des heurts. delouvrier souhaitait implanter des universités en banlieue et dans les villes nouvelles, tandis que Pompidou voulait ardemment qu’elles restent à Paris. Mais en même temps, Pompidou respectait delouvrier et inversement.
Quelles étaient vos relations avec la DATAR?dans les premières années de la daTar (elle a été créée en
1963), olivier Guichard et Jérôme Monod étaient au cabinet de Pompidou. Ce sont eux qui ont géré le domaine de l’aménagement du territoire. Je me souviens de delouvrier me disant: «Qu’est-ce qu’il est dur, Monod» (il savait que Monod avait été mon com-pagnon de régiment en algérie). Monod est un homme franc et direct, qualités pour lesquelles delouvrier le respectait beaucoup. il y a eu une bagarre pour la ville nouvelle de Mantes-sud. Pour marquer que c’était la daTar qui était la plus forte, Monod a obtenu du gouvernement sa suppression pour créer une ville nouvelle au vaudreuil, qui n’a jamais marché car elle était trop loin de Paris. du temps de Chalandon, j’ai été beaucoup aidé par la daTar. L’exemple de delouvrier et de l’iaurP ont été imités dans les métropoles régionales: il y a eu les organismes régionaux d’étude d’aires métropolitaines (les oreaM) qui s’inspiraient de l’iaurP; comme en région parisienne, ce sont de jeunes
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
72
architectes qui ont proposé l’aménagement des métropoles régio-nales (comme à Lyon, sur l’étang de Berre et à villeneuve-d’ascq). Je recevais régulièrement de jeunes et remarquables ingénieurs des Ponts et Chaussées qui nous demandaient de nous occuper des villes nouvelles de province. L’idée d’un groupe central des villes nouvelles, contre laquelle s’est beaucoup battu Marcel doublet, le successeur de delouvrier, est venue de la daTar.
Et avec la Caisse des dépôts? Y a-t-il eu des affrontements avec vous?
C’est une histoire que personne n’a écrite. Bloch-Lainé était un ami très proche de delouvrier. il avait créé la sCiC et la sCeT, qui ont été très efficaces, et construit des centaines de milliers de logements. Quand je suis rentré chez delouvrier, toute la politique des grands ensembles était pilotée par la Caisse des dépôts, qui distribuait les financements (sous forme de prêts) à des sociétés d’économie mixte. il s’était créé un empire qui avait, pour ainsi dire, le monopole des prêts: grâce à ce système, elle faisait construire 300 000 ou 400 000 logements par an, le plus souvent des barres et des tours. on construisait surtout dans des terrains agricoles mal desservis. Cela a donné sarcelles. dans ses discours, delouvrier en rajoutait peut-être un peu et répétait souvent: «Tout sauf les grands ensembles». il a fait adopter deux actes importants: une directive qui interdisait de confier plus de six cents logements au même architecte (à l’époque, certains archi-tectes s’occupaient de plusieurs milliers de logements); par ailleurs, il a organisé en 1964 le premier concours national des maisons individuelles groupées. À un certain niveau, la structure de la CdC (surtout celle de la sCeT) était très centrée sur elle-même. elle s’opposait assez violemment aux villes nouvelles, d’autant plus qu’elle s’était mise à acheter des terrains qui, par la suite, se sont avérés inconstructibles. Quand on a construit l’établissement public de la ville de Melun-sénart (le dernier de la région pari-sienne), la société d’économie mixte de la Caisse des dépôts s’y est
Entretien avec Jean-Eudes Roullier
73
opposée. La structure de la Caisse des dépôts était fondée sur deux éléments que Paul delouvrier détestait: 1. la présence d’un architecte en chef, souvent un grand «mandarin», qui avait le monopole d’une opération et se réservait une partie des construc-tions ou qui choisissait les architectes parmi ses amis; 2. les conseillers techniques de la Caisse des dépôts, souvent des Parisiens, qui voulaient construire rapidement et à faible coût. Ce qui a donné ce qu’on a vu. Le système préconisé par delouvrier était à l’opposé: les équipes étaient jeunes, il n’y avait pas de hiérarchie. Les ingénieurs, les architectes, les urbanistes étaient sur place, ils s’engueulaient, mais travaillaient ensemble. Bloch-Lainé a accepté assez vite cette diminution du rôle de la Caisse des dépôts, d’autant plus qu’il se rendait compte qu’elle ne pouvait pas remplir les tâches qui lui étaient demandées.
Quels sont vos souvenirs du départ de Delouvrier du District? Estimait-il que sa tâche était terminée ou aurait-il souhaité rester encore quelque temps?
vers 1968, delouvrier a connu une période de traumatisme et de crise psychologique. ses adversaires les plus violents étaient les grands propriétaires fonciers. La politique de base de delouvrier était d’acheter des terres au prix agricole et d’en interdire la construction. Le système des Zad (zones d’aménagement différé) donnait à l’État un droit de préemption. il y a eu un conflit d’une rare violence pour le Bois notre-dame (aux portes de Paris), où les promoteurs voulaient construire une ville dans la forêt. delouvrier a reçu des pressions et a mis sa démission dans la balance pour sauvegarder la forêt.
Tout cela a commencé avec la construction de l’aéroport de roissy. delouvrier a constitué une brigade d’intervention de choc, pour rechercher les terres qui pouvaient être achetées à bas prix, tout en évitant la spéculation foncière. Les grands pro-priétaires fonciers, qui se sentaient pénalisés par cette politique, ont lancé une série de campagnes contre delouvrier, notamment
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
74
par l’intermédiaire du sénateur dailly, qui représentait les bette-raviers de la région parisienne. Le sénateur Édouard Bonnefous a lui aussi mené des campagnes acharnées contre nos projets. J’ai donc connu un delouvrier qui, pendant trois semaines, ne parlait plus à personne.
son départ a été une épreuve, même s’il a fini par se convaincre que ce n’était pas plus mal. il y a eu le climat des derniers mois, car on a évoqué son départ dès 1968. il y avait des tensions, car des intérêts puissants étaient en jeu. Par la suite, je l’ai revu plusieurs fois, pour le début de l’année ou quand on a inauguré une rue Paul-delouvrier à Évry. Je note également que Paul delouvrier a reçu le prix Érasme. Le discours qu’il a prononcé à cette occasion mériterait d’être publié: ce texte remarquable présente sa vision d’ensemble des villes nouvelles 4.
4. Ce discours est présenté en annexe.
79
entretien avec edgard Pisani
Quel est votre premier souvenir de Paul Delouvrier?une visite à sa maison de campagne à Héricy, près de la forêt
de Fontainebleau.Les delouvrier m’avaient invité à passer la journée chez eux,
avec François-Xavier ortoli et deux ou trois autres personnes. nous avons refait le monde trois fois en une après-midi. Ce devait être vers 1964-1965, mais je l’avais rencontré auparavant.
il y avait un peu de l’aventurier dans son tempérament: de la témérité, un certain goût de la provocation. il aimait susciter la contradiction, ce qui contrastait avec l’attitude de son épouse, qui était calme et posée.
Ce qui fascinait chez lui, c’était son obéissance dans l’auto-nomie. nous avons toujours eu, l’un à l’égard de l’autre, une liberté extrême: à diverses reprises, il m’a demandé des rendez-vous en tête-à-tête pour me dire son désaccord sur tel ou tel point. et quand le politique l’avait écouté, il estimait de son devoir d’obéir. si cela lui avait été impossible, la décision étant contraire à sa conscience, il aurait démissionné.
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
80
Comparées à celles des autres grands commis de l’État, ses qualités étaient peu fréquentes: il avait du charisme, une ima-gination folle, des audaces qui le faisaient sortir de son rôle de grand commis (avec cependant une finesse qui lui évitait les risques inhérents à ses prises de position). il y avait en lui une dialectique permanente entre le réalisme et la vision prophétique. on l’a vu en algérie.
D’où tenait-il ces qualités?il avait ce qu’on pourrait appeler une attitude de scout, toujours
prêt… J’étais impressionné par sa capacité à maîtriser intellectuell-
ement, techniquement et financièrement un problème, à mettre ses connaissances au service de la vision qu’il partageait avec son patron: il a été un grand médiateur entre l’appareil administratif et les responsables politiques. et comme Bloch-Lainé, il a refusé d’être ministre, parce que ce n’était pas son métier.
Avez-vous été en relation avec lui pour l’aménagement de l’Est parisien?
oui. et une anecdote me revient à l’esprit. on parlait beaucoup d’équilibrer Paris à l’est, et la décision avait été prise de déloger les entrepôts de Bercy. J’étais alors ministre de l’Équipement et nous nous sommes retrouvés dans mon bureau, delouvrier, le préfet raymond Haas-Picard et moi.
deux heures durant, nous avons discuté: il fallait utiliser ces espaces. Je leur ai proposé de nous retrouver le lendemain matin à 7 h 30 à Bercy, où nous avons longuement arpenté les terrains et déambulé à travers les cuves à l’abandon, tandis que manuten-tionnaires et employés commençaient à arriver, tout étonnés de voir ces bourgeois se promener sur leur lieu de travail.
réaction de delouvrier: «il faudrait s’approprier tout cela (c’était du domaine de l’État et de la ville de Paris) et mettre en place un grand projet.» Haas-Picard nous a dit qu’il en parlerait
Entretien avec Edgard Pisani
81
en conseil municipal. delouvrier et moi étions sûrs qu’il échouerait. Ce fut le contraire: le préfet a convaincu les deux ou trois leaders qui comptaient et, moins d’une semaine plus tard, une délibération du conseil lançait le projet du quartier et du parc de Bercy.
Et pour les villes nouvelles?Je me souviens d’une autre anecdote.C’était à Corbeil, où delouvrier voulait me présenter le projet
d’Évry-ville nouvelle. Je l’ai trouvé un peu optimiste, avec une attitude à la hussarde, entraînant derrière lui toute son équipe d’architectes et d’urbanistes. Partisan des villes nouvelles, je me méfiais cependant de cet enthousiasme. C’était un peu le défaut de Paul delouvrier: quand il trouvait qu’un projet était beau, il mettait la machine en route et ne tenait plus compte des dif-ficultés techniques, des oppositions ou de l’avis des gens. J’ai dit ce jour-là que les villes nouvelles ne devaient pas être une «aven-ture intellectuelle». La presse s’est emparée de l’expression, qui a fait des vagues dans le tout-Paris.
Quelle a été la réaction de Delouvrier quand vous avez parlé d’«aventure intellectuelle»?
il m’a demandé rendez-vous et nous avons longuement discuté. il faut avoir à l’esprit la cordialité de cet homme. Même quand il «cognait», son but n’était pas de détruire, mais de l’emporter.
il voulait savoir le pourquoi de mes propos. or, j’avais une certaine autorité en la matière, puisque j’avais créé en Haute-Marne la première ville nouvelle de l’après-guerre (une petite ville de 20 000 habitants, en fait une opération immobilière assez audacieuse). Je lui ai raconté mon expérience, en lui recomman-dant de ne pas achever ses villes nouvelles: il fallait laisser des espaces vides. Car c’est une aventure périlleuse que d’imaginer comment vivra une ville, comment se feront les équilibres entre les commerces et les zones de résidence: la vie corrige ce que l’imagination a conçu. À partir de là, nous avons engagé une
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
82
conversation positive, cordiale: il fallait quitter une œuvre en lui laissant une marge de devenir. C’était fondamentalement ce que j’avais voulu dire en parlant d’aventure intellectuelle: croire que l’on peut se passer du temps pour ajuster et modeler une ville. en réalité, il faut aller suffisamment loin pour que les choses soient irréversibles, mais ne pas prétendre les achever, comme si on était capable d’imaginer leur vie future.
delouvrier et moi étions faits pour nous entendre. et nous étions proches quand nous parlions d’urbanisme, de la situation algérienne ou de l’europe.
Quel regard portez-vous aujourd’hui sur les villes nouvelles?Je pense qu’elles ont réussi.
Quelle doit être aujourd’hui la responsabilité de l’État en matière d’aménagement du territoire?
L’aménagement du territoire est un concept macroécono-mique, qui recouvre des problèmes divers comme la désertification ou l’urbanisme des banlieues. au niveau local, il appartient aux élus de décider, de faire leurs plans et de les mettre en œuvre.
Quant à l’État, il lui revient de définir les règles générales (les élus locaux sont davantage que lui exposés aux pressions finan-cières) et de mobiliser les moyens au service de ceux qui entre-prennent. C’est ce que, en leur temps, ont fait olivier Guichard et Paul delouvrier.
83
entretien avec Georges valbon
Quand avez-vous rencontré Paul Delouvrier?Probablement quand il était délégué général au district de la
région de Paris et que j’étais membre du Comité d’aménagement de la région parisienne. Je l’ai alors vu à diverses reprises pour évoquer les problèmes de la banlieue et du district.
J’étais de longue date un élu communiste, après avoir été un jeune résistant. Paul delouvrier connaissait mes opinions poli-tiques, comme je connaissais son admiration et sa fidélité pour le général de Gaulle. ses idées étaient donc opposées aux miennes, mais il était très ouvert.
C’était un homme intelligent, de grande envergure, travailleur, qui faisait de la politique dans un sens non péjoratif. Grand commis de l’État, il aurait pu avoir d’autres responsabilités, mais il n’y tenait pas: il préférait servir l’État et, à mon avis, il le servait bien, même si quelquefois je ne l’approuvais pas. Paul delouvrier était un homme cordial, et il n’a jamais eu l’attitude classique des préfets à notre égard: sa porte était ouverte.
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
84
Le fait d’avoir été tous deux résistants a-t-il créé entre vous des liens dépassant les étiquettes politiques?
Probablement. il était sensible au fait qu’adolescent, j’y avais joué un rôle, même modeste (à la différence du sien).
il tenait la résistance pour un facteur important dans le choix de ses collaborateurs. À la création du département de la seine-saint-denis, il a insisté auprès du général de Gaulle pour que le premier préfet en fût un ancien résistant, Henri Bouret.
Quand votre collaboration avec le District a-t-elle commencé?vers 1964, quand le gouvernement a modifié les structures
administratives de la région de Paris et remplacé la seine et la seine-et-oise par sept départements: l’essonne, les Hauts- de-seine, la seine-saint-denis, le val-de-Marne, le val-d’oise, la ville de Paris et les Yvelines. nos relations n’ont pas été très bonnes, parce que delouvrier a participé à ce découpage et a longtemps nié mes critiques.
Mais quelques années avant sa mort, dans un article publié dans Le Monde 5, il a évoqué les arrière-pensées gouvernementales de ce découpage: il s’agissait d’éviter les majorités de gauche en région parisienne. La seine-saint-denis était acquise à la gauche, notamment aux communistes, et pour éviter que pareille situation se reproduise dans le val-de-Marne, des communes de droite comme vincennes ou saint-Mandé y ont été incluses afin d’y assurer une «bonne» majorité. en échange, des municipalités communistes appartenant naturellement au val-de-Marne, comme noisy-le-Grand ou neuilly-Plaisance à l’époque, ont été placées en seine-saint-denis afin de constituer une sorte de «ghetto» de la classe ouvrière.
Paul delouvrier, à l’évidence poussé par le gouvernement, a participé à ce «charcutage» destiné à limiter le rôle des commu-nistes. Mais il a aussi été un réaménageur de la région parisienne,
5. «Les années delouvrier, 1961-1969», Le Monde, supplément du 26 novembre 1987.
Entretien avec Georges Valbon
85
dont la structure avait peu changé depuis la guerre: la banlieue était vieillotte, les moyens de transport en dehors de Paris, inexis-tants. il a vu le danger de maintenir cet état de fait, d’autant plus que la population de la région parisienne augmentait. C’est ainsi qu’il a été le promoteur du premier schéma d’aménagement de la région et l’inventeur des villes nouvelles.
Personnellement, j’étais assez opposé à l’idée des villes nou velles, craignant la création de nouveaux pôles, l’isolement croissant d’une partie active de la population, l’aggravation de bien des problèmes, notamment ceux des transports biquotidiens (dans la région parisienne, on travaille rarement là où l’on habite).
Quel regard portez-vous aujourd’hui sur les villes nouvelles? Sont-elles un échec?
non. on a beaucoup fait pour les structurer, pour qu’elles ressemblent à de vraies villes. Mais j’ai une autre opinion sur la question, pour avoir été maire de Bobigny pendant trente ans.
Bobigny était un vieux village, habité par de gens pauvres chassés de Paris entre les deux guerres. Ce que j’espérais pour ma commune, comme pour mon département (dont j’ai présidé le conseil général à partir de 1967), c’était qu’on ne «désosse» pas, qu’on ne désarticule pas les communes de la petite couronne en faveur des villes nouvelles. or c’est en grande partie ce qui s’est passé: des primes ont été données par le gouvernement pour que les entreprises quittent ces communes et s’installent, d’abord dans les villes nouvelles, ensuite en province. en fait, j’aspirais à un brassage des populations, à une diversité des catégories sociales.
Comment se passaient les réunions du conseil d’administration du District?
J’étais un opposant et j’avais des discussions avec Paul delouvrier sur ses orientations, dont je me faisais l’écho pendant les conseils. il connaissait mes opinions. Mais il m’est aussi arrivé d’approuver ses positions, par exemple au sujet des moyens de transport.
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
86
Les débats m’opposaient surtout aux membres de droite. Ce conseil ne reflétait nullement la réalité politique et sociale de la région, et la gauche y était ultra-minoritaire: il n’y avait que deux socialistes et deux communistes, alors qu’à l’époque, la gauche était au moins à égalité avec la droite dans les différentes assem-blées des départements. Ces débats n’étaient donc pas simples.
delouvrier est devenu préfet de région en 1966, après la création des nouveaux départements, et il a aidé à mettre en place des outils de modernisation, ce dont Bobigny a profité. C’est grâce à lui que ma ville a été désignée comme chef-lieu.
Pourquoi Bobigny? d’autres villes avaient été envisagées, dont Bondy. Mais son maire socialiste de l’époque, Maurice Coutreau, était catégoriquement contre la réorganisation de la région parisienne et avait refusé que sa ville devînt chef-lieu. Bobigny présentait des avantages: elle était au centre du département, les axes de circulation pouvaient y converger, et il y avait des terrains libres pour y installer les équipements départementaux. delouvrier a persuadé le gouvernement et le général de Gaulle de renoncer à leurs arrière-pensées politiques et d’accorder la préfecture à une municipalité ayant une majorité incontestée de gauche et un maire communiste.
Au début du District, y a-t-il eu une méfiance à l’égard de Paul Delouvrier?
oui, forte. et pas seulement chez les élus de gauche. Les socialistes craignaient que la réorganisation de la région
parisienne ne fût en réalité qu’une mise sous tutelle par l’État. Le préfet de la seine, dont nous dépendions alors, se comportait comme un adversaire politique: si j’apportais un dossier à la pré-fecture, par exemple pour la création d’une école, il disparaissait immédiatement sous la table. Quand j’étais vice-président du conseil général de la seine, dont je présidais le groupe politique le plus important (cinquante-cinq membres sur cent cinquante), durant des années, le préfet de la seine ne m’a jamais consulté.
Entretien avec Georges Valbon
87
J’étais donc sur ma réserve quand est arrivé Paul delouvrier, puisqu’il représentait le gouvernement. Mais les choses ont changé. et, par la suite, j’ai pu coopérer efficacement avec le préfet Henri Bouret à la mise en place de certaines infrastructures.
Avez-vous d’autres souvenirs de collaboration avec Delouvrier?oui. Ce qui m’amène à parler de l’enseignement.au début des années 1960, il n’y avait ni université ni lycée
dans ce qui par la suite allait devenir le département de la seine-saint-denis: seule existait une annexe du lycée Charlemagne.
delouvrier a contribué à la création de l’université de ville-taneuse: c’est à son époque qu’en fut acheté le terrain. ensuite, lorsque l’université Paris 8 a été expulsée par la majorité du conseil municipal de Paris (pour des raisons politiciennes), il contribua à en installer les équipements en seine-saint-denis. sa politique a donc aidé à développer chez nous les enseignements du second degré et supérieur, car dès lors que les conseils généraux ont pu intervenir dans ce domaine, tout a progressé plus rapidement. Les transports, l’enseignement et la santé étaient nos priorités: delouvrier l’a parfaitement compris.
Quelle a été votre collaboration avec lui pour la création des grands équipements de la région parisienne, notamment le RER et les autoroutes?
il avait accepté mes demandes pour l’aménagement de ma ville et de mon département, et il m’a aidé pour la mise en place de sociétés d’économie mixte, destinées à réaliser ce que légalement les collectivités ne pouvaient pas entreprendre.
dès le début avait été posée la question des transports. or, le métro n’est arrivé à Bobigny qu’en 1983: le prolongement de la ligne, objet d’une vieille bataille, était inscrit dans le projet de l’iaurP, mais les gouvernements successifs de droite en refusaient le financement. Paul delouvrier a aussi contribué au prolongement du métro jusqu’à Montreuil et saint-denis.
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
88
L’une des questions sur lesquelles nous n’avons pas réussi à nous entendre a été celle de la circulation autour de Paris. Pour ma part, je la préférais au développement en rayon (c’est aussi la raison pour laquelle j’étais hostile aux villes nouvelles, qui reproduisaient ce développement en rayon): il fallait des liaisons banlieue-banlieue. C’est pourquoi a été créé le tramway de saint-denis, réalisation dont je suis fier. il serait indispensable de prolonger cette ligne de tramway, car il est malheureusement utopique de vouloir rapprocher les lieux d’habitation et de travail des Franciliens.
Paul delouvrier avait des réticences d’ordre financier à l’égard de ces liaisons banlieue-banlieue, mais il a contribué à créer trois des quatre autoroutes de la région parisienne: l’a3, l’a4, l’a1. L’autoroute a86 était dans les projets de l’iaurP. et la «Fran-cilienne» (a104), elle aussi, a été imaginée à l’époque, mais elle ne fut créée que bien plus tard.
Avez-vous aussi travaillé avec des collaborateurs de Delouvrier?J’ai eu de bonnes relations avec eux: l’équipe de l’iaurP n’était
pas trop dirigiste, même si l’institut avait peut-être des méthodes autoritaires, impulsées par le «patron» – ce qui se comprend, compte tenu des fonctions de celui-ci.
nous avions de grands besoins dans notre département. Les réflexions avec cette équipe, qui nous a consultés sur de nombreux points, nous ont été particulièrement utiles. Le travail fut excellent, et l’iaurP a été l’instrument qui a permis de lancer toutes les grandes opérations nécessaires.
Selon Jean Millier, la difficulté n’était pas tant de construire que d’empêcher de construire. Partagez-vous son opinion?
oui. il fallait faire attention à des promoteurs comme Bouygues.
Quand j’étais président du conseil général de la seine- saint-denis, j’ai veillé à remplacer des zones de bidonvilles par le parc de la Courneuve plutôt que par des constructions: le conseil
Entretien avec Georges Valbon
89
général a bloqué les terrains pour réaliser un espace vert plutôt que des cités ou des zones industrielles que nous souhaitions dans des lieux plus appropriés. Paul delouvrier avait approuvé la création de ce parc, que le conseil général a dû, au début, financer intégralement. Quand il est devenu réalité, Paul delouvrier n’était plus préfet.
Quel doit être le rôle de l’État en matière d’aménagement du territoire?
Toute perspective d’aménagement et toute réponse aux besoins que cela implique ne peuvent pas être imaginées seulement dans quelques têtes, quelles que soient leurs qualités et leurs compétences (je pense à l’iaurP). Les élus doivent contribuer à la réflexion, pour la simple raison qu’ils sont responsables et doivent rendre des comptes aux électeurs. Mais même cela n’est pas suffisant.
Pour qu’elle soit efficace, toute décision doit être imaginée avec les intéressés eux-mêmes, avec les techniciens, les ingénieurs, les chercheurs, le personnel qualifié: un maximum de personnes doit contribuer à la recherche et à la prise de décision.
Je ne suis cependant pas favorable à la multiplication des structures: il existe en France plusieurs structures démocratiques à taille humaine, comme la commune ou même le département. au niveau régional, il est déjà plus difficile d’être à l’écoute des gens pour pouvoir répondre à leurs besoins.
Cette écoute est nécessaire à tous les échelons de la société: dans une entreprise, les salariés ne sont-ils pas aptes, à quelque niveau qu’ils soient, à donner une opinion sur le fonctionnement de leur entreprise? ils ne détiennent pas nécessairement tous les éléments en matière financière: il faut pour cela les spécialistes. Mais les salariés devraient pouvoir dire comment les infrastruc-tures et les moyens de l’entreprise pourraient être mieux utilisés. il en va de même pour les problèmes de sécurité. si on consulte la population d’un quartier, tout le monde – même les jeunes – a envie de donner son avis. La démocratie, c’est faire en sorte que
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
90
le maximum de personnes puisse donner son avis pour répondre à un besoin.
il y a en France de multiples niveaux administratifs, mais je ne suis pas partisan d’une suppression des communes ou des dépar-tements. si des décisions communes peuvent être prises librement par plusieurs municipalités, tant mieux. Mais l’intercommunalité doit dépendre du volontarisme des élus locaux et ne pas être une nouvelle structure contraignante. il faut donc garder les communes et leur donner les moyens financiers et administratifs nécessaires quand elles décident de se regrouper.
91
entretien avec Jérôme Monod
À quel moment avez-vous rencontré Paul Delouvrier? Je l’ai connu quand il était délégué général du gouvernement
en algérie, mais assez peu. À l’époque, j’étais au cabinet du Premier ministre Michel debré. L’une de nos tâches, c’était la préparation du premier plan de Constantine. en tant que chargé de mission, je n’ai toutefois aucun souvenir d’avoir directement eu affaire à delouvrier en algérie.
Quelques mois après, je suis parti vers un autre horizon, celui de l’aménagement du territoire. en 1961, j’ai proposé à debré la candidature de Paul delouvrier pour la délégation générale au district. J’avais contribué à rédiger les textes législatifs qui avaient donné naissance au district. Je me rendais compte que le Plan n’avait pas la force nécessaire pour se charger des problèmes d’urbanisme. il fallait créer une structure et une délégation de l’aménagement du territoire. J’avais beaucoup plaidé pour la création du district, dont la mission était d’aménager la région parisienne pour conte-nir sa croissance, car on prévoyait à l’époque qu’elle compterait quatorze millions d’habitants, ce qui ne s’est pas réalisé.
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
92
Je suis resté au cabinet de Michel debré jusqu’à son départ du pouvoir, en 1962. Le général de Gaulle ne pouvait pas laisser sans emploi ou laisser retourner à son corps d’origine un homme de la qualité de delouvrier. Les travaux qu’il avait menés au Plan, au début de sa carrière, le désignaient pour un poste de ce genre, et il avait l’esprit organisé pour ce type de mission. Les choses se sont passées très vite et sans problème. Je dois avoir quelque part une note où je proposais à Michel debré de nommer delouvrier délégué général du district. Je crois avoir vu delouvrier à cette époque, puis il en a lui-même parlé au Premier ministre.
Quand j’ai quitté le cabinet de Michel debré, j’ai été pendant trois mois directeur de cabinet de Maurice schumann, qui était chargé de l’aménagement du territoire. Quand celui-ci a quitté le gouvernement, Pompidou a décidé de créer une délégation à l’aménagement du territoire, la daTar. olivier Guichard en a été nommé président, et, moi-même, j’étais l’un des chargés de mission à la daTar. Quand j’ai été nommé délégué adjoint en 1966, puis délégué général en décembre 1968, nous avons com-mencé à nous frotter à delouvrier. il avait une imagination et une ambition larges, il avait projeté un nombre de villes nouvelles qui me paraissait excessif, car notre but était de contrôler la croissance de la région parisienne. il y a eu des séances toujours amicales, mais un peu houleuses au conseil du district…
Quelles étaient vos relations avec lui? nous étions liés d’amitié sans nous connaître très bien. nous
n’avions pas de relations personnelles, mais des relations de travail très étroites, mues par l’intérêt de nos missions respectives. un mot sur l’homme. delouvrier était un homme qui épatait. Je ne crois pas que c’était un homme d’une très grande finesse, pour sa culture et son caractère. il était un peu comme un général d’armée, qui donne des ordres, qui avance, qui travaille beaucoup. il avait des idées et un bon staff. Jean Millier était un peu dans son genre, tandis que Michel Picquard était un esprit très subtil. Je n’ai jamais
Entretien avec Jérôme Monod
93
considéré delouvrier comme un génie, mais comme un bon concep-teur et un remarquable organisateur pour la région parisienne (je ne peux pas juger son action en algérie). sa dureté et son esprit de décision ne lui ont pas fait que des amis parmi les élus, mais cela était normal. dans ce type de fonction, on ne peut pas être trop flexible. son adjoint, Jean vaujour, l’était déjà pour deux!
Même si delouvrier n’a pas eu l’importance du baron Haussmann – leurs missions étaient d’ailleurs très différentes – son nom restera certainement parmi les très hauts fonctionnaires que la ve république a produits, du moins à ses débuts.
Quelles étaient les relations entre la DATAR et le District?nous avions des relations de travail, mais nos vues étaient
différentes. La daTar s’occupait de la province. Le problème de la région parisienne était de créer des équipements pour accueillir une population en forte croissance. Guichard et moi considérions qu’il fallait être très strict sur la croissance de la région parisienne, et par conséquent qu’il fallait régionaliser une partie des compé-tences (nous avons commencé par la régionalisation des budgets). nous avions donc tendance à freiner l’action du district, ce qui provoquait l’opposition de l’équipe de delouvrier. Lors des conseils d’aménagement du territoire, auquel delouvrier participait, nous avions parfois des rapports difficiles, mais cela s’arrangeait toujours. delouvrier n’avait pas une stratégie très fine vis-à-vis du gou-vernement, de l’administration ou des communes. il avançait, il écrasait et tendait à passer en force.
Delouvrier s’entendait-il avec Guichard?C’étaient deux hommes extrêmement différents. Guichard
était un vrai libéral, au bon sens du terme. il avait des principes, mais ne se battait pas jusqu’à la mort pour imposer ses vues. delouvrier, lui, n’était pas un libéral. Ce fut un très grand techno-crate, un très grand serviteur de l’État, mais ce n’était pas un politique. Guichard et delouvrier s’entendaient, mais il n’y avait
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
94
pas de réelle affinité. Comme je vous l’ai dit, l’un des principes de la politique que nous menions, c’était de s’opposer à la croissance excessive de la région parisienne.
Quelle fut votre réaction quand Delouvrier vous annonça l’estimation d’après laquelle la région parisienne compterait quatorze millions d’habitants à l’horizon de l’an 2000?
Je ne me souviens pas exactement de la scène. nous faisions nous-mêmes des études prospectives sur la démographie fran- çaise. Quand delouvrier et son équipe ont «sorti» le chiffre de quatorze millions d’habitants, je lui ai dit qu’il était hors de question de construire des équipements correspondant à une telle population. Je lui ai probablement dit qu’à partir de dix mil-lions d’habitants, la région parisienne poserait des problèmes au reste du pays. delouvrier avait l’impression que son intelligence et son analyse lui permettraient de voir la «réalité des choses». or il n’y a pas de réalité de choses, mais seulement une réalité des hommes. Car à un moment donné, les hommes souffrent de la congestion des villes.
sur les huit villes nouvelles qui avaient été prévues, trois ont été abandonnées. nous avons obtenu que la ville nouvelle prévue à Mantes-sud soit abandonnée au profit du vaudreuil, près de rouen. dans les autres cas, c’est l’équipe de delouvrier qui a elle-même renoncé à la construction de nouvelles villes.
Qui suivait les projets? L’Élysée ou Matignon? L’aménagement de la région parisienne était un grand projet,
et les grands projets sont suivis à la fois par l’Élysée et par Matignon. Le Général tenait beaucoup au district. Toutefois, les comités interministériels d’aménagement du territoire avaient lieu à Matignon. il n’y a eu qu’un seul comité interministériel qui s’est réuni à l’Élysée, précisément pour statuer sur le nombre de villes nouvelles. C’est vrai qu’il y a eu des rencontres informelles, mais je ne crois pas qu’on puisse dire qu’il y ait eu une relation
Entretien avec Jérôme Monod
95
privilégiée entre le Général et delouvrier. Ce n’était pas le style du Général de jouer les uns contre les autres. de Gaulle recevait Guichard (et me recevait moi-même, quand j’ai succédé à Guichard) au même titre que delouvrier. Cela d’autant plus que Guichard faisait preuve d’une grande finesse dans ses relations avec le pouvoir: les problèmes étaient réglés sans drame. alors que delouvrier avait pour ainsi dire un caractère de butor et tendait à tout écraser sur son passage…
Quelles étaient les questions abordées lors de ces comités interministériels?
nous avons notamment abordé la question des villes nouvelles et des équipements de la région parisienne. et puis il y a eu une politique qui n’a pas très bien réussi, qui concernait les villes de la couronne du bassin parisien (reims, rouen, orléans, Tours). L’idée, c’était de créer une structure de villes moyennes qui permettent d’équilibrer, de manière plus raffinée que les villes nouvelles, la puissance de l’agglomération parisienne.
dans ces comités, delouvrier expliquait souvent sa politique d’aménagement de la région parisienne. «L’europe de demain, disait-il, ne pourra pas se passer d’un Paris de huit millions d’habitants.» L’argument était fallacieux, car ce n’est pas le nombre d’habitants qui fait la force d’une ville et, parfois, l’excès de taille peut nuire à l’éclat et à l’influence d’une ville. C’est pour cela que je pense que, dans l’équipe de delouvrier, il y avait parfois un certain manque de finesse. Prenons le cas de Jean Millier. il a pris la décision, sage et hardie, de faire construire un périphérique à quatre voies. Mais il était un peu comme un général qui avance avec ses troupes, sans se soucier des obstacles et des problèmes qui se posent.
Quel est le regard que vous portez aujourd’hui sur les villes nouvelles?Je les ai beaucoup visitées avec Jean-eudes roullier. Je crois
qu’elles sont désormais entrées dans les faits et dans les mœurs.
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
96
elles remplissent leur rôle. Je crois toutefois qu’on ne portera jamais assez d’attention au contrôle de la région parisienne.
Dans les années 1970, Paul Delouvrier a créé Ouest-Atlantique. C’est sur votre conseil qu’il recrute Jacques Voisard.
Jacques voisard était une force mystique, un ancien comman-dant de bataillon reconverti dans l’aménagement du territoire (par la suite, il a travaillé avec Charles Pasqua). il a été un bon secrétaire général d’ouest-atlantique. Pour ma part, je n’avais que peu de contacts avec Paul delouvrier, quand il s’est occupé de cette association. il y avait déjà tellement de choses à faire pour déve-lopper la province française!
L’une des dernières conversations que j’aie eues avec delouvrier se situe en 1969, deux mois avant le référendum qui a abouti au départ du Général. delouvrier était devenu président d’edF. il s’agissait de déterminer, dans le plus grand secret, les sites d’implantation des futures centrales nucléaires. Paul delouvrier avait surtout parlé du référendum…
voilà mes souvenirs sur l’homme, ses qualités et ses défauts. Toutefois, ne croyez pas qu’en disant cela, j’aie le moindre ressen-timent contre delouvrier. C’était un grand commis de l’État et, à l’heure actuelle, on aimerait en avoir beaucoup comme lui!
97
entretien avec Jacques voisard
Vous avez rencontré incidemment Paul Delouvrier en Algérie en 1959…
C’était après le discours du général de Gaulle sur l’autodéter-mination. À l’époque, j’étais à l’état-major du corps d’armée d’alger, sous les ordres du colonel argoud. on m’a envoyé assister à l’exposé qu’allait faire le Général. effectivement, après ce discours, il y eut un pot à la préfecture de Tizi ouzou, et je fus présenté au délégué général du gouvernement, Paul delouvrier. Je lui ai dit un certain nombre de choses concernant les choix du Général 6. Comme d’autres capitaines, j’avais été en indochine avec une grande autonomie opérationnelle, avec une hiérarchie un peu lointaine. Tout en respectant cette hiérarchie, nous n’avions pas de craintes révérencielles, et nous nous exprimions avec une certaine véhémence. Ce qui m’a frappé, ce fut l’extraordinaire disponibilité d’esprit et la qualité d’écoute de Paul delouvrier. il m’a laissé parler, puis il m’a fait des objections comme si nous étions à égalité, ce qui était loin d’être le cas. il n’était pas question
6. sur cet épisode, voir roselyne Chenu, op. cit., p. 333.
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
98
d’être en accord ou en désaccord, mais de faire ressortir un certain nombre de choses sur l’appréciation du moral de l’armée et de la population civile. Paul delouvrier dégageait en même temps de la sympathie, de l’intelligence, de la loyauté. Même si je devais l’agacer, il ne le montrait pas.
L’avez-vous revu en Algérie?au moment des barricades, en janvier 1960. Massu s’était
fait rappeler à Paris, après une interview à un journal allemand. on sentait de fortes tensions à alger. J’assurais la permanence à l’état-major du corps d’armée. Paul delouvrier s’était rendu à Paris pour un conseil exceptionnel consacré à l’algérie. À son retour de Paris, il a téléphoné au corps d’armée. J’entends encore sa voix: «Mon capitaine, où sont vos généraux?». Les quatre généraux commandant les divisions étaient repartis dans leur PC. delouvrier était d’abord cette voix, une voix forte, chaude, une voix autori-taire dans l’exercice de ses fonctions, bref, une voix de patron.
J’ai éprouvé beaucoup d’admiration pour le discours qu’il a prononcé lors des barricades. Ce haut fonctionnaire, intelligent, lucide, avait bien mesuré les risques de la situation. Quand les manifestants ont commencé à tirer sur les forces de l’ordre, le discours de delouvrier a réussi à émouvoir les différents prota-gonistes. Quand j’ai entendu peu après les réactions d’un certain milieu parisien (qui considérait que delouvrier était devenu fou), je me suis dit, quelles que soient les opinions qu’on pouvait avoir sur la question algérienne, qu’il en était sorti grandi d’une manière extraordinaire.
Bien des années plus tard, vous retrouvez Paul Delouvrier à Ouest-Atlantique.
J’ai pris la décision de quitter l’armée au lendemain du putsch. J’ai d’abord travaillé dans la sidérurgie, puis à la daTar. À la suite de la crise des charbonnages français, il avait été décidé de fermer des puits de mine. La daTar avait été créée en Lorraine.
Entretien avec Jacques Voisard
99
dans le nord, on avait mis en place deux commissaires à la conver-sion industrielle (un troisième le fut à saint-Étienne). dans l’ouest, qui était faiblement industrialisé, le problème se posait de manière différente: il s’agissait surtout d’une reconversion de l’agriculture à l’industrie. À ce moment-là, un groupe d’industriels réfléchissait au développement de la Basse-Loire, avec l’aide de différents bureaux d’études. J’étais alors chargé de mission à la daTar. en raison de mes attaches bretonnes, on m’a demandé de suivre ce groupe d’industriels. Très vite, notre réflexion s’est étendue de la Basse-Loire aux trois régions de l’ouest (Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes). il s’agissait de développer des activités industrielles dans des économies encore fortement dominées par le secteur agricole. au même moment, la daTar, sous la direction de Jérôme Monod, réfléchissait à une structure de commissariat à l’industrialisation comparable aux commissariats à la recons-truction qui existaient dans le nord et en Lorraine. Toutefois, les situations étaient très différentes. dans le nord et dans l’est, il y avait deux industries dominantes, le charbon et l’acier. il fallait trouver des solutions pour ces grandes industries en reconversion. dans l’ouest, l’industrie était peu représentée, à l’exception de l’industrie militaire dans la Basse-Loire. La volonté de la daTar a donc rejoint celle de ces groupes d’industriels de Bretagne, d’une partie des agriculteurs ou de leurs enfants.
nous avons tenu un séminaire avec des chefs d’entreprise des Pays de la Loire, du Poitou-Charentes, avec les commissaires à la reconversion de Lorraine et de saint-Étienne. nous avons fixé les limites d’action de la nouvelle association: la Bretagne, le Poitou-Charentes et les Pays de la Loire. nous avions pensé à l’aquitaine, mais Chaban-delmas s’y est opposé, malgré les tentatives de delouvrier pour le convaincre qu’il pouvait y avoir une communauté d’intérêts dans ce que l’on appelait la façade atlantique.
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
100
Pourquoi avoir choisi Paul Delouvrier comme président? il fallait trouver un président qui puisse être le porte-drapeau
de l’association et de son projet. nous nous sommes demandés quelles étaient les activités structurantes susceptibles de s’intéresser au développement industriel de ces trois régions de l’ouest. on a pensé aux transports et à l’énergie, c’est-à-dire la snCF, air inter, GdF, edF ou elf. on a vite pensé à delouvrier, qui était alors président d’edF. on a commencé à peaufiner le sujet. Quand je suis allé voir Jérôme Monod, nous avons eu la même idée en même temps. Je suis donc allé voir Paul delouvrier pour lui expliquer le sujet. il a accepté presque tout de suite. nous avons écrit ensemble les statuts d’ouest-atlantique à partir des idées que je lui apportais de la part de notre groupe et de son expérience administrative. J’ai vécu là les dix meilleures années de ma vie professionnelle dans le «civil». Paul m’a ouvert des quantités de portes, m’a fait réfléchir à des quantités de choses, en me laissant une liberté totale, mais toujours prêt à nous protéger… Ce n’était pas un président potiche. Chaque année, nous faisions au mois de septembre un séminaire à Héricy avec toute l’équipe d’ouest-atlantique et on préparait le programme des douze mois suivant. il ne se passait pas quinze jours sans que je le voie ou que je l’aie longuement au téléphone.
Qui faisait partie de cette équipe? au début, nous étions une vingtaine (à la fin d’ouest-atlantique,
nous étions plus de quarante). Je recrutais principalement dans les administrations, en ce qui concerne les chargés de mission, et dans le secteur privé, en ce qui concerne les assistants. J’ai notamment embauché des ingénieurs de l’armement, du génie rural, des Mines, des télécoms et d’edF, qui étaient mis à disposition d’ouest-atlantique. La plupart d’entre eux ont ensuite fait de très belles carrières.
Entretien avec Jacques Voisard
101
Qui finançait l’association? avec la daTar, les trois conseils régionaux (Bretagne, Pays de
la Loire, Poitou-Charentes), les treize conseils généraux, les vingt-deux chambres de commerce, environ quatre cents chefs d’entre-prise. Les moyens étaient conséquents. C’était un réseau où chaque membre était à la fois actionnaire, client et prescripteur.
Comment organisiez-vous le travail avec Delouvrier? Je le voyais souvent en tête-à-tête à Paris. et au moins une fois
par mois, il y avait un conseil d’administration ou une visite d’usine dans l’ouest. Paul avait d’autres occupations, n’était pas sur place, mais il connaissait beaucoup de monde, et il avait une vision. on se voyait souvent et il était au courant de tout. ses observations m’aidaient beaucoup.
Quelles ont été les principales réalisations d’Ouest-Atlantique? Et comment se prenaient les décisions?
Les projets industriels venaient de la daTar, du réseau des entreprises et parfois des collectivités locales. Quand nous avions mis ces projets en forme, j’allais chez Paul delouvrier et je lui demandais de recevoir les décideurs pour leur en parler. on demandait à delouvrier d’intervenir à son niveau de président, grâce à sa personnalité et son réseau de relations. nous nous étions fixé un objectif de 10 000 emplois industriels par an par apport de l’extérieur.
Avez-vous par la suite gardé des relations avec Delouvrier? Quand je suis parti à la retraite, je lui ai annoncé mon intention
de travailler le plus longtemps possible bénévolement pour l’État. J’ai été en particulier président du Comité de décentralisation pendant douze ans. À ce titre, je suis souvent allé le voir pour lui demander conseil. nous échangions toujours nos expériences, notamment sur l’évolution de l’État dans le cadre des lois de décentralisation.
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
102
Quel est le regard que vous portez sur les diverses tentatives de décentralisation?
Jusqu’à présent la mise en œuvre de la décentralisation s’est faite en deux phases: la première pendant les années quatre-vingts, la seconde à partir de 2002.
Pour le moment on ne peut qu’être satisfait de constater que le transfert de compétences de l’administration de l’État à des autorités territoriales élues s’est souvent traduit par une meilleure prise en compte des questions touchant à la vie quotidienne, comme l’éducation, la santé, l’environnement par exemple.
Par contre, il faut souligner et déplorer une forte augmentation des effectifs globaux des fonctions publiques d’État et territoriales (hors Éducation nationale): si cette augmentation des effectifs de la fonction publique territoriale est compréhensible même si l’on peut observer des excès, cela est parfaitement incompré-hensible en ce qui concerne la fonction publique nationale. elle a deux conséquences: un alourdissement de nombreuses pro-cédures et une occasion perdue d’allègement et de modernisation des structures administratives dans leur ensemble. de ce point de vue, le passage à la deuxième phase de décentralisation à partir de 2002 aurait gagné à être précédé d’une évaluation des décisions prises au cours des années 1980.
103
entretien avec robert Lion
À quel moment avez-vous fait la connaissance de Paul Delouvrier? J’ai commencé à travailler avec Paul delouvrier en janvier 1967
(je l’avais déjà croisé, ayant été son élève à sciences-Po dans les années cinquante). Quand edgard Pisani a démissionné du gouvernement, le jour même, j’ai eu un coup de fil de delouvrier pour venir le rejoindre au district de la région parisienne et suivre les questions du logement, dont je m’occupais au cabinet de Pisani. J’ai travaillé environ dix-huit mois avec delouvrier, puis j’ai été appelé par albin Chalandon au ministère de l’Équipement.
Vous étiez donc au cabinet d’Edgard Pisani lorsque celui-ci a parlé d’«aventure intellectuelle» au sujet des villes nouvelles.
Cela n’a pas été un drame. C’était juste une formule qui était profondément légitime. en 1965, Paul delouvrier avait réussi à faire adopter le schéma directeur par le président de la répu-blique, c’est-à-dire le général de Gaulle, en court-circuitant non seulement le ministre responsable, mais également le Premier ministre. il avait rapidement mis en place les équipes des nouveaux
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
104
départements et des villes nouvelles. edgard Pisani est venu lui rendre visite à Évry. J’ouvre une parenthèse: tous les ministres de l’Équipement, sans exception, ont été dans un premier temps contre les villes nouvelles, avant de comprendre que c’était une bonne idée, car il fallait mettre de l’ordre dans l’urbanisation de la région parisienne. Le mot de Pisani n’était pas méchant. il faut dire qu’entre un ministre de l’Équipement en charge de l’amé nagement du territoire et un délégué général au district qui avait beaucoup d’autorité, il y avait très naturellement des frottements.
Quels étaient les traits de caractère qui vous impressionnaient le plus chez Delouvrier?
Paul delouvrier s’imposait. Ce qui en imposait était surtout son sens de l’État et sa force de caractère – ce qui allait de pair avec une carrure physique impressionnante. Quand il arrivait dans une réunion, c’était toujours un événement, il s’imposait quasi physiquement. il présidait toujours les réunions avec les mains croisées et le buste levé, dans des positions souveraines. il incarnait l’État et l’intérêt général. Quand il ouvrait la bouche, c’était tou-jours pour tenir des propos fermes et clairs; le silence s’établissait aussitôt. il avait une aura comparable à celle du général de Gaulle. Par ailleurs, il était travailleur, il préparait bien ses dossiers, il avait d’excellents collaborateurs, il savait faire confiance et déléguer et, bien entendu, il était porteur d’une vision. Le schéma directeur est un morceau de bravoure. Quand j’étais maître de conférences à sciences-Po, je donnais comme exercice à mes étudiants la pré-face du schéma directeur, que Paul delouvrier a rédigée de sa plume et qui exprime cette vision. Lorsqu’on regarde aujourd’hui la carte de la région parisienne, on constate que quasiment tout ce qui avait été tracé à l’époque – les villes nouvelles, les infrastruc-tures, le rer, les autoroutes – a été réalisé là où c’était prévu. delouvrier dynamisait ses équipes, c’était un chef, mais aussi il a su traduire ses projets dans la réalité.
Entretien avec Robert Lion
105
Quelles étaient, à l’époque, vos fonctions? Je travaillais rue Barbet-du-Jouy, à côté de Jean Millier et au
même étage que Paul delouvrier. Mon patron, c’était Millier, mais je voyais régulièrement delouvrier. Je m’occupais surtout du logement social et, en particulier, du «fichier des mal-logés». il fallait une autorité régionale pour s’occuper de cela. Les mal- logés se trouvaient surtout à Paris et les nouveaux logements étaient construits en banlieue. il s’agissait d’imposer des quotas de réservation aux organismes HLM dans les départements péri-phériques pour y loger les gens qui s’entassaient dans les taudis de Paris.
delouvrier était toujours attentif. Quand je le croisais dans les couloirs, il m’interpellait: «Bonjour, Lion!» il y avait en lui quelque chose de gaullien. il respirait l’autorité, mais pas de manière arrogante et méprisante. il s’intéressait à tout épisode qui concernait la région parisienne. il lui arrivait de se pointer dans des réunions de niveau modeste avec des chefs de bureau des Finances ou de l’Équipement. il arrivait, écoutait le point de vue des gens, mais quand il exprimait le sien, il avait un poids consi-dérable. Bref, il était là où les décisions se prenaient, il savait que ce n’était pas toujours au niveau des ministres.
il a suivi de près le lancement des villes nouvelles. en com-pagnie de Jean Millier, il allait voir sur place leurs «patrons», qu’il avait choisis avec beaucoup d’éclectisme: administrateurs, ingé-nieurs des Ponts, un inspecteur des Finances… il nourrissait une affection particulière pour Bernard Hirsch, qu’il avait placé à la tête de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise.
Les rapports entre Delouvrier et Chalandon ont été compliqués. J’estime Chalandon. Je lui dois beaucoup: il m’a confié la
direction de la construction. Quand il est arrivé au ministère de l’Équipement, cet homme de culture du secteur privé a voulu faire table rase des règlementations. Par exemple, il a déclaré que tout le territoire français serait «constructible». Cela n’allait pas
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
106
précisément dans le sens de delouvrier, qui voulait concentrer les constructions dans certaines zones et les interdire sur la plupart du territoire de la région parisienne! Le choc entre les deux hommes ne pouvait qu’être violent. Toutefois, Chalandon et delouvrier n’ont cohabité que pendant un an: Paul delouvrier a quitté le district en 1969.
De 1972 à 1974, vous avez travaillé avec Delouvrier dans le cadre du Plan-construction.
L’histoire est à peu près la suivante. Chalandon, qui était mon ministre de tutelle, ne s’intéressait qu’au nombre et au prix des logements à construire. son but était de faire baisser les prix; la qualité et l’innovation lui étaient indifférentes. Je n’étais pas heu-reux de cela. J’avais publié dans la revue du ministère un article «Pour un habitat de qualité», que j’avais largement diffusé dans le réseau des directions départementales de l’Équipement. C’était à soi seul une petite révolution. À l’époque, tout architecte apportant une idée neuve était systématiquement rejeté par le système, qui était tenu par les «mandarins» (les prix de rome des années cinquante et soixante). Ces «mandarins» étaient presque toujours «mariés» – pour ne pas dire maqués – à de grandes entreprises de bâtiment, avec lesquelles ils s’adonnaient aux faci-lités de la préfabrication et des barres de cinq cents mètres.
depuis les années cinquante, la coutume était de construire des HLM là où se trouvaient des usines de préfabrication à amortir. J’ai changé la règle du jeu en décidant de faire du logement social là où il y en avait besoin, et surtout d’introduire l’innovation au cœur du système.
Mes préoccupations rejoignaient celles de Pierre aigrain, qui dirigeait la délégation générale à la recherche scientifique et technique (dGrsT). avec son collaborateur Loïk Le Floch- Prigent, aigrain a imaginé le Plan-construction. Je me suis rapproché d’eux et leur ai dit que j’étais prêt à les aider en mettant à leur disposition les crédits de construction des HLM. La dGrsT était axée sur des
Entretien avec Robert Lion
107
aspects techniques, avec l’idée de sortir de la préfabrication la plus triste. J’ai ajouté la dimension qualitative et l’innovation architec-turale… et le financement!
au cours de l’automne 1971, on a réussi à bâtir dans la plus grande discrétion l’un des programmes majeurs du vie Plan (1971-1976). nous avons réussi à y faire introduire le Plan-construction grâce au soutien de Matignon et de l’équipe de Jacques delors. Le Premier ministre Chaban-delmas est venu avec moi visiter le bidonville de nanterre, et ce jour-là, je l’ai convaincu; à la fin de l’année 1972, je suis allé voir Chalandon pour parler du Plan-construction. il a fait une grimace en disant que cela ne l’intéressait pas, mais que si cela m’amusait, il n’y voyait pas d’inconvénient.
un jour, le cabinet m’annonce la nomination à la tête du Plan-construction de M. decenne, un vieil ingénieur des Ponts qui venait de quitter la présidence d’aéroports de Paris, un mon-sieur souriant, aimable, ayant avant tout le souci de ne pas trop travailler. nous avions déjà produit des documents visionnaires, qui tendaient à casser le monopole des «mandarins» et à ouvrir l’accès à la commande aux jeunes architectes. Je raconte tout cela à decenne, qui bâille. Je décide alors de l’inonder de dossiers, en lui demandant des réponses pour le lendemain. au bout de trois réunions, decenne m’a dit que mon Plan-construction lui demandait trop de travail et qu’il allait rendre son tablier.
À ce moment-là, j’ai passé deux coups de téléphone à partir du premier café. Le premier était pour Paul delouvrier, qui était alors président d’edF: «Monsieur le préfet, lui ai-je demandé, voulez-vous être le patron du Plan-construction? – oui. – Je raccroche, je viens vous voir». J’ai ensuite appelé daniel dommel, conseiller de Chalandon: «vous allez avoir un appel de M. decenne, qui va vous donner sa démission du Plan-construction. Je vous demande, s’il vous plaît, de l’accepter. Je vais vous proposer un candidat pour le remplacer.» Je suis allé le voir boulevard saint-Germain pour lui proposer la nomination de Paul delouvier. «Mais il n’acceptera jamais. – Je prends le pari qu’il acceptera si
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
108
vous voulez bien l’appeler.» Tout s’est joué en deux heures. J’ai donc renoué avec Paul delouvrier, qui a été enchanté – dans sa citadelle d’edF – de retrouver la construction et l’urbanisme. À partir de ce jour-là, j’ai développé avec lui, et à grande allure, une complicité magnifique.
nous avons d’abord réfléchi à la philosophie du Plan- construction. il était totalement en ligne avec ce que j’avais écrit avec Pierre aigrain. ensuite, nous avons subi une offensive de la part d’une petite direction du ministère de l’Équipement (la direction du bâtiment et des travaux publics et de la construc-tion), dirigée par un inspecteur des Finances, Pierre Consigny, qui essayait d’exister sans en avoir les moyens. delouvrier a beau-coup œuvré pour que Consigny ne touche pas à nos activités. nous avons établi l’organigramme du Plan-construction, qui était rattaché au directeur de la construction, avec un secrétariat per-manent sous l’autorité de celui-ci, mais avec une nature d’organisme interministériel, puisqu’il mobilisait des directions rattachées à d’autres ministères. Le tout était coiffé par un comité directeur, où siégeaient les représentants des ministères, mais aussi – à titre personnel – des architectes, des experts et des professionnels du secteur. enfin, nous avons rédigé la lettre de mission, pour que soient couchés sur le papier les objectifs de ce programme. Je me souviens des deux soirées que nous avons passées, lui et moi, pour peaufiner cette lettre, que delouvrier lisait à haute voix dans son bureau d’edF. Le Premier ministre Chaban-delmas a adressé cette lettre, signée de sa main, à Paul delouvrier, sans en changer une virgule, lui demandant d’être le président du comité directeur. il faut noter que cela a été le seul document fondateur du Plan-construction: il n’y a eu ni loi, ni décret, ni arrêté, ni circulaire.
en mars ou avril 1972, le Plan-construction a été lancé à Matignon, afin de marquer son caractère interministériel. Cela n’a pas plu à albin Chalandon, qui toutefois n’a rien fait pour nous torpiller. au printemps 1972, le ministre acceptait un relèvement significatif des prix plafonds des HLM, qui n’avaient jusque-là pas
Entretien avec Robert Lion
109
cessé de baisser, avec d’inquiétantes chutes de qualité. nous avons donc établi des labels qualitatifs. Chalandon a eu le mérite – je rends hommage à son honnêteté intellectuelle – d’infléchir sa position dans le domaine de la qualité de l’habitat. il a fait de même en matière d’urbanisme, en reconnaissant que la France n’était pas «entièrement constructible» et que les promoteurs devaient suivre de strictes règles.
Delouvrier était alors président d’EDF. Avez-vous l’impression qu’il s’y sentait un peu à l’étroit, n’ayant plus le même rôle que celui qu’il avait eu au District?
Bien sûr. À edF, il y avait un partage des rôles, d’après lequel le directeur général était le vrai patron. Marcel Boiteux était très respectueux à l’égard de delouvrier, mais celui-ci n’avait pas son comptant de travail. Le Plan-construction lui a permis de retrouver des sujets qu’il aimait beaucoup. il était enchanté, se trouvant à nouveau sur ses terres. Pendant toute cette période, l’architecture est restée son violon d’ingres.
Pourriez-vous décrire votre direction du Plan-construction? nous avons eu deux années de lune de miel. delouvrier était
un patron merveilleux. Je l’avais au téléphone tous les jours, j’allais le voir au moins une fois par semaine. Chaque mois, il présidait le comité directeur, en toute majesté. nous avons très vite lancé les programmes du Plan-construction, par exemple le Programme architecture nouvelle (le Pan) ou les Modèles innovations, en mobilisant notamment les villes nouvelles pour qu’elles deviennent des laboratoires de la création architecturale. J’ai apporté les crédits de la direction de la construction, et aigrain ceux de la dGrsT, ce qui a permis de financer 30 000 logements innovants par an.
au mois d’avril 1974, nous tenions une réunion du comité directeur sous la présidence de Paul delouvrier. À un moment donné, quelqu’un lui apporte un papier. delouvrier se lève et nous dit: «Mesdames et Messieurs, je vous demande de vous lever. Le
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
110
président de la république est mort.» C’est ainsi que j’ai appris le décès de Georges Pompidou.
J’avais déjà décidé de quitter la direction de la construction pour partir aux HLM. Pour ce choix, souvent jugé incongru, delouvrier m’avait encouragé. J’ai continué à siéger au comité directeur du Plan-construction, et l’excellente équipe, sous les ordres de raymond sajus, est restée à la direction de la construction.
Une question d’actualité. À l’heure où l’on lance le nouveau Schéma directeur de la région parisienne, l’expérience du District peut-elle nous être utile?
oui: il faut un chef. L’élaboration du schéma directeur de 1965 et le début de sa mise en œuvre n’auraient pas été possibles sans une structure extraordinaire, dirigée par un homme extra-ordinaire, mettant son autorité et sa passion au service de l’État.
Quant à la période actuelle, le président sarkozy a eu raison de lancer le projet du Grand Paris en ne s’encombrant pas dans un premier temps des aspects institutionnels, qui auraient tout bloqué. Parce qu’elle associe divers acteurs au stade de la conception, sa démarche est intéressante et originale. Mais on ne réalisera rien sans une autorité forte. Mon message: il faudra ici un nouveau delouvrier. Ça ne se trouve pas sous les sabots d’un cheval!
113
Paul Delouvrier: éléments biographiques
Paul delouvrier est né en 1914 à remiremont, dans les vosges. après des études de droit et de sciences politiques, il se bat comme lieutenant d’infanterie motorisée en mai 1940, est reçu au concours de l’inspection des Finances (1941), passe par l’École nationale des cadres d’uriage (1941 et 1942) et prend dans la région de nemours la responsabilité d’un maquis armé (1944).
À la Libération, il est chargé de mission au cabinet d’aimé Lepercq, ministre des Finances, puis de rené Pleven, dont il sera ensuite le directeur de cabinet. en 1946, il entre dans l’équipe de Jean Monnet, qui élabore le premier Plan de modernisation et d’équipement – dit plan Monnet – destiné, à l’issue de la guerre, à redresser l’économie et l’industrie françaises.
après avoir dirigé en 1947 le cabinet de rené Mayer, ministre des Finances et des affaires économiques, Paul delouvrier est nommé directeur général adjoint des impôts (1948-1953), chargé des réformes et de la fusion des régies fiscales, et contribue alors à la mise en place de la taxe sur la valeur ajoutée.
en 1953, il est conseiller technique au cabinet de rené Mayer, président du Conseil, puis secrétaire général du Comité inter-ministériel pour les questions de coopération économique
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
114
européenne. À ce titre, il fait partie des délégations françaises à l’oCde et à l’oTan.
deux ans plus tard, il part diriger à Luxembourg la division des finances de la Haute autorité de la Communauté euro-péenne du charbon et de l’acier, que préside Jean Monnet. il est membre du comité spaak pour la préparation des traités de rome et joue un rôle capital dans la création en 1957 de la Banque européenne d’investissement, dont il assumera la vice-présidence.
en 1958, le général de Gaulle le nomme délégué général du gouvernement en algérie, avec la totalité des pouvoirs civils et militaires. Paul delouvrier part avec la consigne: «vous êtes la France en algérie» et la mission de réaliser le plan de Constan-tine. il y affrontera notamment la semaine des barricades, en janvier 1960, au cours de laquelle son discours radiodiffusé, resté célèbre, contribuera à rétablir l’ordre public à alger.
en août 1961, il est titulaire d’un poste nouveau: délégué général au district de la région de Paris. À ce titre, il étudie l’en-semble des problèmes que pose le développement de la capitale et est chargé de proposer au gouvernement une politique d’aménagement et d’équipement. après avoir inspiré en grande partie la réforme administrative de la région, il publie en 1965 le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la région de Paris. en 1966, il devient le premier préfet de la région parisienne et, dans cette fonction, peut mettre en application la politique qu’il a préconisée: une action foncière audacieuse et novatrice, un grand programme d’équipements – routes et transports, préfectures et universités. il soutient la création de centres urbains nouveaux dans les banlieues existantes et amorce la création de cinq villes nouvelles.
en 1969, il devient président du conseil d’administration d’Électricité de France, poste qu’il occupera pendant dix ans. ses deux mandats successifs seront marqués par le changement de filière nucléaire et la levée de l’interdit de toute action
Annexes
115
commerciale qui entravait l’essor de l’entreprise, puis par le programme massif d’équipement nucléaire et le développement parallèle du marché de l’électricité.
nommé en 1979 premier président de l’Établissement public du parc de la villette, il est chargé de créer un musée des sciences et des techniques (qui deviendra la Cité des sciences et de l’industrie), un parc et un équipement musical (le Conser-vatoire national supérieur de musique et de danse et la Cité de la musique). en 1984, atteint par la loi sur la limite d’âge, il en devient président d’honneur. distingué pour son inlassable dynamisme, sa capacité à inventer des solutions, son franc-parler, il participe activement aux travaux du Conseil écono-mique et social, dont il est membre de 1979 à 1994.
Parallèlement à son parcours professionnel, Paul delouvrier a enseigné l’économie politique dans divers établissements d’études supérieures et, surtout, il a mis son énergie au service de la vie associative, contribuant à créer ou présidant un grand nombre d’associations: Éducation et échanges, le Foyer inter-national d’accueil de Paris, ouest-atlantique, le Plan- construction, l’association Jean Monnet et bien d’autres encore…
il s’est éteint à Provins, en janvier 1995.Par sa manière d’être et d’agir, Paul delouvrier a profondément
influencé plusieurs générations de serviteurs de l’État et fait partie des quelques hommes qui, au confluent de la politique et de la pensée visionnaire, auront marqué la France contemporaine.
(notice établie par roselyne Chenu)
117
L’Aménagement de la région parisienne (1961-196217) [extraits]
Paul DelouvrierJe voudrais vous livrer mes souvenirs personnels, qui sont
nécessairement fragmentaires. L’idée d’un «Paris parallèle» a très vite été écartée, en l’espace d’un mois. L’idée de transporter toutes les administrations parisiennes dans une zone à part, de faire un «vichy à côté de Paris», alors qu’historiquement parlant, même quand Louis Xiv est parti à versailles, il a laissé son administration à Paris, était une erreur historique grave. La vertu de Paris est d’avoir toutes les fonctions d’une capitale, y compris l’administration de son pays. nous avons donc très vite écarté cette idée.
Le courant porteur des villes nouvelles anglaises, avec le projet de reconstruction de Londres de 1944 était une autre paire de manches. Les voyages que nous avons faits ensemble ont joué un rôle important dans la prise de décision. au cours de notre voyage aux États-unis, nous avons vu l’excroissance de new York, ville assise sur trois États, devenue ingouvernable avec pas moins de 1 600 autorités devant percevoir des taxes sur une agglomération de vingt-deux millions d’habitants. Cela nous
7. extrait de Bernard Hirsch (dir.), op. cit., p. 58-67.
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
118
a complètement effrayés. nous n’étions pas pour accroître Paris démesurément. nous sommes donc restés sur une notion de besoins très stricte qui, un jour, ferait que Paris pourrait voir stagner sa population.
nous avons également vu les villes nouvelles suédoises, bâties sur des lignes de métro. Ce principe était très intéressant parce qu’il permettait d’assurer la continuité sur un moyen de trans-port, permettant, par ailleurs, des discontinuités locales d’espaces verts. C’était la «continuité dans la discontinuité» chère à edgar Faure. Puis nous nous sommes rendus dans la région de Londres. J’ai été frappé par l’exemple de stevenage. Le chef de la ville nouvelle de stevenage, l’une des plus anciennes, […] venait de fêter ses quinze ans. La reine était venue à cette occa-sion. elle s’y était promenée, avait pris un bain de foule, puis avait interrogé un habitant en lui demandant s’il était satisfait de la vie à stevenage. Cette personne, m’a dit le chef de la ville nouvelle, lui a répondu: «Le logement n’est pas mal, mais on s’ennuie ici à perte de vue. – Comment! dit la reine, il y a des espaces verts, des tennis…» L’habitant lui avait alors dit: «oui, le travail est à proximité, mais on ne peut faire un crochet sans que l’on nous observe, et lorsque l’on veut aller voir nos amis qui sont à Londres en le décidant au dernier moment, c’est impossible: on ne peut jamais y aller, ni en voiture, ni par le train.» Le directeur de la ville nouvelle m’avait raconté cette anecdote pour me dire que lui-même, issu de l’adminis-tration britannique des domaines, considérait que stevenage était une erreur: cette ville était beaucoup trop éloignée de Londres […]
Michel PiquardLondres nous a appris une chose: où que l’on place les centres
nouveaux, je ne reprends pas ici le terme de ville nouvelle, il faut que ces derniers soient très bien raccordés au cœur de l’agglomération parisienne. L’alternative disant qu’en créant
Annexes
119
de nouveaux centres urbains comportant de nombreux services, les gens y seraient heureux et n’auraient plus besoin d’aller en région parisienne – les anglais avaient même poussé le bouchon plus loin en affirmant qu’ils ne devaient pas pouvoir se rendre facilement au centre de Londres – était fausse. À un moment donné, on a beaucoup insisté sur le fait que la ville devait apporter à tous ses habitants, y compris ceux de la banlieue, la possibilité du choix entre, d’une part, des transports d’un niveau acceptable pour se rendre au centre et, d’autre part, des services d’un niveau également acceptable en relative proximité. de leur côté, je dois dire, les financiers, pensaient qu’il fallait choisir entre le financement des transports et celui des centres, mais ne voyaient pas la nécessité de faire les deux. une sorte de bataille conceptuelle s’est donc ouverte pour convaincre de la nécessité de réaliser les deux. en pratique, le schéma directeur comporte à la fois des centres urbains puissants et diversifiés et l’impérieuse nécessité que ces centres soient reliés par des liaisons ferroviaires et autoroutières au cœur de Paris […]
Paul Delouvrieril y a quelque chose d’amusant sur la continuité adaptée. Les
axes privilégiés ont été travaillés pour éviter d’éloigner un nombre croissant de personnes des lieux de verdure et de nature. en laissant de grands intervalles entre ces axes, on laissait des zones de campagne peu éloignées de Paris, sauf dans la direction des axes préférentiels.
J’ai cependant eu des hésitations à l’ouest. L’idée de mégapole m’a alors effleuré. Je m’étais dit: «Puisqu’il y a un mouvement vers l’ouest, qu’il existe dans cette direction des agglomérations fortes, avec rouen et Le Havre en bout de chaîne, avec, déjà, un développement d’un million d’habitants entre la frontière de la région parisienne et la mer – l’idée de porte océane très présente dans la littérature française me revenait alors à l’esprit –, pourquoi ne pas peupler la vallée de la seine, avec ses méandres,
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
120
en évitant d’aller vers Melun et Fontainebleau et, surtout, vers l’est qui paraissait ingrat? J’ai vécu un moment sur cette idée, mais vous m’avez convaincu que cette vision était fausse […]
Jean Millierune étude avait été faite, dans laquelle toutes les industries
existantes avaient été relevées, ainsi que leurs extensions, et nous avions remarqué que toutes les industries de l’est s’étendaient vers l’est, et celles de l’ouest vers l’ouest. il n’était donc pas question pour elles de traverser l’agglomération […]
Michel PiquardCela est important. Cela signifie que le schéma directeur a
été fortement influencé par sa capacité de réalisation effective. il s’agissait de l’art du possible. dans notre esprit, faire preuve de volonté ne signifiait pas prendre le contre-pied systématique de tout ce qui se faisait spontanément, mais d’enlever ce qui était mauvais – le système de la tache d’huile, de la croissance dans toutes les directions – pour organiser une croissance différenciée et en continuité. il s’agit là d’une véritable philo-sophie politique. Je rappellerai le mot que vous aviez eu: «un bon schéma est un schéma qui peut se réaliser.» Je crois qu’il y a toujours eu, dans les esprits, le fait qu’il fallait être volontaire sans se laisser aller et qu’il ne fallait pas prendre pour le plaisir le contre-pied systématique de ce qui se faisait spontanément pour aboutir à des choses, peut-être parfaites sur le papier, peut-être flattant une partie de l’opinion publique, mais tota-lement irréalistes.
121
Introduction au Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la région de Paris, 1965 (extraits)
Objectifs de l’urbanisme et de l’aménagement en région de Pariss’il est nécessaire de mettre d’abord en relief les dimensions
des besoins de la région de Paris, c’est parce qu’il ne peut y avoir d’urbanisme sans prise en compte des aspects quantitatifs.
Même séduisant dans son principe, un projet est inopérant s’il n’est à l’échelle. Cette vérité d’ordre général doit être rappelée ici, car il faut constamment garder présent à l’esprit qu’entre une agglomération d’un demi-million d’habitants – généralement considérée en France comme une «grande agglomération» – et la région de Paris, dix à vingt fois plus peuplée, la différence n’est pas seulement de degré dans le volume des moyens à mettre en œuvre, mais véritablement de nature, et dans les problèmes posés, et dans les solutions à leur apporter.
Mais il faut le répéter, l’objectif final ne peut être purement quantitatif. L’urbanisme doit s’efforcer de répondre à une «vision moins partielle de l’homme». Créant le cadre physique de la vie des hommes, il met en jeu très largement les modes de vivre, et son but est de contribuer au «bien-être», ou plus ambitieusement au «bonheur». Plus précisément, l’urbanisme doit viser à mettre à la disposition du plus grand nombre quelques conditions matérielles du bonheur, et il faut d’autant
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
122
moins hésiter à écrire ce mot que subsistent trop souvent dans les esprits les vieilles images selon lesquelles bonheur et vie en ville seraient antinomiques. de ces conditions du bonheur, deux paraissent dominantes et susceptibles de recueillir l’accord de tous:
– la diminution de la fatigue. Les actions en ce sens sont fort diverses: la diminution de la fatigue due au transport entre l’habitat et le travail peut être obtenue par une réduction de la distance, ou par une amélioration de la vitesse, de la régularité, du confort des moyens de transport; il en va de même pour la fatigue due aux achats, aux distractions; le bruit est aussi source de fatigue, comme la concentration des trafics aux mêmes heures dans les mêmes directions; la pollution de l’air, qu’elle soit due au chauffage des immeubles, aux voitures automobiles, à des industries vétustes, à l’insuffisance des dispositifs d’aération dans les transports en commun, doit être particulièrement men-tionnée ici. Cette lutte contre les causes de fatigue peut paraître secondaire, ou peu exaltante pour l’esprit. Mais la fatigue tient une place telle dans la vie quotidienne de la plupart des citadins que les multiples responsables du secteur privé comme du secteur public, dont les décisions forment le cadre de la vie de leurs concitoyens, n’apporteront jamais trop d’attention à cette réalité à la fois reconnue et méconnue;
– la restauration d’une possibilité de choix dans la vie du citadin de condition modeste. Qu’il s’agisse de son logement, de son travail, des établissements d’enseignement pour les enfants, des terrains de sport ou des maisons de jeunes, des forêts ou des plans d’eau, le citadin moyen se heurte trop souvent à des contraintes nées de la pénurie, de l’éloignement, de l’insuffisance des transports, qui restreignent, voire suppri-ment sa liberté pratique. en particulier, les moyens d’éducation et de culture ne doivent pas être rares et d’accès difficile par leur situation ou leurs horaires, mais aussi proches et disponibles que possible.
Annexes
123
un troisième élément peut être ajouté: l’urbanisme doit créer le cadre et les conditions d’une meilleure architecture. dans ce domaine plus subjectif, la réussite ou l’échec d’une telle réalisation peut être diversement apprécié: il est indéniable toutefois que passer huit ou dix heures par jour face au mur aveugle d’une cour obscure ou devant un paysage dégagé com-portant un morceau de ciel et de verdure n’est pas une mince différence. et ce n’est pas seulement affaire d’urbanisme au sens strict: au niveau d’un aménagement régional, les surfaces et les sites nécessaires à une meilleure architecture peuvent être ou ménagés ou compromis. Jadis limitée à quelques mécènes et princes éclairés, presque disparue depuis la révolution indus-trielle, la prise de conscience qu’il existe un devoir de «construire beau» devient une exigence collective.
Ces conditions matérielles d’une vie heureuse, l’observation de ce qui s’est passé en région de Paris depuis vingt ans, pour ne pas remonter plus loin, montre à l’évidence qu’elles ne se créent pas spontanément. Beaucoup d’échecs ont été accumulés, qui ne se répareront pas facilement, faute, pour l’essentiel, d’une vue large de l’avenir et de la volonté consciente et obstinée d’un urbanisme novateur.
125
Discours de Paul Delouvrier à l’occasion de la remise du Prix Érasme
(1985)
votre Majesté,votre altesse royale, régent de la fondation Praemium
erasmianum,vos altesses royales,Monsieur l’ambassadeur, Mesdames, Messieurs, mes chers
amis, de nederland et de France,Quand, au début de l’année, son altesse royale, le Prince
Bernhard des Pays-Bas m’a fait l’honneur de m’informer que le régent et le conseil directeur de la Fondation venaient, pour excellence d’urbanisme, de décider de m’attribuer le prix Érasme 1985, ce fut pour moi, grâce à une discrétion parfaite, une surprise plus que parfaite.
Mes réflexes furent, dans l’ordre, l’étonnement, la joie, la confusion et la reconnaissance.
Le prix Érasme m’était connu; Jean Monnet, mon maître, et robert schuman, les deux pères de l’europe, l’avaient reçu. Mais que les membres exigeants du conseil de la Fondation, aidé du Comité international, me portent à ce rang, quel honneur et quelle joie! Quand j’eus consulté la liste de vos quarante-trois lauréats, quelle compagnie et quelle confusion!
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
126
Le sentiment le plus fort est la reconnaissance. Je me permets de vous demander d’en mesurer l’exacte portée. La plupart de vos lauréats avaient déjà, dans leur pays, et souvent au- delà, une notoriété affirmée. en choisissant l’urbanisme et en recherchant une œuvre de pensée et d’action, vous preniez le risque d’avoir à distinguer entre des noms moins évidents; le fait, en outre, que le milieu culturel français ignore ou presque l’urbanisme ne contribue pas à mettre en relief ceux qui œuvrent en France dans ce domaine. voilà pourquoi ma reconnaissance est si étendue.
Puis-je vous apporter une preuve de ce retard à l’urbanisme de l’intelligence française. Lorsque le général de Gaulle m’a confié en 1961 la charge nouvelle de délégué au district de la région parisienne, je me suis précipité sur le Grand Larousse de 1876 et, au mot «urbaniste», j’ai trouvé:
«1. Partisan du pape urbain contre le pape Clément lors du grand schisme d’occident (1378).
2. religieuse clarisse qui suit la règle de saint urbain (1263).»
Ce n’est que dans le supplément de 1911 que l’on voit appa-raître un troisième sens:
«3. Celui qui pratique l’art d’assainir, d’embellir et d’agrandir les villes.»
Comme vous le notez, il n’est nullement question de construire une ville nouvelle: concept à l’époque impensable.
Pour maîtriser la croissance de l’agglomération parisienne, il fallait une forte équipe à laquelle la devise de votre Fondation s’applique admirablement: «Inveniemus viam aut faciemus». C’est vrai, nous avons inventé la route à faire et nous l’avons faite. Le «nous», c’est l’équipe initiale du schéma directeur, avec Jean Millier, que je salue ici, auteur de la ville moderne d’abidjan, c’est bien sûr l’équipe des fondateurs des cinq villes nouvelles, c’est en même temps la succession des élus, des représentants et des préfets de la région Île-de-France.
Annexes
127
Je remercie M. Hoetink d’avoir permis qu’ils soient invités à cette cérémonie, comme vous me permettrez de remercier ceux d’entre eux qui ont pu s’y rendre.
son altesse royale m’a fait la grâce de vous indiquer ce qu’il y a d’original dans notre conception de la croissance de la métro pole parisienne: croissance rapide en vingt ans, 2,5 mil-lions d’habitants en plus, soit dix millions aujourd’hui.
notre plan de 1964 appelé schéma directeur: cinq villes nouvelles, un réseau modernisé et bien articulé de métros express et d’autoroutes, des centres urbains nouveaux dans les banlieues anciennes, ce plan était d’une audace «coupable».
Comment a-t-il pu être accepté?L’acceptation tient aux circonstances politiques. L’auteur du
miracle fut, bien sûr, le général de Gaulle. J’avais doublé, il est vrai, le projet d’urbanisme, d’un projet administratif, restaurant la présence de l’État dans les banlieues, y compris la banlieue rouge, par la création de cinq départements nouveaux.
Je vis le Général en premier et en secret. devant une immense carte, le président de la république se sentait redevenir général, et il manœuvrait les villes nouvelles et les préfectures nouvelles comme des divisions blindées.
enfin, il s’arrêta pour me dire: «eh bien, voici un plan d’une ampleur de belle venue. Que vous faut-il pour faire tout cela?» Je me gardais bien de dire qu’il fallait beaucoup d’argent, ce qui eût été à la fois vrai et faux (un bon urbanisme coûte d’abord, économise ensuite), mais je répondis que ses ministres ne feraient sans doute rien devant l’importance de l’effort et les réactions de la province. il fallait donc que tout fût décidé à l’elysée. La réponse partit, gouailleuse: «vous avez raison, les ministres se couchent toujours (pardonnez-moi, ce n’est pas moi qui parle). Tout sera décidé par moi ici.» C’était bien là la forme d’une démocratie royalement républicaine et présiden-tielle; la promesse en tout cas fut tenue. Cinq ans plus tard, de Gaulle quitte le pouvoir. Tous les ministres successifs de
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
128
l’urbanisme sont hostiles au schéma directeur. Comment a-t-on pu continuer à l’appliquer? après le miracle de l’appro-bation, c’est le mystère de l’application. en voici les clefs:
1. la maîtrise du sol: l’État achète progressivement plus de 40 000 hectares;
2. l’adhésion des élus et des représentants des forces écono-miques et sociales de la région parisienne; je suis heureux de saluer ici M. roland nungesser, ancien ministre, deuxième président du Conseil des élus de la région, et M. roger Courbey, premier président du Conseil des forces économiques et sociales de cette même région;
3. la force et la loyauté de mes quatre successeurs préfets de région; M. Maurice doublet a regretté de ne pouvoir venir, je salue Lucien Lanier, et j’excuse l’actuel préfet de la région Île-de-France, M. olivier Philip, qu’une obligation impérieuse a empêché de venir, mais qui a tenu à se faire représenter par un collaborateur, M. le préfet Cayon;
4. l’avancement des projets des fondateurs de villes nouvelles; la situation, avec le temps, devenait irréversible.
Le secret final est simple: les ministres qui ne voulaient pas des villes nouvelles désiraient aussi voir construire des logements en région parisienne; pour cela, il fallait des terrains rapidement disponibles. Comme il n’y en avait qu’en villes nouvelles, le ministre devait bien les y mettre par priorité. C’est le principe de la seringue que j’avais appris par le jeu des réserves foncières d’amsterdam.
La fondation d’une ville nouvelle est une tâche passionnante, exténuante, risquée: toute ville, surtout nouvelle, est un réfé-rendum permanent: les vrais décideurs sont les habitants, les employeurs, les commerçants, etc. Pardonnez-moi cette familiarité: la mayonnaise peut rater.
en région parisienne, elle a réussi: tous les fondateurs, tous ceux qui sont sur le terrain, nous avons connu une joie rare, celle de créer, et de créer un cadre de vie pour des générations.
Annexes
129
Les fondateurs de villes sont peut-être les seuls démiurges de notre époque: de rien, ils font surgir un tout, un complexe de vie.
ainsi la joie ab Urbe condita de romulus et rémus. Mais nous, nous n’avons pas eu de sabines à enlever: les femmes sont venues librement.
La solution adoptée pour l’extension spatiale de l’agglomération parisienne a-t-elle une valeur qui dépasse ce Grand Paris?
au risque de vous paraître immodeste, je répondrai oui.Chacun sait que l’urbanisation de la planète devient un pro-
blème gigantesque. La Banque mondiale a élaboré quelques chiffres à ce sujet.
d’ici l’an 2000, en quinze ans, la population du globe va s’élever à six milliards au lieu de quatre aujourd’hui. sur les deux milliards supplémentaires, la moitié, soit un milliard, habitera en ville.
Les villes de plus de trois millions d’habitants, qui sont quarante à l’heure actuelle, passeront à quatre-vingt-cinq en l’an 2000, dont soixante en pays en voie de développement. Les plus grandes villes seront Pékin, shanghai, new York, plus de vingt millions d’habitants, Tokyo et são Paulo, plus de vingt-cinq, et Mexico, plus de trente millions.
Comment organiser la croissance de ces villes de plus de trois millions en tiers-monde?
Beaucoup de dirigeants de ces villes nous ont interrogés, et, nous faisant visiter leurs banlieues et leurs bidonvilles, ils n’ont pas refusé les idées-forces du schéma directeur parisien. Mais pour les villes du tiers-monde, il faut savoir reconnaître le dualisme fondamental de la structure urbaine: d’un côté, la ville de type plus ou moins européen, de l’autre, les bidonvilles. La conclusion est claire: ce n’est pas avec le stéréotype occi-dental qui a privilégié le logement qu’on pourra commencer à résoudre le phénomène urbain à l’échelle mondiale.
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
130
La meilleure solution, me semble-t-il, consiste à conjuguer une aide extérieure très importante pour les voieries, l’eau, l’assai nissement, avec la force de travail de ces populations suburbaines et sous-urbaines. il peut paraître sacrilège au regard de nos conceptions habituelles d’affirmer que le bidonville est un mécanisme social de survie et d’adaptation des immigrants des campagnes. C’est pourtant vrai.
il reste à dominer les bidonvilles en les localisant à l’avance par un bon schéma directeur qui peut s’inspirer du nôtre. Peut-être pourrait-on ici se souvenir du vieux sénèque, qui aurait pu être néerlandais.
Ces vues d’avenir sur l’urbanisation mondiale nous ramènent à Érasme. La vie du grand humaniste s’est déroulée dans un monde en rupture complète avec les siècles précédents; l’avancée extraordinaire de l’esprit humain se marque par: la réforme, la Contre-réforme, la renaissance, l’imprimerie, l’exploration des limites océanes de la Terre par une magnifique lignée d’ex-plorateurs dont l’audace n’était bornée que par leur espérance; Galilée, Copernic, autant de révolutions dans les croyances et les valeurs.
Paraissent, en outre, au début de xvie siècle et pratiquement la même année, l’ouvrage de Machiavel et celui d’Érasme sur le prince; c’est la marque d’une autre et fondamentale rupture qui touche le pouvoir politique. Le prince de Machiavel est encore celui du Moyen Âge; il cherche à satisfaire son ambition et ses passions.
Érasme, héritier de la tradition des libertés communales aux Pays-Bas, voit le pouvoir d’un œil moderne; écoutez-le parlant au prince: «Quand vous acceptez une principauté, ne cherchez pas à vous représenter combien vous recevrez d’honneur et de grandeur, mais combien de charges et de soins.» désormais, le pouvoir doit s’exercer pour le peuple.
Trois ans avant la mort d’Érasme, naît, en 1533, le grand homme qui allait le mieux le comprendre, Guillaume d’orange,
Annexes
131
père de votre patrie, qui va moderniser ces Bataves, supérieurs aux autres peuples germains, dit Tite-Live, et qualifiés de «fratres et amici populi romani», qui ont dû prolonger la vie de l’empire romain d’occident par la valeur de leurs cohortes.
desiderius erasmus fut-il finalement le premier ou le dernier des humanistes européens?
on pourrait discuter longuement. Marguerite Yourcenar, parlant ici même, il y a deux ans, souhaitait l’apparition d’un humaniste s’apparentant à Érasme, d’un humaniste moderne qui, dit-elle, ne peut aujourd’hui qu’appartenir au monde entier.
de même qu’Érasme, cet humaniste doit être, à notre sens, un prophète et un conciliateur:
– un prophète dans la vraie acception du terme, non pas suivant la croyance populaire, celui qui devine l’avenir, mais bien selon la Bible, celui qui dénonce les apparences, qui trouve et clame la vérité, tel soljénitsyne qui crie le goulag, ébranlant la foi communiste de beaucoup d’intellectuels;
– un conciliateur: Érasme, ennemi de tout fanatisme, aimait la gaieté, comme Jean Chrysostome qui disait, en pleine persé-cution: «La tristesse est le dissolvant de l’intelligence.» Érasme savait que pour concilier et convaincre il faut savoir rire.
Humaniste universel? demande Marguerite Yourcenar. Posons-nous la question: quels faits l’esprit de cet humaniste devrait-il dominer et intégrer pour trouver les valeurs nouvelles de ce monde qui est déjà celui de nos enfants?
La première de ces données, c’est que le citoyen du monde a fait sienne la formule de valéry: «L’ère du monde fini com-mence.»; la finitude de la terre des hommes exige aujourd’hui que la psychologie et les besoins du tiers-monde – nous l’avons vu pour l’urbanisation – occupent, dans nos esprits, une place prépondérante. Comment faire vivre dans la dignité six milliards d’êtres humains en l’an 2000?
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
132
Quinze ans nous séparent de cette date: c’est l’instant d’un instant comparé aux millénaires de l’histoire humaine. Parce que le monde industrialisé est en crise, nous diminuons actuel-lement nos heures travaillées; ne faudra-t-il pas les augmenter demain pour nourrir et faire épouser leur siècle à ces peuples démunis, et plus égoïstement pour faire vivre un récent cin-quième monde, celui de nos propres vieillards qui vont croître en nombre et en âge? il y aura d’autres chocs que pétroliers, il y aura d’autres spartacus que ceux qui existent déjà.
seconde exigence pour l’humanité moderne: «la conscience anticipante». il faut voir loin en avant, et pas seulement pour la population; on sait que 90 % des savants et des chercheurs depuis les débuts de l’humanité sont à l’heure actuelle vivants et actifs. nous avons besoin d’un nouveau Jules verne pour inventer les inventions, je veux dire prévoir celles qui ont le plus de chances de surgir avec les conséquences les plus étendues.
Qui, en dehors d’un humaniste, définira la déontologie des manipulations sur la personnalité de l’être humain, qui pré-cisera l’éthique de la procréation comme de l’acharnement thérapeutique? Lequel dira qui a le droit de débrancher les fils par où passe un filet de vie?
n’oublions pas que notre ignorance augmente avec notre savoir: nous sommes donc finalement la civilisation de l’inquié-tude, que seul peut vaincre le refus de la passivité.
Finitude du monde, conscience anticipante, maintenant ère nucléaire, c’est le troisième fait à intégrer, qui nous transporte de la civilisation de l’inquiétude à celle de l’angoisse. Hiroshima a été une incroyable rupture; jusque-là, la guerre, si longue et meurtrière fût-elle, avait un but: la paix; aujourd’hui, la guerre n’a d’autre résultat que le vide, la paix du vide en sept minutes. stultitia, dirait Érasme, folie suprême! et c’est pourtant la folie qui maintient la sagesse. si bien que, mis à part les conflits de la décolonisation, les luttes tribales du tiers-monde, qui parcourt son Moyen Âge, et les passions déclenchées par le fait israélien,
Annexes
133
nous venons de vivre quarante ans de paix, dans une angoisse liée au fait que la paix ne tient qu’à un fil, le fil de la dissuasion, c’est-à-dire de deux peurs égales qui se paralysent et donnent, dans les États disposant de la bombe, le pouvoir suprême à un seul, butoir pour l’instant de notre europe.
Ces deux peurs commencent maintenant à nous faire monter dans l’espace pour la guerre des étoiles. Cette familiarité nou-velle avec l’espace et la non-pesanteur – quelle surprise pour newton! – va avoir une conséquence bouleversante, déjà entamée, qui est la mondialisation, avec bataille des ondes, de la communication. L’ère du monde uniforme commence, avec une langue universelle qui, malgré le regret du français, ne peut être que l’anglais. Quelle influence aura sur le milliard de Chinois l’impact de la télévision américaine?
Hiroshima a beaucoup d’autres suites que l’impossible sacri-fice de quelques milliards de morts. entre nations également avancées, l’absence de guerre, pour la première fois dans l’his-toire des hommes, – pendant presque un demi-siècle, et, espérons- le à jamais – a et va avoir des conséquences sociologiques mal perçues: sans doute peut-on lui imputer déjà l’atténuation des différences de comportement entre l’homme et la femme, de la coupe des cheveux au port du jean et à la conquête des emplois, ainsi que le caractère aigu des revendications fémi-nistes contre un homme qui, faute de faire la guerre, peut faire la cuisine; la violence, sans l’exutoire de la gloire ou de la mort au combat, resurgit sous des formes citadines, accompagnée des stupéfiants, et la police en reste paralysée; peut-être faudra-t-il créer des routes spéciales pour les fous du volant, race irrémédiable et qui fait périr beaucoup plus de gens innocents que le terrorisme international, lui-même riposte moderne du faible au fort, qui laisse le militaire à la chambre et met le diplomate en première ligne, ô Clausewitz! Quant à la patrie, c’est une valeur qui s’éteint; peut-être renaîtrait-elle si les fils d’europe, derrière le mur de la honte et de l’attaque, gardaient
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
134
ensemble la frontière d’europe pour garder les valeurs euro-péennes, les libertés européennes, bref, la civilisation euro-péenne; enfin, les migrations sans précédent de populations d’âge préindustriel, engendrent un racisme qui se généralise, et qu’une condamnation théorique sans nuance ne fait que renforcer. L’islam intégriste se marie mal.
dernière conséquence d’Hiroshima que je mentionnerai: elle porte sur le pouvoir des États en dehors du pouvoir suprême dont j’ai parlé: la naissance, non de l’écologie, mais des éco-logistes, dont les revendications, souvent saines, deviennent dange reuses quand elles vont à l’extrême. L’effort nucléaire civil, que souhaitait einstein, a été ainsi rendu insuffisant dans le monde, de même que les euromissiles nucléaires militaires tardaient à venir. L’électricité et le gaz peuvent nous délivrer de la crainte de manque de pétrole, (je n’oublie pas 1974 et le splendide égoïsme des États oubliant les effets de l’embargo chez vous); ne plus craindre l’insuffisance pétrolière pourrait à son tour nous libérer de la cavalcade à travers le monde développé des pétrodollars, dont personne, crainte de rétorsion, ne veut parler en allant au fond des choses. Le chômage géné-ralisé n’y trouve pas sa cause unique, mais nous payons très cher, et les pays se développant et sans pétrole encore plus cher, pour des universités dans le désert.
Toujours dans le domaine de l’énergie, le barrage psycho-logique a retardé la centrale électrique qui multiplie par plus de cinquante les réserves d’uranium du globe, la centrale sur-génératrice, dont on oublie qu’elle est aussi seule à «manger» de façon utile nos bombes nucléaires. Le jour où celles-ci deviennent obsolètes, ou le jour tant attendu où MM. Gorbatchev et reagan se décideraient, même très partiellement, à désarmer; que faire des bombes rayées sur le papier? Faudra-t-il des milliers de gardiens avec des armes nucléaires tactiques pour garder le cimetière des bombes à la fois mortes et encore vivantes? Quelle dérision!
Annexes
135
voilà donc une liste toute provisoire des exigences interroga-tives du monde moderne. Je voudrais terminer en signalant un suprême et capital élément. J’espère ne choquer personne en disant que cette dernière exigence, c’est dieu. Je ne dis pas le christianisme d’Érasme, mais plus simplement dieu, dieu non pas comme explication de l’univers, car la science recule cette explication à l’infini, mais comme Être suprême, maître de l’éthique et amour éternel, satisfaisant ce besoin rationnel de notre irrationnel.
Beaucoup dans l’élite des penseurs pensent ainsi et pourtant, la plupart d’entre eux, sont plus athées que croyants.
Jean rostand, biologiste athée disait: «Le problème de dieu sera le plus grand problème à la fin de notre siècle.» et Jean Guitton, philosophe chrétien ajoute: «seuls les mystiques peuvent sauver l’humanité.»
J’ai connu un président du Conseil en France qui disait: «Pour y voir clair, la politique des yeux mi-clos doit être pour-suivie aveuglément.» C’est l’inverse pour l’humaniste. voir clair est essentiel. Le mysticisme est plus mystérieux, et je ne me sens pas capable de terminer ce propos par une crise de ce genre. Le modérateur Érasme, au nom duquel je suis honoré, me dirait d’ailleurs: «Modérez-vous.»
J’ai simplement voulu marquer que l’urbanisme et l’archi-tecture, qui sont l’inscription des besoins humains sur le seul bien vraiment rare, le sol urbanisable, et qui, par ce fait, pour-raient paraître arts seconds et matérialistes, ne peuvent ignorer aucune des disciplines de l’esprit. au sens propre du terme, urbanisme et architecture sont l’incarnation des idées et des valeurs d’une époque. rappelez-vous le soin que les moines mettaient à édifier leurs monastères: ils savaient que la beauté des formes et que l’heureux agencement des espaces élèveraient plus haut leurs prières.
Le mot «prière» me donne à penser que j’en ai une à vous adresser: la surprise de ce prix le rend plus délicieux, mais
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
136
priez pour qu’il ne me rende pas vaniteux, péché français par excellence.
vous comprendrez donc que je termine par le mot le plus simple pour vous exprimer une double reconnaissance.
Je dis aux Pays-Bas, qui, par les jeux de l’amour et du hasard, m’ont donné une épouse, née à amsterdam de père néerlandais, laquelle m’a donné cinq enfants, cinq couples aujourd’hui qui auront le temps, je l’espère, de devenir de vrais européens, alliés bien sûr aux américains, au peuple d’Érasme et de Guillaume d’orange, je dis merci.
À la Fondation Praemium erasmianum, très spécialement à votre altesse royale qui vient de me remettre, ainsi qu’à l’équipe des aménageurs de la région capitale de la France, un prix prestigieux dont nous mesurons pleinement la portée,
Je dis, avec l’intelligence et le cœur, merci.
137
Notices biographiques
Michel Debré (1912-1996)a été garde des sceaux, Premier ministre, ministre de l’Édu-
cation, de l’Économie et des Finances, des affaires étrangères et de la défense. en décembre 1964, il fait voter la «loi debré» qui vise à éradiquer les bidonvilles en France. Témoignage recueilli par Bernard Hirsch.
Serge Goldberg (né en 1927)a été directeur des études générales à l’iaurP pendant l’éla-
boration du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la région parisienne. il a dirigé l’établissement public d’amé-nagement de la ville nouvelle de saint-Quentin-en-Yvelines, puis présidé l’établissement public du parc de la villette. Témoignage recueilli le 5 avril 2005.
Robert Lion (né en 1934)a été directeur de la construction, directeur général du Plan-
construction, délégué général de l’union des HLM, directeur de cabinet du Premier ministre Pierre Mauroy et directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Témoignage recueilli le 4 mai 2009.
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
138
Jean Millier (1917-2006)a été ministre des Travaux publics en Côte-d’ivoire, directeur
au district de la région de Paris, directeur général de l’iaurP et président-directeur général de l’Établissement public pour l’aménagement de La défense. Témoignage recueilli le 1er octobre 1999.
Jérôme Monod (né en 1930)a été chargé de mission au cabinet du Premier ministre
Michel debré, délégué adjoint puis délégué à la daTar, secré taire général du rPr et président-directeur général de la Lyonnaise des eaux. Témoignage recueilli le 6 juin 2005.
Edgard Pisani (né en 1918)a été ministre de l’agriculture, de l’Équipement, en charge
de la nouvelle-Calédonie et commissaire européen. Témoignage recueilli le 9 novembre 1999.
Jean-Eudes Roullier (1931-2010) ancien collaborateur de Paul delouvrier à la délégation
générale au district de Paris, il a été conseiller technique aux cabinets de François-Xavier ortoli, de robert Galley et albin Chalandon, directeur général du Groupe de travail interminis-tériel pour les villes nouvelles, puis président du Groupe central des villes nouvelles. Témoignage recueilli le 11 mai 2005.
Georges Valbon (1924-2009) a été maire de Bobigny et président du conseil général de la
seine-saint-denis. Témoignage recueilli le 13 octobre 1999.
Annexes
139
Jacques Voisard (né en 1924)a été officier en indochine et en algérie, chargé de mission
à la daTar et commissaire à l’industrialisation de l’ouest atlantique. Témoignage recueilli le 14 juin 2006.
Éric Westphal (né en 1929)a travaillé aux côtés de Jean Monnet à la Haute autorité de
la CeCa et de Paul delouvrier en algérie et au district de la région de Paris. il est également l’auteur de nombreuses pièces de théâtre. Témoignage recueilli le 1er mars 2005.
141
Bibliographie succincte
Michel Carmona, Le Grand Paris: l’évolution de l’idée d’amé-nagement de la région parisienne, thèse de doctorat, 1979.
Roselyne Chenu, Paul Delouvrier ou la passion d’agir, Paris, éditions du seuil, 1994.
Michel Debré, Mémoires, III. Gouverner (1958-1962), Paris, albin Michel, 1988.
Délégation générale au district de la région de Paris, Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la région de Paris, Paris, La documentation française, 1966.
Marcel Doublet, Paris en procès, Paris, Hachette, 1976. Alessandro Giacone, Paul Delouvrier. Un demi-siècle au service de
la France et de l’Europe, Paris, descartes & Cie, 2004.Alessandro Giacone, Dominique Lefrançois (dir.), Jean Millier
(1917-2006), ingénieur des Ponts et Chaussées, un hussard de l’architecture, Paris, anteprima/aaM éditions, 2008.
Bernard Hirsch, L’Invention d’une ville nouvelle. Cergy-Pontoise, 1965-1975, Paris, Presses de l’école nationale des Ponts et chaussées, 2000.
Bernard Hirsch (dir.), L’Aménagement de la région parisienne (1961-1969), Paris, Presses de l’École nationale des ponts et chaussées, 2003.
Sébastien Laurent (dir.), Paul Delouvrier, un grand commis de l’État
Les Grands Paris de Paul Delouvrier
142
(actes de la journée d’études du 1er décembre 2003), Paris, Presses de sciences-Po, 2005.
Lion Murard, François Fourquet, La Naissance des villes nouvelles: anatomie d’une décision (1961-1969), Paris, Presses de l’école nationale des Ponts et chaussées, 2004.
Jean Vaujour, Le Plus Grand Paris: l’avenir de la région parisienne et ses problèmes complexes, Paris, PuF, 1970.
Jean Vaujour, Vingt-cinq ans de villes nouvelles en France, Paris, economica, 1989.
Danièle Voldman (dir.), «Les origines des villes nouvelles de la région parisienne, 1919-1969», Cahiers de l’IHTP, décembre 1990.
Laurent Zylbergerg, De la région de Paris à l’Île-de-France, thèse de doctorat, 1992.
on trouvera une bibliographie détaillée sur le site: http://www.villes-nouvelles.equipement.gouv.fr/base/index.html
Du même auteur
Paul Delouvrier. Un demi-siècle au service de la France et de l’Europe, Paris, descartes & Cie, 2004.
L’Europe difficile. La construction européenne, co-auteur Bino olivi, Paris, Gallimard, «Folio Histoire», 2007.
Jean Millier (1917-2006), ingénieur des Ponts et Chaussées, un hussard de l’architecture, co-auteur dominique Lefrançois, Paris, anteprima/aaM éditions, 2008.