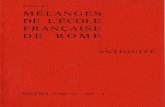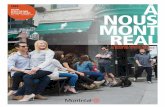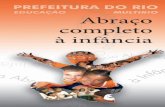Évolution stratigraphique et paléo-environnementale de la Formation à Microcodium et des...
Transcript of Évolution stratigraphique et paléo-environnementale de la Formation à Microcodium et des...
Évolution stratigraphique et paléo-environnementale de la Formationà Microcodium et des Calcaires à Nummulites dans
les Alpes Maritimes franco-italiennes
Stratigraphic and paleoenvironmental evolution of the MicrocodiumFormation and the Nummulitic Limestones in the French-Italian
Maritimes Alps
Dario Varrone a,*, Pierangelo Clari a,b
a Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze della Terra, 5, via Accademia delle Scienze, 10123 Torino, Italiab CNR, Istituto di Geoscienze e Georisorse Sezione di Torino, 5, via Accademia delle Scienze, 10123 Torino, Italia
Reçu le 5 août 2002 ; accepté le 28 février 2003
Résumé
Le présent travail vise à donner une description détaillée et une interprétation paléo-environnementale de l’Eocène du DomaineDauphinois-Provençal dans les Alpes Maritimes méridionales. Le secteur étudié couvre une aire de 40 km2 environ. Il a été cartographié àl’échelle 1:10 000. Cinq coupes stratigraphiques ont été levées et échantillonnées. Sur la base des caractéristiques lithologiques etpaléontologiques, les dépôts analysés ont été divisés en deux unités lithostratigraphiques : la Formation à Microcodium et les Calcaires àNummulites. La Formation à Microcodium comprend cinq faciès : (1) les brèches à Microcodium, (2) les calcaires argileux à débris deMicrocodium, (3), les conglomérats à Microcodium, (4) les calcaires micritiques sombres et (5) les grès blancs quartzeux. Les Calcaires àNummulites comprennent trois faciès : (6) les dépôts de base, (7) le faciès à Nummulites et (8) le faciès à Orbitoidacea. L’analyse desenvironnements de dépôt a mis en évidence que les premiers sédiments éocènes du Domaine Dauphinois-Provençal (faciès 1 à 5), sont desfaciès de remplissage de paléo-vallées. Les paléo-vallées ont incisé le substrat mésozoïque pendant son émersion du Crétacé supérieur àl’Eocène inférieur. La sédimentation, au cours de l’Eocène moyen-supérieur, débute par des dépôts fluviatiles à estuariens (brèches àMicrocodium, 1 ; calcaires argileux à débris de Microcodium, 2 ; conglomérats à Microcodium, 3) qui sont limités vers la mer par des flèchessableuses comportant des dunes (grès blancs quartzeux, 5). Ces flèches barraient l’embouchure du fleuve et isolaient une partie de l’estuaireoù se localise une sédimentation saumâtre (calcaires micritiques sombres, 4). Les grès blancs quartzeux représentent le dernier terme d’affinitécontinentale de la succession éocène. Le passage à un milieu franchement marin se situe dans la base des Calcaires à Nummulites. LesCalcaires à Nummulites sont représentatifs d’un paléo-environnement de rampe interne à moyenne dominée par les vagues et sont caractériséspar un taux de sédimentation très faible. L’action des vagues est responsable du mélange des éléments silicoclastiques et bioclastiques dans lessecteurs internes de la rampe (faciès 7). Par contre, sur la rampe moyenne à externe (facies 8), l’action des vagues de tempête permet l’apportde matériel remanié provenant des secteurs les plus internes. Les faciès décrits enregistrent une tendance bathycroissante des environnementsde dépôt. Les environnements de dépôt fluviatiles puis paraliques, sont suivis par une transgression marine (faciès 6) qui procède d’unenvironnement de rampe mixte silicoclastique-carbonatée à un milieu hemipélagique. Le découpage séquentiel proposé dans ce travail se basesur l’identification des principales surfaces stratigraphiques. La première surface mise en évidence est la limite de séquence localisée entre lesfaciès pélagiques du Crétacé supérieur et les premiers dépôts continentaux de l’Eocène. Cette surface est liée à l’évolution tectonique dudomaine alpin, qui conduit au soulèvement et à l’émersion des dépôts mésozoïques. La deuxième surface est une surface de ravinementtransgressif localisée entre la Formation à Microcodium et les Calcaires à Nummulites. Cette surface est un marqueur à l’échelle régionale etse situe entre la partie sommitale du Lutétien et la partie basale du Bartonien. Le découpage séquentiel proposé ici est en désaccord avec les
* Auteur correspondant.Adresse e-mail : [email protected] (D. Varrone).
Geobios 36 (2003) 775–786
www.elsevier.com/locate/geobio
© 2003 Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS. Tous droits réservés.doi:10.1016/j.geobios.2003.09.001
courbes eustatiques de deuxième et troisième ordre de Haq et al. (1987). L’absence, dans la succession décrite, de l’enregistrement des signauxeustatiques les plus remarquables de l’Eocène nous suggère que, dans les Alpes Maritimes, les fluctuations globales du niveau de la mer ont étémasquées par l’évolution tectonique du bassin d’avant-pays alpin, pendant le Lutétien-Priabonien.
© 2003 Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS. Tous droits réservés.
Abstract
The present study offers a detailed description and a palaeogeographic interpretation of the Eocene deposits of the Dauphinois-Provençaldomain in the southern Maritime Alps. The studied area is 40 km2 in extent and was mapped at 1:10.000. Five sections were measured andsampled. On the basis of lithological and paleontological features, two lithostratigraphic units have been distinguished: the Microcodiumformation and the Nummulitic limestone. The Microcodium formation includes five facies: (1) the Microcodium breccias, (2) the clayeylimestones, (3) the Microcodium conglomerates, (4) the dark micritic limestones and (5) the white quartz sandstones. The NummuliticLimestones include three facies: (6) a basal lag deposit, (7) the Nummulitic facies and (4c) the Orbitoidacea facies. The paleoenvironmentalanalysis shows that the first Eocene sediments of the Dauphinois-Provençal Domain (facies 1 to 5) represent incised valley fills. The valleyswere incised on the Mesozoic deposits during their subaerial exposure from Late Cretaceous to Early Eocene. Fluvial to estuarine deposits(Microcodium breccias, 1; clayey limestones, 2; Microcodium conglomerates, 3) accumulated during the middle-upper Eocene in the valleysthat were limited towards the sea by sand ridges (white quartz sandstones, 5). Theses ridges, located in the distal part of the estuary, isolateda brackish environment where the dark micritic limestones (facies 4) deposited. A transition to a fully marine environment occurred onlyduring the Nummulitic limestones deposition. This unit represent a wave-dominated, middle to inner ramp, characterized by a lowsedimentation rate. The storm waves action resulted in a mixing of bioclastic and terrigenous grains in the inner ramp (facies 7), whiletransported material prevailed in the middle ramp (facies 8). As a general trend, the facies indicate an ininterrupt deepening of the depositionalenvironment. The passage from continental to paralic environments was followed by a marine transgression (fades 6) beginning with ainner-middle ramp mixed sedimentation and ending with a more pelagic sedimentation. In the present study a sequential analysis based on therecognition of major stratigraphic surfaces was attempted. The first stratigraphic surface is a sequence boundary located between the UpperCretaceous facies and the Eocene continental deposits. This sequence boundary is linked to the geodynamical evolution of the Alps that causeda general uplift during the Late Cretaceous to Early Eocene. The second surface is a ravinement surface located at the base of the Nummuliticlimestones. It is a regional marker of Lutetian-Bartonian age. A significant discrepancy between the depositional depth evolution of the studiedfacies and the second and third order eustatic cycles of Haq et al. (1987) is evidenced. The major eustatic signals referred to the Eocene, are notregistered in the studied sections. In conclusion we can assert that, in the Maritime Alps, during the Lutetian-Priabonian, the eustatic sea levelchanges have been masked by the geodynamic evolution of the Alpine foreland basin.
© 2003 Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS. Tous droits réservés.
Mots clés : Alpes Maritimes ; Formation à Microcodium ; Calcaires à Nummulites ; Vallée incisée ; Rampe
Keywords: Maritime Alps; Microcodium Formation; Nummulitic limestones; Incised valley; Ramp
1. Introduction
Les caractères généraux et les grands traits paléogéogra-phiques du Domaine Dauphinois-Provençal dans les AlpesMaritimes ont été fixés il y a quarante années environ (Bous-sac, 1911 ; Faure-Mauret et Fallot, 1954 ; Sturani, 1969 ;Bodelle et Campredon, 1971 ; Campredon, 1972 ; Lan-teaume, 1968), mais depuis peu de travaux ont paru (Lan-teaume, 1990 ; Vanossi, 1990 ; Pasquini et al., 2001).
Ce travail, conduit dans la Vallée Roya (Ligurie et Dépar-tement des Alpes Maritimes), est basé sur des nouveauxtravaux de cartographie géologique et sur le lever de coupesstratigraphiques. Un intérêt particulier a été porté à la Forma-tion à Microcodium et aux Calcaires à Nummulites. Il n’estpas ici question d’une révision détaillée des Calcaires àNummulites dans le domaine étudié, mais de mettre en évi-dence les variations de faciès dans les séries de l’Eocène et dereconstruire les paléo-environnements de dépôts en s’ap-puyant sur des études inédites (Lapio, 1998 ; Varrone, 1998 ;Gelci, 2001 ; Irace, 2001 ; Sanchez-Palomo, 2001).
Dans ce travail, un découpage séquentiel est proposé afinde mettre en parallèle les fluctuations relatives du niveau dela mer et l’évolution tectonique alpine dans ce secteur desAlpes Maritimes.
2. Géologie
Le secteur étudié est localisé dans les Alpes Maritimesfranco-italiennes et il correspond à la terminaison méridio-nale du Domaine Dauphinois-Provençal (Fig. 1(a)), qui re-présente un secteur à la partie externe de la marge continen-tale européenne.
Au cours de l’Eocène, la région étudiée se situait le longde la marge du bassin d’avant-pays alpin. La collision entreles deux marges continentales a provoqué dans les zonesexternes une flexuration de la marge européenne chevauchée,dont la migration a contrôlé en grande partie l’émersion etl’érosion du substrat pré-Paléogène (Ford et al., 1999). Al’Eocène inférieur-moyen, des sédiments paraliques, attri-bués à la Formation à Microcodium (Faure-Mauret et Fallot,
776 D. Varrone, P. Clari / Geobios 36 (2003) 775–786
1954), se sont déposés dans les zones érodées (Gupta, 1997),(Fig. 1(b)). A l’Eocène moyen-supérieur, la migration dubassin d’avant-pays en direction du sud-ouest provoque unetransgression marine majeure et le dépôt des Calcaires àNummulites (Crampton et Allen, 1995). Ces calcaires, dépo-sés en discontinuité sur les calcaires mésozoïques ou sur laFormation à Microcodium, groupent de nombreux faciès,différents pour leur granulométrie, leur pétrographie et leurcontenu fossilifère. Ils se sont déposés dans un environne-ment de rampe mixte silicoclastique-carbonatée, à une pro-fondeur variable entre 0 et 130 mètres (Sinclair, 1997). Danscet environnement marin les apports silicoclastiques ont li-mité la production carbonatée biogénique représentée parune association biotique de type « heterozoan », dominée parles macroforaminifères (James, 1997). Les Calcaires à Num-mulites, dont l’épaisseur est comprise entre 30 et 100 mètresenviron, sont datables du Lutétien-Bartonien et localementau Priabonien inférieur (Blondeau et al., 1968).
Les Calcaires à Nummulites sont surmontés par les Mar-nes à Globigerina ; ces faciès hémipélagiques à pélagiquessont datés du Priabonien s.l. (Lanteaume, 1968, 1990). Laphase terminale de la sédimentation dans le bassin d’avant-pays alpin, dans les Alpes Maritimes, est marquée par ladéposition des successions turbiditiques, le Flysch de Venti-miglia (Vanossi, 1990).
3. Méthodes
Le secteur étudié de 40 km2 environ (Fig. 2), a été carto-graphié à l’échelle du 1:10 000. Les différences majeures, quiapparaissent en comparaison avec la cartographie de Cam-predon (1972), sont relatives à la Formation à Microcodiumqui s’étend avec beaucoup de continuité dans l’aire étudiée.
Cinq coupes stratigraphiques ont été levées et échantillon-nées (Fig. 3). Les corrélations entre coupes sont basées surl’analyse de la géométrie des corps sédimentaires ; ces géo-métries sont localement compliquées par la déformationpost-Eocène. Les microfaciès ont été distingués sur la basede leur contenu fossilifère, sur leurs caractéristiques diagé-nétiques et sur la pétrographie de leurs composants silico-clastiques. 186 répliques de sciages sur acétate (« peels ») et132 lames minces ont été décrites.
L’étude des fossiles tient compte de la variété des espèces,de la succession verticale de ces espèces et du rapportd’abondance entre foraminifères planctoniques et benthi-ques. Le découpage biostratigraphique des calcaires marinsest basé sur l’analyse des macroforaminifères benthiques. LeGenre Nummulites a été étudié au niveau spécifique car tousles niveaux de la succession contiennent une associationriche et diversifiée. La biostratigraphie des Nummulites a étéfondée sur la synthèse de Serra-Kiel et al. (1998). Les nou-velles données sont parfois en désaccord avec celles de lalittérature (p. ex Lanteaume, 1968 ; Campredon, 1972). Dansce travail, on s’est toutefois borné à mettre simplement enévidence ces différences d’interprétation et/ou de datation.
Dans cette étude est appliquée la « terminologie séquen-tielle » définie par Homewood et al. (1999).
4. Faciès et environnements de dépôt
Les dépôts des coupes de Trucco, Croce di Sapalea, Biviodi Olivetta, Roche de Tron et M. Forquin (Fig. 3) ont étédivisés en deux unités lithostratigraphiques : la Formation àMicrocodium et les Calcaires à Nummulites. La Formation àMicrocodium a été déposée sur un substrat mésozoïque cons-titué de calcaires micritiques, tandis que les Calcaires à
Fig. 1. (A) Localisation géographique et géologique du secteur étudié. (B) Coupe stratigraphique schématique du secteur étudié.Fig. 1. (A) Geographic and geologic location of the studied area. (B) Schematic stratigraphic section of the studied area.
777D. Varrone, P. Clari / Geobios 36 (2003) 775–786
Nummulites peuvent raviner sans distinction la formation àMicrocodium ou le substrat mésozoïque.
Le substrat mésozoïque est représenté par des calcairesmicritiques en bancs centimétriques ou décimétriques inters-tratifiés avec des lits marneux ; des intercalations silteusescaractérisent les calcaires micritiques dans leur partie supé-rieure. L’association fossilifère est représentée par des calcis-phères, des débris d’Inoceramus et des foraminifères planc-toniques. Les foraminifères aplatis et étirés, sont trèsdifficiles à reconnaître au niveau spécifique. Les espècessuivantes ont toutefois été identifiées : Globotruncana arca,Globotruncana linneiana, Contusotruncana fornicata, Glo-botruncanita sp. Ces formes sont caractéristiques du Crétacésupérieur. Les Calcaires micritiques sont caractéristiquesd’un environnement de dépôt hémipélagique soumis à desapports détritiques.
4.1. La Formation à Microcodium
Cette formation a été décrite pour la première fois, dansles Alpes Maritimes par Faure-Mauret et Fallot (1954) quiont individualisé des niveaux qui s’intercalent, de façon dis-continue, entre les premiers sédiments marins du Tertiaire(Calcaires à Nummulites) et le substrat mésozoïque. Danscette étude, la définition de la « Formation à Microcodium »proposée par Faure-Mauret et Fallot (1954) est appliquée.
La Formation à Microcodium est constituée par des ni-veaux irrégulièrement répartis, d’épaisseur variable, parfoisà dominante conglomératique, parfois franchement argileux,dont l’âge est directement comparable à celui des Calcaires àNummulites superposés (Cavelier, 1984). Nous avons diviséla Formation à Microcodium en cinq faciès : (1) les brèches àMicrocodium, (2) les calcaires argileux à débris de Microco-
Fig. 2. Carte géologique schématique du secteur étudié et localisation des coupes levées.Fig. 2. Geological sketch of the studied area and location of the sections.
778 D. Varrone, P. Clari / Geobios 36 (2003) 775–786
Fig. 3. Coupes de Roche de Tron, du Bivio di Olivetta, du M. Forquin, de Trucco et de Croce di Sapalea. Faciès, corrélations, associations biotiques et surfacesstratigraphiques majeures.Fig. 3. Roche de Tron, Bivio di Olivetta, M. Forquin, Trucco and Croce di Sapalea sections. Facies, correlations, fossils assemblages and main stratigraphicsurfaces.
779D. Varrone, P. Clari / Geobios 36 (2003) 775–786
dium, (3) les conglomérats à Microcodium, (4) les calcairesmicritiques sombres et (5) les grès blancs quartzeux.
• Les brèches à débris de Microcodium (1)Ce faciès est relativement épais dans toutes les coupesétudiées (Fig. 3) à l’exception de la Roche de Tron oùcelle-ci n’a qu’une puissance de quelques dizaines decentimètres. Ces dépôts massifs, à graviers anguleux,sont localisés à la base de la succession tertiaire encontact net et parfois érosif avec le substrat mésozoïque.La matrice, qui représente 40% du sédiment, est consti-tuée de marnes silteuses blanches qui contiennent desdébris de Microcodium et des foraminifères planctoni-ques remaniés du Crétacé supérieur. Les graviers ont undiamètre de 2 à 15 cm. Mais Pasquini et al. (2001) ontobservé, au nord de la coupe du Bivio di Olivetta, desblocs de dimensions métriques. Les graviers sont com-posés par des débris de calcaires gris du Crétacé supé-rieur. Localement, ce faciès a une géométrie lenticulairemais toutefois manque toujours d’un litage et d’un gra-noclassement.
• Les calcaires argileux à débris de Microcodium (2)Ces calcaires, de teinte sombre, sont épais de 0 à environ30 m et présentent un litage mal défini. Les couchesprennent localement une couleur pourpre, due à uneforte teneur en hématite, ou verte. Analysés en lamemince, les sédiments ont révélé un contenu en silt impor-tant qui peut atteindre 20%. Ce faciès montre une aug-mentation de la fraction carbonatée dans sa partie supé-rieure où des nodules carbonatés centimétriques,entourés de fissures circum-granulaires, suggèrent desphénomènes de dissolution et de réprécipitation.Les bioclastes sont représentés uniquement par des dé-bris de Microcodium.
• Les conglomérats à Microcodium (3)Les conglomérats à Microcodium affleurent seulementdans la coupe du M. Forquin (Fig. 3) toutefois, uneextension majeure de ce faciès a été observée par Pas-quini et al. (2001) dans les environs de Ventimiglia, ausud du secteur étudié.Ce faciès est intercalé dans les calcaires argileux à débrisde Microcodium (2) et il est constitué de corps lenticu-laires caractérisés par une épaisseur qui peut atteindre20 m et une extension latérale de quelques dizaines demètres. La matrice est toujours absente et les galets,d’un diamètre de 1 à 10 cm, sont pour la plupart compo-sés par des débris de calcaires gris du Crétacé supérieuret, accessoirement, par des silex noirs et des fragmentsde paléosols remaniés du Crétacé supérieur. Ces galetssont représentatifs du bassin versant et dérivent princi-palement de roches sédimentaires mésozoïques. Le fa-ciès est caractérisé par la présence de Microcodium(Fig. 4(a)), qui se présente en petites chaînes millimétri-ques de prismes de calcite sombre. Le Microcodiumpeut se trouver à la surface ou à l’intérieur des galetscarbonatés. Les conglomérats à Microcodium contien-
nent de rares débris d’Inoceramus et une riche micro-faune remaniée du Crétacé supérieur. Comme pour lesfaciès 1 et 2, l’âge est incertain, entre un Crétacé supé-rieur et un Lutétien.
• Les calcaires micritiques sombres (4)Le terme de calcaires micritiques sombres a été utiliséindifféremment, dans cette étude, soit pour indiquer unfaciès à composant calcaire et à litage centimétrique àdécimétrique, soit pour les dépôts décrits dans la littéra-ture sous le nom de Couches à Cerithium diaboli (Bous-sac, 1911).Ce faciès débute sans discontinuité au-dessus des calcai-res argileux à débris de Microcodium (2), des conglomé-rats à Microcodium (3) et localement des Grès blancsquartzeux (5) (Fig. 3). Le faciès est essentiellementconstitué par des alternances de calcaires micritiques, demarnes sableuses bleutées et de grès. Vers le sommet, lesbancs calcaires-marneux deviennent prépondérants etils contiennent des lits de silex noir (Fig. 4(b)) et dedolomite qui sont caractérisés par une structure rubanéeou laminée. Parfois ces niveaux sont associés à desmarnes massives contenant des bitumes (coupe deTrucco).L’association fossilifère est souvent abondante et peudiversifiée. Les niveaux sableux contiennent des céritheset des huîtres tandis que les niveaux micritiques sontcaractérisés par la présence de charophytes et d’ostraco-des (Fig. 4(c)). Les faciès les plus carbonatés ont livré :Discorbis, Bolivina, Valvulammina, Elphidium sp.,Neoconorbina sp., Sigmoilina, Textularia, Cibicides lo-batus, Cibicidoides, Nonion et des miliolides (Sanchez-Palomo, 2001).Les calcaires micritiques sombres ont été rapportés auLutétien supérieur (Boussac, 1911 ; Bodelle, 1968 ;Sturani, 1969).
• Grès blancs quartzeux (5)Les grès blancs quartzeux reposent en concordance ap-parente sur les faciès 1 et 3 ou sur les termes mésozoï-ques ravinés (Fig. 3). Ils débutent par une assise conglo-mératique suivie par des grès quartzeux à bioclastes etdes calcaires gréseux. Ils sont organisés en couchesdécimétriques à métriques, bien classées, et la fractionpélitique est toujours absente. L’analyse au microscopedes granules de quartz indique l’existence de deux clas-ses granulométriques différentes : des grains grossiersbien arrondis (entre 2 et 1 mm) et des grains anguleuxplus petits (<0,25 mm) (Fig. 4(d)). La bioturbation estdiffuse ; toutefois, on peut voir localement soit unelamination oblique mal développée, soit une laminationparallèle et des laminations de tempête (« hummockycross stratification »). La géométrie d’ensemble est len-ticulaire et son épaisseur varie entre 0 et 35 mètres. Lesrares bioclastes sont des macroforaminifères très frag-mentés et corrodés (Nummulites gr. puschi, Nummu-lites gr. brongniarti) pouvant être attribués à la biozone
780 D. Varrone, P. Clari / Geobios 36 (2003) 775–786
SBZ 17 du Bartonien (Serra-Kiel et al., 1998). Toute-fois, il n’est pas certain qu’il s’agisse d’une associationautochtone.La Formation à Microcodium correspond à un environ-nement de dépôt saumâtre, laguno-estuarien qui précèdela transgression marine (Calcaires à Nummulites). Lescinq faciès individualisés dans la Formation à Microco-dium enregistrent le passage entre un environnement dedépôt continental (faciès 1, 2 et 3) et paralique (faciès4 et 5).Les brèches à débris de Microcodium (1) sont caractéri-sées par une surface basale nette, par une extrême varia-bilité de dimensions des graviers, par l’absence d’ungranoclassement des éléments et par une forte propor-tion de la matrice. A notre avis ces dépôts sont rapporta-bles à des « debris-flow » plus ou moins plastiques qui sesont développés dans un environnement continental (cô-nes alluviaux proximaux ?).Les calcaires argileux à débris de Microcodium (2) et lesconglomérats à Microcodium (3) traduisent un environ-nement fluviatile peu profond, de haute énergie. LeMicrocodium témoigne d’une activité bactérienne dansun environnement continental émergé (Lucas, 1967 ;
Klappa, 1978 ; Freytet et Plaziat, 1982 ; Alonso et al.,1997). Selon la classification de Miall (1995), les calcai-res argileux associés à des paléosols comportant desniveaux à racines (faciès 2), représentent des dépôts dedébordement et des chenaux abandonnés. Les paléosolsdes calcaires argileux sont caractérisés par des nodulescarbonatés qui indiquent un profil de pédogenèse à ma-turité moyenne (Wright et Tucker, 1993). Par contre, lesgraviers propres stratifiés et chenalisés (faciès 3), cons-tituent le remplissage de chenaux fluviatiles mineurs(Pasquini et al., 2001).Les calcaires micritiques sombres (4) représentent la finde la sédimentation continentale sensu stricto. Ce facièss’est déposé dans des milieux saumâtres, laguno-estuariens, qui peuvent passer latéralement à des envi-ronnements plus marins ou plus continentaux sur decourtes distances. Les niveaux micritiques témoignentde conditions de faible énergie dans la zone centrale dela lagune (Freytet et Plaziat, 1982). Dans ces niveaux, laprésence de structures laminées, des marnes riches ensilex noir et bitume, suggèrent une cyclicité saisonnière.Par contre, les marnes sableuses bleutées et les grès, quisont caractérisés par une faune abondante mais peu
Fig. 4. Vue en lame mince et sur échantillon scié des faciès décrits. (A) Section d’un galet du conglomérat à Microcodium (faciès 3) ; surface polie montrant quele Microcodium s’est infiltré à l’intérieur d’un galet de calcaire du Crétacé. (B) Lits à silex noir dans les calcaires-marneux (faciès 4). (C) Calcaires micritiquessombres (faciès 4) ; argiles sombres contenant une association riche en Ostracodes. (D) Grès blancs quartzeux (faciès 5) ; les grains quartzeux sont soit arrondiset grands, soit anguleux et petits ; au centre, on peut voir un macroforaminifère remanié (f).Fig. 4. Thin sections and polished samples of the described facies. (A) Pebble section from the Microcodium conglomerate (facies 3); polished surface showingMicrocodium developed inside a Cretaceous pebble. (B) Black chert layers in the marly limestones (facies 4). (C) Dark micritic limestones (facies 4); brownishmarls rich in Ostracodes. (D) White quartz-sandstones (facies 5); quartz grains correspond to two granulometric classes: large rounded and angular small-sized;a reworked macroforaminifer (f) is visible on center.
781D. Varrone, P. Clari / Geobios 36 (2003) 775–786
diversifiée (cérithes et huîtres), suggèrent un environne-ment laguno-estuarien dominé par les apports détriti-ques des rivières mais influencées par la mer (Dalrympleet al., 1992).Les grès blancs quartzeux (5) sont des dépôts infralitto-raux organisés en barres/dunes. Ils sont caractérisés parla présence fréquente d’une lamination oblique mal dé-veloppée et d’interprétation incertaine. L’absence desédiments liés à un environnement tidal suggère que cesbarres formaient des flèches discontinues, parallèles à laligne de côte, qui barraient les baies à l’embouchure defleuves et isolaient des lagunes (Fig. 5). Dans les travauxprécédents, les grès blancs quartzeux ont été considéréscomme les premiers dépôts marins transgressifs et ontété attribués aux Calcaires à Nummulites (Lanteaume,1968 ; Campredon, 1972). Toutefois, l’étude de l’évolu-tion verticale des faciès a mis en évidence que les grèsblancs peuvent être suivis par les calcaires micritiquessombres du faciès 4 (Fig. 3). Donc le faciès 5 està rattacher aux paléo-environnements lagunaires-estuariens.
4.2. Les Calcaires à Nummulites
Cette unité lithologique est composée par des sédimentsmixtes, silicoclastiques et carbonatés, caractérisés par uneassociation biotique de type « heterozoan » (James, 1997).L’épaisseur totale de l’unité varie de 30 à 100 m. Nous avonsdivisé cette unité en trois faciès : (6) les dépôts de base, (7) leFaciès à Nummulites et (8) le Faciès à Orbitoidacea.
• Les dépôts de base (6)Ces dépôts ravinent aussi bien les sédiments continen-taux de l’Eocène que le substratum Crétacé. Le faciès estconstitué par un conglomérat à éléments centimétriques(« lag deposits ») qui peut varier rapidement d’épaisseur
(25-50 cm) ou alors être absent. Les galets sont descalcaires du Campanien-Maastrichtien, du Jurassique etdes roches volcaniques. La matrice gréseuse peut man-quer.
• Le faciès à Nummulites (7)Ce faciès est constitué par des alternances métriques degrès et de calcaires silteux (Fig. 6(a)) dont l’associationfossilifère est dominée par des Nummulites, plates ourenflées, de grandes à moyennes dimensions (diamètrede 0,5 à 2,0 cm). Les sédiments gréseux sont constituésessentiellement de quartz et ont une granulométrie fine àmoyenne. Ils contiennent également de la glauconieremaniée et de nombreux bioclastes, formant parfois desniveaux de biorudite. La division en niveaux est ainsidéfinie par les variations de la concentration en fossiles.La matrice est peu abondante et la bioturbation est trèsintense. Ce faciès admet des intercalations congloméra-tiques et gréseuses à base érosive et un granoclassementdes éléments les plus grossiers. Le passage aux niveauxcalcaires silteux est net et marqué par une augmentationdu pourcentage en matrice et de l’intensité de la biotur-bation. Le faciès à Nummulites peut contenir des ni-veaux marno-silteux comparables, par leur lithologie etleur association faunistique, aux calcaires micritiquessombres (4). Ces faciès contiennent des petites Nummu-lites (surtout formes A, à grand proloculus), des gastéro-podes, des miliolides et quelquefois, des bioclastes dé-placés ou même remaniés, des charophytes et desostracodes.L’épaisseur du faciès à Nummulites est de 50 m environet il reste assez constant entre les coupes levées (Fig. 3).L’étude paléontologique a mis en évidence la présencede serpules, de gastéropodes (Turritella), de bivalves(Ostrea, Teredo, Cardium à valves jointes), de coraux
Fig. 5. Schéma interprétatif des relations spatiales entre les paléo-environnements de dépôt des faciès décrits.Fig. 5. Palaeogeographical reconstruction of the spatial relations of the paleo-environmental units.
782 D. Varrone, P. Clari / Geobios 36 (2003) 775–786
solitaires et de foraminifères benthiques (Nummulites,Assilina et rares Orbitoidacea). Les espèces de Nummu-lites reconnues sont : Nummulites brongniarti, Nummu-lites perforatus, Nummulites striatus. Ces espèces indi-quent les biozones SBZ 17 et SBZ 18 du Bartonien(Serra-Kiel et al., 1998). Le contact avec le faciès àOrbitoidacea (8) se marque nettement dans la morpho-logie en formant une rupture de pente sur les versants.
• Le faciès à Orbitoidacea (8)Ce faciès est constitué par des alternances décimétriquesde calcaires silteux et de marnes (Fig. 6(b)), l’associa-tion fossilifère est dominée par les Orbitoidacea tandisque les Nummulites sont plus rares et plus petites quedans le faciès sous-jacent. Les calcaires silteux sont descalcaires finement détritiques qui contiennent des gasté-ropodes, des échinodermes, des coraux solitaires, desbivalves (Ostrea) et des macroforaminifères (Actinocy-clina, Asterocyclina, Discocyclina, qui sont plus abon-dants que les Nummulites). Les calcaires silteux mon-trent des laminations de tempête et une tendance grano-décroissante. Les niveaux marneux intercalés entre les
calcaires silteux sont très bioturbés et renferment desassociations biotiques peu diversifiées : Globigerinidaeà test épais et Rotaliidae.L’épaisseur du faciès à Orbitoidacea est assez variabled’une coupe à l’autre (50 à 110 mètres).L’absence des grandes Nummulites et la présence duNummulites striatus, et du Nummulites chavannesi (?)conduit à attribuer ce faciès aux biozones SBZ 18 et SBZ19 (?) du Bartonien supérieur-Priabonien inférieur(Serra-Kiel et al., 1998).Les conditions de sédimentation des Calcaires à Num-mulites correspondent à une rampe caractérisée par unefaible pente, un taux de sédimentation relativement fai-ble et une association biotique de type « heterozoan ».L’horizon transgressif (6) est partout associé à desconglomérats à éléments pré-Tertiaires, toutefois le ma-tériel sableux peut dominer.Le faciès à Nummulites (7) comporte une fraction carbo-natée bioclastique associée à des sédiments silicoclasti-ques beaucoup plus fins. Cette organisation litée dessédiments signale un milieu mixte où se produit unmélange entre les organismes vivant in situ et les apportssilicoclastiques (Mount, 1984). Les niveaux gréseux quirenferment beaucoup de serpules, de Turritella, d’Os-trea, de Teredo et de Cardium, sont typiques d’un milieuproximal de rampe interne, situé à une profondeurcomprise entre 0 et 80 mètres. Les grands tests desmacroforaminifères indiquent une énergie élevée deseaux (Hallock et Glenn, 1986). Souvent, les tests desmacroforaminifères sont concentrés et imbriqués enamas lenticulaires centimétriques à décimétriques. Cettedisposition « en nuage » des tests est attribuée à l’actiondes vagues (cf. Aigner, 1985) qui concentrent et rema-nient le matériel fossilifère sur le substrat silicoclastiqueau cours des tempêtes. Les calcaires silteux, intercalésdans les niveaux gréseux, sont caractérisés par une fortebioturbation qui a effacé toutes les structures sédimen-taires. Ces sédiments témoignent d’un environnementpeut être plus profond, caractérisé par une plus faibleagitation des eaux.Le faciès à Orbitoidacea (4c) est encore plus argileux etrenferme un nombre peu élevé de bioclastes. L’associa-tion biotique est constituée par de petites Nummulitesrenflées et par des Discocyclina. Les couches les plusfossilifères sont le résultat du transport de bioclastes dela rampe interne vers les zones distales, lors des tempê-tes (cf. Aigner, 1985). En effet, la présence localisée detests d’Ostrea alignés selon la stratification confirmel’hypothèse d’un flux de matériel provenant de la rampeinterne. Par contre, les niveaux argileux sont riches enforaminifères planctoniques et doivent représenter lasédimentation en conditions « normales ». Le faciès àOrbitoidacea s’est développé à des profondeurs esti-mées entre 80 et 130 mètres (cf. Hottinger, 1983), sur larampe moyenne à externe.
Fig. 6. Vue en lame mince et sur échantillon des faciès à grands foraminifè-res. (A) Faciès à Nummulites (7) ; formes A de Nummulites, la matrice estriche en grains de quartz. (B) Faciès à Orbitoidacea (8) ; diverses Discocy-clina, Actinocyclina sont dispersées dans une matrice silteuse.Fig. 6. Thin sections and hand samples view of the large foraminifera facies.(A) Nummulitic facies (7); A forms of Nummulites, the matrix is a quartz-sandstone. A vertical solution seam cuts the foraminifera tests. (B) Orbitoi-dacea facies (8); Various Discocyclina, Actinocyclina are dispersed in thesiltous matrix.
783D. Varrone, P. Clari / Geobios 36 (2003) 775–786
5. Discussions
Les unités décrites ont été interprétées en termes de mi-lieux de dépôt (Fig. 7) qui résultent principalement de l’évo-lution du bassin de l’avant-pays alpin méridional (Sinc1air,1997). Ces milieux de dépôt enregistrent une tendance géné-rale à l’élévation du niveau marin relatif qui caractérise, plusglobalement, l’Eocène des Alpes Maritimes.
Au cours de l’élaboration d’un modèle de faciès (Fig. 7)nous avons tenu compte de la géométrie des corps sédimen-taires, des caractéristiques lithologiques-paléontologiques etde l’évolution verticale des faciès. Les rapports entre lesfaciès peuvent être expliqués par ces remarques :
• Dans toutes les coupes étudiées, le passage entre lesfaciès 1, 2-3 et 4 est transitionnel sans que des disconti-nuités stratigraphiques importantes puissent être locali-sées. Les différences majeures entre les faciès consistenten des différences de litage et d’association biotique.
• La présence d’un environnement lagunaire (faciès 4)au-dessous et au-dessus des dunes sableuses (faciès 5),l’absence d’enregistrement d’une tendance régressiveimportante du niveau marin relatif, nous suggère lacoexistence des deux faciès.
• Les grès blancs quartzeux (faciès 5) ont livré une pauvreassociation fossilifère à macroforaminifères (Nummuli-tes) d’âge Lutétien supérieur à Bartonien, tandis que lesCalcaires à Nummulites sont datés au Bartonien.
• Les environnements de dépôts des grès blancs quartzeux(faciès 5) et des Calcaires à Nummulites (faciès 6, 7 et 8)sont caractérisés par des faibles taux de sédimentation etpar une haute énergie des eaux qui produisent, surtoutlors des tempêtes, de nombreuses surfaces d’érosion
dans les successions. Toutefois, ces surfaces ne repré-sentent pas forcement d’importantes surfaces stratigra-phiques sur lesquelles on peut baser un découpage sé-quentiel.
En se fondant surtout sur ces remarques, nous avonsélaboré un modèle de faciès (Fig. 5) dans lequel tous lesfaciès peuvent coexister. Donc, la disposition verticale desfaciès résulte de la migration latérale des différentes zones desédimentation, en admettant l’existence de plusieurs pulsa-tions transgressives pouvant avoir développées des surfacesstratigraphiques de significations différentes.
L’évolution verticale des faciès décrits montre, de bas enhaut, un cortège de dépôts transgressifs, témoignant d’uneaugmentation continue de la profondeur de dépôt des sédi-ments lutétiens et priaboniens sans que des cortèges sédi-mentaires régressifs soient observés.
Au stade actuel de l’étude, le découpage séquentiel sebase sur l’interprétation des surfaces stratigraphiques princi-pales (Fig. 7). La première discontinuité est une limite deséquence localisée entre le substrat mésozoïque (Crétacésupérieur) et les premiers dépôts continentaux du Paléogène.Cette surface résulte de l’évolution tectonique du domainealpin, qui conduit au soulèvement, à l’émersion et à l’érosiondes dépôts mésozoïques.
La deuxième surface mise en évidence est une surface deravinement transgressif, sensu Nummedal et Swift (1987),localisée entre la Formation à Microcodium et les Calcaires àNummulites. Cette surface d’érosion résulte de l’action de lahoule lors de la transgression nummulitique. Il s’agit d’unmarqueur à l’échelle régionale. Cette surface est, pour l’ins-tant, mal datée par un manque de marqueurs biostratigraphi-
Fig. 7. Schéma stratigraphique et découpage séquentiel de la succession Eocène.Fig. 7. Stratigraphic sketch and sequential interpretation of the Eocene succession.
784 D. Varrone, P. Clari / Geobios 36 (2003) 775–786
ques précis. Toutefois, elle petit être placée approximative-ment entre le sommet du Lutétien et la partie basale duBartonien.
Entre les deux surfaces stratigraphiques, on observe loca-lement, à la base des grès blancs quartzeux (faciès 5), unesurface d’érosion. De telles surfaces sont interprétées commeliées à la migration latérale des bancs quartzeux d’extensionlocale, elles ne peuvent donc être utilisées pour le découpagestratigraphique (voir remarque 4).
Les variations de la profondeur des dépôts de l’Eocène desAlpes Maritimes sont en contradiction avec les courbes eus-tatiques globales de deuxième et troisième ordre de Haq et al.(1987). Les signaux eustatiques les plus remarquables del’Eocène (par exemple l’abaissement de 180 mètres du ni-veau de la mer au passage entre Bartonien et Priabonien) sontabsents.
6. Conclusions
La description détaillée et l’interprétation des environne-ments de dépôt de l’Eocène du Domaine Dauphinois-Provençal méridional, ont contribué à mettre en évidencedeux unités stratigraphiques (la Formation à Microcodium etles Calcaires à Nummulites) qui ont été divisées en huitfaciès. La géométrie des corps sédimentaires, les caractéris-tiques lithologiques et paléontologiques ont indiqué que cesfaciès peuvent coexister et qu’ils résultent de la migrationlatérale des différentes zones de sédimentation pendant unetransgression contrôlée principalement par la tectonique.
La Formation à Microcodium, qui représente les premierssédiments de l’Eocène du Domaine Dauphinois-Provençal,est constituée par des sédiments de remplissage des paléo-vallées. Les paléo-vallées ont été incisées sur le substratmésozoïque pendant son émersion (Crétacé supérieur-débutdu Paléogène). La sédimentation, au cours de l’Eocènemoyen-supérieur, débute avec des dépôts fluviatiles-estuariens (les brèches à Microcodium 1, les calcaires argi-leux à débris de Microcodium 2 et les conglomérats à Micro-codium 3). Des flèches sableuses (les grès blancs quartzeux,5) ont barré les baies à l’embouchure des rivières et isolé unelagune-estuaire où s’est localisée une sédimentation saumâ-tre (les calcaires micritiques sombres 4).
Les grès blancs quartzeux des secteurs étudiés sont ratta-chés aux premiers dépôts marins transgressifs des Calcaires àNummulites (Lanteaume, 1969 ; Campredon, 1972). Toute-fois, cette étude à mis en évidence que ce faciès a été déposéen bordure d’un système estuarien à la fois raviné par lapartie basale des Calcaires à Nummulites. Donc le passage àune sédimentation marine généralisée se situe seulement aucours de la sédimentation des Calcaires à Nummulites.
Les Calcaires à Nummulites, par contre, sont attribués àun environnement de rampe interne-moyenne dominée parles vagues et ils sont caractérisés par un taux de sédimenta-tion très bas. L’action des vagues induit le mélange desfractions bioclastiques et silicoclastiques dans les secteursplus internes de la rampe, tandis que sur la rampe moyenne-
externe, l’influence des tempêtes contrôle les apports dematériel d’origine moins profonde, déplacé depuis les sec-teurs plus internes. Ce système de rampe mixtesilicoclastique-carbonatée évolue jusqu’à l’établissementd’un milieu hémipélagique (Marnes à Globigerina) à la finde l’Eocène.
Les faciès décrits enregistrent, tout au long de l’Eocène,une tendance à l’approfondissement du milieu de dépôt de-puis un environnement continental jusqu’à un milieu hemi-pélagique.
Le découpage séquentiel privilégie deux surfaces strati-graphiques principales : une limite de séquence, qui corres-pond à une surface d’émersion et d’érosion localisée entre lesubstrat mésozoïque et les premiers sédiments de l’Eocène ;une surface d’érosion transgressive localisée à la base desCalcaires à Nummulites. Les deux surfaces individualisentdeux cortèges de dépôts transgressifs sans régression inter-posée.
La comparaison entre les courbes eustatiques dedeuxième et troisième ordre de Haq et al. (1987) et lesvariations de la profondeur de dépôts des sédiments décritssuggèrent un contrôle local et/ou régional plutôt que globalde la sédimentation de l’Eocène des Alpes Maritimes.
Remerciements
Nous remercions chaleureusement G. Ghibaudo pour lesdiscussions de grande valeur sur les données de terrain quiont été extrêmement appréciées. Nous remercions E. Bicchi,pour son appui constant et sa grande générosité.
Nous remercions vivement les rapporteurs J-C. Plaziat etB. Pittet qui avec leurs suggestions nombreuses et détailléesont permis d’améliorer la forme et le fond de cet article.
Références
Aigner, T., 1985. Biofabrics as dynamic indicators in nummulite accumula-tion. Journal of Sedimentary Petrology 55, 131–134.
Alonso-Zarza, A.M., Sanz, M.E., Calvo, J.P., Estevez, P., 1997. Sequencestratigraphy and facies model of an incised valley fill: the Girondeestuary, France. Journal of Sedimentary Petrology 63 (3), 378–391.
Blondeau, A., Bodelle, J., Campredon, R., Lanteaume, M., Neuman, M.,1968. Répartition stratigraphique des grands foraminifères de 1’Eocènedans les Alpes Maritimes (franco-italiennes) et des Basses Alpes. Extraitdu Mémoire du Bureau de Recherches Géologiques et Minières, 58,1–26.
Bodelle, M.J., 1968. Un nouveau gisement de « Formation à Microcodium »et de « Couches à Cheritium diaboli » à Cuébris (Alpes-Maritimes).Considérations sur l’âge des « Couches à Cheritium diaboli ». ComptesRendus de l’Académie des Sciences, Paris, 266, 2372–2375.
Bodelle, J., Campredon, R., 1974. Les formations à Microcodium dans lesAlpes-Maritimes Franco-Italiennes et Basses Alpes, leur importancepaléogéographique. « Colloque sur l’Eocène ». Mémoires du Bureau deRecherches Géologiques et Minières, 61, 453–471.
Boussac, J., 1911. Études paléontologiques sur le Nummulitique alpin.Mémoire de la Carte géologique de France, Paris, 1.
Campredon, R., 1972. Les formations paléogènes des Alpes-Maritimesfranco-italiennes. Thèse de l’Université de Nice.
785D. Varrone, P. Clari / Geobios 36 (2003) 775–786
Cavelier, C., 1984. Paléogène. In: Debrand-Passard, S., et al. (Eds.), Syn-thèse géologique du Sud-Est de la France. Mémoires du Bureau deRecherches Géologiques et Minières, pp. 1–125.
Crampton, S.L., Allen, P.A., 1995. Recognition of Forebulge Unconformi-ties Associated with Early Stage Foreland Basin Development: Examplefrom the North Alpine Foreland Basin. Bulletin of American Associationof Petroleum Geologists 79 (10), 1495–1514.
Dalrymple, R.W., Zaitlin, B.A., Boyd, R., 1992. Estuarine facies models:Conceptual basis and stratigraphic implications. Journal of SedimentaryPetrology 62, 1130–1146.
Faure-Mauret, A., FaI1ot, P., 1954. Sur le Secondaire et le Tertiaire auxabords sud-orientaux du massif de l’Argentera-Mercantour. Bulletin duService de la Carte géologique de France 241, 189–198.
Ford, M., Lickorish, W.H., Kusznir, N.J., 1999. Tertiary foreland sedimen-tation in the Southern Subalpine Chains, SE France: a geodynamicappraisal. Basin Research 11, 315–336.
Freytet, P., Plaziat, J.-C., 1982. Continental carbonate sedimentation andpedogenesis-Late Cretaceous and Early Tertiary of Southern France.Contribution to Sedimentology, 12. Schweizerbart’sche Verlagsbuch-handlung, Stuttgart.
Gelci, R., 2001. Stratigrafia dei depositi terziari della bassa Valle Roya eValle Nervia. These Università degli Studi di Torino (inédit).
Gupta, S., 1997. Tectonic control on paleovalley incision at the distal marginof the early tertiary alpine foreland basin, southeastern France. Journal ofSedimentary Research 67 (6), 1030–1043.
Hallock, P., Glenn, E.C., 1986. Larger Foraminifera: a tool for paleoenviron-mental analysis of Cenozoic carbonate depositional facies. Palaios 5,55–64.
Haq, B.U., Hardenbol, J., Vail, P.R., 1987. Chronology of fluctuating sealevels since the Triassic. Science 235, 1156–1167.
Homewood, P.W., Mauriaud, P., Lafont, F., 1999. Best practices in SequenceStratigraphy for reservoir engineers. Bulletin Centre Research ElfExploration Production, Mémoire 25, 1–81.
Hottinger, L., 1983. Processes determining the distribution of larger fora-minifera in space and time. Utrecht Micropaleontological Bulletin 30,239–253.
Klappa, C.F., 1978. Biolithogenesis of Microcodium: an elucidation. Sedi-mentology 25, 489–522.
James, N.P., 1997. The cool-water carbonate depositional realm. In: James,Noel, P. (Eds.), Cool-Water Carbonates. Kingston, Ontario, Canada, p.1–20.
Irace, A., 2001. Rilevamento geologico dell’alta Valle Nervia e analisistratigrafica dei Calcari a Nummuliti. Thèse Università degli Studi diTorino (inédit).
Lanteaume, M., 1968. Contribution à l’étude géologique des Alpes Mari-times franco-italiennes. Imprimerie nationale, Paris.
Lanteaume, M., 1990. Notice explicative de la Carte Géologique de France(1:50 000) feuille Viève-Tende 948. Bureau de Recherches Géologiqueset Minières, Orléans.
Lapio, R., 1998. Stratigrafia dei depositi terziari della bassa Valle Roya.Thèse Università degli Studi di Torino (inédit).
Lucas, G.M., 1967. Observations sur les structures internes et le développe-ment des Microcodium. Bulletin de la Société Géologique de France 7,909–918.
Miall, A.D., 1995. Description and interpretation of fluvial deposits: acritical perspective: discussion. Sedimentology 42, 379–384.
Mount, J.F., 1984. Mixing of siliciclastic and carbonate sediments in shallowshelf environments. Geology 12, 432–435.
Nummedal, D., Swift, D.J.P., 1987. Transgressive stratigraphy at sequence-bounding unconformities: some principles derived from Holocene andCretaceous examples. The Society of Economic Paleontologists andMineralogists, Special Publication, 41, 241–260.
Pasquini, C., Lualdi, A., Vercesi, P.L., 2001. Analisi di un sistema deposiz-ionale costiero eocenico nei dintorni di Ventimiglia (Alpi Marittimeitalo-francesi). Atti ticinesi di Scienze della Terra 42, 23–36.
Sanchez Palomo, E., 2001. Rilevamento geologico dell’alta Valle Nervia eanalisi stratigrafica della “Formazione a Microcodium” Thèse Universitàdegli Studi di Torino (inédit).
Serra-Kiel, J., Hottinger, L., Caus, E., Drobne, K., Ferrandez, C., Jau-hri, A.K., Less, G., Pavlovec, R., Pignatti, J., Samso, J.M., Schaub, H.,Sirel, E., Strougo, A., Tambareau, Y., Tosquella, J., Zakrevskaya, E.,1998. Larger foraminiferal biostratigraphy on the Tethyan Paleocene andEocene. Bulletin de la Société Géologique de France 169 (2), 281–299.
Sinclair, H.D., 1997. Tectonostratigraphic model for underfilled peripheralforeland basins: An Alpine perspective. Bulletin Geological Society ofAmerica 109 (3), 324–344.
Sturani, C., 1969. Impronte da disseccamento e “torbiditi” nel Luteziano infacies lagunare (“strati a Cerithium diaboli” auct.) delle Basse Valli Royae Bévera. Bollettino della Società Geologica Italiana 88, 363–379.
Vanossi, M., 1990. Alpi liguri. Guide Geologiche Regionali. BE-MA edi-trice.
Varrone, D., 1998. Stratigrafia, facies e paleogeografia dei Calcari a Num-muliti (Eoc. Medio – sup.): alte valli Roya e Argentina. Thèse Universitàdegli Studi di Torino (inédit).
Wright, V.P., Tucker, M.E., 1993. The sequence stratigraphy of fluvialdepositional systems: the role of floddplain sediment storage. Sedimen-tary Geology 86, 203–210.
786 D. Varrone, P. Clari / Geobios 36 (2003) 775–786