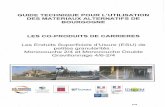Dossier de Licence : "La Science au prisme de la Magie. Petites réflexions sur un regard...
Transcript of Dossier de Licence : "La Science au prisme de la Magie. Petites réflexions sur un regard...
0
Marie Véronique Amella ETHQ 01
Petites réflexions sur un regard hégémonique
Enseignant-correcteur : M. Bruno Martinelli Année universitaire 2013-2014
Science
La
au prisme de la magie
1
Sommaire
Présentation ........................................................................................................... p.2
La magie, un objet frontière ? .............................................................. p.3
I°) Généalogie d’un regard anthropologique ...................................................... p.4
1°) Évolutionnisme(s) ...................................................................................... p.4
2°) « Jeux sociaux » en interaction ................................................................. p.6
II°) Une relation dissymétrique ............................................................................ p.7 Fausses polémiques, vrais préjugés .................................................... p.7
1°) Objet-passerelle : le lointain rendu proche ................................................ p.8
2°) Objet-fracture : le proche rendu lointain ................................................... p.9
III°) Une ordalie scientifique : l’efficacité et la preuve ..................................... p.11 1°) Colonialismes latents .............................................................................. p.11
2°) Efficacité(s) ............................................................................................. p.12
Idéation théorique contre technique ................................................... p.13
Conclusion ........................................................................................................... p.14 Ce que la magie révèle de la science occidentale ...................................... p.14
Vers une coopération des savoirs ? ............................................................ p.16
Bibliographie ........................................................................................................ p.17 1i
1 Crédit photo couverture : http://fr.123rf.com/photo_3357327_fun-caractere-illustration-d-39-une-sorciere-halloween-avec-l-39-arriere-plan.html + Travail photo MVA ® Photoshop.
2
Présentation
On recouvre généralement du terme "magie" un phénomène mondial décliné en
expressions particulières regroupant tout ce que la science ou le sens commun ne s'expliquent
pas toujours, mais qui pourtant persiste à durer dans le temps et malgré les frontières, aux
dépens des « progrès », des différences entre sociétés ou des classes sociales. Par rapport à
la forme courte de ce dossier, nous prendrons une définition large de la magie -qui aurait mérité
par ailleurs de longs développements et une plus grande différenciation entre ses
manifestations-. Dans ce terme, nous trouverons donc la pensée dite « magique » de tout pays
-passée et présente- élaborant des rituels, individuels ou collectifs, d’initiation, de maléfice ou
de guérison. Le dénominateur commun à des expressions vernaculaires si différentes que la
possession, la transe chamanique, le jet de sorts ou la divination est le recours à une efficacité
invisible pour résoudre un problème matériel souvent vérifiable (maladie, sécheresse, mort).
Ces phénomènes opèrent tous dans des cadres sociaux bien délimités, dont leurs membres en
relation partagent en général la même langue, des symboles, une mythologie et des statuts
divers. Cependant, la magie, avant d’être un objet homogène plus ou moins circonscrit par la
science, possède en amont un statut paradoxal, souvent hétérogène dans les sociétés qui la
pratiquent. S’appuyant à la fois sur les mythes sociaux et sur la transgression de ces mythes,
son rapport à la société apparaît comme ambigü. La magie se trouve bien au confluent d’une
continuité socio-culturelle particulière, et en état de rupture permanente par rapport à celle-ci.
La relative homogénéité de la magie telle que la décrit l’anthropologie pose d’emblée le
problème de la pluralité des sens en amont d’une définition à la fois trop précise et trop floue.
Derrière la nécessité de rendre nos descriptions cohérentes, la magie est-elle vraiment celle
que nous pensons comprendre ?
Au titre de cette étonnante diffusion, de cette persistance singulière et de sa relative
ressemblance avec la religion ou la science, le phénomène magique intéresse les
anthropologues depuis le XIXè s., tout comme les explorateurs de nouveaux mondes bien
avant eux. Notre objectif n’est pas d’apporter des réponses aux questions anciennes sur le
bien-fondé de la magie, mais bien de proposer, à partir de la magie comme objet partagé et
diviseur, une réflexion épistémologique sur notre propre regard anthropologique, scientifique et
occidental, depuis sa formation au titre de science jusqu’à nos jours. Ce regard, souvent
univoque, cristallise le sorcier et ses productions dans une image familière à l’Europe depuis les
grandes explorations du passé, celle du Sauvage. Cette constante du regard traverse les
3
Écoles et les courants anthropologiques comme un non-dit, et elle constitue bien souvent
l’étiquette préformée sur laquelle nous nous appuyons pour désigner le praticien magique dans
toute son altérité. De la rencontre entre l’Autre étrange et cette étrange magie naît un étrange
rapport, celui de l’anthropologue et de son informateur à travers l’objet magique.
En outre, dans quelle mesure la littérature anthropologique -ce discours produit par un
individu sur les représentations de l’Autre-, renouvelle aujourd’hui encore à travers une certaine
idée de la magie, ce regard subjectif hérité de sa propre Einstellung culturelle ? Comment, au
final, notre interprétation scientifique peut-elle fabriquer de l’inégalité entre savoirs tout en se
donnant pour objectif une compréhension holiste des phénomènes ?
La magie, un objet frontière ?
L’objet frontière, tel que l’ont défini Susan Leigh-Star et James Griesemer dans leur
article fondateur « Ecologie institutionnelle » révèle une tension interne à la science dans son
ensemble. Objet matériel ou immatériel, l’objet frontière permet le parallèle entre une
problématique de la science fondamentale - conceptualiser un objet cohérent à partir
d’éléments bruts - et la configuration de travail d’un chercheur, amené à collaborer avec des
partenaires de différents statuts et origines sociales sur le terrain. La préoccupation de la
science et du chercheur concerne donc le mode de réification d’un objet formé à l’origine par
des éléments hétérogènes : « Le fait que les objets ont comme origine des mondes différents et
qu’ils continuent à y habiter reflète la tension fondamentale à l’œuvre dans la science :
comment des découvertes qui regroupent des significations radicalement différentes peuvent-
elles devenir cohérentes ? (Leigh-Star & Griesemer : 2008, 8) ».
Par transposition, l’objet-magie, tel qu’il est étudié par l’anthropologie et pratiqué par ses
usagers, présente des caractéristiques d’un objet frontière, dans la mesure où il se révèle, se
redéfinit et s’interprète dans la rencontre ethnographique, jonction entre deux systèmes de
valeurs, deux visions du monde a priori différents. L’objet-magie devient alors à la fois une
passerelle et une fracture entre observateurs et acteurs. Au final, c’est le rendu ethnographique
etic qui cristallise une idée cohérente de la magie, préférée à des versions emic existantes
principalement en raison du caractère généralisable de la « parole » scientifique : « Ainsi, il
existe dans l’activité scientifique une “opposition centrale “ entre la divergence des points de
vue et la nécessité d’effectuer des découvertes susceptibles d’être généralisées (Leigh-Star &
Griesemer : 2008, 2) ». La phase de mise en texte du discours indigène est donc
4
incontournable si l’on envisage une ethnographie comme la base matérielle permettant une
mutualisation de données à travers un langage universel à la base de comparaisons
scientifiques à venir. A l’instar des analyses de Geertz, une telle reformulation ne peut pas
constituer une traduction directe de la magie. Le texte transforme d’une certaine façon l’objet
décrit au prisme des influences de son auteur. La science, tout comme le background culturel
de l’ethnologue ou le discours non neutre des informateurs constituent à ce titre, autant de
bases idéologiques colorant l’objet de leurs valeurs respectives.
Par conséquent, le concept d’objet frontière permet d’aborder de façon assez claire les
catégorisations à l’œuvre dans une collaboration entre domaines et systèmes de pensée, et
particulièrement lorsque les partenaires s’entendent sur l’importance de l’objet signifiant mais
pas toujours sur le sens de l’objet signifié. Si l’étude de la magie est ce lieu d’affrontement
priviliégié entre savoirs anthropologiques et savoirs locaux, elle met particulièrement en scène
le jeu dynamique des représentations de l’Occident au travers duquel l’objet magique devient
une frontière indépassable entre Eux et Nous.
I°) GÉNÉALOGIE D’UN REGARD ANTHROPOLOGIQUE
Dans la réflexion de Marcel Mauss au tout début du XXè s., la question de la magie
renvoie à une problématique sociale plus générale, où le sacré des choses découle de leur
position sociale hiérarchique, laquelle accouche d’une identité et d’une légitimité singulières.
Les « préjugés » partagés par un groupe détermineraient alors toute la spécificité de cette
position : « [...] La valeur magique des choses résulte de la position relative qu'elles occupent
dans la société ou par rapport à celle-ci. Les deux notions de vertu magique et de position
sociale coïncident dans la mesure où c'est l'une qui fait l’autre. Il s'agit toujours au fond, en
magie, de valeurs respectives reconnues par la société. Ces valeurs ne tiennent pas, en réalité,
aux qualités intrinsèques des choses et des personnes, mais à la place et au rang qui leur sont
attribués par l'opinion publique souveraine, par ses préjugés. Elles sont sociales et non pas
expérimentales » (Mauss : 1902, 76). Nous apprenons aussi que le savoir du scientifique, sous-
entendu derrière les qualités « expérimentales » dont parle Mauss, se fonde quelque part en
dehors ou au-dessus des valeurs du mage. Cette position spéciale d’une science neutre et
positive va pouvoir bénéficier au crédit de l’ethnologue sur son terrain, qui, porteur de sa propre
subjectivité, n’en demeure pas moins juge et partie dans son analyse.
Remplaçons les termes « magique » et « magie » par « scientifique » et « science »,
toutefois sans retirer le mot « préjugé », et nous obtenons par un reversement de perspective
5
assez amusant, une métaphore sur les présupposés scientifiques d’origine évolutionniste
susceptibles de nous masquer la réalité contextuelle de notre objet frontière...
1°) Evolutionnisme(s)
Le regard occidental de l’anthropologie naissante de la fin du XIXè siècle s’est en effet
construit autour d’un postulat évolutionniste ambigü : oscillant entre une universalité du destin
de l’Homme et un différentialisme isolant chaque société, les « retards » technologiques furent
mesurés à l’aune de l’Europe industrielle. Autour de cette mise en œuvre ethnocentrée d’un
progrès prosélyte à travers une colonisation bienfaitrice, s’est alors développé un schéma
scientifique dissymétrique, essentialisant en quelque sorte la frontière entre les savoirs
scientifiques occidentaux et des savoirs autres, collectés par l’anthropologie : « Le premier
dispositif théorique a été celui de l’évolutionnisme victorien, avec sa fameuse ligne d’évolution
par laquelle doivent passer nécessairement toutes les sociétés : magie, religion, science. Cette
hypothèse a été rendue célèbre par James George Frazer, mais elle a d’abord été proposée
par Tylor sous l’influence du darwinisme et de la géologie de Lyell. Cette loi d’évolution se
donne comme une sorte de dialectique : la magie est une forme de science, puisqu’elle tente
d’agir sur la nature, mais c’est une fausse science, car elle ne propose que des explications
partielles, et il faut en passer par la généralisation produite par la religion pour parvenir à une
véritable science (Keck : 2002, § 4) ». Ainsi, pour Frazer, la magie serait totalement dépourvue
d’un arrière-plan théorique ; pour le magicien le résultat compterait plus que la logique
conduisant sa démarche. Par cet aspect, ce dernier s’éloigne de la science occidentale.
Toutefois, par le cheminement implicite de son mode d’agir, il se rapproche également de « la
plupart des hommes ». Dans une phrase décrivant le magicien tirée du Rameau d’Or, l’auteur
semble alors condenser toute l’ambiguïté du regard évolutionniste à la base de l’anthropologie
contemporaine : « Il ne se préoccupe pas d'analyser l'opération mentale sur laquelle sa pratique
se fonde ; il ne s'inquiète aucunement des principes abstraits qui le font agir ; chez lui, comme
chez la plupart des hommes, la logique est implicite et non pas explicite : il fait son
raisonnement de même qu’il fait la digestion de ses aliments, dans l’ignorance absolue des
procédés tant intellectuels que physiologiques, essentiels à l’une et à l’autre opération »
(Frazer : 1981, 41).
Cependant, si ce regard occidental révèle les tares du praticien magique, il dévoile aussi,
par la même occasion un aspect de ses propres références d’origine. Pour Frazer, la science
comme rationnelle, expérimentale et abstraite semble une alternative absolue à l’ignorance.
6
Cette logique binaire se construit à partir d’un couple d’oppositions constitué des valeurs
scientifiques occidentales d’une part, et d’anti-valeurs archaïques de moindre rationalité
incarnées par le mage d’autre part.
Le problème est posé... l’Autre magique est pensé comme « inférieur » au Nous
scientifique du moment où ce Nous identifie des tares de lenteur, d’incohérence, de croyance
chez l’autre, ce qui justifie d’une manière tautologique une différence dans le traitement des
savoirs issu de cette réflexion : « À partir du moment où l’on aura “démontré“ qu’un chaman est
fou, il ne pourra plus bénéficier de la crédibilité (occidentale) concernant son rôle et sa fonction.
Et le pas est vite franchi pour porter le discrédit sur la possession ou le chamanisme dans leur
ensemble. Il s’agit là d’une position extrême [...] mais, comme elle est le plus souvent refoulée,
non consciente, elle n’en est que plus pernicieuse, agissant en sourdine et colorant, comme par
mégarde, les théories les plus “scientifiques“ » (Monfouga-Broustra : 2001, 171-176).
2°) « Jeux sociaux » en interaction
Dans son travail sur le terrain, l’ethnologue est idéalement amené à connaître
l’importance et la validité du « jeu social » de l’autre dans le contexte indigène et certaines
situations focales. Dans le cadre de la magie, il s’agit pour lui de rendre compte le plus
fidèlement possible de la densité identitaire comprise dans le symbole et la pratique rituels. Or,
le scientifique est également issu d’un « moule identitaire » dans lequel se reconnaissent des
pairs. Il est lui même « pris » dans un « jeu social » aux symboles partagés, une sorte de
lignage professionnel rendu légitime par des connaissances universitaires institutionnalisées à
la manière d’un consensus « légal-rationnel » cher à Max Weber et à Bourdieu. Ce dernier
explique d’ailleurs par quel processus des situations, des attitudes générées au sein d’un
groupe solidaire paraissent aller de soi à ses membres : « L’illusio n’est rien d’autre “que ce
rapport enchanté à un jeu qui est le produit d’un rapport de complicité ontologique entre les
structures mentales et les structures objectives de l’espace social“, c’est-à-dire entre un
ensemble de schèmes mentaux (habitus) et des régularités caractéristiques d’un espace social
autonome (champ) qui conduit ceux qui possèdent la maîtrise pratique de cet univers à
anticiper de façon correcte les évolutions du jeu. Pour celui qui possède les catégories
mentales (un “ensemble de principes de vision et de division“) adaptées à un champ donné,
tous les événements qui s’y produisent paraissent “naturels“ ou “évidents“ » (Costey : 2005, §
2). L’analyse du terrain est d’autant plus délicate qu’il s’agit alors d’objectiver deux « jeux
profonds » se confondant à des savoirs en interaction ; ces « jeux » qui, selon l’idée de Geertz,
7
donnent, derrière la relative fantaisie des formes, des objets manipulés ou des comportements,
une idée des représentations d’un groupe sur lui-même.
Ainsi que l’énonce Victor Turner, une meilleure reconnaissance scientifique des savoirs
d’autrui passe par une appréhension des émotions et des « croyances » encadrant le rituel en
Afrique : « I think, becoming widely recognized that religious beliefs and practices are
something more than “grotesque“ reflections of expressions of economic, political, and social
relationships ; rather are they coming to be seen as decisive keys to the understanding of how
people think and feel about those relationships, and about the natural and social environments
in which they operate2 (Turner : 1969, 6) ». Pour que le « jeu social » de l’anthropologue et celui
des informateurs ne se termine pas en « jeu de dupes » où chaque interlocuteur colle une
étiquette sur l’autre tout en prétendant l’expliquer, ce moment de la rencontre ethnographique
peut être prétexte à un travail d’identification et de reconnaissance préalables des « cadres
émotionnels » respectifs dont parle Turner.
II°) UNE RELATION DISSYMÉTRIQUE
Fausses polémiques, vrais préjugés
Cependant, en négligeant souvent l’impact de son propre « jeu social » dans la rencontre
ethnographique, l’anthropologie dissimule derrière un argument d’autorité une grande partie de
sa propre histoire disciplinaire. Or, cette histoire s’est construite dans un rapport dissymétrique
entre sociétés sous l’empire des Colonies depuis le XVè s. : « Or il ne s’est pas seulement agi
d’une exploitation économique et commerciale : l’Europe a également porté un regard sur les
peuples qu’elle a colonisés, elle les a représentés, voire exhibés ; elle a parlé en leur nom, s’est
prononcée sur leur statut, et ce faisant elle a souvent trahi l’universalisme religieux, juridique
qu’elle proclamait, proposait, ou prétendait incarner et diffuser (Mangeon : 2006, §1) ». La
magie constitue peut-être de manière emblématique une ligne de traverse entre les époques
coloniale et post-coloniale, une passerelle pernicieuse qui aura en quelque sorte permis à la
figure du Sauvage de survivre à une évolution occidentale des mœurs décolonisées,
notamment à travers l’écrit anthropologique jusqu’à nos jours.
2 « Je pense, et c’est un fait largement admis, que les croyances religieuses et les pratiques sont quelque chose de plus que des expressions “grotesques“ de relations économiques, politiques, et sociales ; bien plus que cela, ces croyances devraient être envisagées comme des clés essentielles dans la compréhension des pensées et des émotions encadrant ces relations, en même temps que sur le contexte naturel et social dans lesquelles ces dernières évoluent » (Traduction par nos soins).
8
L’exemple récent de la controverse entre Mashall Sahlins et Gananath Obéyésékéré
dans les années 80 illustre à quel point l’interprétation de la mort du Capitaine Cook en 1779 à
Hawaï contient un cadre idéologique plus profond, tenace, celui du doute sur la « rationalité des
Sauvages ». Lors de son périple en Océanie, Cook aurait été confondu par les Hawaïens avec
le dieu Lono, entraînant par son sacrifice rituel, un meurtre bien réel. A cette thèse de Sahlins
s’oppose alors celle de l’anthropologue sri-lankais Obéyésékéré, brandissant sa qualité de
native contre celle de l’impérialisme représenté par Sahlins : « Obeyesekere s'en prenait à
“l'idée grotesque“ d'une mentalité “enfantine ou prélogique des indigènes“ que Lévy-Bruhl et
Freud avaient “reçue en héritage“ de l'idéologie européenne » (Zimmermann : 1998, 8).
Cependant, que ce soit pour Sahlins, Obéyésékéré ou Thomas -tous anthropologues-, la
science et son background occidental demeurent la référence absolue discourant sur un objet
frontière magique privé de voix. Nous le voyons notamment au niveau de l’argumentaire
employé dans cet exemple tiré d’une seconde polémique, opposant cette fois Sahlins à
Nicholas Thomas :
« Sahlins, dont la thèse consacrée à une île des Fiji en 1962, Moala : Culture and
Nature on a Fijian Island, est directement mise en cause, s'enflamme et démolit les conclusions de Thomas dans l'un de ces articles [...], où il pointe une erreur (sur Hocart) et un oubli (sur Malinowski). Thomas [...] affirmait que la coutume du kerekere naissait à peine “du temps d'Hocart“. Sahlins [...] rappelle au contraire la description très détaillée qu'en fait Hocart dans ses Lau Islands, Fiji, et reprend à Malinowski dans ses Argonauts la traduction du nom de cette coutume si fondamentalement liée à la théorie anthropologique classique du don par “sollicitation“. L'affaire est entendue ! Hocart, Malinowski et Moala... En deux références et un résumé ciblé de son ethnographie de première main, l'essentiel est dit et le kerekere retrouve toute sa place dans la vulgate ethnologique sur le don. Mais au coeur des analyses de Thomas et de ses deux controverses successives avec Sahlins, il y a le problème de l'objectivation d'un fait de culture » (Zimmermann : 1998, 14).
1°) Objet-passerelle : le lointain rendu proche
Le magicien des sociétés dites « exotiques », tout comme le sorcier du bocage normand
est l’héritier d’une certaine vision du monde, établie sur une analogie dialogique entre les
règnes minéraux, végétaux, animaux et humains. Il maîtrise, catalyse et institue un collectif en
sa personne tout en restant paradoxalement à la lisière du corps social. Cet être spécial et
nécessaire représente, actualise et garantit dans son « jeu social » la reproduction du groupe
par un comportement normé, rituel, en même temps que son propre équilibre psychique, moral,
physique, alors remis en cause lors des transes, des possessions, de sorties hors du corps.
Cette ambiguïté du sorcier entre marge d’initiative personnelle et normes collectives rendrait
pensable et possible la coexistence dangereuse de deux dimensions de réalité superposées ;
un temps mythique, invisible et imprévisible d’une part, et un ordre tangible, quotidien, de
9
l’autre: « Au centre du monde culturel magique, il y a le magicien, vivante synthèse d’initiative et
de tradition : le magicien qui s’ouvre au drame existentiel caractéristique du magisme et qui
remporte sur le risque une victoire pleine de sens, non seulement pour lui-même, mais pour les
autres » (De Martino : 1967, 113) ».
Le magicien, tout comme le scientifique, explore donc des champs liminaires risqués,
aux prises avec une réalité multiforme. Il lutte pour faire exister son monde culturel face à ces
données mouvantes, indéterminées ou invisibles : « [...] l’intérêt dominant du monde magique
n’est pas de réaliser des formes particulières de la vie spirituelle, mais de conquérir et de
consolider l’être au monde élémentaire, ou présence, de la personne. Nous savons maintenant
qu’idéologie, praxis, institutions du monde magique ne révèlent leur vraie signification que si on
les reconduit à l’expression d’un seul problème : défendre, maîtriser, régler l’être au monde
menacé (et corrélativement, fonder et maintenir l’ordre du monde, menacé lui aussi de
dissolution (De Martino : 1967, 189) ». Dans sa description du mage, l’auteur introduit la
possibilité qu’il existe une théorisation de la magie derrière la pratique, ainsi que des institutions
servant de cadre légal à cet exercice. D’autre part, si De Martino admet au mage une qualité
d’efficacité pleine de sens et d’utilité, il décrit le monde magique comme « idéologies, praxis,
institutions ». Dans cette perspective rapprochante, magie et science se trouvent donc
légitimées chacune dans son contexte, mais toujours, cependant selon un vocabulaire
occidentalisant le contexte magique.
Plus que les différences mises en exergue par Mauss, dans l’analyse de cet auteur, nous
entrevoyons une proximité certaine entre science et magie, lesquelles reconnaissent l’une et
l’autre des lois physiques ou spirituelles qui restent à maîtriser.
2°) Objet-fracture : le proche rendu lointain
Si la magie est porteuse d’un exotisme latent pour l’Occidental lambda comme pour le
scientifique à l’évolutionnisme attardé, cet implicite se traduit dans les textes bien souvent
comme une opposition simple entre un ici et un ailleurs géographiques contenant la proposition
éculée « Nous les civilisés et Eux les archaïques ». Contrairement aux rapprochements opérés
plus haut par De Martino, la plupart du temps, cette distance hiérarchisant entre savoirs se
mesure plutôt à l’aune des kilomètres parcourus hors d’Occident et à partir de celui-ci. Or,
d’après les travaux contemporains de Jeanne Favret-Saada sur le bocage normand ou de Clara
Gallini en Sardaigne, le sujet magique persiste de façon obstinée (et honteuse ?) au cœur de
l’Europe. La reproduction d’un dualiste « Eux et Nous » lié aux pratiques magiques ne serait
10
donc pas lié uniquement à une séparation kilométrique. La « tare d’exotisme » est aussi affaire
de voisinage immédiat ; elle vient s’interposer dans ce dualisme facile comme une pensée
d’achoppement : « Dans tous les cas, il s’agit toujours d’une création à deux devant un public,
singulier jeu de cache-cache, fait de résistances de mensonges, d’esquives, de caprices de
prima-donna, de concessions à l’égard de qui est finalement considéré comme le plus fort, et
c’est dans cette dynamique que le possédé arrive à exprimer et donc à exorciser son propre
fantasme. (Gallini : 1998, 55) ». Ici, la transe de possession a bien lieu en Sardaigne, en plein
milieu de la Méditerranée, et au XXè s.. Le soupçon de supercherie magique transparaît dans
le terme de « fantasme ». Pour l’observatrice en effet, l’affection du patient « pris » dans la crise
ne peut être qu’illusion psychologique, et certainement pas une souffrance réelle. Du moins,
cette dernière en est réduite dans le discours ethnologique à sa plus fausse expression.
Une idée d’archaïsme ridicule posée par un regard évolué sur les Primitifs de tout bord est
également lisible dans ce commentaire de Favret-Saada : « Ce canton de la primitivité, du
surnaturel et de l’anachronisme où les idéologues urbains parquent ainsi les paysans du
Bocage est aussi -et principalement- celui de la crédulité. Dans cette région hantée par les
“loups-garous en campagne“, les habitants sont représentés comme des gobe-mouches ou des
enfants naïfs dont “il est possible d’exploiter sans risque la crédulité » (Favret-Saada : 2009,
68). Derrière une explication rationnelle se cache souvent un pendant accusatoire, la négation,
un mépris de classe qui « éloigne » le praticien de la magie aux confins de l’humanité. Derrière
cette dénonciation du magisme, c’est tout le savoir de l’autre, essentialisé sous les termes
opaques de « naïveté », de « croyance » qui est attaqué au nom d’une forme supérieure,
implicite de savoir citadin, rationnel, athée. Le savoir des villes sur celui des campagnes, celui
de l’Europe sur celui de l’Afrique, celui de l’énonciateur sur celui qui n’énonce pas : « Nous
voudrions prendre le problème sous un autre angle : avancer que les chamans-possédés
pourraient bien avoir leur propre métapsychologie à écouter et à décoder. A décoder, parce que
si les psychanalystes occidentaux écrivent (beaucoup !), les chamans-possédés ne le font pas
[...]. D’une métaphysique l’autre : il ne s’agit pas là de tomber dans un comparatisme abusif ni
dans une théorisation universaliste. Il s’agit simplement d’écouter (Monfouga-Broustra : 2001,
174) ». A la parole de l’autre, toutefois, est souvent substituée une idée de superstition.
Comme le souligne justement l’historien italien Tomasino Pinna, l’emploi du terme
« superstition », souvent assimilé à la « croyance » de l’autre dans un sens péjoratif, n’est pas
réservé au champ exclusif de la magie. Ce mot recouvre en général tout ce qu’une idéologie
désire abattre au nom de la raison dominante. Aussi, lorsque l’ethnologue qualifie le recours
11
aux rituels magiques de « superstition », ce dernier emprunte au discours culturel hégémonique
de sa propre société et de son temps : « Dans les diverses époques, lorsque résonne le mot
superstition, il peut s'entendre de diverses manières : pour l'Etat romain et pour ses
intellectuels, la superstition est le christianisme ; pour les chrétiens, cependant, la superstition
devient la religion polythéiste et idolâtre de l'empire, défini plus tard comme paganisme ; pour
les protestants, c'est le culte des saints ainsi que beaucoup de pratiques festives et
dévotionnelles catholiques qui constituent la superstition. La catégorie de superstition fut reprise
à l'infini et utilisée par des courants de pensée rationalistes et scientistes pour lesquels toute
forme de religion est définie par défaut comme superstition (...) (Pinna : 2012, 199. Traduit de
l'italien par nos soins) ».
Le regard du scientifique sur la sorcière n’a pourtant pas vocation de remplacer celui de
l’inquisiteur. Mais nous voyons qu’au-delà des kilomètres et des époques, ce qui fait parfois
encore consensus autour de l’objet frontière magique est souvent plus la somme des
présupposés occidentaux projetés sur l’autre que le constat objectif, contextualisé, dialogique
du rapport de l’autre à sa magie.
III°) UNE ORDALIE SCIENTIFIQUE : L’EFFICACITÉ ET LA PREUVE
Dans la pluralité des savoirs locaux, la globalisation met en évidence aujourd’hui et plus
que jamais ce réseau de relations connexes et de conflits complexes qui, pour être compris et
synthétisé par notre monde scientifique, passe par la mise en forme documentaire, la
publication d’ouvrages, d’articles, et donne lieu à des colloques.
1°) Colonialismes latents
Si des objectifs neutres président à notre démarche de généralisation scientifique,
nous l’avons vu, c’est bien le savoir savant occidental qui demeure la référence, laquelle
n’existe qu’en rapport à un sous-savoir magique, populaire, religieux, païen, profane dessiné en
creux. Cependant, aujourd’hui, mis en balance dans les nouvelles configurations géopolitiques
qui se dessinent, « l’héritage du rationalisme occidental ne vaut plus de manière incontestée.
L’idée de rompre avec les Lumières et ce qu’elles ont promu a, de fait, favorisé le
développement d’une compréhension décentrée du monde. Hors du cadre exclusif de la
modernité occidentale, d’autres formations de la conscience universelle émergent, même si ce
procès reste profondément lié aux conditions de l’impérialisme colonial et du capitalisme
12
moderne (Mbembé : 26-27. Cité dans Mangeon : 2006, 67) ». La dichotomie entre savoirs
renvoie ici plus que jamais à une histoire occidentale des séparatismes, du centralisme jacobin
et des hiérarchies, à une tradition de la taxinomie naturaliste que le Grand Partage de la
colonialisation a fourni en exemple à travers les idées de progrès et d’archaïsme accolées à
celles de sociétés supérieures et inférieures : « L'idéologie cartésienne de la science exige une
nette opposition entre matière et esprit, et dévalorise l'imagination en ôtant aux images leur
vigueur signifiante. Théoriser la croyance au mauvais œil ou à la jettatura implique qu'on
revienne sur ce dualisme et cette dévalorisation » (Caisson : 1998 : § 4). Cet arrière-plan de la
pensée occidentale est à l’origine de notre science contemporaine ; il aura en quelque sorte
naturalisé une distance entre science et magie, rendant malaisée toute remise en question
culturelle ultérieure de cette séparation. Les Lumières puis l’Évolutionnisme ensuite ont fixé les
paramètres de ce système binaire aux XVIIIè et XIXè s., et qui deviendront ce continuum
dépréciatif discret tapi derrière certaines analyses scientifiques jusqu’à nos jours : "Je me
demande jusqu'à quel point la notion de "superstition" utilisée aujourd'hui sans tenir compte de
son héritage historique, conduit à réaffirmer une distance et de rassurantes postures
autoréférentielles tout en liquidant à proprement parler la réalité non comprise (Pinna : 2012,
202. Traduit de l'italien par nos soins) ».
Au final, cette magie comme « science mensongère », qualifiée d’« art stérile » ou de
« falsification systématique de la loi naturelle » reste aujourd’hui la « règle de conduite
fallacieuse » qui continue à diriger l’acte du sorcier ou du chamane, quoique Frazer ait depuis
longtemps quitté les devants de la scène anthropologique, et l’Évolutionnisme colonial tombé
officiellement en désuétude.
2°) Efficacité(s)
Il est pourtant avéré que des rites à visée thérapeutique « non scientifiques »
emploient des procédés tout aussi logiques que la médecine occidentale, que des résultats sont
obtenus grâce à ces moyens. Depuis sa fameuse description du processus d’efficacité
symbolique à partir du mythe, Claude Lévi-Strauss établit un autre point de comparaison
possible entre Eux et Nous à travers ce qui correspondrait le plus à une inférence occidentale,
la psychanalyse : « Et il faut que, comme le malade et comme le sorcier, le public participe, au
moins dans une certaine mesure, à l’abréaction, cette expérience vécue d’un univers
d’effusions symboliques dont le malade, parce-que malade, et le sorcier, parce-que
psychopathe, c’est-à-dire disposant l’un et l’autre d’expériences non intégrables autrement-
13
peuvent lui laisser, de loin, entrevoir “les illuminations“ (Lévi-Strauss : 2012, 208, Anthropologie
Structurale I, « Le sorcier et sa magie ») ». « Abréaction », « symbolique » et « psychopathe »
renvoient à l’imaginaire freudien ; par simple transposition du magique à la psychanalyse, la
cure du « Sauvage » nous apparaît dès lors beaucoup plus familière lorsqu’elle est traduite en
français dans le texte. Par conséquent, la cure chamanique ne nous devient intelligible que
lorsqu’elle emprunte une grille explicative psychanalytique, tout comme le monde magique
devenait cohérent pour De Martino dans son analogie « institutionnelle ».
Cependant ici, et à l’inverse du constat de Gallini pour qui une cérémonie réelle guérit
du fantasme, l’efficacité symbolique désincarnée -parce-que mythique- renvoie à une maladie
bien réelle. De Martino, citant le psychologue Wundt, exprime autrement cette même idée :
« L’ennemi percé en effigie ne souffre pas symboliquement mais réellement, même si la flèche
qui traverse son image ne peut frapper son corps réel. Mais elle frappe son âme et, par le
truchement de celle-ci, elle peut procurer la maladie et la mort à son corps (De Martino : 1967,
218. Cité de Wundt, Völkerpsychologie IV, 1910). Comme il ne s’agit pas de trancher sur le bien
fondé d’un système de pensée contre un autre (ce qui reviendrait à envisager une partie de
l’objet frontière pour expliquer sa totalité), ce qui importe ici est le paradoxe d’une valeur
accusatoire issue d’une analyse scientifique créant une inégalité entre savoirs. Aussi, l’historien
des religions De Martino dénonce une certaine attitude de l’ethnologue limité par son propre
« jeu social » sur le terrain : « Mais pour l’ethnologue, la découverte la plus importante n’est pas
la réalité de la télépathie ou d’autres phénomènes paranormaux, mais bien plutôt d’avoir surpris
des hommes de sa propre civilisation dans une attitude révélatrice devant le problème de la
réalité des pouvoirs magiques : une attitude qui met ingénument en évidence les limites de leur
Einstellung culturelle (De Martino : 1967, 154) ».
Idéation théorique contre technique
Dans sa notion de bricolage, Lévi-Strauss compare la figure du technicien bricoleur
(assimilé à l’opérateur magique) à l’ingénieur (désigne le scientifique). Ce couple renvoie à une
ressemblance (tous deux fabriquent bien quelque chose), mais aussi à une différence
essentielle, de l’ordre d’une inégalité ontologique des savoirs, inscrite à la fois dans le statut
professionnel de l’acteur et dans la méthode employée dans l’action. L’ingénieur scientifique
conçoit le plan à l’origine de l’objet, tandis que le bricoleur se contenterait d’assembler des
pièces préfabriquées. Dans la réflexion de Jacqueline Monfourga-Broustra cependant, le savoir
magique est réinvesti d’un potentiel créatif capable de concevoir ET de fabriquer un objet
14
magique, maîtrisant en cela toute la chaîne des opérations. Le savoir théorique préexisterait
bien dans la pensée du mage, avec cette différence que ce dernier n’écrirait pas le concept que
sous-tend son acte de manière implicite. Sur le plan de la pensée magique comme de la
pensée scientifique, cet auteur réintroduit une certaine forme d’égalité dans le traitement des
savoirs, les faisant équivaloir en rationalité et en légitimité : « On sait bien que l’anthropologue
et le psychanalyste sont des interprètes. Le chaman-possédé aussi. C’est son savoir, à lui
aussi, qui lui permet l’interprétation (Monfouga-Broustra : 2001, 175) ». Rendant l’autre maître
de lui-même et de ses actes, le renvoyant à son entière responsabilité loin de tout résidu
paternaliste voire suprémaciste, le regard conscient du scientifique, à travers le respect de cette
liberté fondamentale, se donne aussi le devoir de décrire sans déprécier.
Conclusion
Ce que la magie révèle de la science occidentale
Empruntant à des savoirs a priori éloignés des représentations vernaculaires qu’elle
étudie, l’ethnographie inscrit son objet dans une grille de lecture scientifique et culturelle
occidentale qui lui est propre. Objectivant les données collectées en une traduction parfois
subjective des phénomènes, le scientifique prive quelquefois les savoirs magiques de leur
« voix native » pour revêtir un nouveau sens dès lors qu’ils empruntent cette grille scientifique :
« Notre science est faite pour explorer des phénomènes qui appartiennent à un monde donné,
par rapport auquel la présence est garantie ; par conséquent, ses méthodes ne peuvent
entièrement s’adapter à des phénomènes appartenant à un monde qui se donne et qui est
encore inclus dans la dramatique décision d’une présence en crise (De Martino : 1967, 155) ».
Ne correspondant pas totalement au cadre natif de l’objet décrit, la grille scientifique doit donc
opérer une transformation sémantique pour rendre le monde magique compréhensible de la
communauté scientifique. Enfoui sous les non-dits et l’objectivisme, nous voyons émerger au
contact de la magie un second territoire de pensée, celui d’une science éminemment
occidentale dans le regard qu’elle continue de porter sur le reste du monde : « Codrington
aborde ses Mélanésiens sans les garanties méthodologiques nécessaires pour s’assurer une
compréhension médiate et étayée de l’objet de la recherche, et il tend, par conséquent, à
introduire dans l’interprétation des données le bagage d’expérience que lui fournit sa propre
formation culturelle [...]. En effet, si nous considérons comme document authentique, non pas
15
ce que rapporte Codrington sur la signification du terme atai, mais la manière dont le
missionnaire Codrington, avec sa formation culturelle, réagit devant l’ensemble de faits culturels
que désigne le terme atai, nous pouvons en tirer des conclusions qui éclaireront,
simultanément, les deux mondes culturels dont la rencontre a fait naître le document (De
Martino : 1967, 93) ». Dans cet exemple, la révélation du système de représentations de
chacun, loin de diviser sur le signifié, serait au contraire un premier pas vers une ouverture
méthodologique et réflexive nécessaire à une reconnaissance plénière des savoirs en
présence.
Cependant, si dans un élan enthousiaste vers une « décolonisation des esprits » les
Postmodernes ont prôné une ouverture et dialogue des voix sur le terrain, notre savoir savant
ne s’est pas montré forcément prêt à céder une once de ses prérogatives depuis le phénomène
Writing Culture et devant une égalité de principe sapant les fondements officieux d’une autorité
de l’ethnologue. Selon Leigh-Star et Griesemer, une solution apparaît sous la forme d’une
compatibilité dialogique minimum, issue d’une reconnaissance mutuelle des subjectivités et des
savoirs autour de l’objet frontière. Dès lors, nous pourrions nous demander avec Guillaume
Rosenberg, jusqu’à quel point nous avons trop parlé de, sur et à la place de l’autre : « Y-a-il une
conscience indigène de ce que le rituel construit et des manières dont il le construit ? Une telle
éventualité réduirait (dangereusement ?) la fracture conceptuelle communément établie, même
si ponctuellement remise en cause, entre l’ethnologue et ses sujets d’étude -le premier
apercevant dans les dits et les faits des seconds ce à quoi ceux-ci resteraient aveugles,
incapables qu’ils seraient, par leur position d’insiders, par leur condition de croyants et par leur
manque d’outillage anthropologique, de le formaliser ou de le signifier (Rosenberg : 2010, 2) ».
Par conséquent, s’il n’est pas question de remettre en cause le bien-fondé d’une étude
scientifique généralisant le particulier à des fins de compréhension, se pourrait-il que l’on
reconnaisse la spécificité et la subjectivité de ce regard occidental dissimulé derrière un
paravent d’objectivité ? Ainsi que le souligne très justement Raymond Massé, il faut distinguer
entre science et usages biaisés de la science. Pour cela, il nous paraît important de lever
l’anomie entourant ce regard hérité de l’histoire sociale occidentale : « Il faut éviter de
confondre la science elle-même, [...] et les usages sociaux et politiques de cette science et des
savoirs scientifiques, qui, eux, font place à la subjectivité, à la mystification et à la défense
d’intérêts particuliers » (Massé : 2002, 11).
Entre une autorité autoproclamée et des voix discordantes, entre une vérité partiale et des
réalités partielles du savoir se dessine en négatif une trame rémanente évolutionniste qui n’en
16
finit plus de compter les progrès de l’autre à l’aune de sa propre vision du monde. Dans le
rapport obligé induit par l’ethnographie sur le terrain, les techniques chamaniques de guérison
sibériennes, les rituels de la grand-mère corse et la divination africaine n’en ressortent pas
toujours compris, expliqués sans être en partie détruits par l’hégémonisme de ce regard
occidental. De la rencontre à travers l’objet frontière magique, paradoxalement, c’est souvent
en effet, une idéation de notre propre supériorité qui se rend lisible.
Vers une coopération des savoirs ?
Sans tomber dans un relativisme systématique qui sape la base de tout comparatisme,
admettre la possible validité d’une multitude de représentations du monde réduirait d’emblée la
fracture entre savoirs. Ces derniers nous deviendraient alors pensables aujourd’hui hors de tout
jugement moral ou classificatoire : « Si l’on veut comprendre la ténacité de ces représentations
et l’aisance avec laquelle elles s’articulent aux changements modernes, il semble à première
vue important de laisser plus d’envergure à l’ambivalence de ces notions [de magie] ainsi qu’à
la fluidité de toutes les classifications de ce champ miné. Une telle souplesse s’impose plus
encore lorsque l’analyse ne se restreint plus au discours général, mais s’oriente vers le lien
entre discours et pratiques quotidiennes » (Geschiere : 2000 § 20-21). La compréhension n’est
peut-être pas loin lorsque l’observateur accepte de laisser choir sa position dominante au profit
d’une réelle posture d’apprenti. La collaboration entre savoirs s’extrait alors d’une contradiction
artificielle, du moment où l’ethnologue cesse de prendre une critique occidentale pour juge
universel des preuves : « L’analyse du problème des pouvoirs magiques dans l’histoire de
l’ethnologie nous a donc offert une occasion supplémentaire de prendre conscience de ceci :
[...] que nous prenons pour de la compréhension ce qui n’est encore que de la négation
polémique, de la passionnalité en acte » (De Martino : 1967, 250). Dans ce long monologue de
l’Occident scientifique sur lui-même, où sont donc passées les nuances polysémiques qui
faisaient de la magie un paradoxe pour la société qui la pratique ? Si beaucoup d’ethnologues
ont su rendre leur voix aux praticiens, combien d’entre eux l’ont-ils fait en considérant ces
savoirs comme valides en dehors de toute référence morale à l’Occident ? Il ne s’agit pas de
remplacer la Chasse aux sorcières de l’Inquisition par une chasse aux Consciences,
néanmoins, l’argument d’autorité scientifique accolé à nos travaux mériterait qu’une plus large
part y soit consacrée à une analyse réflexive. Dans le concert international des sociétés
interconnectées par la globalisation, y-aurait-il une vraie place pour une polyphonie intégrative
des savoirs dans laquelle l’ethnologue pourrait se faire également expérimentateur, modeste
apprenti, oreille attentive ?
17
Bibliographie BENOIST, Jean, 1993, Anthropologie médicale en société créole, Paris, PUF, 258 p.. CAISSON, Max, « La science du mauvais œil (malocchio) », Terrain [En ligne], 30 | mars 1998, mis en ligne le 14 mai 2007, consulté le 04 décembre 2013. URL : http://terrain.revues.org/3304 ; DOI : 10.4000/terrain.3304. COSTEY, Paul, « L’illusio chez Pierre Bourdieu. Les (més)usages d’une notion et son application au cas des universitaires », Tracés. Revue de Sciences humaines [En ligne], 8 | 2005, mis en ligne le 20 janvier 2009, consulté le 11 octobre 2012. URL : http://traces.revues.org/2133). DE MARTINO, Ernesto, 1967, Le monde magique, Paris, Marabout Université, 254 p.. FRAZER, James, 1981 [1911-1915], Le Rameau d’Or, 1004 p.. FAVRET-SAADA, Jeanne, [1985], 2009, Les Mots, la Mort, les Sorts, Paris, Folio Essais, 427 p.. GALLINI, Clara, 1988, La Danse de l’Argia, La Grasse, Verdier, 272 p.. GESCHIERE, Pieter, « Sorcellerie et modernité : retour sur une étrange complicité », Politique africaine [En ligne], 3 | 2000 (N° 79), consulté le 04 décembre 2013. URL : www.cairn.info/revue-politique-africaine-2000-3-page-17.htm ; DOI : 10.3917/polaf.079.0017. KECK, Frédéric, « Les théories de la magie dans les traditions anthropologiques anglaise et française », Methodos [En ligne], 2 | 2002, mis en ligne le 05/04/2004, consulté le 06 novembre 2013. URL : http://methodos.revues.org/90 ; DOI : 10.4000/methodos.90. LEIGH-STAR Susan & GRIESEMER James, 2008, « Ecologie institutionnelle, “traductions“ et objets frontières : des amateurs et des professionnels au musée de zoologie vertébrée de Berkeley », 1907-1939, in LAHIRE Bernard & ROSENTAL Claude, La Cognition au prisme des sciences sociales, Paris, Archives contemporaines, 310 p.. LÉVI-STRAUSS, Claude, « Le sorcier et sa magie », in Anthropologie Structurale I, [1958], 2012, Paris, Pocket, Collection Agora, 478 p.. MANGEON, Anthony, « Maîtrise et déformation : les lumières diffractées », in Labyrinthe n°24, 2006, p.63 à 83. MAUSS, Marcel, 1902-1903, Esquisse d’une théorie générale de la magie, Les Classiques des Sciences Sociales [En ligne], mis en ligne le 17 février 2002, consulté le 31 octobre 2013. URL : http://classiques.uqac.ca/classiques/mauss_marcel/socio_et_anthropo/1_esquisse_magie/esquisse_magie.html ; DOI : http://dx.doi.org/doi:10.1522/cla.mam.esq, 107 p.. MASSÉ, Raymond, 2002, « Introduction. Rituels thérapeutiques, syncrétisme et surinterprétation du religieux », in Massé R. & Benoist J., Convocations thérapeutiques du sacré, Paris, Editions Karthala, Collection Médecines du Monde, 493 p.. MONFOUGA-BROUSTRA, Jacqueline, « Sur l'efficacité symbolique », Cahiers internationaux de sociologie [En ligne], 1 | 2001 (n° 110), p.171-176, consulté le 16 novembre 2013 ; URL : www.cairn.info/revue-cahiers-internationaux-de-sociologie-2001-1-page-171.htm ; DOI : 10.3917/cis.110.0171. PINNA, Tomasino, 2012, Il sacro, il diavolo e la magia popolare. Religiosità, riti e superstizioni nella storial millenaria della Sardegna, Sassari, EDES, 309 p.. ROSENBERG, Guillaume, 2010, « Magie du Rituel, démon de la Réflexivité », in L’Homme n°198-199, 2011/2-3, 472 p.. TURNER, Victor, [1969], 2008, The Ritual Process. Structure and anti-Structure, USA, Aldine Transaction, Library of Congress, 213 p..