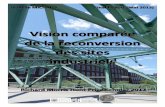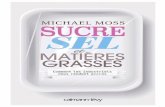L'ENSIC et ses partenaires industriels : le prisme de la Fondation scientifique des Industries...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of L'ENSIC et ses partenaires industriels : le prisme de la Fondation scientifique des Industries...
L'ENSIC et ses partenaires industriels : le prisme de la Fondation scientifique des Industries chimiques
(1920-1960)
Laurent Rollet Philosophie et Histoire des Sciences
Laboratoire de Philosophie et d'Histoire des Sciences – Archives Henri Poincaré Institut National Polytechnique de Lorraine
Résumé
"Créer ou subventionner des cours, conférences, laboratoires et diverses entreprises de recherche au sein de l'École ; accorder des bourses d'études, de recherches ou de voyage d'études aux élèves et au personnel et développer des systèmes de prix et de récompen-ses ; mettre en place un programme de rénovation ou de construction de locaux ; donner à l'École les moyens financiers […] pour permettre la formation d'ingénieurs-chimistes de haute qualité, aptes à constituer une élite, où seront puisés les Chefs et les Cadres de l'Industrie Chimique". C'est en ces termes que la direction de l'École supérieure des In-dustries chimiques de Nancy (aujourd'hui ENSIC) s'adressait en 1943 à différentes en-treprises du monde de la chimie dans le but de créer une Fondation scientifique des in-dustries chimiques. L'établissement de réseaux et de partenariats industriels constitue une stratégie nécessaire pour l'organisation de l'enseignement et de la recherche dans les éco-les d'ingénieurs. La chimie étant traditionnellement une discipline de contact avec la sphère industrielle, l'institutionnalisation des relations entre une école et des entreprises semblait donc relever de la simple routine. Cependant, tout en s'inscrivant dans le fonc-tionnement ordinaire des écoles d'ingénieurs, la Fondation scientifique des industries chimiques constitue un objet d'étude à part entière, à plusieurs titres. D'une part, parce qu'elle vit le jour à un moment où l'École supérieure des Industries chimiques de Nancy traversait une crise profonde en matière de recrutement d'étudiants. D'autre part, parce qu'elle fut créée durant la période de l'Occupation allemande, dans le contexte d'une prise en main de la production industrielle par l'intermédiaire des Comités d'Organisation du gouvernement de Vichy. Enfin, parce qu'elle semble avoir participé de manière active au développement du pôle chimique nancéien de la Libération jusqu'aux années 1960, no-tamment à travers le développement de l'enseignement et de la recherche en génie chi-mique.
Ce texte se propose d'évoquer les circonstances de la création de la Fondation de l'EN-SIC ainsi que les premières années de son fonctionnement, en se focalisant principale-ment sur quelques acteurs : Pierre Donzelot, Maurice Letort (directeurs successifs de l'ENSIC) et Maurice Brulfer (président de l'Union des Industries chimiques).
I°/ Introduction En 2004, l'École supérieure d'Électricité (Supélec) s'est dotée d'une Fondation. Créée sous l'égide de la Fondation de France, la Fondation Supélec vise en fait à établir un partenariat entre l'école (représentée notamment par l'Amicale des Ingénieurs Supélec) et le monde indus-triel (Schlumberger, Schneider, Électricité de France). Au-delà de la création de bourses d'études, l'objectif est aussi de renforcer les contacts de l'école avec le monde industriel, de promouvoir la communauté des ingénieurs Supélec et de contribuer au financement des pro-jets. L'objectif affiché est donc d'accompagner le développement de l'école et de renforcer son
Genèse et Développement du Pôle Scientifique Nancéien
- 166 -
rayonnement international en apportant son soutien financier à des programmes de recherche et de formation et en finançant des bourses d'études ou des échanges d'enseignants-chercheurs :
"Les défis à relever aujourd'hui se posent autant en termes scientifique, économique, géo-politique, législatif, que de formation et de société. Se doter des moyens de maîtriser et gérer la complexité est un impératif. Comme elle l'a été dès sa création en 1894, Supélec sera à la pointe de ces futurs développements, mais pour répondre à ces nouveaux défis, il lui faut de nouveaux moyens. C'est le rôle de la Fondation Supélec, qui lui apportera des ressources complémentaires afin de lui permettre de faire plus et plus vite".1
Un tel discours semble très nettement en phase avec la modernité. Le registre linguistique est celui de la performance, de la compétitivité et de l'innovation, avec une référence aux racines historiques de l'institution.
Une telle rhétorique est loin d'être une nouveauté. En 1943, l'École supérieure des Industries chimiques (ESIC) de Nancy décida de se doter elle aussi d'une Fondation. Elle fit appel à des partenaires industriels (Rhône Poulenc, Saint-Gobain, etc.) par l'intermédiaire de son associa-tion d'anciens élèves et insista sur la nécessité de trouver un complément de financement pour créer des bourses d'études, élaborer de nouveaux enseignements, accroître la reconnaissance du diplôme et élargir le rayonnement de l'école. Elle choisit également de communiquer sur le registre du dynamisme et de la performance tout en mobilisant son histoire. La Fondation scientifique des industries chimiques vit le jour durant la période troublée de l'Occupation allemande et à un moment où l'école supérieure des industries chimiques traversait une crise profonde en matière de recrutement d'étudiants. Il serait probablement illusoire de comparer termes à termes ces deux événements distants de près de 60 ans. Il est cependant frappant de constater le caractère intemporel des discours des écoles d'ingénieurs lorsqu'il s'agit de mettre en avant leurs stratégies de développement ou de tisser des liens avec le monde industriel.
L'objectif de cet article est d'étudier le fonctionnement de l'ENSIC sur une période de temps assez longue (1920-1960) et de rendre compte de ses relations avec le monde économique et industriel. Il ne s'agira pas de proposer ici une monographie exhaustive sur l'évolution des enseignements et des pratiques de recherche. Il ne s'agira pas non plus de traiter dans toute son extension la question des relations entre monde universitaire et monde économique. La perspective choisie sera en fait plus précise : on s'attachera principalement à suivre le proces-sus par lequel l'école de chimie nancéienne fut conduite à se doter d'une Fondation scientifi-que des Industries chimiques dans une période troublée (l'Occupation et le régime de Vichy) et à institutionnaliser ses relations avec des partenaires industriels. Quelles étaient les rela-tions de l'ENSIC avec le monde industriel dans l'entre-deux-guerres ? Pour quelles raisons l'école décida-t-elle de créer une Fondation en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale ? Qui étaient les acteurs de cette association ? Partageaient-ils tous les mêmes conceptions sur les objectifs de l'association ? Quelle fut la contribution réelle de la Fondation (et donc des industriels) à la vie de l'école jusqu'aux années 1960 ?
Pour mener à bien cette étude, nous porterons d'abord notre attention sur la situation de l'insti-tut chimique durant l'entre-deux-guerres, période durant laquelle il se trouva confronté, à l'instar des autres instituts nancéiens, à une grave crise démographique et financière. Nous nous intéresserons ensuite aux circonstances de la création de la Fondation en 1943, dans le contexte particulier de la France de Vichy et de l'occupation allemande. Ceci nous conduira ensuite à décrire dans le détail le fonctionnement de la Fondation jusqu'au début des années
1 Communiqué de presse, avril 2004. http://www.supelec.fr/actu/TB_Fondation_Supelec.html. Consulté le 1er juillet 2005.
Rapport de Recherche
- 167 -
1960. Enfin, dans un dernier temps, nous porterons notre attention sur l'émergence du génie chimique à Nancy, événement marquant de l'histoire du pôle scientifique nancéien et auquel participa la Fondation.
La chimie est traditionnellement une discipline de contact avec les milieux industriels. L'his-toire de la Fondation scientifique des Industries chimiques constitue une sorte de cas d'école pour qui entendrait juger des vertus et des limites de ces partenariats privilégiés. Ce parcours nous permettra de suivre l'évolution du statut de l'Institut chimique de Nancy,2 mais aussi, en arrière plan, d'interroger la question des attentes de l'industrie vis-à-vis des formations d'ingé-nieurs et de mettre en évidence les ambiguïtés et les compromissions qui en découlèrent à certaines périodes.
II°/ L'Institut chimique de Nancy durant l'entre-de ux-guerres
A°/ La reconstruction des années 1920
La Première Guerre mondiale fut une période noire pour l'Institut chimique de Nancy, en termes de recrutement d'étudiants. Durant les premières décennies de son existence, il avait connu une croissance considérable, ses effectifs passant de quelques dizaines d'élèves dans les années 1890 à plus de 300 à partir de 1905 (et jusqu'en 1913). Durant l'année 1913-1914, les effectifs globaux de l'institut chimique se virent diminués de près de 250 étudiants et il fallut attendre l'année 1919-1920 pour les voir augmenter de nouveau, puis dépasser les chiffres de 1914.3 À l'instar de l'Institut électrotechnique de Nancy, l'école de chimie avait largement bénéficié de l'apport d'étudiants étrangers : ainsi, en 1913-1914, sur 53 élèves de troisième année, 30 étaient d'origine étrangère (russes majoritairement), soit 56,60 %. Cette proportion d'étudiants étrangers chuta fortement à partir de 1915 (à peine 6 % en 1916-1917) pour fina-lement se rétablir à des niveaux élevés durant l'entre-deux-guerres.4
Dès le début des années 1920, l'institut chimique put bénéficier de nouveaux locaux et com-mença à développer des installations semi-industrielles destinées aux travaux pratiques et aux essais de chimie industrielle. L'afflux des démobilisés eut un effet non négligeable sur l'aug-mentation des effectifs (l'école accueillant jusqu'à plus de 350 élèves en 1921-1922), à un point tel que l'institut fut contraint de mettre en place un examen d'entrée fondé sur le pro-gramme du baccalauréat de mathématiques.
Après-guerre, la Société industrielle de l'Est manifesta très rapidement son désir de jouer un rôle moteur pour la promotion des relations entre science et industrie. En 1920 fut ainsi créée
2 Celui-ci devenant école supérieure des industries chimiques en 1936 puis école nationale supérieure des indus-tries chimiques (ENSIC) en 1948. Notre propos n'est pas ici de relater les circonstances de la création de l'institut chimique. Pour des mises en perspective de plus grande ampleur, on consultera, dans le présent rapport, bien sûr les textes de Marie-Jeanne Choffel-Mailfert (page 31) et de Françoise Birck (page 233). On se référera surtout à : Birck, "Des instituts annexes de facultés aux écoles nationales supérieures d'ingénieurs, à propos de trois écoles nancéiennes". In Birck & Grelon (Eds), Des ingénieurs pour la Lorraine 19ème-20è siècles. Metz, Éditions Serpe-noise, 1998, 143-213. On pourra également consulter l'ouvrage suivant, à visée plutôt commémorative : Aubry, "L'institut Chimique de Nancy et l'École Supérieure des Industries Chimiques de 1887 à 1946". In ENSIC (Ed.), Centenaire de l'ICN-ENSIC 1887-1987, Historique de l'École. Ouvrage contenant des notices historiques P. Barral et J.-L. Greffe. Nancy, Institut National Polytechnique de Lorraine, 1987, 13-63. 3 Petit, "L'œuvre industrielle de la Faculté des Sciences de Nancy", Revue bleue, 1925. 4 Voir à ce sujet, les archives de l'École Supérieure de physique et de chimie industrielle, dossier Albin Haller, H/2-24. Cité dans Birck, "Des instituts annexes de facultés aux écoles nationales supérieures d'ingénieurs, à propos de trois écoles nancéiennes". In Birck & Grelon (Eds), Des ingénieurs pour la Lorraine 19ème-20ème siècles. Metz, Éditions Serpenoise, 1998, 143-213. (page 165).
Genèse et Développement du Pôle Scientifique Nancéien
- 168 -
une Société des Amis des Instituts visant à leur apporter un soutien substantiel par le biais de cotisations régulières. Cette aide était associée à une volonté politique forte de l'université : le doyen Paul Petit s'engagea ainsi à ce que "tout l'enseignement soit donné conformément au désir des industriels et selon leurs vœux".5 L'institut chimique, l'institut électrotechnique, l'institut de géologie appliquée et l'institut commercial bénéficièrent de ces aides.
On peut supposer que cette initiative de la Société des Amis de l'Institut portait en elle les ferments d'une alliance future entre les instituts, voire même du développement d'une politi-que commune. Cependant, le résultat fut tout autre : dès 1925, certains instituts commencèrent à se doter de leurs propres fondations et leur attribuèrent pour rôle essentiel de collecter et de gérer les fonds de la taxe d'apprentissage (à l'exception de l'institut chimique qui ne créa sa fondation qu'en 1943).6 Ce faisant, ils se dotèrent d'une instance de décision autonome par rapport à la politique de l'université nancéienne. De plus, l'université se trouva elle-même dans l'obligation de redéfinir sa propre politique. Avant 1918, l'histoire politique de l'Alsace-Moselle avait contribué à faire de l'université nancéienne une université-frontière et celle-ci s'était beaucoup appuyée sur une rhétorique du développement local et régional (avec une forte charge patriotique). Après 1918, une telle rhétorique n'était plus de mise et le dévelop-pement du pôle scientifique nancéien semblait beaucoup plus lié à une stratégie nationale. On ajoutera que le système germanique de formation des ingénieurs et techniciens avait servi à la fois d'exemple et de stimulant avant-guerre pour la création des instituts techniques en France. Or, à partir de 1918, un grand nombre de voix critiques à son encontre commencèrent à se faire entendre en France. On l'accusait notamment de délivrer beaucoup trop de diplômes et de ne proposer aux jeunes diplômés que la seule perspective du chômage.7
B°/ La crise démographique et les problèmes de recrutement
La loi universitaire de 1896 avait institué une répartition des charges budgétaires incombant aux universités. Elle prévoyait en effet que l'État assure le fonctionnement des enseignements théoriques et des laboratoires de science pure et elle laissait aux universités – dès lors dotées de la personnalité civile – la charge d'organiser le financement des enseignements complé-mentaires de sciences appliquées. Une des conséquences de cette organisation était que les droits d'inscription payés par les élèves représentaient une part substantielle du budget des écoles (En 1922, les frais d'inscription représentaient les 2/3 du budget de l'Institut électro-technique de Nancy). Ceci explique en partie pourquoi la plupart des instituts scientifiques nancéiens avaient historiquement opté pour des politiques de recrutement ouvertes, c'est-à-
5 Archives de l'Institut électrotechnique de Nancy, lettre rédigée par Paul Petit pour promouvoir l'association, 10 novembre 1920. Cité dans Ibidem. (Page 180). 6 Ce nouveau dispositif correspondait à ce qu'on appela le "sou du laboratoire" et doit être rattaché à l'histoire ancienne du CNRS : "La faiblesse de la caisse des recherches pousse en 1924 le mathématicien-ministre Émile Borel à profiter d'une majorité parlementaire favorable, le Cartel des gauches, pour créer un nouveau mode de financement de la science. Il s'agit de prélever sur la taxe d'apprentissage, à laquelle est assujettie toute entre-prise, une contribution destinée à la recherche. Cette taxe, inscrite dans la loi de finance du 13 juillet 1925, sera appelée le "Sou du laboratoire". […] Au demeurant, le sou du laboratoire consiste à rendre obligatoire une contribution de l'industrie à des recherches dont elle profite. Puisqu'il s'avère difficile d'amorcer le soutien libre-ment consenti de l'industrie, le mécénat d'État se substitue à l'initiative privée. Mais cette participation reste modeste et surtout elle ne prétend ne s'accompagner d'aucun effort d'organisation". Picard, Jean-François, La République des savants, la recherche française et le CNRS, Paris, Flammarion, 1990, page 25. 7 Collectif, "Pour notre enseignement technique supérieur", Revue internationale de l'enseignement 72, 1918, 124-134. Cité dans Birck, "Des instituts annexes de facultés aux écoles nationales supérieures d'ingénieurs, à propos de trois écoles nancéiennes". In Birck & Grelon (Eds), Des ingénieurs pour la Lorraine 19ème-20ème siècles. Metz, Éditions Serpenoise, 1998, 143-213. (Page 181).
Rapport de Recherche
- 169 -
dire ne comportant ni concours ni examen. Ceci explique également pourquoi la proportion d'étudiants étrangers dans les promotions était loin de représenter une simple variable an-nexe ; par leur présence et leur contribution financière, ceux-ci contribuaient directement à la bonne santé des instituts. Et cela d'autant plus que le gouvernement accordait, à partir des années 1920, des crédits pour venir en aide aux étudiants des anciens pays alliés.8
Cette politique du nombre permettait d'assurer l'essentiel des besoins en fonctionnement des instituts. Cependant, dans les années 1920-1930, les associations d'anciens élèves commencè-rent à dénoncer cette politique qui, selon eux, ne pouvait qu'amoindrir la valeur des diplômes délivrés, et à militer pour une forme de malthusianisme. De la même manière, dans le corps enseignant, se dessina la crainte que cet afflux d'étudiants étrangers ne dévalorise l'image des instituts. Pour certains professeurs, il devenait donc nécessaire d'élever le niveau de recrute-ment. Face à ces critiques, les instituts du pôle scientifique nancéien décidèrent de rééquilibrer les effectifs entre les étudiants français et les étudiants étrangers, ce qui selon eux devait rele-ver le niveau des élèves (la formation initiale des français étant jugée meilleure). On tenta également de créer une préparation à l'entrée en première année au lycée de Nancy mais sans grand succès.9
À partir de 1927, le déficit des naissances, la diminution de l'afflux d'étudiants étrangers et la crise économique installèrent une crise durable au sein des instituts nancéiens. La baisse dra-matique du nombre d'étudiants eut un impact sérieux sur l'équilibre financier des écoles. De plus, alors qu'ils s'en croyaient protégés par leur formation, les jeunes diplômés se trouvèrent confrontés aux licenciements et au chômage.10 Dans une telle situation, des réactions s'impo-saient. La première réaction fut d'envisager une augmentation des droits d'inscription payés par les étudiants dans les instituts : de 1933 à 1935, l'institut chimique, l'institut électrotechni-que et l'école des mines adoptèrent successivement cette politique.11
D'une manière plus stratégique, on décida également de privilégier la 'qualité' des élèves par rapport à la quantité. Dès 1931, l'école des mines explorait cette solution en limitant le nom-bre de places au concours d'entrée (25 places au lieu de 30 en 1931, puis 20 places au lieu de
8 Cf. Birck, "Des instituts annexes de facultés aux écoles nationales supérieures d'ingénieurs, à propos de trois écoles nancéiennes". In Birck & Grelon (Eds), Des ingénieurs pour la Lorraine 19ème-20ème siècles. Metz, Édi-tions Serpenoise, 1998, 143-213. (Page 182). Pour plus de détails, nous renvoyons à la présentation du colloque sur les étudiants étrangers organisé par notre groupe en 2002 (page 359). 9 De tous les instituts de Nancy, l'Institut électrotechnique était incontestablement le plus concerné par ces criti-ques sur la valeur des diplômes et sur le nombre d'étudiants étrangers (ceux-ci y étant proportionnellement en plus grand nombre que les élèves français). La direction décida donc en 1927 d'introduire un concours d'entrée basé sur le niveau des classes de mathématiques spéciales. Cette mesure entraîna un effondrement des effectifs sans pour autant régler totalement le problème, le nombre d'élèves français demeurant minoritaire : entre 1927 et 1934, le nombre d'élèves de première année se trouva réduit de ¾ (de 99 à 24 étudiants) ; il en fut de même pour le nombre total d'étudiants (de 257 à 114). Ibidem. page 183. Voir également : Grelon, André et Birck, Françoise (dir.).Un siècle de formation d’ingénieurs électriciens, ancrage local et dynamique européenne : l’exemple de Nancy. Paris : Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris, (à paraître en 2006). 10 Grelon, "La question des besoins en ingénieurs de l'économie française. Essai de repérage historique (première partie)", Technologies, idéologies, pratiques 6 & 7 (1 & 2), 1987, 4-24. Grelon, Les ingénieurs de la crise, titre et profession entre les deux guerres. Paris, Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1986. 11 On trouve mention de ces augmentations dans les Procès-verbaux des conseils de la faculté des sciences (Archives de la Faculté des sciences de Nancy) : séances du 21 juin 1933 (institut chimique), 5 mars 1934 (insti-tut électrotechnique) et du 20 février 1935 (école des mines).
Genèse et Développement du Pôle Scientifique Nancéien
- 170 -
25 en 1936).12 De son côté, l'institut électrotechnique décida de recruter des élèves venus d'autres formations pour une quatrième année de spécialisation. Enfin et surtout, l'institut chimique adopta une stratégie risquée en 1936 à travers une réforme proposée par son direc-teur, Alexandre Travers. Afin d'élever de façon radicale le niveau de recrutement de l'école, et toucher ainsi les élèves des classes préparatoires, celui-ci proposa une importante refonte des enseignements proposés ainsi qu'un alignement du concours d'entrée sur le programme de l'École polytechnique. Travers avait succédé au professeur Guntz à la direction de l'institut chimique. Son parcours personnel explique peut-être en partie cette stratégie. Diplômé de l'École normale supérieure, élève d'Henry Le Chatelier et d'Albin Haller, il avait été pendant longtemps professeur de lycée et examinateur aux concours de l'école normale et de l'école centrale. Il avait par ailleurs travaillé au sein des usines Schneider durant la guerre. Il dispo-sait ainsi d'une bonne expérience des milieux industriels et il connaissait particulièrement bien le public des classes préparatoires.13
Les conséquences de cette réforme ne se firent pas attendre et prirent une orientation quelque peu paradoxale. Au premier concours inaugurant la réforme Travers en 1936, seuls 51 candi-dats se présentèrent et, sur les 16 élèves de la promotion, seuls 14 obtinrent leur diplôme 3 ans plus tard. De la même manière, la promotion suivante (1937) n'accueillit que 12 élèves (9 élèves pour la promotion 1938) alors que l'école avait une capacité d'accueil d'une trentaine d'élèves. Au premier abord cette stratégie semblait assez suicidaire. Pourquoi choisir une option aussi étroite en pleine crise démographique, alors que l'équilibre financier de l'école reposait en partie sur les droits d'inscription payés par les étudiants ? La réforme Travers ne risquait-elle pas de nuire à la survie même de l'école ?
Pour la direction de l'institut chimique, l'une des motivations essentielles de cette réforme était d'adapter les futurs ingénieurs chimistes à l'évolution des sciences et de l'industrie en renforçant leur culture mathématique et physique. Cependant, s'il s'agissait simplement d'augmenter le niveau des élèves recrutés, il aurait été possible d'imiter l'Institut électrotech-nique de Nancy qui, en 1927, avait prit le parti de recruter des étudiants de la faculté des sciences. On peut estimer que cette stratégie était en relation avec des enjeux de politique universitaire locale.
Face à la crise démographique des années 30, l'institut électrotechnique considérait que la solution passait par la mutualisation des moyens. Dès 1936 il avait donc proposé au conseil de la faculté des sciences de créer une grande école polytechnique comportant les divisions de l'électrotechnique, de la mécanique appliquée, de la métallurgie et de l'industrie des mines, de la chimie, voire même de la brasserie.14 Présenté le 5 février 1936 par René Pouget, le très
12 315 candidats au concours de 1921, 90 à celui de 1936. Birck, "Des instituts annexes de facultés aux écoles nationales supérieures d'ingénieurs, à propos de trois écoles nancéiennes". In Birck & Grelon (Eds), Des ingé-nieurs pour la Lorraine 19ème-20ème siècles. Metz, Éditions Serpenoise, 1998, 143-213. (Page 186). 13 Lors de sa candidature à la direction de l'institut chimique en 1928, cette double expérience semble avoir joué un rôle face à celle de Courtot (voir à ce sujet les Procès verbaux du Conseil de la Faculté des sciences de Nan-cy, Archives de la faculté des sciences, séance du 24 octobre 1928). 14 On notera qu'en 1915-1916, le sénateur Goy avait proposé pour les petits centres universitaires la transforma-tion des facultés des sciences en facultés des sciences appliquées. Il s'agissait déjà à cette époque de mutualiser des moyens dans un centre polytechnique. Ce projet n'avait pas abouti, même si la faculté des sciences y sem-blait plutôt favorable. Voir à ce sujet l'enquête de la Revue internationale de l'enseignement, 1916. Voir égale-ment : Birck, "Des instituts annexes de facultés aux écoles nationales supérieures d'ingénieurs, à propos de trois écoles nancéiennes". In Birck & Grelon (Eds), Des ingénieurs pour la Lorraine 19ème-20ème siècles. Metz, Édi-tions Serpenoise, 1998, 143-213. (Pages 172-173). Ainsi que Grossetti, Grelon, et al., Villes et institutions scien-tifiques (Rapport pour le PIR-Villes), CNRS, 1996.
Rapport de Recherche
- 171 -
influent président de l'Association des Anciens Élèves de l'institut électrotechnique, ce projet rencontra quelques réactions de défiance, notamment de la part de l'école de brasserie et de l'école de laiterie.15 De son côté, l'institut chimique ne se situait pas sur la même ligne straté-gique et regardait plutôt d'un bon œil les pratiques mises en place par l'école des mines dès sa création en 1919 (recrutement des élèves issus des classes préparatoires). Il se considérait, en termes de recrutement, dans une situation de concurrence face aux Mines et prit position pour un maintien de son indépendance et pour la sauvegarde de son individualité.16 La direction craignait en effet d'être confinée dans une position subalterne, les autres écoles s'arrogeant les meilleurs éléments.17 Cette proposition de Pouget déboucha sur une motion plus que prudente de la faculté des sciences :
"L'assemblée de la faculté des sciences, réunie le 5 février 1936, pour étudier un projet de fusion des instituts, estime, après délibération, 1° Que le succès de la formule des Instituts Nancéiens a démontré sa valeur en face de l'enseignement donné dans les Écoles et Insti-tuts Polyvalents, 2° Que la supériorité de cette forme d'enseignement est due à la spéciali-sation des études sous la direction de maîtres eux-mêmes spécialisés, 3° Que la fusion des Instituts n'apporterait qu'une simplification apparente et, en réalité, enlèverait toute sa souplesse au système actuel dont le grand avantage est de permettre l'apparition et l'épa-nouissement de nouvelles branches qu'un cadre unique et forcément plus rigide ne man-querait pas d'étouffer, 4° Qu'au surplus, l'interpénétration des différents Instituts est une chose déjà largement réalisée par l'échange des professeurs et des chefs de travaux, ainsi que par la mise à disposition de tous, des locaux et du matériel des différents laboratoires et Services. En conséquence, l'Assemblée de la faculté des sciences estime qu'il n'y a pas intérêt à envisager une fusion entre l'École des Mines, l'École de Chimie, l'Institut Agri-cole, l'École de Brasserie et l'École de Laiterie ; mais toutefois, sur la demande de Mon-sieur le directeur de l'institut électrotechnique, elle ne voit pas d'inconvénient à ce que soit examinée par les intéressés l'étude d'un rapprochement quelconque entre l'école des mines et l'institut électrotechnique et éventuellement l'institut de géologie (étant entendu que le résultat de cette étude lui sera soumise)".18
Cette très prudente motion faisait état d'un rapprochement éventuel entre l'école des mines et l'institut électrotechnique, sous réserve d'une étude approfondie. Il est probable qu'un tel rapprochement ne fut jamais envisagé sérieusement par l'école des mines, celle-ci ayant tou-jours envisagé ses perspectives de développement à un niveau plus national que local (rappro-chement avec les Mines de Paris et de Saint-Étienne).
Au final, la posture de Travers en 1936 pourrait être interprétée de deux manières. Il serait d'une part possible de le considérer comme un précurseur de l'organisation actuelle des recru-
15 Archives de la Faculté des sciences de Nancy, Procès-verbaux de l'assemblée générale de la Faculté des Sciences de Nancy, séance du 5 février 1936. 16 Pour un aperçu de la position de l'école de géologie, voir le texte de Françoise Birck, page 357. 17 Travers faisait déjà allusion à cette situation en 1933 : "… la possibilité de l'entrée directe dans nos instituts les fait considérer, par beaucoup, comme des établissements de deuxième, voire de troisième zone ! Il est difficile de réagir contre l'opinion, même chez les gens cultivés ! Les lauréats de la classe de Mathématique se croiraient déshonorés d'entrer dans un institut, et tous vont grossir les rangs des fameuses classes de 'Spéciales', dont un tiers seulement des élèves rentre aux grandes écoles. Pourquoi la chimie ne pourrait-elle pas recruter dans cette catégorie d'étudiants ?" Bulletin des élèves de l'Institut chimique de Nancy, 1933, n° 2, p. 15. Cité dans Birck, "Des instituts annexes de facultés aux écoles nationales supérieures d'ingénieurs, à propos de trois écoles nan-céiennes". In Birck & Grelon (Eds), Des ingénieurs pour la Lorraine 19ème-20ème siècles. Metz, Éditions Serpe-noise, 1998, 143-213. (Page 188). 18 Archives de la Faculté des sciences de Nancy, Procès-verbaux de l'Assemblée Générale de la Faculté des Sciences de Nancy, séance du 5 février 1936.
Genèse et Développement du Pôle Scientifique Nancéien
- 172 -
tements dans les écoles d'ingénieurs (interprétation généralement retenue par l'histoire 'offi-cielle' de l'école). Il serait, d'autre part possible de considérer cette position comme un repli conservateur sur un modèle élitiste et séculaire de formation d'ingénieurs, modèle spécifique-ment français et qui n'a guère d'équivalents dans les autres pays européens. Quoi qu'il en soit, rien n'était absolument inéluctable et ce choix particulier engagea l'école dans une direction tout à fait nouvelle de son histoire.
C°/ La situation de l'ESIC à la fin de l'entre-deux guerres
L'année 1936 fut une année cruciale pour institut chimique. Par un décret du 19 février, il devint École des Sciences et Industries chimiques. Pour la direction, une nouvelle école venait de naître ; une école désireuse de maintenir son indépendance au sein du pôle scientifique nancéien, soucieuse de s'assurer un recrutement de qualité et de répondre aux attentes du monde industriel. Ainsi, dans les rapports adressés à la direction de l'Enseignement technique, Alexandre Travers ne manquait pas d'insister fortement sur l'idée d'une rupture avec l'ancien institut chimique.
Alors que, comme toutes les écoles, elle subissait de plein fouet un déficit démographique, l'ESIC décida de faire de celui-ci une opportunité pour changer radicalement de mode de recrutement et jouer la carte des classes préparatoires. Le tableau ci-dessous illustre parfaite-ment la crise du recrutement qui affecta l'école entre 1931 et 1941 : même avec un recrute-ment de niveau baccalauréat (avant 1936), l'institut chimique peinait déjà à faire le plein d'étudiants. L'installation de la réforme Travers ne changea pas fondamentalement la donne concernant le nombre d'étudiants recrutés en première année.
Première année Deuxième année Troisième année Élèves de thèse
1931-1932 30 30 38 33
1932-1933 27 17 36 38
1933-1934 36 23 21 34
1934-1935 21 26 20 24
1935-1936 12 11 32 18
1936-1937 1619 14 20 22
1937-1938 9 16 14 18
1938-1939 9 10 15 13
1939-1940 École fermée
1940-1941 12 2 4
Répartition du nombre d'élèves de l'Institut Chimique de Nancy - ESIC par année d'étude (au 1er janvier de chaque année)20
En revanche, sur cette période de 10 ans on ne peut que constater une diminution très nette des effectifs totaux, l'ESIC passant de 131 élèves en 1931-1932 à 47 en 1939-1940, puis 18 en 1940-1941 (voir graphique ).
19 Ces 16 étudiants de première année représentent les premiers élèves concernés par la mise en place de la réforme Travers. Les élèves de 2è et de 3è année de 1936-1937 appartenaient à l'ancien institut chimique et avaient été initialement recrutés au niveau baccalauréat. 20 Archives de Meurthe-et-Moselle, dossier 1T488. On pourrait expliquer l'augmentation du nombre de thèses par une prolongation des études en relations avec les problèmes de chômage de l'époque.
Rapport de Recherche
- 173 -
47
18
118
73 72
57
91
114
131
0
20
40
60
80
100
120
140
1931
-193
2
1932
-193
3
1933
-193
4
1934
-193
5
1935
-193
6
1936
-193
7
1937
-193
8
1938
-193
9
1939
-194
0
1940
-194
1
Évolution des effectifs globaux de l'Institut chimique de Nancy - ESIC21
En 1940, Travers pouvait faire un premier bilan de sa réforme. La première promotion de la nouvelle École comptait 14 élèves. Tous avaient obtenu, en plus de leur diplôme, le grade de licencié ès sciences physiques avec les trois certificats : physique générale, chimie générale, chimie physique, permettant l'accession au doctorat d'État. 5 avaient de plus obtenu le certifi-cat de mécanique rationnelle. Dans son rapport annuel à la direction de l'Enseignement tech-nique, Travers se félicitait de ce succès :
"Nous tenons à souligner l'importance de ces résultats presque uniques dans l'ensemble des grandes Écoles. Ils manifestent la solidité des études, que nous ne ferons que renfor-cer. Les stages industriels de vacances, malheureusement interrompus brusquement cette année par la guerre, avaient fourni des données encourageantes pour l'avenir des jeunes gens.
Le concours de 1939 a été d'un niveau particulièrement élevé, puisque dans la liste des admis (18), figuraient 2 candidats reçus en même temps à l'École Normale Supérieure, 5 candidats reçus en même temps à l'École Polytechnique (dont 4 dans les soixante pre-miers), 1 jeune fille reçue en même temps à Sèvres.
Tous ces résultats autorisent de solides espoirs pour l'avenir. […] Nous croyons que l'œu-vre à laquelle nous nous sommes entièrement dévoués doit réussir et porter ses fruits ra-pidement. De toutes les branches de l'Industrie Chimique on nous demande instamment des Ingénieurs de haute culture, possédant en même temps une forte technique. C'est pré-cisément là le but de tous nos efforts et c'est pourquoi nous vous serons reconnaissants de nous soutenir particulièrement dans cette période difficile". 22
On constate donc une grande satisfaction de la direction de l'école. La réforme Travers laissait augurer un changement net dans la pédagogie proposée et dans l'image de l'école vis-à-vis des candidats des classes préparatoires et de ses partenaires industriels. Ce qui était en jeu, c'était finalement le statut social des ingénieurs formés par l'école. Mais à quel prix ? Au-delà des aspects pédagogiques, il est possible de s'interroger sur l'équilibre financier de l'école. Quelle
21 Archives de Meurthe-et-Moselle, dossier 1T488. 22 Travers, Alexandre, Rapport à la direction de l'Enseignement technique, 28 février 1940, Archives de Meur-the-et-Moselle, dossier 1T488.
Genèse et Développement du Pôle Scientifique Nancéien
- 174 -
était la situation financière de l'institut chimique durant les années 1930 à l'orée de la Seconde Guerre mondiale ?
Chaque année, l'école était tenue de faire parvenir à la direction de l'Enseignement technique de la préfecture de la Meurthe-et-Moselle un document faisant état de sa situation budgétaire pour l'année écoulée. Ce dossier contenait des éléments concernant le budget de l'école et ses ressources propres. Il fournissait le détail des dépenses effectuées et était évalué par l'inspec-teur de l'enseignement technique. L'examen de ces dossiers permet de se faire une idée assez précise du mode de fonctionnement de l'institution pour la période 1934-1943.
Le tableau ci-dessous donne le détail des recettes et des dépenses déclarées par l'école auprès de la direction de l'Enseignement technique. Les chiffres indiqués ne tiennent pas compte des reliquats des années écoulées. Nous avons mentionné la part occupée par la taxe d'apprentis-sage dans le volume total des recettes mais sans prendre en compte le reliquat indiqué pour l'année précédente. On constate d'abord que de 1934 à 1937-1938, la répartition des recettes et des dépenses demeura à peu près équilibrée ; dans les premières années, le budget de l'école accusait un léger déficit fonctionnel, la somme des dépenses pouvant être légèrement supé-rieure à la somme des recettes (déficit d'ailleurs compensé par le reliquat des années passées). À partir de 1938-1939, on constate une très nette diminution des dépenses et un maintien, voire une augmentation des recettes ; la situation exceptionnelle de l'année 1942-1943 (recet-tes de 668.340 F. - dont 241.415 F. de taxe d'apprentissage - et dépenses de 642.998 F.) s'ex-plique probablement par un report des crédits durant les premières années de la guerre, l'école étant fermée en 1940-1941 mais continuant, semble-t-il, de percevoir la taxe d'apprentissage.
Recettes Part de la taxe d'ap-prentissage dans les
recettes
Total dépenses
1934-1936 454.915 105.976 465.780
1935-1936 377.812 110.413 385.298
1936-1937 346.562 115.057 343.090
1937-1938 390.045 148.013 376.958
1938-1939 425.913 177.512 344.207
1939-1940 480.410 160.290 430.655
1940-1941 Pas d'info 149.550 Pas d'info
1941-1942 467.219 187.179 297.270
1942-1943 668.340 241.415 642.998
Évolution des recettes et dépenses de l'École supérieure des Industries chimiques de Nancy 1934-1943
Sur la période étudiée, la part de la taxe d'apprentissage dans le budget passa de 105.976 F. en 1934-1935 à 241.415 en 1942-1943. Si cette évolution est difficile à interpréter, on peut au moins mentionner que cette taxe représentait 23,3 % des recettes en 1934 et que ce pourcen-tage ne fit qu'augmenter jusqu'en 1938-1939, date à laquelle il était de 41,6 %. Durant les années suivantes, ce pourcentage fluctua entre 33,3 et 40 %.
L'École disposait à cette époque de deux sources principales de financement. D'une part, les recettes provenant de la gestion de l'école : elles découlaient quasiment uniquement des frais de scolarité (élèves de l'école, PCB, chimie générale, licence).23 D'autre part, les subventions :
23 En outre, chaque année, l'école recevait quelques milliers de Francs d'indemnités accessoires dues par les élèves, notamment les provisions pour casse de matériel. Pour des raisons évidentes, l'école ne tirait aucune ressource des sources de financement suivantes : frais de pension, revenus des capitaux, cotisations et revente des objets fabriqués par les élèves.
Rapport de Recherche
- 175 -
sur la période considérée, en tant qu'entité dépendant de la faculté des sciences, l'école obte-nait des subventions régulières des ministères de tutelle (en moyenne 155.000 F. par an).
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
1934
-1935
1935
-1936
1936
-1937
1937
-1938
1938
-1939
1939
-1940
1940
-1941
1941
-1942
1942
-1943
Total recettes
Total dépenses
Part de la taxe d'apprentissage
Détail des recettes et dépenses de l'Institut chimique de Nancy - ESIC pour la période 1934-1943
Ses revenus provenaient également d'autres sources plus ou moins régulières : gestion du laboratoire d'analyses, subventions pour les collections, analyses de gaz effectuées pour la ville, crédits spéciaux de l'État pour l'installation de matériel et subventions de la taxe d'ap-prentissage. Ces dernières représentaient bien sûr, la part essentielle de cette rubrique (le document ci-dessous donne un état des recettes de la taxe d'apprentissage pour l'année 1935).
Établissement Somme versée Compagnie Alais, Froges et Camargue 1.000 Établissements Gillet-Thaon 1.000 Établissements Kuhlmann 1.000 Société Française Fabrikoid 1.000 Société Nancéienne 1.000 Usines de Chaux à Xeuilley 1.000 Chambre de Commerce de Nancy 2.000 Compagnie Continentale du Gaz (Nancy) 2.000 Établissements, Fourneaux et Fonderies de Pont-à-Mousson 2.000 Société des Matières Colorantes et Produits Chimiques de Saint-Denis 2.000 Comité Interprofessionnel de l'apprentissage (Lille) 3.000 Société Anonyme des Ciments Français 3.000 Société Progil 4.000 Compagnie des Glaces et Verres Spéciaux du Nord de la France 4.500 Société des Pétroles Jupiter 5.000 Société Saint-Gobain à Varangéville 5.000 Usine Solvay et Cie (Dombasle) 5.000 Société des Produits Chimiques de et à Clamecy 5.500 Chambre Syndicale des Sels Gemmes (Nancy) 6.000 Société Rhône-Poulenc 10.000 Amis des Instituts (Nancy) 17.500
Genèse et Développement du Pôle Scientifique Nancéien
- 176 -
Détail des recettes de la taxe d'apprentissage de l'Institut chimique de Nancy en 193524
Le graphique suivant donne la répartition des recettes de subvention et de gestion de l'ESIC entre 1934 et 1943. Il permet de constater une baisse progressive des recettes liées à la gestion de l'école (frais d'inscription) et une augmentation non négligeable des recettes liées aux sub-ventions (dont la taxe d'apprentissage). La part des subventions dans les recettes passa de 52,3 % en 1934-1935 à 68,2 % en 1941-1942 et à 58,3 % en 1942-1943.
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
1934
-1935
1935
-1936
1936
-1937
1937
-1938
1938
-1939
1939
-1940
1940
-1941
1941
-1942
1942
-1943
Gest ion École
Subvent ions
Dont t axe d'apprent issage
Répartition des recettes de l'Institut chimique de Nancy - ESIC pour la période 1934-194325
Gestion École Subventions Dont taxe d'ap-prentissage
1934-1935 203.711 238.018 105.976
1935-1936 180.982 196.830 110.413
1936-1937 160.800 185.762 115.057
1937-1938 145.110 241.463 148.013
1938-1939 133.795 272.796 177.512
1939-1940 104.344 294.370 160.290
1940-1941 École fermée École fermée 149.550
1941-1942 66.400 318.489 187.179
1942-1943 108.407 389.935 241.415
Répartition des recettes de l'Institut chimique de Nancy - ESIC pour la période 1934-194326
24 Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle, dossier 1T488. On notera l'importante subvention (17.500 Francs) de l'Association des Amis de l'Institut. Ce tableau ne prend en compte que les subventions égales ou supérieures à 1.000 F. 25 Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle, dossier 1T488. 26 Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle, dossier 1T488. Les brusques augmentations des subven-tions et de la taxe d'apprentissage dans les années 1941-1943 correspondent probablement à un report de crédits non utilisés durant la période de la fermeture de l'école en 1940-1941. On notera d'ailleurs que durant cette année de fermeture, l'école semble continua apparemment à recueillir cette taxe d'apprentissage.
Rapport de Recherche
- 177 -
À partir du tableau précédent, il est possible de comparer l'évolution des recettes de gestion et des recettes de subventions. Il apparaît nettement que les recettes liées aux droits payés par les élèves présentent une baisse continue sur l'ensemble de la période alors que les subventions ne font qu'augmenter. La chute brutale qui marque l'année 1940-1941 correspond à une période de fermeture de l'école en raison de la guerre (graphique ci-dessous).
0
50000100000
150000
200000250000
300000
350000400000
450000
1934
-193
5
1935
-193
6
1936
-193
7
1937
-193
8
1938
-193
9
1939
-194
0
1940
-194
1
1941
-194
2
1942
-194
3
Recettes de gestion
Recettes de subventions
Évolution comparée des recettes de gestion et de subvention de l'Institut chimique de Nancy - ESIC entre
1934 et 194327
La chute des recettes de subvention ne fut peut-être pas aussi radicale car l'ESIC continua à percevoir la taxe d'apprentissage durant cette année. Le graphique ci-dessous donne par ail-leurs une indication du rapport entre les subventions diverses reçues par l'école (ministères, département, etc.) et la collecte de la taxe d'apprentissage. On peut supposer que la chute des recettes de gestion liées à la mise en place de la réforme Travers fut compensée par une aug-mentation relative des subventions et par une amélioration du taux de récupération de la taxe d'apprentissage (et donc une amélioration des relations industrielles de l'école).
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
1934
-193
5
1935
-193
6
1936
-193
7
1937
-193
8
1938
-193
9
1939
-194
0
1940
-194
1
1941
-194
2
1942
-194
3
To utes les subventio ns sauf TA
Taxe d'apprentissage
Évolution de la taxe d'apprentissage perçue par l'Institut chimique de Nancy - ESIC entre 1934 et 194328
27 Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle, dossier 1T488.
Genèse et Développement du Pôle Scientifique Nancéien
- 178 -
Enfin, le graphique ci-dessous fournit des éléments de réflexion sur la répartition des dépen-ses. Sur la période étudiée, on constate nettement que les dépenses de personnel n'évoluèrent que très peu et accusèrent même une légère diminution jusqu'en 1942. À l'inverse, les dépen-ses de matériel étaient variables d'une année à l'autre tout en demeurant toujours supérieures à celles concernant le personnel. On constate également que l'année 1942-1943 fut marquée par une augmentation importante, liée en partie à celle des prix des produits chimiques durant la guerre.
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
1934
-193
5
1935
-193
6
1936
-193
7
1937
-193
8
1938
-193
9
1939
-194
0
1940
-194
1
1941
-194
2
1942
-194
3
Dépenses personnel
Dépenses matériel
Répartition des dépenses de l'Institut chimique de Nancy - ESIC pour la période 1934-193529
Ces données semblent indiquer que durant cette période, l'ESIC parvenait à équilibrer son budget. La baisse liée au déficit d'étudiants était compensée par une augmentation des droits d'inscription et par un meilleur rendement de la taxe d'apprentissage. Cela signifie donc que les réseaux dont l'école disposait dans les milieux industriels étaient relativement actifs et on peut supposer que l'Association des Anciens jouait un rôle dans leur activation (peut-être par l'intermédiaire de Maurice Brulfer, dont nous reparlerons). Cependant, cet équilibrage ne se faisait pas sans problèmes. En effet, sur la période 1934-1943, on constate d'abord que l'école conservait d'année en année dans son budget un important reliquat (entre 80.000 et 180.000 F.) ; cette somme lui servait probablement de matelas de sécurité. Par ailleurs, comme toutes les écoles nancéiennes, elle connaissait des problèmes de fonctionnement : les procès-verbaux des conseils de la faculté des sciences sont régulièrement consacrés à des questions tout à fait prosaïques : les difficultés pour recruter du personnel compétent pour le secrétariat et la direc-tion des écoles, le financement de postes de chefs de travaux ou de préparateurs, les problè-mes de chauffage (les directeurs des écoles se plaignaient régulièrement de l'insuffisance des dotations en ce domaine), etc.
Pour terminer sur ces questions, on mentionnera un rapport sur le fonctionnement de l'école en 1942-1943. Probablement rédigé par Pierre Donzelot à l'attention du rectorat ou du minis-tère de l'Éducation nationale, ce rapport fournit de précieuses informations sur la situation pédagogique et financière de l'ESIC au milieu de la guerre. Du point de vue du recrutement Donzelot se félicitait de la reprise du fonctionnement de l'école dans des conditions normales
28 Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle, dossier 1T488. Les données pour 1939-1941 manquent dans les dossiers et sont donc des interpolations. 29 Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle, dossier 1T488.
Rapport de Recherche
- 179 -
de la bonne image dont bénéficiaient ses diplômés auprès du monde industriel.30 Après deux années de recrutement sur titres, l'école était revenue au principe du concours d'entrée, dans la continuité de la réforme Travers. Ces deux années avaient suffi à faire circuler auprès des professeurs et des élèves des classes spéciales l'image d'une école de seconde catégorie faci-lement accessible. Il fallait donc renverser le vapeur et revenir à l'orientation élitiste d'avant-guerre :
"[…] Nous avons décidé de reprendre, en 1943, la voie qu'il [Travers] avait suivie en 1936, 1937, 1938 et 1940. Nous avons toutefois apporté quelques modifications au concours, dans les coefficients des différentes épreuves. Nous avons augmenté ceux de physique et de chimie, ce qui est naturel pour une École de Chimie. Et nous avons tenu à ce que l'épreuve de français joue un rôle non négligeable. C'est en effet un sérieux crité-rium de culture et d'intelligence".31
Du point de vue matériel, en revanche, la situation semblait beaucoup plus problématique. Le budget de 1943 prévoyait 828.000 F. de dépenses alors que l'école ne pouvait espérer plus de 325.000 F. de recette. De plus, la subvention ministérielle reçue par l'intermédiaire de l'uni-versité et de la faculté menaçait d'être réduite de 65.000 à 21.000 F., une somme nettement insuffisante pour prendre en charge les dépenses d'éclairage, de chauffage, de gaz et d'électri-cité. Enfin, même si le ministère avait autorisé la direction à compenser cette diminution par une augmentation des droits d'inscription, l'école ne fonctionnait pas à pleine capacité et la situation financière des familles des étudiants rendait impensable une nouvelle augmentation de ces droits. La priorité était donc à la recherche de nouvelles marges de manœuvres en ma-tière financière…
La fondation Scientifique des Industries Chimiques constitua manifestement une réponse à ces problèmes de financement.
III°/ La naissance de la Fondation et les années de guerre
A°/ L'ESIC dans la guerre
La déclaration de guerre de 1939 entraîna bien des difficultés au sein de l'ESIC. Dès septem-bre 1939, Nancy fut déclarée zone des armées ; enseignants et élèves furent alors mobilisés. Alexandre Travers demeura sur place avec quelques collègues non mobilisables (dont Pierre Donzelot et Pierre Courtot). Il était le chef du groupe de Nancy du Centre de la Recherche Scientifique et il tenta de faire œuvre utile en menant des recherches appliquées potentielle-ment utiles pour la recherche nationale. Les bouleversements de juin 1940 amenèrent le repli et la dispersion de ce centre.
À l'automne 1940, Nancy était isolée au sein d'une zone tampon qui allait des Ardennes au Jura et qui englobait la Lorraine. Par la force des choses, Travers s'était replié à Grenoble, Cornubert à Montpellier, Paul Lafitte à Toulouse et Donzelot à Poitiers. Seul Courtot était resté à Nancy et continuait à travailler dans son laboratoire. Progressivement cependant cer-tains enseignants de l'école parvinrent à revenir à Nancy et un enseignement reprit peu à peu. Il était impossible d'organiser un concours national à ce moment là. Par conséquent, dans un premier temps, Courtot organisa un recrutement sur titres parmi les étudiants de la faculté des
30 "La demande d'ingénieurs a été naturellement très supérieure à ce que l'école pouvait fournir. Plus de 30 demandes d'ingénieurs nous sont arrivées au cours des derniers mois, auxquelles nous n'avons pu répondre. Cet afflux de demandes vers notre École montre bien la haute estime qu'on a pour elle dans l'industrie". Donzelot, "Rapport sur le fonctionnement de l'école en 1942-1943", Archives de l'ENSIC, dossier Travers. 31 Ibidem.
Genèse et Développement du Pôle Scientifique Nancéien
- 180 -
sciences et les étudiants des classes spéciales de lycée : 12 élèves furent choisis sur dossier pour suivre les enseignements de l'école de 1940 à 1943. Un second concours sur titres fut organisé en 1941 et permit le recrutement de 23 élèves.32 L'école fonctionna ainsi pendant des mois dans des conditions plus que précaires.
Au début de l'année 1942, la situation administrative semblant s'améliorer, Travers put re-prendre la direction de l'école. Cependant, très rapidement, il manifesta le désir de se rappro-cher de sa région d'origine et il retourna donc à Lyon, puis à Clermont-Ferrand pour devenir responsable du centre de recherche des usines Michelin. C'est donc Pierre Donzelot qui lui succéda au cours de l'année 1942.33 En 1943, il parvint à rétablir un concours national de re-crutement, avec un certain succès (375 candidats). Dans le même temps, il s'occupa de pour-voir au remplacement des collègues partis vers d'autres fonctions. Il recruta ainsi Maurice Letort pour perpétuer les recherches de cinétique physique menées auparavant par Lafitte34 (pour ce faire il parvint à convaincre Letort, alors enseignant à l'université de Caen, de venir s'installer dans la zone interdite de l'Est ; Letort le suivit, accompagné de son assistant Xavier Duval).35
B°/ Les initiateurs du projet
Il semble que l'idée de créer une Fondation scientifique des industries chimiques ait pris nais-sance durant les mois de mai-juin 1943. Divers documents attestent que ce projet émergea suite à des suggestions du Comité des anciens élèves de l'école, d'industriels de la chimie et de responsables de firmes locales. L'examen attentif des pièces d'archives permet de constater que le noyau des porteurs de ce projet était initialement restreint à quelques personnes : Phi-lippe Aubertin, alors gérant de la Société Solvay à Paris, Pierre Donzelot, au titre de directeur de l'École de chimie de Nancy et Maurice Brulfer, ancien élève de l'école.
La première réunion attestée de la Fondation eut lieu le 10 juin 1943. Réunissant un comité restreint d'industriels, elle visait avant tout à former le noyau dur de la Fondation et, par conséquent, à s'appuyer sur des personnes déjà acquises à la cause. C'est Maurice Brulfer qui présenta alors le sens de la Fondation. Philippe Aubertin (Société Solvay) en fut élu président et deux membres (Brulfer et Donzelot) furent désignés pour l'expédition des affaires couran-tes, notamment la réalisation des démarches administratives en vue de la reconnaissance insti-tutionnelle de la Fondation.36 Étaient présents à cette réunion des représentants des sociétés suivantes : Solvay (Philippe Aubertin), Cie Alais, Froges et Camargue (Raoul de Vitry d'Avaucourt), Rhône-Poulenc (Marcel Bô), Cie des Mines de Bruly (Hermann), PROGIL (Maurice Brulfer), Société des Produits Chimiques de Clamecy, Établissements Bruder d'Ar-ches (Bruder), Établissements Ducancel à Reims (Hébert), Établissements Dauvergne à Meaux, Produits chimiques de Ribecourt, Société Gillet-Thaon.
32 Archives de la Faculté des sciences de Nancy, procès-verbaux du Conseil de la Faculté des sciences, séance du 18 mars 1941. 33 Celui-ci était revenu à Nancy en même temps que Lafitte en novembre 1941. Archives de la Faculté des scien-ces de Nancy, Procès-verbaux du conseil de la Faculté des sciences, séance du 14 novembre 1941. 34 Lafitte déplaça son laboratoire à Paris. Après la guerre, il fut président de la Société chimique de France (1961) ainsi que membre de l'Académie des sciences. 35 Letort fut élu sur la chaire de chimie minérale de la faculté des sciences en novembre 1942. Archives de la Faculté des sciences de Nancy, Procès-verbaux du conseil de la faculté des sciences, séance du 19 novembre 1942. 36 Compte-rendu de la réunion du 10 juin 1943, Archives de l'ENSIC, chemise "Fondation divers".
Rapport de Recherche
- 181 -
Les motivations pour la création d'une telle fondation se situaient à deux niveaux : un niveau financier d'une part et un niveau de représentation institutionnelle et symbolique d'autre part. D'un point de vue financier, l'enjeu était bien évidemment de trouver des fonds pour assurer le développement de l'école et la maintenir au niveau des autres institutions de formation et de recherche. Cependant, il était aussi d'assurer le maintien de la position institutionnelle et sym-bolique de l'école en montrant, par exemple, qu'elle bénéficiait encore du regard bienveillant et du soutien de l'industrie locale et nationale. Dans cette perspective, il s'agissait de s'inscrire dans le prolongement d'une histoire remontant à la fondation de l'école et sollicitant les noms d'Arth, Guntz ou Haller. Cette stratégie de retour aux origines apparaissait très clairement dans la procédure élaborée pour faire connaître ce projet et susciter des soutiens.
Le 22 juin 1943, J. de Laucardière, secrétaire de l'Association amicale des anciens Élèves de l'Institut chimique et de l'École supérieure des Industries chimiques de Nancy, écrivait une lettre à Donzelot dans laquelle il lui faisait parvenir une liste des premiers fondateurs de l'ins-titut chimique, avant la Première Guerre mondiale.37 Cette liste était en fait destinée à faire partie du dossier envoyé à d'éventuels souscripteurs de la Fondation, dossier qui comprenait en outre un argumentaire insistant sur le poids du passé et les enjeux du présent. Il s'agissait de mobiliser les souscripteurs du passé pour aider une vénérable maison à maintenir son rang et mener à bien ses projets de modernisation. Les anciens maîtres étaient donc sollicités tout comme le vivier des classes préparatoires (dans le contexte d'une concurrence avec l'École des Mines de Nancy, l'objectif principal de la réforme Travers était de parvenir à recruter sur concours) :
"Lors d'une souscription faite en faveur de l'institut chimique, fondé par le regretté Pro-fesseur Haller, membre de l'Institut, et dirigé, après sa nomination à la Sorbonne, par MM. ARTH, GUNTZ et TRAVERS, vous avez, vers 1900, participé aux frais d'extension de cet Institut, et à l'Édification du bâtiment n° 2, où se trouvent aujourd'hui les laboratoi-res de Chimie organique industrielle, de Chimie minérale et de Chimie-physique [no-tamment la création du laboratoire d'électrochimie].
L'évolution de la Science chimique et de l'Industrie Chimique, les modifications dans leurs besoins, et l'élévation générale du niveau des connaissances nécessaires, ont amené la direction de l'institut chimique à envisager une transformation qui a été effectuée en 1936. Depuis cette date, les élèves sont recrutés au concours, le programme des connais-sances exigées étant le même que le programme d'admission à Polytechnique. On peut dire aujourd'hui, sept années plus tard, que cette formule a réussi.
Par ailleurs, l'ancien Institut chimique de Nancy, devenu ÉCOLE SUPERIEURE DES INDUSTRIES CHIMIQUES de Nancy, a vu ses locaux transformés et remis à neuf, l'ou-tillage de ses laboratoires modernisé, grâce à l'appui du ministère de l'Éducation nationale et du Centre de la Recherche Scientifique. Il semble qu'au sortir de la grande crise qui a suivi 1930, la vieille et sympathique Maison, rajeunie, était bien préparée à continuer la glorieuse tradition qu'avait créée l'institut chimique, et ses Maîtres".38
La référence historique renvoyait aux premières années de l'institut chimique et notamment à la grande souscription lancée par Albin Haller auprès du monde industriel pour construire et équiper un Institut de chimie physique et d'électrochimie. Trois années plus tard, cette sous-cription avait permis de lever près de 300.000 F., la subvention la plus importante provenant
37 Archives de l'ENSIC, chemise "Fondation scientifique des industries chimiques". Lettre datée du 22 juin 1943 (sous-chemise "Premiers projets"). 38 Archives de l'ENSIC, chemise "Fondation scientifique des industries chimiques" (sous-chemise "Premiers projets").
Genèse et Développement du Pôle Scientifique Nancéien
- 182 -
d'Ernest Solvay. La ville de Nancy avait offert un terrain le long de la rue Sellier sur lequel on avait pu construire une nouvelle série de laboratoires, un amphithéâtre et deux grandes salles techniques (l'une contenant des générateurs électriques, l'autre destinée à la teinture et à l'im-pression des tissus).
En fait, ces références historiques demeuraient relativement incomplètes. En effet, les cons-tructions et rénovations auxquelles le dernier paragraphe du texte faisait référence s'inscri-vaient dans le cadre de la politique du plan d'outillage national puis le fonds des grands tra-vaux du Front Populaire. Autrement dit, un certain nombre de ces infrastructures avaient été principalement financées par l'État. Cependant, dans le cadre d'un argumentaire destiné à lever des fonds privés, il n'était pas de bon ton de rappeler ce fait de manière trop évidente.
La suite de l'argumentaire portait sur les enjeux présents et futurs de la recherche et de la formation en chimie. Dans la continuité de la réforme Travers, l'école supérieure des indus-tries chimiques avait pour ambition de se situer au même niveau que le concours de l'École polytechnique ou que l'école centrale et avait l'obligation d'offrir des bourses aux étudiants recrutés. De plus, l'État ne pouvait assurer seul le maintien de son 'standing scientifique' :
"Mais les conditions du nouveau recrutement d'une part, qui nous ont amené une grande majorité de jeunes gens issus des classes les plus modestes, et d'autre part, les frais énor-mes qu'entraîne aujourd'hui la recherche scientifique si on veut la faire dans l'esprit qui convient à la grande École d'un grand Pays, ont créé des besoins d'argent qu'il est facile de justifier :
a) Les étudiants, entre le Lycée et l'agrégation, n'ont pas la possibilité de demander des bourses de scolarité, sauf rares exceptions. L'École Polytechnique, l'École Centrale, les Écoles des Mines, l'École Normale Supérieure disposent d'un budget dans ce but. Il serait normal, moral et profitable aux intérêts de la grande famille chimique, que de telles bour-ses soient créées de façon stable à l'école supérieure des industries chimiques.
b) L'État assure ce qu'on peut appeler le fonctionnement normal des cours et laboratoires. Mais si l'on veut que l'école supérieure des industries chimiques garde et accroisse son standing, beaucoup d'autres dépenses sont à envisager dont il n'est pas d'usage que l'État assure la couverture. Tels sont, les voyages d'études en France ou à l'étranger, certains cours spéciaux indispensables, des conférences par les plus grands spécialistes, des bour-ses de recherche dirigées, etc…"39
Cet argumentaire est intéressant à plus d'un titre. On voit d'une part toute l'importance institu-tionnelle et symbolique accordée à la réforme Travers. Les grandes lignes de la réforme avaient été posées en 1936 mais les vicissitudes de la guerre avaient empêché sa pleine appli-cation. D'après la plupart des témoignages, Donzelot souhaitait nettement perpétuer cette réforme et favoriser un modèle élitiste de recrutement traditionnel. Dans cette perspective, la Fondation devait financer l'installation de la réforme à travers l'octroi de bourses aux étu-diants.40 D'autre part, on peut constater qu'il est fait une distinction concernant le financement d'une école comme l'ESIC : d'un côté, on mettait en avant le fait que l'État avait vocation à soutenir le fonctionnement normal de l'école en finançant les cours et les laboratoires ; d'un autre côté, un tel financement était insuffisant pour maintenir le standing national et interna-
39 Archives de l'ENSIC, chemise "Fondation scientifique des industries chimiques" (sous-chemise "Premiers projets"). 40 Cette justification de la création d'une Fondation pour le développement de bourses d'études relèverait-il de la clause de style ? Ce qui semble avéré c'est qu'en 1948, d'après les rapports de fonctionnement dont nous dispo-sons, les bourses d'étudiants représentaient un peu plus de 10 % des dépenses de la Fondation. Voir le tableau page 205.
Rapport de Recherche
- 183 -
tional de l'école (voyages d'étude, construction de cours spéciaux, bourses de recherche, etc.) et il semblait naturel qu'elle se tourne vers des financements privés offerts par des partenaires industriels. L'ESIC ne faisait en cela que retrouver son histoire ancienne ; elle suivait par ailleurs le mouvement amorcé depuis plusieurs années par les autres écoles d'ingénieurs nan-céiennes, qui avaient pratiquement toutes associé le monde industriel à leur développement par le biais de fondations. En revanche, comme nous le verrons, cette séparation des attribu-tions en 'financement normal' et 'financement exceptionnel' devait déboucher sur quelques confusions notables, le fonctionnement de la Fondation n'étant pas totalement conforme à l'orthodoxie comptable de l'université.
Sur la base de cet argumentaire, le dossier se concluait sur l'annonce de la création d'une Fon-dation scientifique des industries chimiques à l'École supérieure des Industries chimiques de Nancy, pour aider la direction de l'école dans la réalisation de ses projets. Du point de vue du mode de fonctionnement, il était envisagé que tout membre fondateur verse une cotisation pour l'année 1943 et s'engage à continuer ses versements pour une durée de 5 ans. Outre cette cotisation, chaque souscripteur pouvait contribuer, de manière régulière ou exceptionnelle, à l'alimentation du fonds de réserve de la Fondation.
D'un point de vue officiel, cet argumentaire avait une double destination : il s'agissait, d'une part, de convaincre les industriels de contribuer financièrement à cette association et, d'autre part, de préparer le dossier de reconnaissance de l'association par les autorités préfectorales de l'époque. Cependant, en filigrane, il serait possible de lire cette initiative comme une tentative de normalisation et de contractualisation des relations de l'école avec ses partenaires indus-triels. Un décret de 1920 prévoyait en effet la création de conseils de perfectionnement dans les universités et les instituts qui en dépendaient. Ces conseils avaient pour vocation d'institu-tionnaliser et de pérenniser les contacts avec le monde industriel par le biais d'une représenta-tion de ses acteurs. Toutes les autres écoles nancéiennes faisaient participer des acteurs indus-triels à l'évolution de leurs formations ? L'ESIC n'avait-elle tenu aucun compte de ces obliga-tions légales ?41
Durant le mois de juin 1943, les choses se mirent rapidement en place. Prenant vraisembla-blement appui sur l'argumentaire et tirant parti de certains contacts dans les milieux indus-triels, les promoteurs de la Fondation parvinrent à obtenir le soutien de 22 sociétés (qui devin-rent ainsi membres de l'association). Parmi ces premiers souscripteurs on compte de très grandes entreprises, comme la Société Solvay, la Société des Usines Chimiques Rhône-Poulenc, les établissements Kuhlmann ou la Société des Produits Chimiques de Clamecy.42 Une première version des statuts fut rédigée à la même époque ; elle fut soumise aux autorités en vue d'obtenir un agrément et elle servit de cadre pour le fonctionnement de l'association. Le dossier déposé à la préfecture recensait 31 membres souscripteurs. On remarquera qu'il s'agissait de sociétés d'envergure nationale :
41 Nos n'avons pas trouvé de trace de l'existence d'un conseil de perfectionnement avant 1947, année de création des ENSI et, donc du changement de statut de l'ESIC en ENSIC. 42 Première version des statuts de la Fondation. Archives de l'ENSIC, chemise "Fondation scientifique des indus-tries chimiques" (sous-chemise "Fondation Création Pièces Secondaires").
Genèse et Développement du Pôle Scientifique Nancéien
- 184 -
Compagnie des Produits Chimiques et Électrométallur-giques, Alais, Froges et Camargue
Société d'Électrochimie et d'Électrométallurgie et Aciéries Électriques d'Ugine
Société Anonyme des Matières Colorantes et Produits Chimiques Francolor
Société Pyrénéenne des Carburants et Solvants Société des Produits Chimiques de Clamecy Société des Usines Chimiques Rhône-Poulenc Société Industrielle des Schistes Bitumeux de l'Aveyron Société de Carbonisation et des Charbons Actifs Établissements Kuhlmann Comptoir Linier Thibaud, Gibbs et Cie Société Bozel-Maletra Société Clément et Rivière Brueder et Cie
Sociétés Huiles, Goudrons et Dérivés Société Les Écrans Radiologiques
Établissements Georges Dauvergne Société Parra-Mantois
Produits Chimiques de Ribécourt Grands Moulins de Paris
Produits du Lion Noir Compagnie de Saint-Gobain
Compagnie des Mines de Bruay Teinturerie Clément Marot
Société Française Fabrikoid Société Gillet-Thaon
Comptoir des Textiles Artificiels Société Solvay et Compagnie
Pierre Hébert Louvroil
Liste des membres de la Fondation en septembre 194343
Les motivations affichées pour la création de la Fondation étaient les suivantes : "développer l'étude de la Chimie à l'École supérieure des Industries chimiques de Nancy, et favoriser la formation d'Ingénieurs-Chimistes à ladite École".44 Les premiers articles des statuts indi-quaient les moyens envisagés pour remplir ces objectifs. L'article I mentionnait ainsi que le but de l'association était "de développer, à l'École supérieure des Industries chimiques de Nancy, l'enseignement et les recherches appliquées aux Industries de la Chimie, la mise en œuvre de tous les moyens propres à améliorer ses procédés, à perfectionner son outillage, à favoriser l'essor de cette Industrie dans l'intérêt général du Pays". L'article 4 mentionnait ex-plicitement les moyens d'action de la Fondation pour réaliser ses objectifs :
"(1) Créer ou subventionner des cours, conférences, laboratoires et diverses entreprises de recherche au sein de l'École ;
(2) Accorder des bourses d'études, de recherches ou de voyage d'études aux élèves et au personnel et développer des systèmes de prix et de récompenses ;
(3) Mettre en place un programme de rénovation ou de construction de locaux ;
(4) Donner à l'École les moyens financiers pour réaliser les buts et opérations prévues par la fondation, à savoir favoriser (a) l'enseignement et les recherches à l'école supérieure des industries chimiques, pour permettre la formation à l'École d'Ingénieurs-Chimistes de haute qualité, aptes à constituer une élite, où seront puisés les Chefs et les Cadres de l'In-dustrie Chimique ; (b) la poursuite à l'École de recherches et d'essais tendant au progrès de la Chimie française".
Cette première déclaration de statuts était accompagnée d'une liste des membres du Bureau. Occupation oblige, les documents devaient être visés par les autorités allemandes pour obtenir leur agrément. Les formalités d'agrément étaient obligatoires pour toutes les associations existantes ou en cours de création (sauf pour les associations sportives) et elles obéissaient à un protocole très strict. Il fallait ainsi adresser à la préfecture ou à la Sous-préfecture, par l'intermédiaire du maire, un dossier comprenant différentes pièces : texte des statuts en fran-çais et en allemand signé par tous les membres du comité, liste de tous les membres, liste des membres du comité avec indication de leur état-civil, déclaration en français et en allemand et
43 Ibidem. On notera que Maurice Brulfer semblait, de par ses contacts et ses responsabilités, impliqués dans plusieurs de ces entreprises. 44 Première version des statuts de la Fondation. Archives de l'ENSIC, chemise "Fondation scientifique des indus-tries chimiques" (sous-chemise "Fondation Création Pièces Secondaires").
Rapport de Recherche
- 185 -
signée de tous les membres du comité attestant que l'association ne poursuivait pas d'autres buts que ceux indiqués dans les statuts.
Le dossier envoyé par Donzelot et ses collègues se conformait à ces obligations. On y trouvait donc une liste détaillée des membres du Bureau avec des détails concernant leur état-civil.
� Pierre Donzelot, directeur de l'École supérieure des Industries chimiques de Nancy ;
� Philippe Aubertin, directeur général des Établissements Solvay pour la France ;
� Maurice Brulfer, directeur général de la Société Progil ;
� Édouard Husson, doyen de la Faculté des Sciences de Nancy ;
� Raoul de Vitry d'Avaucourt, président-directeur de la Compagnie des Produits Chimi-ques Alais, Proges et Camargue ;
� Joseph Frossard, président-directeur des Établissements Francolor ;
� Félix Lavaste, directeur général de la Compagnie Saint-Gobain ;
� Marcel Bô, directeur général de la Société Rhône-Poulenc.
Tous les membres du bureau furent obligés d'attester sur l'honneur de leur état-civil et de leurs origines aryennes.
Ces premiers statuts provisoires prévoyaient que la Fondation commencerait à fonctionner à partir du 1er janvier 1943, sous réserve de l'approbation gouvernementale (article 3). À cet effet, des dispositions transitoires furent mises en place : elles consistaient à donner tous pou-voirs à Aubertin, Brulfer et Donzelot afin de faire approuver les statuts et obtenir un décret de reconnaissance comme établissement d'utilité publique. Les trois hommes s'attelèrent à la tâche mais sans succès.
Le 4 août 1943, le préfet-délégué transmit au maire de Nancy le dossier constitué par l'asso-ciation 'Fondation scientifique des industries chimiques de Nancy'. Il lui demandait de donner son avis sur l'opportunité de la création d'une telle association. Le maire notait, dans la marge de ce document : "très favorable". Le préfet-délégué transmit l'ensemble du dossier de la Fondation à la Feldkommandantur 591 de Nancy le 11 août.45 Le 22 septembre 1943, la Si-cherheitspolizei de Nancy, qui avait établi ses quartiers à la préfecture de Nancy, donna son agrément à la création de la Fondation scientifique des industries chimiques. L'autorisation était libellée comme suit :
"En vertu des statuts présentés, la création de l'Association 'Fondation scientifique des in-dustries chimiques' est autorisée conformément au §8 de l'Ordonnance concernant les as-sociations, assemblées, insignes et le pavoisement en date du 28.8.40 (VO B1.F.S.76) dans les termes de l'ordonnance du II.8.42 (VO B1.F.S.435).
L'association 'Fondation scientifique des industries chimiques à l'École supérieure des In-dustries chimiques de Nancy' est ainsi autorisée à fonctionner dans le cadre des statuts ainsi que d'organiser des réunions de membres pour autant qu'elles seront nécessaires pour atteindre le but poursuivi par l'association.
Pour les assemblées publiques mon autorisation est toujours nécessaire. Les cortèges ainsi que le port d'insignes restent interdits. Je me réserve de retirer la présente autorisation à tout moment si l'association devait poursuivre des buts autres que ceux indiqués dans les statuts".
45 Compte-rendu de la réunion du 15 octobre 1943, Archives de l'ENSIC, chemise "Fondation divers".
Genèse et Développement du Pôle Scientifique Nancéien
- 186 -
C'est le préfet-délégué de Meurthe-et-Moselle qui notifia cette décision au maire de Nancy, lequel fut ensuite chargé de transmettre l'information à Donzelot.
Une fois l'agrément des autorités allemandes obtenu, l'étape suivante fut de lancer les démar-ches afin d'obtenir la reconnaissance d'utilité publique. Dans l'esprit de Donzelot et de ses collègues, la Fondation ne pouvait fonctionner que si elle parvenait à obtenir un tel statut. Ce statut particulier d'association reconnue d'utilité publique était inscrit dans la loi de 1901 ; il était destiné à permettre à des associations de percevoir des dons et legs tout en instituant un contrôle spécifique. Au-delà des discours symboliques sur les enjeux de formation et de re-cherche, la justification principale pour créer une fondation était de collecter des fonds pour financer le développement de l'école dans un contexte de crise budgétaire.46 La Fondation n'avait pas besoin de cette reconnaissance pour exister et pour fonctionner mais son obtention avait pour avantage d'offrir des réductions d'impôts à ses donateurs.
Le 9 novembre 1943, Donzelot adressa au préfet-délégué de Meurthe-et-Moselle une de-mande officielle de reconnaissance de la Fondation scientifique des industries chimiques comme association d'utilité publique.47 Cette demande était accompagnée d'un dossier com-plet présentant les objectifs de l'association, la liste de ses membres (qui était passée à 31) et les moyens dont elle disposait.48 Quelques jours plus tard, le maire de Nancy49 exprimait un avis favorable concernant cette reconnaissance et le dossier fut transmis (le 26 novembre) au ministre de l'Intérieur. Dans sa lettre au ministre, le préfet-délégué estimait que la reconnais-sance d'utilité publique était susceptible de favoriser les moyens d'actions de la Fondation et il émettait l'avis qu'il y avait lieu d'accueillir favorablement la demande en reconnaissance d'uti-lité publique et d'approuver ses statuts. La reconnaissance semblait ainsi n'être qu'une formali-té administrative et le préfet-délégué ne cachait pas son optimisme et son soutien à Donzelot.50
Deux mois plus tard, le 25 janvier 1944, ne disposant d'aucune information sur l'avancement du dossier, Donzelot adressa une lettre au préfet-délégué. Manifestement, le fonctionnement de la jeune association semblait bloqué, faute d'une réponse du ministère de l'Intérieur et Donzelot souhaitait pouvoir mettre rapidement sur pied un certain nombre de projets prévus de longue date. Cette lettre lui fournissait l'occasion de rappeler les motivations profondes de la création de la Fondation :
"Je vous avais exposé à ce moment [lors de sa visite à la préfecture en novembre 1943] tout l'intérêt qui s'attache à une solution relativement rapide de cette question, étant donné que le but unique de cette fondation est de verser des subventions à l'École supérieure des
46 Voir à ce sujet la lettre de Donzelot au préfet-délégué de Nancy en janvier 1944, page 186. 47 Compte-rendu de la réunion du 5 avril 1944, Archives de l'ENSIC, chemise "Fondation divers". 48 Archives de l'ENSIC, chemise "Fondation scientifique des industries chimiques" (sous-chemise "Fondation Pièces Officielles". Cette lettre ne fut probablement pas adressée directement au ministre mais passa par le cabinet du préfet de Meurthe-et-Moselle. 49 Il s'agissait alors de Camille Schmidt. Il céda ensuite sa place à Jean Prouvé en septembre 1944. C'est Donze-lot lui-même qui succéda ensuite à Prouvé le 18 mai 1945 et qui occupa la mairie jusqu'en mars 1946. 50 Dans une lettre du 30 novembre 1943, Donzelot écrivait ainsi au préfet-délégué : "Je tiens à venir vous remer-cier pour l'excellent accueil que vous avez bien voulu me faire lorsque je suis allé vous porter la demande de reconnaissance d'utilité publique de la Fondation scientifique des industries chimiques à l'École de Nancy. Vous avez compris tout l'intérêt qu'il y avait à résoudre cette affaire et je vous exprime toute ma reconnaissance pour la célérité, apportée grâce à vous, à la transmission de ces documents". Archives de l'ENSIC, chemise "Fonda-tion scientifique des industries chimiques" (sous-chemise "Fondation Pièces Officielles". Le dossier de candida-ture bénéficiait d'une procédure accélérée et on assurait ainsi à Donzelot qu'il obtiendrait une réponse dans un délai de 2 mois.
Rapport de Recherche
- 187 -
Industries chimiques de Nancy ; et que, par suite de la diminution des recettes normales et de l'augmentation vertigineuse des produits chimiques, verreries, appareils de laboratoires et traitement du personnel auxiliaire, les besoins de l'École sont immédiats. Par ailleurs, cette subvention permettra le fonctionnement d'organismes utiles ou indispensables à l'École (Cours spéciaux, conférences, etc.), et il importe de les mettre en œuvre aussitôt que possible.
Vous m'aviez indiqué qu'il était possible que dans un délai de deux mois la réponse soit revenue du ministère de l'Intérieur, étant entendu que du côté de la préfecture de Meur-the-et-Moselle vous aviez bien voulu réduire au minimum le temps nécessaire aux moda-lités exigées.
Puis-je, aujourd'hui, solliciter de votre bienveillance une intervention auprès du ministère pour que soit résolue la question d'autorisation et de reconnaissance d'utilité. Seule cette reconnaissance empêche aujourd'hui le fonctionnement de cette Fondation qui a déjà ré-uni les fonds mais qui ne pourrait en disposer qu'après l'approbation ministérielle".
Cette allusion à une collecte de fonds qui aurait déjà été réalisée est très importante. En effet, dans le dossier envoyé en novembre 1943, les responsables de la Fondation avaient joint une fiche descriptive présentant l'état des dépenses et des recettes de l'association. Celle-ci se présentait sous la forme d'une déclaration des trois fondés de pouvoir affirmant (a) que l'asso-ciation était en voie de constitution, (b) que son actif mobilier était représenté par les cotisa-tions annuelles de ses membres et (c) que l'association, n'ayant pas encore fonctionné, il ne lui était possible que d'indiquer l'état des premiers versements et dépenses entraînées par la cons-titution de la Fondation. Cette déclaration était accompagnée d'une description des actifs mo-biliers et immobiliers de la Fondation qui se présente de la manière suivante :
Dépenses Recettes
Frais de secrétariat 12.750 Cotisations 1943 437.500
Frais de constitution 11.830 Cotisations 1944-1945 et 1945-1947 (versées d'avance)
204.000
Disponible 615.920
641.500 641.500
Actif mobilier………Frs : 615.920
Actif immobilier………néant51
En d'autres termes, avant même d'avoir obtenu l'autorisation de fonctionnement, l'association disposait déjà d'un important budget et avait obtenu de certains de ses membres qu'ils versent leurs cotisations des quatre années suivantes par anticipation. Ce fait témoigne de l'efficacité des administrateurs de la Fondation. À ce stade, si on peut comprendre la stratégie de l'école pour obtenir des fonds de fonctionnement et d'investissement, il est plus difficile de compren-dre ce qui motivait les industriels à participer aussi activement à cette fondation. Quels étaient leurs intérêts ? Ceux-ci étaient-ils identiques à ceux de l'école ? Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point.
Le 17 mars, une réponse négative du ministère de l'Intérieur fut envoyée au préfet-délégué de Meurthe-et-Moselle. Elle était signée du sous-directeur des Cultes et Associations, sous cou-
51 Archives de l'ENSIC, chemise "Fondation scientifique des industries chimiques" (sous-chemise "Fondation Pièces Officielles").
Genèse et Développement du Pôle Scientifique Nancéien
- 188 -
vert de Pierre Laval, alors Président du Conseil du gouvernement de Vichy (avec le porte-feuille de l'Intérieur depuis 1942) :
"Il importe, au préalable, de pouvoir examiner utilement la demande en reconnaissance d'utilité publique présentée par la Fondation scientifique des industries chimiques de l'École supérieure des Industries chimiques de Nancy, de préciser nettement le caractère juridique que ses dirigeants entendent lui donner. Les statuts proposés s'apparentent plus, en effet, à l'organisation d'un établissement qu'à la constitution d'une association liant en-tre elles des personnes physiques, des personnes morales et des sociétés industrielles ou commerciales. Les modalités de fonctionnement de l'établissement s'éloignent en outre très sensiblement de celle d'une association et, pour éviter toute confusion dans l'esprit des animateurs de l'institution ainsi que dans la constitution du dossier nécessaire, vous voudrez bien leur faire tenir les statuts types ci-joints où ils trouveront les éléments né-cessaires à la détermination juridique de l'œuvre qu'ils désirent créer.
Toutefois, s'il s'agit bien dans leur esprit d'une association, et, dans ce cas, la nomencla-ture des pièces à fournir est indiquée aux statuts types ainsi qu'aux articles 8 et suivants du décret du 16 août 1901, il importe de signaler au Président qu'il se méprend sur la por-tée de la reconnaissance d'utilité publique qu'il paraît considérer comme une condition préalable au fonctionnement de l'Association. Non seulement celle-ci en tant qu'associa-tion déclarée peut fonctionner dès maintenant, mais encore serait-il souhaitable qu'elle le fît. […] Il serait également utile d'indiquer, à cet égard, quelles sont les ressources du Groupement qui, bien que comptant 31 membres seulement, fait état de cotisations s'éle-vant à 437.500 francs pour 1943 et de préciser également pour quel motif il a récupéré, dès maintenant au titre des quatre années à venir, 204.000 francs de cotisations. [Comme on le verra, affirmer que l'association avait déjà collecté des financements fut une erreur stratégique].
D'autre part, les dirigeants devront apporter tous les éléments de faits propres à établir que leur institution continue, quoique sous une forme juridique différente, l'activité de l'institut chimique fondé à Nancy en 1889. À ce titre, il serait nécessaire déterminer les rapports de l'Association avec l'Université de Nancy. Comme en outre il est permis de présumer que l'École supérieure des Industries chimiques de Nancy, qui a elle-même suc-cédé à l'institut chimique, possédait un matériel scientifique d'une certaine valeur, il y au-rait intérêt à savoir si l'Association l'a recueilli, auquel cas sa valeur devrait figurer sur l'état de l'actif."52
Cette réponse est révélatrice d'un malentendu à plusieurs niveaux. D'une part, les responsables de la Fondation étaient persuadés d'avoir obligatoirement besoin de la reconnaissance d'utilité publique pour faire fonctionner l'association. Ce premier malentendu peut être interprété de deux manières. On pourrait penser d'une part qu'il ne s'agissait là que d'une simple mécon-naissance des règles régissant le droit associatif. D'autre part, on pourrait également considé-rer que cette volonté de reconnaissance s'appuyait sur la volonté forte d'assurer une parfaite visibilité institutionnelle auprès d'éventuels bailleurs de fonds. Ce malentendu n'allait pas cependant jusqu'à les empêcher de collecter des cotisations. En revanche, Donzelot et ses collaborateurs auraient pu s'éviter cette réponse négative s'ils avaient consulté le détail de la loi de 1901, notamment l'article régissant la reconnaissance d'utilité publique. L'article 10 du titre II de la loi de 1901 stipulait en effet que "les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'État à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans".
52 Lettre du 17 mars 1944. Archives de l'ENSIC, chemise "Fondation scientifique des industries chimiques" (sous-chemise "Fondation dossier principal").
Rapport de Recherche
- 189 -
D'autre part, la référence insistante à l'histoire de la fondation de l'institut chimique semblait mal comprise par le ministère : pour les chargés de pouvoir de la Fondation, cet appel à l'his-toire avait surtout valeur symbolique et culturelle. Pour les autorités ministérielles, une telle référence était interprétée dans une perspective administrative et patrimoniale : quel lien juri-dique la Fondation entretenait-elle avec l'école dont elle était l'émanation ? Ces deux entités bénéficiaient-elles d'un patrimoine commun ? Comment les cotisations prélevées devaient-elles être utilisées et étaient-elles ajoutées aux actifs de l'école ? Sur quelles bases s'établis-saient les relations entre la Fondation nouvellement créée et la Fondation historique dont elle se réclame ? Telles étaient les questions qui semblaient sous-tendre les remarques du minis-tère ; et elles étaient d'autant plus essentielles que le prélèvement anticipé des cotisations avait doté l'association de fonds non négligeables.
Dans cette perspective juridique, il n'était donc guère étonnant que le ministère s'interrogeât sur le caractère pertinent du statut d'association, le mode de fonctionnement et les objectifs poursuivis s'apparentant plus à ceux d'une entreprise que d'une association. N'y avait-il pas une confusion entre différentes sphères, un mélange des genres ? En tout état de cause, la finalité de cette association ne lui semblait pas claire. Est-il possible que ce flou ait été entre-tenu volontairement par les administrateurs de l'école ? C'est là une hypothèse envisageable si l'on tient compte du parcours et de la personnalité de Donzelot et l'on se demandera par la suite si la création de la Fondation ne fut pas en partie motivée par une volonté de camoufler des étudiants et de les soustraire au Service du Travail Obligatoire (STO).
Le 30 mars 1944, le préfet-délégué écrivit à Donzelot pour lui faire part de la réponse du ministère. Il citait in extenso la lettre du sous-directeur des Cultes et Associations et il insistait sur la nécessité de clarifier le statut véritable de la Fondation : "Je vous serais obligé de vou-loir bien, après examen de la question, me faire connaître s'il s'agit d'une association ou d'un établissement et me fournir également, les autres précisions demandées".53 Le 5 mars la Fon-dation se réunit et prit acte de ce refus ; décision fut prise de reporter à plus tard les démarches en vue de l'obtention de la reconnaissance d'utilité publique, étant entendu que l'association avait d'ores et déjà la possibilité de fonctionner :
"Il semble que le Chef du Gouvernement se soit mépris sur le caractère exact de l'Asso-ciation ; des démarches devront être entreprises pour l'éclairer davantage. Il est à retenir dès maintenant, toutefois, que l'association déclarée peut fonctionner et que, d'autre part, une pratique d'administration constante exige que toute Association sollicitant la recon-naissance d'utilité publique ait un minimum de trois ans d'existence. Étant donné la situa-tion générale et les difficultés sans cesse croissantes, il paraît sage de remettre à une autre époque la poursuite des démarches demandant la reconnaissance d'utilité publique".54
À ce stade on peut se demander si la situation de l'école supérieure des industries chimiques constitue un cas véritablement isolé dans le paysage universitaire nancéien. En réalité, il s'avère que de ce point de vue, les autres écoles d'ingénieurs de Nancy avaient depuis des années leurs propres fondations. Ainsi, l'École Supérieure des Mines de Nancy disposait de-puis très longtemps d'une Fondation de la Métallurgie et de l'Industrie des Mines Françaises. De la même manière, il existait une Fondation de l'Industrie à l'Institut d'Électrotechnique et de Mécanique appliquée de Nancy ; et l'École de Brasserie et de Malterie de Nancy appuyait son développement sur une Fondation de la Brasserie et de la Malterie Française. Toutes ces
53 Lettre du préfet délégué à Donzelot, 30 mars 1944. Archives de l'ENSIC, chemise "Fondation scientifique des industries chimiques" (sous-chemise "Fondation dossier principal"). 54 Compte-rendu de réunion, 5 avril 1944 (rédigé par Aubertin). Archives de l'ENSIC, chemise "Fondation scientifique des industries chimiques" (sous-chemise "Fondation divers").
Genèse et Développement du Pôle Scientifique Nancéien
- 190 -
fondations existantes avaient été reconnues d'utilité publique et elles étaient tenues de rendre compte annuellement de leurs activités budgétaires aux autorités préfectorales (plus précisé-ment à la Direction de l'Enseignement technique).55 Ce retard relatif de l'ESIC est paradoxal à plus d'un titre. L'Institut chimique de Nancy avait en effet l'un des tous premiers centres de formation d'ingénieurs créés en province dans les années 1880 et il avait largement contribué à renforcer le développement du pôle scientifique nancéien. De plus, la construction de cet institut avait été rendue possible par la sollicitation du soutien financier d'un grand nombre de partenaires publics et privés. L'ESIC avait-elle dormi sur ses lauriers ? Avait-elle oublié son passé ?56
Suite à cet échec, les responsables de l'association décidèrent de légaliser l'existence de la Fondation en faisant parvenir au préfet de Meurthe-et-Moselle une attestation certifiant que l'association fonctionnait depuis le 22 septembre 1943, date à laquelle elle avait reçu l'accord des autorités compétentes.
"Les soussignés ont l'honneur de vous faire la déclaration suivante, relative au fonction-nement d'une association 'FONDATION SCIENTIFIQUE DES INDUSTRIES CHIMI-QUES À L'ÉCOLE SUPERIEURE DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE Nancy'.
Le siège de cette association est à l'école supérieure des industries chimiques, 1, rue Grandville. Son but est d'appuyer matériellement et moralement l'école supérieure des in-dustries chimiques, en développant l'étude de la Chimie et en favorisant la formation d'ingénieurs à la dite école".57
Le 4 mai une attestation officielle de récépissé de déclaration fut envoyée par la préfecture de Meurthe-et-Moselle à Donzelot.58 Quelques semaines plus tard, Donzelot s'occupa de clarifier la situation bancaire de la Fondation. Celui-ci avait en effet fait ouvrir un compte à son nom à la Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie et avait fait en sorte que les cotisations et sommes versées à la Fondation aillent sur ce compte particulier. L'objectif était vraisembla-blement de contourner les lenteurs administratives et financières et de donner à l'association des moyens pour fonctionner immédiatement. Cependant, cette procédure de gestion finan-cière n'était pas sans ambiguïtés : les sommes versées étaient destinées à l'ESIC mais elles
55 Le dossier 1T322 conservé aux Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle contient les rapports annuels de ces fondations pour les années antérieures à la seconde guerre mondiale. Il faut noter qu'à l'origine la taxe d'apprentissage pouvait être affectée aux laboratoires universitaires (c'est ce qu'on appelait le 'sou de laboratoi-re'). À Nancy, durant les premières années de l'entre-deux-guerres, c'est la Société des Amis des Instituts qui récupérait la taxe et la reversait ensuite aux différentes institutions. Or cette société fut frappée par la faillite ce qui obligea certains instituts à créer leur propre fondation destinée à gérer le recueil et la gestion de cette taxe (ce fut notamment le cas de l'institut électrotechnique). 56 Au-delà des discours officiels des institutions nancéiennes, le soutien apporté par le monde industriel aux premiers instituts de sciences appliquées ne fut pas immédiat. Sur les rapports Science / Industrie, cf. article de Françoise Birck, page 236. 57 Lettre de Donzelot au préfet de Meurthe-et-Moselle, 3 mai 1945. Archives de l'ENSIC, chemise "Fondation scientifique des industries chimiques" (sous-chemise "Fondation dossier principal"). 58 Notons qu'une nouvelle déclaration de l'association fut faite auprès de la préfecture après la guerre, peut-être afin de gommer l'agrément qui avait été accordé par les autorités allemandes en 1943. La préfecture de Meurthe-et-Moselle accusa réception de cette déclaration le 23 octobre 1947 et un paragraphe présentant la Fondation fut publié dans le journal officiel du 31 octobre 1947 : "23 octobre 1947. Déclaration à la préfecture de Nancy. FONDATION SCIENTIFIQUE DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE L'ÉCOLE SUPERIEURE DES INDUS-TRIES CHIMIQUES DE Nancy. But : appui matériel et moral de l'École supérieure et développement de l'étude de la chimie en favorisant la formation d'ingénieurs chimistes à ladite école. Siège social : 1, rue Grandville, Nancy". Archives de l'ENSIC, chemise "Fondation scientifique des industries chimiques" (sous-chemise "Fonda-tion dossier principal").
Rapport de Recherche
- 191 -
étaient utilisables en dehors de tout contrôle et n'apparaissaient pas de manière visible dans les comptes de l'école. Conscient de cette situation, Donzelot fit des démarches auprès de la BNCI pour que le compte initialement déclaré à son nom soit déclaré au nom de la Fondation en adressant les récépissés de déclaration de la préfecture et les copies des statuts :
"24 mai 1945
Monsieur le Directeur de la Succursale de Nancy de la B.N.C.I.
Monsieur le Directeur,
J'ai l'honneur de vous faire connaître que je possède, à mon nom, chez vous un compte N°12.078.
Ce compte avait été pris à mon nom et appartenait en réalité à un groupement 'FONDA-TION SCIENTIFIQUE DES INDUSTRIES CHIMIQUES À L'ÉCOLE SUPERIEURE DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE NANCY'. Des difficultés administratives ont em-pêché que soit régularisée la situation de cette Fondation. C'est aujourd'hui chose faite, et je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'indiquer ce qui doit être fait pour que ce compte passe aussitôt au titre de la Fondation. Les statuts ont été déposés à la préfecture à la date du 4 mai 1945.
Ci-contre un exemplaire de ces statuts.
Recevez, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées.
P. Donzelot".59
Comme on a pu le voir, le refus du statut d'utilité publique pour l'association avait été motivé par l'ambiguïté des statuts, le responsable du gouvernement ayant jugé que les objectifs de la Fondation s'apparentaient plus à ceux d'une entreprise. Cette ambiguïté ne fut pas levée avec le transfert du compte. En effet, durant les années d'après-guerre, la Fondation fut à plusieurs reprises appelée à clarifier sa situation budgétaire et à rendre compte de son rôle dans le fi-nancement du développement de l'école. Notons que ce mélange des genres est loin d'être un épiphénomène dans le fonctionnement historique des écoles d'ingénieurs, celles-ci ayant tou-jours cherché à obtenir une plus grande autonomie financière.60
Alexandre Travers, directeur de l'Institut-chimique-ESIC
de 1929 à 1939
Pierre Donzelot, directeur de l'ESIC de 1942 à 1946
Maurice Brulfer, président de l'Union des Industries chimi-
ques61
59 Lettre de Donzelot au directeur de la BNCI, 24 mai 1945. Archives de l'ENSIC, chemise "Fondation scientifi-que des industries chimiques" (sous-chemise "Fondation dossier principal"). 60 On en trouvera une illustration dans la lettre de Letort à Pavageau citée page 207. 61 Source des documents photographiques de cette page : Centenaire de l'ICN-ENSIC, 1887-1987.
Genèse et Développement du Pôle Scientifique Nancéien
- 192 -
C°/ Les hommes, les entreprises et les réseaux de la Fondation
Les deux principaux acteurs pour la création de cette fondation furent Pierre Donzelot et Mau-rice Brulfer. Il n'est pas inutile de détailler leurs parcours respectifs.62
Pierre Donzelot naquit le 29 juin 1901 à Valentigney, petite ville du Doubs dans laquelle son père était secrétaire de mairie. Après une scolarité au lycée de Besançon il partit faire une année de mathématiques spéciales au lycée Henri Poincaré à Nancy. Il poursuivit ensuite ses études à la Sorbonne et obtint en 1926 le grade de licencié ès sciences. Après des débuts de carrière à la Faculté des Sciences de Besançon, Donzelot devint assistant à la Faculté de Pharmacie de Nancy en 1930. La même année, le doyen de la faculté des sciences le nomma sur un poste d'assistant de physique. Il occupa donc ces deux responsabilités simultanément pendant quelque temps. Considérant qu'il ne pouvait enseigner dans une faculté de pharmacie sans être pharmacien lui-même, il obtint son diplôme dans ce domaine en 1931. Parallèle-ment, il s'attela, dans des conditions plus que précaires, à mener des recherches sur les ondes courtes. Il fut l'un des artisans du projet du doyen Seyot pour constituer un véritable labora-toire de physique à Nancy (financé d'abord par un appel à la générosité des anciens élèves puis par des fonds d'État). Il devait obtenir son agrégation en 1932 et soutenir sa thèse d'État en 1936. L'année suivante (octobre 1937) il fut nommé sur la chaire de chimie physique à la faculté. Dès le début de la guerre, il fut chargé avec plusieurs scientifiques nancéiens de me-ner des recherches sur des sujets intéressants la défense. Les travaux, réalisés à la demande de l'État-Major de Nancy, portèrent sur la réalisation d'un détecteur de mines et d'un appareil photographique à très haute luminosité pour les photographies aériennes. Après la déroute militaire de la France, il partit enseigner pendant un an à la Faculté des Sciences de Poitiers. Il revint ensuite à Nancy en 1942 pour prendre la direction de l'ESIC. Il parvint à faire exister les structures universitaires et à attirer auprès de lui de jeunes savants promis à un bel avenir, tels Maurice Letort ou Maurice Dodé.63
L'importance de Donzelot dans le paysage universitaire local et national se mesure à l'aune des responsabilités qu'il occupa après la guerre. En 1946, alors qu'il était maire de Nancy depuis mai 1945, il fut nommé recteur de l'académie. En 1947, il prenait la présidence du conseil d'administration de l'Université de la Sarre (dont il était membre fondateur). Il joua ainsi un rôle moteur dans la création de la Faculté de Médecine de Homburg en 1947.64 La suite de sa carrière le conduisit à Paris au ministère de l'Éducation nationale : directeur géné-ral de l'Enseignement supérieur (1948), représentant permanent des universités françaises aux États-Unis (1953), directeur général de l'Équipement scolaire, universitaire et sportif. Au-delà de ces activités, il occupa une place éminente dans plusieurs commissions et institutions scientifiques : le Directoire du Centre national de la Recherche scientifique (1949-1953), le Conseil Scientifique du Commissariat à l'Énergie Atomique (1950-1953), l'Académie des sciences de New-York en tant que membre titulaire (1954), la Commission des Marchés de l'Éducation Nationale, le Comité national de la Recherche (1958), le Comité national de la Chimie (1958), le Comité de Réforme des Études de l'École polytechnique, le conseil d'admi-nistration du Muséum d'Histoire Naturelle. En 1959, il fut nommé professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle sur la chaire de physique végétale. Comme on peut s'en douter,
62 Philippe Aubertin, Directeur Général des Établissements Solvay pour la France s'impliqua dès le départ dans la Fondation et la présida durant de nombreuses années. Malheureusement, nous ne disposons pour l'instant d'au-cune information sur son parcours personnel et professionnel (né à Sedan, le 16 octobre 1888). 63 Rivail, Jean-Louis, « Théorie et application en chimie et biochimie, le temps de la récolte ». Cérémonie de rentrée officielle des universités de Nancy. Nancy, 2002. 64 Création qui associa pendant plusieurs années des professeurs de la Faculté de Médecine de Nancy.
Rapport de Recherche
- 193 -
même après son départ de l'ESIC, Donzelot continua à jouer un rôle dans le développement de l'école. Jusque dans les années 1960, ses successeurs à la direction de l'école bénéficièrent dans les instances nationales d'une oreille plus qu'attentive. Donzelot constitua donc un atout maître pour l'émergence du génie chimique à Nancy et pour le financement du pôle chimique nancéien. D'ailleurs, bien qu'éloigné de Nancy, il demeura membre élu de la Fondation jus-qu'à sa mort en 1960.65
Le parcours de Maurice Brulfer est plus difficile à retracer car les informations à son sujet demeurent fragmentaires. Bien que ce soit dans une autre sphère, il exerça également une grande influence sur le développement de l'école, bien au-delà de la seule fondation. Né à Saint-Ménéhould (Marne) le 4 juin 1891, Brulfer avait fait ses études à l'Institut chimique de Nancy juste avant la Première Guerre mondiale (promotion 1912) et était ensuite devenu en 1919 gérant de la Société Brulfer et Cie, une usine de carbonisation du bois et d'extraction de produits organiques qui avait été fondée en 1894. Jeune diplômé, il modernisa les techniques de production en créant des fours verticaux continus. En 1922 cette entreprise changea de raison sociale pour devenir une société anonyme – la Société des Produits chimiques de Cla-mecy – et elle diversifia rapidement ses domaines d'activités en se spécialisant dans la fabrica-tion de résines et de poudres à mouler (1928), dans la récupération du fer étamé (1932) et dans la fabrication des tannins synthétiques (1958). En 1943, à la naissance de la Fondation, celui-ci était présenté comme le directeur de la Société Progil, société qui connut de multiples évolutions avant d'appartenir au groupe Rhône-Poulenc. En revanche, il est avéré qu'il entre-tint jusqu'à la fin des années 1950 des relations suivies avec son ancienne école, par l'intermé-diaire de l'Association des anciens élèves, qu'il présida pendant des années et par le biais de la Fondation qu'il contribua à fonder (son entreprise abondait d'ailleurs régulièrement au budget de l'école par le biais de la taxe d'apprentissage – cf. page 176).
Brulfer n'était pas un personnage anodin dans le monde économique et politique de la Qua-trième République. Comme le mentionne Richard Vinen, dans les années d'après-guerre les partis politiques étaient financièrement exsangues et les responsables économiques avaient mis au point un grand nombre de mécanismes pour leur venir en aide. Parmi ces dispositifs, le Centre d'Études économiques (CEE), établi en 1946 à Paris rue de Penthièvre, jouait un rôle moteur. Brulfer en était le principal animateur, assisté de Périlhon des usines Kuhlmann (qui devait également devenir membre élu de la Fondation). Le but du CEE, en étroite association avec le Conseil national du Patronat Français (CNPF), était de financer des hommes politi-ques soigneusement choisis à l'aide de fonds collectés auprès de cercles d'affaires.66 Politi-quement, Brulfer était un conservateur. Il avait participé en 1946 à la création du Parti Répu-blicain de la Liberté (PRL), dont l'ambition initiale était de devenir un parti fort qui servirait les intérêts économiques. Par ailleurs, ses responsabilités de président de l'Union des Indus-tries Chimiques en faisaient un allié de poids.
Brulfer et Donzelot étaient donc des acteurs de premier plan, tant au niveau local que national. Ils disposaient de réseaux conséquents dans les milieux scientifiques, économiques et politi-ques. Comme on a pu le voir auparavant, avant même d'obtenir l'agrément des autorités,
65 Pour un aperçu de la vie et de l'œuvre de Pierre Donzelot, on consultera la brochure publiée en son hommage : Collectif, Pierre Donzelot. Paris, Imprimerie Mazarine, 1960. 66 Vinen, Bourgeois Politics in France 1945-1951. Cambridge, Cambridge University Press, 2002. Pages 76-77. Brulfer et Périlhon parvinrent même à s'adjoindre les services d'André Boutemy. Celui-ci avait été préfet de la Région lyonnaise sous le gouvernement de Vichy et avait connu une période de disgrâce à la Libération. Bien implanté dans les milieux économiques et politiques, il avait, par son intervention, sauvé la vie de Georges Villiers au moment de son arrestation par la Gestapo de Lyon (celui-ci devint en 1946 le premier président du CNPF).
Genèse et Développement du Pôle Scientifique Nancéien
- 194 -
l'ESIC était parvenue à fédérer un certain nombre d'industriels autour de son projet de Fonda-tion et les sommes récoltées représentèrent vite un apport non négligeable. Mais qui étaient vraiment les contributeurs de cette fondation ? Quelles étaient les entreprises représentées ? Que peut-on dire des hommes et du réseau qui s'agrégèrent à ce projet dans le contexte troublé de la France de Vichy ? Tous ces hommes (Donzelot, Brulfer, les dirigeants des grands grou-pes chimiques français) partageaient-ils des objectifs communs ? Répondre à cette question oblige à poser la question des stratégies économiques des entreprises à cette période et no-tamment des grands groupes industriels associés à la chimie. Répondre à cette question oblige également à poser la question de la collaboration économique de l'industrie chimique fran-çaise durant la seconde guerre mondiale.
Suite à la défaite militaire de la France, une loi du 16 août 1940 institua les comités d'organi-sation (CO). Ces CO constituaient la base de l'appareil d'encadrement et de direction de l'éco-nomie du régime de Vichy. Il s'agissait d'organismes semi-publics dirigés et contrôlés par des hommes nommés directement par les ministères concernés et dont les décisions faisaient force de loi. Dans certains cas, ils venaient remplacer des syndicats patronaux qui avaient été dis-sous. La plupart des secteurs de l'économie française furent dotés de CO (il y en eut plus de 200). À l'origine, le rôle dévolu à ces comités était de mettre en œuvre la politique de l'État : recensement des entreprises, des stocks et de la main d'œuvre ; élaboration des programmes de production ; mise en place de mesures de concentration dans des secteurs où les matières premières et l'énergie venaient à manquer.67
La création des CO fut une des décisions réglementaires les plus précoces du régime de Vi-chy. L'objectif était d'adapter l'économie française aux contraintes économiques allemandes nées de la défaite. Il s'agissait d'assurer dans les meilleures conditions la bonne exécution des commandes allemandes, toutes zones confondues. Dans cette perspective, les autorités alle-mandes agréaient et adoubaient les chefs de CO désignés par l'État français (par l'intermé-diaire du ministère de la Production industrielle). Par ailleurs, les CO s'inscrivaient dans la politique d'aryanisation voulue par les allemands et acceptée par le gouvernement français. C'est ainsi que fut confiée à ces comités la mission de fournir la liste exhaustive des entrepri-ses juives aryanisables ou à supprimer car décrétées inutiles.68
Par l'entremise des CO, il ne fait aucun doute que les entreprises françaises contribuèrent à l'effort de guerre allemand. La question est ensuite de savoir dans quelle mesure et dans quelle proportion cette contribution fut imposée aux acteurs du monde économique. Dans les années d'après-guerre, prévalut la thèse d'une collaboration voulue par les autorités françaises mais subie par le monde industriel et bancaire. Il est certes difficile de juger d'une question aussi
67 Sur ce point on consultera : Barjot, "Introduction". In Joly (Ed.), Les comités d'organisation et l'économie dirigée du régime de Vichy (actes du Colloque Les Entreprises Françaises sous l'Occupation). Caen, Centre de Recherche d'Histoire Quantitative, 2003, 7-20. Joly (Ed.) Les Comités d'Organisation et l'Économie Dirigée du Régime de Vichy, Actes du Colloque International, 3-4 avril 2003. Caen, Centre de Recherche d'Histoire Compa-rative, 2004. Lacroix-Riz, "Les comités d'organisation et l'Allemagne : tentative d'évaluation". In Joly (Ed.), Les comités d'organisation et l'économie dirigée du régime de Vichy (actes du Colloque Les Entreprises Françaises sous l'Occupation). Caen, Centre de Recherche d'Histoire Quantitative, 2003, 50-62. 68 "Tous les CO des branches dans lesquelles les juifs, devaient être soit purement et simplement dépouillées, soit dépouillées et remplacées, montrèrent un grand entrain dans la collaboration, de l'ameublement au textile, de la confection à la publicité, de l'édition au cuir. Elle portait sur le partage des dépouilles, aussi litigieux fut-il parfois, que sur l'accélération que les opérations d'éviction imprimaient aux livraisons à l'Allemagne". Lacroix-Riz, "Les comités d'organisation et l'Allemagne : tentative d'évaluation". In Joly (Ed.), Les comités d'organisa-tion et l'économie dirigée du régime de Vichy (actes du Colloque Les Entreprises Françaises sous l'Occupation). Caen, Centre de Recherche d'Histoire Quantitative, 2003, 50-62. p. 57.
Rapport de Recherche
- 195 -
complexe à partir de considérations générales. Cependant, des travaux récents69 tendent à montrer que cette collaboration économique ne fut pas toujours imposée et que certains sec-teurs économiques jouèrent franchement et volontairement la carte de la victoire allemande. Dès 1940, croyant à une prochaine victoire allemande, des industriels et des banquiers se lancèrent dans une politique de collaboration avec les autorités germaniques : associations de capitaux et création de sociétés mixtes franco-allemandes fleurirent donc dans tous les sec-teurs, sous le regard du gouvernement de Vichy. Le secteur de la chimie ne fut pas en reste dans ce domaine et les travaux récents d'Annie Lacroix-Riz tendraient même à montrer que les dirigeants français du secteur de la chimie allèrent parfois bien au-delà des attentes des autorités allemandes et françaises.70
Comme nous l'avons indiqué précédemment, une liste de 31 entreprises membres de la Fonda-tion fut déposée à la préfecture de Nancy (cf. tableau page 184). L'étude de cette liste permet de constater que les grands noms de la chimie française y étaient représentés. Certes, certaines de ces entreprises fondatrices jouaient un rôle relativement modeste dans le paysage industriel de l'époque mais d'autres, comme la Compagnie des Produits Chimiques et Électrométallurgi-ques, Alais, Froges et Camargue, la Société des Usines Chimiques Rhône-Poulenc, les Éta-blissements Kuhlmann, la Société d'Électrochimie et d'Électrométallurgie et Aciéries Électri-ques d'Ugine ou la Société des Produits Chimiques de Clamecy étaient des poids lourds de ce secteur industriel. De plus, certains des dirigeants de ces grands groupes avaient des respon-sabilités qui dépassaient le simple cadre de leur société et s'étendaient jusqu'à l'organisation nationale et internationale de l'industrie de la chimie.
Pour beaucoup de ces grands groupes,71 l'économie de guerre fut une grande opportunité, notamment en ce qui concerne la production de produits utiles dans le domaine militaire. L'Allemagne avait des besoins énormes en matières premières et en composants de toutes sortes (acétone, plexiglas, etc.) et les CO de branche eurent à répercuter ces exigences sur les entreprises concernées (ainsi la société Bozel-Maletra en Savoie – qui comptait 400 employés à cette époque – fournissait du plexiglas pour l'industrie aéronautique allemande). Cependant, selon Lacroix-Riz, des groupes comme Péchiney cherchèrent à profiter de cette situation et à gagner sur tous les tableaux : engranger des profits maximum par la livraison de fournitures à l'Allemagne sans abdiquer totalement l'avenir français (c'est-à-dire en protégeant au besoin ses arrières).
Parmi les entreprises associées à la création de la Fondation, il est possible de s'attarder sur les activités de certaines d'entre elles durant la guerre : la Société Gillet-Thaon, par l'intermé-diaire de ses dirigeants, s'impliqua activement dans la procédure d'aryanisation du géant du textile, La Société cotonnière du Nord et de l'Est détenue par la famille Schwob d'Héricourt.72
69 Notamment : De Rochebrune & Hazera, Les patrons sous l'occupation. Paris, Éditions Odile Jacob, 1997. Lacroix-Riz, Industriels et banquiers sous l'occupation - La collaboration économique avec le Reich et Vichy. Paris, Armand Colin, 1999. 70 Dans un ouvrage instruit à charge (mais extrêmement bien documenté), Annie Lacroix-Riz qualifie ainsi la France de Vichy, pour ce qui concerne les mouvements de capitaux, de "royaume de la chimie allemande", phénomène qui peut s'expliquer en partie par la fascination exercée depuis longtemps par l'industrie chimique allemande sur la France. Lacroix-Riz, Industriels et banquiers sous l'occupation - La collaboration économique avec le Reich et Vichy. Paris, Armand Colin, 1999. Chapitre 7. 71 Sur ces 31 entreprises, certaines étaient à n'en pas douter des filiales de grands groupes industriels comme Péchiney et Rhône-Poulenc. Cependant, la reconstitution des structures de ces groupes reste à faire. 72 Lacroix-Riz, Industriels et banquiers sous l'occupation - La collaboration économique avec le Reich et Vichy. Paris, Armand Colin, 1999. Pages 411-414
Genèse et Développement du Pôle Scientifique Nancéien
- 196 -
Le Comptoir-Linier semble avoir profité de la guerre pour éliminer ses concurrents les plus directs.73 La Société Louvroil-Montbard s'engagea dans un vaste projet de construction d'un pipe-line entre l'Étang de Berre et le Rhin.74 Le groupe d'Ugine fut pour les autorités alleman-des un important fournisseur des tristement célèbres cristaux de gaz Zyklon B (usine de Vil-lers-Saint-Sépulcre dans l'Oise).75 Enfin, le cas de la société Francolor est relativement connu. Celle-ci était le résultat d'une alliance du groupe IG-Farben et des Établissements Kuhlmann. Les deux groupes s'étaient entendus (avec l'aval des représentants du patronat français et en forçant la main aux autorités de Vichy) pour créer cette société mixte franco-allemande en février 1942. Le groupe Kuhlmann avait accepté de céder 51 % du capital, en échange de quoi il avait reçu des actions ordinaires pour une valeur nominale de 12,75 millions de Reichsmark d'actions sur un capital total de l'IG Farben porté à 848.5 millions de Reichsmark en février 1942. Après la Libération, certaines de ces entreprises furent sommées de s'expliquer sur leurs agissements durant la guerre et affirmèrent qu'elles avaient travaillé sous la contrainte des autorités françaises et allemandes.76
Comme nous l'avons mentionné, Donzelot, Aubertin et Brulfer furent chargés par le Bureau de la Fondation de procéder aux démarches administratives de déclaration de l'association. Il s'avère que les cinq autres personnes qui composaient ce Bureau77 n'étaient pas, loin s'en faut des personnalités de second plan. C'est donc au cours de cette période troublée des années 1940, et avec ces entreprises, que Donzelot, résistant, fut amené à travailler.
Joseph Frossard était ingénieur et président de la société Francolor (il était né le 9 juin 1879 à Thann). En 1942, avec René Paul Duchemin (Président de Kuhlmann et président de la Confédération générale de la Production française, l'ancêtre du MEDEF), il avait été l'un des principaux acteurs des négociations franco-allemandes en vue de la création de la société mixte Francolor. Sa nomination à la tête de cette entreprise en 1942 était supposée contreba-lancer l'affront que représentait pour l'orgueil national cette opération de mise sous tutelle et cette prise de contrôle d'une part importante de l'industrie chimique de l'hexagone.78
Polytechnicien (promotion 1914) et ingénieur du corps des Mines, Joseph-Marie Raoult de Vitry d'Avaucourt (1895-1977) était directeur général et vice-président de Péchiney,79 prési-dent du CO de l'aluminium et du magnésium et responsable des ventes de bauxite à l'exporta-
73 Ibidem, page 176. 74 Ibidem, pages 341-342. 75 Ibidem, pages 164-166. 76 Ibidem, pages 160-164. 77 Probablement pour des raisons juridiques et administratives, Édouard Husson, doyen de la Faculté des Scien-ces de Nancy était également membre du Bureau. 78 De Rochebrune & Hazera, Les patrons sous l'occupation. Paris, Éditions Odile Jacob, 1997. Le Docteur Kra-mer, qui était l'un des représentants de l'IG-Farben à Paris et délégué du parti nazi à l'économie devait ainsi déclarer : "On voit d'une façon parfaitement claire chez Kuhlmann que l'Allemagne gagnera la guerre et que l'économie européenne sera faite sous la direction de l'Allemagne. Frossard offre de mettre son industrie toute entière au service de l'Allemagne pour renforcer le potentiel chimique pour la continuation de la guerre contre l'Angleterre. Kuhlmann serait prêt à produire tous les produits préliminaires et auxiliaires pour l'IG, ce qui serait désiré du côté allemand. Lui Frossard veut une collaboration intime, union plus étroite sur le terrain des matières colorantes et des produits chimiques, intégration de l'industrie française dans l'économie européenne sous une direction allemande". Lacroix-Riz, Industriels et banquiers sous l'occupation - La collaboration économique avec le Reich et Vichy. Paris, Armand Colin, 1999. Citation p. 68. 79 Il était semble-t-il à la tête du groupe depuis 1938. Dans les documents de la Fondation il apparaissait en tant que président-directeur de la Compagnie des Produits chimiques Alais, Proges et Camargue.
Rapport de Recherche
- 197 -
tion. Il avait joué un rôle moteur dans les négociations du contrat "Aluminium français-Vereinigte Aluminium Werke" en septembre 1940. Il semble par ailleurs avoir été un négocia-teur zélé puisque le contrat fut renouvelé en 1941, sans qu'il n'y ait aucune contrainte de Vi-chy, les signataires obtenant même du gouvernement une clause de garantie de non responsa-bilité pour assurer leurs arrières (ce contrat prévoyait la livraison de près de 5.000 tonnes d'aluminium par mois à l'Allemagne).80 Félix-René Lavaste (1881-1957) était également poly-technicien (promotion 1900) et ingénieur du corps des Mines. Directeur général de la Compa-gnie Saint-Gobain en 1943, il avait été associé en 1941 à des négociations concernant l'orga-nisation de la production de charbon et des cokeries du Nord de la France.81 Enfin, Marcel Bô, directeur général de Rhône Poulenc avait été partie prenante en décembre 1940 dans les négo-ciations avec l'IG-Farben pour la convention sur l'aspirine. Rhône-Poulenc avait obtenu, aux termes de négociations cordiales, le droit d'exploiter ce produit découvert par l'entreprise allemande ainsi qu'une participation aux revenus pour une durée prolongée.82
Après la guerre, la Fondation continua ses activités et établit des contacts avec un grand nom-bre d'entreprises et des représentants de l'industrie chimique. Entre 1946 et la fin des années 1950, à en juger par les comptes-rendus de plusieurs réunions, les dirigeants suivants furent associés au devenir de l'ENSIC : le baron Pierre Hely d'Oisel, Castets, Pierron, René Perrin et Eugène Prosper Mathieu. Ceux-ci avaient également occupé de hautes responsabilités écono-miques ou politiques et avaient été associées au fonctionnement des comités d'organisation. Hély d'Oisel, président directeur général de Saint-Gobain semble avoir été un convive régulier des banquets de la Table Ronde organisés au Ritz de février à octobre 1942. Ces banquets réunissaient les plus hauts responsables de la collaboration économique et ils étaient destinés à faciliter un rapprochement franco-allemand. Castets, représentant de la société Organico, avait été associé avec Lavaste aux négociations concernant l'organisation de la production de charbon et des cokeries du Nord de la France (voir plus haut). Pierron, qui était directeur des Usines Solvay de Dombasle (et adjoint d'Aubertin, président de la Fondation) semble avoir participé aux réunions de la Chambre de Commerce de Nancy en juillet 1941, réunions dont les réflexions dessinèrent les contours de la charte du travail du gouvernement de Vichy.83 René Perrin (1893-1966) était en 1946 directeur général de la Compagnie d'Ugine. Polytech-nicien (promotion 1911) et ingénieur du corps des Mines, il avait été chargé durant la guerre, en tant que président de la Compagnie française des Raffineries, de négocier un accord avec la Kontinentäle Öl-AG. Cette négociation, effectuée conjointement avec Jules Meny, prési-dent de la Compagnie française des Pétroles et directeur responsable du CO des combustibles liquides, avait débouché sur des avantages non négligeables pour les entreprises françaises.84 Perrin avait été un membre actif des CO et membre du cabinet du maréchal Pétain. Chargé des questions sociales d'avril 1941 à la fin 1943 (date de sa démission) il avait participé aux travaux d'élaboration de la charte du travail85 Perrin fut pendant une partie de sa carrière l'ad-joint d'Eugène Prosper Mathieu (1886-1966). Ce dernier était également passé par l'École
80 Lacroix-Riz, Industriels et banquiers sous l'occupation - La collaboration économique avec le Reich et Vichy. Paris, Armand Colin, 1999. Pages 87, 312-315. 81 Ibidem, page 102. Les réunions avaient lieu à l'hôtel Majestic, siège de la Gestapo à Paris. 82 Ibidem, pages 208-209. 83 Ibidem, pages 498-501. Ces réunions étaient présidées par Marcel Paul-Cavallier, président de la Société Pont-à-Mousson et sympathisant notoire du régime allemand. Promulguée en octobre 1941, la charte du travail prohi-bait en particulier le droit de grève. 84 Ibidem, pages 189-193. 85 Ibidem, pages 518-519.
Genèse et Développement du Pôle Scientifique Nancéien
- 198 -
polytechnique (promotion 1905) et par l'école des mines. Avant la Première Guerre mondiale il avait travaillé avec Henry Le Chatelier puis il avait rejoint la Compagnie d'Électrochimie d'Ugine en 1918. De 1930 à 1945, il avait été le collaborateur de Georges Painvin, président directeur général du Groupe d'Ugine (il devait d'ailleurs lui succéder en 1946). De 1939 à 1945, il avait dirigé le CO des ferro-alliages. Il devait obtenir la médaille de la résistance à la Libération.
Les responsabilités importantes de ces dirigeants les plaçaient, à n'en pas douter, dans des situations difficiles : il leur fallait concilier les intérêts propres de leurs entreprises avec ceux des autorités allemandes et ceux du gouvernement français, le tout dans un climat de crise économique, politique et morale. On ne saurait faire ici le procès de la collaboration. En re-vanche, il convient de s'interroger sur la position de l'ESIC durant la guerre et sur les raisons qui motivèrent la création de cette Fondation.
Doit-on supposer que la direction de l'ESIC avait décidé en 1943 de faire un pari sur une défaite des Alliés contre l'Axe ? Cette hypothèse paraît peu plausible. L'année 1943 constitua un tournant essentiel de la guerre ; au moment où l'ESIC concrétisait son projet de Fondation (soit à l'été 1943) les difficultés de l'Allemagne sur le front russe ou en Afrique du Nord avaient suffisamment filtré (malgré la censure) pour que les pronostics s'inversent. Il semble difficile d'accuser Donzelot d'avoir joué la carte allemande quand on connaît son activité de résistant. Durant les années de guerre, Donzelot usa en effet de son influence et de ses réseaux pour écarter les étudiants de l'ESIC du STO :
"Pour les élèves menacés et le plus souvent faméliques, Pierre Donzelot est plus que le di-recteur : il est le père auquel on se confie, celui qui protège, qui conseille, qui met à l'abri du Service du Travail obligatoire, le STO de triste mémoire par des opérations aussi in-génieuses qu'illégales".86
Exemple parmi d'autres de ces manœuvres, le cas de Jack Bastick, étudiant à l'ESIC sous l'Occupation et futur directeur de l'école (1962-1975) : "Il y avait aussi les convocations pour le Service du Travail Obligatoire… J'exposais la situation à notre directeur qui décrochait le téléphone et annonçait ma visite à un jeune médecin du nom de Pierre Weber… Une heure plus tard, je sortais du cabinet de consultation atteint d'une très grave affection dont je connaissais parfaitement tous les symptômes, et dont le nom… me rendait à tout jamais inapte au S.T.O".87 Donzelot ne pouvait manifestement pas souhaiter la victoire allemande et sa posture politique était bien différente de celle des autres acteurs que nous avons mentionnés. Ses responsabilités en tant que maire de Nancy à la Libération (de mai 1945 à mars 1946) attestent qu'il avait choisi le bon camp durant la guerre. Les intérêts de l'école transcendaient-ils un tel clivage ? Pourquoi ne pas avoir créé cette Fondation avant la guerre (comme l'avaient fait certaines autres écoles nancéiennes) ? Y avait-il une opportunité particulière liée au contexte de la guerre et de l'Occupation ? Voulait-on profiter d'une manne financière subi-tement disponible ?
Il est particulièrement difficile de répondre à ces questions mais on peut proposer quelques hypothèses d'interprétation sur la stratégie de l'école. D'une part, l'école entretenait des rap-ports réguliers avec la plupart des acteurs industriels cités depuis bien longtemps, ne serait-ce
86 Letort, "Éloge de Pierre Donzelot, allocution de M. Jack Bastick, Membre de l'Académie des Sciences, Direc-teur Honoraire de l'École Nationale Supérieure des Industries Chimiques de Nancy". In ENSIC (Ed.), Hommage à Pierre Donzelot. Nancy, ENSIC, 1966, 27-39. 87 Bastick, "Éloge de Pierre Donzelot, allocution de M. Jack Bastick, Directeur de l'École Nationale Supérieure des Industries Chimiques de Nancy". Ibidem, 11-13. D'après certains témoignages, enfin, durant la guerre, les archives de l'école auraient été 'nettoyées' de manière à faire disparaître les informations sur les étudiants juifs.
Rapport de Recherche
- 199 -
que par le biais du prélèvement de la taxe d'apprentissage (cf. page 176) ; par conséquent, il est possible de lire cette sollicitation des entreprises de la chimie comme le prolongement de la stratégie de l'école en direction des milieux industriels. D'autre part, on sait qu'un des sujets de plainte régulière de la direction de l'ESIC à cette époque concernait les prix exorbitants atteints par certains produits chimiques. Il n'est pas impossible que l'école ait envisagé, par le biais de la Fondation, de bénéficier de prix avantageux ou d'un accès privilégié à certains composants devenus rares. Par ailleurs, au-delà des aspects financiers, la création de la Fonda-tion s'inscrivait probablement dans la cadre d'une politique d'image : mettre en avant des rela-tions privilégiées avec de grands groupes industriels permettait de renforcer l'image élitiste véhiculée par la réforme Travers et de conférer une plus grande valeur aux diplômes (ce qui constituait assurémment une demande des anciens élèves). Enfin, si l'on considère l'activité de résistant de Donzelot (il reçut la croix de guerre avec palmes pour son action dans la résis-tance), on peut légitimement se demander si une de ses motivations en créant la Fondation ne fut pas d'instrumentaliser les relations industrielles de l'école pour en faire un paravent respec-table vis-à-vis des autorités de Vichy et soustraire ainsi les étudiants au STO.88 Il ne s'agit là, bien évidemment que d'une hypothèse mais elle est loin d'être incohérente et elle permettrait de comprendre toute la rhétorique sur les bourses d'enseignement présente dans les premiers documents de la Fondation (et qui prend nettement moins d'importance durant l'après-guerre).
Qu'attendaient, de leur côté, les industriels de la chimie qui adhérèrent à la Fondation dès 1943 ? Comme nous l'avons vu, l'école tournait au ralenti et, historiquement, les grands grou-pes chimiques ne semblaient pas spécialement dépendants des promotions de l'Institut chimi-que de Nancy. Cependant, l'économie de guerre créait probablement des contraintes en termes de recrutement d'ingénieurs (décès dûs à la guerre et STO) auxquels il fallait remédier en allant puiser dans un vivier de jeunes diplômés. D'autre part, il est possible d'expliquer ce ralliement au projet de l'école par le poids de l'Association des anciens Élèves de l'institut chimique et par sa capacité à mobiliser des réseaux dans le monde économique. Enfin, l'hypo-thèse d'une politique d'image pourrait être évoquée, d'autant plus que dans certains cas il s'agissait d'une 'opération blanche' pour certaines entreprises !89
En tout état de cause, les circonstances de la création de la Fondation posent la question du rôle de la communauté scientifique sous l'Occupation et obligent à s'interroger sur les marges de liberté dont pouvaient disposer les institutions scientifiques à cette époque.90 Elles posent
88 Au lendemain de l'armistice, en juin 1940, un Comité gaulliste avait été créé par le capitaine Médard, chargé de cours à la Faculté des Lettres de Nancy et le lieutenant Klee, agrégé de philosophie. Ce comité donna nais-sance au groupe de résistance R. A. qui commença à fonctionner à Nancy dès octobre 1940, avec l'appui de Lapointe,, secrétaire des facultés, plus spécialement chargé du service des faux papiers, cachets et pièces d'iden-titité destinés aux prisonniers évadés, Alsaciens-Lorrains et étudiants. Donzelot travailla, semble-t-il, en contact étroit avec ce groupe jusqu'à la Libération. Cf. : Hobam, Nicolas, Quatre années de lutte clandestine en Lor-raine : historique du "Mouvement Lorraine", préface et médaillon de Jean-Ville-Albert. Nancy, 1946. Par ail-leurs, à la mort de Donzelot en 1960, Gilbert Grandval, commandant de la Région C durant la période de la résistance, témoigna de son engagement en ces termes : "C'est un ami incomparable qui disparaît. Nos deux vies ont été étroitement mêlées depuis près de 20 ans. Qu'il s'agisse de la lutte clandestine, de la Libération de Nancy, du commandement de la vingtième Région militaire de la Sarre, de l'Institut d'Université de Homburg, de l'Uni-versité de Sarrebrück ou du Maroc". Télégramme de Gilbert Grandval, à l'épouse de Donzelot, (29 août 1960), confié par sa fille, Michelle Boyer-Donzelot,. 89 Ainsi tout en étant membres fondateurs de l'association dès 1943, Saint-Gobain, Ugine et Kuhlmann – qui constituaient des poids-lourds du secteur de la chimie industrielle – ne versèrent aucune côtisation à l'école avant 1948. 90 Sur ce point, voir N. Chevassus-Au-Louis, Savants sous l'Occupation, enquête sur la vie scientifique française entre 1940 et 1944. Paris, Seuil, 2004.
Genèse et Développement du Pôle Scientifique Nancéien
- 200 -
également la question de la cohérence politique des réseaux mobilisés pour défendre les inté-rêts de l'école. S'il est possible de comprendre les affinités entre deux personnes comme Don-zelot et Letort (tous deux résistants et de sensibilité à gauche), la coalition entre Donzelot et Brulfer est nettement plus ambiguë et demanderait à être approfondie.91
D°/ Les premières années d'après-guerre
D'une manière générale, durant les premières années, les divers épisodes de création de l'asso-ciation n'associèrent que très peu la totalité des membres. Le Bureau provisoire se réunissait de manière ponctuelle en fonction des impératifs du moment et des actions destinées à donner une existence légale à la Fondation. De fait, la plupart des réunions antérieures à 1946 ne réunirent que Donzelot, Brulfer et Aubertin (qui remplissait les fonctions de président). Comme on a pu le voir, le bilan de leurs actions était en demi-teintes. Certes, l'association était parvenue à se constituer autour d'un noyau de contributeurs et d'amis de l'école ; de plus, elle avait collecté des sommes non négligeables, notamment en demandant à ses partenaires les plus volontaires d'anticiper les versements futurs de cotisations. Cependant, elle n'avait pas réussi à obtenir la reconnaissance d'utilité publique dont bénéficiaient les fondations des au-tres écoles du pôle scientifique nancéien.
La ville de Nancy fut libérée en septembre 1944 et sa proche Région demeura très instable jusqu'à l'automne, en raison de la poursuite des combats. Donzelot, qui s'était distingué par des actes de résistance, fut appelé à faire partie de la délégation municipale aux côtés du maire, l'architecte Jean Prouvé. À la démission de ce dernier en mai 1944, tout en conservant la direction de l'école, Donzelot devint maire de la ville (charge qu'il exerça jusqu'en mars 1946). À partir de cette époque, cependant, son adjoint Maurice Letort, assuma un nombre grandissant de responsabilités dans l'école, et il lui succéda à la direction le 1er avril 1946. En tant que directeur Letort fut donc amené à jouer un rôle essentiel dans le fonctionnement de la Fondation scientifique des industries chimiques. Letort orienta les pratiques de recherche et d'enseignement dans la direction du génie chimique et il fit accomplir à l'école un tournant décisif, lui conférant un rôle de première importance dans le paysage de la recherche fran-çaise. La Fondation vint fortement appuyer cette ouverture vers de nouvelles disciplines scientifiques et, à ce titre, l'analyse de son fonctionnement durant les années d'après guerre peut s'avérer instructive.
En 1943, la Fondation disposait déjà d'un fonds mobilier de 615.920 F. En raison des diffi-cultés matérielles liées à la guerre, elle n'était pas en mesure d'utiliser ses ressources dans des projets de développement avant la Libération et les archives nous apprennent que ses activités ne débutèrent vraiment qu'à partir des années 1945-1947. Durant ces deux années, l'associa-tion continua à fonctionner par l'intermédiaire du bureau provisoire qui avait été constitué durant les années de guerre. Les réunions ne semblaient pas être plus nombreuses qu'aupara-vant mais elles portaient désormais sur les stratégies de développement de l'école et elles accueillaient des industriels et des membres souscripteurs. À titre d'exemple, voici le compte-rendu d'une réunion qui eut lieu le 25 octobre 1946. Étaient présents Donzelot (en tant que recteur de l'Académie de Nancy), Letort et Aubertin ainsi que plusieurs industriels : Bô (Rhône-Poulenc), Castets (Organico), Hély d'Oisel (Saint-Gobain), Périlhon (Kuhlmann), René Perrin (Ugine) et Toinet (Saint-Gobain). Les points abordés concernaient le passage de relais à Maurice Letort et les enjeux stratégiques des années à venir :
91 Detrez, Claude, "De la chimie industrielle au génie industriel : quelles conditions pour l'émergence des scien-ces à finalités industrielles (texte non publié)". Deuxième congrès franco-québécois de génie industriel, Albi, 1997.
Rapport de Recherche
- 201 -
"Monsieur Donzelot met l'assemblée au courant des transformations survenues dans le personnel enseignant de l'école supérieure des industries chimiques. Lui-même vient d'être nommé recteur de l'Académie de Nancy et en date du 1er avril 1946 M. Letort lui succède à la direction de l'École.
M. Donzelot puis M. Letort font devant les membres de l'Assemblée un exposé sur le fonctionnement de l'École. Ils attirent particulièrement l'attention des membres présents, sur la valeur du recrutement de l'École, sur le caractère très fortement physico-chimique de l'enseignement donné à l'École et sur le développement très rapide des laboratoires de recherche, qui dès la Libération, ont pris une grande vitalité".92
Outre la mention du changement de direction, ce compte-rendu présente un intérêt pour ce qui concerne l'évolution des enseignements et des recherches menées au sein de l'école après 1945. La référence à la dimension physico-chimique des enseignements dispensés dans l'école prend tout son sens lorsqu'on connaît les efforts ultérieurs de Letort pour orienter l'école vers le génie chimique à partir de 1948.
Maurice Letort (1907-1972)
Né en décembre 1907 à Corps-Nuds, près de Rennes, Maurice Letort était issu d'une famille exploi-tant une distillerie d'alcool de cidre. Il fit ses études à l'Institut de Chimie de Paris, où il obtint son diplôme d'ingénieur chimiste et sa licence ès sciences. Bénéficiant d'un prêt d'honneur de l'Union des Industries chimiques, il commença sa carrière dans le laboratoire de René Wurmser à l'Institut de Biologie physico-chimique. À partir de 1932, il occupa un poste d'assistant faisant fonction de chef de travaux à l'Université de Liège, sous la direction de Victor Henry. Titulaire d'une chaire de chimie physique, Henry était l'un des pionniers de la chimie physique. Il engagea Letort à préparer un doctorat Sur le mécanisme de la décomposition thermique des vapeurs organiques. Cette thèse devait l'orienter définitivement vers la cinétique chimique et lui conférer rapidement une bonne réputation scientifique. En conflit scientifique avec Henry, Letort retourna alors en France, dans le laboratoire de René Audubert (avec une bourse de la Caisse nationale de la Recherche scientifique). Nommé en 1937 à la Faculté des Sciences de Paris, il fut très vite sollicité pour occuper un poste de professeur à l'Institut français Ernest Denis à l'Université de Paris à Prague. L'année suivante, il devait prendre la direction scientifique et technique de cet institut. Le déclenchement de la guerre le contraignit à quitter Prague et il continua sa carrière en tant que chef de travaux puis maître de conférences à la Faculté des Sciences de Caen. Sollicité par Pierre Donzelot, il fut nommé sur la chaire de chimie générale et minérale de la Faculté des Sciences de Nancy en 1943 (en remplacement de Lafitte). À Nancy, Letort s'affirma comme l'un des promoteurs de la cinétique chimique. Il semble avoir été l'un des premiers en France à s'intéresser aux mécanismes de la réaction chimique. Ses travaux le portèrent vers la décomposition thermique de l'acétaldéhyde. Il s'intéressa également aux réactions des molécules sur une surface métallique chaude, aux mécanismes fondamentaux de combustion du carbone et la polymérisation de l'état solide. Après avoir dirigé l'ENSIC pendant 10 ans (1946-1956), il devint directeur général scientifique du Centres d'Études et de Recherches des Charbonnages de France. Après le colloque de Caen de 1956 sur l'université et la recherche, une des priorités de la cinquième République était de définir un plan pour la recherche française. Letort, qui avait participé au colloque au titre de représentant de l'industrie, fut nommé en décembre 1958 président d'un Comité des Sages, le Comité consultatif de la Recherche scientifique et technique (CCRST).93 Au même moment, Pierre Piganiol fut nommé Délégué Général à la Recherche scientifique et technique (DGRST), ce qui faisait de lui une sorte de ministre de la recherche. La cohabitation au sein de cette direction bicéphale devint très vite problé-matique. Au sein du CCRST, Letort et quelques autres de ses collègues (Sadron et Aigrain) étaient très favorables au développement d'une recherche dirigée. Leur projet était de créer un fonds de développement de la recherche scientifique et technique (pour financer les recherches prioritaires), de créer également un Office des Instituts nationaux de Recherche (chargé de gérer les laboratoires
92 Compte-rendu du 25 octobre 1946. Archives de l'ENSIC, chemise "Fondation scientifique des industries chimiques" (sous-chemise "Fondation dossier principal"). 93 Ce groupe rassemblait le physicien Pierre Aigrain, l'agronome René Dumont, le professeur de médecine Jean Bernard, l'historien Louis Chevalier, le mécanicien Paul Germain et le chimiste Charles Sadron. Participaient également Raymond Latarjet (Institut du Radium), André Lichnérowicz (Collège de France), Maurice Ponte (CSF), Pierre Taranger (directeur industriel du CEA), Félix Trombe (directeur de recherche au CNRS).
Genèse et Développement du Pôle Scientifique Nancéien
- 202 -
propres du CNRS) et, surtout, de créer une Centre de la Recherche scientifique universitaire se substituant au CNRS dans tous les aspects de sa mission de soutien à l'enseignement supérieur. Cela revenait, de fait, à réformer totalement le CNRS. Devant la grogne des syndicats et des cher-cheurs, ce projet fut abandonné au profit des propositions de la DGRST.94 Du fait de sa carrière universitaire et de ses contacts industriels (il avait par exemple présidé la Société de Chimie industrielle et la section de chimie physique de l'Union de Chimie pure et appli-quée) Letort était un allié de poids pour l'ENSIC. Par son soutien et par ses réseaux, il contribua au développement de l'école dans les années 1950-1960, notamment en matière de recherche (créa-tion du laboratoire propre du CNRS en 1964). Letort devait décéder en 1972. Il avait été élu à l'Académie des Sciences (division des académiciens libres) en 1965.
Durant les années 1946-1948, des visites de l'école étaient régulièrement organisées pour les membres de la Fondation. On visitait les installations, les laboratoires d'enseignement et les laboratoires de recherche. Il s'agissait à la fois de rendre compte du bon usage des fonds ver-sés à l'institution et aussi de faire prendre conscience des besoins de financement ultérieurs. Les réunions de la Fondation étaient aussi l'occasion de faire le point sur le fonctionnement de l'association et de rappeler à l'ordre les membres souscripteurs dont les cotisations n'étaient pas à jour ou intermittentes.95 En avril 1947, pour les membres de la Fondation, l'association était suffisamment bien assise pour fonctionner normalement, d'autant plus que la situation de l'école était revenue à la normale. Le souhait était donc exprimé qu'une assemblée générale soit organisée pour examiner la situation financière, présenter un rapport moral et procéder à l'élection d'un comité définitif.96
Les années 1947-1948 témoignent de ce retour à une situation normale. Le comité de direc-tion s'attacha à valider la gestion des années antérieures et à dresser un bilan exhaustif de ses activités. Ainsi, un rapport financier de 1947 nous informe sur le volume des subventions récoltées par la Fondation auprès de ses partenaires industriels.97 Il dresse un bilan particuliè-rement détaillé de l'extrême diversité des relations industrielles de la Fondation à cette épo-
94 Sur point, cf. : Picard, Jean-François, La République des Savants - La recherche française et le CNRS. Paris, Flammarion, 1990, pp. 160-165. À propos de cet épisode, Picard cite ce témoignage de Jean Coulomb (page 164), qui permet de comprendre le positionnement de Letort en matière de recherche : "Letort qui venait du centre de recherche des Charbonnages de France ne connaissait que la recherche très orientée et il pensait que ce compartimentage pouvait s'appliquer, sans inconvénient, à toute la science". 95 Ainsi, lors d'une réunion du 25 avril 1947, le compte-rendu relatait les propos de Letort à ce sujet : "M. Letort fait un exposé sur l'état actuel de l'école. Il attire d'autre part l'attention des membres présents sur l'état des coti-sations reçues. Il souligne, en particulier, qu'un certain nombre de membres fondateurs n'ont effectué que des versements partiels et parfois même n'en ont pas effectué du tout, alors que certaines Sociétés, ne figurant pas sur la liste déposée à la préfecture ou n'ayant pas signé d'engagement ont cependant effectué des versements". Compte-rendu du 25 avril 1947. Archives de l'ENSIC, chemise "Fondation scientifique des industries chimi-ques" (sous-chemise "Fondation dossier principal"). 96 On ne trouve pas trace d'une élection de ce type dans les archives de la Fondation. Cependant, un document présentant les statuts, et datant probablement de 1954, fournit des informations précieuses sur la composition de ce comité : "Comité de direction – membres de droit : Urion, doyen de la faculté des sciences ; Letort, directeur de l'ENSIC. Comité de direction – membres élus : Aubertin, gérant de la Société Solvay et Cie à Paris ; Brulfer, Directeur Général de la Société PROGIL ; Donzelot, représentant permanent des universités françaises aux USA ; Jouven, directeur de la Société PECHINEY à Paris ; Landucci, président de la Société Kodak-Pathé à Paris ; Mathieu, président de la Société d'Électrochimie, d'Électrométallurgie et des Aciéries électriques d'Ugine ; Pavageau, Directeur des usines Solvay de Dombasle ; président des établissements Kuhlmann ; Ritter, directeur technique de la Compagnie Française des Matières Colorantes ; Toinet, président de la Société Les Soudières Réunies La Madeleine-Varangéville. Bureau : M. Aubertin, Président ; M. Brulfer, Vice-Président ; M. Jouven, Vice-Président ; M. Pavageau, Secrétaire-Trésorier". Source : Statuts 1954. Archives de l'ENSIC, chemise "Fondation scientifique des industries chimiques" (sous-chemise "Fondation dossier principal"). 97 Rapport financier de 1947. Archives de l'ENSIC, chemise "Fondation scientifique des industries chimiques" (sous-chemise "Fondation divers").
Rapport de Recherche
- 203 -
que. Il distingue ainsi six types différents de donateurs, qui correspondent à des degrés d'en-gagement variables vis-à-vis de la Fondation.
1) Les membres fondateurs (figurant sur la liste des membres de l'association déposée à la préfecture) n'ayant effectué aucun versement et n'ayant donné aucun engagement :
� Compagnie Saint-Gobain ;
� Établissements Kuhlmann ;
� Compagnie d'Électrochimie et d'Électrométallurgie UGINE ;
� Comptoir des Textiles artificiels ;
� Société de Carbonisation des Charbons Actifs ;
� Société Bozel-Maletra.
2) Les membres fondateurs ayant signé un engagement quinquennal, mais n'ayant effectué que certains versements :
Entreprise 1943 1944 1945 1946 1947
Alais, Froges et Camargue 50.000 Bueder et Cie 5.000 Clément et Rivière 5.000 Comptoir Linier 5.000 Ets. G. Dauvergne 5.000 5.000 5.000 Ets Fabrikoid 5.000 Grands Moulins de Paris 1.000 Pierre Hébert 5.000 Huiles, Goudrons et Dérivés 5.000 Ets Louvroil, Montbard et Aulnoye 500 500 500 500 500 Mines de Bruay 50.000 Produits Chimiques de Ribécourt 5.000 Schistes Bitumeux de l'Aveyron 5.000 Société des Produits Chimiques de Clamecy
30.000 30.000
Ets Solvay 100.000 100.000 100.000
3) Les membres fondateurs (figurant sur la liste des membres de l'association déposée à la préfecture) ayant signé un engagement quinquennal et ayant effectué régulièrement leur ver-sement.
Entreprise 1943 1944 1945 1946 1947
Teinturerie Clément Marot 5.00098 Ets. Gillet-Thaon 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Sté du Lion Noir 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ets. Parra-Mantois et Cie 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PROGIL 25.000 25.000 25.000 25.000 Rhône-Poulenc (par Ets. Solvay) 250.00099 Société Pyrénéenne de Carburants et Solvants
5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Ets. Thibaud-Gibbs et Cie 25.000100
98 Versement unique pour 5 ans. 99 Idem. 100 Idem.
Genèse et Développement du Pôle Scientifique Nancéien
- 204 -
4) Les sociétés ne figurant pas sur la liste déposée à la préfecture ayant signé un engagement et effectué régulièrement leur versement.
Entreprise 1943 1944 1945 1946 1947
Comptoir de l'industrie cotonnière 5.000 5.000 5.000 5.000 Cie Continentale du Gaz (Nancy) 5.000 5.000 5.000 5.000 Ets. Outremer-Deschamps 1.000 1.000 1.000 1.000 Ets. Riffard 25.000101
5) Les sociétés ne figurant pas sur la liste déposée à la préfecture ayant signé un engagement et n'ayant effectué que certains versements
Entreprise 1943 1944 1945 1946 1947
Ets. Marcheville-Daguin 1.000 Verreries de Vallerysthal et Protieux 5.000 Faïencerie Fenal 12.000
5) Les membres fondateurs figurant sur la liste des membres déposée à la préfecture de Meur-the-et-Moselle, n'ayant pas signé d'engagement quinquennal mais ayant effectué un versement en 1943 (et n'ayant donné aucune précision)
Entreprise 1943 1944 1945 1946 1947
Les Écrans Radiologiques 5.000 Sté Francolor 25.000
Comme on peut le voir, le degré d'engagement des souscripteurs était variable. De manière régulière, au cours de son existence, les responsables de la Fondation assurèrent un suivi des subventions et n'hésitèrent pas à rappeler les souscripteurs à leurs responsabilités.102
L'ensemble des versements effectués sur ces trois années représente la somme de 1.164.000 F. Il s'agit d'anciens Francs pour lesquels il est difficile de trouver une correspondance précise. Cependant, selon les tables proposées par l'Institut National de la Statistique et des Études économiques (INSEE), on peut estimer qu'une telle somme représenterait aujourd'hui l'équi-valent de 54.195 Euros en termes de pouvoir d'achat.103 Un autre rapport, daté du 25 février 1948, faisait état de l'utilisation de ces fonds par la Fondation :
Nature des dépenses 1943 1944 1945 1946 1947 Total des dépenses par matières
Personnel 19.250 19.000 19.000 24.774
82.024
Frais de voyage divers 13.834 10.080 6.000
11.280 41.194
101 Idem. 102 En témoigne, par exemple, cette lettre de Letort à Brulfer concernant la Société Kuhlmann : "Je profite de cette lettre pour vous signaler une question importante concernant notre Fondation Scientifique. MM. Pierron et André m'ont fait observer, en effet, que la Société Kuhlmann, qui envoie très régulièrement un représentant (souvent M. Périlhon lui-même) aux réunions, n'a pas envoyé un sou jusqu'ici à cette Fondation. Cette situation dure depuis 1943 !" Lettre datée du 3 mai 1949. Archives de l'ENSIC, chemise "Fondation scientifique des industries chimiques" (sous-chemise "Fondation divers"). 103 Pour mémoire, le salaire minimum national interprofessionnel garanti (le SMIG, ancêtre du SMIC) était de 75 F. par mois en 1950.
Rapport de Recherche
- 205 -
Nature des dépenses 1943 1944 1945 1946 1947 Total des dépenses par matières
Frais de réception 600
22.004 22.604
Bourses104
61.000 30.000
91.000
Aide aux professeurs pour les laboratoires
210.000 126.000 366.000 84.665 786.665
Aide aux élèves
5.000 25.000
30.000
Frais divers de docu-ments
3.996 1.009 5.005
Frais de Banque 57.70
14.95
62.35 135
Divers
584 584
Total des dépenses par année
33.741 303.080 206.014 394.770 119.604 1.059.211
Répartition des dépenses de la Fondation de 1943 à 1948105
5005
22604
30000
41194
82024
91000
786665
0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000
Frais de Banque
Divers
Frais divers de documents
Frais de réception
Aide aux élèves
Frais de voyage divers
Personnel
Bourses
Aide aux laboratoires
Répartition des dépenses de la Fondation de 1943 à 1948
On s'en souvient, une des raisons avancées pour la création de l'association en 1943 avait été l'octroi de bourses aux étudiants. Cependant il apparaît précisément que durant les 5 premières années de son existence l'attribution de bourses ne représente qu'une part marginale de ses dépenses (un peu plus de 10 %).
104 On notera que les financements des bourses disparaissent après 1945 des rubriques des dépenses. Ceci pour-rait venir appuyer l'idée que la Fondation fut en partie créée pour soustraire des étudiants au STO. 105 Rapport financier de 1947. Archives de l'ENSIC, chemise "Fondation scientifique des industries chimiques" (sous-chemise "Fondation divers").
Genèse et Développement du Pôle Scientifique Nancéien
- 206 -
IV°/ Le fonctionnement de la Fondation jusqu'au début des années 1960
A°/ Les ambiguïtés financières
Comment fonctionnait la Fondation du point de vue financier ? Comme on a pu le voir, la 'raison sociale' de cet organisme était de parvenir à associer des partenaires industriels au développement de l'école par le biais de contributions financières. Les termes de l'équation étaient finalement assez simples : s'assurer d'un fonctionnement budgétaire souple et réactif de l'association et, par conséquent, contourner les rigueurs de l'administration budgétaire classi-que. C'est ce qui explique l'existence, dès la création de la Fondation, d'un compte bancaire ouvert au nom de Donzelot (puis transféré au nom de la Fondation elle-même en 1945). L'adoption d'un tel mode de fonctionnement n'était pas propre à l'école de chimie puisque toutes les autres écoles procédaient plus ou moins de la même manière. Ceci induisait fatale-ment une confusion des genres : en effet, le développement des écoles se faisait à l'aide d'une double comptabilité : d'une part, une comptabilité officielle régie par le code de l'administra-tion comptable publique et correspondant au budget de fonctionnement de l'école (subven-tions d'État, droits d'inscription des étudiants, taxe d'apprentissage) ; d'autre part, une compta-bilité 'officieuse' (mais tenue précisément à jour) correspondant aux dons consentis par les partenaires industriels de la Fondation. Un tel système arrangeait fondamentalement les écoles mais il n'était pas en conformité avec l'orthodoxie de la gestion comptable traditionnelle dans la mesure où il pouvait être source de confusions.
Comment pouvait-on distinguer les dons faits à la Fondation des versements de la taxe d'ap-prentissage ? Si les dons servaient à développer le fonctionnement de l'école, pourquoi n'étaient-ils pas inscrits dans le budget de fonctionnement global ? Quel était le statut fiscal des sommes versées à la Fondation ? L'existence de l'association dans les années d'après-guerre est fortement marquée par cette confusion et par ces interrogations. Plusieurs épisodes l'illustrent de manière particulièrement claire.
En 1956, Letort revenait assez longuement sur l'organisation financière de l'association dans une lettre adressée à Pavageau, qui était alors secrétaire-trésorier de la Fondation et directeur des Usines Solvay de Dombasle-sur-Meurthe. Pavageau venait probablement de prendre la succession de Pierron, l'ancien secrétaire de la Fondation, et il semble qu'il avait demandé à Letort des éclaircissements sur la structure financière de la Fondation. Dans sa lettre Letort exposait les raisons historiques motivant la création d'une comptabilité particulière pour la Fondation et, par conséquent, l'existence de deux comptes liés à la Fondation (ce qui, de son propre aveu, ne constituait pas une procédure totalement légale). Le ton de la lettre semblait indiquer que Pavageau n'était pas totalement d'accord avec Letort sur cette organisation. Ce dernier prenait donc bien soin de lui indiquer que sa réponse était destinée à laisser une trace écrite106 tout en lui rappelant qu'il n'avait pas manifesté de désaccord particulier lors des entre-tiens qu'il avait eu avec lui auparavant.107 Cette lettre est particulièrement intéressante puisque Letort y décrivait à la fois le montage financier de la Fondation et les difficultés pour faire valider celui-ci par les autorités comptables de l'université.
106 "Je crois utile de répéter par cette lettre, afin de laisser un document écrit, ce que je vous disais concernant le Compte en Banque que le Directeur de l'ENSIC possède sous le couvert de la Fondation…". Lettre de Letort à Pavageau datée du 26 mars 1956. Archives de l'ENSIC, chemise "Fondation scientifique des industries chimi-ques" (sous-chemise "Fondation divers"). 107 "Lorsque vous avez succédé à M. PIERRON, je vous ai fait connaître ces dispositions auxquelles vous avez donné votre agrément". Ibidem.
Rapport de Recherche
- 207 -
Avant la guerre, sous la direction de Travers, l'école avait ouvert à la Trésorerie Générale un compte pour l'école et elle disposait également d'un compte-chèque postal. Sous la pression de l'administration, Letort avait supprimé le premier compte mais il avait conservé le second, dont l'utilité était de pouvoir contrôler directement les droits d'inscription au concours d'en-trée :
"Déjà, le Professeur Alexandre TRAVERS, Directeur de l'École avait ouvert à la Trésore-rie Générale un compte pour l'École, puis ultérieurement, un compte chèque postal. En toute rigueur, l'École n'a pas le droit de disposer de tels comptes particuliers, puisqu'elle n'a pas l'autonomie financière et qu'en principe toutes ses recettes et dépenses doivent passer par l'Agent-Comptable de l'université. Mais cette situation manque de souplesse et, sous la pression des faits, toutes les Écoles se sont pourvues de comptes particuliers.
Il y a plusieurs années déjà, le Trésorier Payeur Général (qui précédait notre ami BER-GER) m'a mis en demeure de supprimer le compte à la Trésorerie. Cet accès de rigorisme m'a donc fait supprimer ce compte en versant ce qu'il possédait entre les mains de l'Agent-Comptable de l'université.
Le compte chèque postal est menacé également. En 1949 l'Administration des Finances en a ordonné, in abstracto, la suppression. Je n'ai pas obtempéré, non plus d'ailleurs que mes collègues. En 1953, je suis parvenu à repousser le même ordre (en rédigeant un rap-port auquel on n'a jamais répondu), bien que cette fois cet ordre s'adressait explicitement aux Écoles de la Faculté des Sciences de Nancy. Mais l'année dernière l'Administration des Finances est revenue à l'assaut. Aussi, cette liberté qui est encore laissée à l'École ris-que fort de disparaître un jour. Ce CCP ne sert plus que pour collecter les droits d'inscrip-tion au concours d'entrée dont on peut ainsi contrôler directement le versement".108
La suite de la lettre exposait clairement les modalités de gestion financière de la Fondation. En 1956, celle-ci possédait deux comptes à la Société Nancéienne : l'un géré par le secrétariat de la Fondation (en l'occurrence Pavageau) et sur lequel le directeur de l'école ne disposait d'aucun moyen de contrôle (Letort en ignorait même le numéro) ; l'autre où la Fondation ne faisait que prêter son nom et pour lequel le directeur de l'école avait la signature. Ce deuxième compte était alimenté uniquement par des recettes de l'école, sa comptabilité était rigoureu-sement tenue à jour par le secrétariat et elle pouvait être mise à la disposition du secrétaire de la Fondation.109 Formellement, d'après les indications de Letort, il semble que la procédure de communication entre les deux comptes s'établissait de la manière suivante : le compte géré par le secrétariat de la Fondation servait à recueillir les souscriptions des différents donateurs industriels. Chaque année, la Fondation versait une importante somme sur le compte géré par le directeur de l'école sous le libellé d'une grosse société française. Cette somme venait alors s'ajouter aux autres recettes qui parvenaient sur ce compte : les frais de laboratoire versés bénévolement par les entreprises finançant des étudiants en thèse dans les laboratoires de l'école et les frais d'analyse effectuées par certains enseignants.110 Les dépenses, quant à elles, étaient consacrées à l'achat de matériel et, exceptionnellement, au paiement du personnel
108 Ibidem. 109 Cette comptabilité était placée sous la responsabilité d'Anne-Catherine Steinhel, qui fut la secrétaire générale de l'ENSIC de l'après-guerre à 1967. Pour plus de détails sur sa carrière, cf. Aubry, "L'institut Chimique de Nancy et l'École Supérieure des Industries Chimiques de 1887 à 1946". In ENSIC (Ed.), Centenaire de l'ICN-ENSIC 1887-1987, Historique de l'École. Ouvrage contenant des notices historiques P. Barral et J.-L. Greffe. Nancy, Institut National Polytechnique de Lorraine, 1987, 13-63. 110 Traditionnellement, les frais d'analyse étaient répartis de la manière suivante : 75 % des frais pour rétribuer le travail d'analyse et 25 % pour les frais matériels. Lettre de Letort à Pavageau datée du 26 mars 1956. Archives de l'ENSIC, chemise "Fondation scientifique des industries chimiques" (sous-chemise "Fondation divers").
Genèse et Développement du Pôle Scientifique Nancéien
- 208 -
("qu'il est plus commode de régler ainsi plutôt que de passer par le lourd mécanisme financier administratif"). Letort terminait sa lettre en mentionnant son prochain remplacement par Hen-ri Wahl et son souhait que ce système de fonctionnement, malgré son caractère 'clandestin', soit reconduit :
"Étant donné le caractère de ce compte que l'Administration considérerait comme 'clan-destin', j'ai toujours attaché le plus grand soin à ce que cette comptabilité soit strictement tenue et à ce qu'aucune dépense ne soit faite dont le caractère serait discutable.
Pour conclure, je souhaiterais que mon successeur, le professeur Henri WAHL, disposât des mêmes facilités que moi ; qu'en conséquence ma signature disparaisse à ce compte et qu'on y substitue celle de M. Henri WAHL.
Je suis convaincu que celui-ci prendrait immédiatement l'engagement moral que vous aviez de ma part concernant la bonne gestion de ce compte et le droit de contrôle que vous pouvez en toute liberté exercer".111
Henri Wahl
Né à Nancy en novembre 1909, Henri Wahl était le fils d'André Wahl (1872-1944), qui occupa la chaire de chimie générale appliquée à l'industrie au Conservatoire national des Arts et Métiers. Celui-ci, alsacien d'origine et ingénieur chimiste de formation, se distingua tout particulièrement dans le domaine de la chimie des colorants. Après des études de physique et de pharmacie, Henri Wahl fut nommé chef de travaux à la Sorbonne, où il soutint un doctorat d'État en chimie organique. Wahl eut à souffrir de la guerre en raison de ses origines juives ; il fut ainsi destitué entre 1941 et 1944.112 À la Libération, il revint à Nancy en tant que suppléant sur la chaire de chimie appliquée à la teinture et à l'impression, occupée alors par Courtot. Il devint titulaire de cette chaire quelque mois plus tard, après le départ en retraite de Courtot. Il fut nommé directeur de l'ENSIC le 29 juin 1956113 et c'est sous son mandat que les travaux initiés par Maurice Letort, avec l'appui ministériel de Donzelot, arrivèrent à leur terme (bâtiment Déglin). En 1961 le ministère avait décidé de mettre un terme au projet de cons-truction d'une deuxième annexe de l'ENSIC. Cet arrêt correspondait à un changement d'orientation de la politique universitaire qui visait à promouvoir des campus 'à l'américaine' (et qui devait déboucher sur le déplacement de la faculté des sciences et des laboratoires de mathématiques, physique et chimie à Vandoeuvre-lès-Nancy. Ne pouvant mener les projets de l'ENSIC à leur terme, Wahl donna sa démission de la direction et prit la succession de son père sur la chaire qu'il occupait au CNAM.114
Quelques mois plus tard, en mai 1956, c'était au tour d'Henri Wahl d'écrire à Pavageau pour lui transmettre différents chèques qui lui avaient été adressés au titre de la Fondation. Il lui demandait de les verser sur le compte mis à disposition du directeur de l'école, ce qui semble attester que le mode de fonctionnement décrit par Letort était destiné à se perpétuer.
"Cher Monsieur,
111 Ibidem. 112 "Sur votre dossier administratif figure sur une ligne cette simple mention : cessation de service du 1er janvier 1941 au 1er décembre 1944, en application de la loi du 3 octobre 1940. Sur votre notice individuelle, vous avez placé le mot "loi" entre guillemets. Qu'il me suffise de dire que cela évoque pour vous les années de souffrances courageusement endurées, où vous étiez comme mis au ban de la société qui se prétendait officielle". Rapports sur l'activité des facultés, 1959 à 1961, Nancy, 1962, 3è partie, cérémonies d'inauguration, p. 523, 524, discours du Recteur Imbs. 113 En février 1956, Donzelot semblait vouloir poser sa candidature à la direction de l'ENSIC. À la demande de Wahl, le conseil de la faculté des sciences procéda à un vote, dont le résultat fut nettement en faveur de sa candi-dature (10 voix pour Wahl, 5 voix pour Barriol et un bulletin blanc). Procès vervaux du conseil de la Faculté des Sciences de Nancy, séance du 29 février 1956. 114 Concernant le départ de Wahl de Nancy, cf. l'article de Françoise Birck (note 143, page 267). La succesion de Wahl à la direction de l'ENSIC suscita de vives discussions universitaires. Ce fut finalement Jack Bastick qui le remplaça. Procès vervaux du conseil de la Faculté des Sciences de Nancy, séance du du 10 janvier 1962.
Rapport de Recherche
- 209 -
Comme suite à notre conversation téléphonique, je vous adresse ci-joint les quelques chèques actuellement en souffrance, dont certains remontent à plus d'un mois, et je vous serais très obligé de bien vouloir les endosser et les verser au compte :
FONDATION SCIENTIFIQUE DES INDUSTRIES CHIMIQUES
1, rue Grandville – Nancy
N° 600-37 4920
-------------------
À la SOCIETE NANCEIENNE DE CREDIT INDUSTRIEL, place Maginot, en attendant que la question de la signature soit réglée.
Pour nous permettre de tenir nos comptes à jour, les bordereaux de crédits ainsi que les extraits de comptes devraient nous être adressés, 1 rue Grandville, à Nancy, par la Ban-que ; il serait peut-être utile de le préciser en remettant ces chèques.
En vous remerciant par avance, je vous prie d'agréer, cher Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus amicaux et les plus dévoués".115
Cette lettre permet d'avoir une idée de la procédure standard d'une subvention à la Fondation. Les chèques étaient le plus souvent adressés à la direction de l'école. Celle-ci se chargeait alors de les transmettre au trésorier de la Fondation, à charge pour lui de les prendre en compte dans sa comptabilité et de les verser à la Société nancéienne de Crédit sur le compte dont le directeur de l'école possédait la signature.116 Ce mode d'organisation garantissait pro-bablement une bonne gestion comptable des sommes versées, celles-ci étant dûment enregis-trées par le secrétariat de l'école et par le secrétariat de la Fondation. Cependant, cette transpa-rence dans la gestion des fonds versés à l'école ne fonctionnait probablement que de manière interne. Du point de vue extérieur, les choses semblaient beaucoup moins claires. En témoi-gnent la confusion fréquente de certaines entreprises entre les dons versés à la Fondation et la taxe d'apprentissage ou encore les demandes d'éclaircissement de la Cour des Comptes en 1958.
Concernant le premier point, on citera à titre d'exemple l'épisode du 'Lion Noir'. La direction de l'Enseignement technique au ministère de l'Éducation nationale avait pour rôle de contrôler la collecte de la taxe d'apprentissage et elle avait été intriguée par une demande d'exonération de cette taxe provenant de cette société. Le 30 mars 1949, elle écrivait ainsi à Letort pour lui soumettre le problème :
"Monsieur le Directeur,
115 Lettre de Wahl à Pavageau, datée du 18 mai 1956. Archives de l'ENSIC, chemise "Fondation scientifique des industries chimiques" (sous-chemise "Fondation divers"). Cette lettre était accompagnée d'un bordereau d'envoi précisant la nature des quatre chèques en question : un chèque des Établissements Gantois à Saint-Dié (2.000 F), un chèque de Gabriel Petit (7.000 F), un chèque de la Société d'Électrochimie d'Ugine (18.000 F.) et un chèque de 10.000 F de l'IRSID (Institut de Recherche de la Sidérurgie). 116 Ce fait est confirmé par cette autre lettre envoyée par Letort à Pierron durant l'année 1951 : "Je reçois par mandat-carte, adressé directement à l'école, la somme de 1.000 Frs (mille Francs) représentant la cotisation pour la Fondation, de la Société Anonyme OUTREMER-DESCHAMPS frères (142 rue Réaumur –Paris 2°) pour 1951. Je tiens ce billet de 1.000 Frs à votre disposition. À mon avis, la meilleure façon de procéder serait que vous portiez dans vos comptes cette somme comme "rentrée" et comme immédiatement "sortie" au profit de la petite caisse "Fondation" que je détiens. Par contre, il serait nécessaire que vous veuilliez bien accuser réception à la Sté Outremer-Deschamps". Archives de l'ENSIC, chemise "Fondation scientifique des industries chimiques" (sous-chemise "Fondation divers").
Genèse et Développement du Pôle Scientifique Nancéien
- 210 -
L'exonération de la Taxe d'Apprentissage pour l'exercice 1947 est demandée devant la Commission Permanente du Conseil Supérieur de l'Enseignement Technique par la Socié-té des Produits Chimiques "Lion Noir", 43 rue de Liège – Paris 8°, qui invoque dans sa requête une subvention de : 5.000 Frs versée à votre École le 20 juin 1946.
Pour permettre à la Commission précitée de se prononcer sur la réalité et sur l'utilité de cette subvention, je vous serais obligé de me faire connaître :
1°) Si la subvention a été effectivement reçue par vous, à quelle date ?
2°) À quelle dépense d'enseignement technique ou d'apprentissage a-t-elle été employée ou affectée ?
3°) À quelle date a été effectuée cette dépense ou cette affectation ?
Ces renseignements qui doivent me parvenir sous votre signature, sont destinés à être joints au dossier de l'affaire susvisée".117
La société "Lion Noir" souhaitait visiblement bénéficier d'une exonération de cette taxe, dans la mesure où elle avait versé une subvention à la Fondation scientifique des industries chimi-ques en 1946.118 Indubitablement, il y avait là confusion entre don gratuit et taxe d'apprentis-sage. Par conséquent, le 4 avril 1949 Letort écrivait au directeur de la société pour clarifier la situation :
"Monsieur le Directeur,
La Direction de l'Enseignement technique nous interroge au sujet d'une subvention de Frs 5.000 - que vous auriez versé à notre École au titre de la Taxe d'Apprentissage en 1946.
Recherches faites, nous ne trouvons pas cette subvention parmi celles reçues au titre de la Taxe d'Apprentissage à la date indiquée.
Toutefois, nous nous demandons s'il n'y aurait pas confusion avec un versement que vous avez fait à cette époque à la Fondation scientifique des industries chimiques à l'École su-périeure des Industries chimiques de Nancy.
Comme M. Pierron, Directeur des Établissements Solvay à Dombasle, Secrétaire de la Fondation scientifique des industries chimiques vous l'indiquera lui-même, d'après les statuts de cette Fondation, les sommes qui lui sont versées doivent être considérées comme des dons et ne sont pas susceptibles d'exonération comme les subventions faites au titre de la Taxe d'Apprentissage".119
117 Lettre du directeur de l'Enseignement Technique à Maurice Letort, 30 mars 1949. Archives de l'ENSIC, chemise "Fondation scientifique des industries chimiques" (sous-chemise "Fondation divers") 118 Cette société avait d'ailleurs versé régulièrement des subventions à la Fondation depuis sa création. Voir le tableau page 203. 119 Lettre de Letort au Directeur de la Société "Lion Noir", 4 avril 1949. Archives de l'ENSIC, chemise "Fonda-tion scientifique des industries chimiques" (sous-chemise "Fondation divers"). Notons que quelques jours plus tard, Letort transmettait cette lettre au trésorier Pierron pour lui demander de prendre acte de ce problème : "Il semble bien qu'il y a eu là une fois de plus confusion entre les dons faits à la Fondation scientifique des indus-tries chimiques et les subventions versées au titre de la Taxe d'Apprentissage. Ne serait-il pas souhaitable que, pour votre part, vous expliquiez la situation à la Société "Lion Noir" ? Je pense qu'après les précisions que nous aurons données ainsi à cette Société, celle-ci retirera sa demande d'exonération présentée à la direction de l'En-seignement technique. Avant de répondre à la Direction de l'Enseignement technique, je préfère attendre que cette situation soit mise au point directement avec la Société "Lion Noir", et à ce titre je vous serais obligé de me faire connaître la réponse que vous recevrez éventuellement de cette Société". Lettre de Letort à Pierron, datée du 11 avril 1949. Archives de l'ENSIC, chemise "Fondation scientifique des industries chimiques" (sous-chemise "Fondation divers").
Rapport de Recherche
- 211 -
Cet épisode se régla probablement rapidement mais on ne trouve aucune trace de son dé-nouement dans les Archives de l'école. Cependant, cette confusion entre dons faits à la Fonda-tion et taxe d'apprentissage apparaît à plusieurs reprises, signe que pour bien des entreprises la situation n'était pas toujours très claire.120
Cette ambiguïté financière perdura quelques années. En janvier 1958, l'ENSIC fut sommée par la Cour des Comptes, lors d'une enquête sur l'Université de Nancy, de donner des explica-tions sur le fonctionnement de la Fondation. Henri Wahl, son directeur de l'époque, écrivait ainsi le 11 janvier à Aubertin, le président de la Fondation :
"Monsieur le Président,
Je crois devoir vous informer que la Cour des Comptes, à l'occasion d'une vérification de la Comptabilité de l'Université de Nancy, vient de poser un certain nombre de questions très indiscrètes sur le fonctionnement de la Fondation.
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint copie de la lettre émanant de la Cour des Comptes, ainsi que de ma réponse à ses questions.
Je pense que cette affaire n'ira pas plus loin, étant donné que la Fondation n'est jamais in-tervenue dans le Budget de l'École, contrairement à ce qui s'est produit, à ma connais-sance, pour l'École de Brasserie et l'École de Géologie. En cas de besoin, je vous tiendrai au courant des suites que l'Administration donnera à cette question. […]".121
On peut noter que les renseignements demandés par l'auditeur de la Cour des Comptes sem-blaient pour le moins anodins : date de création de l'association, nom et qualités de ses diri-geants, nature de ses recettes et relevés d'opérations. Cependant, bien qu'elle ait pour vocation d'intervenir dans le développement de l'école et de financer les enseignements et la recherche, la Fondation était selon Wahl une entité indépendante de l'école, dont les dons privés ne figu-raient pas dans la comptabilité de l'école. Par conséquent, dans sa lettre au recteur Wahl ré-pondit que la Cour des Comptes n'avait pas qualité pour s'intéresser aux statuts et au fonction-nement de la Fondation.
Les archives ne permettent pas de connaître l'issue de cet épisode mais on peut s'interroger sur la légitimité de cette réponse, connaissant la contribution importante apportée par la Fonda-tion aux professeurs pour les laboratoires de l'école (cf. page 205).
B°/ Moderniser les enseignements et la recherche
Comme on a pu le voir, la Fondation avait pour vocation de contribuer au développement des enseignements et de la recherche à l'ENSIC en apportant une contribution financière au bud-get de l'école. Au-delà de l'apport matériel, les avantages pour l'ENSIC étaient indéniables : meilleure visibilité de l'école vis-à-vis des partenaires industriels, possibilités de stages en entreprise pour les élèves, opportunités de carrière pour les jeunes diplômés, meilleure attrac-tivité pour les élèves des classes spéciales, etc. Du côté des donateurs, l'avantage évident était la possibilité d'avoir un accès privilégié à des jeunes diplômés et, dans une certaine mesure,
120 Ainsi le 24 janvier 1951, Letort adresse une autre lettre à Pierron pour lui soumettre un cas similaire concer-nant la Société Péchiney : "Je reçois aujourd'hui ce chèque de la Société PECHINEY accompagné de la lettre ci-jointe. Manifestement, il y a erreur d'orientation et c'est au Secrétaire de la Fondation que lettre et chèque au-raient dû être adressés. Une fois de plus, il y a eu confusion entre les dons bénévoles à la Fondation et d'autre par les subventions au titre de la Taxe d'Apprentissage versées directement à l'école". Archives de l'ENSIC, chemise "Fondation scientifique des industries chimiques" (sous-chemise "Fondation divers"). 121 Archives de l'ENSIC, chemise "Fondation scientifique des industries chimiques" (sous-chemise "Fondation divers").
Genèse et Développement du Pôle Scientifique Nancéien
- 212 -
d'infléchir le contenu des formations dans une direction convenant aux besoins de l'industrie chimique.
On ne peut évidemment affirmer que la Fondation fut le seul moteur de l'évolution de l'EN-SIC dans l'après-guerre ou que l'infléchissement de ses stratégies de formation et de recherche fut le seul fait de ses contacts avec les milieux industriels. Cependant, on ne peut que consta-ter les efforts de la direction de l'école pour mettre en avant auprès d'eux son dynamisme et son ouverture sur les problématiques de l'application industrielle. Les assemblées générales de la Fondation offraient donc l'occasion de rendre compte de l'évolution positive de l'école auprès des partenaires industriels, tant au niveau de son recrutement (toujours dans la conti-nuité de la réforme Travers) qu'au niveau des programmes d'enseignement (l'orientation vers la chimie physique et le génie chimique).
En 1952, Maurice Letort proposait ainsi un bilan des actions entamées pour moderniser l'école dans les années 1946-1951. Il mentionnait au premier chef la transformation de l'ESIC en ENSIC qui, selon lui, était liée à la réussite du système Travers :
"En 1948, l'épithète de 'Nationale' a été ajoutée à ce titre [ESIC] sans que rien n'ait été changé dans le fonctionnement de l'École. De fait, ce sont les résultats heureux de la 'ré-forme Travers' qui ont inspiré au ministère de l'Éducation nationale la création au sein des facultés des sciences des Écoles Nationales Supérieures d'Ingénieurs (Décret du 16 jan-vier 1947).122 Les traits essentiels de la réforme Travers, sont d'avoir instauré :
1) Une sélection sévère des candidats à l'entrée de l'École grâce à un concours difficile du niveau du programme d'entrée à l'École Polytechnique.
2) Un relèvement très sensible du niveau des études, spécialement par l'introduction d'en-seignements poussés de physique, de chimie physique et sur l'art de l'ingénieur".123
Un certain nombre d'indicateurs permettaient à la direction de mesurer la visibilité et l'image de l'école auprès des élèves de classes spéciales. D'une part, l'évolution du nombre de candi-dats au concours ; d'autre part, le nombre de candidats qui, reçus à d'autres concours, avaient démissionné pour entrer à l'ENSIC (sur ces deux points, cf. page 213). Enfin, les classements de sortie de l'École nationale supérieure du Pétrole permettaient, selon Letort, d'évaluer la qualité objective des élèves de l'ENSIC : certains jeunes diplômés allaient en effet suivre une année de spécialisation dans cette école ; or, dans la période 1946-1951, cinq de ces élèves sur six s'étaient classés parmi les quatre premiers des promotions 1948, 1949 et 1950.
Juin-Juillet 1946 1947 1948 1949 1950 1951
Nombre de places mises au concours 32 32 30 28 28 30
Nombre de candidats 367 342 317 355 381 447
Nombre d'admissibles (oral) 148 124 133 121 132 145
Fin de la liste supplémentaire N° 60 N° 72 N° 83 N° 76 N° 71 N° 92
N° du dernier admis à l'école N° 50 N° 64 N° 60 N° 71 N° 64 N° 61
Sa moyenne générale au concours (sur 20) 11,14 10,3 11,4 11,06 10,8 11,7
122 Les propos de Letort contribuent à enraciner la légende suivant laquelle la réforme de l'école aurait inspiré la l'action du ministère de l'Éducation nationale, alors que les décrets de 1947 ont été pris dans la foulée de la commission Langevin-Wallon qui entendait justement remettre en cause le système classes préparatoires / concours / grandes écoles (cf. article F. Birck, encadré, p. 257). 123 Maurice Letort, "Rapport sur l'activité de l'école nationale supérieure des industries chimiques de l'Université de Nancy de 1946 à 1951", février 1952. Archives de l'ENSIC, chemise "Fondation scientifique des industries chimiques" (sous-chemise "Assemblées générales").
Rapport de Recherche
- 213 -
Évolution du nombre de candidats au concours de l'ENSIC (1946-1951)124
1946 1947 1948 1949 1950 1951
École Polytechnique 1 - - - - -
École Centrale 8 4 1 2 3 8
École des Mines de Paris 1 1 - - - -
École des Mines de Nancy 4 7 3 3 2 4
École des Mines de Saint-Étienne 8 3 1 4 1 2
École des Ponts et chaussées 3 - - - - 1
École Supérieure d'Aéronautique 3 - - 1 1 2
École Nationale Supérieure d'Aéronauti-que de Poitiers
- - - 1 - 2
École Nationale Supérieure d'Électricité et de Mécanique de Nancy
3 5 8 6 3 6
Total 31 20 13 17 10 25
Démissionnaires au profit de l'ENSIC (1946-1951)125
À partir de 1946, sous l'influence de Letort, l'école infléchit progressivement son programme d'enseignement afin de le mettre en phase avec l'évolution des disciplines scientifiques et les bouleversements de la chimie industrielle : transformation de la chaire de chimie tinctoriale (occupée par Courtot jusqu'à sa retraite en 1947) en chaire de chimie organique industrielle (Henri Wahl) ; introduction d'enseignements de biochimie (Urion), de cristallographie (Long-chambon), d'analyse des solides aux rayons X (Longchambon) ; augmentation du volume d'heures consacrées à la cinétique chimique ; création, en 1948, d'une chaire de chimie théori-que (Barriol) ; mise en place d'enseignement de physique moléculaire (Barriol) et d'électroni-que appliquée ; rénovation des programmes et des installations de travaux pratiques (à raisons de 16 heures par semaine) ; création d'un département de spectroscopie et augmentation très nette du nombre d'heures consacrées à la chimie physique.
Maurice Letort, directeur de l'ESIC-ENSIC de 1946 à 1956
Henri Wahl, directeur de l'ENSIC de 1956 à 1961126
124 Ibidem. 125 Ibidem. 126 Source des documents photographiques de cette page : Centenaire de l'ICN-ENSIC, 1887-1987.
Genèse et Développement du Pôle Scientifique Nancéien
- 214 -
V°/ L'ouverture vers le génie chimique Pendant longtemps, la formation des ingénieurs chimistes, en France comme à l'étranger, demeura centrée sur l'enseignement de la chimie industrielle. Cet enseignement consistait essentiellement en des descriptions qualitatives des procédés et des appareils utilisés dans les industries chimiques. Il était parfaitement adapté tant que l'on produisait relativement peu et que les procédés de fabrication se modifiaient lentement. Avec l'accélération du développe-ment de l'industrie chimique, notamment aux États-Unis, on se rendit rapidement compte des limites d'un tel système. Vers 1915-1920 émergea le principe des opérations unitaires : l'idée était que tout procédé industriel pouvait se ramener à une combinaison d'un nombre restreint d'opérations physiques dites unitaires : broyage, filtration, distillation, absorption, etc. Arthur D. Little joua un rôle essentiel dans ce processus, ainsi que trois professeurs du MIT - Walker, Lewis et McAdams - qui publièrent l'un des premiers ouvrages sur le chemical engineering.127
C'est sur ces bases précises que se constitua le chemical engineering américain. Pour des raisons diverses, cette nouvelle manière de définir la chimie industrielle ne fit guère recette en France avant la seconde guerre mondiale : le terme de chemical engineering fut traduit en français par génie chimique. Malgré son caractère ambiguë (fallait-il par exemple traduire chemical engineer par ingénieur chimiste ou par ingénieur du génie chimique ?), cette expres-sion s'installa rapidement dans le vocabulaire francophone et fut notamment reprise par les différents acteurs de son acclimatation en France, avec parfois des nuances sémantiques subti-les d'un auteur à l'autre.128 À partir des années 1950, certains chercheurs américains et euro-péens se fixèrent pour objectif de constituer le génie chimique comme une discipline scienti-fique autonome et proposèrent de ramener les opérations unitaires à des concepts encore plus simples : phénomènes de transport de chaleur, de transport de matière et de transport de quan-tité de mouvement au sein de phases. Ces concepts devaient déboucher sur l'émergence de la cinétique physique qui, plutôt que d'examiner successivement diverses opérations physiques unitaires, s'intéressait aux lois communes à tous ces phénomènes et les traitait par le calcul à partir de trois sortes de relations : les principes de conservation, les lois d'équilibre et les lois cinétiques.
127 Little, Report of Committee on Chemical Engineering Education of the American Institute of Chemical Engi-neers, 1922. Walker, Lewis, et al., Principles of Chemical Engineering. New-York, Mac Graw Hill, 1923. Notons que les fondements du chemical engineering semblent nettement plus anciens puisqu'il est possible de trouver trace des premiers enseignements dans ce domaine dans les années 1880 au MIT : Weber, "The Impro-bable Achievement, Chemical Engineering at the MIT". In Furter (Ed.), History of Chemical Engineering. Washington, American Chemical Society, 1980, 76-95. Williams & Vivian, "Pioneers in Chemical Engineering at MIT". In Furter (Ed.), History of Chemical Engineering, 1980, 95-105. 128 Notre propos ne sera pas ici de retracer l'histoire de l'émergence du génie chimique aux États-Unis et de son acclimatation en Europe et en France. Sur ces deux points spécifiques, nous renvoyons le lecteur aux sections bibliographiques pages 230 et 231. Concernant les problèmes de traduction du terme de chemical engineering on se référera à l'article suivant : Coeuret, "Ingénieur-chimiste ou ingénieur chimiste ?" L'actualité chimique, 2003 (juin), 30-36. Pour un aperçu récent de l'histoire française du génie chimique, on consultera de préférence : Breysse, Du génie chimique au génie des procédés : émergence en France d'une science pour l'ingénieur (1947-1991) - Mémoire de DEA (non publié). Paris, CNAM - Centre d'Histoire des Techniques, 2004. Detrez, "L'évolu-tion de l'École Nationale Supérieure de Chimie de Nancy vers le génie chimique". In Birck & Grelon (Eds), Des ingénieurs pour la Lorraine, 19ème-20ème siècles. Metz, Éditions Serpenoise, 1998, 239-249. Grossetti & Detrez, "Sciences d'ingénieurs et sciences pour l'ingénieur : l'exemple du génie chimique", Sciences de la société 49, 2000, 63-82. Pour un aperçu des débats sémantiques concernant la définition du génie chimique en France - notamment les discussions indirectes entre Pierre Le Goff (Nancy) et Joseph Cathala (Toulouse) – on se référera à Grossetti & Detrez, Le Génie Chimique en France : la difficile genèse d'une science appliquée (texte non publié). Congrès de l'European Association for the Study of Science and Technology, Lisbonne, 1998.
Rapport de Recherche
- 215 -
Revenant en 1976 sur l'histoire récente du génie chimique, Pierre Le Goff - l'un des princi-paux acteurs du développement de cette discipline à Nancy129 – affirmait que cette discipline reposait sur six sciences de base : (a) la thermodynamique physique et la thermodynamique chimique, (b) la cinétique physique et la cinétique chimique, (c) la science des milieux poreux et dispersés (textures granulaires), (d) la science des matériaux, (e) l'analyse des systèmes et (f) l'optimisation.130 Une telle caractérisation, on s'en rend compte aisément, était fortement éloignée d'une conception classique de la chimie et faisait la part belle à la physique et à la mécanique (et historiquement les mécaniciens jouèrent un rôle moteur dans l'émergence du génie chimique).
Sélection sévère des candidats et relèvement du niveau des études furent les deux maîtres-mots de la direction de l'école dans les années d'après-guerre. Ils vinrent légitimer les réfor-mes des programmes d'enseignement et notamment l'introduction du génie chimique à Nancy. Cette orientation de l'ENSIC vers une nouvelle discipline vint renforcer la stratégie élitiste de l'école amorcée depuis la réforme Travers. Elle lui permit aussi de développer une identité spécifique dans le paysage des écoles de chimie en France, passant ainsi du statut d'une école classique centrée sur la 'vieille' chimie industrielle au statut d'école dynamique, pionnière d'une nouvelle discipline scientifique importée des États-Unis et annonciatrice de l'émergence des sciences de l'ingénieur.
Bien évidemment cette nouvelle orientation allait dans le sens des attentes des grands groupes industriels français et internationaux131 au sortir de la seconde guerre mondiale et ce n'est donc pas un hasard si la mise en place d'enseignements et de recherches en génie chimique oc-cupent une large place dans les débats de la Fondation scientifique des industries chimiques à partir des années 1950. C'est donc à travers ce filtre particulier que nous nous proposons de rendre compte de la montée en puissance de cette nouvelle discipline à Nancy.
A°/ L'émergence d'une nouvelle discipline à Toulouse et à Nancy
L'installation du génie chimique en France, comme discipline d'enseignement et de recherche, se fit d'abord à Toulouse sous l'influence de Joseph Cathala. En 1931, Cathala avait succédé à Paul Sabatier sur la chaire de chimie de la Faculté des sciences de Toulouse et il avait pris la direction du laboratoire d'électrochimie. En quelques années, il entreprit une réforme com-plète de ce laboratoire en le transformant en 'usine chimique d'enseignement'. Un séjour de trois ans au Canada lui avait en effet permis de découvrir à partir de 1927 les avancées du chemical engineering américain :
"C'est durant un séjour à l'Université canadienne de Québec que nous avons mûri les idées qui ont servi de base à la transformation du Laboratoire d'Électrochimie de la Fa-culté des sciences de Toulouse, laboratoire classique de recherche et d'enseignement, en un laboratoire puissamment outillé de Génie Chimique.
Nos contacts avec l'Industrie Chimique canadienne et américaine nous ont convaincu que l'essor prodigieux qui s'amorçait en 1927 était dû non seulement au développement des recherches chimiques pures dans les laboratoires scientifiques américains, mais égale-ment à l'apparition et au développement d'une nouvelle discipline chimique désignée par
129 Il avait fondé à Nancy en 1964 le Centre de Cinétique Physique et Chimique, laboratoire propre du CNRS. 130 Le Goff, "Qu'est-ce que le génie chimique ?" Association amicale des anciens élèves de l'École Nationale Supérieure des Industries Chimiques 66, 1972, 11-22. 131 L'industrie chimique américaine (notamment Du Pont de Nemours) contribua de manière essentielle à l'émer-gence du génie chimique. Voir ainsi : Ndiaye, Pap, Du nylon et des bombes. Du Pont de Nemours, le marché et l'État 1910-1960. Paris, Belin, 2001.
Genèse et Développement du Pôle Scientifique Nancéien
- 216 -
les Américains sous le terme de 'Chemical Engineering'. Cette branche spéciale de la Chimie se consacre à l'étude des problèmes particuliers qui se posent lorsque l'on veut transplanter dans la technique industrielle une réaction complètement étudiée en labora-toire".132
Après ce séjour en Amérique du Nord, Cathala s'efforça de faire connaître le chemical engi-neering auprès de ses collègues et des industriels de la région toulousaine. Au début de l'an-née 1936, son laboratoire bénéficia d'importants dons de matériels industriels et de crédits ministériels (800.000 F. du ministère de l'Éducation nationale et 400.000 F. du ministère des Travaux publics). Cela lui permit de construire et d'équiper un laboratoire industriel et d'éla-borer des programmes de recherches avec des partenaires industriels. L'un d'eux devait dé-boucher sur l'élaboration d'un procédé électrothermique d'extraction de l'acide sulfurique à partir du gypse. De 1937 à 1940, Cathala bénéficia également d'un appui financier constant du ministère de la Défense nationale (notamment du Service des Poudres), en raison de ses tra-vaux sur la production d'acide sulfurique. Le déclenchement de la guerre porta un frein à tous ces efforts.
En juin 1940, au moment de l'armistice, Cathala décida de se réfugier en Grande-Bretagne où il travailla avec l'équivalent britannique du Service des Poudres à la fabrication d'acide nitri-que et d'oxygène. De retour en France après la guerre, il devait mobiliser tous ses efforts pour mettre en place à Toulouse un enseignement spécialisé de génie chimique sanctionné par un diplôme. Un arrêté ministériel du 17 mars 1948 transforma le diplôme d'ingénieur électrochi-miste de l'Université de Toulouse en diplôme d'ingénieur du génie chimique. L'année sui-vante, en avril 1949 était officiellement créé l'Institut de Génie chimique de Toulouse. Il déli-vrait le diplôme à l'issue d'un cursus de 2 ans, soit après une licence ès sciences, soit après un diplôme d'ingénieur. La première promotion, constituée en 1947, comptait initialement 7 candidats. Deux étudiants abandonnèrent le cursus et, au final, seuls 5 étudiants reçurent leur diplôme d'ingénieur du génie chimique en 1949.133
À Nancy, la situation était toute autre. Avant la seconde guerre mondiale, on ne trouve pas trace d'un quelconque intérêt des responsables de l'école pour le chemical engineering. Pierre Donzelot et Maurice Letort ne commencèrent, semble-t-il, à s'intéresser à cette nouvelle dis-cipline que durant les années d'Occupation. Letort raconta ainsi que Donzelot était fasciné par la réussite du modèle américain et qu'ils avaient souvent des échanges à propos du chemical engineering :
"Quels souvenirs pour moi que ces longues conversations – c'était un des très rares avan-tages de l'Occupation – avec Pierre Donzelot où, sur un mode toujours plaisant, nous dis-cutions de cette belle et grande idée ainsi que d'autres sujets graves. Quel programme ra-tionnel et satisfaisant fallait-il adopter et, pour le réaliser, quels seraient les professeurs dont il conviendrait de provoquer la nomination ? Qu'était-ce donc que ce 'chemical engi-neering' des Américains dont nous commencions à entendre parler par de vagues informa-tions filtrant de Belgique ? Comment se sortir des dangers de l'heure ? Comment, sans
132 Rapport de Joseph Cathala au CNRS, "Historique, Programme futur de recherches, Besoins en personnel et en matériel, Budget et financement", Toulouse, 1er mars 1946. Centre des Archives Contemporaines de Fontaine-bleau, F800284, article 229. 133 Jusqu'aux années 1960, la taille des promotions demeura relativement modeste : 9 diplômés en 1956, 16 en 1957, 13 en 1958, 13 en 1959. Breysse, Du génie chimique au génie des procédés : émergence en France d'une science pour l'ingénieur (1947-1991) - Mémoire de DEA (non publié). Paris, CNAM - Centre d'Histoire des Techniques, 2004.
Rapport de Recherche
- 217 -
moyens et pratiquement sans élèves de thèse, faire malgré tout un peu de recherche et sur-tout, dans ce domaine, comment préparer l'après guerre ?"134
En revanche, dans les années d'après-guerre, la direction de l'école s'intéressa attentivement aux initiatives de Cathala à Toulouse et tenta de jouer sa carte dans ce domaine. Un épisode illustre ce fait de manière particulièrement éclairante. Comme nous l'avons mentionné aupa-ravant, la carrière de Donzelot le conduisit à partir de 1946 vers les instances nationales de l'enseignement et de la recherche, et c'est Letort qui lui succéda à la direction de l'ENSIC. En 1948, Donzelot fut nommé directeur général de l'Enseignement supérieur au ministère de l'Éducation nationale. Ce poste très haut placé lui permettait d'avoir un regard surplombant sur l'évolution des formations d'ingénieurs en France. Et c'est en fait lui qui supervisa l'im-plantation du génie chimique à Toulouse puis à Nancy.
En août 1949, il recevait ainsi un volumineux rapport de Cathala faisant état des premiers résultats de la toute jeune formation au génie chimique toulousaine. Dans la lettre accompa-gnant ce rapport, Cathala faisait appel à la double expertise (ministérielle et universitaire) de Donzelot et lui expliquait en détail les réalisations de l'Institut du Génie chimique en matière d'enseignement et de recherche.
"C'est pour moi un agréable devoir de vous adresser le rapport préparé à la fin de l'année scolaire pour les membres du conseil d'administration de l'INSTITUT DU GENIE CHI-MIQUE. J'ose espérer que vous estimerez que nous pouvons, sans fausse modestie, être satisfaits des résultats de nos efforts. […] Je désirerais beaucoup que vous puissiez juger sur pièces les résultats de notre enseignement, et que vous ne me ménagiez pas vos criti-ques, non seulement à titre de Directeur de l'Enseignement supérieur, mais également comme ancien Directeur de NANCY".135
Donzelot n'oublia pas ses anciens collègues de Nancy et transmit l'ensemble des documents pour expertise à Maurice Letort.136 Ceux-ci arrivèrent probablement à point nommé à Nancy. En effet, Letort était convaincu qu'il se passait quelque chose de très important aux États-Unis autour du chemical engineering. Probablement informé par Donzelot des initiatives de Catha-la, il avait invité ce dernier à Nancy dès 1948 pour y prononcer trois conférences. Quelques mois plus tard, il profitait d'un congrès aux États-Unis pour faire une tournée de plusieurs semaines dans le pays pour visiter différents départements de génie chimique (dont celui du MIT) et pour rencontrer quelques représentants de cette discipline (dont Piret à Minneapolis). Finalement, c'est Donzelot qui signa le décret de création de l'Institut du Génie Chimique de Toulouse en avril 1949.137
Il est probable que Cathala ne saisit pas sur le champ l'importance de son projet. Ainsi, avant 1945, l'essentiel de ses efforts se portèrent, semble-t-il, sur la mise en place de dispositifs pédagogiques à échelle quasi-réelle, sans qu'il perçoive la possibilité de définir une nouvelle
134 Letort, "Éloge de Pierre Donzelot, allocution de M. Jack Bastick, Membre de l'Académie des Sciences, Direc-teur Honoraire de l'École Nationale Supérieure des Industries Chimiques de Nancy". In ENSIC (Ed.), Hommage à Pierre Donzelot. Nancy, ENSIC, 1966, 27-39. 135 Lettre de Joseph Cathala à Pierre Donzelot, 24 août 1949, Archives de l'ENSIC. 136 Donzelot transmit même à Letort la lettre qu'il avait reçue de Cathala et qui portait sur sa première page la mention 'Personnelle' : "Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joints quelques documents sur lesquels je vous serais reconnaissant de me fournir votre avis. Serez-vous assez aimable pour me renvoyer le tout après en avoir pris connaissance ?". Lettre de Donzelot à Letort, 2 septembre 1949, Archives de l'ENSIC. 137 Grossetti & Detrez, Le Génie Chimique en France : la difficile genèse d'une science appliquée (texte non publié). Congrès de l'European Association for the Study of Science and Technology, Lisbonne, 1998.
Genèse et Développement du Pôle Scientifique Nancéien
- 218 -
discipline à partir des opérations unitaires.138 À travers la création de l'Institut du Génie Chi-mique de Toulouse, Cathala joua la carte du développement monodisciplinaire et de l'hypers-pécialisation. L'ENSIC, en revanche, cultiva sa personnalité en adoptant une posture plus ouverte : ni véritable école de chimie, ni véritable école de génie chimique, elle choisit de ne proposer ce nouvel enseignement qu'à titre d'enseignement de spécialisation et, surtout, d'in-sister sur la continuité que pouvait représenter le génie chimique par rapport à l'ancienne chi-mie industrielle. Ainsi, en 1950, dans une allocution en l'hommage d'Albin Haller, Letort affirmait que les besoins de l'industrie "exigent de l'ingénieur chimiste moderne une connais-sance approfondie de cette discipline nouvelle qui lui est propre, et qu'on appelle maintenant le 'génie chimique', ou comme nous le faisons à Nancy, physico-chimie industrielle".139 Letort concentra d'abord ses efforts sur la création d'un service de génie chimique dans l'école en invitant à Nancy plusieurs professeurs américains.140
René Gibert fut le premier professeur de l'école à introduire le génie chimique dans ses ensei-gnements et ses recherches en 1949.141 Les premiers cours dans ce domaine représentaient 4H30 par semaine en troisième année. Cependant, il ne se concentrait pas sur les opérations unitaires mais sur les phénomènes de transfert. À partir de 1951, il transforma progressive-ment ses cours de chimie industrielle pour leur conférer une orientation de génie chimique. Il fut nommé en 1952 sur la première chaire de génie chimique créée en France.142
Cependant, le principal promoteur du génie chimique à Nancy devait être Pierre Le Goff. Le Goff avait fait ses études d'ingénieur à l'ENSIC durant les années d'Occupation. Il avait été très vite repéré par Letort pour son dynamisme et celui-ci l'avait donc orienté vers une thèse de chimie fondamentale. Ce n'est qu'après sa thèse, en 1955, que Letort lui confia la charge de se convertir au génie chimique et d'installer dans l'école un département de génie chimique.
138 Cathala écrivit après la guerre qu'il avait dû procéder très prudemment et qu'il ne prononça jamais le mot de de 'génie chimique' avant 1945. Grossetti et Detrez interprètent ce souvenir, à la fois comme le signe d'un conflit avec les chimistes locaux et comme une incapacité à saisir la portée de son entreprise avant la guerre. Seul son séjour en Grande-Bretagne pouvait, selon eux, l'amener à entrevoir la possibilité de définir une nouvelle disci-pline au-delà des améliorations pédagogiques. Ibidem, page 12. 139 Letort, "Hommage à Albin Haller", Bulletin de la Société Chimique de France 17, 1950, 950. Cité dans Grossetti & Detrez, Le Génie Chimique en France : la difficile genèse d'une science appliquée (texte non pu-blié). Congrès de l'European Association for the Study of Science and Technology, Lisbonne, 1998. Bien plus tard, en 1962, Le Goff devait défendre une position similaire en affirmant, au cours d'une conférence prononcée en Belgique, que dans le programme appliqué à Nancy, le génie chimique était essentiellement conçu comme l'application industrielle de la chimie physique. Grossetti & Detrez, Le Génie Chimique en France : la difficile genèse d'une science appliquée (texte non publié). Congrès de l'European Association for the Study of Science and Technology, Lisbonne, 1998. 140 Entre 1950 et 1954, plusieurs professeurs américains se succédèrent dans l'école : E. L. Piret (1950 et 1951), B. J. Dodge (1951), C. O. Benett (1952), A. Rose (1953-1954). 141 Il était alors maître de conférences. 142 On ne trouvera aucune trace de la notion de génie chimique dans la revue Chimie et industrie avant 1951, dans un article signé par Piret : "Cette branche du génie s'est développée surtout aux États-Unis. […] En Angle-terre et récemment en Belgique, certains efforts ont été entrepris pour développer des programmes similaires. En France, les efforts ont été jusqu'à présent presqu'uniquement ceux de M. Cathala, pionnier francais dans ce domaine dont la persévérance a réussi à créer une première installation à Toulouse. […] L'École nationale supé-rieure des Industries chimiques de Nancy s'est intéressée au domaine du Génie Chimique, et elle amorce mainte-nant un développement beaucoup plus considérable qui, s'il est vigoureusement poursuivi et soutenu, sera une contribution importante et essentielle à l'avenir économique de la France". Cf. Piret, "Qu'est-ce que le génie chimique ?" Chimie et industrie 66 (2), 1951. Voir aussi Grossetti & Detrez, "Sciences d'ingénieurs et sciences pour l'ingénieur : l'exemple du génie chimique", Sciences de la société 49, 2000, 63-82.
Rapport de Recherche
- 219 -
"Je suis entré comme élève à l'ENSIC en 1942-43 pendant la guerre. À ce moment là le directeur était Maurice Letort et, quand je suis sorti ingénieur, j'ai commencé une thèse de doctorat de chimie physique sous sa direction. Il s'agissait donc d'une thèse de génie phy-sique ; le génie chimique n'existait pas. J'ai fait ma thèse de doctorat de 1949 à 1955. Pendant que j'étais ici Maurice Letort, en tant que directeur, voyageait un peu partout et il a pris conscience du chemical engineering aux États-Unis. Donc, il m'a demandé, à moi qui étais pourtant un homme de chimie physique, de me convertir au génie chimique et de créer le génie chimique. Il m'a donc envoyé aux États-Unis à la fin de ma thèse en 1955 pour voir ce que c'était que le chemical engineering. Simultanément, Maurice Letort a in-vité des professeurs américains ici et, notamment Édouard Piret, qui est venu passer un an ici pour nous faire découvrir le génie chimique ; dans le même temps, il engagea Mon-sieur Gibert, qui était professeur de génie physique, en lui demandant d'enseigner des ba-ses du génie chimique. Donc on peut dire que le génie chimique est apparu à Nancy entre 1955 et 1960, premièrement par la venue de professeurs américains (notamment Piret et d'autres), deuxièmement par la reconversion de Gibert qui s'est mis aux bases et surtout par moi parce qu'il a fallu que je crée, ici à Nancy, le département de génie chimique dans le bâtiment d'à côté".143
Durant l'hiver 1955-1956, Le Goff entreprit donc un voyage de 3 mois aux États-Unis pour découvrir différentes installations universitaires de chemical engineering. Henri Wahl succéda à Letort à la direction de l'ENSIC en 1956 et il parvint à faire créer une maîtrise de conféren-ces en génie chimique pour Le Goff. Autour de lui se constitua progressivement une équipe de recherche qui s'installa provisoirement dans un ancien bâtiment de l'école. En 1958, un premier laboratoire de travaux pratiques y fut constitué et permit aux élèves de l'ENSIC de s'initier à la manipulation de matériels industriels en vraie grandeur. En 1959, Gibert décida de retourner vers la chimie physique et Le Goff le remplaça sur la chaire de génie chimique. L'année suivante fut créée, à l'initiative de Le Goff et de G. Laplace, une semaine de perfec-tionnement en génie chimique destinée aux ingénieurs de l'industrie.144 Cette incursion sur le territoire de la formation continue devait s'avérer fructueuse : en 1962 était créée une section spéciale de génie chimique assurant en un an une formation en génie chimique à des ingé-nieurs déjà titulaires d'un diplôme d'une autre école ; par ailleurs en 1970, l'école se dota d'un organisme spécifique chargé de gérer tous les aspects des enseignements dispensés aux ingé-nieurs de l'industrie dans le cadre de la formation permanente : le Centre de Perfectionnement des Industries Chimiques (le CPIC).145
L'action de Le Goff et de ses collègues déboucha en quelques années sur plusieurs réalisations de premier plan. En 1961, le génie chimique s'installa dans un nouveau bâtiment construit à quelques rues de l'ENSIC, rue Déglin. Dans le même temps, Le Goff travailla à la création d'un laboratoire de recherche en cinétique physique et chimique. En 1962, il pensait que ce laboratoire pourrait s'installer une fois de plus à proximité de l'école, sur un terrain acheté par le CNRS dans la rue Joli Cœur. Cependant, une importante restructuration du tissu universi-taire nancéien était alors en cours. Elle prévoyait notamment que l'ensemble des structures d'enseignement et des laboratoires de la faculté des sciences serait transféré sur un nouveau campus à la périphérie de Nancy, à Vandœuvre-lès-Nancy ainsi qu'à Villers-Lès-Nancy.
143 Birck, Françoise / Rollet, Laurent, "Entretien avec Pierre Le Goff", 15 juillet 2002. 144 La première session regroupa 20 personnes, dont 13 étaient des anciens élèves de l'école. Pour la plupart, les entreprises représentées étaient impliquées dans le Fonctionnement de la Fondation scientifique des industries chimiques : Ugine, Secpia, Solvay, Saint-Gobain, Péchiney, Lever, Onia, Rhône Poulenc, Carbone Lorraine, Progil, etc. Anonyme (ancien élève de l'école ?), "Rapport sur la semaine de perfectionnement en génie chimi-que", octobre 1960, Archives de l'ENSIC. 145 Cette association autonome fut pendant longtemps placée sous la tutelle de Le Goff.
Genèse et Développement du Pôle Scientifique Nancéien
- 220 -
Toute la chimie était concernée par cette réforme que pilotait notamment Henri Wahl, le di-recteur de l'ENSIC. L'idée d'un laboratoire de proximité fut finalement abandonnée et le Cen-tre de Cinétique physique et Chimique s'installa donc en 1964 à Villers-Lès-Nancy.146 Cette restructuration aboutit à une séparation de fait entre l'ENSIC et l'université : la partie génie chimique demeura à Nancy au centre ville, au contact avec les élèves ingénieurs et les parte-naires industriels ; la partie cinétique physique et chimique s'installa en périphérie et se consti-tua autour d'un noyau de chercheurs CNRS n'entretenant que peu de contacts avec l'ensei-gnement. De ce fait, la séparation géographique de ces laboratoires placés sous la responsabi-lité de Le Goff se transposa partiellement dans une distinction entre recherche appliquée et recherche fondamentale.
L'ambition de Le Goff avait été de faire se rejoindre la physico-chimie fondamentale et le génie chimique. Il avait ainsi constitué son laboratoire autour d'équipes de théoriciens et d'équipes de spécialistes du génie chimique. Malgré ses efforts et la bonne volonté manifeste des chercheurs, le rapprochement scientifique ne se fit pas : les chercheurs ne se parlaient pas sur le plan scientifique et ne parvenaient pas à s'entendre sur des sujets ou des objectifs com-muns. Au début des années 1970, l'idée d'une séparation entre les laboratoires du génie chi-mique et le Centre de Cinétique physique et chimique commença à se faire jour. Elle fut fina-lement rendue effective par la création en 1975 du Laboratoire des Sciences du Génie Chimi-que au centre ville de Nancy, qui fut placé sous la direction d'un élève de René Gibert, Jac-ques Villermaux. Le Centre de Cinétique continua pour sa part d'exister sous différentes ap-pellations.147 À partir de ce moment, Le Goff laissa la main à d'autres chercheurs plus jeunes que lui et se concentra sur ses travaux personnels. Il fut associé cependant à l'évolution du génie chimique vers le génie des procédés ainsi que vers le génie des systèmes industriels.148
Comment toutes ces réalisations furent-elles financées ? Il semble que l'école n'eut aucun problème pour trouver des sources de financement. À en juger d'après les souvenirs de Le Goff, l'argent ne constituait pas un problème majeur :
"Moi j'étais jeune maître de conférences. C'était Letort qui avait de l'argent pour créer le génie chimique à Nancy. […] Il y avait Cathala à Toulouse et Letort à Nancy. Ils ont eu de l'argent du gouvernement, je ne sais pas de quel ministère, pour créer l'aspect chemical engineering. Donc ce sont eux qui ont eu de l'argent. Je sais que lorsque j'étais aux États-Unis je n'avais aucun problème. Il n'y avait pas de problème financier. Et de même, au début, lorsque j'ai créé le génie chimique je n'ai jamais rencontré de problème financier. Maurice Letort était là et il nous donnait l'argent tant qu'on voulait".149
De la même manière, lors de la création du Centre de Cinétique Physique et Chimique Le Goff put bénéficier d'une manne financière conséquente et d'une marge de manœuvre appré-ciable. Au début des années 1960, le CNRS souhaitait voir se créer un département de génie chimique et confia un budget à Le Goff. Ayant constaté que de nouvelles bases avaient émer-gé du génie chimique à travers la cinétique physique (transferts de matière, de chaleur et de quantité de mouvement dans les réactions et dans les réacteurs chimiques), il refusa d'aller
146 Pour plus de détails, Centre des Archives Contemporaines de Fontainebleau, F850501, article 57. 147 Il s'appelle maintenant Laboratoire de Chimie Physique et de Microbiologie pour l'Environnement. 148 Il joua ainsi un rôle dans la création de l'École nationale supérieure en Génie des Systèmes industriels. 149 Birck, Françoise / Rollet, Laurent, "Entretien avec Pierre Le Goff", 15 juillet 2002. Comme on a pu le voir, les entrées de Letort dans les instances nationales de la recherche lui donnaient accès à des sources de finance-ment importants.
Rapport de Recherche
- 221 -
dans cette direction et créa, avec cet argent du CNRS le Centre de Cinétique Physique et Chimique.150
B°/ Le génie chimique, un enjeu identitaire pour l'École
L'industrie française regardait le génie chimique avec un intérêt d'autant plus grand que cette dimension était plutôt absente dans les autres écoles d'ingénieurs. Elle avait donc tout intérêt à participer à son financement et à son développement. Les rapports d'activité sur la vie de l'école présentés périodiquement lors des Assemblées Générales de la Fondation scientifique des industries chimiques permettent de suivre pas à pas le développement de cette nouvelle discipline de recherche et d'enseignement. Ainsi, revenant en 1952 sur les réalisations des cinq années précédentes, Letort insistait fortement sur le fait que l'école profitait de la forte culture en mathématiques et en physique de ses élèves [instituée par la réforme Travers], pour instaurer un enseignement cohérent et spécifique de Génie Chimique".151 Son rapport men-tionnait un enseignement spécialisé de physique industrielle fait par Arnu, chef de service à la Compagnie des Forges de Chatillon, Comentry et Neuves-Maisons, et qui proposait des élé-ments d'ouverture au génie chimique. Il évoquait également la création de la maîtrise de conférences de Gibert en 1949 ainsi que la mise en place, l'année suivante, d'exercices d'ap-plication numérique. Il rendait compte enfin des projets de construction d'un hall d'études du génie chimique avec l'ensemble du matériel nécessaire pour la conduite de travaux pratiques sous la responsabilité d'un chef de travaux.152
Dans les rapports des années suivantes, on vit de la même manière apparaître différentes des-criptions de réalisations ou de projet réalisés avec le soutien moral et financier de la Fonda-tion : l'accueil de professeurs étrangers ; le recrutement de Pierre Le Goff, le récit de son voyage aux États-Unis et son action pour la construction du hall du génie chimique ; les diffé-rents projets d'extension des locaux ; les réflexions préliminaires à la création du Centre de Cinétique Physique et Chimique ; la création en 1956 du Centre Universitaire de Coopération Économique et Sociale (le CUCES) et la mise en place d'enseignements sur l'organisation administrative et financière des entreprises ou sur le rôle social de l'ingénieur ; l'introduction des concours ENSI A et B pour le recrutement des élèves ingénieurs ; la création de la se-maine de perfectionnement des industries chimique.
Au final, la Fondation fut associée à une grande part de la vie de l'école jusqu'au milieu des années 1960 et l'ensemble des rapports permet d'ailleurs de constater que son soutien financier ne fut pas négligeable :
1955-1956 1956-1957 1957-1958 1958-1959 1959-1960
Dotation globale 1.250.000 F 1.150.000 F 16.600 NF 22.700 NF
Service de chimie minérale 265.000 F 265.000 F 2.250 NF 1.400 NF
Service de chimie organique 125.000 F 125.000 F 7.000 NF 5.000 NF
Service de chimie physique 360.000 F 360.000 F 5.400 NF 2.800 NF
Services généraux de l'école 500.000 F 400.000 F
Pas de données
5.200 NF 4.900 NF
150 Ibidem. 151 Letort, Maurice, "Rapport sur l'activité de l'école nationale supérieure des industries chimiques de l'Université de Nancy de 1946 à 1951", février 1952, Archives de l'ENSIC, chemise "Fondation scientifique des industries chimiques" (sous-chemise "Assemblées générales"). 152 Ibidem.
Genèse et Développement du Pôle Scientifique Nancéien
- 222 -
Le budget de la Fondation de 1955 à 1960153
Même si la Fondation ne cantonna pas son soutien au seul développement du génie chimique, il n'en demeure pas moins que ce nouveau domaine fut constamment mis en avant dans les relations avec les partenaires industriels de l'école et qu'il constitua pour elle un enjeu identi-taire essentiel dans les années d'après guerre. Soucieuse de répondre aux attentes des milieux industriels, consciente de jouer une carte maîtresse vis-à-vis des autres écoles, la direction de l'ENSIC n'économisa donc pas ses efforts pour installer et faire connaître le génie chimique en France. Nous nous concentrerons simplement sur deux exemples particulièrement repré-sentatifs : (a) la question de la réponse des écoles d'ingénieurs aux besoins de l'industrie chi-mique en ingénieurs en génie chimique ; (b) la rivalité avec l'Institut du Génie Chimique de Toulouse pour le recrutement d'élèves sur les concours ENSI.
En 1956, un article du Figaro suscita de vives réactions de la part du directeur de l'ENSIC, Henri Wahl. La rubrique 'marché du travail' du journal proposait alors un espace donnant la parole aux employeurs qui éprouvaient des difficultés à recruter les spécialistes dont ils avaient besoin. La rubrique du 27 mars se faisait ainsi l'écho des propos de M. Berline, prési-dent directeur général des Filtres Philippe, entreprise fabriquant des matériels de filtration pour l'industrie chimique. Berline faisait état du développement considérable des industries chimiques et dressait le constat d'une incapacité de la France à répondre aux besoins des in-dustriels en ingénieurs et en techniciens du génie chimique :
"Je ne vous apprends pas que les industries chimiques, en général, se développent avec rapidité, qu'il s'agisse de matières plastiques, de chimie nucléaire, de pétrochimie, d'anti-biotiques, etc. Demain, elles seront peut-être les plus importantes de toutes. Or beaucoup d'entreprises chimiques françaises sont obligées pour concevoir et créer leurs usines, de s'adresser à des bureaux d'études étrangers. En Amérique, par exemple, on attribue le suc-cès actuel de l'industrie chimique, en stagnation jusqu'en 1925, aux quelques vingt mille ingénieurs et techniciens du "génie chimique" qui nous font tant défaut ici. […] De même qu'il existe un Institut Supérieur d'Aéronautique, un Institut d'Optique, une École Supé-rieure d'Électricité, qui forment des spécialistes sur la base d'une instruction supérieure étendue, il devrait exister des instituts de génie chimique. […] L'un des plus sûrs moyens d'exporter nos matériels consisterait d'abord à exporter des ingénieurs français du génie chimique".154
Berline estimait les besoins annuels de l'industrie chimique française à 150 cadres supérieurs du génie chimique et 500 cadres subalternes. Il affirmait par ailleurs qu'il n'existait en France aucune école donnant à des cadres supérieurs techniques un enseignement concret leur per-mettant d'acquérir les connaissances particulières mises en pratique dans l'industrie chimique. Il terminait son interview en suggérant de créer à Lyon un établissement de ce type, tout en laissant à d'autres écoles - les écoles supérieures de chimie de Nancy ou de Toulouse et l'école centrale – la possibilité de former également ces ingénieurs. Suites à ces propos qui remet-taient en cause les efforts entrepris depuis plusieurs années, Wahl écrivit au Rédacteur du Figaro pour lui rappeler les efforts entrepris par l'école depuis plusieurs années.155 Quelques
153 Données établies à partir de divers rapports de Letort et de Wahl rédigés pour la Fondation, Archives de l'ENSIC, chemise "Fondation scientifique des industries chimiques" (sous-chemise "Assemblées générales"). 154 Allan, "Un industriel nous déclare : 'Aucune école ne forme les 650 ingénieurs du génie chimique dont l'in-dustrie française a besoin chaque année'", Le Figaro, 27 mars 1956. 155 "Depuis plusieurs années, la direction de l'école nationale supérieure des industries chimiques en la personne de M. le Professeur Letort avec l'appui de MM. Les Directeurs Généraux de l'Enseignement Supérieur Donzelot et Berger, a fait des efforts considérables pour organiser et créer de toutes pièces un enseignement de Génie
Rapport de Recherche
- 223 -
semaines plus tard, il écrivit également à Berline pour rectifier l'information principale de l'article :
"Quoique vous ayez été nommé et que vos soi-disant déclarations étaient entre guille-mets, je n'ai pas pensé un instant que vous ayez pu commettre les erreurs ou inexactitudes que M. Allan vous attribue généreusement. C'est pourquoi ma réponse était adressée au Journal et non à vous-même. Je saisis cependant l'occasion que vous m'offrez pour préci-ser les points suivants : il est difficile d'accepter qu'on proclame dans un journal estimable et généralement bien informé, qu'il faut à la France 650 ingénieurs du Génie Chimique par an. L'Union des Industries chimiques [que présidait probablement Brulfer à cette épo-que], après des enquêtes sérieuses, estime qu'en doublant le nombre actuel des Ingé-nieurs-Chimistes, on pourrait satisfaire tous les besoins prévisibles, c'est-à-dire qu'il fau-drait former par an 600 à 650 Ingénieurs-Chimistes de toutes catégories, au lieu des 300 à 350 diplômés actuels? Nous sommes très loin du chiffre de 650 spécialistes du Génie Chimique. Si la disette actuelle d'Ingénieurs est reconnue unanimement, pour y remédier il faut des locaux et du personnel, c'est-à-dire en définitive de l'argent".156
Un autre exemple vient mettre en évidence l'extrême sensibilité de la direction de l'ENSIC autour des questions du génie chimique. Comme nous l'avons montré, l'Institut du Génie Chimique de Toulouse fut le premier à s'engager sur la voie du génie chimique. Dans ces conditions, l'ENSIC ne pouvait ignorer l'antécédent toulousain et ses efforts dans cette direc-tion se firent dans un climat d'émulation manifeste, voire de concurrence directe. Du point de vue de l'enseignement, Nancy s'attela en particulier à se forger une identité différente de celle de Toulouse en refusant de jouer uniquement la carte du génie chimique et en faisant de cette discipline une spécialisation parmi d'autres. En janvier 1947 était paru le décret ministériel instituant le statut d'école nationale supérieure d'ingénieurs et l'école nancéienne (alors école supérieure des industries chimiques) était parvenue à obtenir ce statut en mars 1948. En re-vanche, l'Institut du Génie chimique de Toulouse avait dû attendre 1952 pour obtenir l'autori-sation de recruter 10 élèves (en plus du numerus clausus de 10 étudiants accordés en 1949) par concours sur la base du programme de mathématiques spéciales et 1953 pour être assimilé à une ENSI.
Cette assimilation ne suscita apparemment pas l'adhésion de la direction de l'ENSIC. En effet, en 1958-1959, dans un contexte de pénurie d'ingénieurs, les écoles s'engagèrent dans de lon-gues discussions pour tenter d'améliorer les conditions d'accès à l'oral des concours de recru-tement (mise en place de jurys parallèles, simultanéité de certains concours, etc.). Les rivalités entre les écoles créèrent, semble-t-il, de nombreux blocages et le ministère de l'Éducation nationale décida en 1958 de créer une Commission d'études des concours des grandes écoles pour préparer le concours de 1959. C'est dans ce contexte que la direction de l'école nan-céienne rédigea un argumentaire destiné à empêcher l'Institut toulousain de recruter ses étu-diants sur ce type de concours. Ce texte anonyme fut-il diffusé dans les autres ENSI ou au sein de la direction de l'Enseignement supérieur ? Filtra-t-il, sous une forme ou une autre, jusqu'à Toulouse ? Il est difficile de répondre à ces questions. En revanche, la tonalité de ce document ne laisse guère de doutes quant à son origine nancéienne. L'argumentaire commen-
Chimique dont le besoin s'est fait effectivement sentir dans le pays. Depuis 1955, l'ENSIC forme des Ingénieurs spécialisés dans cette branche et cette orientation est suivie avec le plus grand intérêt par les milieux industriels. Je suis donc surpris que M. Berline envisage la création d'une nouvelle école à Lyon et qu'il semble ignorer les efforts tenaces de l'ENSIC. À titre d'information complémentaire, je joins à la présente lettre une brochure sur l'École des Industries Chimiques". Lettre d'Henri Wahl au Rédacteur du Figaro, 28 mars 1956, Archives de l'ENSIC. 156 Lettre d'Henri Wahl à Berline, 24 avril 1956, Archives de l'ENSIC.
Genèse et Développement du Pôle Scientifique Nancéien
- 224 -
çait par opérer une distinction entre deux grandes familles d'écoles d'ingénieurs. D'une part, les grandes écoles, d'où sortent des ingénieurs de formation générale pour les grandes bran-ches de l'industrie française (ingénieurs des Mines, ingénieurs des Ponts-et-Chaussées, ingé-nieurs des industries chimiques, etc.) et recrutant soit en classe de taupe, soit dans les classes d'ENSI A ou B. D'autre part, les écoles plus spécialisées (École de Brasserie-Malterie à Nan-cy, Institut d'Optique à Paris, etc.) ou certains instituts créés par les facultés des sciences (ins-titut de radiotechnique, institut d'électromécanique, etc.) ne recrutant pas par des concours communs à ceux des écoles de la première famille. Sur la base de cette distinction, la stratégie des auteurs de ce texte était de montrer que l'Institut du Génie chimique de Toulouse apparte-nait à la seconde famille et non à la première.
"2° Pour prouver l'assertion précédente, c'est-à-dire que l'Institut du Génie Chimique de Toulouse est vraiment une École de spécialisation, il suffit de comparer les emplois du temps et les programmes de cet Institut à celui de l'École nationale supérieure des Indus-tries chimiques de Nancy. À Nancy est réalisé un juste équilibre entre les différents as-pects de l'art de l'ingénieur dans l'industrie chimique à savoir : la physique, la chimie, les relations humaines et la technologie. Le Génie Chimique proprement dit n'occupe pas plus de 20 à 30 % de l'emploi du temps total. La majeure partie du temps étant réservée à l'enseignement des sciences fondamentales. Au contraire à Toulouse, l'enseignement de la chimie est réduit à son minimum, les élèves ne peuvent d'ailleurs pas préparer la Licence ès Sciences pendant leur scolarité puisque notamment les certificats de Chimie Minérale et de Chimie Organique ne figurent pas au programme. Par contre, les enseignements de technologie, de dessin industriel, de calcul graphique et toutes activités propres à un Bu-reau d'Études sont fortement développés.
3° En toute rigueur, l'Institut du Génie Chimique de Toulouse n'est pas une École Natio-nale Supérieure d'Ingénieurs et n'est même pas assimilée à ce niveau. Il ne serait donc pas légal qu'elle [sic] soit mise sur le même plan du point de vue recrutement. Si l'on admet-tait cette exception, cela constituerait un précédent grave car on ne pourrait pas refuser la même faveur aux nombreuses autres Écoles qui poseraient leurs candidatures l'année pro-chaine".157
Le cœur de l'argumentation reposait sur la prise en considération du nombre d'heures consa-crées à l'enseignement du génie chimique ainsi que sur les matières enseignées. L'ENSIC tenait nettement à mettre en avant son statut d'école généraliste et son souci d'un recrutement élitiste. De plus, fait particulièrement marquant, elle semblait implicitement vouloir tourner le dos à son ancien statut d'Institut de la Faculté des sciences de Nancy et valoriser le statut plus dynamique d'École Nationale Supérieure. L'objectif de l'école était nettement de défendre son rang dans le paysage de plus en plus concurrentiel des écoles d'ingénieurs. Cette stratégie de défense ne fut d'ailleurs pas uniquement réservée aux formations concurrentes éloignées ap-partenant à d'autres pôles scientifiques. Quelques années plus tard, une mobilisation sembla-ble se fit au sein des écoles d'ingénieurs du pôle scientifique nancéien contre l'Institut des Sciences de l'Ingénieur de Nancy (aujourd'hui École Supérieur des Sciences et Technologies de l'Ingénieur de Nancy). Créée en 1960, cette école s'inscrivait dans la continuité d'un vaste mouvement de modernisation des formations d'ingénieurs qui avait été notamment initié par la fondation de l'INSA de Lyon. L'ISIN se voulait une école de spécialisation accolée à la Faculté des sciences de Nancy et se fixait pour objectif de former en quatre ans des ingénieurs spécialisés en mécanique, électricité et chimie. Cependant, il n'était pas question que cette nouvelle école empiète sur un terrain conquis de haute lutte par les autres écoles nancéiennes et notamment par l'ENSIC. C'est pour cette raison qu'en 1965, au moment de la sortie de la
157 Document anonyme, "Arguments à développer pour empêcher que l'Institut du Génie Chimique de Toulouse ne recrute sur le concours A commun aux cinq ENSI", 1958 ou 1959, Archives de l'ENSIC.
Rapport de Recherche
- 225 -
seconde promotion, un argumentaire anonyme contre l'ISIN circula au sein de la communauté universitaire nancéienne. L'essentiel des griefs portaient sur le statut des enseignements de chimie :
"Il nous avait été promis formellement que les ingénieurs formés par l'ISIN seraient des 'ingénieurs d'exécution' qui, notamment dans le domaine de la chimie seraient spécialisés pour diriger des laboratoires d'analyse et de contrôle industriels, postes qui ne sont habi-tuellement pas occupés par les ingénieurs issus de l'ENS des industries chimiques. Or, l'étude du programme d'enseignement de la chimie à l'ISIN, tel qu'il vient de nous être soumis par son Directeur, ne correspond absolument pas aux promesses. Aucun dévelop-pement particulier n'est consacré ni à l'analyse, ni au contrôle, ni à la technologie. Bien au contraire, l'accent est mis assez souvent sur la chimie théorique, le programme se présente comme un plagiat complet et raccourci du programme donné à l'ENS des Industries Chi-miques. Étant donné cette superposition complète des programmes, il serait totalement impossible d'envisager que des élèves issus de l'ISIN rentrent ensuite en 2° ou en 3° an-née de l'ENSIC pour s'y perfectionner, contrairement aux projets prévus initialement".158
L'argumentaire consistait à mettre en évidence le statut inférieur de l'ISIN (école de 'super techniciens') et proposait plusieurs solutions pour remédier à cette situation de concurrence : (1) respecter les conditions initiales du projet pédagogique,159 (2) supprimer l'ISIN, (3) ratta-cher complètement l'ISIN à la Direction de l'Enseignement technique, (4) créer une nouvelle École Nationale Supérieure à Nancy, (5) maintenir un status quo sur l'organisation adminis-trative de l'ISIN mais en développant des spécialisations qui ne fassent pas double emploi avec celles existantes à Nancy (génie civil, hydraulique, textile, matière plastiques, etc.). C'est manifestement la cinquième option qui s'imposa ; l'ISIN abandonna finalement toute spéciali-sation en chimie pour jouer la carte de l'informatique en ouvrant une filière cybernétique (il fut l'une des premières écoles françaises à se doter d'un ordinateur, en 1963).160
158 Document anonyme ("Par MM. X, Y, Z …, Professeurs à la faculté des sciences), Éléments pouvant consti-tuant un rapport qui pourrait être intitulé 'Sur l'abus de confiance que constitue l'orientation générale donnée actuellement à l'ISIN et sur les moyens d'y remédier, 1965 ou 1966, Archives de l'ENSIC. À l'origine, en 1960, l'école s'appelait Institut des Spécialités Industrielles de Nancy et elle ne prit le nom d'Institut des Sciences de l'Ingénieur de Nancy que l'année suivante. Cependant, dès sa création, l'ISIN fut confronté à des résistances très fortes des écoles nancéiennes, et notamment des ENSI. 159 L'ISIN avait été créé dans le but de former des ingénieurs de fabrication et d'exécution. Il était prévu qu'il délivre des diplômes d'ingénieurs praticiens en mécanique, électronique, électrotechnique et en chimie. Ces deux dernières disciplines étaient depuis longtemps les domaines réservés de l'ENSEM et de l'ENSIC. 160 Mounier-Kuhn, "L’enseignement supérieur, la recherche mathématique et la construction de calculateurs en France (1920-1970)". In Birck & Grelon (Eds), Des ingénieurs pour la Lorraine 19ème-20ème siècles. Metz, Édi-tions Serpenoise, 1998, 251-286.
Genèse et Développement du Pôle Scientifique Nancéien
- 226 -
Campagne de publicité pour l'ENSIC dans l'Est Républicain (avril 1961)161
Un numéro spécial de l' Est républicain (26 avril 1961)
En 1961, l'ENSIC finança un supplément gratuit de quatre pages de l'Est républicain. Réalisée par les élèves de l'école, cette édition spéciale célébrait le dynamisme de l'école et offrait une tribune à la direction pour présenter les évolutions récentes en matière d'enseignement et de recherche, et no-tamment le développement de l'enseignement du génie chimique. Dans un court éditorial intitulé "Qu'est-ce qu'une école ?", le président des élèves, Jean-Pierre Desorbay insistait sur le caractère de nouveauté que représentait le statut d'école nationale supérieure et sur le rôle moteur joué par l'EN-SIC dans le paysage des écoles d'ingénieurs : "Que s'est-il au juste passé le jour où, sur les murs de l'ancien institut chimique, une plaque fut apposée mentionnant "École Nationale Supérieure des Industries Chimiques" ? Sans doute rien, tant il est vrai qu'elle ne faisait que sanctionner un état de fait. Mais alors qu'est-ce qu'une école ? […] Il pourrait sembler que le statut original de notre école – qui fut repris par la suite par toutes les écoles nationales supérieures d'ingénieurs – caractérisé par l'absence d'un cadre trop rigide afin de permettre des contacts étroits avec la faculté des sciences, exclue la notion d'esprit d'école. Il n'a fait que le rénover. Loin de le détruire, il a fait des élèves et anciens élèves les soutiens et le véritable agent moteur de cet esprit tout en permettant d'éviter les excès de traditionalisme que l'on lui reproche parfois".162 D'autres élèves se faisaient l'écho de l'ouverture des formations à l'ENSIC à travers un compte-rendu du voyage de la promotion 1960 en Afrique (Jean-Louis Rivail), un long article sur les activités du club d'astronomie du Chimique (Jacques Villermaux) ou un exposé sur le développement des qualités humaines.163 Cependant, au-delà de l'espace réservé aux élèves ou à la publicité (notamment pour la
161 Supplément gratuit au numéro 24817 de l'Est républicain du 26 avril 1961, édition spéciale réalisée par les élèves de l'ENSIC. 162 Ibidem, p. 1. 163 L'auteur (anonyme) de ce texte donnait dans l'humour potache à propos des qualités humaines cultivées par la formation ENSIC : "Contrairement à ce que pense le vulgaire, l'élève ingénieur ENSIC est souvent un indivi-du triste, sérieux, voire morose, davantage travailleur par routine et manque d'imagination que par pure nécessité et, pour le distraire, ses professeurs doivent faire preuve de beaucoup d'imagination. Disons, à titre d'exemple, que la direction de l'école, qui préfère avant tout former des 'hommes au sens le plus noble du terme', plutôt que des savants ou des intellectuels, 'invite' ces mêmes élèves à assister à des conférences distrayantes et intéressan-tes où sont traités avec une maestria éblouissante les sujets les plus variés, parmi lesquels on relève notamment 'la psychologie de cet être que l'on appelle l'ouvrier'. Or les 'invitations' émanant de la direction doivent être considérées dans les meilleurs des cas comme des ordres à suivre scrupuleusement, sous peine de représailles ad hoc. […] Et le chimiste apprend que : 'Non ! Non ! Messieurs ! L'ouvrier n'est pas une bête de somme…'" No-
Rapport de Recherche
- 227 -
Société Progil de Maurice Brulfer), l'essentiel de ce numéro spécial était réservé à la présentation de l'évolution récente de l'école, de sa contribution au secteur industriel (un article de Wahl sur l'ENSIC et le développement des industries chimiques) ainsi qu'à la promotion du génie chimique. B. H. Sanders (Président Directeur Général de la société Ionics), proposait ainsi un long article sur "La part de l'industrie chimique dans l'étude et la fabrication de mélanges propulseurs". Sir Christopher Hinton (de l'Autorité britannique de l'énergie atomique) insistait sur "Le rôle de l'ingénieur du génie chimique comme liaison entre la recherche et la construction d'usines". Pierre Le Goff décrivait quant à lui en détail les procédures d'enseignement du génie chimique à Nancy. Enfin, une place importante était accordée à l'ouverture des formations sur le monde économique et industriel, notamment l'organisa-tion des stages ou la préparation à l'administration des entreprises dans la formation des ingénieurs. Le génie chimique devenait ainsi un vecteur de communication auprès du grand public et un outil de construction de l'identité de l'école. Dans ce numéro spécial, Henri Wahl se tournait volontiers vers l'avenir et évoquait le nouvel essor de l'école. Après la crise des années 1930, après les difficultés de redémarrage en 1946, l'ENSIC pou-vait selon lui envisager son futur avec optimisme, tant du point de vue de son recrutement que du point de vue de ses activités de recherche ou de ses partenariats industriels : "Le prestige dont jouit l'ENSIC aussi bien dans l'université que dans les milieux de l'industrie, attire vers elle de nombreux candidats. Pour une trentaine de places mises au concours chaque année, le nombre de postulants ayant effectué la totalité des épreuves écrites est passée de 490 en 1957 à 718 en 1958, 1.183 en 1959 et 1.672 en 1.960. Aussi est-il dans les intentions de la direction de l'École d'augmenter notam-ment le nombre des admissions dans un proche avenir en fonction, d'une part de l'afflux des candida-tures, et d'autre part des besoins sans cesse croissants des industries chimiques. C'est pourquoi un vaste plan d'extension de l'École a été décidé. Bientôt de nouveaux bâtiments s'élèveront sur l'em-placement de l'ancienne caserne Hugo, entre les deux vieilles portes de la Craffe et de la Citadelle, au cœur même de la faculté des sciences et à proximité de l'ENSEM. […] Ainsi, dotée de bâtiments spacieux, équipée de laboratoires et de services modernes, l'ENSIC, toujours à l'avant-garde de l'enseignement scientifique, pourra poursuivre plus efficacement encore, sa mission de formation des cadres supérieurs de l'industrie chimique".164
VI°/ Conclusion Au début des années 1960, l'école avait donc réussi à consolider son statut et à moderniser ses pratiques d'enseignement et de recherche. Par son soutien financier et par ses réseaux, la Fon-dation scientifique des industries chimiques avait apporté un support non négligeable à cette évolution. Au cours des années 1960 et 1970, l'ENSIC va s'engager dans d'autres projets de grande envergure : la création d'un pôle de recherche en génie chimique (fondation du Centre de Cinétique Physique et Chimique, qui fut l'un des premiers laboratoires propres du CNRS en province), la séparation géographique entre l'école et la faculté des sciences (création d'un campus scientifique à Vandœuvre-lès-Nancy), la participation à la création de l'Institut Natio-nal Polytechnique de Lorraine, la création du Laboratoire des Sciences du Génie Chimique, etc. La Fondation joue encore sa part dans toutes ces évolutions, probablement jusqu'aux années 1980, période à laquelle elle fut dissoute par la direction de l'ENSIC.
Certes, étudier dans le détail la genèse et le fonctionnement de la Fondation scientifique des Industries chimiques, n'épuise pas le sujet des relations entre l'ENSIC et le monde industriel. Pour être complète, l'analyse devrait porter sur la composition et le fonctionnement des conseils d'administration et de perfectionnement, sur l'organisation des stages industriels, sur les partenariats entre l'industrie chimique et les laboratoires de recherche de l'école. Il faudrait également s'intéresser précisément aux carrières des ingénieurs formés à l'ENSIC et identifier précisément les acteurs industriels qui s'associèrent à son développement. Il faudrait enfin parvenir à dégager l'arrière-plan politique des épisodes qui jalonnent l'histoire de l'école, comme on l'a fait pour la période de l'Occupation (et notamment identifier le positionnement politique des acteurs impliqués dans ces événements).
tons que Jacques Villermaux et Jean-Louis Rivail devaient jouer au cours de leur carrière un rôle moteur dans le développement du pôle chimique nancéien. 164 Ibidem, p. 4.
Genèse et Développement du Pôle Scientifique Nancéien
- 228 -
Quoi qu'il en soit de ses limites, ce travail permet cependant de mettre en évidence une cer-taine forme d'asymétrie entre le monde universitaire – représenté par l'ENSIC – et le monde industriel – représenté par les entreprises souscrivant à la Fondation. Les discours de célébra-tion insistent souvent sur les relations historiques entre la Faculté des Sciences de Nancy et le tissu industriel local, relations qui débouchèrent d'abord sur l'émergence d'enseignements de sciences appliquées puis sur la création d'instituts techniques. Ces discours se plaisent à rap-peler le rôle joué, avant la Première Guerre mondiale, par le monde industriel dans le déve-loppement du pôle scientifique nancéien, le modèle étant celui du groupe Solvay, qui accorda d'importantes subventions à l'institut chimique et à l'institut électrotechnique. Cependant, une analyse historique des premières années d'existence des instituts permet de constater que les interactions entre les milieux scientifiques et l'environnement industriel local furent loin d'être évidentes. Sans l'action volontariste d'universitaires bénéficiant de forts ancrages politiques (notamment Bichat), on peut raisonnablement supposer que l'université nancéienne n'aurait pas connu un développement aussi important. La création des instituts techniques fut moins le résultat d'une demande économique et industrielle que d'une mobilisation de l'université et de ses acteurs en direction des sciences appliquées.165 L'entrée en scène du monde industriel dans le paysage universitaire nancéien fut relativement tardive, peu spontanée et, finalement, sans grand rapport avec une demande spécifique en termes de recrutement d'ingénieurs.166 L'his-toire de la Fondation scientifique des Industries chimiques semble confirmer ce constat d'une asymétrie entre l'école et l'industrie. En effet, si la création de l'association fut bien initiée par des acteurs du monde industriel (Brulfer et Aubertin), il n'en demeure pas moins que celle-ci fut une émanation de l'école elle-même et le résultat d'une coalition d'intérêts de l'Association des Anciens et de la direction. Maurice Letort constitue un cas exemplaire de l'émergence d'une nouvelle figure du scientifique : un scientifique évoluant entre le monde universitaire et le monde industriel, qui mobilise des réseaux complexes et qui, surtout, tente d'anticiper les attentes du secteur économique (voire de les susciter).
Enfin, même si la rhétorique des écoles d'ingénieurs concernant leurs relations avec le monde industriel semble quasiment intemporelle, force est de constater qu'elle prend des significa-tions radicalement différentes suivant les contextes historiques. Rien de commun, en effet, entre la situation de Supélec en 2004 et la situation de l'ESIC en 1943. Cette étude tend donc à montrer, à travers un cas concret, l'extrême complexité des interrelations entre ces deux mon-des.
VII°/ Bibliographies
A°/ Références utilisées
Allan, Gilbert, "Un industriel nous déclare : 'Aucune école ne forme les 650 ingénieurs du génie chimique dont l'industrie française a besoin chaque année'", Le Figaro, 27 mars 1956,
Aubry, Jacques, "L'institut Chimique de Nancy et l'École Supérieure des Industries Chimiques de 1887 à 1946". In ENSIC (Ed.), Centenaire de l'ICN-ENSIC 1887-1987, Historique de
165 Cf. Birck F., Grelon A. "La Lorraine et ses enseignements techniques supérieurs", in Birck F., Grelon A., des ingénieurs pour la Lorraine, 19ème-20ème siècles, Metz, Éditions Serpenoise, 1998, pp. 23-25. 166 Grand groupe international, Solvay n'avait probablement pas d'attente particulière vis-à-vis des formations d'ingénieurs nancéiennes et son soutien financier à l'Université de Nancy releva, dans un premier temps, d'une politique de 'communication' (l'entreprise souffrant de sa qualité d'entreprise étrangère) ; puis, dans la première décennie du 20è siècle, de la politique de mécénat scientifique de Solvay lui-même (on citera en exemple les fameux congrès scientifiques Solvay).
Rapport de Recherche
- 229 -
l'Ecole. Ouvrage contenant des notices historiques P. Barral et J.-L. Greffe. Nancy, Institut National Polytechnique de Lorraine, 1987, 13-63.
Barjot, Dominique, "Introduction". In Joly, Hervé (Ed.), Les comités d'organisation et l'éco-nomie dirigée du régime de Vichy (actes du Colloque Les Entreprises Françaises sous l'Oc-cupation). Caen, Centre de Recherche d'Histoire Quantitative, 2003, 7-20.
Bastick, Jack, "Eloge de Pierre Donzelot, allocution de M. Jack Bastick, Directeur de l'Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques de Nancy". In ENSIC (Ed.), Hommage à Pierre Donzelot. Nancy, ENSIC, 1966, 11-13.
Birck, Françoise, "Des instituts annexes de facultés aux écoles nationales supérieures d'ingé-nieurs, à propos de trois écoles nancéiennes". In Birck, Françoise & Grelon, André (Eds), Des ingénieurs pour la Lorraine 19ème-20ème siècles. Metz, Éditions Serpenoise, 1998, 143-213.
Breysse, Jacques, Du génie chimique au génie des procédés : émergence en France d'une science pour l'ingénieur (1947-1991) - Mémoire de DEA (non publié). Paris, CNAM - Centre d'Histoire des Techniques, 2004.
Coeuret, François, "Ingénieur-chimiste ou ingénieur chimiste ?" L'actualité chimique, 2003 (juin), 30-36.
Collectif, "Pour notre enseignement technique supérieur", Revue internationale de l'ensei-gnement 72, 1918, 124-134.
De Rochebrune, Renaud & Hazera, Jean-Claude, Les patrons sous l'occupation. Paris,
Éditions Odile Jacob, 1997.
Detrez, Claude, "L'évolution de l'École Nationale Supérieure de Chimie de Nancy vers le génie chimique". In Birck, Françoise & Grelon, André (Eds), Des ingénieurs pour la Lor-raine, XIXè-XXè siècles. Metz, Éditions Serpenoise, 1998, 239-249.
Grelon, André, "La question des besoins en ingénieurs de l'économie française. Essai de repé-rage historique (première partie)", Technologies, idéologies, pratiques 6 & 7 (1 & 2), 1987, 4-24.
Grelon, André (Dir.), Les ingénieurs de la crise, titre et profession entre les deux guerres. Paris, Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1986.
Grossetti, Michel & Detrez, Claude, Le Génie Chimique en France : la difficile genèse d'une science appliquée (texte non publié). Congrès de l'European Association for the Study of Science and Technology, Lisbonne, 1998.
Grossetti, Michel & Detrez, Claude, "Sciences d'ingénieurs et sciences pour l'ingénieur : l'exemple du génie chimique", Sciences de la société 49, 2000, 63-82.
Grossetti, Michel, Grelon, André, Birck, Françoise et al., Villes et institutions scientifiques (Rapport pour le PIR-Villes), CNRS, 1996.
Joly, Hervé (Ed.) Les Comités d'Organisation et l'Économie Dirigée du Régime de Vichy, Actes du Colloque International, 3-4 avril 2003. Caen, Centre de Recherche d'Histoire Com-parative, 2004.
Lacroix-Riz, Annie, Industriels et banquiers sous l'occupation - La collaboration économique avec le Reich et Vichy. Paris, Armand Colin, 1999.
Lacroix-Riz, Annie, "Les comités d'organisation et l'Allemagne : tentative d'évaluation". In Joly, Hervé (Ed.), Les comités d'organisation et l'économie dirigée du régime de Vichy (actes
Genèse et Développement du Pôle Scientifique Nancéien
- 230 -
du Colloque Les Entreprises Françaises sous l'Occupation). Caen, Centre de Recherche d'Histoire Quantitative, 2003, 50-62.
Le Goff, Pierre, "Qu'est-ce que le génie chimique ?" Association amicale des anciens élèves de l'École Nationale Supérieure des Industries Chimiques 66, 1972, 11-22.
Letort, Maurice, "Hommage à Albin Haller", Bulletin de la Société Chimique de France 17, 1950, 950.
Letort, Maurice, "Eloge de Pierre Donzelot, allocution de M. Jack Bastick, Membre de l'Aca-démie des Sciences, Directeur Honoraire de l'Ecole Nationale Supérieure des Industries Chi-miques de Nancy". In ENSIC (Ed.), Hommage à Pierre Donzelot. Nancy, ENSIC, 1966, 27-39.
Little, Arthur D., Report of Committee on Chemical Engineering Education of the American Institute of Chemical Engineers, 1922.
Mounier-Kuhn, Pierre-Éric, "L'enseignement supérieur, la recherche mathématique et la cons-truction de calculateurs en France (1920-1970)". In Birck, Françoise & Grelon, André (Eds), Des ingénieurs pour la Lorraine 19ème-20ème siècles. Metz, Éditions Serpenoise, 1998, 251-286.
Petit, Paul, "L'œuvre industrielle de la Faculté des Sciences de Nancy", Revue bleue, 1925,
Piret, E.-L., "Qu'est-ce que le génie chimique ?" Chimie et industrie 66 (2), 1951,
Vinen, Richard, Bourgeois Politics in France 1945-1951. Cambridge, Cambridge University Press, 2002.
Walker, W. H., Lewis, W. K. & MacAdams, W. H., Principles of Chemical Engineering. New-York, Mac Graw Hill, 1923.
Weber, H.C., "The Improbable Achievement, Chemical Engineering at the MIT". In Furter, William (Ed.), History of Chemical Engineering. Washington, American Chemical Society, 1980, 76-95.
Williams, G. C. & Vivian, J. E., "Pioneers in Chemical Engineering at MIT". In Furter, Wil-liam (Ed.), History of Chemical Engineering, 1980, 95-105.
B°/ Histoire du génie chimique
Darton, R.C., Prince, R.G.H. & Wood, D. G. (Eds), Chemical Engineering : Visions of the World, Elsevier Science, 2003.
Divall, Colin, "Education for design and production: professional organization, employers, and the study of chemical engineering in British universities, 1922-1976", Technology and Culture 35, 1994, 258-288.
Dodge, B.J., "La profession d'ingénieur du Génie Chimique. Sa conception aux États-Unis", Chimie et industrie 66 (5), 1951,
Donnely, J.F., "Chemical Engineering in England, 1880-1922", Annals of Science 45, 1988, 555-590.
Furter, William (Ed.) History of Chemical Engineering. Washington, American Chemical Society, 1980.
Rapport de Recherche
- 231 -
Hougen, Olaf O., "Seven Decades of Chemical Engineering", Chemical Engineering Pro-gress, 1977,
Lécuyer, Christophe, "MIT, Progressive Reform and Industrial Service, 1890-1920", Histori-cal Studies in the Physical Sciences 26 (1), 1995,
Lesch, John (Ed.) The German Chemical Industry in the Twentieth Century, Kluwer, 2000.
Ndiaye, Pap, Du nylon et des bombes. Du Pont de Nemours, le marché et l'État 1910-1960. Paris, Belin, 2001.
Nikolaus, Peppas A., One Hundred Years of Chemical Engineering, from Lewis M. Morton to Present. Dordrecht, Kluwer, 1989.
Scriven, L. E., "On the Emergence and Evolution of Chemical Engineering", Advances in Chemical Engineering 16, 1991,
Travis, A.S., Schroter, H.G., Homburg, E. et al. (Eds), Determinants in the Evolution of the European Chemical industry 1900-1939, New Technologies, Political Frameworks, Markets and Companies, Kluwer, 1998.
Van Antwerpen, F.J., "The Origins of Chemical Engineering". In Furter, William (Ed.), His-tory of Chemical Engineering. Washington, American Chemical Society, 1980, 1-14.
Weber, H.C., "The Improbable Achievement, Chemical Engineering at the MIT". In Furter, William (Ed.), History of Chemical Engineering. Washington, American Chemical Society, 1980, 76-95.
Williams, G. C. & Vivian, J. E., "Pioneers in Chemical Engineering at MIT". In Furter, Wil-liam (Ed.), History of Chemical Engineering, 1980.
C°/ Introduction du génie chimique en France et relations entre Nancy et Toulouse
Bastick, Jack, "Éloge de Pierre Donzelot, allocution de M. Jack Bastick, Directeur de l'École nationale supérieure des Industries chimiques de Nancy". In ENSIC (Ed.), Hommage à Pierre Donzelot. Nancy, ENSIC, 1966, 11-13.
Bastick, Jack, Brulfer, Maurice, Imbs, Paul et al., Hommage à Pierre Donzelot. Nancy, EN-SIC, 1966.
Bauer, Michel & Cohen, Elie, "Politiques d'enseignement et coalitions industrialo-universitaires. L'exemple de deux 'grandes écoles' de chimie, 1882-1976", Revue française de sociologie XXII, 1981, 183-203.
Breysse, Jacques, Du génie chimique au génie des procédés : émergence en France d'une science pour l'ingénieur (1947-1991) - Mémoire de DEA (non publié). Paris, CNAM - Centre d'Histoire des Techniques, 2004.
Cathala, J., "Le laboratoire d'électrochimie de l'Université de Toulouse", Science et industrie (hors série : l'énergie électrique en France), 1935,
Cathala, J., "Le génie chimique", Chemical Engineering Science 1, 1951,
Cathala, J., "L'ingénieur du génie chimique et les besoins de l'industrie", Belgische Chemische Industrie XXII (6), 1957,
Cathala, J., "L'institut du Génie Chimique de Toulouse", Achema-Jahrbuch, 1959-1961,
Genèse et Développement du Pôle Scientifique Nancéien
- 232 -
Charpentier-Morize, M., "La contribution des laboratoires propres à la recherche chimique en France de 1939 à 1973", Cahiers pour l'histoire du CNRS 4, 1989,
Coeuret, François, "Ingénieur-chimiste ou ingénieur chimiste ?" L'actualité chimique, 2003 (juin), 30-36.
Detrez, Claude, "De la chimie industrielle au génie industriel. Quelles conditions pour l'émer-gence des sciences à finalité industrielle ?", Albi, 1997.
Detrez, Claude, "L'évolution de l'École Nationale Supérieure de Chimie de Nancy vers le génie chimique". In Birck, Françoise & Grelon, André (Eds), Des ingénieurs pour la Lor-raine, 19ème-XXè siècles. Metz, Éditions Serpenoise, 1998, 239-249.
Grossetti, Michel & Detrez, Claude, Le Génie Chimique en France : la difficile genèse d'une science appliquée. Congrès de l'European Association for the Study of Science and Techno-logy, Lisbonne, Non publié, 1998.
Grossetti, Michel & Detrez, Claude, "Sciences d'ingénieurs et sciences pour l'ingénieur : l'exemple du génie chimique", Sciences de la société 49, 2000, 63-82.
Guédon, Jean-Claude, "Conceptual and Institutional Obstacles to the Emergence of Unit Op-erations in Europe". In Furter, William (Ed.), History of Chemical Engineering. Washington, American Chemical Society, 1980, 43-75.
Le Roux, M., "Recherche et développement, génie chimique et bureaux d'études en France entre 1940 et 1948". In Merger, M. & Barjot, D. (Eds), Les entreprises et leurs réseaux : hommes, capitaux, techniques et pouvoirs, 19ème-20ème siècles, Mélanges en l'honneur de F. Caron. Paris, Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 1998, 733-747.
Le Goff, Pierre, "Qu'est-ce que le génie chimique ?", Association amicale des anciens élèves de l'école nationale supérieure des industries chimiques 66, 1972, 11-22.
Letort, Maurice, "Le génie chimique", Chimie et industrie 86 (3), 1961, 53-63.
Letort, Maurice, "Éloge de Pierre Donzelot, allocution de M. Jack Bastick, Membre de l'Aca-démie des sciences, Directeur Honoraire de l'École nationale supérieure des Industries chimi-ques de Nancy". In ENSIC (Ed.), Hommage à Pierre Donzelot. Nancy, ENSIC, 1966, 27-39.